« Au-delà de l'effondrement, 43 : La folle semence d'Anthony Burgess | Page d'accueil | Don DeLillo et l’expérience hérétique de la littérature : une lecture de L’étoile de Ratner, par Gregory Mion »
14/03/2013
Le Grand Coucher de Guy Dupré

Crédits photographiques : Richard Sennott (The Star Tribune / Associated Press).
 Guy Dupré dans la Zone.
Guy Dupré dans la Zone.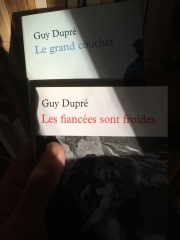 À propos de Guy Dupré, Le Grand Coucher (Éditions de La Table Ronde, coll. La petite vermillon, 2013. La première édition date de 1981).
À propos de Guy Dupré, Le Grand Coucher (Éditions de La Table Ronde, coll. La petite vermillon, 2013. La première édition date de 1981).LRSP (livre reçu en service de presse).
Signalons encore, à l'initiative des Éditions Bartillat, la réédition des Manœuvres d'automne.
De Guy Dupré, nous pourrions écrire, comme Léon Blum à propos de Maurice Barrès, qu'il «est arrivé parmi nous comme un étranger».
Il nous quittera, je le crains, avec le même statut peu enviable, qui le prémunit du moins de la familiarité (et du mépris, plus ou moins voilé) que l'on jette aux filles de joie et aux écrivants faisant les délices des journalistes, lorsqu'ils ne partagent pas, comme des putains, la couche voire le caniveau où s'allongent ces derniers, pour un sommeil qui n'est hélas pas définitif.
Lire un des livres de ce grand écrivain, c'est être convié à une cérémonie aussi banale que secrète et qui, d'ici peu, demandera à ses célébrants de s'entourer d'une prudence de conspirateur.
Ce n'est d'ailleurs pas le mystérieux colonel de Sainte-Rose qui nous servira de hiérophante, ou même, simplement, d'initiateur, mais Guy Dupré lui-même, dernier officiant d'un culte orgiastique et pourtant solitaire, le troublant, le profond onanisme de l'écriture qui, bien que stérile au strict sens biologique du terme, n'en favorise pas moins la naissance d'esprits et même d'âmes plutôt que de corps, selon les vertus invisibles de cette hérédité débarrassée de sa pelure scientifique que nous propose Le Grand Coucher.
Le culte dont je parle est celui de l'écriture qui, chez l'admirable écrivain qu'est Guy Dupré, possède la vertu magique de dénouer tous les nœuds gordiens de l'être, y compris ceux, réputés inextricables, qui emprisonnent le temps et les personnes dans des boucles dont la particularité mystique est qu'elles sont accrochées les unes aux autres et forment ainsi des motifs infinis, que nous n'avons pas assez d'yeux pour voir, dont notre regard semble désormais incapable d'imaginer la complexité. La littérature devient une denrée périssable, parce que nous ne savons plus lire, et, surtout, parce que nous n'éprouvons plus le besoin de lire, non seulement les textes contemporains qui, à de très rares exceptions, ne nous disent absolument rien de l'état de la France et, surtout, de l'état de l'homme français, son immense fatigue, mais aussi les textes anciens, qui nous jettent au visage une grandeur dont nous ne savons plus quoi faire.
Il y avait un christianisme des catacombes, lorsque celui-ci était persécuté. Il y a, il y aura de plus en plus une littérature des catacombes, alors que nul ne persécute celle-ci. C'est tout simplement que l'homme français, peut-être même occidental, n'a plus grand-chose à dire et que, honteux dans les cas les plus nobles, il veut se prémunir du soleil et se calfeutre sous terre, où il rumine sa déchéance comme un démon.
Verra-t-on se créer, comme dans tel célèbre roman de science-fiction, des cénacles secrets où les hommes partagent la mémoire des textes menacés, moins par le feu de la police politique que par la gangrène de l'ennui et du vide ?
Toute initiation consacre l'instant présent pour en conjurer la puissance et, partant, le rapprocher de sa source, passée forcément, invisible aussi mais qu'il s'agit pourtant non seulement de redécouvrir, sous les strates d'oubli et de mensonges, mais surtout de revivifier en lui offrant son âme et son sang, en lui obéissant aussi. L'initiation est un sacrifice qui, en consumant l'offrande, investit de vie et de souffle une dimension propitiatoire qui élargira l'empan de l'homme, étendu d'aval en amont entre le passé nourricier et le futur prolifique, le présent étant le temps de l'enfantement secret, l'athanor où se mélangent les deux fluides.
Ainsi, toute initiation ne peut être, par essence, que contre-révolutionnaire, donner l'apparence de servir un temps présent le plus souvent abhorré qu'il s'agit de renverser, en creusant, sous ses fondations de boue, des galeries où l'eau vivifiante de la mythique origine fera résonner sa déflagration.
C'est Guy Dupré lui-même qui nous présente l'intention qui a été la sienne en écrivant son Grand Coucher : «Un livre écrit avec les «mots de la tribu» ne nous semblait pas mériter l'arbre de la forêt qui lui avait été sacrifié. C'était avant l'érosion des caractères par le simoun audiovisuel et la substitution du «parler petit-blanc» à la langue écrite. S'il nous importait d'étaler, de mettre sur table les cartes biseautées d'une fin de partie – de la fin de «patrie» à quoi fait penser l'histoire de France de 1890 à 1960 –, ce ne pourrait être qu'en soumettant celle-ci à un traitement à la fois chimique et oratoire» (1).
Le temps présent est celui du mépris, voire, de la haine, qu'importe que Guy Dupré cache celle-ci derrière une ironie cinglante, celle du premier de cordée pour celui qui, de la montagne, ne connaît que le tire-fesse des stations de sports d'hiver. Le temps reconquis, non pas passé fossilisé et dont une poignée d'officiants répète l'antienne délavée, est celui d'un futur qui n'est pas synonyme de crainte ou d'horreur, parce qu'il témoigne d'une confiance retrouvée dans la destinée. Le temps retrouvé de Guy Dupré, disons-le expéditivement, est celui de ce que nous pourrions nommer le Grand Réveil, le pouvoir de l'écrivain étant de redonner un peu de vie aux membres gourds de ces Dormants dont la très douce et chuchotante mélopée, que plus personne ne semble désormais capable de pouvoir écouter ni même entendre, charrie des mondes, bâtit des empires et, à l'occasion, édifie de beaux livres qui bruissent de paroles connues ou inconnues comme un temple baudelairien.
Ainsi, la prose du monde, sa tristesse devenue mutisme selon Walter Benjamin, ne peut être disjointe de notre propre langage, de notre persévérance à dire et vouloir dire par quels étranges chemins, heureusement inconnus des badauds, se découvrent les seules vérités qui importent, celles qui, en nous intimant l'ordre de nous relever, nous dressent au-dessus de l'encolure des bœufs.
Dans cette guerre contre la stupidité des langues avariées, viciées comme je l'ai écrit, le temps est un allié ou plutôt, certains de ses plus nobles représentants, les morts bien sûr, dont l'importance nous est signalée par une exergue extraite de Monsieur Ouine, un roman dans lequel les morts ne cessent de hanter la conscience, les gestes et les paroles des vivants, un roman dans lequel le personnage principal, bien que vivant, semble mort de toute éternité. Influence directe ou souvenir d'une scène marquante, Guy Dupré répète l'étrange saisissement, derrière lequel nous pouvons imaginer bien des choses (qui nous seront hélas révélées dans le roman de Dupré), qui fige le jeune Steeny dans la demeure de Ouine, dont l'enflure (je ne me souviens plus s'il s'agit d'hydropisie) est elle-même rappelée par Dupré à propos de Georges Pompidou : «Interloqué par mon regard mi-clos qui semblait le rapetisser, l'éloigner dans le temps, le réduire aux dimensions d'un passant vu du haut d'une des tours dont il se faisait le zélateur, il s'était levé pour s'approcher de moi et je voyais sur son visage en gros plan l'irritation le disputer à l'étonnement, quand je me suis senti aspirer par les espaces blancs séparant les aiguilles sur les cadrans des heures» (p. 249).
Ainsi, comme Guy Dupré a raison de le rappeler : «Pas de silence intérieur que n'instruisît la soumission aux voix qui crient dans les ossuaires» (p. 19). Ces voix, est-il besoin de préciser qu'elles ne nous délivrent pas toutes un message de simple fraternité ? «Ils finiront bien par l'avoir, leur génération, et Dieu sait ce qu'elle sera», nous avertit Bernanos. Il n'y a pas, du moins à notre connaissance, de présence maligne directement évoquée dans l'œuvre de Guy Dupré, qui reste pourtant, bien davantage que Julien Gracq auquel on le compare sottement, l'écrivain du qui va là ?, comme si, toujours, derrière chacune de ses lignes, fût-elle préoccupée, à la Gabriel Matzneff, de sexe et de bonne chère, se dessinait, pour qui sait voir, une ombre que l'on devine ne pas être le seul effet de la lumière du grand jour.
Les morts, alliés ou ennemis, ne sont pas les seuls intercesseurs, lorsqu'il s'agit de dynamiter le temps pourri «où nous fait barboter notre concupiscence de petits-fils assis entre deux chaises» (p. 22). Dans cette tâche qui pourrait être considérée comme une forme de lazarisme métaphorique, les femmes se révèlent de très précieuses aides, puisqu'il s'agit, pour l'écrivain admirant Proust, de déjouer la sotte linéarité du temps, afin de reconquérir «une autre mémoire», «un intervalle qui nous [ferait] vivre par âges, par poitrines de femmes interposées», afin de nous faire «franchir le gué» et surtout franchir «la marge qui sépare la durée pastiche, la durée postiche, du temps vécu» (p. 23) en vérité, en pleine conscience, le temps retrouvé où les morts, avec les vivants, prennent langue et même communauté de destin, cette belle expression, si mal employée par nos technocrates, développant ce qui gît sous le nom de nation.
L'intensité de l'écriture de Guy Dupré, sa délicatesse d'un autre âge, sa respiration haletante qui exulte souvent en longues incandescences pétrifiées comme la fulgurite indique le parcours de la foudre ayant frappé la terre, ou, pour le dire en un mot, sa classe, lui viennent sans aucun doute des morts, d'un long apprentissage de leur hiératique raideur, dont il connaît mieux que nul autre les forces remarquables et les faiblesses inouïes, la langue aussi, plus morte qu'une momie de pharaon et qui pourtant, sous la chair saponifiée par les siècles, cache une beauté enfouie mais vivace, puisqu'il les a apprises de la bouche de ses maîtresses, réelles ou imaginaires.
Lire Guy Dupré, c'est non pas seulement se souvenir d'Edgar Poe, mais aussi, médusés et parfois effrayés, assister à la confession, forcément impudique puisqu'elle s'est détachée des convenances auxquelles obéissent les vivants, de Monsieur Valdemar, préservé de la pourriture à la seule condition, comme dans les fameux contes, de ne jamais s'arrêter de parler. Ainsi, lorsque Guy Dupré mourra – que nous dirions pourtant immortel et riche de milliers d'histoires qui pourraient à bon droit constituer un de ces recueils de souvenirs où les vieux (et moins vieux, le gâtisme n'ayant pas d'âge) messieurs colligent pieusement leurs rognures d'ongle comme s'il s'agissait de débris du Saint Graal -, ce n'est pas seulement un formidable vivant qui nous sera arraché, mais le plus remarquable interprète de la voix des morts qui ne cesseront alors plus d'être inquiets, un peu comme Steeny, écoutant les étranges confessions de l'infirme Guillaume, sent l'atmosphère, pourtant claire, environnée de présences qui, trop tôt et violemment arrachées à la vie, réclament leur dû.
Nous pourrions dès lors caractériser l'écrivain Guy Dupré en affirmant qu'il se sait débiteur (2), du passé, d'une grandeur perdue, celle de feue la France, des morts, des femmes, de ces dernières surtout, mortes et vivantes, et même, craint-on, mort-vivantes, qui vont lui permettre de construire ses textes en les ancrant sur un sol aux fondations profondes, indestructibles, l'arbre magnifique aux frondaisons impressionnantes puisant sa sève dans l'énergie rentrée de tant de morts qui ne voulaient pas quitter la vie et qui réclament sans relâche d'y revenir, de retrouver la chaleur que se donnent les vivants.
Si, dans un ou plusieurs siècles, Guy Dupré est encore lu, il le devra sans doute à la part la plus périssable de la langue, celle qui a été tournée en bouche délicate et tentatrice de femme, celle qui, par définition, est infiniment subtile et labile, et ne peut être enfermée dans aucun livre, fût-il le plus aérien. L'art de Dupré, comme celui du Barbey d'Aurevilly des Diaboliques, comme le notait à propos Julien Gracq, est celui de la conversation, de l'histoire contée au coin du feu, qui effraie et tout à la fois exalte les jeunes forces prometteuses des petits garçons, recroquevillés pour le moment épaule contre épaule, le regard déjà perdu dans les flammes où se dessinent, peut-être, les figures énigmatiques de leur futures actions.
Aérien, Le Grand Coucher ne l'est pas, la tentation de l'angélisme, y compris verbal (ou de ce que Julien Benda appelait le byzantinisme) étant réservée aux petits maîtres ou aux tripoteurs de langage, qui croient incarner leur langue alors qu'ils ne font rien de plus que gratter leur eczéma sémantique en se payant de mots.
Bien au contraire d'un navet chatoyant qui aurait été cultivé hors de terre et que les ménagères de bien plus de cinquante ans se demandent de quelle façon elles parviendront à le cuisiner, Le Grand Coucher sent la terre, l'amour, la femme, y compris dans ses gestes les plus humbles sinon dégradants (bien qu'il n'existe aucun geste dégradant) : digestion, défécation (cf. p. 202), faisandage de chairs devenues blettes, dont Guy Dupré, du moins son personnage, est un grand amateur, lui qui ne s'avoue jamais à court de désir, donc d'appétit : «Combien sous les assauts de l'Impossédé soudain pèse peu la chair où nous avons trempé – à nos acquis charnels victorieusement, vicieusement s'oppose ce qui nous est passé sous le nez devant le bassin !» (pp. 38-9), ce mélange, dont Guy Dupré est l'orfèvre incontestable, de maniérisme spécieux et de gauloiserie franche formant un alliage inimitable, dans le fin grain duquel il cisèle les moments les plus anodins d'une vie qui en contient des milliers d'autres.
C'est là le cri de tout amant véritable, jamais rassasié par celles qu'il a eues, à peine intéressé par celle ou celles qu'il possède, uniquement aiguillé par celles, innombrables, qu'il ne manquera pas d'avoir, croit-il, s'imagine-t-il même quelques secondes avant de rendre l'âme et d'expirer, sur le bord du néant où il redoute de tomber sans coquetterie, pour rejoindre celles qui lui tendent leurs bras de fantômes !
C'est là, dans cette quête acharnée de jeunesse et de jeunesses, la mission de tout amant véritable, non pas l'étreinte offerte, ni même l'amour donné et pourtant, trop souvent, maladroitement refusé, mais la recherche mystique, l'inaccessible vérité poursuivie de corps en corps, d'âme en âme et que, logiquement pour un adorateur du passé, l'écrivain Guy Dupré recherchera dans les corps de femmes devenues vieilles, la quête charnelle aussi bien qu'esthétique et mystique ne pouvant se dégager d'une loi mystérieuse, littéraire bien sûr mais débordant de toutes parts le seul réduit des livres, dite loi de Sainte-Beuve, plusieurs fois évoquée par Guy Dupré, et ainsi définie dans Le Grand Coucher : «Devant cette inconnue il me semblait réentendre le réveille-mémoire dont le bruit est fait du battement des pieds qui nous ont immédiatement précédés dans le temps. Ô jours de notre avant-chair vers quoi nous ramène la chair des passantes dont celle-ci me proposait la charte inoubliée !» (p. 40) (3).
Dynamiter l'imposture du présent en élargissant son enflure jusqu'à l'implosion, c'est lui injecter les sucs corrosifs d'un passé non pas indéfiniment éloigné mais remarquablement proche, à pouvoir presque être revécu, c'est-à-dire touché, reconquis dans la chair recuite dans la marinade de mille et unes désillusions, d'une vieille dame de la Haute redevenue, magiquement, adorable et irrésistible cocotte.
Le passage à l'action, dans ce roman grouillant de demi-soldes cryptiques et de maîtresses aux chairs flasques qui en savent plus, sur l'Histoire réelle de la France, que les agrégés et les historiens translucides, est un «passage à l'ancien», comme Guy Dupré le nomme : «À s'absorber dans le contenu de ces graffiti émouvants comme des épitaphes dont la chair courrait encore, à prélever, isoler l'instant où un couple entre tous a déposé sa petite fiente sur le parapet de la coupole du Sacré-Coeur ou la paroi intérieure de la colonne de Juillet ou de la tour de Montmajour, il vous semblait parfois comme devant ces mandalas bouddhiques dont la contemplation prolongée fait, paraît-il, mourir, qu'à force d'application et en faisant en quelque sorte ventouse, vous réussirez, à travers les méandres de la chair indivise, à isoler, pomper le secret du passage à l'ancien» (p. 47, l'auteur souligne).
Et, si ce passage à l'ancien devait décidément être plus difficile que prévu, s'il devait, justement, être forcé, et cassée la dalle qui le recouvre (cf. p. 129), nul doute que le passé ne saurait alors nous rappeler son incroyable résistance, sa fossilisation, selon l'image qui semble avoir marqué Guy Dupré (puisqu'il l'emploie deux fois) d'un «fœtus calcifié découvert dans l'abdomen d'une femme de soixante ans», et qui ressemble «à une statue découpée dans le marbre avec tous les traits parfaitement dessinés» (p. 56; Guy Dupré cite cette dernière phrase sans en préciser l'auteur).
Mais il faut tout de même, avant qu'elles ne meurent, aimer ces femmes qui ont engrossé le temps, dirait-on, d'enfants cachés, invisibles, bâtards errants qui sont pourtant les vrais acteurs de l'Histoire formidable, qui n'est que fort platement consignée dans les livres savants et décrite, comme un insecte piqué derrière une plaque de verre, au moyen de généalogies jaunies par la sanie du temps.
Il faut les aimer car elles seules préservent «l'intimité amoureuse entre générations» qui «a besoin pour s'épanouir de fiancées veuves et de mères encore virginales» (p. 107), autrement dit d'aberrations, de monstres qui, étymologie oblige, nous montrent, nous indiquent ce que nous devons, en le regardant, comprendre.
Il faut les aimer avant qu'elles ne meurent car elles constituent, seules, le lien unique, en tout cas le plus digne de confiance, avec les hommes qui nous ont précédés, qu'elles ont aimés ou haïs : «J'aimais. J'aimais l'odeur du temps s'exhalant des photos et des penderies des hommes qui nous ont précédés dans la couche des bonnes nôtres» (pp. 60-1, l'auteur souligne).
Elles nous induisent en erreur et ne contribuent pas peu à nous faire confondre le geste véritable avec son déplacement d'air, impalpable ? Qu'importe, puisque c'est effectivement le risque à courir (et parfois Guy Dupré fait plus que le courir, il s'y enfonce, pour nous livrer des gestes, des attitudes ou des paroles surprenants, comme l'épisode, fort drôle, du dentier de Massis, cf. p. 101, ou bien l'agonie d'Henri Mondor, faisant entrer dans sa couche funèbre «quatre jeunes Norvégiennes se relayant par paires pour lui adoucir le passage à l'après-chair», p. 245), qu'importe donc, puisque c'est le risque à courir pour s'enfoncer dans le temps : «Souvent vous n'écoutiez plus, comme si la bouche du narrateur vous eût fait la narration oublier. Irritantes, saintes distractions des femmes qui vous font vérifier de quel blanc battu en neige est faite l'histoire des hommes, et vous aident à rendre à l'écume ce qui appartient à César» (p. 72).
Guy Dupré n'a évidemment pas oublié de quelle hauteur, prodigieuse, Léon Bloy a fulminé ses coruscantes exégèses de l'Histoire invisible, forcément (et férocement) invisible, mais il a adouci la manne destinée au seul intraitable stylite en l'accommodant de délicate façon.
C'est peut-être, aussi, se prémunir contre le risque si courant qui guette le plumitif tout autant que l'écrivain, le bavardage bien sûr, l'épanchement aussi impudique que creux tel que le réalise le genre de la confession, comme Guy Dupré le note avec méchanceté, alors qu'il se trouve à un raout organisé par son éditeur : «Pépinière d'auteurs ratés, la France était aussi la patrie des espions rentrés. Double source de fausses vocations donnant naissance aux nappes souterraines de justiciers délateurs que l'on voyait sourdre et s'étaler sous les occupations et les libérations» (p. 78). Comment mieux résumer la destinée de la France, telle que cette dernière l'a réalisée durant la première moitié du siècle passé, comment mieux stigmatiser ces polygraphes de toutes espèces (pas seulement militaire, ni même journalistique) qui n'écrivent pas réellement, en levant le regard de leur page et en le dirigeant sur l'horizon, métaphorique ou bien réel, mais, comme le remarque Guy Dupré, en écrivant sous eux (titre d'un chapitre du Grand Coucher), selon une image que je ne m'aventurerai pas à expliciter ? : «Ayant tenu la page de l'Histoire verticale, et retombés avec elle du mauvais côté, ils occupaient leur retraite à réécrire» (p. 104).
L'écrivain de race, lui, à la différence de tous ces comploteurs béquillés d'absence de talent mais en revanche équipés d'une remarquable boussole pointant toujours le profit, l'intérêt, le cheval sur qui parier, le maître qu'il faut flatter, est un artisan solitaire obsédé par le polissage d'un unique objet, qui n'est autre que le langage, forcé à dire l'indicible, poli jusqu'à ce qu'il reflète les astres les plus ténus, ceux dont la lumière nous parvient après d'incroyables traversées de vide, comme dans ce passage que d'aucuns jugeront d'un franc mauvais goût : «D'une sensualité fruste, localisée à la seule zone érectile, le petit père - le futur petit père va se contenter d'une de ces filles fleurs séchées comme tombées des pages d'un manuel d'ostéologie, devant qui les bras aussi vous tombent, à considérer leurs salières, leurs éclanches, et une cage thoracique derrière les barreaux desquels semble voleter quelque ménate élevé à Ravensbrück» (p. 131), ou bien comme dans tant de comparaisons et de métaphores héritées, peut-être, de telles images fulgurantes de Breton : «Nous faisions nos premiers pas dans Paris. Sur notre passage se levaient les rencontres comme les épingles au passage de l'aimant» (p. 170).
Sur le passage du solitaire aussi, l'écrivain impeccable, se lèvent les rencontres, et peu nous importe qu'elles aient lieu dans le temps présent ou dans celui, retrouvé, réel, magnifié, de l'écriture, si, comme Sainte-Rose, l'écrivain est celui qui parvient à établir, au sein d'une confrérie spirituelle et secrète, le sens d'une vie entretissée d'influences et d'affinités électives, spirituelles avant que d'être charnelles, et auxquelles la très lente décantation des mots fournira un corps, moins peut-être, un support : «Comme l'air ou l'eau qui ont des flux variables et connaissent des courants et des vents, il semblait que pour lui certains moments pouvaient déborder, se répandre. Un temps cérémoniel où parmi de multiples avènements intérieurs certains se renversaient, cristallisés et pris en masse, au grand jour. On ne pouvait dire qu'il passait son temps; il s'attachait plutôt à le suspendre, à en suspendre les proies dans des sortes de sphères où il vivait en compagnie de ses Couples, de ses Doubles, de ses Saints, pour lui comiquement, capiteusement présents dans leurs émotions et dans leurs actes, comme ces Juifs ashkénazims vivant le long d'une année sans avant ni après, en compagnie de leurs Apôtres, de leurs Patriarches et de leurs Rois» (p. 169).
La réalité se creuse d'une réalité seconde, d'un arrière-monde poétique et symbolique, où il importe de graver la geste essentielle, non pas en effaçant ce qui a déjà été gravé, ou bien, comme l'affirme Guy Dupré, en tentant de se «dégrever du péage», mais bien davantage en glissant ses pas dans les empreintes de pas déjà tracées sur l'«espèce de pont qu'il [Sainte-Rose] eût perpétuellement franchi d'un bord à l'autre» (ibid.), comme un moderne Jacob auquel le songe eût présenté la figure comique d'une échelle surplombant un gouffre, et ne reliant plus la terre au ciel.
C'est bien cette entreprise de reconquête du temps perdu qu'il importe d'accomplir, non point pour se réfugier dans un passé idéalisé je l'ai dit, par exemple celui qui n'aurait point vu la France tomber de sa si haute place pour déchoir dans le caniveau de toutes les compromissions plus ou moins diligentées par les intelligences ennemies (ou simplement intérieures, car seul celui qui se trahit lui-même peut prêter le flanc aux attaques extérieures), mais pour reconquérir le présent, c'est-à-dire lui insuffler une grandeur, l'épaissir d'une peau plus sensible parce que plus profonde, plus irriguée en sang et, comme dit Rimbaud, charriant à grosses veines un «vin de vigueur» qui nous fait désirer le grand large, de plus hautes destinées politiques, donc poétiques, une vie désamarrée de sa pesante cale, désentravée de ses liens les plus insidieux : «Comme dans un rêve dont je ne me serais pas lassé de m'éveiller, je cherchais à lui expliquer ce que j'avais à l'origine trouvé dans certains poèmes, recherché dans certains morceaux, et l'espèce d'hérédité lyrique dont j'aurais aimé dégager les lois plus mystérieuses que les lois de Mendel, car elles échappent aux gènes, se rient des groupes sanguins, bouleversent le jeu des filiations» (p. 171).
Cette «hérédité lyrique», qui transforme les travaux à ridicule prétention scientifique d'un Lombroso en recherche bloyenne (et massignonienne, par voie de conséquence) en et de paternité élective est la seule mission qui vaille, malgré l'accumulation des anecdotes de bas ou hauts faits militaires, malgré la répétition de certains motifs un peu trop convenus (4), puisqu'elle instaure un «jeu cérémoniel», tout autant que le «renouvellement [des] vœux» et nous convoque au «mystère d'appartenance» (p. 172), qui n'est qu'un des noms de notre désir, profond, si refoulé sous le bavardage démocratique qu'il en devient suspect, de trouver, enfin, l'homme providentiel et de se placer sous son autorité, afin de servir.
«L'homme a besoin d'un commandement» (p. 174), écrit ainsi Guy Dupré, qui n'en a sans doute trouvé aucun qui ne soit un peu plus que littéraire, c'est-à-dire réel, incarné dans une action politique au sens noble du mot, le déficit des grands hommes étant de nos jours non pas plus cruel qu'il ne l'était il y a cinquante ans ou un siècle, mais tout simplement comique, profondément grotesque. Et qu'on ne vienne pas lui parler de Pétain ou du Général, tous deux détestés, et qu'il renvoie dos à dos dans une gémellité saisissante (5).
Nous sommes tombés si bas que nous ne ressentons absolument pas le désir de nous trouver confrontés à ce qui nous dépasse, comme un Léon Bloy qui quêta, inutilement il en convint lui-même, la signature de Dieu dans les actes d'audace inouïs d'un Napoléon, par exemple.
Comment pourrions-nous comprendre une telle phrase : «Les seules tutelles nourricières sont les tutelles sacramentales» (ibid.), qui obligerait, en plaçant, je l'ai dit, nos pas dans les pas d'un autre, à nous intégrer «à l'édifice d'une grande aventure dans le temps» où, «devenu[s] caryatide[s] sur un profond socle», nous serions épaulés par des morts qui nous guideraient tout autant que par des personnes vivantes qui ne banniraient pas ces derniers dans les limbes commémoratives, et créeraient toutes deux, l'une par l'autre inextricablement nouées, une communauté invisible «supportant le pont jeté d'une rive à l'autre» (ibid.) ?
C'est impossible, du moins il est fort improbable que la France, saignée par deux boucheries internationales et vidée à présent de ses dernières énergies, fussent-elles strictement obsédées par le désir de faire de l'argent, qui ressemble de plus en plus à la peinture faite par Houellebecq dans La carte et le territoire, puisse, de mon vivant, faire germer une de ces grandes figures, femme ou homme, saint ou brigand, écrivain ou homme d'action, susceptible de lever, une dernière fois peut-être, l'échine recourbée depuis des décennies sur une morne digestion de gnou débarrassé, croit-il, de fauves.
Des gnous, des moutons ou des veaux, selon la métaphore qui paraîtra préférable aux derniers amoureux d'un pays qui fut plus qu'un pays, aux yeux de Guy Dupré, qu'est-ce que cela change, puisque, comme les personnages de Stevenson, nous semblons nous trouver au creux de la vague et que, quand bien même se présenterait un sauveur ou sa version risible et destructrice, un dictateur, nous ne saurions plus qu'en faire, comme Guy Dupré l'écrit : «Vous oubliiez que c'est seulement si l'homme le porte que l'événement est engendré. Si lui fait défaut ce dévouement maternant, l'événement glisse et n'est pas retenu, l'avenir n'est pas engendré mais seulement subi» (p. 190) ?
C'est donc fini, tout semble joué, et c'est Guy Dupré lui-même qui nous a averti que la fin de partie dans laquelle nous nous donnions comiquement l'illusion d'agir, et qui, impuissante et comique, ne bruit que du fracas de batailles de papier (6), était aussi une fin de patrie. L'écrivain, sauf erreur de ma part, fait débuter l'apparition de la faille qui va déchirer la France, non en deux familles politiques irréconciliables (qui seraient, elles, apparues durant la Révolution), mais en la privant de son sang, à l'événement si marquant de la Commune : «La guerre d'Algérie a fait resurgir les vieux fantômes sans que jaillisse la nappe de sang souterraine dans laquelle depuis l'affaire Dreyfus trempent les racines de nos pissenlits. L'imaginaire de la feue Fille aînée de l'Église baigne dans ce fond de violence qui n'a pas éclaté, et tient pour une part à ce que la dette envers ceux de la Commune n'a jamais été payée, et qu'il n'a jamais été versé à la partie civile autre chose qu'un franc symbolique» (p. 191).
Ce franc symbolique, sans doute qu'un Léon Bloy y eût vu l'ironie féroce, à vrai dire démoniaque à ses yeux, de l'Argent à l'égard des pauvres, dont des milliers furent envoyés, raisonnablement, posément, comme s'il eût fallu se débarrasser, par d'expéditives fournées, des forces vives de la France, milliers de jeunes qui, souvent, n'avaient pas 18 ans, à l'abattoir de la Grande Guerre : «La dette, il me semblait que notre dette longtemps épongée se remît à crier. Sous quelles formes allions-nous devoir commencer à payer ? Dans cet «arrière» qui envahissait, envahissait tout, comment retrouver l'air des créneaux ? Ce ne sont plus les rats ni la boue. Les obus à croix verte ni les attaques «pour le communiqué». C'est une autre guerre d'usure où sont tombés déjà plusieurs parmi les plus gonflés de notre génération de fruits secs», et l'écrivain de conclure sur une très belle image : «Ni génération sacrifiée, ni génération perdue, je nous voyais, fruits secs mais fiers de l'être, et décidés à passer, pauvres pommes, la promesse de vos arbres en fleurs sciés à mi-tronc comme en Picardie et dans le Vermandois, lors du repli stratégique allemand de mars 1917»» (p. 216).
Ce n'est donc pas par hasard que Guy Dupré a cité un passage du Monsieur Ouine de Georges Bernanos, qu'il a d'ailleurs si bellement et intelligemment évoqué, au rebours d'une critique universitaire trop souvent sans le moindre talent, voire, la moindre culture littéraire. C'est ainsi à Guy Dupré que je dois mes propres recherches sur l'influence, possible bien qu'indirecte, d'Arthur Machen sur le Grand d'Espagne, par le biais de Paul-Jean Toulet qui traduisit Le Grand Dieu Pan et enfanta l'un des ancêtres romanesques de l'ancien professeur de langues, dans la personne du bien-nommé Monsieur Du Paur.
Chez Guy Dupré comme chez Bernanos, la compénétration intime entre les univers visibles et invisibles ne saurait faire le moindre doute, alors même que le premier de ces deux écrivains n'a pas même besoin de postuler l'existence d'un Dieu maître et régisseur de ce que nous pourrions, un peu ironiquement, appeler les deux domaines d'extension de la lutte et des actions des hommes. Méfions-nous des raccourcis et des réclames propres au mode d'écriture (et de pensée) des journalistes, et évitons donc de dire que Guy Dupré est ou serait un spiritualiste charnel, un ermite sybarite, un initié n'appartenant à aucune confrérie ou loge, un homme de Dieu qui jamais ne semble évoquer ce dernier, par pudeur ou dédain, on ne sait, ou tout simplement parce qu'il n'a pas besoin de son existence pour postuler celle d'une membrane, beaucoup plus perméable qu'on ne le pense (ou le craint) entre les morts et les vivants, son «instinct de frontalier» (p. 236) (7) lui indiquant les mouvements en territoire non pas ennemi mais contigu au nôtre.
Et, chez l'un comme chez l'autre, le même constat, désabusé s'il n'était, d'abord, désespéré : «À l'homme de guerre ou guerrier a succédé l'homme de solde ou soldat. Voilà pourquoi la poussière dont est fait le soldat, lorsqu'elle s'élève, ne nous fait pas tousser» (p. 231), même si, peut-être, au creux de la vague nous l'avons dit, pouvons-nous espérer retrouver son formidable élan, qui nous arrachera de notre torpeur, des mâchoires de la fin de partie et qui nous permettra d'inverser le sens du cycle, redevenant sentinelles après avoir été successivement sursitaires puis déserteurs (cf. p. 237).
En ce sens, le «passage à l'ancien», que Guy Dupré ne manque jamais de souligner, comme s'il voyait dans cette expression une sorte de talisman, ne peut-il viser qu'un temps redevenu plénier, passé, présent mais aussi avenir réconciliés, le vin de vigueur, depuis longtemps éventé, pouvant de nouveau circuler dans les veines de l'Histoire, plus que dans le corps de l'amante, de toute façon endormie et assaillie, sinon par des monstres comme dans Le Cauchemar peint par Füssli, par des membres de la soldatesque, ou de ce qu'il en reste à notre époque : «Grande Guerre et affaire Dreyfus étaient de grosses loupes posées sur le tissu cicatriciel de l'Histoire; elles permettaient de grossir les tavelures, de mieux suivre les liserés, les aréoles du passage à l'ancien – ordres du jour et jamais de la nuit; péchés du passé où se réfractaient les peines de l'avenir; innocence et culpabilité que s'épuisent à vouloir dessouder les historiens laïcs; événements avènements mariant la couleur de feuilles séchées que l'on observe dans les ruines de Rome avec la couleur d'ambre des breuvages à 65° d'illusion. Général à tuer et maréchal à laisser dormir étaient les deux faces de la même obole – qui ne nous servirait pas d'obole à Charon. Pour les meilleurs, devenus simultanément pères indignes ou pères nobles, le choix de la vie, parfois de la mort, s'était joué sur ce pile ou face effaçable» (p. 234).
Effaçable parce qu'il ne convoque en fin de compte rien de plus que deux hommes dont les actions étaient moins antagonistes que secrètement ajointées l'une à l'autre.
Effaçable parce que la dernière vérité du roman de Guy Dupré ne consiste pas en une langue superbe, dressée par l'écrivain pour lui rapporter un gibier de choix, ni même dans la célébration de la chair des femmes mûres et dans le dépliage des pliures les plus insoupçonnables de l'Histoire récente de feue la France, qui nous semble encore plus profondément endormie que Constance, mais toutefois souillée par bien plus de soudards que ne l'a été la femme dont le narrateur s'est épris.
Il est temps, en sondant le puits de l'histoire officielle et surtout secrète de la France, de plonger dans une nappe de vif argent, où nous trouverons peut-être, en plus du nouveau cher au poète, la réelle présence que Guy Dupré le sourcier n'a cessé de quêter : «Ce qu'il y a de plus ancien parmi les choses anciennes nous suit et pourtant semble venir à notre rencontre» (p. 260).
Nous attendons cette rencontre, tout comme le grand écrivain.
Notes
(1) Toutes les pages entre parenthèses renvoient à notre édition. En l'occurrence, il s'agit de la page 11 de la Préface.
(2) «À tant de péris en terre dont la barbe n'avait pas eu le temps de pousser, ne restions-nous pas redevables d'un délai de grâce, d'une sorte de sursis à valeur baptismale, comme si le temps à l'avance racheté par le sel des larmes de ces quatre années-là [celles de la Grande Guerre, bien sûr], et réunie la rançon de nos joies par tant d'agonies avant terme, nous continuions à percevoir les arrérages du capital enfoui» (p. 26).
(3) Voir aussi p. 92, où Guy Dupré écrit : «Plus que Le Cuirassé Potemkine ou La Ruée vers l'or nous ramènent au déduit ces bobines qui souvent n'ont laissé de traces que sur notre première enfance, et autour desquelles notre nostalgie de l'époque légèrement antérieure où nous berce la tradition maternelle et où nous croyons volontiers avoir existé, s'est enroulée, resserrée de telle sorte qu'elles jalonnent de visages tumulaires les âges de notre vie» (pp. 92-3).
C'est à la page 109 que Guy Dupré écrira encore, revenant inlassablement à cette loi de Sainte-Beuve, qu'il agrémente du motif de la dette impayée, de l'influence bloyenne, invisible, entre les êtres, qui constitue le fonds où se détachent leurs actes, petits ou grands : «N'avez-vous pas remarqué comme le temps où nous aurions le mieux aimé vivre est celui qui précède immédiatement le temps où nous sommes venus ? Ne vous semble-t-il pas que vous ayez vécu avec ardeur et fraîcheur en ces saisons que je dis ? [...] Même si le capitaine s'épuise qu'ont amassé pour nous les «vingt ans» qui d'avance payèrent rançon pour nos lâchetés et les joies de notre maturité tardive, la ridicule obsession du «temps qu'il fait» chez leurs descendants – beau fixe, nuageux avec éclaircies, ou ensoleillé avec ondées – ne ravive-t-elle pas en vous la brûlure du «temps qu'il faisait» en ces années-là ?».
(4) Cf. p. 224 celui du passager du Titanic retrouvé, emprisonné dans les glaces, plusieurs dizaines d'années après sa mort.
(5) «Les troublants phénomènes de consanguinité qu'il relevait dans le comportement du maréchal, et du général sans me convertir à sa folie simplificatrice, m'inclinaient à les renvoyer dos à dos – opposés comme deux duellistes avant la marche contraire et comptée qui mesurera l'intervalle de leur affrontement, mais soudés par la même épine dorsale, chacun faisant cinquante pas en avant, cinquante pas en arrière, alternativement poussant et repoussé, poussé et repoussant, sans pouvoir se désunir ni s'affronter autrement qu'à coups de nuque» (p. 195).
(6) Il n'est donc guère étonnant que Guy Dupré ne voie en Charles De Gaulle qu'un phraseur un peu plus habile qu'une multitude d'autres phraseurs, «écrivant des livres sur des livres traitant des livres des mêmes auteurs»» (p. 215) : «Le lendemain, sur le parvis du Mémorial, il s'agirait pour lui de fixer, de couler, de figer l'inénarrable bataille dans le plomb de sa prose Troisième Empire, de graduer la louange et l'omission, de décerner un satisfecit aux Nivelle et aux Mangin en s'attachant cependant à ne pas découvrir le pot aux roses, à préserver l'image de Pétain sauveur de Verdun – son bienfaiteur à qui il affecterait de brosser les moustaches et polir le crâne tout en lui barrant l'accès au saint-sépulcre» (p. 204).
Ailleurs, c'est la «floraison sans sève des jeunes romanciers des années 60» (p. 219) qui subira l'acrimonie de l'écrivain, dont on se plaît à imaginer le jugement sur les jeunes romanciers des années qui ont suivi...
(7) Remarque faite à propos de Driant, un des personnages qu'évoque Pierre Mari dans son dernier beau roman, Les grands jours.






























































 Imprimer
Imprimer