« L’ultime diptyque américain de Fritz Lang : La Cinquième victime et Invraisemblable vérité, par Francis Moury | Page d'accueil | Nous, fils d'Eichmann de Günther Anders »
24/04/2013
Les états généraux de la violence, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Keith Srakocic (Associated Press).
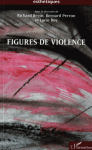 À propos de Figures de violence (sous la direction de Richard Bégin, Bernard Perron et Lucie Roy), L’Harmattan, 2012).
À propos de Figures de violence (sous la direction de Richard Bégin, Bernard Perron et Lucie Roy), L’Harmattan, 2012).Ce recueil de textes est l’initiative de trois chercheurs canadiens francophones (Richard Bégin, Bernard Perron et Lucie Roy). La plupart des contributions se concentre sur le traitement médiatique de la violence, décrivant un «mal nécessaire» qui s’enrichit d’une inquiétante confusion des dispositifs émotionnels. C’est que la violence, outre qu’elle est au sens premier la manifestation d’un excédent de force dont la destination implique un mouvement destructeur, suggère aussi des effets de sédimentation que les technologies médiatiques laissent hors traitement, faute de pouvoir les apparenter aux stratégies informatives qui régulent le champ des perceptions immédiates – entendons par là que l’action soudaine de la violence est médiatiquement commensurable tandis que ses conséquences, à court ou long terme, demeurent irréductibles au temps éphémère des médias modernes.
Conscient de cet écart, Stephen Prince (pp. 103-6) propose une délimitation entre la violence fictionnelle et la violence réelle. Il part du principe que la violence à laquelle nous sommes confrontés est majoritairement fictive ou imaginaire. Quant à la violence véritable, elle est selon lui contenue par des mécanismes de censure. Même si la médiatisation des guerres a perdu bon nombre de ses caractères abstraits depuis les années 1990, notamment lors du premier conflit du Golfe, elle n’en reste pas moins contrôlée, supervisée, soumise à des organes de rationalisation qui évaluent la décence ou l'incongruité des images incriminées. Cette part de hors champ incite la fiction à prendre le relais, d’où la multiplication, au cours de la dernière décennie, des productions cinématographiques américaines qui ont choisi pour cadre fictionnel les déserts de l’Irak ou de l’Afghanistan. Le cinéma essaie à cet égard de s’approcher de la violence réelle qui s’inscrit dans le temps long de ses effets (deuil, cicatrisations de blessures internes/externes, bouleversements économiques, etc.). Ainsi Paul Haggis, avec son film Dans la vallée d’Elah, propose une focalisation sur les prolongements psychologiques de la guerre, s’attachant à raconter la tension entre un vétéran qui veut savoir pourquoi son fils a possiblement déserté l’armée lors d’une permission, et les amis du potentiel déserteur qui sont troublés par cette ingérence paternelle. Aucune violence active ou imminente n’est à l’œuvre, sinon par le truchement d’une vidéo fragmentée que le père reconstitue graduellement, le film s’intéressant à la dissémination des traumatismes, plus précisément à la manière dont les soldats ont rapatrié dans un pays où les images subissent un contrôle permanent (les États-Unis) des représentations fondamentalement incommensurables. En faisant le choix d’une violence décrite a posteriori de ses manifestations explicites, le parti pris esthétique de Paul Haggis se soustrait au régime des horreurs corporelles («body horror is a vanishing feature» nous dit S. Prince) afin d’entamer un examen des proportions autrement plus énormes et complexes de la violence continuée, durable et sédimentée. Il s’agit d’une violence qui n’est plus vraiment audio-visuelle, si bien qu’elle n’est pas complètement traduisible à travers l’appareil médiatique.
Au chapitre des cogitations esthétiques de la violence, il va sans dire que le jeu vidéo constitue désormais un espace privilégié. Bernard Perron et Guillaume Roux-Girard (pp. 81-90) dépassent cependant les seules satisfactions esthétiques que procure le domaine vidéo-ludique. En dirigeant leur attention sur les fonctions du son, ils notent que l’optimisation d’une synchronisation entre les phénomènes acoustiques et visuels a transformé le jeu vidéo en un lieu hautement pragmatique. En d’autres termes, les nécessités d’agir pour le joueur sont plus fortes par cela même que l’univers du jeu est devenu de plus en plus immersif. Le cas des jeux «horrifiques» est évidemment un modèle. Dans un enchaînement narratif où les normes de l’État de droit ne sont plus d’actualité, la violence atteint un seuil de légitimité : d’une part il faudra combattre les monstres pour survivre, d’autre part il faudra régulièrement adjoindre à cet affrontement nécessaire une réflexion en vue de penser une préservation de l’humanité, et par extension, peut-être, une reconfiguration des notions telles que la loi et la justice. Dépendamment de ces contextes, le joueur est perçu comme la composante d’un système de forces (cognitives) qui éprouve les forces d’un autre système. Les « actions primitives » du joueur sur ses outils de jeu (cf. Gregersen et Grodal qui les nomment les «actions-P» (1)), par essence extra-diégétiques, précèdent leurs expressions diégétiques, et le jeu sera d’autant plus pertinent qu’il parviendra quelquefois à mettre en rapport une simplicité des causes avec une complexité des effets. Certes l’impétuosité de la violence sera transcrite dans l’univers diégétique, mais il ne s’ensuivra pas que les décisions initiales du joueur auront été soumises à des applications primesautières. Tout au contraire, un phénomène d’encodage des connivences entre les «actions primitives» et leurs retentissements diégétiques concrétise une philosophie de l’action qui peut présupposer des finalités moins immédiates, à savoir que les résultats de nos actions seront éventuellement passés au crible d’un arbitrage moral. On est ici en plein dans la pensée antique de la mesure et de la tempérance, fût-elle paradoxalement visible à l’intérieur d’un jeu vidéo tout entier environné d’horreurs et de monstruosités. Cette pensée acquiert par ailleurs une valeur de « prévoyance » des actions, en l’occurrence une valeur positive de prudence. Prise en son sens aristotélicien, la prudence (phronêsis) indique « une disposition accompagnée de raison juste, tournée vers l’action, et concernant ce qui est bien ou mal pour l’homme (Éthique à Nicomaque, VI). Par conséquent le héros en première personne du jeu vidéo horrifique n’est pas réductible à un simple agent d’extermination. Mieux encore, tel que le font justement remarquer B. Perron et G. Roux-Girard, la vision d’un corps en troisième personne va induire un coefficient de terreur supplémentaire. En effet, les blessures possibles nous apparaîtront beaucoup plus personnelles, aussi sera-t-on enclin à affiner nos panoplies cognitives en vue de sauvegarder notre intégrité physique dans le jeu, mais aussi notre intégrité intellectuelle en amont étant donné que nous sommes maîtres et possesseurs du personnage incarné. De tels réquisits font définitivement basculer le jeu vidéo du schéma contemplatif au schéma actif, prenant appui sur la maîtrise de l’esthétique dans le but de créer un espace pragmatiquement ordonné où le joueur pourra tester sa compréhension de l’agir.
Il n’empêche que la violence procède à d’autres «figurations» moins interactives que celles de l’environnement vidéo-ludique : ce sont les «figures» imposées par une culture de l’écran de télévision (qui fait écran de surcroît) et qui produisent un phénomène de déferlement des images agressives allié à une symbiose de la souffrance et du spectacle (cf. le texte d’Henry A. Giroux, pp. 15-23). Insistant sur la rhétorique «toxique» des médias de droite aux États-Unis, Giroux voit en cela l’installation d’une politique de la cruauté. Si des meetings politiques brassent des idées qui reposent sur une fallacieuse notion de parasitage (il y aurait des catégories de population qui affaiblissent la forteresse de l’État, donc il serait convenable que ces gens-là disparaissent en dépit de tout ce que l’euphémisation verbale sous-entend), alors on ne peut plus reprocher le renforcement des comportements indifférents, ou bien encore ne peut-on plus réfréner la culture de l’ultra-individualisme qui tend à recevoir la présence de l’autre-que-soi à l’instar d’une menace. Cette forme de violence rhétorique abolit certes les effets d’une violence performative et instinctuelle, mais en même temps elle polarise des processus de persécution qui nous font entrer dans l’ère d’une violence intersubjective. La communication devient dans cette perspective une arme essentielle d’affirmation et de spéculation. Cette configuration découvre simultanément une situation de «guerre asymétrique» : c’est le combat de rationalités différentes qui est à l’ordre du jour (par exemple les rivalités politiques ou les revendications intercommunautaires), et l’enjeu est de pouvoir s’imposer par n’importe quels moyens, souvent très différents de ceux de l’adversaire, dans le but de signifier quelles sont les valeurs dominantes qu’il faudra dorénavant appliquer, quoi qu’il en coûte en quotient d’humanité et de dignité de la parole. Et dans la mesure où l’asymétrie de guerre se pratique entre des individus de même espèce (l’homme en tant que tel), on ajoute aux incidences de la violence intersubjective les effets pervers de la violence intra-spécifique. En corollaire, on obtient des manipulations sur la mémoire des vaincus. À ce titre, Émilie Houssa (pp. 25-35) distingue trois types d’intoxication mémorielle : 1/ la mémoire occultée (crise économique en Argentine en 2001) ; 2/ la mémoire interdite (Salvador Allende renversé par Pinochet) ; 3/ la mémoire impossible due au «trop-plein» des images (Carlo Giuliani tué à Gênes le 20 juillet 2001 par un carabinier, lors des émeutes qui s’opposèrent au sommet du G8), demandant à ce que l’on soit capable de choisir une image prépondérante parmi un fleuve de représentations aussi bien fugitives qu’insoutenables.
Les diverses intoxications de la mémoire prouvent que l’univers médiatique est plus efficace que les prisons quand il est question de verrouiller un point de vue, de mettre à l’écart, ou bien, pour le dire encore autrement, de séquestrer une discordance qui serait trop déstabilisante au sein des normes en vigueur – voire des normes « vigoureuses » attendu que celles-ci sont rarement issues d’une stabilisation flegmatique. Ainsi le traitement de l’information peut arbitrairement enfermer la ou les personnes de son choix, l’incarcération médiatique étant naturellement inséparable de ceux qui jouissent des meilleurs moyens de communication. Conformément à cela, É. Houssa aborde la pratique du cinéma documentaire comme la proposition d’une alternance créatrice qui viendrait falsifier la suprématie des discours officiels. On retrouve ici la nécessité d’une dynamique du conflit, lointainement héritée des fragments d’Héraclite lorsqu’il s’exprimait de façon pythique sur le «Polemos», puis thématisée dans la philosophie politique de Machiavel. Pour peu que l’on soit sensible au « moment » machiavélien, il semble donc qu’une société qui souhaite perdurer ait à comprendre la violence à l’image d’une présence fertile car elle permet de tracer une ligne de démarcation entre deux archétypes du peuple : d’un côté un peuple constitutionnel qui poursuit indifféremment les desseins de l’État, d’un autre côté un peuple expérimental qui pratique une falsification plus ou moins spontanée des discours dominants. Ceci étant, lorsque la violence de la domination politique est si fortement ancrée qu’on en vient à l’identifier à quelque chose de naturel, on supprime les actions potentielles du peuple expérimental tout en affermissant la docilité du peuple constitutionnel.
Alain Brossat (pp. 39-52), au cours d’un texte éblouissant de lucidité, dénonce le moralisme antiviolence que la parole politique s’est approprié, une parole invariablement fabriquée d’éléments de langage et de redondances. En assignant des territoires parfaitement définis à la violence, qui plus est par l’entremise d’un discours sans cesse fuyant pour mieux contrecarrer la multiplicité des poches insurrectionnelles, la parole du pouvoir produit un déplacement du centre de gravité de l’événement violent. Dans ce cas de figure, non seulement la violence étatique de répression se justifie par l’intervention politico-médiatique en face de ce qui fait événement, métamorphosant de la sorte les mots du pouvoir en un ersatz embarrassé de morale et d’éthique, mais en plus cette répression qui ne dit pas son nom localise la violence directement chez ceux qui subissent au premier chef l’agressivité latente d’un État moralisateur. Tout se concentre autour d’une méthode dont l’objectif est de manufacturer une conjuration de l’événement. Finalement l’État pseudo-libéral, entre son moralisme et sa «démocratie policière», alimente une « machine anti-événement » qui diminue une politique de l’action au profit d’une politique du boniment (p. 49). Les langages du pouvoir ont donc la tâche de combiner une intrigue du monde où se conjuguent des histoires cacophoniques, sautant d’une éclipse médiatique à une autre, mais ayant quoi qu’il arrive l’obligation de maintenir la population sous l’égide d’un «storytelling sécuritaire», avec ses héros normalement violents (les policiers) et ses victimes illégitimement violentes (les séditieux). Ce sont là des dispositifs qui reprennent le thème foucaldien de la biopolitique. L’enjeu consiste à se prémunir d’un excès de «corps» dissemblables aux fonctionnalités de l’ordre ambiant, en quoi l’on n’hésitera pas à éliminer par des voies douces ou symboliques ceux qui s’octroient des libertés qui transgressent l’ordre disciplinaire théorique, en l’occurrence un ordre toujours idéalement présent mais jamais formulable en termes pratiques du fait même des contraintes imposées par le «storytelling» de la parole sécuritaire. Ces astuces politiciennes, dont il ne faudrait pas minimiser les conséquences, altèrent radicalement l’espace social. D’une part elles ont tendance à rendre vulnérables les sociétés modernes en complexifiant inutilement la perception de l’information, ne serait-ce qu’en la transmettant sous des angles arrangeants, et d’autre part elles décrédibilisent massivement l’image du dirigeant politique qui apparaît de plus en plus comme l’agent d’une manutention humaine insupportable.
Note
(1) Gregersen, Andreas et Torben Grodal (2009). Embodiment and Interface, dans Bernard Perron et Mark J.P. Wolf (dir.), The Video Game Theory Reader 2 (New York, Routledge), pp. 65-83.




























































 Imprimer
Imprimer