« Au-delà de l'effondrement, 55 : Le dernier Blanc d'Yves Gandon | Page d'accueil | Le Siècle des Charognes de Léon Bloy »
24/04/2015
La Persuasion et la Rhétorique de Carlo Michelstaedter
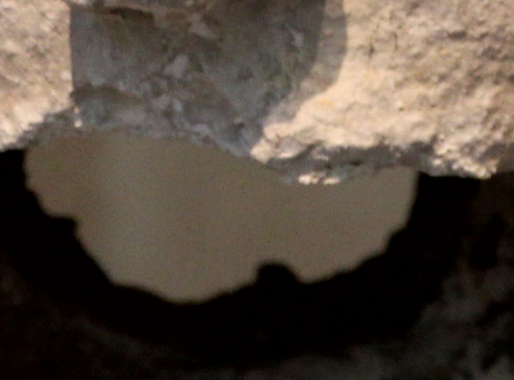
 Études sur le langage vicié.
Études sur le langage vicié.«Peut-être est-ce cela, le péché originel, être incapable d’aimer et d’être heureux, de vivre à fond le temps, l’instant, sans avoir la rage de le brûler, de le faire finir tout de suite. Inaptitude à la persuasion, disait Michelstaedter.»
Claudio Magris, Colline, in Microcosmes [Microcosmi, 1997) (traduction de l’italien par Jean et Marie-Noëlle Pastureau, Gallimard, coll. Folio, 2000), pp. 154-5.
 Il n'a pas franchement tort, ce gamin qui n'a pas 25 ans, de citer, en exergue de ce qui fut son génial mémoire de maîtrise, le propos de l’Électre de Sophocle à sa mère Clytemnestre : «Je comprends que mes façons ne répondent ni à mon âge, ni à mon rang» (vers 617-8), comme un coup de pied au cul de tous les professeurs, présents ou futurs, tout comme il a bien fait, dans sa Préface, de poursuivre en affirmant : «Moi je sais que je parle parce que je parle mais que je ne persuaderai personne», ajoutant «Et pourtant ce que je dis a été dit tant de fois et avec tant de vigueur qu'il semble impossible que le monde ait encore continué après qu'eurent résonné ces mots» (1).
Il n'a pas franchement tort, ce gamin qui n'a pas 25 ans, de citer, en exergue de ce qui fut son génial mémoire de maîtrise, le propos de l’Électre de Sophocle à sa mère Clytemnestre : «Je comprends que mes façons ne répondent ni à mon âge, ni à mon rang» (vers 617-8), comme un coup de pied au cul de tous les professeurs, présents ou futurs, tout comme il a bien fait, dans sa Préface, de poursuivre en affirmant : «Moi je sais que je parle parce que je parle mais que je ne persuaderai personne», ajoutant «Et pourtant ce que je dis a été dit tant de fois et avec tant de vigueur qu'il semble impossible que le monde ait encore continué après qu'eurent résonné ces mots» (1).Pourtant, il a continué, et il y a fort à craindre que le monde ne se laisse jamais arrêter par des paroles, mêmes les plus hautes. Après tout, le monde a-t-il cessé d'exister après les paroles de Moïse, d'Isaïe, de Job ou du Christ ?
Quels sont les auteurs de ces paroles qui, une fois prononcées ou bien écrites, auraient dû rendre caduques toutes les autres ? La liste en est aussi courte que remarquable : Parménide, Héraclite, Empédocle, Socrate, l'Ecclésiaste, le Christ, Eschyle, Sophocle, Simonide, Pétrarque, Leopardi, Ibsen et enfin Beethoven, voilà selon l'auteur la poignée de grandes âmes dont les paroles n'ont été considérées que comme de beaux vers, des genres littéraires, des systèmes après tout réfutables, de grandes œuvres musicales, bref, autant de façons de refuser de les considérer comme des injonctions brûlantes à se transformer et transformer le monde, des commandements bien davantage que des sujets de dissertation. Ces quelques lignes, à la fois désolantes de lucidité et ironiques, qui accueillent le lecteur de ce livre qui porte à l'incandescence la puissance du langage et qui semble presque concrétiser le rêve des vieux mages et des linguistes modernes : quand dire, c'est faire, et lui demandent, d'une façon imagée, d'abandonner là son espérance, auraient dû apprendre aux lecteurs de Carlo Michelstaedter que ce dernier n'aurait jamais accepté de devenir un de ces vieux professeurs pontifiants, répétant chaque année à ses élèves des truismes sur des auteurs considérés un peu comme des insectes curieux et pulvérulents punaisés derrière une vitrine, soigneusement étiquetés, inoffensifs, rédacteurs de livres pénibles constitués d'un assemblage de fiches de cours barbantes.
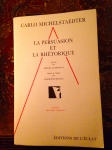 Si Carlo Michelstaedter, le 17 octobre 1910, très exactement à 14 heures, s'est tué quelques heures après avoir terminé d'écrire son livre, c'est parce qu'il était du côté de la vie, de la vraie vie qui n'est absente que pour celles et ceux qui ne veulent pas s'ouvrir à elle, la vraie vie qui est persuasion.
Si Carlo Michelstaedter, le 17 octobre 1910, très exactement à 14 heures, s'est tué quelques heures après avoir terminé d'écrire son livre, c'est parce qu'il était du côté de la vie, de la vraie vie qui n'est absente que pour celles et ceux qui ne veulent pas s'ouvrir à elle, la vraie vie qui est persuasion.La persuasion est du côté de la vérité, mais n'est pas la vérité. La persuasion est la vie droite, quelque chose comme la sprezzatura, peut-être, de Cristina Campo, en tout cas une vie sans artifice qui n'est pas contrainte, comme un poids, de chuter indéfiniment, car «il ne lui est pas donné de se satisfaire», autrement dit : «Le poids ne peut jamais être persuadé» (p. 42, l'auteur souligne). La persuasion est donc la liberté essentielle qui n'est pas donnée à l'homme, puisque ce dernier doit la conquérir : «La persuasion ne vit pas en celui qui ne vit pas uniquement de soi-même : mais est fils et père, esclave et maître de ce qui l'entoure, de ce qu'il y a avait avant, de ce qui doit venir après : chose parmi les choses» (p. 43, l'auteur souligne). Celui qui ne vit pas dans la persuasion vit dans la dépossession, synonyme de la rhétorique, car «chacun tourne autour de son pivot, qui n'est pas le sien, et le pain qu'il n'a pas, il ne peut le donner aux autres», étant persuadé «celui qui a en soi sa vie», «l'âme nue dans les îles des Bienheureux», peut-être (p. 44, l'auteur souligne).
Vivant dans la dépossession, les hommes qui refusent la persuasion se cachent la sordide vérité de leur état, qui n'est autre que : la peur de la douleur. Carlo Emilio Gadda a-t-il lu Carlo Michelstaedter ? Je ne le sais pas, mais après tout, pourquoi pas, tant est manifeste, de La Connaissance de la douleur, l'évidence que ce texte n'a pas été écrit pour rire. L'homme persuadé est un homme libre, l'homme qui n'est pas persuadé est un esclave car, écoutez ce secret, peut-être le plus manifeste et pourtant le mieux caché du monde, l'homme n'est esclave que de sa propre peur : «Les hommes ont peur de la douleur et pour lui échapper ils lui appliquent en guise d'emplâtre la foi en un pouvoir conforme à l'infinité de la puissance qu'ils ne connaissent pas et la chargent du poids de la douleur qu'ils ne savent pas porter. Le dieu qu'ils honorent, auquel ils abandonnent tout [...] c'est le plaisir; tel est leur dieu familier, le cher, l'affable, le connu» (pp. 56-7).
La liberté fait peur, et il faut imaginer que, désireux de briser les chaînes qui le maintiennent dans l'esclavage, l'homme, avant de pouvoir se prétendre (à nul autre qu'à lui-même, la persuasion ne souffrant pas une quelconque publicité) persuadé, risque de traverser une période très difficile où, ayant renoncé aux consolations faciles, ses «projets pour le lendemain et le surlendemain» s'arrêteront : alors, «l'homme est à nouveau sans prénom, sans nom, sans réponse et sans parents, désœuvré, sans habits, seul, nu, les yeux ouverts à regarder l'obscurité» (p. 59). Autrement dit, s'enfonçant, volontairement, dans la profondeur qui seule importe, l'homme renonce à la docilité, à la bonté, «ou même supériorité ou science du monde», autant de termes synonymes désignant «la superficialité de celui qui n'avait pas en soi la raison de ce qu'il faisait, mais se trouvait à le faire, ne sachant pas pourquoi il voulait ces choses-mêmes qu'il voulait», n'ayant donc pas «en soi la puissance de ces choses ni la force suffisante pour s'opposer à ce qui pouvait les lui retirer», mais se trouvant néanmoins «à puiser sa petite vie en elles» (p. 66).
La «voie vers la persuasion» (le titre de la troisième partie de notre livre) est non seulement ardue mais périlleuse, car nul ne revient de cette voie une fois qu'il s'est engagé dessus, qui mènera l'homme persuadé à retrouver, en lui-même, le centre perdu qu'évoquera plus tard Zissimos Lorentzatos. Comme tous les grands maîtres (nous verrons plus loin qu'il nous faut rester prudent avec ce terme), et qu'importe l'âge qui fut celui de ce jeune homme au moment où il écrivit son livre le plus fameux, Michelstaedter nous apprend à voir de quoi il en retourne vraiment, nous mène jusqu'au sommet de la montagne, nous demande de contempler le vide, puis de nous y jeter. Il n'est pas question d'affirmer que cette influence serait perverse ou même diabolique : Carlo Michelstaedter ne nous tente pas, il ne nous éprouve pas davantage. Il nous presse de nous plonger en nous-même, afin de nous débarrasser des derniers expédients grâce auxquels nous nous berçons d'illusions et, littéralement, nous voilons la face et, surtout, il ne cesse de nous redire que, sur le chemin de la persuasion, nulle halte n'est permise ni même possible (cf. p. 82) : «Es-tu ou non persuadé de ce que tu fais ? Tu as besoin que telle chose advienne ou n'advienne pas pour faire ce que tu fais, que les corrélations coïncident sans cesse, car la fin, aussi vaste et éloignée soit-elle, n'est jamais dans ce que tu fais, mais est toujours ta continuation. Tu dis que tu es persuadé de ce que tu fais, et advienne que pourra ? – Oui ? – Alors moi je te dis : demain tu seras certainement mort : peu importe ? tu penses à ta réputation ? tu penses à ta famille ? mais ta mémoire est morte avec toi, avec toi ta famille est morte; – tu penses à tes idéaux ? tu veux faire ton testament ? tu veux une pierre tombale ? mais demain ils seront morts, morts eux aussi; les hommes meurent tous avec toi – ta mort est une comète infaillible; tu t'adresses à dieu ? – il n'y a pas de dieu, dieu meurt avec toi; le règne des cieux s'écroule avec toi, demain tu seras mort, mort; demain tout est fini; ton corps, ta famille, tes amis, ta patrie, ce que tu fais, ce que tu peux encore faire, le bien, le mal, le vrai, le faux, tes idées, ton rôle, dieu et son règne, le paradis, l'enfer, tout, tout, demain, tout est fini – dans 24 heures c'est la mort» (pp. 67-8). L'homme persuadé, ainsi, ne craint pas de mourir, car «Qui craint la mort est déjà mort» (p. 69, l'auteur souligne), alors que celui qui au contraire «veut fortement sa vie, ne se contente pas, de peur de souffrir, de ce vain plaisir qui fait écran à sa douleur, pour que celle-ci continue au tréfonds, aveugle, muette, insaisissable; mais il assume au contraire la personne de cette douleur», ce qui lui permet de se «créer soi-même afin d'acquérir la valeur individuelle, qui ne se meut pas contrairement aux choses qui vont et viennent, mais est en soi persuadé» (p. 71, l'auteur souligne).
Difficile, peut-être même impossible à emprunter, est la voie, disais-je, l'unique voie du salut, et il est certain que la majorité d'entre nous préférera, toujours, consolider ses maigres assurances, continuer de dormir plutôt que se réveiller : «Mais les hommes sont comme celui qui rêve de se lever et qui s'apercevant qu'il est encore couché, ne se lève pas mais se remet à rêver qu'il se lève», alors qu'ainsi, poursuit Michelstaedter, «sans se lever et sans cesser de rêver, il continue à souffrir de l'image vive qui trouble la paix de son sommeil et de l'immobilité qui rend vaine l'action dont il rêve» (p. 72).
Et l'auteur de poursuivre, ne laissant pas en paix celui auquel il s'adresse, imaginant bien que les hommes, presque tous les hommes, ne manqueront pas de lui opposer une multitude d'arguments qui sont autant de cris trahissant leur peur, la peur de la mort qui les pousse à vivre sans persuasion (cf. p. 77) : «mes jambes flageolent, et ton chemin est impraticable», et à ceux-là il répond : «Il y a les boiteux et les valides – mais l'homme doit se fortifier de lui-même les jarrets pour marcher – et avancer là où il n'y a pas de route. Par les voies habituelles les hommes cheminent dans un cercle qui n'a ni commencement ni fin; ils vont, ils viennent, ils rivalisent, se pressent, affairés comme des fourmis – sans doute se confondent-ils les uns les autres, – certes quand bien même ils marchent, ils sont toujours là où ils étaient, car tous les endroits se valent, dans la vallée sans issue. L'homme doit se frayer un chemin pour parvenir à la vie et non pour se mouvoir parmi les autres, pour entraîner les autres avec lui et non pour réclamer les récompenses qui ne sont pas sur le chemin des hommes» (p. 73).
Carlo Michelstaedter sait bien qu'à l'impossible nous sommes tous tenus, et que ce qu'il appelle le «droit de vivre» (p. 78) ne s'arrache qu'au prix d'un travail constant, infini à vrai dire : «Car de même que l'hyperbole se rapproche à l'infini de l'asymptote, l'homme qui, en vivant, veut être en possession de sa vie, s'approche à l'infini de la ligne droite de la justice; et de même que la courbe, si petite soit la distance d'un point de l'hyperbole à l'asymptote, doit infiniment se prolonger pour atteindre le contact, le devoir d'un homme envers la justice, aussi modeste soit ce qu'il demande comme juste pour soi dans sa vie, demeure infini» (pp. 77-8).
Il est frappant de constater que Carlo Michelstaedter ne craint pas d'adopter, bien davantage qu'une position de maître, fût-il éminent comme Aristote qu'il déteste par-dessus tout (2), une véritable attitude christique, comme plusieurs passages le prouvent : «Il ne s'agit pas d'apporter un soutien aux hommes soumis à la peur de la mort, mais de leur ôter cette peur; il ne s'agit pas de leur donner la vie illusoire et les moyens pour que sans cesse ils la demandent encore, mais de leur donner la vie maintenant, ici, dans sa totalité, afin qu'ils n'aient pas besoin de demander : telle est l'activité qui coupe la violence à sa racine» (p. 80, l'auteur souligne).
Il serait peut-être dès lors tentant d'analyser le suicide de l'auteur comme une forme profane de mort, volontaire, sur la croix de la connaissance plutôt que sur celle de la charité, mais je pense que, bien davantage que cette tentative, avortée, blasphématoire et même, peut-être, hermétiquement close sur elle-même, il ne faut voir dans le geste terrible, mais logique, de Carlo Michelstaedter que son assurance ultime, sa compréhension profonde de ce qui ne pouvait être que son échec. Vivant, Michelstaedter a peut-être estimé qu'il faisait lui aussi partie de cette catégorie d'êtres sans épaisseur, vivants dans le divertissement, comme certaines de ses lettres peuvent nous le laisser penser (3), lui qui écrit : «Si vous êtes en ce monde et n'êtes pas en ce monde», si «vous prenez les choses et ne les possédez pas, si vous mangez et restez affamés, si vous dormez et êtes fatigués, si vous aimez et vous faites violence, si vous êtes vous et n'êtes pas vous» (ibid.). Vivant et bien vivant, mais ne parvenant toutefois pas à vivre dans l'instant et ainsi coïncider pleinement avec le présent de la persuasion (4), Carlo Michelstaedter a peut-être préféré ne plus vivre dans le mensonge commun et, par son geste, a mis fin à son insomnie métaphysique : «L’absolu je ne l’ai jamais rencontré, mais je le connais comme celui qui souffre d’insomnie connaît le sommeil, comme celui qui regarde l’obscurité connaît la lumière» (p. 93). Il est aussi vrai que Carlo Michelstaedter a pu vouloir, à son tour, tenter de comprendre ce que le personnage de Gilliatt des Travailleurs de la mer de Victor Hugo a compris au moment de mourir, mais de cette expérience, nous ne pouvons strictement rien savoir.
La suite de cet article figure dans Le temps des livres est passé.
Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici.































































 Imprimer
Imprimer