« Le septième sceau de Sous le soleil de Satan | Page d'accueil | Dans un cimetière, en Haute-Normandie »
23/10/2016
Narthex de Marien Defalvard

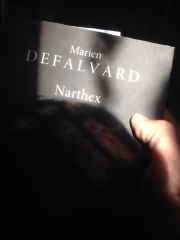 Acheter Narthex sur Amazon.
Acheter Narthex sur Amazon.Marien Defalvard, qui naguère offrit au public un premier roman somptueux dont Gregory Mion et moi-même avons rendu longuement compte, rejoue sa parole, par un véritable acte de bravoure qui, à lui seul, écrase la rentrée dite littéraire française.
Je revois il y a quelques jours Christian Guillet, que je tiens pour l'un des tous derniers prosateurs français, reprocher à Marien Defalvard d'avoir écrit des poèmes beaucoup trop denses, et ce dernier lui rétorquer, non sans une pointe évidente de malice et comme s'il s'agissait d'un reproche adressé aux voies impénétrables de l'édition, qu'il les avait pourtant sacrément dégrossis avec son éditeur. C'est bien simple, ce jeune écrivain, infiniment plus talentueux que tous les péquenauds incultes et insignifiants réunis que la critique journalistique, l'inénarrable sot François Busnel en tête, s'échine à nous présenter comme des génies de présentoirs, parvient encore à nous surprendre, en poursuivant la méthodique trame de son roman, enroulée, je l'ai écrit, autour de quelques puissants câbles de force que sont le souvenir, le langage, le questionnement de l'être des lieux et des années qui fuient, avec pour môle la figuration d'une identité malléable et subtile elle-même soumise à l'emprise du langage. Ce que nous donne à voir l’œuvre, encore en développement, de Marien Defalvard, c'est un homme tout entier tombé, emprisonné dans les rets du langage. Nous verrons peut-être le jour où, pour reprendre, au sens kierkegaardien du terme, le geste du plus grand de ses aînés, Arthur Rimbaud bien sûr, Marien Defalvard se libérera de sa prison, dans laquelle, pour l'heure, il semble particulièrement à l'aise, et même heureux de s'y trouver, comme le bourreau baudelairien n'est jamais plus heureux que de soumettre sa propre chair et son esprit à ses savantes tortures.
 Je connais déjà le sort critique, ou plutôt le sort gisant hors de toute critique, de Narthex, un recueil de poèmes oraculaires, parfois hermétiques, toujours surchargés d'images, de métaphores et de significations, de plus de 230 pages, qui mériterait deux voire trois lectures attentives, ou tel exercice que, lorsque j'étais assis sur des bancs d'école, on appelait commentaire composé : nul n'en parlera, d'abord parce que la critique littéraire n'a pas grand-chose à dire, si l'on y réfléchit, sur la parole poétique, sinon tenter de dérouler en mots clairs quelques fulgurances ramassées comme un crotale avant de se jeter sur sa proie, ensuite parce que l'éditeur n'a certes pas facilité le travail de nos paresseux journalistes en ne leur prémâchant pas le travail au moyen d'un sot argumentaire axé sur l'emploi autiste de consternants éléments de langage, enfin parce que, parviendrait-elle à ne point trop paraphraser le texte concerné, celle-ci, du moins à notre époque, n'existe tout simplement plus.
Je connais déjà le sort critique, ou plutôt le sort gisant hors de toute critique, de Narthex, un recueil de poèmes oraculaires, parfois hermétiques, toujours surchargés d'images, de métaphores et de significations, de plus de 230 pages, qui mériterait deux voire trois lectures attentives, ou tel exercice que, lorsque j'étais assis sur des bancs d'école, on appelait commentaire composé : nul n'en parlera, d'abord parce que la critique littéraire n'a pas grand-chose à dire, si l'on y réfléchit, sur la parole poétique, sinon tenter de dérouler en mots clairs quelques fulgurances ramassées comme un crotale avant de se jeter sur sa proie, ensuite parce que l'éditeur n'a certes pas facilité le travail de nos paresseux journalistes en ne leur prémâchant pas le travail au moyen d'un sot argumentaire axé sur l'emploi autiste de consternants éléments de langage, enfin parce que, parviendrait-elle à ne point trop paraphraser le texte concerné, celle-ci, du moins à notre époque, n'existe tout simplement plus. Que diable pourrait donc dire la critique à la poésie, la servante moribonde, quoique indéfectiblement bavarde, à sa maîtresse qui éclate de vie, dernière floraison ou bien, qui sait, nouvelle jeunesse se manifestant par un enracinement qui livrera d'autres fruits, d'autres frondaisons splendides, propulsant de hautes images comme des canopées de significations ? Elle ne peut absolument rien dire bien sûr, et les plus doués de nos journalistes broderont de rapides banalités sur ce diable de Defalvard, qui déjoue les pronostics et parvient encore à surprendre la poignée de happy few qui le suivent, et les plus nuls ne manqueront pas d'évoquer tels tracas judiciaires si peu poétiques, qui enfermèrent naguère le jeune prodige dans la catégorie des faits divers, et ce sera à peu près tout, et cette avant-nef qui après tout peut être aisément confondue avec une rosace iridescente de mots tour à tour transparents ou opaques sera murée puis recouverte du stuc publicitaire habituel, puisqu'il faudra, vite, baver les mêmes sottises sur les heureux gagnants du Premier Prix du Putanat littéraire français, à savoir n'importe lequel de nos ridicules et indigents prix dits littéraires. Alors la poésie ne mentira pas et, fidèle à la réputation que les imbéciles lui font, elle pourra se replier dans le recoin d'une littérature élitiste, qu'il serait impensable de prétendre ouverte à tous, et d'abord aux lecteurs indigents de Lydie Salvayre ou de Mathias Enard.
L'antienne est convenue bien sûr, et mon cadavre ne sera rien de plus qu'un peu de poussière que les filles et petites-filles, les fils et les petits-fils de nos maquereaux et de nos putains continueront de se nourrir de carne putréfiée, faisant mentir les mots, clabaudant la littérature, l'étouffant en la livrant aux mains sales des tripoteurs professionnels et des publicitaires semi-mondains mais, un jour pourtant, le pas des mendiants fera de nouveau trembler la terre comme l'écrivait Bernanos dans Monsieur Ouine, et quelques hommes recouverts de hardes puantes liront peut-être, comme un ultime trésor plus précieux que le dernier vestige de vie animale ou végétale, quelques vers de Narthex, où se joue la mise en jeu du langage, son questionnement, sa naissance ou renaissance, sa mort ou fossilisation, sa puissance térébrante ou sa muetteté satanique, autant dire, son essence.
 Car c'est bien l'essence même du langage (pas seulement poétique à l'évidence) que Marien Defalvard, intrépide ou inconscient comme tous les écrivains de race, veut attraper dans les mailles de son filet savamment tissé, je parle là non seulement de l'ensemble de ses poèmes qui peut être lu comme une espèce de roman déambulatoire dans une géographie aussi méticuleusement pointée qu'imaginaire, mais de quelques-unes des plus belles et longues pièces qu'il contient, et qui peuvent être lues et comprises comme autant d'arts poétiques coruscants et complexes. Prenons ainsi le long poème intitulé Ode à Pithiviers qui ouvre le recueil (pp. 10-26), monologue halluciné (cf. p. 16) qui se clôt, quelques dizaines de poèmes plus loin, sur une Fondation mythique de Pithiviers (pp. 232-5), aussi contenue, elle, resserrée et elliptique que le premier texte était grandiose, rimbaldien dans son long épanchement et son intention programmatique, sorte de remise à jour ou à flot de quelque Bateau ivre tour à tour remontant le cours du fleuve ou bien encalminé sur ses berges, comme s'il s'agissait de déchiffrer l'énigme du temps «par les images qu'il a déposées en nous / Disposées en nous selon un ordre qu'il est seul à appréhender» et, ainsi, de parvenir à l'orée de l'origine, dans un mouvement somptueux et sauvage qui sera sans cesse repris tout au long du recueil, comme s'il fallait encore tenter de parvenir à surprendre l'unique secret, celui de la dévitalisation du langage, aujourd'hui livré en pâture «aux pires des êtres», à «ceux dont la vitalité ressemble à la mort», alors qu'il était auparavant capable de vriller «dans l'air entre deux stèles / Pointu comme le pieu de l'amant de la matrone d’Éphèse, entre deux tombes» (p. 11). Il est difficile de considérer l'auteur comme un réactionnaire, fût-il noble, au sens où il tenterait de retrouver la verte vigueur de la langue, sa mythique, son introuvable origine, son éclatante primitivité plusieurs fois pointée mais presque immédiatement moquée, mais il n'en reste pas moins que comme un guerrier nostalgique il s'est engagé, «en parlant une belle langue / Une langue de spadassin idolâtre et terne / Sur les voies déblayées de la tragédie» (p. 12), lui qui ne peut que constater, dépité, la réalité et voir «toutes les images s'effondrer avec un cliquetis sonore / Comme un tas d'armes jetées en vrac au sol» (p. 11). Tout bon navigateur est d'abord un homme pragmatique, qui se dote d'un rigoureux programme, qu'importe qu'il ne concerne que de noirs travailleurs, comme ceux que Rimbaud se plaisait à imaginer en gésine, sortant de leur trou pour quelque prodigieuse aventure de l'âme, si «ce qu'il faudrait écrire», c'est bel et bien «un livre en deçà et au-delà de toute compréhension» (p. 18), une «langue au nord du futur» comme l'écrivait Paul Celan, qui seule peut-être parviendrait à redonner vie et souffle à ces «arches qui flottaient sur les fleuves d'Europe / Avant que les patries spirituelles ne s'effondrent» (p. 22).
Car c'est bien l'essence même du langage (pas seulement poétique à l'évidence) que Marien Defalvard, intrépide ou inconscient comme tous les écrivains de race, veut attraper dans les mailles de son filet savamment tissé, je parle là non seulement de l'ensemble de ses poèmes qui peut être lu comme une espèce de roman déambulatoire dans une géographie aussi méticuleusement pointée qu'imaginaire, mais de quelques-unes des plus belles et longues pièces qu'il contient, et qui peuvent être lues et comprises comme autant d'arts poétiques coruscants et complexes. Prenons ainsi le long poème intitulé Ode à Pithiviers qui ouvre le recueil (pp. 10-26), monologue halluciné (cf. p. 16) qui se clôt, quelques dizaines de poèmes plus loin, sur une Fondation mythique de Pithiviers (pp. 232-5), aussi contenue, elle, resserrée et elliptique que le premier texte était grandiose, rimbaldien dans son long épanchement et son intention programmatique, sorte de remise à jour ou à flot de quelque Bateau ivre tour à tour remontant le cours du fleuve ou bien encalminé sur ses berges, comme s'il s'agissait de déchiffrer l'énigme du temps «par les images qu'il a déposées en nous / Disposées en nous selon un ordre qu'il est seul à appréhender» et, ainsi, de parvenir à l'orée de l'origine, dans un mouvement somptueux et sauvage qui sera sans cesse repris tout au long du recueil, comme s'il fallait encore tenter de parvenir à surprendre l'unique secret, celui de la dévitalisation du langage, aujourd'hui livré en pâture «aux pires des êtres», à «ceux dont la vitalité ressemble à la mort», alors qu'il était auparavant capable de vriller «dans l'air entre deux stèles / Pointu comme le pieu de l'amant de la matrone d’Éphèse, entre deux tombes» (p. 11). Il est difficile de considérer l'auteur comme un réactionnaire, fût-il noble, au sens où il tenterait de retrouver la verte vigueur de la langue, sa mythique, son introuvable origine, son éclatante primitivité plusieurs fois pointée mais presque immédiatement moquée, mais il n'en reste pas moins que comme un guerrier nostalgique il s'est engagé, «en parlant une belle langue / Une langue de spadassin idolâtre et terne / Sur les voies déblayées de la tragédie» (p. 12), lui qui ne peut que constater, dépité, la réalité et voir «toutes les images s'effondrer avec un cliquetis sonore / Comme un tas d'armes jetées en vrac au sol» (p. 11). Tout bon navigateur est d'abord un homme pragmatique, qui se dote d'un rigoureux programme, qu'importe qu'il ne concerne que de noirs travailleurs, comme ceux que Rimbaud se plaisait à imaginer en gésine, sortant de leur trou pour quelque prodigieuse aventure de l'âme, si «ce qu'il faudrait écrire», c'est bel et bien «un livre en deçà et au-delà de toute compréhension» (p. 18), une «langue au nord du futur» comme l'écrivait Paul Celan, qui seule peut-être parviendrait à redonner vie et souffle à ces «arches qui flottaient sur les fleuves d'Europe / Avant que les patries spirituelles ne s'effondrent» (p. 22).Et pourtant, je l'ai dit, toute remontée de fleuve est un échec, car sa source est introuvable, origine noire et trompeuse des mots mensongers comme ceux de Kurtz, vacillant mirage de l'identité pour le poète, où «Il faut entrer en son oubli comme dans une ombilicale chaumière, bien chauffée / Ou comme dans la mort de son père; / Paysage impalpable qui s'étage sous les horizons / Voilà ce qui loge petitement en ce mot, / Comme un tiroir déplié à l'infini, et qui ne débouche sur rien qu'une absence».
Marien Defalvard, remarquable lecteur avant que d'être écrivain (car cela se tient bien évidemment) ne saurait être la dupe de l'aporie qu'il ne cesse lui-même d'excorier et de gratter, comme un maître en supplice ne désirant rien d'autre que voluptueusement creuser la plaie qu'il s'est lui-même infligée : «Y a-t-il un état d'innocence qui, dans la convoitise, rende à son unité ?» se demande-t-il, avant de répondre au vers suivant : «Aucun, je l'espère. Aucun, aucun» (p. 23). Comme si, en fait, l'écrivain, non seulement ne craignait pas d'employer une langue «qui mène au pire» (p. 12), mais cédait, voluptueusement, au Mal, qui constitue l'une des principales thématiques de ses poèmes, et de celui-ci, qui les résume tous, l'Ode à Pithiviers donc, «Le Mal et ses arborescences plus longues que les chemins blancs de la Margeride dans l'été asphyxié / Le Mal et ses palmures plus nombreuses que les nervures sur les pierres de la Margeride / Le Mal et ses réseaux plus embrouillés que les rues des villages torchés de la Margeride aux pierres grises et asphyxiées / Le Mal et son discours» (p. 15). Le Mal est même le compagnon de route du poète, moins dans la vieille tradition de l'horrible travailleur rimbaldien ou même trakléen que dans la figuration souverainement moderne d'un langage vacillant, qui n'ose plus chanter le monde et qui, s'il se risque à le chanter, est immédiatement mis à découvert, séparé de l'objet de son chant, alors que les anciens chants, pourtant plus forts que le sont les nôtres, parvenaient, mais miraculeusement, à toucher et figurer la réalité au travers même de leur échec, comme par exemple «les chants de Pise [qui], s'ils vont loin dans la crypte, s'ils y résonnent / C'est que, tandis que la foule était écrasée de volupté, qu'elle avait trouvé un accord entre elle et elle / Non pas par la raison, mais par la volupté / Tandis que la foule fumait, buvait, mangeait, se baignait, avait chaud / Tandis qu'on ne la séparait plus des oranges vertes, des raisins, des noyers, / Celui qui les traça, dans un matin trop creux ou dans un soir confus / Voyait s'enferrer dans l'échec son image» (p. 24). Notre échec lui-même est diminué, n'est plus que l'ombre d'une ombre, n'a plus la grandeur passée. Notre échec est minable alors que l'échec des grands poètes avait du panache, et pour vertu souveraine de nous indiquer, à tout le moins, ce que manquait le langage, non pas «l'image de Pithiviers» se rétractant «sur le réel d'un minuscule oppidum gris» (p. 11), ni même les forêts «vides de tombes», où «c'est l'oubli qui semble peupler leurs hectares» (p. 26), mais un monde non point plus grand ni plus spectaculaire, mais dirait-on plus précisément ajointé aux mots, pourquoi pas ceux de ces chants de Pise que l'on peut «fondre à de plus hautes expériences», car ils sont «une argile renouvelable, qu'on peut remodeler» et parce qu'ils «ont été écrits / Parmi les pins, les fresques, l'insolence, les figuiers sauvages / Et qu'ils contenaient le thrène misérable d'espoir avili, de la croyance devenue risée des hommes» (p. 23).
La Fondation mythique de Pithiviers redit ce «temps d'avant les pôles; / D'avant le regret, d'avant l'image vue comme image, incomprise encore / Dans sa gangue absolument pure, parce qu'imparlable» (p. 232), Marien Defalvard semblant penser qu'il existe une pureté inévitablement perdue avec l'accession, par l'homme, au langage, puisque cette pureté n'existait qu'avant que le monde ne soit bruissant d'aucun son, pas même, d'aucun rêve de langage, et qu'il se suffisait en somme à lui-même, à sa propre joie muette, comme si nous étions confrontés à une «obsession d'ontologie du paysage, sans discours» (p. 233), et que tout le mince travail du poète, bien qu'essentiel, était de retrouver une fondation mythique de l'univers, et d'abord de Pithiviers, en évoquant les «noms des premiers temps : Grégoire, Lyé, Gault" qui désormais sont éloignés «à l'exemple des chemins de croix enfoncés dans la terre» (p. 235).
Mais pas de nostalgie je le redis, ou si peu qu'elle ne peut être comprise que comme une faute, un manquement, une faiblesse qu'il sera difficile, pour le poète, de se pardonner puisque, comme l'autre auprès duquel tout génie est jaugé, il faut tenir le pas gagné : «Il n'y a pas, dans les planches sur lesquelles je m'installe en attendant le fracas grasseyant du tonnerre, / De nostalgie particulière, paradoxale, ou simplement de regret de la foule d'avant» (Toulouse (31) - Saint-Just Saint-Rambert (42), p. 30), même s'il faut pourtant revenir «là où aurait dû se passer l'avènement manqué de l'écriture, sans connaître rien de ses présupposés !» (p. 31), alors «que rien ne nous sépare de la lumière mal usée dans le passé / Que l'oubli considérable des hommes» (p. 29).
Cette quête paradoxale, à la fois consciente de ce qui a été perdu et qu'il faut donc regagner, sans pour autant sombrer dans l'infantilisme élégiaque des romantiques chantant le passé irrémédiablement perdu, peut-être s'explique-t-elle parce que notre écrivain affirme que «l'élémentaire de la foi» est «à jamais réfractaire à [sa] nature» (La Chapelle-Montligeon, p. 33), et cela alors même qu'il faut bien se contenter de vivre dans «une chrétienté parodique / Une naine blanche chrétienne dans un trou noir apostolique», dans un monde désormais phagocyté par les formes devenues folles, alors qu'autrefois, «les formes n'avaient pas encore explosé, leur structure / S'amalgamait à l'être / Et notre regard cousait la forme à son trône, la diction à son parlement» (Domme 1999, Châtel-Montagne 2015, pp. 34-5).
Cette indécision, que nous estimons plus ontologique que psychologique, sera l'un des mouvements les plus réguliers et fascinants de ce recueil surécrit : il faut être absolument moderne bien sûr, mais il est évident que nous avons perdu quelque chose, un surcroît de puissance langagière, une forme de réelle présence au monde qui n'avait le plus souvent même pas besoin d'être évoquée ou dite, puisque sa plus haute déhiscence coïncidait avec sa plus implacable évidence. La pire des brutes le sait : sa brutalité est peut-être due à quelque manquement invisible dont il n'est même pas coupable, comme un flanchement brutal de l'époque, un creux de vague, laquelle, autrefois, portait loin les hommes.
 De ce piège ou, si l'on veut, de ce nœud gordien, les poème de Marien Defalvard ne sortiront jamais, qui répèteront, jusqu'au dégoût, la certitude de la perte d'une parole qui fut plus haute et forte qu'elle ne l'est («Et personne ne sait quelle glaciation a rompu / Les jambes des phrases normales», Mouthe, p. 37), mais aussi d'une époque non point sacrée mais sacrale, sacralisante même, à la différence de la nôtre («Le gour des événements mal sacrés, sacrés trop tard, sans contrepartie divine», Trauerarbeit, p. 49), puisqu'elle élevait le geste le plus humble à hauteur de frise où se découpaient les vies de tous les autres hommes, avec lesquels faire ensemble et, qui sait, danse sensuelle et violente («un temps aboli, / Où les cadenassages dogmatiques étaient si bien ficelés / Que le manque de lumière, de couleur, de stupeur devant la lumière calculante / N'était pas vécu comme plainte mimétique / Mais comme bassin de la substance à la lèvre des jours», Contradiction de l'éternel retour..., p. 47) et, de l'autre côté, la déchéance actuelle, du langage comme des lieux sans relâche arpentés, puisque «nous sommes aussi à l'intérieur de ce rêve comme une passion mutique dans les ravinements de la langue» (Le viaduc du Blanc, p. 43).
De ce piège ou, si l'on veut, de ce nœud gordien, les poème de Marien Defalvard ne sortiront jamais, qui répèteront, jusqu'au dégoût, la certitude de la perte d'une parole qui fut plus haute et forte qu'elle ne l'est («Et personne ne sait quelle glaciation a rompu / Les jambes des phrases normales», Mouthe, p. 37), mais aussi d'une époque non point sacrée mais sacrale, sacralisante même, à la différence de la nôtre («Le gour des événements mal sacrés, sacrés trop tard, sans contrepartie divine», Trauerarbeit, p. 49), puisqu'elle élevait le geste le plus humble à hauteur de frise où se découpaient les vies de tous les autres hommes, avec lesquels faire ensemble et, qui sait, danse sensuelle et violente («un temps aboli, / Où les cadenassages dogmatiques étaient si bien ficelés / Que le manque de lumière, de couleur, de stupeur devant la lumière calculante / N'était pas vécu comme plainte mimétique / Mais comme bassin de la substance à la lèvre des jours», Contradiction de l'éternel retour..., p. 47) et, de l'autre côté, la déchéance actuelle, du langage comme des lieux sans relâche arpentés, puisque «nous sommes aussi à l'intérieur de ce rêve comme une passion mutique dans les ravinements de la langue» (Le viaduc du Blanc, p. 43).Puis reste le rêve maudit, la quête circonscrite par la laideur, l'absence de force, de profondeur («Ne voyez-vous pas que la profondeur est pastiche ?», Clermont-Ferrand une fois pour toutes, p. 61), de foi («Ici, les vieux décalogues de la foi, même sans sacré au menuet, / Sont restés précis comme l'aiguille enfoncée sous la peau», ibid., p. 65), le Mal qui rôde, non point décuplé mais disséminé, rhizomisé, tentaculaire, l'écriture d'un grand livre, d'un livre unique, du livre même, d'un seul poème «Sur la cause de tous les autres poèmes» (Chambon-sur-Voueize, p. 45). L'exigence du moderne, qu'il le veuille ou non, qu'il en soit conscient ou pas, est toujours un geste prométhéen, une révolte en somme, puisque le seul geste encore acceptable et valable reste la révolte, pour tenter de s'extirper d'un univers qui ne vise plus que la stase des mourants de sanatorium.
Mais, hélas, et c'est le constat ultime sur lequel se clôt le deuxième chapitre du recueil, «Tout porte la marque d'une déficience du langage» (Clermont-Ferrand une fois pour toutes, p. 66) bellement comparé à une «grenade consumée (Un coup d’État, p. 75) qu'il s'agit, une fois de plus, de remotiver, de réenchanter, en remontant «les fleuves embourbés» car, parfois, «le nom s'infiltre dans la boue, archaïque» (Je vois Satan tomber, etc., p. 70), et aussi parce que «Les phrases des autres sont des lierres primitifs» (Et ma mauvaise imitation, p. 78). Une grenade, arme plus que fruit, reste toujours dangereuse pour celui qui prétend creuser une brèche dans les contreforts du langage massifié, concentré.
Si le langage est «épuisé et perclus» (Le centre de la vie est vide comme une arène, p. 85), il n'en faut pas moins parier, crânement, sur le fait que «le langage tient», car c'est «rassérénant / De croire au langage une fois de plus / De croire aux bienfaits du langage», de le voir «tendu comme un pont de lianes», même s'il tient, se dépêche d'ajouter Marien Defalvard, «hors de lui, il tient sans ferveur, / Il tient comme tiennent les vieux tableaux de genre», lequel essaie, comme toujours, de s'étrangler «au seuil du mot», du «mot accidentel, essentiel, admirable / Qui ne sera jamais dit» (Le langage tient, pp. 82-4).
Admirable mouvement que celui d'évoquer des «phrases anorexiques» (Le centre de la vie est vide comme une arène, p. 86), d'admettre tranquillement que le langage s'affaiblit (cf. p. 98, Six années (2008-2014)), d'être capable d'affirmer que la «vraie damnation c'est de ne pouvoir exprimer / De ne pouvoir donner forme dans les moyeux obsédés du langage» (La vraie damnation, p. 94), et pourtant de poursuivre l'inlassable recherche d'une «phrase serrée, comme le cordage minutieux» (
Le chapitre IV de notre recueil contient des poèmes assez hermétiques, qui ne sont pas les plus intéressants à notre sens, et c'est le poème intitulé Pas de garantie à la pureté, au symbolique, au désir qui nous réintroduit au plus près de la problématique que nous avons développée, à savoir un questionnement perpétuel sur les puissances du langage face au monde. Ainsi, si c'est bien abolir «la finalité cachée du langage» qui importe, autant essayer de vivre en s'en passant (mais c'est impossible), afin d'obtenir «l'inaliénable gain singulier, / Qu'aucune parole ne peut dissoudre en son fief» (pp. 143-4) puisque, après tout, comme semble nous le dire le poème intitulé L'échange impossible, «Corrodé, l'acte; / Corrodée, la pénétration du signe, / Les corps sont des écluses où passent des échardes» (p. 146) et que la parole n'est tout au mieux que la «réticente partenaire» (Apprendre la parole du sacrifice, p. 147) du poète qui doit se débrouiller avec ce dont il dispose après Babel, pour le dire avec George Steiner, non point l'unicité, «vibrante plainte» d'avant la séparation des langues, réelle présence où de mystérieux signes n'étaient point séparés du monde : «Je me souviens à peine des inscriptions d'avant Babel. / Elles sont comme les fentes cunéiformes des glaises», comme des «Images diluées dans le tournoiement du même présent. / Sous le ventre des mots, comme sous ceux des insectes, / On découvrait une bigarrure dorée tendre à la main», étant donné qu'avant la chute de la tour légendaire, «c'était des témoins, des parties jouées» alors qu'après, ce ne sont «que de sournoises et corruptrices métaphores» (Avant Babel, pp. 149-50).
Curieusement, Marien Defalvard, je l'ai dit, ne témoigne absolument pas d'un tropisme que nous pourrions qualifier de monomaniaque dans son obsession. Il sait, comme tout écrivain conscient de ses moyens et connaissant les textes de celles et ceux qui l'ont précédé, que le sens est perdu, lui qui, auparavant, ne pouvait être séparé des réalités les plus humbles («Et le sens passait par l'étable avant de se laver le cou», Pour ou contre Lucrèce, p. 156), mais il fait aussi le pari que «Nous reviendrons dans le langage si tard, mon ami, / Que du nœud bien serré du poème, de son nombril, / Ne jailliront que poussières, cendres, particules fanées / Une boisson incolore, picturale, mélangée de repentirs», ibid., p. 158). Il avoue avoir tenu au langage «comme à la peau de [sa] mère, à son tissu réceptif», et pourtant il sait aussi que «la résolution du langage sera offerte par le langage lui-même, sans nous / Et que nous restons les yeux clos, épuisés, comme des colonnes logiques d'indifférence» (Le professeur et son mirage, p. 160).
 Devant ce constat qui toujours oscille entre l'inventaire méthodique de ce qui a été perdu, ce jaillissement primesautier où «les noms propres étaient plus communs que les autres» (Un seul nom pour le poème, p. 164), la quête de l'origine est elle-même un leurre, plus puissant sinon maléfique que les autres, comme tente de le dire un magnifique poème métaphysique de bout en bout, intitulé L'origine, qui résume notre propos et le complète en s'ouvrant à une perspective apocalyptique, lorsque «l'origine sera transvasée en une autre matière», à moins que nous guette une issue plus funeste, dans laquelle «le mot aura valeur de cercle damné, ans eau, sans eau», alors même que nous «hésiterons entre nommer cela la bénédiction du désastre ou la punition des repentis» (p. 173). Cette révélation, au sens étymologique du terme, qui ne peut advenir qu'en nous surprenant et en déchaînant la violence, fera paradoxalement triompher le langage dans et par le silence : «Je suis un corps sans passions, attendant un silence qui ne viendra / Qu'après un rachat intégral de nos actes» (Règle d'un matin d'été, p. 185). Mais c'est aussi ce nouvel élan qui nous fera découvrir «des déserts de pensée, / Des religions non encore cristallisées, dont le mystère manque» (ibid., p. 186), un nouvel âge du verbe qui, comme celui qui s'est enfui ou a été détruit justifiera «sans phrases gel, stuc, eaux planches» (Cowper Powys, p. 188), ou bien encore quelque nouvelle ère grosse de merveilles, durant laquelle «Jacob se battrait avec l'ange du langage, de l'extinction du langage» (Le mythe, Jacob et l'herbe, p. 190).
Devant ce constat qui toujours oscille entre l'inventaire méthodique de ce qui a été perdu, ce jaillissement primesautier où «les noms propres étaient plus communs que les autres» (Un seul nom pour le poème, p. 164), la quête de l'origine est elle-même un leurre, plus puissant sinon maléfique que les autres, comme tente de le dire un magnifique poème métaphysique de bout en bout, intitulé L'origine, qui résume notre propos et le complète en s'ouvrant à une perspective apocalyptique, lorsque «l'origine sera transvasée en une autre matière», à moins que nous guette une issue plus funeste, dans laquelle «le mot aura valeur de cercle damné, ans eau, sans eau», alors même que nous «hésiterons entre nommer cela la bénédiction du désastre ou la punition des repentis» (p. 173). Cette révélation, au sens étymologique du terme, qui ne peut advenir qu'en nous surprenant et en déchaînant la violence, fera paradoxalement triompher le langage dans et par le silence : «Je suis un corps sans passions, attendant un silence qui ne viendra / Qu'après un rachat intégral de nos actes» (Règle d'un matin d'été, p. 185). Mais c'est aussi ce nouvel élan qui nous fera découvrir «des déserts de pensée, / Des religions non encore cristallisées, dont le mystère manque» (ibid., p. 186), un nouvel âge du verbe qui, comme celui qui s'est enfui ou a été détruit justifiera «sans phrases gel, stuc, eaux planches» (Cowper Powys, p. 188), ou bien encore quelque nouvelle ère grosse de merveilles, durant laquelle «Jacob se battrait avec l'ange du langage, de l'extinction du langage» (Le mythe, Jacob et l'herbe, p. 190).De sorte qu'il faut un secours au poète, dont la condition, semble nous suggérer Marien Defalvard, est moins celle de l'homme qui ne cesse de se lamenter sur ce qu'il a perdu, que celle de celui qui se tient dans la pure négativité, face à «l'objet de foi qui se dissout» (ibid., p. 192). Ainsi, l'écrivain est moins celui qui ne cesse de lorgner vers l'origine perdue, «L'acidité des matins du miracle» (La barbarie éternelle, p. 198), où le langage, nous l'avons vu, était plus puissant et mieux ajointé au monde, que celui qui sait qu'il mourra «en escaladant le temps impropre et l'espace négligent» (La mer d'Aral, p. 194), et qui osera pénétrer dans «L'oubli de la langue qui est [son] narthex» en oubliant «l'impérial logos, cette mèche allumée par les pentes combustibles du temps» (Hellénismes, p. 200), et peut-être même en faisant lui-même le sacrifice de son don, imaginé défait et consumé dans quelque rival ou bien double expiateur : «Qu'un autre poète, presque mutique au pied de son Dieu impossible, / Quêté dans l'avortement et l'entrave / Décoloré depuis le début, dans le langage stérile, / Dans la pénéplaine du langage plus stérile que l'eau verte et boueuse du Jarama, / Que l'instant plumitif, / Qu'un autre poète ait été castré devant le mot, le bief du mot, la lance du mot» (Mépris, p. 203).
Nous n'avons pour l'heure pas évoqué l'une des grandes thématiques de ce magnifique et puissant recueil de Marien Defalvard, à savoir le Mal, «Les mille bouches du Mal» (L'éblouissement, p. 225) qui n'est jamais plus coriace et subtil que lorsqu'il s'exerce non seulement par l'entremise de celui qui écrit mais sur lui-même, comme oblation de son don verbal, satanique haine pour une parole qui pourrait être rédimée mais qui ne le sera pas, par choix dirait-on de la stérilité, de l'ennui, du vice. Lisant les sonnets de François de Malherbe, Marien Defalvard a beau jeu de saluer «L'épidermique cadenassage de la langue après de le cadenassage du Ciel», les mots de l'illustre poète échafaudant, «sur l'espace indigent aux scories désertiques, / Une raison verbale, un terreau nettoyé de vocables bruyants» (Lecture des sonnets de François de Malherbe..., p. 209), tout le mythique cortège des grands faiseurs, au sens noble du terme, des puissants nommeurs qui l'ont précédé, s'il sait que seul l'Apocalypse apportera, vraiment, du nouveau, car «C'est lui la langue : vertu sérieuse, métaphore» qui assurément creusera la «fragile couche de civilisation [qui] nous retient» (Malesherbes le 28 septembre 2008 : Ma dernière mémoire, p. 230) ou bien qui, seul, une fois que nous nous tiendrons «après l'histoire», une fois que l'innocence mais aussi toute valeur se sera «dissipée derrière un rideau», nous rendra non point à notre état initial, d'avant la faute de Babel, non point à notre présent état, dans lequel les «phrases demeurent au bord des chemins lisses, dans l'herbe, perdues, passées» (La plaque, p. 221), mais nous convoquera à quelque inimaginable état futur où nous refuserons de baiser «les figures flottantes, / Envenimées du Mal», où nous refuserons de céder «à la lumière du Mal», où nous refuserons d'écouter les «paroles somptueusement tendues comme filets» (Un pronom, p. 161), où nous refuserons de «lécher le sceau du Mal», où nous ne cèderons pas devant «la jeunesse effrayante du Mal» (L'ascension, pp. 174-5), où nous ne refuserons même pas l'évidence de sa beauté, qui «n'est pas vraiment une découverte», où nous ne verrons même pas «le siècle, la stèle élevée par les paysans et la grande nuit des bourreaux venir comme une péroraison infernale» (Totenkopf (557 mètres) - Mont Sinaï (286 mètres), p. 196), mais où nous saurons, enfin, «que l'homme est reflété par l'altitude, / Que c'est elle qui l'a saisi» (Septentrion, p. 152).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, poésie, marien defalvard, narthex, éditions exils |  |
|  Imprimer
Imprimer




























































