« Entretien avec le Club Roger Nimier | Page d'accueil | L’Argent de Charles Péguy, par Gregory Mion »
30/09/2017
Les réincarnations de l’incarnation. À propos de La religion industrielle de Pierre Musso, par Baptiste Rappin

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Baptiste Rappin dans la Zone.
Baptiste Rappin dans la Zone.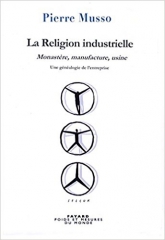 Acheter La religion industrielle de Pierre Musso sur Amazon.
Acheter La religion industrielle de Pierre Musso sur Amazon.Qu’est-ce que la religion industrielle? Une métamorphose du monothéisme chrétien d’Occident, construite longuement de façon souterraine, puis ouvertement contre la religion théologico-politique, sous la forme d’un «nouveau christianisme» qui noue les éléments mis au jour par les Lumières : l’Incarnation dans l’Humanité s’auto-accomplissant dans l’Histoire, dont on peut désormais identifier des «lois» de développement (1).
Dans le cas occidental, nous avons affaire au mythe rationnel issu de la longue histoire du montage judéo-romano-chrétien sécularisé, de sorte que, sous l’emprise de la techno-science-économie, nous n’avons plus affaire au Despote divin dont se réclamait l’État monarchique d’Ancien Régime – joint, cheville, le principe politique d’harmonie entre le scénario et le droit –, mais à la Comptabilité universelle instaurant le règne des chiffres, nouvelle référence souveraine capable de tenir sous sa coupe toute forme politique après s’être adjugé le scenario fondateur et, par voie de conséquence, les pratiques juridiques (2).
Est-il exagéré d’affirmer que l’entreprise cristallise une part importante des débats contemporains ? Question rhétorique bien sûr, tant elle se trouve au centre des controverses économiques et sociologiques qui opposent les hommes politiques ne sachant plus quelle mesure proposer pour accroître leur efficacité et, de la sorte, orienter la France dans la direction de la prospérité, laquelle, cela va sans dire, une fois présente et durablement installée, résoudra définitivement l’ensemble des problèmes, des dysfonctionnements et des anomalies de l’époque. Mais en sus de cette actualité qui saute aux yeux de chacun, l’entreprise fait également l’objet de querelles scientifiques et philosophiques : pour les économistes libéraux, dits néo-classiques, elle est une exception qui échappe dangereusement à la loi du marché dont les seuls acteurs théoriques sont des individus rationnels et calculateurs; pour les scientifiques de l’homme, elle procède d’une construction sociale et s’avère être le lieu d’exercice de jeux de pouvoir et de violence symbolique ; pour les psychologues, elle produit la souffrance ou l’épanouissement des salariés; pour les ingénieurs encore, elle ressemble à une machine dont il faut arranger les paramètres de façon optimale afin de produire efficacement. Les juristes, quant à eux, ne sont pas mieux lotis qui définissent l’entreprise sous le seul prisme de la «liberté d’entreprise» (3), c’est-à-dire de la capacité d’agir, et ne l’appréhendent principalement que sous l’aspect des multiples formes ou statuts dont elle peut se revêtir. En d’autres termes, cette réalité si commune, si partagée, – qui aujourd’hui ne se trouve pas en lien, direct ou indirect, avec une entreprise ? –, ne se laisse contrairement aux apparences guère aisément appréhendée, et c’est certainement l’une des raisons majeures, outre l’idéologie et l’ignorance qu’il ne faudrait point ici omettre, pour laquelle convergent vers elle tant de tensions, de haines et d’incompréhensions.
 C’est dans ce contexte que l’ouvrage de Pierre Musso, La religion industrielle, sous-titré «Monastère, manufacture, usine : une généalogie de l’entreprise», se trouve plus que le bienvenu; comme la balle du jeu de paume, on peut même dire qu’il tombe à pic. Le livre est certes volumineux (792 pages), mais se lit agréablement car le philosophe fit le choix d’une écriture simple, dépouillée, sans jargon ni fioritures. Plus outre, Pierre Musso fait montre d’une prodigieuse érudition qu’il ne confond pas avec l’étalage kitch de la polymathie car il la met au service de son projet généalogique : une gigantesque fresque de l’histoire occidentale qui prend ses racines dans la réforme grégorienne, à la charnière des XIe et XIIe siècles, et se clôt à la période contemporaine, sans que le lecteur ne perde à quelque instant que ce soit le fil directeur de l’argumentation. D’une part, il s’avère bien expédient de relever et de soutenir cette ambition, car trop d’historiens se complaisent aujourd’hui dans l’histoire en miettes (4) sans qu’aucune intelligibilité globale ne puisse en sourdre; et quand bien même les histoires du rivage (5), du viol (6) ou du diable (7), pour ne prendre ici que quelques exemples significatifs, se révèlent bien agréables à la lecture, force est pourtant de remarquer que l’histoire sérielle, issue de l’archéologie foucaldienne, désespère le lecteur soucieux d’acquérir une compréhension générale du mouvement historique occidental – un tel désir ne faisant pas nécessairement appel à une philosophie de l’Histoire comme le ressassent à l’envi les déconstructeurs. De ce point de vue, il faut reconnaître à Pierre Musso le talent d’éviter tant le piège de la linéarité que l’impasse du déterminisme en faisant état, pour chacune des trois périodes qu’il dégage, de points de bifurcation lors desquels une option contingente s’impose parmi d’autres. Si elle détermine largement ce qui la suit – «le commencement est la moitié du tout» rappelle la sentence pythagoricienne –, la bifurcation résulte bien quant à elle d’un choix ou d’une lutte remportée. D’autre part, l’angle d’attaque du philosophe implique que le généalogique ne se réduise pas à l’historique; la chronologie ne peut en effet faire office de quête des origines. On lit ainsi sous la plume du philosophe de nombreuses références à des historiens bien sûr, mais aussi à des anthropologues, à des sociologues, à des juristes, à des ingénieurs, à des philosophes et même à des théologiens. Car l’hypothèse centrale de l’ouvrage est explicitement la suivante, stimulante à souhait, provocatrice à l’envi : l’entreprise doit être comprise et pensée dans le cadre de la théologie chrétienne de l’Incarnation. Formulé en d’autres termes, l’industrie a pris la place de la religion, elle est même la nouvelle religion, ou, pour citer l’auteur qui prend justement soin d’éviter ce terme si usé qu’il sue grassement de tous ses pores et qui emprunte l’expression au Paul Valéry de La politique de l’esprit, «elle est la structure fiduciaire qui fait tenir l’édifice occidental» (p. 40). Non sans quelque amusement, nous imaginons déjà économistes, sociologues, psychologues et gestionnaires tomber de leur chaise…
C’est dans ce contexte que l’ouvrage de Pierre Musso, La religion industrielle, sous-titré «Monastère, manufacture, usine : une généalogie de l’entreprise», se trouve plus que le bienvenu; comme la balle du jeu de paume, on peut même dire qu’il tombe à pic. Le livre est certes volumineux (792 pages), mais se lit agréablement car le philosophe fit le choix d’une écriture simple, dépouillée, sans jargon ni fioritures. Plus outre, Pierre Musso fait montre d’une prodigieuse érudition qu’il ne confond pas avec l’étalage kitch de la polymathie car il la met au service de son projet généalogique : une gigantesque fresque de l’histoire occidentale qui prend ses racines dans la réforme grégorienne, à la charnière des XIe et XIIe siècles, et se clôt à la période contemporaine, sans que le lecteur ne perde à quelque instant que ce soit le fil directeur de l’argumentation. D’une part, il s’avère bien expédient de relever et de soutenir cette ambition, car trop d’historiens se complaisent aujourd’hui dans l’histoire en miettes (4) sans qu’aucune intelligibilité globale ne puisse en sourdre; et quand bien même les histoires du rivage (5), du viol (6) ou du diable (7), pour ne prendre ici que quelques exemples significatifs, se révèlent bien agréables à la lecture, force est pourtant de remarquer que l’histoire sérielle, issue de l’archéologie foucaldienne, désespère le lecteur soucieux d’acquérir une compréhension générale du mouvement historique occidental – un tel désir ne faisant pas nécessairement appel à une philosophie de l’Histoire comme le ressassent à l’envi les déconstructeurs. De ce point de vue, il faut reconnaître à Pierre Musso le talent d’éviter tant le piège de la linéarité que l’impasse du déterminisme en faisant état, pour chacune des trois périodes qu’il dégage, de points de bifurcation lors desquels une option contingente s’impose parmi d’autres. Si elle détermine largement ce qui la suit – «le commencement est la moitié du tout» rappelle la sentence pythagoricienne –, la bifurcation résulte bien quant à elle d’un choix ou d’une lutte remportée. D’autre part, l’angle d’attaque du philosophe implique que le généalogique ne se réduise pas à l’historique; la chronologie ne peut en effet faire office de quête des origines. On lit ainsi sous la plume du philosophe de nombreuses références à des historiens bien sûr, mais aussi à des anthropologues, à des sociologues, à des juristes, à des ingénieurs, à des philosophes et même à des théologiens. Car l’hypothèse centrale de l’ouvrage est explicitement la suivante, stimulante à souhait, provocatrice à l’envi : l’entreprise doit être comprise et pensée dans le cadre de la théologie chrétienne de l’Incarnation. Formulé en d’autres termes, l’industrie a pris la place de la religion, elle est même la nouvelle religion, ou, pour citer l’auteur qui prend justement soin d’éviter ce terme si usé qu’il sue grassement de tous ses pores et qui emprunte l’expression au Paul Valéry de La politique de l’esprit, «elle est la structure fiduciaire qui fait tenir l’édifice occidental» (p. 40). Non sans quelque amusement, nous imaginons déjà économistes, sociologues, psychologues et gestionnaires tomber de leur chaise… Voilà donc qui est clair comme de l’eau de roche : à qui prétend comprendre l’entreprise, sa nature, sa fonction, son histoire, il n’est guère d’autre option que celle de procéder à un audacieux «pas en arrière» d’allure toute heideggérienne : et c’est bien vers la théologie de l’Incarnation qu’il s’agit en l’espèce de rétrocéder afin de saisir d’une part ce qu’elle a en propre, cette singulière expérience du monde qui la sépare d’autres formes élémentaires de la vie religieuse, et d’autre part les possibles qu’elle lègue à l’historicité occidentale. Le Dictionnaire critique de la théologie rappelle que le terme d’Incarnation renvoie au prologue de l’Évangile de Jean dans lequel il est affirmé que «le Verbe s’est fait chair» (8). Non seulement Dieu s’est-il manifesté comme événement historique en prenant la forme charnelle du Fils – drôle d’aventure à propos de laquelle s’affronteront érudits et théologiens pour fixer le rapport des personnes dans la Trinité ainsi que la nature de Jésus le Christ –, mais en sus s’est-il attribué la mortalité et la finitude de la chair, ce qui allait conférer à l’Incarnation deux caractères fondamentaux du point de vue d’une généalogie de l’entreprise : elle possède un cycle de vie, autrement dit le corps qui accueille Dieu est voué à disparaître, ce qui implique comme corollaire son caractère dynamique, c’est-à-dire la possibilité de se réincarner. Le lecteur commence alors à percevoir le chemin méandreux vers lequel Pierre Musso aimerait l’entraîner : l’entreprise ne serait-elle pas en fin de compte, à la suite du monastère et de la manufacture, le Corps d’une nouvelle Incarnation, une nouvelle ecclesia ?
Le philosophe généalogiste, s’il s’inspire explicitement de l’anthropologie dogmatique de Pierre Legendre, nous reviendrons plus bas sur la nature et l’objet de cette filiation, nous semble également de ce point de vue étonnamment proche des thèses du Carl Schmitt de La visibilité de l’Église et de Catholicisme romain et forme politique qu’il ne cite pourtant pas. Car si le juriste allemand se trouve convoqué dans l’ouvrage de Musso, c’est bien plutôt en raison de son appréhension du politique qu’en vertu de ses thèses sur le catholicisme romain. Pourtant, Schmitt appuie sa réflexion politique, de facture institutionnaliste, sur l’Incarnation, lieu d’une médiation visible qui, sur le plan horizontal, assemble les personnes en une communauté, et, sur le plan vertical, lie le haut et le bas. L’Incarnation, «cette unique révolution de l’histoire mondiale» (9), ouvre la possibilité du katechon, c’est-à-dire de l’existence d’une puissance qui retarde voire empêche l’arrivée de la fin des temps. Ici se noue ce qui sépare l’itinéraire de Schmitt et la réflexion de Musso : car si tous deux accordent un rôle prééminent à l’Incarnation et à la médiation, au tiers-terme, le premier adopte un point de vue eschatologique et insiste sur la nécessaire stabilité de l’institution catholique qu’il considère comme la clef de voûte de la cité, tandis que le second, par son effort généalogique, insiste sur leur plasticité et leur potentiel métamorphique.
La première pièce de l’assemblage a été décrite, venons-en à la seconde : la rationalité. Car, si corps il y a, si réceptacle il existe, encore faut-il identifier et mettre la main sur ce qui se fait chair et s’incorpore, et constitue ainsi le second relata de la relation d’Incarnation. Eh bien, Pierre Musso suit l’ascension progressive de la technique et de son pouvoir arraisonnant : il en décèle une première occurrence dans les monastères qui célèbrent le travail comme vecteur d’union à Dieu; il en perçoit une seconde dans la manufacture au sein de laquelle s’épanouissent les fruits de la science moderne; il en identifie enfin une troisième en l’usine, puis en l’entreprise, qui témoignent toutes deux du projet triomphant de la révolution industrielle. L’auteur résume cette histoire de la façon suivante : «Le scenario fondateur de la religion industrielle s’appuie ainsi sur deux piliers : d’une part, un mystère longuement élaboré, devenu un mythe, celui de l’Incarnation, laquelle se voit transférée du Christ à la Nature puis à l’Humanité, et d’autre part, une rationalité qui, elle aussi, prend diverses formes se superposant : cette rationalité a d’abord été une raison normative ou légale (lois divines), puis elle est devenue une rationalité scientifique (lois de la science) et enfin une rationalité organisationnelle ou sociale (lois de l’histoire) avec la formulation de la religion industrielle au XIXe siècle et de la science des ingénieurs investie dans le management» (pp. 56-8).
On comprend alors que Pierre Musso s’en prenne à la thèse du désenchantement du monde formulée par Max Weber. Pour ce dernier, en effet, modernité rimerait avec sortie de la religion, maîtrise rationnelle du monde, primat de l’idéaltype bureaucratique, éviction des autorités charismatique et traditionnelle. Tout au contraire, notre auteur met en exergue le phénomène de désécularisation accompagnant la formulation de la religion industrielle qui, comme toute religion, requiert un appareil de croyances et une structure fiduciaire.
Mais d’où provient néanmoins ce pouvoir décisif de la raison en Europe puis en Occident et dans le Monde avec la planétarisation de la Technique ? C’est ici qu’il convient de pointer les deux principales sources d’inspiration de Pierre Musso : l’historien du droit américain Harold Berman et le juriste français Pierre Legendre.
De l’œuvre du premier (10), notre philosophe retient l’idée de la révolution grégorienne, c’est-à-dire de la naissance de la tradition juridique européenne au tournant des XIe et XIIe siècles. Pour Berman, la naissance du droit canon, qui donna plus tard ses assises à l’ensemble des branches du droit telles que nous les connaissons encore aujourd’hui, correspond à la première grande révolution occidentale, au premier grand chamboulement qui s’empare d’une société dans un laps de temps relativement court. Ici se trouve la matrice révolutionnaire de l’occident qui accouchera de la Réforme protestante, puis des révolutions anglaise, américaine, française et enfin russe. L’apport de Musso consiste alors à mettre en évidence l’existence d’une septième révolution, passé inaperçue et pourtant si structurante pour nos sociétés : la «Révolution industrielle» qui donne précisément son titre à l’ouvrage. Plus outre, le philosophe émet l’hypothèse stimulante selon laquelle le management et la cybernétique, pointes avancées et contemporaines de la société postindustrielle, viendraient clore le cycle de révolutions inauguré par la Reformatio. Ce qui n’est d’ailleurs pas sans faire écho au diagnostic de Berman qui avoue ressentir «une crise sans précèdent des valeurs et de la pensée juridique, pendant laquelle la totalité de nos traditions en la matière est remise en question» (11).
Pour comprendre cette affirmation, il s’avère expédient de se pencher sur la seconde source majeure d’inspiration de l’auteur : Pierre Legendre qui s’efforce de fonder, à travers une série de dix Leçons ardues, une anthropologie dogmatique. Selon le juriste, la réforme grégorienne a abouti à séparer les pouvoirs spirituel et temporel, et se trouve à l’origine de ce qu’il nomme la «Schize» : «La faille, plus exactement une schize, est un trait singulier de l’Occident romano-chrétien. Le système normatif est fendu en deux : d’un côté, le discours de légitimité; la vie des concepts dans la casuistique des règles. Au rebours donc du judaïsme et de l’islam, où l’entrelacement interne de ces deux éléments les a en quelque sorte soudés, c’est-à-dire rendus indissociables au sein de la structure» (12). Le trait distinctif de l’Occident, qui le différencie donc des autres civilisations et permet ainsi de saisir un certain nombre de malentendus voire de frictions contemporains, tiendrait donc à cette dissociation de la légitimité et de la normativité : d’un côté la religion chrétienne et ses formes dérivées, la théologie politique et la théologie économique; de l’autre, l’arsenal rationnel du droit romain, qui vient pallier l’absence de règles civiles dans le Nouveau Testament et pave la voie à l’enquête scientifique puis au règne de la technique. Or, c’est précisément cette structure schizique que met directement en cause l’empire du Management, nouvel avatar du dominium mundi selon Legendre : le programme industriel, déjà dessiné par Saint-Simon au début du XIXe siècle, et dont les sciences de gestion ne sont aujourd’hui qu’un lointain et laborieux écho, élimine, progressivement mais radicalement, toutes les institutions qui assuraient la liaison entre légitimité et normativité : Églises, États, Gouvernements, Académies, Universités, se trouvent tous sommés de quitter le siège du pouvoir et de laisser la place aux hommes d’affaires. Ne subsiste plus que l’organisation, notion empruntée à la biologie naissante avant que la cybernétique n’en finalise la conceptualisation au mitan du XXe siècle, qui n’aspire qu’à son propre fonctionnement : «Désormais, une seule mesure gouvernera les hommes, elle sera scientifico-industrielle» (p. 532), peut affirmer Pierre Musso parvenu au terme de sa démonstration. Un cycle se clôt, celui de la Schize engagée par la révolution papale il y a maintenant neuf siècles, et s’ouvre une nouvelle ère inquiétante dans laquelle légitimé et normativité se rapportent toutes deux à la seule efficacité.
En somme, l’ouvrage de Pierre Musso ne présente pas à proprement parler une histoire de l’entreprise, mais bien plutôt une généalogie de la religion industrielle qui s’avère un puissant schème explicatif de nos sociétés postmodernes avancées. Outre l’érudition et la clarté d’un livre que tout «manager» devrait posséder dans sa bibliothèque en lieu et place des best sellers qui peuplent les étals des halls de gares et d’aéroports, et même maintenant des librairies réputées les plus sérieuses, on retiendra encore en guise de conclusion les trois points suivants qui mériteraient, évidemment, de plus amples développements. Trois éléments que l’auteur ne partagera peut-être pas, mais que l’ouvrage, inévitablement, invite à évoquer.
Le premier concerne la fructueuse confrontation de l’enquête de Pierre Musso à la saga Homo sacer du philosophe italien Giorgio Agamben. Les deux auteurs mettent en effet en évidence, en écho à Carl Schmitt, que le pouvoir politique relève en dernier ressort d’une théologie politique tant dans ses concepts que dans sa structure; mais ils constatent également que la théologie politique s’efface devant une nouvelle forme de gouvernementalité, aujourd’hui triomphante, la théologie économique. Musso et Agamben s’accordent même à diagnostiquer un état d’incubation, pour reprendre ici l’expression de Heidegger à propos du principe de raison : la rationalité gestionnaire plonge en effet ses racines dans des fondements qui déborde le simple cadre postmoderne voire moderne. C’est certainement à ce point que se nouent les premières divergences : déconstructeur dans l’âme, Agamben ne pouvait éviter de mettre en cause la métaphysique grecque, en dénichant le principe de la vie nue dans la philosophie politique d’Aristote, ainsi que la théologie chrétienne en proposant une généalogie du concept d’économie dans la patristique des premiers siècles. Musso, de son côté, ne cède pas aussi facilement aux sirènes de l’abstraction : et si la philosophie et la théologie sont bien sûr convoquées, et fort à propos, elles forment toujours un couple fécond avec l’histoire et l’anthropologie qui leur offrent un contenu vivant et les empêchent de sombrer dans la pure spéculation.
Le second point permet d’assigner des origines, peut-être des causes, à la crise du politique que nous connaissons et qui, cela ne tient pas du hasard, apparaît en même temps que les avancées de la cybernétique et la formation du management contemporain. Saint-Simon avait le sens de l’image : ôtez trente mille fonctionnaires, juristes et métaphysiciens d’État, disait-il dans L’organisateur, et la France n’en pâtira guère; retirez trois mille hommes d’affaires et notre pays ira droit dans le mur. C’est ainsi que la gestion se substitue à la politique, que les écoles de commerce remplacent l’ENA, que les ministres deviennent des animateurs d’équipe et des promoteurs qui distillent les bons slogans sur les plateaux de télévision et de radio. De sorte que le travail généalogique de Pierre Musso, s’il tourne le regard vers le passé, n’en offre pas moins un puissant éclairage sur les temps présents, et semble même trouver une confirmation inattendue dans la récente élection du Président Emmanuel Macron. «La France doit devenir une start-up nation !», disait ce dernier au moins de juin 2017, tandis que Saint-Simon souhaitait déjà faire de la France un «grand atelier» et «une grande manufacture».
Le dernier élément, certainement le plus provocateur, tient à l’étiologie de «la crise de l’esprit» que nous traversons. Il est un diagnostic relativement partagé chez les analystes critiques des temps modernes : à savoir que le délabrement de nos sociétés tiendrait à l’empire d’une rationalité libérale dont les deux bouts, l’économique et le culturel, se trouveraient enfin réunis; c’est en tout cas la désormais célèbre thèse de Jean-Claude Michéa que partagent un bon nombre d’intellectuels anticonformistes. Nous vivrions ainsi le règne de l’individualisme sous toutes ses formes : celui de l’extension indéfinie des droits, celui de l’intérêt court-termiste, celui de la jouissance immédiate, celui du nomadisme généralisé. À cette thèse qui possède assurément le mérite de souligner une partie de la vérité de l’époque, il faudrait tout de même ajouter celle qui affirme que notre monde n’a jamais été aussi organisé, et que l’idéal d’une concurrence pure et parfaite que poursuivent les économistes néoclassiques n’a jamais été aussi éloigné de son incarnation dans la réalité. Nous vivons bien le temps de l’industrie, et même de la post-industrie qui n’en est que la pointe la plus avancée, et de la gestion généralisée; ce projet s’énonce aujourd’hui sous les termes de «management», de «gouvernance» et de «coopération». Mais alors, tirons-en la conséquence ! Lisons plutôt Pierre Musso : «Au début du XIXe siècle, c’est une immense cathédrale fiduciaire qui s’édifie, monument de textes, de discours, dialogues et déclarations, tandis que les usines se multiplient. Elle est surtout le fait des premiers «socialistes» comme on les a (mal) nommés, mieux eût été de les dire «premiers industrialistes» : Henri Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, Étienne Cabet, Pierre Leroux, puis les saint-simoniens, mais aussi Auguste Comte. Chacun formule à sa manière la nouvelle religion mondaine, terrestre, efficace, utile, rationnelle, scientifique…[…] Selon la nouvelle logique qui sous-tend l’édifice fiduciaire, la religion politique qui occupe le devant de la scène va se défaire au profit de la religion industrielle, qui fourbit sa puissance d’adhésion, après les désarrois issus de la Révolution française et pour le siècle qui vient» (p. 460). La religion industrielle qui s’accomplit dans la société managériale provient de l’œuvre foisonnante de ceux que Marx qualifia de «socialistes utopiques» pour y opposer son approche scientifique. Plutôt que de relever du libéralisme, notre époque, faite de quadrillages et de normativités multiples et disséminés, ne serait-elle pas le fruit de ce projet utopique né en réaction à la Révolution française ?
Notes
(1) Pierre Musso, La religion industrielle. Monastère, manufacture, usine : une généalogie de l’entreprise (Fayard, coll. Poids et Mesures du Monde, 2017), p. 459. Sans autre mention, les pages entre parenthèses renvoient à cet ouvrage.
(2) Pierre Legendre, Le point fixe. Nouvelles conférences (Mille et une Nuits, 2010), p. 22.
(3) Article 16 de la Charte européenne des droits fondamentaux.
(4) François Dosse, L’histoire en miettes. Des «Annales» à la «nouvelle histoire» (Pocket, coll. Agora, 1997).
(5) Alain Corbin, Le territoire du vide. L’Occident et le désir du rivage, 1750-1840 (Champs Flammarion, 1988).
(6) Georges Vigarello, Histoire du viol, XVIe-XXe siècle (Éditions du Seuil, coll. Histoire, 1998).
(7) Robert Muchembled, Une histoire du diable, XIIe-XXe siècle (Éditions du Seuil, coll. Histoire, 2000).
(8) Jean-Yves Lacoste (dir.), Dictionnaire critique de la théologie (Presses Universitaires de France, coll. Quadrige, 2007), p. 676 et sq.
(9) Carl Schmitt, La visibilité de l’Église (traduction d’André Doremus, Éditions du Cerf, coll. La nuit surveillée, 2011), p. 145.
(10) L’ouvrage de référence est le premier volume de Droit et Révolution : Harold Berman, Droit & Révolution (traduction de Raoul Audouin, Aix-en-Provence, Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence, 2002). Le sous-titre américain, qui n’apparaît hélas pas dans la traduction française est : «La formation de la tradition juridique occidentale».
(11) Harold Berman, Droit & Révolution, op. cit., p. 49.
(12) Pierre Legendre, Leçons IX. L’autre Bible de l’Occident : le Monument romano-canonique. Étude sur l’architecture dogmatique des sociétés (Fayard, 2009), p. 23.






























































 Imprimer
Imprimer