« Souvenirs sur Francis Pasche : Pasche et la philosophie par Francis Moury | Page d'accueil | La nouvelle gigantomachie, 3 : La garde de l’Institution, par Baptiste Rappin »
27/02/2018
Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ? de Günther Anders, par Gregory Mion

 Günther Anders dans la Zone.
Günther Anders dans la Zone. Gregory Mion dans la Zone.
Gregory Mion dans la Zone.Je dédie cette note à mon père, le combattant de cœur.
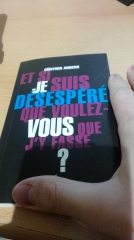 Acheter Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ? sur Amazon.
Acheter Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ? sur Amazon.En 1977, vers le soir de sa vie, Günther Anders accorde un entretien dans lequel il retrace les étapes théoriques et pratiques de son parcours, nous montrant à quel point un esprit philosophique ne saurait faire l’économie des charges émotionnelles du monde concret. Cet entretien est intégralement reproduit dans ce volume au titre si bien choisi : Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ? (1) À la fois question et lamentation, stupeur et désappointement, mais aussi haussement des épaules qui désigne un sursaut de volonté au milieu de la nuit, cette formule n’est autre qu’un principe revendiqué par Anders à la fin de la discussion. Après avoir mis de côté les vertus du courage, de la consolation et de l’espérance, trop connotées, trop réservées aux bavardages rétrospectifs, le philosophe défend le fait que n’importe quelle situation horrible n’empêche pas la spontanéité d’une action et que si nous sentons qu’il y a une toute petite chance d’embrocher les ténèbres, alors il faut s’y engouffrer sans condition, sans réflexion préalable. En outre, on l’aura anticipé, cette préférence de l’intuitif sur le discursif n’est pas un remède contre la désespérance. On peut vouloir participer aux actions de la dernière chance tout en étant remué par un ouragan de consternation. Un cœur impulsif n’est pas exempt d’une raison qui s’est longtemps heurtée à l’horreur sous toutes ses formes. C’est d’ailleurs l’accumulation des difformités du XXe siècle qui aura aussi bien nourri les engagements inconditionnels d’Anders, immédiats et infaillibles, que ses ruminations interminables, indirectes et souterraines, successivement convoquées dans des ouvrages qui ont compté et qui continuent d’interroger les esprits vigilants.
Au fond, lorsqu’on y regarde mieux, la «carrière» de Günther Anders est moins celle d’un universitaire en pantoufles (2) que celle d’un empêcheur de tourner en rond, toujours préoccupé par les convulsions du présent, si nombreuses et si cruellement répétitives au cours de sa vie, autant de secousses qui l’ont conduit à formuler le principe suivant : «Inquiète ton voisin comme toi-même». Tel un cynique aboyant la vérité, chien errant qui prévient de tous les séismes, ou tel Socrate médusant ses interlocuteurs par ses piqûres de rappel, Anders fut en quelque sorte ce qu’il est commun d’appeler aujourd’hui un lanceur d’alerte, dans la droite lignée d’un David Rousset, par exemple, qui ne relâcha pas ses efforts pour mettre les dérives du système soviétique sous les feux de la rampe. Il va de soi évidemment que le «voisin» d’Anders s’incarne dans la totalité des hommes de son époque et des suivantes. Dans les plus atroces temps de trouble, il convient de ne pas édulcorer ce que l’on sait. On ne rend pas service à l’humanité en lui administrant un sédatif ou une parole apaisante. Traumatisé par la vision des soldats mutilés par la Première Guerre mondiale, Anders, à quinze ans seulement, comprend très tôt sa mission de sentinelle et la nécessité d’ouvrir les yeux et les narines devant les tas de fumier de la condition humaine. Il sera constamment à l’avant-garde de l’épouvante in the making : l’ascension du «salopard» Hitler le tracasse, les camps de concentration lui font découvrir la voracité de la Furor Teutonicus régénérée, la bombe atomique l’avertit des nouvelles dérives de la technique et la guerre du Vietnam le porte à combattre corps et âme aux côtés de Bertrand Russell.
Toutes ces régressions de l’Histoire ont à voir avec l’emballement du progrès technique et la demande d’un Grand Timonier pour superviser la salle des machines, et, parallèlement, Anders n’omet pas de souligner l’état lamentable de la langue allemande au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. D’un point de vue plus général, la technique associée aux guerres et aux génocides évacue la dimension infinie de la nature humaine afin de la finitiser à outrance. Les conséquences sur nos manières de parler sont sans appel : nous perdons les initiatives de la «Nature-Poète», omni-créatrice et généreuse en formes vivantes (3), suscitant les meilleures rhapsodies, encourageant les plus vifs néologismes, et nous entrons machinalement dans l’ère de l’Homme-Dépeupleur, avare de mots et de créativité, coupant la vie à la racine et ne laissant derrière lui qu’une dévastation sans précédent.
Du reste, Anders avait pressenti la menace de la technique lors de son expérience professionnelle à l’usine, entracte relativement inattendu dans l’existence d’un savant lettré. Contraint de vivre ou de vivoter lors de son exil américain (1936-1950) pendant que l’Europe se décapitait une seconde fois, Anders aura en effet expérimenté toutes sortes de «mauvais jobs», néanmoins il reconnaîtra que cette constellation de métiers pénibles aura chaque fois soulevé en lui quelque chose de crucial, comme si un levier important de l’esprit ne pouvait être activé que par l’intermédiaire d’une violence faite au corps. Ainsi l’usine yankee de ce temps-là, probablement saturée par les théorèmes du fordisme et les pires applications de la division du travail, fournit à la pensée d’Anders un matériau de première main pour travailler en profondeur la dévitalisation du sujet humain. Sans ce passage dans les cryptes industrielles de ceux qui gagnent leur vie à la sueur de leur front (et qui la perdent simultanément), Anders avoue qu’il n’aurait pas pu écrire correctement L’Obsolescence de l’homme, son chef-d’œuvre sur l’homme prisonnier de la technique, «tyran de lui-même» dirait Rousseau. Plus largement, le segment américain de son existence renforce son impression d’un Mal qui n’est pas exclusif à l’Europe, d’où son idée de proposer «un serment d’Hippocrate élargi», adressé en premier lieu aux scientifiques et aux experts de tous horizons, puis, en second lieu, adressé hypothétiquement à la planète, incitant chaque individu à s’impliquer dans une philosophie du soin universel, à croire en une « morale du lointain » que ne voulait pas admettre l’anthropologue Arnold Gehlen et contre lequel Anders s’insurge, l’accusant de «provincialisme des plus sinistres».
D’autre part, Anders est conscient de la difficulté de montrer aux hommes la nudité dérangeante de l’hubris technique, ou bien parce que le diable gît dans les détails et que nous ne sommes pas disposés à percevoir ce qui se situe dans le domaine de «l’infraliminaire», ou bien parce que l’énormité de la chose est telle qu’elle est résolument non-présentable, située cette fois dans le domaine du «supraliminaire». Pour l’infraliminaire, Anders s’appuie sur les recherches des physiologistes allemands E.H. Weber et G. T. Fechner. À partir de ces données sur le monde « subliminal » où la perception humaine ne saisit plus de différences, incapable de discriminer parmi un réseau de formes microscopiques, Anders, par ricochet, élabore le concept de «supraliminarité» pour exhiber un monde indifférencié de grossièretés techniques devenues invisibles à force de gigantisme. Eu égard à cet aspect cyclopéen de la technocratie, il se réfère bien entendu à la bombe atomique, à ce banal monstre d’acier désormais en mesure de faire disparaître l’humanité, cette «petite bombe qui peut tuer cent mille homme d’un coup» écrivait Sartre dans Les Temps modernes en octobre 1945, insistant d’ailleurs sur le fait que l’humanité était à présent mise en situation de décider de prolonger sa vie – ou de l’abréger rapidement. Il y avait donc urgence à prendre la parole et à agir sur ces problèmes d’actualité, tout comme il y avait urgence à ne pas se laisser embrigader dans le moelleux des Universités ou le confort des dialogues bourgeois. C’est la raison pour laquelle Anders confesse volontiers son manque de contribution dans la philosophie dite classique. En effet, quoiqu’il prît jadis du plaisir à enseigner la philosophie de l’art et à penser sous l’égide de son ancien maître Husserl, Günther Anders ne put s’enferrer longtemps dans les boulevards de la commodité tandis que le monde, autour de lui, ne cessait de s’effondrer. À ce titre, ses critiques sur les positions interlopes de Heidegger sont bien senties et il n’oublie pas non plus de viser la femme du philosophe de la Forêt Noire. Ce scandaleux binôme s’enlisa globalement dans des opinions politiques réactionnaires, et c’est la femme de Heidegger, nettement, qui pencha la première du côté des vociférations du «tambourineur» (Hitler). Ce n’est cependant pas un alibi pour pardonner quoi que ce soit à Heidegger, dont Anders précise la faiblesse des préjugés dès l’aurore de la déferlante hitlérienne, des préjugés alors si proches du Blubo (4), une conception du national-socialisme qui stipulait la pureté du sang apparenté à un sol de valeur supérieure.
Notes
(1) Günther Anders, Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ? (Éditions Allia, 2001 puis 2016, trad. par Christophe David).
(2) Il a refusé de nombreuses «planques» à l’Université afin d’être au plus proche de la réalité en train de se faire (et de se défaire).
(3) Marcel Conche, Métaphysique. Conche établit dans cet ouvrage un naturalisme forcené à partir des présocratiques et ses choix terminologiques pour évoquer la nature constituent en eux-mêmes une poésie remarquable.
(4) De l’allemand Blut, le sang, et Boden, le sol.
Lien permanent | Tags : philosophie, günther anders, grgory mion, éditions allia |  |
|  Imprimer
Imprimer




























































