« La Connaissance de la douleur de Carlo Emilio Gadda | Page d'accueil | Orgueil et préjugés de Jane Austen, par Gregory Mion »
24/03/2020
Sombre comme la tombe où repose mon ami de Malcolm Lowry

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Malcolm Lowry dans la Zone.
Malcolm Lowry dans la Zone.Sombre comme la tombe où repose mon ami se tient dans l'ombre portée, immense, de Sous le volcan qui n'a pas encore été publié au moment où Malcolm Lowry évoque son retour au Mexique, avec sa femme, sous les traits d'un couple imaginaire plus vrai que nature car affublé de leur propension indéfectible à boire et à se disputer, Sigbjörn Wilderness et Primrose, son épouse. C'est donc encore assez peu dire que ce texte fascinant apparaît, ainsi que l'écrit Maurice Nadeau, «comme le récit d'un voyage» dans Sous le volcan ou plutôt, une promenade éthylique et parfois même hallucinatoire dans un texte colossal qui s'appelait encore La Vallée de l'Ombre de la Mort, autrement dit : «une nouvelle plongée, mais volontaire cette fois, au sein du maelström» (1). Il faut aller plus loin et tenter de rejoindre Malcolm Lowry au plus près de son intention, dont l'évocation de l'élaboration aussi méticuleuse que désespérante de Sous le volcan n'est qu'un des aspects d'une intention profonde, rimbaldienne dans son essence solitaire, hermétique, véritablement titanesque et même inhumaine : la vie d'un écrivain est tout bonnement parfaitement indissociable de son écriture, le grand romancier n'ayant de cesse de nous rappeler, sous le couvert d'une fausse interrogation, que les rouages de l'écriture dévoilent ceux de la destinée (cf. pp. 14-5), fût-elle presque continuellement ivre, s'il est bien vrai, comme l'a écrit quelque part James, que l'alcool est la «symphonie du pauvre» (p. 34). Si nous avions quelque doute sur cette identité profonde ayant été exemplairement servie par la vie misérable et grandiose de Malcolm Lowry, nous aurions de quoi être convaincus par cette description aussi sobre que riche d'implications : «Au fond des niches de verre, les saints habituels dont l'un, qui ressemblait à Hamlet, vêtu d'une toge romaine parsemée de pierreries et de dorures, chaussé de sandales lacées sur les jambes, paraissait se poignarder et en fait se poignardait le ventre à l'aide d'une plume. Un écrivain sans nul doute, conclut Sigbjörn» (p. 220).
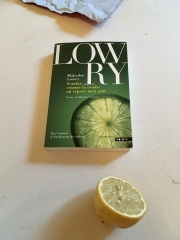 De quoi Sigbjörn souffre-t-il ? D'addiction à l'alcool ? Certainement, il ne cesse de la déplorer et de l'entretenir tout à la fois ! D'une sorte de mélancolie kierkegaardienne, de guignon baudelairien et même d'une fugitive mais fort réelle aphasie comme née du vertige de sombrer dans un désespoir inamovible ? Oui, bien sûr, et cette addiction ontologique à la poisse est évidemment mère de la précédente, qui rarement parvient à l'atténuer, encore moins à la soigner : «pire encore que la souffrance dont il ne reste rien, est la beauté que le poète ne désire plus dire» (p. 229). Il souffre bien évidemment de tous ces maux mais ce n'est là que la superficie de son mal, son épiderme pour ainsi dire, alors que son derme, le foyer de l'infection, lui, est profond, aussi profond que l'exploration de son âme dont les accidents se confondent avec ceux du paysage mexicain (2). Malcolm Lowry, au travers de son personnage qui n'est même pas un masque commode, est en perpétuelle tension entre deux pôles qu'il ne cesse d'entremêler, à moins que ce ne soit la boisson qui serve d'intermédiaire agile, de navette diligente entre les deux môles déformant, tiraillant à hue et à dia sa trajectoire de bolide : la réalité, la vie quotidienne, y compris la plus humble d'un côté et, de l'autre, l'art, comme il l'exprime magnifiquement dans ce passage : «Il croyait voir la vie s'épancher dans l'art; l'art octroyer forme et sens à la vie, s'y épancher, la vie ne demeurant point immobile. On l'oubliait toujours : la vie, transformée par l'art, quêtait de nouvelles significations à travers l'art, transformé par la vie» (p. 50).
De quoi Sigbjörn souffre-t-il ? D'addiction à l'alcool ? Certainement, il ne cesse de la déplorer et de l'entretenir tout à la fois ! D'une sorte de mélancolie kierkegaardienne, de guignon baudelairien et même d'une fugitive mais fort réelle aphasie comme née du vertige de sombrer dans un désespoir inamovible ? Oui, bien sûr, et cette addiction ontologique à la poisse est évidemment mère de la précédente, qui rarement parvient à l'atténuer, encore moins à la soigner : «pire encore que la souffrance dont il ne reste rien, est la beauté que le poète ne désire plus dire» (p. 229). Il souffre bien évidemment de tous ces maux mais ce n'est là que la superficie de son mal, son épiderme pour ainsi dire, alors que son derme, le foyer de l'infection, lui, est profond, aussi profond que l'exploration de son âme dont les accidents se confondent avec ceux du paysage mexicain (2). Malcolm Lowry, au travers de son personnage qui n'est même pas un masque commode, est en perpétuelle tension entre deux pôles qu'il ne cesse d'entremêler, à moins que ce ne soit la boisson qui serve d'intermédiaire agile, de navette diligente entre les deux môles déformant, tiraillant à hue et à dia sa trajectoire de bolide : la réalité, la vie quotidienne, y compris la plus humble d'un côté et, de l'autre, l'art, comme il l'exprime magnifiquement dans ce passage : «Il croyait voir la vie s'épancher dans l'art; l'art octroyer forme et sens à la vie, s'y épancher, la vie ne demeurant point immobile. On l'oubliait toujours : la vie, transformée par l'art, quêtait de nouvelles significations à travers l'art, transformé par la vie» (p. 50). Cette extrême imbrication entre deux trames, la réelle et l'inventée, l'imaginaire et la quotidienne, la circulation de l'une à l'autre et leur enrichissement mutuel s'expriment, d'abord superficiellement dans le livre de Lowry, par la permanence de références littéraires, de Shelley, du Goethe de Faust et de Coleridge jusqu'à Poe sans oublier le grand concurrent de Sous le volcan, l'oublié Rigaudon de l'ivrogne (The Lost Weekend) de Charles Jackson, et profondément cette fois-ci, par le truchement des personnages du grand roman labyrinthique, toujours pas édité au moment où Lowry et sa femme retournent au Mexique en mettant leur pas dans les traces de celles et ceux qui les ont inspirés, et que Sigbjörn essaie de retrouver (Fernando) ou de fuir (Stanford), comme si les créatures de papier avaient plus de consistance, aux yeux de celui qui les a créées, que leurs imparfaits modèles vivants dont l'un d'eux, d'ailleurs, ne manquera même pas de mourir ou plutôt : d'être mort depuis plusieurs années, alors que nos deux protagonistes s'élancent pour le retrouver puisqu'ils le croient encore en vie.
Revenir au Mexique, c'est bien sûr descendre, géographiquement mais, plus encore, spirituellement, tout déplacement, pour le romancier, étant un itinéraire qui, avant même que d'espérer, un jour, remonter à l'air libre, s'enfonce dans les ténèbres : le Gethsémani (mentionné p. 96) de Lowry est l'antichambre du Purgatoire et son Golgotha est bâti sur le dôme de l'Enfer, «profond, profond, profond», avec des «profondeurs au-delà et encore au-delà des profondeurs» (p. 95). La thématique chrétienne, bien présente dans ce roman, est celle d'une quête de la rédemption qui elle-même est indissociable de la quête du Livre, «le vrai» écrit Lowry, c'est-à-dire bien sûr Sous le volcan, puisque tout ce qu'il vit au Mexique «y participe», même s'il doit concéder qu'il est «incapable de l'écrire, bien sûr» (p. 100), de sorte que son voyage qui n'est après tout qu'un retour sur une terre qu'il a aimée et évoquée magnifiquement dans son roman impubliable est aussi une façon de découvrir que «nous ne pouvons vivre sans Dieu» (p. 101), autrement dit sans la présence du Livre, celui que l'on essaie d'achever en revenant dans le pays duquel il est sorti et qui pourtant le contiendra tout entier, contiendra tous les Mexique possibles. Ce n'est évidemment pas un hasard si le romancier est comparé, assez traditionnellement, à Dieu, lorsque Malcolm Lowry écrit par exemple : «Il croyait avancer au milieu de sa propre création et, dût-elle aboutir à un échec, n'était-il pas presque l'égal de Dieu ? Dieu en personne n'avance-t-Il pas au milieu de Sa propre création de cette même spectrale manière, et comment Le verrions-nous autrement, dès lors que nous comprenons obscurément qu'Il a le pouvoir à n'importe quel moment de nous rayer tout à fait de Son étrange, sombre manuscrit ?» (p. 163), ou encore lorsque son narrateur a l'impression de n'être qu'une marionnette et, paradoxalement, de jouir d'une «illusion de puissance», puisqu'il est «enclos dans son propre roman» et que Dieu, pour lui jouer quelque sale tour sans doute, serait après tout bien capable de refermer «le livre sur lui comme sur un vulgaire insecte» (p. 225).
Si, avant d'espérer monter, il ne faut pas craindre de descendre, c'est encore dire qu'il faut sans cesse rejouer ce que l'on a vécu, et qui est perdu : le mouvement essentiel, dans ce roman de Lowry comme dans tous ses autres textes, est de redite ou, pour l'écrire en un beau mot kierkegaardien, de reprise. Il faut tout refaire, tout redire, tout enserrer, de nouveau, dans la cire molle de la conscience, dans le filet aux mailles plus ou moins larges du langage. Voyez ce beau passage : «Un homme tout à fait submergé par la catastrophe tendra à oublier, même si automatiquement il les pleure, les cimes jadis atteintes et les obstacles qu'il lui a fallu surmonter pour cela. Et le vieux moi contemple le neuf avec un si total mépris d'avoir cédé que ce dernier fuit, craintif, l'implacable regard de l'autre par-dessus les années et à la fin, pour tout aplanir, l'oublie» (p. 106). Malcolm Lowry, lui, n'est absolument pas homme à oublier, malgré ses monumentales cuites qui lui font dévaler l'escalier de l'inconscience «comme si son âme était liée», écrit-il magnifiquement, «à la queue d'un cheval emballé» (p. 110). Tout mouvement littéraire véritable est, pour le romancier, de reprise, de répétition, y compris de répétition dénaturée, c'est-à-dire carnavalesque, déchue : il faut quoi qu'il en soit répéter «plusieurs fois ce trajet et vous aurez la fantastique impression de revivre encore et encore une existence, ce qui est peut-être vrai de n'importe quel voyage, mais plus particulièrement de celui-ci» (p. 112). Ainsi, à bon droit, Malcolm Lowry peut-être être désigné comme étant le plus parfait exemple de voyageur immobile : placez-le, seul, dans une chambre close, et il oubliera le temps qui passe s'il peut toutefois disposer d'une solide réserve d'alcools variés qui faciliteront son exploration acharnée des labyrinthes qui s'enfoncent si profondément sous le volcan éruptif de son implacable mémoire.
Si tout voyage est un retour ulysséen, le meilleur moyen de capturer la réalité dans son filet consiste à ne point séparer l'écriture, je l'ai dit, de ce que l'on vit au jour le jour, du moindre fait, aussi dénué d'importance romanesque qu'il puisse paraître : il s'agit, toujours, d'écrire et, en écrivant, d'écrire tout autant que de perpétuellement commenter l'autre livre, le Livre, le seul, l'unique, celui qui, je l'ai indiqué dans ma note, les contient tous et, en réalisant cette opération magique, de s'absorber, soi-même comme un personnage, ainsi que le fera Ernesto Sabato dans le dernier tome de sa trilogie romanesque, dans ce livre des livres qui est «un livre paradoxalement non écrit en entier, qui risquait de ne jamais l'être mais qui, sur le mode transcendantal, était en voie d'écriture pendant qu'ils roulaient» (p. 118, l'auteur souligne), et par la sorte de se mettre à travailler sur le thème de l'ivresse «dans ma vie et dans le livre, si vous voyez ce que je veux dire» (p. 174). Aux yeux de Malcolm Lowry, si le livre sans cesse remis en chantier, impubliable, est l'unique réalité, alors tout, absolument tout devra le rappeler, y compris l'incendie de sa maison (et des manuscrits qu'elle contenait) : «L'auteur est un homme tout le temps en train de se frayer une voie à travers une aveuglante fumée, tâchant de sauver quelques précieux objets d'un bâtiment en feu. Effort désespéré, inexplicable...», et le narrateur de Lowry de se dire, immédiatement après ce constat, que ce bâtiment est sans doute identique à son livre rêvé, façonné dans son esprit avant que d'avoir été écrit, est son livre-même, depuis longtemps parfait dans son esprit, mais devenu «le véhicule de la destruction par la peine [qu'il] coûte à réaliser, à transmuer sur le papier» (p. 178), comme une espèce de rayonnant aleph que l'on peut voir mais qu'il est interdit de trop approcher, encore moins de toucher.
Malcolm Lowry, confiné dans «la tour de sa propre création, environné des spectres du passé» (p. 219), est ainsi le damné qui doit écrire ce qu'il doit vivre mais, tout autant sinon plus, «vivre ce [qu'il] devrai[t] écrire» (p. 180), puisque ce qu'il vit lui semble constituer «l'écriture d'un livre» (p. 182), l'échec de sa vie n'étant au fond pas différent de celui de son livre, «l'échec, l'échec et rien d'autre, [ayant] rendu son ouvrage de plus en plus compliqué, y avait accumulé ces divers paliers de signification» (p. 208) que n'importe quel lecteur de Sous le volcan, fût-il inattentif, est tout de même capable d'explorer, si bien sûr il ne peut clairement tous les définir, encore moins se prononcer sur les directions qu'ils empruntent et la nature des nouveaux gouffres qu'ils laissent entrevoir.
Le texte de Malcolm Lowry est bien souvent déchirant, parce qu'il est assez vite clair que son narrateur, comme l'ancien marin de Coleridge, va finalement de port en port (ici de ville en village mexicains) pour raconter l'histoire lamentable de son épique déveine mais, aussi, comment il a réussi à faire qu'un simple «brin de limaille du pire de ces heures» de souffrance et d'errance, la moindre «goutte de mescal», soient «transmués en or pur», tout comme il déclare aussi avoir «fait chanter» la moindre goutte d'alcool. Ce mouvement, belle certitude, bien que douloureuse, de l'écrivain qui écrit ce qu'il vit et tout autant vit ce qu'il écrit, semble l'inverse de celui qui, avec une aussi grande régularité que celui-ci, enfonce Lowry dans les ténèbres, dans un désespoir et un «sentiment de faillite» qui s'accroît «jusqu'à la folie par son remords, par la conviction que tant de beauté» aurait pu prendre «un sens infiniment plus riche s'il l'avait partagée avec la femme qu'il aimait mais qu'il avait renvoyée volontairement» (p. 244). Finalement, si notre narrateur se sauve en faisant témoin sa femme, mais aussi certaines personnes bien vivantes qu'il n'a pas hésité à transmuer dans son grand roman, de sa chronique malchance, il se perd, de nouveau, il se perd et se mure au carré pour ainsi dire, en comprenant que jamais il ne parviendra à restaurer ce qui a été perdu, ce qu'il a volontairement perdu voire sacrifié, en toute connaissance de cause. Dès lors, même accompagné de Keats et de Shelley, son ambition enfantine de commencer une existence nouvelle est caduque, bien qu'il affirme, assez étrangement, que «l'indicible mélancolie des arbres et des nuages» l'environnant au Mexique sait pourtant lui «restituer profondément, à lui si dépossédé, l'océan des prés, les champs de renoncules et de primevères et les saules de Cambridge» (p. 245). Chacune de ses explorations, souvent entreprises dans un état de candeur que l'expérience pour le moins abondante de notre écrivain devrait pourtant drastiquement atténuer sinon balayer, se termine en piteux constat d'échec, comme l'indique ce passage qui pourrait en fait symboliser l'intention profonde ayant présidé à l'écriture des plus grands textes de Lowry : «C'était comme le retour du jusant de sa vie, destiné à lui révéler, dans la fange, une horreur que le temps n'avait pu désintégrer ni disperser, et plus effrayante que cette impossibilité de l'évincer était la tentation de l'accueillir avec cordialité, avec tact, et surtout de communier avec elle» (p. 253). Rien à faire, semble nous suggérer Lowry, il n'y a strictement rien à faire contre le passé ou plutôt contre certain entêtement de mauvais démiurge qui rend obstinément non rédimable telle pelote de ténèbres, que tout l'effort de l'écrivain était pourtant de méthodiquement démêler.
Alors, avant de sombrer définitivement dans la mer aux courants terrifiants ou dans un océan d'alcools divers, qui entraîneront encore plus loin que les premiers l'intrépide nageur, avant de pouvoir prétendre devenir «tout à fait comme l'un de [ses] propres personnages» (p. 272), avant même d'espérer, comme tel démiurge ou même Dieu, être investi «du pouvoir de transmuer en triomphes les apparents désastres de notre vie» (p. 290), il faut continuer coûte que coûte d'écrire un texte qui gravite, pour y tomber à jamais, autour de l'astre noir, Sous le volcan bien sûr, le livre qui les contient tous après les avoir dévorés, dont nous ne savons même pas, à l'instar de Malcolm Lowry, s'il daignera être publié et, ainsi, comme l'a écrit Maurice Nadeau dans sa Préface, devenir «l'homme qui continue d'incarner pour nous au plus haut point la tragédie de notre condition et celle du monde où nous vivons» (p. 12).
Notes
(1) Malcolm Lowry, Sombre comme la tombe où repose mon ami (traduction de l'anglais par Clarisse Francillon, préface de Maurice Nadeau, Denoël, 2005 puis Point Signature, 2009), p. 8. Comme toujours, ce genre d'édition de poche semble assez mal relu, surtout pour ce qui concerne les mots/phrases en espagnol, nombreux, que contient le texte.
(2) «Et de nouveau les montagnes ! les montagnes ! On eût dit que le regard scrutait, au-delà des lointains abysses des sens, une formidable houle assourdissante, en crescendo, de toutes les vastes mers et prairies intérieures, intarissables, démesurées, acculant l'âme à ses ultimes frontières» (p. 242) ou encore : «et la chaîne des pensées ne se rompait pas, sinuait à l'infini comme la Sierra Madre» (p. 255).































































 Imprimer
Imprimer