« De la mobilisation en période de pandémie. Neuf extraits commentés de La mobilisation totale d’Ernst Jünger, par Baptiste Rappin | Page d'accueil | Les abeilles d'Aristée de Wladimir Weidlé »
26/05/2020
Essais sur la rhétorique, le langage, le style de Thomas De Quincey
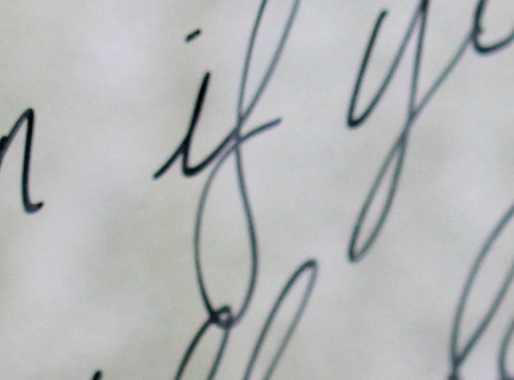
Photographie (détail) de Juan Asensio.
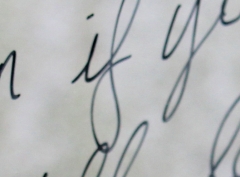 Thomas De Quincey dans la Zone.
Thomas De Quincey dans la Zone. Précédés d'une préface solide signée par Éric Dayre, ces Essais sur la rhétorique, le langage, le style parus chez José Corti en 2004 dans la célèbre collection intitulée Domaine romantique (un ouvrage, comme c'est du reste une constante chez cet éditeur, absolument point dépourvu de fautes) (1), ont respectivement paru en 1828, 1840 et 1851 et nous offrent, s'il en était besoin, de nouveaux aperçus sur l'effrayant génie de Thomas De Quincey, dont on aperçoit tant de lueurs, comme des explosions de lumière dans un ciel noir d'orage, avant que le bruit immense ne secoue le paysage et n'indique au promeneur qu'il est grand temps pour lui de se mettre à l'abri, sauf si, bien sûr, il veut prendre le risque de fixer le ciel et, peut-être, dans la déchirure du monde que provoquent les éclairs, espérer voir du nouveau. Notre préfacier le dit à sa façon, d'ailleurs, en écrivant que c'est «dans la brume de chaleur de ces essais» que l'on «voit trembler les polémiques derrière l'harmonie, les dialectes dans la langue, la philosophie et la prose derrière la poésie, la technique derrière la nature, les traductions dans la Tradition, l'enfant derrière l'homme, l'individu contre le groupe, les détails dans l'histoire universelle, les différences irréductibles dans la littérature générale» ou encore «les rythmes dans la durée» (pp. 19-20) : en bref, quel que soit le sujet sur lequel Thomas De Quincey fixe son attention ironique et subtile, il n'a aucune importance car nous savons que c'est de l'infinie littérature qu'il va nous parler, seule capable de tisser un réseau de correspondances frappantes entre des réalités que rien ne semblait devoir rapprocher les unes des autres.
Précédés d'une préface solide signée par Éric Dayre, ces Essais sur la rhétorique, le langage, le style parus chez José Corti en 2004 dans la célèbre collection intitulée Domaine romantique (un ouvrage, comme c'est du reste une constante chez cet éditeur, absolument point dépourvu de fautes) (1), ont respectivement paru en 1828, 1840 et 1851 et nous offrent, s'il en était besoin, de nouveaux aperçus sur l'effrayant génie de Thomas De Quincey, dont on aperçoit tant de lueurs, comme des explosions de lumière dans un ciel noir d'orage, avant que le bruit immense ne secoue le paysage et n'indique au promeneur qu'il est grand temps pour lui de se mettre à l'abri, sauf si, bien sûr, il veut prendre le risque de fixer le ciel et, peut-être, dans la déchirure du monde que provoquent les éclairs, espérer voir du nouveau. Notre préfacier le dit à sa façon, d'ailleurs, en écrivant que c'est «dans la brume de chaleur de ces essais» que l'on «voit trembler les polémiques derrière l'harmonie, les dialectes dans la langue, la philosophie et la prose derrière la poésie, la technique derrière la nature, les traductions dans la Tradition, l'enfant derrière l'homme, l'individu contre le groupe, les détails dans l'histoire universelle, les différences irréductibles dans la littérature générale» ou encore «les rythmes dans la durée» (pp. 19-20) : en bref, quel que soit le sujet sur lequel Thomas De Quincey fixe son attention ironique et subtile, il n'a aucune importance car nous savons que c'est de l'infinie littérature qu'il va nous parler, seule capable de tisser un réseau de correspondances frappantes entre des réalités que rien ne semblait devoir rapprocher les unes des autres.Cet ouvrage composite fourmille d'aperçus, même si, au vu des dates diverses de publication des trois essais, il paraît difficile d'en dégager une idée maîtresse autre que celle d'une union intime, essentielle, charnelle, entre le style et la pensée. C'est en évoquant le génie de Burke que Thomas De Quincey, moquant la bêtise de «la race de ses critiques aux longues oreilles», affirme du grand penseur, et aussi grand styliste, qu'il «pense dans ses figures et à travers elles», ce qui est absolument le contraire de l'attitude paresseuse consistant à les étaler «délibérément comme un vernis et un ornement qui vient après coup», non pas, donc, incarnant, «mais simplement habillant ses pensées dans les images» (p. 56, l'auteur souligne). Dans Le Style, reprenant les idées de Wordsworth, De Quincey réaffirme que le style ne saurait être séparé de la pensée, «chacune coexistant non seulement avec l'autre, mais également dans et à travers l'autre», image et pensée n'étant pas unies «au sens d'un corps revêtu d'un vêtement séparable, mais dans le sens d'une incarnation mystérieuse» : et ainsi, conclut l'auteur, «dans la mesure où les pensées sont subjectives, alors dans la même mesure, leur essence devient identique à l'expression, et style et matière deviennent confluents» (p. 212, l'auteur souligne). Thomas De Quincey ramassera cette identité, qui n'a jamais été, si on y réfléchit bien, une lumineuse évidence, au moyen d'une de ces fulgurances dont il n'est pas vraiment avare, quel que soit le sujet de ses savantes méditations : «le style, ou, au sens le plus large du terme, la manière, est le confluent de la matière» (p. 209, l'auteur souligne). Je parlais d'évidence; et d'ailleurs, si l'on suit l'auteur, le style, n'est-ce justement pas cette géniale capacité dont jouissent certains écrivains et qui consiste à nous faire saisir de nouveaux rapports dans des objets, des êtres, que l'on croyait définitivement connus, classés, et ne point être susceptibles de parvenir de nouveau à nous enthousiasmer ou nous étonner ? : «Celui qui, à une ancienne conviction depuis longtemps inopérante et morte, confère une forme de régénérescence qui la transporte à nouveau dans nos cœurs comme une puissance d'action vitale», et aussi celui «qui grâce à une lumière nouvelle, ou par un éclaircissement empruntant de nouveaux canaux, réconcilie avec l'entendement une vérité dont l'apparence avait semblé obscure et incertaine», voilà deux hommes qui sont réellement, poursuit De Quincey, «les inventeurs de cette vérité» (p. 95, l'auteur souligne).
Cette union intime entre la pensée et le style, ce «grand écheveau dans lequel le processus textile de l'intellect en mouvement se révèle et prospère» (p. 92), est peut-être la seule certitude trouvant grâce aux yeux de Thomas De Quincey, qui se livre à un magnifique éloge de la relativité des points de vue dans tel passage, pour aussitôt la battre en brèche, en rappelant que le grand penseur, le grand styliste, l'écrivain unique, prodigieux, sont justement ceux qui sont ou plutôt seraient seuls capables d'adopter un point de vue suffisamment vaste pour rendre cohérent, en appliquant «un principe d'organisation a priori» à l'apparence chaotique de l'univers : «Certains pensent que toutes les étoiles qu'on voit briller avec tant de constance dans le ciel d'une nuit de gel sous une haute latitude, et qui semblent avoir été semées à l'entour avec autant de négligence que les grains sur l'aire à battre [...] sont toutes rassemblées en zones ou en strates; de sorte que notre pauvre petit monde (et l'ensemble de notre système solaire particulier) est une partie de cette zone, et que toute cette parfaite géométrie des cieux, comme autant de rayons d'une puissante roue, deviendrait apparente si nous pouvions simplement, nous les spectateurs, l'observer depuis son vrai centre, lequel pourrait être bien trop éloigné pour que le regard de l'homme puisse l'atteindre, qu'il soit aidé ou non du télescope» (p. 185, l'auteur souligne).
Burke nous l'avons vu, dont la distinction découle «du fait qu'il considérait tous les objets de l'entendement sous un nombre plus grand de rapports et de relations que les autres hommes, et sous des relations plus complexes» (p. 56), Burke qui «au contraire [de ses contemporains] devant lui, avance et modifie sa position à mesure que ses phrases elles-mêmes avancent» (p. 67) mais aussi John Donne qui «a su combiner ce que personne d'autre n'a réussi», à savoir «l'ultime sublimité de la subtilité et de l'adresse dialectiques avec la majesté la plus passionnée» (p. 39), Sir Thomas Brown ou encore Jeremy Taylor, qualifiés comme étant «les plus riches, les plus éclatants et, par référence à la matière dont ils traitent tous les deux, les plus captivants de tous les écrivains dans l'ordre rhétorique» (p. 43), à l'inverse de Kant dont le style est joyeusement étrillé (2), nul ne pourra faire le reproche que Thomas De Quincey ne salue pas ses aînés, lui qui évoque remarquablement un phénomène qu'il ne se lasse pas de trouver aussi étrange que fascinant, l'éclosion du génie certes chez tel ou tel membre d'une société à une période historique donnée mais, surtout, de plusieurs génies s'influençant les uns les autres, qu'importe d'ailleurs qu'ils exercent tous dans le même art, au sein d'une seule et même génération, ou peu s'en faut, en tout cas dans une période temporelle qu'un homme peut connaître toute entière, fût-il, tel Isocrate, capable de considérer, pour les rapprocher, les comparer ou les différencier, «l'oasis de Périclès de celle d'Alexandre» (p. 191), constituant de la sorte «une unité de temps close et isolée», ces différents individus pouvant alors «ne mesurer qu'entre eux leurs capacités fondées sur l'échelle de leurs mérites respectifs» (p. 174).
Thomas De Quincey donne à de «semblables rassemblements de puissance intellectuelle» illustrant telle mystérieuse «tendance de l'énergie intellectuelle à s'exprimer par des paroxysmes intermittents» (p. 178) par la «contagion de la sympathie» qui propage «son électricité dans la société toute entière», et cherche «dans toutes les directions les facultés qui sont compatibles avec elle, et ne tolère pas qu'une seule de ces facultés demeure ignorée de celui qui la possède» : «un tourbillon» alors se crée, «attirant dans son mouvement tout ce qui est susceptible d'une action similaire». C'est bel et bien l'admiration qui explique ce «principe de sympathie», les grands peintres italiens pouvant par exemple «être rangés dans la foule de ceux qui obéissent à l'action de ce principe» si l'on admet que «le fait d'entendre pendant des années les murmures d'admiration aller vers des œuvres d'art particulières et des artistes précis, avive quelque chose de plus élevé que la simple ambition et la rivalité des hommes; ce fait allume des sentiments plus heureux et plus favorables à l'excellence, c'est-à-dire un amour authentique et une compréhension géniale des qualités qui conviennent pour faire naître une émotion si profonde et si durable» (p. 179).
Cette salutations de la grandeur est peut-être, aussi, affaire d'autre chose que la sympathie, pourquoi pas la nostalgie, voire le regret d'une époque révolue, celle de la rhétorique qui, nous assure Thomas De Quincey, «a glissé, comme celle de la chevalerie, parmi les choses oubliées; et le rhéteur n'a pas plus de chance de revenir que le rhapsode de la Grèce primitive ou les troubadours des premiers romans» car il est vrai qu'à notre époque, «les modalités du plaisir intellectuel sont si multipliées que la possibilité du choix en est absolument perturbée» et que, «sur un théâtre de plaisirs illimités, et dont on peut profiter sans beaucoup ou sans du tout se dépenser intellectuellement, il serait véritablement merveilleux de rencontrer un public considérable intéressé par une représentation qui présuppose une attention extrême et constante tant de la part de l'auditoire que de l'artiste» (p. 34). Thomas De Quincey estime donc qu'il n'y a pas de place «pour une renaissance de la rhétorique dans la parole publique» (p. 38) à notre époque, peut-être parce que cette dernière est devenue totalement incapable de créer le type d'homme ancien qui, lui, savait tourbillonner autour de ses propres pensées, et dont la fantaisie se mouvait et se soutenait «d'elle-même à partir de ses propres activités» (p. 63), peut-être encore parce que les moyens de diffusion des textes écrits, notamment par le biais de la presse, nous font nous noyer dans un monde de textes inutiles, chaque année portant «en terre sa propre littérature» (p. 216), les livres croulant sous les livres, alors même que l'on ne peut même pas dire que soit rendue visible «la plus grande partie de ce qui est imprimé» puisque nous ne lisons qu'en diagonale, de travers, mal ou pas du tout. Un «devoir très sérieux, et qui chaque année devient plus solennel et plus grave», affirme alors, non sans ironie, Thomas De Quincey, consiste à favoriser «la culture d'un style non verbeux» (p. 218), ce qui aura au moins pour effet de freiner quelque peu le rythme infernal de publication. Autre solution proposée, revenir, justement, à un véritable art rhétorique, puisqu'on peut décidément «envoyer dans les bibliothèques un millier d'exemplaires d'un ouvrage, et pas un seul d'entre eux ne sera ouvert», art rhétorique qui ne fut jamais plus magnifiquement incarné que par le génie tragique des grands Grecs, dont les textes «étaient rendus intelligibles par une voix et une action pleines de vie et d'emphase» car, «en un mot, à chaque représentation successive, une très importante édition d'une très belle tragédie était publiée dans le sens le plus impressionnant de ce qu'on appelle une publication», autrement dit «non seulement avec précision, mais avec une réalité mimétique qui interdisait tout oubli, et ne pouvait souffrir d'aucune inattention» (p. 230). Encore une fois, il s'agit de trouver un véritable style, au sens profond donné à ce terme par l'auteur, qui nous permettrait de redonner vie et éclat à la littérature désormais réduite au rang d'une vivandière de la Presse, se contentant, au mieux, d'en singer les tics et d'en reproduire efficacement les phrases acéphales comme si, en plus de se soumettre à ce qu'elle dépasse pourtant infiniment, il lui fallait aussi se mépriser profondément.
Notes
(1) Je n'en donne que quelques-uns, à peu près certain de l'inutilité de cette tâche, la grande majorité de l'édition courante n'étant tout simplement pas ou très mal relue : les termes dans la mesure où il semblait maîtriser ses artifices sont répétés dans la même phrase (p. 52); toute la rhétorique qu'ils ont jamais eue et non «toute la rhétorique qu'ils ont jamais eu» (p. 63);
(2) «Kant était un grand homme, mais en ce qui concerne la langue et ses capacités, il était obtus et sourd comme un rocher antédiluvien. Il y a chez lui des phrases qui ont été mesurées par un charpentier, et qui, pour certaines, couvrent deux pieds huit pouces sur six pouces. Or, une phrase d'une ampleur si énorme est faite pour le seul usage d'un mégathérium ou d'un préadamite» (p. 92). Bien d'autres métaphores et images foisonnent sous la magnifique plume de Thomas De Quincey, dont on ne soulignera jamais l'extraordinaire capacité, en une phrase, d'ouvrir des mondes entiers de méditation, comme le montre cette comparaison : «La Grèce était dans l'état d'isolement absolu du Phénix, cet oiseau unique, qui meurt sans avoir éprouvé le moindre frémissement de joie, ni connu le moindre sentiment de jalousie» parce qu'il «a révélé son magnifique plumage et les mystères solennels de sa beauté aux seuls recoins éloignés et obscurs des désertes thébaïques» (pp. 85-6). Je me permets aussi de citer intégralement le très beau passage dans lequel De Quincey compare le grec à l'hébreu, le second obtenant ses préférences parce qu'il est le langage de l'intimité de l'homme avec ses dieux et ses démons, alors que le premier est celui du clair savoir : «Le grec périra quand un déluge de calamités submergera les bibliothèques de notre planète, il périra encore si une grande révolution de pensée en change la forme, et on se souviendra de lui exactement comme on se souvient d'un printemps de fleurs, avec la même tendresse de sentiments, et ce même sentiment pathétique d'une prédestination naturelle à l'évanescence. L'hébreu au contraire, en s'introduisant dans les recoins les plus secrets du cœur humain, en demeurant assis là, comme pour faire lever les terribles germes des choses spirituelles qui relient l'homme à des mondes invisibles, a su se perpétuer comme un pouvoir dans le système humain : il dure autant que la race de l'homme, et ne se soucie pas des révolutions de la littérature ou de la composition des sociétés» (p. 82).



























































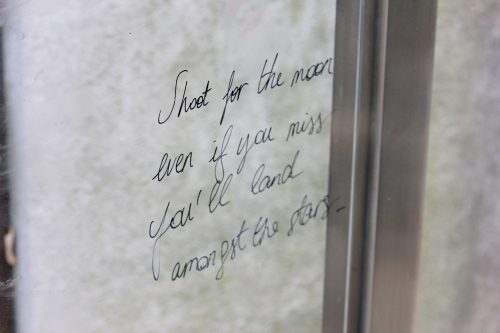

 Imprimer
Imprimer