« Entretien avec Pierre Jourde à propos d'À Rebours | Page d'accueil | Entretien autour de l’anthologie J’ai mis la main à la charrue : Gregory Mion et Henri Rosset aiguisent le soc afin de rendre la terre moins vaine, 1 »
11/02/2023
La panoplie littéraire de Bernard Frank

Photographie (détail) de Juan Asensio.
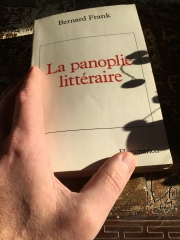 Il ne faudrait certes pas, feuilletant au hasard La panoplie littéraire (1) de Bernard Frank, tomber sur la dernière ligne de l'une de ses dernières pages, où est écrit ce piètre slogan : «Écrivains de gauche, nous venons d'apprendre que, pour nous, le plus court chemin qui mène au socialisme est celui qui passe par notre propre pays» (p. 241), pour accabler l'auteur en lui reprochant ses coupables tropismes idéologiques ou bien son flagrant manque de prescience.
Il ne faudrait certes pas, feuilletant au hasard La panoplie littéraire (1) de Bernard Frank, tomber sur la dernière ligne de l'une de ses dernières pages, où est écrit ce piètre slogan : «Écrivains de gauche, nous venons d'apprendre que, pour nous, le plus court chemin qui mène au socialisme est celui qui passe par notre propre pays» (p. 241), pour accabler l'auteur en lui reprochant ses coupables tropismes idéologiques ou bien son flagrant manque de prescience. Pas davantage, il ne faudrait perdre patience en constatant que les sept premier chapitres du livre sont consacrés à l'apprentissage du métier de journaliste et d'essayiste auprès de Jean-Paul Sartre, au risque de ne pas comprendre, et cela avant même d'aborder le corps central du livre évoquant subtilement Drieu la Rochelle, que La panoplie littéraire vaut d'abord comme un traité de critique littéraire.
Les remarques fourmillent, sur le style (2), la critique littéraire elle-même (3), mais aussi sur tel ou tel art littéraire, au premier rang desquels le roman (4), les auteurs bien sûr, et pas seulement Drieu, mais Jean Cau, qui «se devait de susurrer des petites phrases de politesse qui étaient l'envers de sa nature», qui «étouffait» et qui «avait la nostalgie d'un monde solaire, qu'un gros bon sens le contraignait à passer sous silence» (p. 34), Sartre bien sûr, «mercenaire du Bien» (p. 47) ou encore André Gide bellement campé, de même que Camus, pendant l'Occupation.
C'est sans doute l'évocation de cette période, qualifiée, nous le savons, de sombre par les échotiers, qui permet à Bernard Frank de proposer un assez remarquable portrait du collaborateur, ce paradoxal «conservateur de la situation impossible [qui] voudrait qu'elle dure le temps de sa vie, qu'elle le caresse comme un éventail, ou, si elle doit finir, eh bien ! que le monde se consume avec elle» (pp. 119-20), et d'analyser quelques caractéristiques intimes de ce si fâcheux tropisme consistant à trahir sa propre patrie, du moins, bien sûr, aux yeux des vainqueurs qui nous le savons bien écrivent (ou réécrivent) l'histoire. Bernard Frank souligne, non sans une certaine mauvaise foi au ton grinçant ou alors une ruse certaine (nous y reviendrons), que le suicide de Drieu la Rochelle a finalement arrangé tout le monde, les résistants bien sûr qui n'eurent pas à trancher quelque cas épineux d'écrivain ayant pactisé avec le Diable, comme Brasillach, mais aussi les écrivains de droite qui alors ont eu beau jeu de prétendre que c'est cette «garce de politique» qui avait tout gâché et «corrompu les meilleurs» : «l'écrivain de droite, au début, est bien décidé à passer pour une tête folle; c'est un gentil garçon ou un pur esprit, tout occupé de la beauté de sa phrase sur les tulipes ou de pensée hindoue. Il était bon que la collaboration eût dans son coffre à souvenirs cette victime romantique, ce cher disparu, qui ajoute une nuance de deuil et de sérieux au gai savoir d'aujourd'hui» (p. 129). Ainsi, si «le résistant est la vérité du collaborateur» qui «détenait le négatif de son être dont il ne possédait que la copie» (p. 98), le collaborateur, lui, estimant que les idées politiques l'ont trahi, tentera de «disgracier les idées et la politique». En somme, «ces écrivains engagés vont bannir l'engagement», assurant désormais «qu'on ne pourra pas être un bon écrivain et dans le même temps avoir des idées». Bernard Frank a cette image truculente : «L'écrivain engagé, c'est le frère d'Amérique qui a fait fortune dans les affaires, tandis qu'ils [les collaborateurs] périclitaient à Périgueux. Cette phobie de l'idée va couper en deux notre littérature. La Libération n'a pas effacé cette boue, on sera un écrivain de talent ou un affreux philosophe» (p. 99).
Drieu la Rochelle, selon Bernard Frank, est assurément l'un de ces assez rares écrivains qu'il a «choyés comme un maniaque» (p. 13), mais je ne connais cependant pas suffisamment la personnalité de cet auteur pour m'aventurer sur le terrain boueux et même très franchement merdailleux de la psychanalyse, sans doute parce que nombre des défauts et, plus que des défauts, des manières d'être de Drieu sont les siens. Cela se voit assez nettement lorsque Bernard Frank émet plusieurs jugements qui ne se fondent pas tant sur de définitives concaténations que sur des espèces de foudroyantes intuitions (5) qu'il s'agit, une fois notées, de tenter d'amener au grand jour, à la franche lumière de la raison, en empruntant patiemment de longs détours déductifs; ainsi, si Bernard Frank «trouve Gilles si réussi, c'est [qu'il tient] ce roman pour le chef-d’œuvre d'une sincérité de mauvaise foi», et que s'il était en effet «difficile de parler de soi en termes si justes», c'est parce que «ce soi était miraculeusement faux» (p. 153, l'auteur souligne). Comment ne pas comprendre que c'est la part la plus trouble de Drieu, adepte de «la confession blafarde», «boudeur» de génie dont on hésite à qualifier la «subjectivité ombrageuse toujours sur le point de s'évanouir» (p. 186, l'auteur souligne) de pudeur ou de manque, qui trouble Bernard Frank au point qu'il parle de malaise à propos de cet écrivain qui «n'a pas eu la force de monter au ciel de la littérature et d'y flamboyer en lettres d'or» et, puisqu'on est certain qu'il a quitté la terre, qui doit donc «se trouver dans une espèce de purgatoire» (p. 190), comme s'il s'agissait d'un «rêve qui se souvient d'avoir été un homme et qui rôde un peu au-dessus de nos têtes comme une ombre» (p. 191) ? Comment ne pas comprendre que Bernard Frank, s'il tient Le Feu follet «pour le meilleur roman de Drieu», «le plus chargé de bonnes phrases (comme on parle avec tendresse d'une bonne femme) puisque, dans ce roman au moins, «il fait vite», «il est pressé» car «la mort souffle sur les pages et balaie avec entrain les digressions» (p. 209, l'auteur souligne), c'est sans doute parce qu'il se reconnaît lui-même dans «le portrait de celui pour qui l'existence est de l'autre côté de la vitrine" (p. 208) ? N'allons pas trop loin, encore une fois, dans le petit jeu des identifications plus ou moins secrètes, ne creusons pas davantage le sillon où Bernard Frank ne craint pas d'engager le soc de sa charrue interprétative, afin, une fois la terre retournée, d'y jeter quelques graines plus ou moins vigoureuses qu'on n'aura même pas le temps de voir germer, en évoquant par exemple l'image d'une effraction entre deux personnalités contraires, que notre interprète, à propos de Drieu, qualifie de Viking et de décadent (cf. pp. 138 et sq.).
Ces mots sont durs en tout cas, comme d'autres où il parle, à propos de l'écrivain qu'il semble si bien avoir disséqué (sans toutefois évoquer la totalité de ses œuvres), de «rumination rêveuse de l'échec» (p. 192), ou bien d'un faiseur angoissé qui aurait créé, «un peu au-dessus de sa tête (ou un peu en dessous) un double malchanceux qui échoue à sa place» car, en fin de compte, «c'est son imaginaire même qui est pourri», Drieu, selon la confession de Chardonne, donnant l'impression d'être d'ores et déjà un «mort» qui «préfère l'échec à n'être rien» (p. 193).
Finalement, il serait assez facile de troubler la conscience, apparemment limpide, ainsi que le ton quelque peu altier de Bernard Frank, cette assurance hautaine du jugement de l'homme de gauche qui, ici ou là, ne regimbe pas à lâcher une saillie en bonne et due forme, et d'abord contre l'homme de droite (6), en lui faisant remarquer que son livre, comme tous ceux qu'il a évoqués et singulièrement les œuvres de Drieu, nous fournit l'exemple d'une parfaite panoplie littéraire, autrement dit d'«une série d'attitudes dans lesquelles l'écrivain se complaît, un miroir qui l'avantage, des faiblesses qui sont des charmes, un duveteux pour l'intelligence» (p. 66) et que, comme n'importe quel jouet, celui-ci pourrait être démonté en assez peu de temps. Qu'est-ce qui apparaîtrait alors, sous le déguisement du fier bretteur de gauche ? Un homme hanté par la nostalgie d'une époque où la littérature française, et même la France elle-même (7), étaient grandes, la certitude désabusée que, «quand il n'y a plus de princes, il reste à se costumer en prince» (p. 65), une ruse tout de même assez vite éventée que semble avoir faite sienne un écrivain comme Philippe Bordas, toujours pressé de se grandir un peu, lui, nain à tout le moins conscient de son nanisme qu'il ne cherche guère à cacher, auprès de géants comme Carlo Emilio Gadda.
Il apparaîtrait aussi assez clairement que cette assurance de Bernard Frank, à l'évidence bien trop intelligent pour se leurrer lui-même, n'en esquive pas moins un angle mort pour le moins intéressant, et n'esquisse, avec un embarras vite évacué, un discret pas de côté, vers la fin de son livre, par ces quelques mots que nous soulignons : «En sais-je plus que ce Drieu que je suis à la trace, humant ses échecs, dénonçant ses vertiges d'un air vainqueur ? Suis-je donc si fier de moi ? De mon pays ? Mais ces questions ne figurent pas au programme» (p. 200).
Notes
(1) Bernard Frank, La panoplie littéraire (Flammarion, 1989). Je n'ai repéré que deux fautes dans ce livre, une note marquée dans le corps du texte mais absente en bas de page, p. 199, ainsi qu'une maladresse avec la répétition de l'adjectif lunaire aux pages 195 et 197. J'ai signalé plus bas la seconde faute relevée.
(2) «Le style, je rougis de le répéter, n'est pas l'imitation d'un style, il est cette juste et adorable manière qu'ont les phrases de se ployer aux sinuosités d'une pensée, il est ce qui arrache une idée au ciel où elle se mourait d'ennui pour l'enduire du suc absolu de l'instant», p. 20.
(3) «Une part majestueuse de la critique d'aujourd'hui a instauré dans ses écrits la dictature des lieux communs et, comme il est vrai que ceux-ci contiennent toujours des bribes de vérité, on en a conclu étourdiment qu'ils étaient la vérité», p. 20.
(4) Comme celui du roman, censé faire fuir les vaniteux et les pressés, du moins les écrivains qui ne sont jamais obsédés que d'eux-mêmes : «Ce que certains écrivains haïssent dans le roman, c'est qu'il ne les paie pas au jour le jour. Ils se sont dit au revoir, en le commençant, pour un temps beaucoup trop long. Ils ne se reverront vraiment que lorsqu'ils auront tracé le mot fin. Quel atroce oubli alors qu'on avait précisément choisi d'écrire pour ne jamais se perdre de vue» (p. 49). Voyez cette autre remarque frappé du coin du bon sens : «Avant de prononcer le mot juste qui lui ouvrira la grotte de ses livres, l'écrivain crache une ribambelle de faux mots de passe» (p. 58). Ailleurs encore (p. 189), nous pouvons lire : «Le roman est un diable qui s'amuse à toujours filer entre nos gros filets. Nous n'avons eu le temps de ne rien voir et voilà qu'on nous chante que le sens est déjà parti, déjà loin, ailleurs, qu'il a sauté tout frais dans l'assiette du critique», qui, une fois «sa digestion terminée», se fera (et non «se sera») «un doux plaisir de nous faire avaler une copieuse et succulente arête».
(5) Voyez ce passage : «J'éprouve quelque méfiance pour ces essais où les marges d'erreur ne sont pas prévues. L'étude d'un écrivain n'est jamais une science exacte. Et s'il n'y a de bons essais que dirigés, si pour comprendre un écrivain, rien ne remplace cette perforatrice admirable qu'est l'intuition, il faut adoucir ces rigueurs métalliques par des méthodes gentiment archaïques» (p. 179, l'auteur souligne).
(6) Ainsi, depuis Maurras, les écrivains de droite «sont rentrés sous terre. Il n'y a pas une pensée de droite, il y a, ce qui est bien différent, des souvenirs, des relents de droite, des coalitions financières, des techniques de droite, des intérêts de droite appuyés par la police et la majeure partie de l'armée. Ce que l'on nomme improprement la pensée de droite, ce sont des colonels et quarante mille parachutistes armés» (note 2, pp. 237-8, l'auteur souligne).
(7) «La France est devenue un théâtre. Un tableau vague peut remplacer une armée, un arbre en carton, une forêt, un phono, la rumeur aigre d'une foule qui monte à l'assaut du palais. Ainsi de la France. Le mot défaite écorchait nos oreilles, nous lui substituâmes le mot Pétain. La victoire fut un songe qui s'appelait de Gaulle. Récemment, on parlait de guerre civile. Affolé, le pays tout entier s'est recroquevillé. Des millions d'hommes et de femmes sont rentrés sous terre pour désarmer la menace. Les fables racontent que les ours ne touchent pas les hommes morts. Nous avons dû nous dire que si l'Histoire sortait du bois et nous trouvait couchés, endormis, elle aurait peut-être pitié de nous» (p. 225).































































 Imprimer
Imprimer