Rechercher : Proust
La Francia que espera a los reyes de España : un país en llamas, par Juan Pedro Quiñonero

Don Juan Carlos y doña Sofía llegarán a una Francia profundamente inquieta ante el fantasma de una jornada nacional, el martes, el día más importante de su visita de Estado, de huelgas, manifestaciones, paros, protestas y violencias callejeras.
Una Francia mortificada por el paro de masas, la precariedad laboral, el crecimiento de la fractura social, la emergencia de guetos étnicos, las llamaradas racistas. Una Francia cuarteada por el multi culturalismo, los enfrentamientos étnicos y religiosos; gobernada por un presidente que la prensa extranjera califica de dinosaurio y sus últimos biógrafos presentan como la encarnación del declive nacional y la impotencia de los poderes públicos.
Esos son los rostros mejor conocidos y más amables de una crisis que los historiadores de la política y la economía consideran abocada a una ruptura brutal y los biógrafos de Jacques Chirac describen como un campo de minas incendiarias, cercando un palacio presidencial donde un presidente shakesperiano, envejecido, curtido en todas las traiciones y cobardías, agoniza políticamente mientras su esposa (Bernadette), su hija (Claude), su primer ministro (Dominique de Villepin) y su ministro del interior (Nicolas Sarkozy), protagonizan incontables escaramuzas al arma blanca, con un lenguaje tabernario y hampesco.
Cuando Bernadette Chirac habla de Dominique de Villepin, entre conocidos que no siempre son de confianza, lo trata, con ironía, de Nerón, Gran estratega, o el poeta de mi marido. Alusiones envenenadas a trágicos incendios políticos precipitados por Villepin. Por su parte, Nicolas Sarkozy trata a Jacques Chirac de Luis XVI. Menos aristocrático, Villepin evoca sus aspiraciones presidenciales, entre amigos, con un lenguaje que me veo forzado a limpiar de obscenidades : Francia desea que la posean. Le pica en el bajo vientre. Y abre sus muslos. Esperando al carretero que venga a hacerla suya.
Esa frase, textual, es citada en la última biografía de Chirac, escrita por Franz-Olivier Giesbert, que describe un fin de reino en términos devastadores: un presidente que ha asesinado y traicionado a rivales y amigos, y ha precipitado el declive de Francia, víctima de su demagogia, disoluto, consagrado al goce íntimo del poder por el poder, pero al fin solo, abandonado de amigos y amantes.
Tras la violencia shakesperiana de los enfrentamientos personales se oculta el paisaje otoñal de una Francia víctima de los demagogos que la gobiernan, hundiéndola en el abismo del aislamiento diplomático internacional y la fragmentación social de la patria.
Jacques Marseille, profesor de historia económica en la Sorbonne, describe de este modo las raíces últimas de la crisis actual: «En Francia, desde la Revolución de 1789-93, hay una relación directa entre el Estado y los ciudadanos. Cuando todo está en crisis, comenzando por la República, es lógico, que la calle intente imponer su ley. Máxime, cuando la gran mayoría de los franceses viven al margen de la política. El 20 o el 30 % de los franceses no votan. Un 15 % votan a la extrema derecha. Otro 10 % vota a la extrema izquierda. El resto, están desconcertados e intentan manifestarse a través de la contestación. La crisis actual confirma nuestra incapacidad de discursión, reforma o compromiso, condenándonos a la ruptura». «Estamos al borde de una ruptura – concluye Marseille –, a la vista del diálogo imposible entre el gobierno y la calle».
Ruptura también es la palabra mágica del programa político personal de Nicolas Sarkozy: «Romper con veinte años de paro de masas, quince años de crecimiento mediocre, diez años de poder adquisitivo declinante, siete alternancias políticas desde 1981».
Ruptura, declive, son, así mismo, las palabras de moda en las librerías, en los debates de radio y tv. Cuando los Reyes de España vinieron a París, en 1985, para sellar con una visita de Estado la plena reincorporación española a los negocios europeos, Madrid buscaba un puesto en firmamento estrellado de Europa, y París todavía brillaba con una luz declinante. Hoy, Madrid, Londres y Berlín deben fingir que ignoran el penoso ocaso parisino, esperando con inquietud que alguien vuelva a iluminar los palacios polvorientos y mal iluminados, donde el visitante, despavorido, escucha los graznidos de una infame turba de aves nocturnas. Los lectores de Góngora apreciarán.
05/04/2006 | Lien permanent
Portrait d'Éric d'Éric Werner

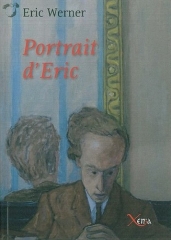 À propos de Portrait d'Éric d'Éric Werner (Éditions Xenia, 2010).
À propos de Portrait d'Éric d'Éric Werner (Éditions Xenia, 2010).Curieux livre d'un curieux auteur que ce Portrait d'Éric, petite autobiographie devant son titre à un beau portrait que le peintre Joseph Czapski (le même qui écrivit le très beau livre intitulé Proust contre la déchéance) réalisa en 1971 de l'auteur. Werner, qui n'aima pas ce portrait de lui, jugé bien trop froid, le commente longuement puis nous donne les raisons de son récent attachement à ce tableau : enfin, il est parvenu à comprendre que ce miroir n'était pas seulement celui qui lui permettait de contempler certains détails symboliques de sa personne mais surtout celui qui lui avait permis de réaliser un bon dans le temps : Czapski n'a pas peint l'auteur tel qu'il l'a vu mais en fait tel que ce dernier lui-même se comprendrait dans le futur, à savoir comme un homme froid, un homme où les facultés intellectuelles paraissent étouffer les autres.
De fait, je crois n'avoir pas lu dans ce livre qui ressemble à une séance d'autopsie, sous la plume de Werner, une seule ligne que nous pourrions rattacher à une minuscule effusion, voire la preuve, pourtant maigre, d'une quelconque sentimentalité, du plus petit attendrissement pour l'une de ses compagnes (Murielle Gagnebin, dont Werner s'est séparé, auteur d'un ouvrage sur Czapski publié en 1974) ou son père, qu'Éric Werner évoque avec une froideur toute protestante.
Dans sa préface, Slobodan Despot, patron des éditions Xenia qui publièrent en 2006 La Maison de servitude, un étrange essai, se déclare heureux d'avoir pu éditer un texte tel que celui que nous tenons sous les yeux. Il aurait dû, afin d'accroître quelque peu ce légitime sentiment de fierté, relire plus attentivement le texte de Werner, déparé par d'horribles quelque part (Et donc, quelque part, je jouais la comédie, p. 69) ou encore par la tournure fort laide et trop souvent employée consistant à commencer une phrase par mais (voir l'avant-propos, truffé de ces occurrences).
Détails sans doute. Reste que la trajectoire intellectuelle et spirituelle de l'auteur, pourtant intéressante, ne m'est point vivifiée par une écriture qui en aurait épousé les failles, les drames, les interrogations et les joies. Il me semble que l'écriture de Werner est celle d'un clinicien qui, froidement, s'interdisant toute forme d'émotion, se contenterait de minutieusement dérouler l'écorché des grandes lignes de sa biographie, depuis le mois d'octobre 1940 qui vit sa naissance à Genève jusqu'en juin 2009 où il s'est installé à La Tour-de-Peilz, en passant par son divorce en 1975, son rôle dans l'affaire Paschoud en 1986 ou bien la mort de son père en 2005.
Lorsqu'il délaisse le terrain purement biographique, Éric Werner évoque Jean-Jacques Rousseau et sa Nouvelle Héloïse, contredisant la thèse ridiculement psychanalytique de son ancienne compagne sur la mort de Julie d'Étange. Bien. Et alors, cher Monsieur ? Pourquoi avoir évoqué le roman de Rousseau, hormis pour nous rappeler que vous vous êtes installé dans la région même, magnifique, où l'écrivain français a fait évoluer ses personnages ? Hormis encore pour nous rappeler que vous avez précédemment évoqué ce même roman dans la partie de votre ouvrage consacrée à l'analyse du fameux tableau de Czapski puisque le titre qui lui fut donné, Le jeune philosophe, par votre ex-femme Murielle Gagnebin, est directement tiré de l'œuvre de Rousseau ? Ne s'agit-il donc, dans le texte de Werner, que de poursuivre un dialogue avec une personne dont, selon son propre aveu, il ne sait plus rien ?
Serait-ce finalement cela, la trame secrète de ce livre, son motif dans le tapis ?
«En tant qu’expression de la parole, écrivait Éric Werner dans sa Maison de servitude (également édité par Xenia en 2006, p. 59), la démocratie moderne n’est pas un état de choses stable mais au contraire en devenir constant, à l’image même de la vie à laquelle s’identifie la parole.» Bien évidemment, il serait grotesque d'affirmer que la vie d'Éric Werner est figée. Son livre même réfute cette vue, puisqu'il s'attache à montrer une partie du cheminement de pensée de son auteur.
Pourtant, aucune chaleur ne paraît brûler les pages de ce livre sec, à tout le moins les réchauffer quelque peu. Cet ouvrage est parvenu semble-t-il à quelque délétère stabilité, depuis laquelle il ne nous offre aucune trouée. Ce livre ne s'élance pas vers d'autres livres, ne nous donne l'envie d'en lire aucun (et surtout pas ceux de Rousseau), comme tout bon ouvrage le fait.
Le peintre Czapski ne s'était apparemment pas trompé en représentant Éric Werner comme un intellectuel au front hypertrophié, dans un tableau aux tonalités elles-mêmes froides.
28/07/2010 | Lien permanent
Inversion de Brian Evenson
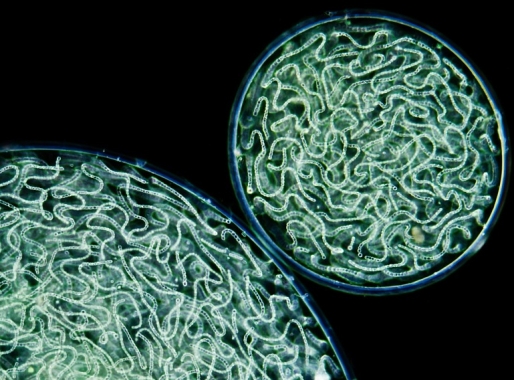
Stevenson, Markheim, in Le cas étrange du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde (Seuil, 10/18, 1992), p. 329.
«[…] un démon d’aspect […] infernal était sans cesse à ses côtés sous la forme de son frère.»
James Hogg, Confession du pécheur justifié (Gallimard, coll. L’Imaginaire, 1987), p. 58.
Je crois qu'il n'y a nul besoin, pour évoquer ce bizarre roman qu'est Inversion de Brian Evenson, de faire appel aux analyses de Gilles Deleuze sur la schizophrénie. Le faire même, et le faire trop longuement quelles que soient les précautions prises par le critique, c'est-à-dire développer lesdites analyses en les plaquant sur ce qui n'est point un essai mais, je crois, un roman, c'est en fin de compte appauvrir celui-ci et ne le donner à lire que filtré par une grille de lecture après tout parfaitement contestable. J'affirme cela alors même que, selon Evenson, il ne serait pas grand-chose sans la philosophie de Deleuze. Avec celle-ci en tous les cas, et en ce qui concerne cet unique roman (je n'ai pas encore lu La confrérie des mutilés), il n'est, au mieux, qu'un écrivain doué mais certes pas un véritable romancier, même s'il prend le soin de préciser qu'en ayant écrit Inversion, il n'a nullement voulu illustrer, contrairement aux affirmations d'Éric Bonnargent, les thèses de Deleuze et Guattari sur la synthèse disjonctive.
Un roman, du moins si son auteur n'a point hésité quant à la forme qu'il donnerait à son rêve ou à son cauchemar, n'a que fort rarement besoin, pour se sustenter ou même survivre, de s'appuyer sur la mince béquille de la glose philosophique (ou psychanalytique, ou théologique, etc.). Je n'affirme bien évidemment pas que les ouvrages de romanciers tels que Proust, Dostoïevski, Conrad, Faulkner, Joyce, les grands Autrichiens et quelques autres encore n'autorisent pas une multitude de lectures : l'inflation des commentaires de toute espèce prouverait même le contraire. C'est là une évidence. Seulement, il ne faut point oublier la spécificité d'un roman qui est, après tout, d'être un... roman, c'est-à-dire un étrange monstre qui, attirant à lui bien des objets, disciplines, textes de diverses factures, est tout de même un assemblage de grumeaux dont la cohésion est garantie par une espèce de force forte (par opposition, en physique, à la force ou interaction dite faible) irréductiblement littéraire et qui, sauf dans ses échecs (parfois étranges et même envoûtants, comme Le Tunnel de Gass), est toujours supérieur à la somme de ses différentes composantes.
Dans Inversion, ce qui frappe donc, plus que la description clinique des troubles qu'entraîne la schizophrénie dans l'esprit d'un homme (ou dans celui de plusieurs : le roman est en tous les cas riche, un premier temps du moins, de cette ambiguïté), c'est l'étroite imbrication existant entre les actes, codes et symboles religieux mormons (l'auteur, on le sait, a fait partie de l'Église dite de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours), la doctrine, plus ou moins phantasmée, de la rétribution par le sang et la contamination d'une cervelle par des signes absolument coupés de leurs signifiants (plusieurs fois, Rudd se déclare hanté par des mots, contaminé par le virus d'expressions lues dans la Bible ou dans n'importe quelle publication, cf. pp. 19, 38, 120, 125). Si les deux premières parties du livre se lisent avec plaisir, parfois, même, avec effroi (ainsi de la dernière scène de la deuxième partie intitulée Lindy, égarée) puisque l'auteur sait parfaitement suggérer la présence d'une sorte de jumeau de l'ombre du personnage principal (p. 87 : «[...] qui saurait dire qui d'autre attendait son heure dans les replis de son cerveau, tel le ver dans le fruit ?»), rejouant avec bonheur la gamme tout de même convenue du double diabolique (cf. p. 113), la dernière, intitulée Hooper, déchaîné, n'est guère convaincante, Brian Evenson, en mélangeant les locuteurs, les identités labiles, schizophréniques apparemment et les trames narratives et temporelles réalisant une sorte de resucée, parfois franchement ridicule (voir la scène des petits papiers collants ou, selon l'époque envisagée, post-it, qui délivrent autant de messages à Rudd/Hooper/Lael...), du Dick du Maître du Haut Château et du Nolan de Memento.
Brian Evenson a sans doute trop voulu démontrer sa virtuosité, dans ce roman qui en anglais est intitulé, plus intelligemment et poétiquement que dans sa traduction française, The Open Curtain (1), cédant aux sirènes vulgaires du polar mâtiné de fantastique, alors qu'un Thomas Glavinic, dans Le travail de la nuit, a su suggérer, avec une économie d'effets admirable, les horreurs et béances métaphysiques d'un esprit cédant à l'hallucination (2) puis sombrant dans une douce folie. Plutôt, donc, qu'une nouvelle et riche variation, aussi aboutie que cauchemardesque, du thème du double sur fond de religiosité pervertie qui, ici, rejoint sans toutefois le dépasser le remarquable classique datant de 1824 de James Hogg, Confession du pécheur justifié, nous avons, avec Inversion, un scénario pour un sous-Cronenberg.
Note
(1) Ce titre fait référence à la description d'un mariage selon le rite mormon plus qu'à une remarquable nouvelle d'Hawthorne (dans Contes et récits publié par Actes sud, coll. Babel, traduction par Muriel Zagha, 2007), ou même, remarque valable à condition qu'Evenson n'ait pas seulement lu Gilles Deleuze, à un des textes composant Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly. Dans les trois cas, le voile ou le rideau masquent une scène aussi fascinante qu'impossible à déchiffrer.
(2) Un détail est à noter, sans que je sache lequel des deux romanciers s'est inspiré du livre de l'autre, ni même s'il n'y a là rien de plus qu'une coïncidence : le personnage d'Evenson comme celui de Glavinic ont l'idée, afin de vérifier qu'ils ne sont point fous, de se filmer. La scène est très souvent répétée dans le livre de Glavinic, alors qu'elle n'est mentionnée qu'une seule fois dans celui d'Evenson (p. 125).
08/12/2008 | Lien permanent
Enquête sur le roman, 3

05/07/2008 | Lien permanent
Réactionnaires, donc salutaires lectures

Nicolás Gómez Dávila, Le Réactionnaire authentique.
Haine du bruit et dégoût des opinions de nasiques connectés à quoi bien des blogs de bonnes femmes ou d'hommes écrivant comme des bonnes femmes se résument, blogs à purin qui n’ont rien à nous dire mais nous entretiennent pourtant quotidiennement de ce rien comme s'il en allait de la découverte la plus sensationnelle de ce nouveau millénaire, par exemple la trace d'une quelconque activité cérébrale dans le cerveau pour le coup mis en berne d'un de nos festifs édiles écolo-socialo-communistes parisiens. La plus haute pointe du comique est dépassée lorsque, sur tel forum que je ne prendrai pas la peine de citer, s’exerce la censure d’une imbécile qui, en fait de littérature, nous propose d’instructifs sondages capables de faire s'esclaffer le plus immonde racoleur publicitaire : Arthur Rimbaud, bohémien poète ou capitaliste éhonté en terre d'Afrique ? Marcel Proust cachait-il quelque complexe œdipien derrière sa moustache ? Virginia Woolf était-elle attirée par les phares du malheur comme une phalène par une ampoule ? Degré zéro de la réflexion, de l’écriture, de toute culture littéraire, de toute idée de confrontation virile entre des participants méprisés de façon inouïe et, inversement il fallait s'y attendre, triomphe du journalisme le plus veule en ce sens qu'il truque une réalité dérangeante, comme certains ont eu raison de le rappeler.
En réaction si je puis dire à ce bavardage de plancton imberbe, chacun de mes nouveaux billets mis en ligne dans la Zone sera désormais annoncé par un fragment de Nicolás Gómez Dávila extrait d’un ouvrage intitulé Écrit en marge d’un texte implicite. Je me réfugie ainsi, comme si j’étais le triste maître perclus dans son haut-château abandonné, dans la lecture ô combien stimulante du Réactionnaire authentique (paru aux éditions du Rocher, coll. Anatolia, en 2004; ce livre contient aussi le recueil de textes précédemment mentionné) de Gómez Dávila qui donne cette superbe définition du réactionnaire, que je me contente de citer : «En effet, même si elle n’est ni nécessité, ni caprice, l’histoire, pour le réactionnaire, n’est pourtant pas une dialectique de la volonté immanente, mais une aventure temporelle entre l’homme et ce qui le transcende. Ses œuvres sont des vestiges, sur le sable labouré par la lutte, du corps de l’homme et du corps de l’ange. L’histoire selon le réactionnaire est un haillon, déchiré par la liberté de l’homme, et qui flotte au vent du destin.»
 Et, lorsque je lis cette autre pensée («Le réactionnaire échappe à l’esclavage de l’histoire parce qu’il poursuit dans la jungle humaine des traces de pas divins. Les hommes et les faits sont, pour le réactionnaire, une chair servile et mortelle qu’animent des souffles venus d’ailleurs»), je ne puis que songer au bref entretien que j’ai eu avec Joseph Vebret et Alina Reyes (qui devrait paraître dans le prochain numéro du Journal de la culture, succédant à celui, parfaitement inepte, qu’Assouline accorda à ce même Vebret), où nous avons évoqué les traces, dans notre propre chair ou plutôt dans celle de l’artiste qui est un possédé, laissées par Dieu et… le diable, son singe. Car, si «les ténèbres de certaines âmes sont l’ombre portée de la lumière divine», nul doute alors qu’un Trakl, un Hölderlin, un Nietzsche ou encore un Artaud n’ont pu écrire et créer que dans la (dé)-mesure même où ils s’éloignaient de toute prudence humaine et laissaient, en eux, en leur corps devenu calice douloureux, advenir le Verbe impétueux qui remplit, assoiffe puis déborde de la frêle vasque qu’est l’esprit de l’homme. Et, puisque nous avons également parlé, au cours de ce même entretien, de notre manière d’écrire, cette autre pensée de Dávila n’a pu, d’une certaine façon que j’avoue bien peu modeste, que conforter a posteriori ma propre technique de rédaction, concentrique ou plutôt, elliptique : «Mon unique prétention est celle d’avoir écrit un livre non pas linéaire, mais concentrique». La mienne aussi, inévitablement mise en exergue par les facilités vertigineuses qu’autorise la pratique de l’hypertexte. Autre exemple de cette écriture : La littérature à contre-nuit bien sûr, illustration déjà ancienne de cette giratoire manie, puisque j’ai inlassablement remanié les différents textes réunis dans ce recueil, les composant à partir d’une sorte de noyau qui grossissait à mesure que j’ajoutai sur cette sphère insécable primitive des sortes d’écorces, de pelures verbales. L’image évoque quelque démarche gnostique ? Sans doute mais dois-je cacher cette petite évidence : j’écris pour trouver l’illumination, moins même, une illumination ? Oh, je me dois de préciser immédiatement ce que j’entends par ce mot, illumination, au passé glorieux d’enlumineur, sens d'ailleurs réinvesti par Rimbaud, mot qui se rapproche dans mon esprit de ces éphémères et innombrables épiphanies joyciennes qui tramaient le tissu, la chair sensible du monde. Mes illuminations ne sont donc pas, d’abord, religieuses mais, toutes profanes, elle n’en laissent pas moins soupçonner qu’un grand texte, contrairement aux axiomes nains des déconstructeurs, n’est que le miroir imparfait d’un Texte premier, illisible, invisible, tissu même de l’univers, sa chair secrète. Je sais donc bien que je ne trouverai, en montant sur les degrés vermoulus de cette échelle de Jacob (qui descend donc vers les profondeurs et le royaume aveugle des monstres), je sais bien que jamais je ne trouverai la vérité ou que, si je devais la trouver, c’est que, comme le peintre Hokusaï ayant quitté la peinture, j’aurais alors laissé derrière moi le langage pour contempler ce qui ne peut se dire ou se voir : la lumière. Je serai mort. Ou bien fou peut-être, n’ayant plus besoin de parler pour les autres, me tenant l’infatigable monologue qui tissera sa geôle gluante jusqu'à me digérer complètement, comme si j’étais pris au centre d’une toile d’araignée.
Et, lorsque je lis cette autre pensée («Le réactionnaire échappe à l’esclavage de l’histoire parce qu’il poursuit dans la jungle humaine des traces de pas divins. Les hommes et les faits sont, pour le réactionnaire, une chair servile et mortelle qu’animent des souffles venus d’ailleurs»), je ne puis que songer au bref entretien que j’ai eu avec Joseph Vebret et Alina Reyes (qui devrait paraître dans le prochain numéro du Journal de la culture, succédant à celui, parfaitement inepte, qu’Assouline accorda à ce même Vebret), où nous avons évoqué les traces, dans notre propre chair ou plutôt dans celle de l’artiste qui est un possédé, laissées par Dieu et… le diable, son singe. Car, si «les ténèbres de certaines âmes sont l’ombre portée de la lumière divine», nul doute alors qu’un Trakl, un Hölderlin, un Nietzsche ou encore un Artaud n’ont pu écrire et créer que dans la (dé)-mesure même où ils s’éloignaient de toute prudence humaine et laissaient, en eux, en leur corps devenu calice douloureux, advenir le Verbe impétueux qui remplit, assoiffe puis déborde de la frêle vasque qu’est l’esprit de l’homme. Et, puisque nous avons également parlé, au cours de ce même entretien, de notre manière d’écrire, cette autre pensée de Dávila n’a pu, d’une certaine façon que j’avoue bien peu modeste, que conforter a posteriori ma propre technique de rédaction, concentrique ou plutôt, elliptique : «Mon unique prétention est celle d’avoir écrit un livre non pas linéaire, mais concentrique». La mienne aussi, inévitablement mise en exergue par les facilités vertigineuses qu’autorise la pratique de l’hypertexte. Autre exemple de cette écriture : La littérature à contre-nuit bien sûr, illustration déjà ancienne de cette giratoire manie, puisque j’ai inlassablement remanié les différents textes réunis dans ce recueil, les composant à partir d’une sorte de noyau qui grossissait à mesure que j’ajoutai sur cette sphère insécable primitive des sortes d’écorces, de pelures verbales. L’image évoque quelque démarche gnostique ? Sans doute mais dois-je cacher cette petite évidence : j’écris pour trouver l’illumination, moins même, une illumination ? Oh, je me dois de préciser immédiatement ce que j’entends par ce mot, illumination, au passé glorieux d’enlumineur, sens d'ailleurs réinvesti par Rimbaud, mot qui se rapproche dans mon esprit de ces éphémères et innombrables épiphanies joyciennes qui tramaient le tissu, la chair sensible du monde. Mes illuminations ne sont donc pas, d’abord, religieuses mais, toutes profanes, elle n’en laissent pas moins soupçonner qu’un grand texte, contrairement aux axiomes nains des déconstructeurs, n’est que le miroir imparfait d’un Texte premier, illisible, invisible, tissu même de l’univers, sa chair secrète. Je sais donc bien que je ne trouverai, en montant sur les degrés vermoulus de cette échelle de Jacob (qui descend donc vers les profondeurs et le royaume aveugle des monstres), je sais bien que jamais je ne trouverai la vérité ou que, si je devais la trouver, c’est que, comme le peintre Hokusaï ayant quitté la peinture, j’aurais alors laissé derrière moi le langage pour contempler ce qui ne peut se dire ou se voir : la lumière. Je serai mort. Ou bien fou peut-être, n’ayant plus besoin de parler pour les autres, me tenant l’infatigable monologue qui tissera sa geôle gluante jusqu'à me digérer complètement, comme si j’étais pris au centre d’une toile d’araignée. Illustrant l’évidence, moult fois répétée, selon laquelle le hasard n’existe pas, j’avais innocemment fait précéder cette salutaire lecture de Dávila par celle d’Orthodoxie, avant de me plonger dans un essai intéressant quoique, à mon sens, trop vite écrit et allusif de Philippe Maxence (Pour le réenchantement du monde, Ad Solem) sur l’œuvre quelque peu oubliée du grand Chesterton. Dans Hérétiques, l’inventeur du père Brown affirmait tranquillement cette phrase que le camp de concentration occidental pourrait inscrire en lettres de fer au-dessus de son porche immonde et banalisé : «Supprimez le surnaturel, il ne reste que ce qui n’est pas naturel». Chesterton, comme Maxence l’affirme («Autant qu’il est possible sur cette terre – c’est-à-dire imparfaitement – Chesterton est l’homme du paradis terrestre, de la chute, de la rédemption et du paradis retrouvé») est donc bien, sans doute, l’un des modèles de Nicolás Gómez Dávila, qui de toute façon, comme le sont souvent ces magnifiques auteurs du continent sud-américain (que l’on songe à un Borges ou à un Carpentier) était un lecteur infatigable.
Illustrant l’évidence, moult fois répétée, selon laquelle le hasard n’existe pas, j’avais innocemment fait précéder cette salutaire lecture de Dávila par celle d’Orthodoxie, avant de me plonger dans un essai intéressant quoique, à mon sens, trop vite écrit et allusif de Philippe Maxence (Pour le réenchantement du monde, Ad Solem) sur l’œuvre quelque peu oubliée du grand Chesterton. Dans Hérétiques, l’inventeur du père Brown affirmait tranquillement cette phrase que le camp de concentration occidental pourrait inscrire en lettres de fer au-dessus de son porche immonde et banalisé : «Supprimez le surnaturel, il ne reste que ce qui n’est pas naturel». Chesterton, comme Maxence l’affirme («Autant qu’il est possible sur cette terre – c’est-à-dire imparfaitement – Chesterton est l’homme du paradis terrestre, de la chute, de la rédemption et du paradis retrouvé») est donc bien, sans doute, l’un des modèles de Nicolás Gómez Dávila, qui de toute façon, comme le sont souvent ces magnifiques auteurs du continent sud-américain (que l’on songe à un Borges ou à un Carpentier) était un lecteur infatigable.
04/04/2005 | Lien permanent
Le Faulkner délavé de Pierre Bergounioux

Le titre de cet ouvrage de Pierre Bergounioux est trompeur puisqu’il y est moins parlé de Faulkner et de son œuvre que de ce que la littérature a été, ou plutôt aurait dû ne pas être, jusqu’à la publication, en 1929, du Bruit et la fureur du romancier américain. Jusqu’à cette date donc, les écrivains, le plus souvent – à l’exception, notable aux yeux de Bergounioux, du Stendhal de La chartreuse de Parme – se sont contentés de fermer prudemment les yeux sur ce que leurs narrations occultaient : la violence, le désordre, le chaos du monde.
Le divorce, d’ailleurs, est ancien entre le monde et sa représentation par le roman, puisque déjà ce fut Homère (auteur familier à Bergounioux) qui plia les forces destructrices «aux lois du Récit». J’ai parlé d’une exception, constituée par l’exemple de Fabrice del Dongo assistant à la fameuse bataille à laquelle il ne comprend presque rien : hélas, Stendhal recule selon Bergounioux car, après «s’être rapproché comme jamais de sa source enfouie, de l’incohérence et de la confusion, le récit bat en retraite. Il s’écarte de la chose informe, assourdissante, encore sans nom […] et qui menace les structures narratives de dislocation». Consacrer presque cent cinquante pages à étayer benoîtement – mais non sans un certain style – un propos, appelons-le «l’illusion référentielle», que n’importe quel élève de classes préparatoires s’est vu marteler jusqu’au mal de crâne, peut relever de l’exploit. Je parlerais plutôt d’écriture vide ou de morne ressassement, à l’exemple des proses intarissables de Claude Simon dont Bergounioux paraît faire ses délices.
Car enfin, une fois la platitude de la démonstration constatée, qui n’hésite pas à trancher dans la masse de grands blocs hiératiques là où la patience érudite d’un entomologiste eût affirmé la singularité de quelques œuvres bizarrement ignorées, que reste-t-il du cœur de l’ouvrage de Bergounioux, l’idée, justement, qu’une voix assez forte et sûre d’elle-même, celle d’un auteur qui avoua qu’il était un inculte devant un parterre médusé d’étudiants, s’est avancée assez profondément dans le puits de noirceur et en a rapporté un chant infiniment complexe et rugissant de mille voix ? Rien. Pas même quelques considérations intéressantes sur l’œuvre que Pierre Bergounioux s’est, justement, proposé d’ausculter car, en lisant ses jugements de fesse-matthieu distillés sur tel ou tel roman de l’auteur du splendide Parabole, nous ne sortons jamais du manuel scolaire ou, pis, de la compilation rance et sans âme, cette luzerne fade qu’aiment brouter les bacheliers. Ainsi l’auteur, qui pense fort à propos que la littérature n’est rien si elle n’a tenté, douloureusement, de sonder le cœur des ténèbres révélé par la parole malade de Kurtz, n’a pas même le courage tout simple de s’immerger, à son tour, dans la polyphonie démoniaque d’un roman tel que Absalon, Absalon ! afin, au moins, d’éclairer obliquement le mystère noir qui se trame dans l’histoire de l’ascension et de la chute de Thomas Sutpen…
Et puis, s’il est évident (et quelque peu convenu) de citer à la barre de ceux que nous pourrions appeler pompeusement les nommeurs de l’innommable des romanciers tels que Proust, Joyce ou Kafka, comment passer sous silence les tentatives, souvent désespérées, de romanciers tels que Conrad (les efforts de son narrateur favori, Marlow, témoignent ainsi de l’impossibilité de dénouer le nœud gordien du Mal) ou même Bernanos, dont l’ultime roman, le crépusculaire Monsieur Ouine, pourrait bien être, je dis cela sans aucune distanciation métaphorique, la bouche d’Ombre de laquelle l’Occident, a reçu une haleine fétide qui n’est pas près de se dissiper ?
Double échec donc, que rien n’excuse à mes yeux, dans ce livre de Bergounioux somme toute inutile : d’abord dans l’évocation d’une œuvre difficile et aimée (cela, au moins, reste évident) qui me fait regretter le beau Faulkner, Mississippi d’Édouard Glissant, infiniment plus attentif, dans sa prose ourlée et subtile, à protéger le mystère des romans faulknériens, ensuite dans l’illustration de ce qu’est le chaos bouillonnant dans lequel, réellement c’est-à-dire physiquement, doit se risquer l’écrivain qui veut arracher un peu de lumière, de sons articulés, d’ordre en fin de compte, à ce qui n’en a pas, à ce qui n’est que tumulte et ténèbres hurlantes, jadis contemplées avec effroi et tremblement par le Milton du Paradis perdu. Du reste, tout a été dit par Paul Gadenne, autre grand lecteur de Faulkner, affirmant que, de nos jours, «la littérature s’écrit devant le bourreau». Il eût sans doute été fort utile de rappeler à Pierre Bergounioux que la critique doit ou plutôt devrait, elle aussi, elle surtout, s’écrire dans la présence immédiate d’un danger, pourquoi pas cette corne de taureau imaginée par Michel Leiris qui, sans nous assurer que celui qui commente est sincère, témoigne à tout le moins d’une certaine exigence et d’un risque assumés : tenter de s’aventurer, pour le critique, dans les régions où l’auteur s’est enfoncé avant lui, c’est évidemment prendre sa part de l’expérience du gouffre dont Fondane parlait à propos de Baudelaire mais c’est aussi, tout simplement, une question de politesse.
12/09/2007 | Lien permanent
Éric Naulleau, dernière victime (consentante) de l'hanounisation accélérée des esprits ?

Mille petits indices nous laissaient pourtant penser que la Maison Naulleau, comme celle de Poe, la très fameuse Maison Usher, bien que nous présentant des dehors en apparence sains, était en fait irrémédiablement lézardée et même très franchement pourrie, en raison sans doute de la prolifération incontrôlée de la larve de Cyrillus termitoidea qui, malgré un cerveau dont le volume avoisine gaillardement le millimètre cube, déploie une stupéfiante ardeur en présence de toute surface rongeable. Ici par exemple, entre bien d'autres propos de très haute volée (à partir de 16.35), Naulleau nous expliquait combien il appréciait, et visiblement apprécie plus que jamais, les très stratosphériques qualités intellectuelles de son ami Cyril Hanouna qui, parce que ce dernier l'apprécie en retour, mais de façon totalement désintéressée on s'en doute, en a fait l'un des chroniqueurs de sa prochaine émission. Nous sommes donc là en présence d'une estime réciproque entre deux hommes que tout oppose sauf la soif de connaissances, estime respectable qu'il ne me viendrait bien évidemment jamais à l'esprit de critiquer. J'irais même jusqu'à affirmer que ce serait un fort mauvais coucheur que l'esprit chagrin osant prétendre qu'il existe une incompatibilité non point seulement existentielle mais métaphysique et même, ontologique, entre ledit chroniqueur grand lecteur de Pif Gadget qu'il a toutefois du mal à déchiffrer sans s'appliquer de longues heures et ledit ardent défenseur de Marcel Proust ou Paul Gadenne, que notre Danton du journalisme, paraît-il, vénère.
Que Naulleau ne soit depuis quelques années tout de même rien de plus qu'un journaliste amélioré, ce qui certes ne suffit pas à l'éloigner de l'insignifiance absolue, j'en ai touché quelques mots sous forme d'anecdote plaisante dans mon entretien filmé avec Patrice Jean, et nous supposerons fort naïvement que l'homme a quelque prochain livre à faire paraître (dans la collection L'Infini ?) puisque, pour Le Point et contre toute évidence, il affirme péremptoirement que Philippe Sollers se bonifie dans ses derniers livres (1), ce qui est non seulement une prodigieuse stupidité, mais un mensonge apparemment assumé ! Je parlais d'ailleurs, pas plus tard que le 30 mai, d'une naulleauisation des esprits, en avançant, ô pure coïncidence, le nom d'Hanouna comme prochaine subite révélation, dans l'esprit de Naulleau, des plus immarcescibles sommets de la finesse d'esprit. Il est vrai que notre chroniqueur, montrant de la sorte un sens consommé de l'art du jugement si utile aux critiques littéraires, pouvait oublier de saluer Guy Dupré, remarquable écrivain, l'un des derniers grands avec Christian Guillet dont notre pays puisse, pardon, pouvait dans le cas de l'auteur des Fiancées sont froides, s'honorer, mais se dépêcher en revanche de saluer Pierre Bellemare, Monsieur Bellemare je vous prie qui, après tout, a écrit ou fait écrire un nombre respectable de grands livres pour présentoirs promotionnels d'hyper-marchés.
Si j'ai plus haut avancé une prudente hypothèse, je ne puis en revanche que poser cette navrante évidence : ou bien Éric Naulleau n'a jamais su lire et il a fait croire, surtout aux journalistes, qu'il savait lire, ce qui expliquerait tant de stupidités proférées (l'une des dernières en date concerne le lamentable travail d'Hubert Artus sur Maurice G. Dantec), ou bien il sait encore lire, et nous assistons alors à la putanisation, accélérée je le crains, d'un esprit tout de même vif. Je m'en veux d'avoir trouvé suspecte, il y a deux ou trois ans, la délicate et subreptice moue de dégoût que tel grand critique littéraire et d'art contemporain fit à l'évocation du nom de Naulleau qui mériterait, comme je le fis pour Eugénie Bastié, que je lui consacre un texte pour savoir de quoi il est le nom. Perte de temps assez probable car sans doute Naulleau n'est-il le nom de rien d'autre que du mal, la vacuité, qui ronge nos plus brillants journalistes, du moins ceux qui nous semblaient les moins cloacalement stupides.
Ce ne sera hélas pas le premier de nos juges intraitables à se laisser captiver voire corrompre par le chant des sirènes médiatiques mais, comme je m'en avise en relisant tel ironique propos de l'intéressé, peut-être faut-il se contenter de dire que le Naulleau, pas davantage que l'Argento, ne semble avoir d'honneur, et se replonger au plus vite dans les grands livres que ce lecteur réputé d'élite ne semble plus du tout désirer défendre ni même faire connaître et qu'il a même, si j'en juge par ce qu'il écrit désormais, parfaitement oubliés.
Note
(1) Répondant à la question d'un certain Florent Barraco («Quel auteur dont vous n'aimez pas l'œuvre vous a surpris par la qualité d'un chapitre ou d'un livre ?»), Naulleau n'a pas du tout honte d'écrire ce que voici : «Sollers. J'ai haï jusqu'à une époque récente Philippe Sollers. Dans ses quatre derniers livres, il a enfin arrêté ses pitreries littéraires ou pseudo-branchouilles (sic) pour se consacrer à l'essentiel. Il ne cédait plus à sa manie de citer (que j'appeler (sic) la «citite»). Il pratique une littérature qui me plaît. Il a changé du tout au tout. Œuvre du temps ou l'âge... Se délester de l'inutile.» Mon cher Naulleau, ô lecteur insatiable, puis-je te suggérer de jeter un seul de tes yeux de faucons germanopratins sur cet énorme et implacable dossier qui démonte l'unique génie de Philippe Sollers, celui du copinage ?
21/08/2018 | Lien permanent
L'effondrement de la Zone

 Apocalypses sans royaume de Jean-Paul Engélibert.
Apocalypses sans royaume de Jean-Paul Engélibert.Cinéma.
 Cinéma et eschatologie chez George A. Romero, 1 : de 1968 à 1985, par Francis Moury.
Cinéma et eschatologie chez George A. Romero, 1 : de 1968 à 1985, par Francis Moury. Cinéma et eschatologie chez George A. Romero, 2 : de 2005 à 2010, par Francis Moury.
Cinéma et eschatologie chez George A. Romero, 2 : de 2005 à 2010, par Francis Moury.Littérature.
 Au-delà de l'effondrement, 1 : L'Effondrement de Hans Erich Nossack.
Au-delà de l'effondrement, 1 : L'Effondrement de Hans Erich Nossack. Au-delà de l'effondrement, 2 : L'Apocalypse russe de Jean-François Colosimo.
Au-delà de l'effondrement, 2 : L'Apocalypse russe de Jean-François Colosimo. Au-delà de l'effondrement, 3 : L'époque de la sécularisation d'Augusto Del Noce.
Au-delà de l'effondrement, 3 : L'époque de la sécularisation d'Augusto Del Noce. Au-delà de l'effondrement, 4 : Les Anneaux de Saturne de W. G. Sebald.
Au-delà de l'effondrement, 4 : Les Anneaux de Saturne de W. G. Sebald. Au-delà de l'effondrement, 5 : Les ruines de Paris en 4908 d'Alfred Franklin.
Au-delà de l'effondrement, 5 : Les ruines de Paris en 4908 d'Alfred Franklin. Au-delà de l'effondrement, 6 : Les aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe.
Au-delà de l'effondrement, 6 : Les aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe. Au-delà de l'effondrement, 7 : L'Holocauste comme culture d'Imre Kertész.
Au-delà de l'effondrement, 7 : L'Holocauste comme culture d'Imre Kertész. Au-delà de l'effondrement, 8 : Londres engloutie de Richard Jefferies.
Au-delà de l'effondrement, 8 : Londres engloutie de Richard Jefferies. Au-delà de l'effondrement, 9 : Le travail de la nuit de Thomas Glavinic.
Au-delà de l'effondrement, 9 : Le travail de la nuit de Thomas Glavinic. Au-delà de l'effondrement, 10 : Je suis une légende de Richard Matheson.
Au-delà de l'effondrement, 10 : Je suis une légende de Richard Matheson. Au-delà de l'effondrement, 11 : Le Jour des triffides de John Wyndham.
Au-delà de l'effondrement, 11 : Le Jour des triffides de John Wyndham. Au-delà de l'effondrement, 12 : Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
Au-delà de l'effondrement, 12 : Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Au-delà de l'effondrement, 13 : La Terre demeure de George R. Stewart.
Au-delà de l'effondrement, 13 : La Terre demeure de George R. Stewart. Au-delà de l'effondrement, 14 : La race à venir d'Edward Bulwer-Lytton.
Au-delà de l'effondrement, 14 : La race à venir d'Edward Bulwer-Lytton. Au-delà de l'effondrement, 15 : L'homme qui tombe de Don DeLillo.
Au-delà de l'effondrement, 15 : L'homme qui tombe de Don DeLillo. Au-delà de l'effondrement, 16 : Quinzinzinzili de Régis Messac.
Au-delà de l'effondrement, 16 : Quinzinzinzili de Régis Messac. Au-delà de l'effondrement, 17 : Métacortex de Maurice G. Dantec.
Au-delà de l'effondrement, 17 : Métacortex de Maurice G. Dantec. Au-delà de l'effondrement, 18 : La Machine à explorer le temps de H. G. Wells.
Au-delà de l'effondrement, 18 : La Machine à explorer le temps de H. G. Wells. Au-delà de l'effondrement, 19 : Surface de la planète de Daniel Drode.
Au-delà de l'effondrement, 19 : Surface de la planète de Daniel Drode. Au-delà de l'effondrement, 20 : Chronique des jours à venir de Ronald Wright.
Au-delà de l'effondrement, 20 : Chronique des jours à venir de Ronald Wright. Au-delà de l'effondrement, 21 : Je serai alors au soleil et à l'ombre de Christian Kracht.
Au-delà de l'effondrement, 21 : Je serai alors au soleil et à l'ombre de Christian Kracht. Au-delà de l'effondrement, 22 : Fugue for a Darkening Island de Christopher Priest.
Au-delà de l'effondrement, 22 : Fugue for a Darkening Island de Christopher Priest. Au-delà de l'effondrement, 23 : Le Nuage pourpre de M. P. Shiel.
Au-delà de l'effondrement, 23 : Le Nuage pourpre de M. P. Shiel. Au-delà de l'effondrement, 24 : L'oiseau d'Amérique de Walter Tevis.
Au-delà de l'effondrement, 24 : L'oiseau d'Amérique de Walter Tevis. Au-delà de l'effondrement, 25 : Automne allemand de Stig Dagerman.
Au-delà de l'effondrement, 25 : Automne allemand de Stig Dagerman. Au-delà de l'effondrement, 26 : Au nord du monde de Marcel Theroux.
Au-delà de l'effondrement, 26 : Au nord du monde de Marcel Theroux. Au-delà de l'effondrement, 27 : Une brève histoire de l'extinction en masse des espèce de Franz Broswimmer.
Au-delà de l'effondrement, 27 : Une brève histoire de l'extinction en masse des espèce de Franz Broswimmer.  Au-delà de l'effondrement, 28 : La Mort du fer de S. S. Held.
Au-delà de l'effondrement, 28 : La Mort du fer de S. S. Held. Au-delà de l'effondrement, 29 : Le Camp des Saints de Jean Raspail.
Au-delà de l'effondrement, 29 : Le Camp des Saints de Jean Raspail. Au-delà de l'effondrement, 30 : En attendant les barbares de J. M. Coetzee.
Au-delà de l'effondrement, 30 : En attendant les barbares de J. M. Coetzee. Au-delà de l'effondrement, 31 : Missa sine nomine d'Ernst Wiechert.
Au-delà de l'effondrement, 31 : Missa sine nomine d'Ernst Wiechert. Au-delà de l'effondrement, 32 : La route de Cormac McCarthy.
Au-delà de l'effondrement, 32 : La route de Cormac McCarthy. Au-delà de l'effondrement, 33 : Le Dernier Homme de Jean-Baptiste Cousin de Grainville.
Au-delà de l'effondrement, 33 : Le Dernier Homme de Jean-Baptiste Cousin de Grainville. Au-delà de l'effondrement, 34 : De la destruction comme élément de l'histoire naturelle de W. G. Sebald.
Au-delà de l'effondrement, 34 : De la destruction comme élément de l'histoire naturelle de W. G. Sebald. Au-delà de l'effondrement, 35 : Avant de disparaître de Xabi Molia.
Au-delà de l'effondrement, 35 : Avant de disparaître de Xabi Molia. Au-delà de l'effondrement, 36 : Le dernier homme de Margaret Atwood.
Au-delà de l'effondrement, 36 : Le dernier homme de Margaret Atwood. Au-delà de l'effondrement, 37 : Le cheval de Turin de Béla Tarr.
Au-delà de l'effondrement, 37 : Le cheval de Turin de Béla Tarr. Au-delà de l'effondrement, 38 : Le mythe d'Arthur de David Jones.
Au-delà de l'effondrement, 38 : Le mythe d'Arthur de David Jones. Au-delà de l'effondrement, 39 : Terre brûlée de John Christopher.
Au-delà de l'effondrement, 39 : Terre brûlée de John Christopher. Au-delà de l'effondrement, 40 : Sous les bombes de Gert Ledig.
Au-delà de l'effondrement, 40 : Sous les bombes de Gert Ledig. Au-delà de l'effondrement, 41 : L'Amour parmi les ruines de Walker Percy.
Au-delà de l'effondrement, 41 : L'Amour parmi les ruines de Walker Percy. Au-delà de l'effondrement, 42 : Proust contre la déchéance de Joseph Czapski.
Au-delà de l'effondrement, 42 : Proust contre la déchéance de Joseph Czapski. Au-delà de l'effondrement, 43 : La Folle Semence d'Anthony Burgess.
Au-delà de l'effondrement, 43 : La Folle Semence d'Anthony Burgess.15/03/2020 | Lien permanent
L'instinct de conservation de Nathanaël Dupré la Tour : entretien

 À propos de Nathanaël Dupré la Tour, L’instinct de conservation (Éditions du Félin, 2011).
À propos de Nathanaël Dupré la Tour, L’instinct de conservation (Éditions du Félin, 2011).Jean Clair, Journal atrabilaire (Gallimard, coll. L’Un et l’Autre, 2006), p. 133.
«Le pur réactionnaire n’est pas un nostalgique qui rêve de passés abolis, mais le traqueur des ombres sacrées sur les collines éternelles».
Nicolás Gómez Dávila, Le Réactionnaire authentique (éditions du Rocher, coll. Anatolia, 2004), p. 81.
Juan Asensio
Nathanaël Dupré la Tour, vous prenez soin, dans votre petit ouvrage aussi vif que stimulant, de ne point confondre les notions de conservatisme et de réaction, trop souvent amalgamées par les sots. Il est du reste particulièrement significatif que, vous déclarant conservateur, vous affirmiez que celui-ci ne doit point vouer aux gémonies l’idée de progrès, à condition qu’elle soit éclairée, pondérée : «À la différence d’un système réactionnaire de pensée, un conservatisme éclairé doit donc vouer aux progrès une forme de culte. Mais un culte lucide, prenant d’abord acte que tout ce qui bouge n’avance pas, et qui considère surtout, avec une vision excédant le seul point de vue de l’aujourd’hui, les progrès de l’humanité passée comme ceux de l’humanité présente » (pp. 112-3). En quoi cette vision d’une chaîne d’or reliant les morts aux vivants est-elle fondamentalement différente d’une vision plus traditionnaliste de l’histoire ?
Nathanaël Dupré la Tour
La notion de tradition ou de transmission, et celle de ses conditions de possibilités, est en effet au cœur de cet essai. Je ne crois pas pour autant que les «traditionnalistes» s’y retrouvent, tout au moins ceux qui se retranchent radicalement de la modernité, choisissent de vivre et penser à part. Je tiens en effet à cette notion de culte raisonné du progrès, la nécessité de la transmission m’apparaissant d’abord à partir du souci de l’avenir, et d’une foi intacte dans les récits occidentaux d’émancipation que je crois étrangère au traditionalisme authentique. À l’heure où l’idée de progrès est menacée par la fixation sur l’immédiateté et le culte du présent, l’urgence du conservatisme, au sens large que pouvait lui donner Camus (non plus transformer le monde mais l’empêcher de se défaire), me paraît concerner au premier chef ceux qui croient encore dans le progrès comme une possibilité toujours offerte à l’humanité. En ce sens je vois dans le conservatisme d’aujourd’hui une pensée critique au sens de l’héritage des Lumières; c’est-à-dire qui fasse toujours le détour par la raison lorsqu’elle met en examen la modernité. Cette différence avec la pensée réactionnaire est d’abord une différence d’attitude, de contenance à l’égard du présent : c’est surtout une différence fondamentale pour l’action. Je ne crois pas que la douce amertume des contempteurs du présent soit d’une quelconque efficacité pour améliorer le sort des vivants – même s’il m’arrive, je l’avoue, de m’y livrer de temps à autre.
JA
Vous caractérisez, et à plusieurs reprises dans votre ouvrage, l’esprit conservateur de la façon suivante : «Soupçonneux et nostalgique, sensible à la fugacité des choses de ce monde et attaché à un certain maintien de l’ordre» (p. 109). Ailleurs (cf. p. 41), vous évoquez la transcendance qui est «aussi et peut-être surtout pensée de la ligature entre les générations», transcendance dont doit bien évidemment tenir compte l’esprit conservateur. En fait, le conservateur se doit d’avoir une «vision continuiste du temps historique» (p. 29). Avouez que la frontière paraît mince entre le conservatisme tel que vous l’analysez et ce qu’un Nicolás Gómez Dávila appelle, lui, la pensée du «réactionnaire authentique», qu’il définit très bellement de la façon suivante : «En effet, même si elle n’est ni nécessité, ni caprice, l’histoire, pour le réactionnaire, n’est pourtant pas une dialectique de la volonté immanente, mais une aventure temporelle entre l’homme et ce qui le transcende. Ses œuvres sont des vestiges, sur le sable labouré par la lutte, du corps de l’homme et du corps de l’ange. L’histoire selon le réactionnaire est un haillon, déchiré par la liberté de l’homme, et qui flotte au vent du destin » (op. cit., p. 21).
NDT
Entre le réactionnaire et le conservateur, une certaine communauté esthétique ne doit pas masquer des divergences fondamentales (morales, anthropologiques, métaphysiques peut-être) que votre comparaison fait bien apparaître. Ainsi je vois dans la formule de Gómez Dávila la trace d’un pessimisme et d’un providentialisme qui me sont étrangers. Pour reprendre la métaphore du tissu (et donc du texte, au sens propre), qui en est l’artisan ? Qui est l’auteur de ce texte que nous appelons histoire ? L’hypothèse de Gómez Dávila est que la liberté de l’homme n’est pas ce qui constitue le texte, mais ce qui le défait. Quant à moi je crois, après Saint Augustin, que les déchirures de ce tissu sont imputables, en dernière instance, à ce mal intrinsèque à la création en tant que telle (la trace du néant dans la créature ex nihilo) et non à cette liberté qui me semble au contraire ce par quoi nous pouvons répondre de notre vocation – précisément en poursuivant ce récit d’émancipation que les différents mouvements de Renaissance s’efforcent d’écrire. Ce que je considère comme urgent, c’est bien de rétablir une vision continuiste de l’histoire – c’est tout le sens d’un conservatisme prospectif – mais je renvoie la responsabilité de cette vision à l’homme lui-même, la transcendance étant, par provision pour l’instant, une idée régulatrice nous permettant d’orienter notre existence collective ici-bas. Je ne crois pas que la question du théologico-politique soit réglée par l’affirmation laïque, mais il me semble que la façon dont le formule Gómez Dávila ne correspond ni à ma vision de l’homme – et donc de la cité – ni à ma vision de Dieu.
JA
Autre point de convergence entre le conservatisme et la réaction, par le biais d’une dégénérescence du langage. Vous citez Marcel Proust qui écrit que «Peu à peu au cours de la vie, les noms se changent en mots». Une fois encore, Nicolás Gómez Dávila tient un propos sensiblement identique lorsqu’il affirme que : «Quand une langue se corrompt, ses locuteurs s’imaginent qu’elle rajeunit. Sur la verdeur de la prose actuelle on distingue des moirures de charogne» (op. cit., p. 31). Il est d’ailleurs assez dommage que vous n’ayez pas consacré un chapitre entier à la question du langage et à sa détérioration (décadence ou évolution ?), abordée par le biais du conservatisme.
NDT
Je renvoie à la formule de Proust dans un cas très particulier, celui de la perte de signification actuelle du nom «Europe», auquel je crois que Robert Schuman par exemple avait su, après quelques autres (Hugo, Bernanos…) donner un sens singulier – une vocation, au sens propre. J’ai choisi de mettre en valeur trois symptômes de notre fixation sur l’immédiateté (dégradation environnementale, endettement public et échec du projet politique européen) qui me paraissaient s’imposer à l’œil nu. La question du langage est moins cliniquement observable, en apparence. Et pourtant je rêve souvent à un outil de mesure qui nous permettrait d’évaluer au quotidien le nombre de mots qui apparaissent, ou qui disparaissent de nos conversations, du discours médiatique, des arts populaires, de la littérature… Faire valoir ce solde linguistique, ce serait sans doute s’apercevoir que notre monde (si ses limites sont bien celles du langage) se resserre chaque année un peu plus – d’où les difficultés à respirer que certains éprouvent déjà. Et je ne parle là, bien sûr, que d’un point de vue quantitatif.
JA
C’est sans doute la vision continuiste de l’histoire évoquée plus haut qui vous fait visiblement détester toute forme de providentialisme (cf . p. 76). Un lecteur, féru de ces questions complexes, pourrait vous opposer le fait que le providentialisme, y compris dans sa version la plus extrême, l’apocalyptisme, cherche, au-delà de l’effondrement censé laver, si je puis dire, la Terre de son harassante humanité, à rétablir un lien essentiel et non plus dérisoire avec le passé. La tabula rasa de tous les révolutionnaires véritables et des séides du millénarisme ne serait ainsi que la forme paroxystique de la nostalgie d’une pureté perdue. En d’autres termes, une vision conservatrice véritable qui, si je vous ai bien compris, se doit d’être pondérée, éclairée, «prospective» selon vos termes, ne risque-t-elle tout simplement pas de s’embourber dans un immobilisme (ou un «retrait», cf. p. 15) en fin de compte pires que toute destruction ?
NDT
Cette interprétation de la tabula rasa est suggestive; la lecture de Dostoïevski suffit de toute façon à nous convaincre que le nihilisme peut prétendre à des sources religieuses, chrétiennes ou non. Pour ma part je ne goûte aucunement ce type de doctrine, et j’ai trop de respect pour la mystique pour lui faire occuper un terrain (l’histoire humaine) qui ne me paraît pas lui convenir. Cela dit je ne crois pas que l’excès de providentialisme menace l’Europe d’aujourd’hui. L’incompréhension de nos peuples face à la guerre américaine en Irak illustre bien le fait que cette vague-là, si puissante et dévastatrice qu’elle ait pu être, a bel et bien reflué : si au milieu des années 1960, deux des plus grands théologiens protestants (Jürgen Moltmann et Karl Barth) pouvaient convenir que «Joachim [de Flore] [était] plus vivant qu’Augustin», je ne pense pas que la formule vaille pour notre temps. Je dirais que la tâche du conservatisme aujourd’hui est précisément de penser une vision continuiste de l’histoire qui ne soit plus providentialiste, mais fondée uniquement sur la responsabilité de l’homme – toujours cette idée régulatrice.
JA
Vous paraissez être parfaitement conscient du risque implicite, de la chute (sans doute extraordinairement rapide si elle n’est pas complètement consommée) dans l’instantanéité du progrès, que suppose cette assertion : «Pour le dire vite, la dé-traditionnalisation : c’est notre tradition. Avec le formidable élan qu’un tel regard rend possible; au risque aussi d’une aspiration par le vide, celle-là même que propose la radicalité destructrice du nihilisme […]» (p. 95). Cette belle mais dangereuse pensée, qui pourrait s’inscrire dans le sillage de telle autre de vos affirmations («Une vie nous est donnée pour naviguer entre la faille (chaos) et l’harmonie (cosmos), entre la crainte et l’admiration», p. 73) me fait songer à un ouvrage d’Harold Bloom qui, reprenant, je crois, les propos de John Milton, affirmait qu’il fallait «ruiner les vérités sacrées» : «Tous les grands poètes déclare Harold Bloom, que ce soit Dante, Milton ou Blake, doivent ruiner les vérités sacrées et n’en faire que fable et vieille chanson, parce que, précisément, la condition essentielle de la force poétique est que la nouvelle chanson, la sienne propre, doive toujours être une chanson de soi-même » (in Ruiner les vérités sacrées (Circé, coll. Bibliothèque critique, 1999, p. 140). Dans quelle mesure une pensée conservatrice doit-elle, elle aussi, «ruiner les vérités sacrées» pour ne point paralyser l’audace de son souffle et de son élan (cf. p. 134) ?
NDT
Depuis le parricide de Parménide revendiqué dans Le Sophiste, la ruine des vérités sacrées est un leitmotiv du discours occidental. Le christianisme lui-même (chez l’hérétique Marcion en particulier, mais déjà chez saint Paul), aime à se penser comme se libérant de l’Ancienne Alliance par une nouveauté radicale. Mais tuer son père n’est pas l’abolir; les parricides ne peuvent réaliser leur fantasme d’être inengendrés, et la condition de possibilité de toute «chanson de soi-même» est qu’elle procède, si peu que ce soit, d’une chanson antérieure. Je conçois bien que dans l’entreprise même de «ruiner les vérités sacrées» le conflit avec le sacré soit lui-même une forme de dialogue, qui ne nous laisse pas indemne et laisse en notre chair la trace de l’adversaire; néanmoins à ce paradigme de la ruine active je préfère l’idée (empruntée à R. Brague) que ce sont les renaissances successives qui ont fait l’Europe, cette idée de rénovation, de reformation ou de refondation des vérités héritées qu’on trouve au moins depuis les Carolingiens dans nos représentations collectives. Dans cette répétition créatrice se trouve, me semble-t-il, la principale ressource pour notre temps – et un tout autre rapport au sacré. Maintenant toute la difficulté de l’occident est que, précisément, l’une de nos vérités sacrées est cette ruine des vérités sacrées que vous invoquez. J’aime assez une autre façon de le dire qui est celle de Marie-Madeleine Davy, dans son Encyclopédie des mystiques : «Toute conscience supérieure brise les vieilles outres». Nous sommes héritiers de cette méfiance à l’égard de l’héritage; et c’est aussi la grandeur de notre civilisation que ce goût pour les chemins que nul n’a foulés. Je ne le nie pas, mais j’essaye simplement d’être lucide sur le caractère paradoxal de cet héritage.
JA
Vous écrivez, sur la piété et son oubli à notre époque, de très belles phrases, que je cite avec grand plaisir, m’étant moi-même penché, dans un article récent, sur cette notion magnifique, si importante pour les Anciens : «Une époque sans dévotion (veneration), sans ascèse; sans piété c’est-à-dire, au sens premier, impitoyable. Car la pietas latine qui désigne autant la tendresse pour les enfants que la dévotion aux ancêtres, la reconnaissance fervente de ceux desquels nous recueillons toute chose est, tout autant qu’un sentiment, une vertu – c’est-à-dire, étymologiquement, une puissance, la puissance de relier les vivants aux morts, et aux hommes à venir. Mais de qui aurons-nous pitié si nous ne nous savons plus être pieux ? Et quelle compassion pour leurs descendants peuvent avoir les générations de l’ingratitude ?» (pp. 31-2). Revenir (le verbe est déjà significatif) à la piété, bien évidemment nécessaire, vitale même, à la continuité de la civilisation bien plus que le ridicule «lien social» de nos édiles, n’est-ce pas, plutôt que conserver ce qui peut l’être encore, réagir ? Ne doit-on pas, en somme, passer par un mal, fût-il d’une cruauté sans borne, pour parvenir à un bien, selon un principe mille fois illustré par les tyrans (mais aussi les chefs d’État les plus démocratiquement élus) de toutes les époques ? Je songe, peut-être connaissez-vous cet exemple qui pour le coup n'est pas historique, à la guerre dévastatrice lancée par l’empereur-Dieu Léto (petit-fils de Paul Atréides dans le cycle de Dune) contre l’humanité du futur, afin de la contraindre à réagir et à se renouveler, des milliards de morts étant finalement préférables, selon Frank Herbert, à la disparition pure et simple de l’homme, paralysé par une paix de vieillard, comme nous le voyons dans un autre classique de la science-fiction, La Cité et les astres d’Arthur C. Clarke.
NDT
Pardonnez-moi, mais je suis totalement étranger à ce type de vision. Est-ce sensiblerie de ma part ? Héritage familial ? Je crois pouvoir me représenter assez précisément l’horreur de la guerre et de la contagion du mal pour me garder définitivement de la souhaiter à mes contemporains, si peu inspirante soit parfois notre époque.
JA
Vous affirmez qu’il existe des «réactionnaires de talent, et d’autres qui essaient, tant bien que mal, de gagner leur vie en vendant de la réaction» (p. 14). Pourriez-vous évoquer quelques auteurs appartenant à ces deux catégories, la seconde, on le devine, ne recueillant pas forcément vos suffrages ? Je songe bien évidemment à Philippe Muray, dont on nous fatigue depuis quelques semaines et pour de mauvaises raisons, les oreilles, à Renaud Camus aussi, dont je lis en ce moment même l’Abécédaire de l’In-nocence (Éditions David Reinharc) qui me semble, à bien des égards, être une farce souvent grotesque, parfois honteuse, ou encore au bravache et inutile Petit traité des vertus réactionnaires d’Olivier Bardolle (L’Éditeur).
NDT
Figurez-vous que je pensais précisément à Muray et Camus pour illustrer la première de ces catégories. Même si le talent en question peut parfois souffrir d’un rythme trop élevé de publications, des pressions du fan-club, de récupérations, etc. Il y a tellement pire ! Cela ne m’empêche donc pas d’ouvrir avec plaisir Syntaxe ou l’autre dans la langue ou certains des Exorcismes spirituels. Pourtant je me pose souvent la question, refermant les ouvrages de l’un et de l’autre, de ce qui fait la part d’insatisfaction qui me reste : ma réponse est précisément dans l’idée d’écriture réactionnaire, et dans la forme de fascination qu’elle suppose (ou que je lui suppose) à l’égard du présent. J’ai entendu la femme de Philippe Muray raconter qu’à la fin de sa vie, son mari ne quittait presque plus l’Internet et l’univers médiatique. Terrible châtiment… Pour moi c’est là le risque majeur d’une pensée qui se nourrit de ce qu’elle combat. Cela peut nous dessiller les yeux dans certaines circonstances, cela ne doit pas nous empêcher de faire aussi souvent que possible le pas de côté critique à l’égard du présent que le conservatisme propose.
13/01/2011 | Lien permanent
Un Léon superbe et généreux, par Ian Wambrechtein (Infréquentables, 15)

30/06/2011 | Lien permanent

























































