Rechercher : alain soral
Au-delà de l'effondrement, 27 : Une brève histoire de l'extinction en masse des espèces de Franz Broswimmer

 Tous les effondrements.
Tous les effondrements.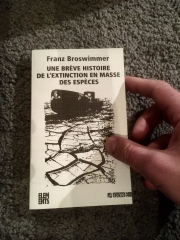 Acheter Une brève histoire de l'extinction en masse des espèces [Ecocide, A Short History of the Mass Extinction of the Species, 2000] (Éditions Agone, coll. Éléments, traduction et préface de Jean-Pierre Berlan, 2010, nouvelle édition revue et complétée) sur Amazon.
Acheter Une brève histoire de l'extinction en masse des espèces [Ecocide, A Short History of the Mass Extinction of the Species, 2000] (Éditions Agone, coll. Éléments, traduction et préface de Jean-Pierre Berlan, 2010, nouvelle édition revue et complétée) sur Amazon.Je pensais, comme beaucoup de mes lecteurs sans doute, que les nombreuses descriptions d'un monde post-apocalyptique n'avaient de valeur que purement imaginative, littéraire, puisque leur vertu première était, bien sûr, l'exagération.
Je me trompais bien sûr, comme j'ai pu le constater après avoir lu le remarquable livre de Franz Broswimmer. Certes, on pourra reprocher à cette étude très fouillée son parti pris furieusement anti-capitaliste mais enfin, il faut bien reconnaître que les exemples que donne l'auteur, s'appuyant sur une multitude de chiffres et de travaux de scientifiques, sont absolument terrifiants.
Que les choses soient parfaitement claires, semble hurler Broswimmer à ses lecteurs : nous ne devons pas penser que la catastrophe, locale (et donc) planétaire est devant nous mais, bien au contraire, que nous vivons dans un monde qui est déjà irrémédiablement saccagé. L'auteur écrit ainsi : «Comme les ruines d’un château médiéval, la «nature» contemporaine est un simple vestige de sa gloire passée» (p. 12). Jean-Pierre Berlan, dans sa percutante préface au livre de Broswimmer, écrit : «Ces quelques observations sur la mathématique de la croissance (exponentielle) montrent : a) qu’un effondrement peut survenir en une période de temps brève à l’échelle historique, une trentaine d’années; b) qu’il se produit sans prévenir et avec une brutalité inouïe; c) qu’il s’accélère continuellement – d’autant plus que la Croissance reste l’objectif de toutes les «élites» mondiales; et, d) qu’il peut prendre des proportions planétaires» (1).
L'une des forces de l'ouvrage de Broswimmer est de nous démontrer que, loin d'être une trouvaille maléfique propre à notre seule époque, l'écocide (2) actuel a été préparé, si je puis dire, depuis des siècles, des millénaires même. Les exemples choisis par l'auteur, qu'il s'agisse des Sumériens (3), des Grecs (4), des Romains (5) ou même des indiens Anasazis (6) sont tout simplement impressionnants.
Et Broswimmer d'enfoncer le clou en remontant plus loin encore dans le passé, en affirmant que : «L’extermination de la mégafaune au pléistocène proche est sans doute le premier indicateur de l’accroissement des capacités de transformation infinies des hommes modernes sur les espèces et les écosystèmes» (p. 51).
C'est bien simple, je crois que l'auteur n'est pas loin de penser que l'apparition du langage, de la conscience symbolique ainsi remarquablement éveillée, est tout simplement la cause première de la destruction, par l'homme, de son habitat : «Grâce à sa capacité biologique unique pour la culture l’Homo sapiens a acquis l’impressionnant pouvoir de s’imposer de l’intérieur à la nature. Mais ce pouvoir est une arme à double tranchant : il crée et il détruit. L’écocide constitue la dimension destructive de l’évolution culturelle» (p. 62). Autant dire que cette évolution culturelle est rigoureusement la même que notre capacité à détruire le monde qui nous porte !
Ce même habitat a été et continue d'être saccagé par la faute d'une autre invention, moderne celle-ci, le capitalisme qui est : «fondé sur une philosophie rationaliste et cohérente exprimant une confiance absolue en un progrès éternel. Elle est matérialiste et utilitaire sans honte aucune, critique de ceux qui échouent dans la course au profit, et incroyablement gaspilleuse» (p. 125).
Appuyant le constat particulièrement pessimiste de Franz Broswimmer, Jean-Pierre Berlan a donc raison d'écrire que : «Ce qui est certain en tout cas, c’est que la concurrence «libre et non faussée» des «imbéciles» (au sens où Bernanos emploie ce terme, c’est-à-dire ces technocrates dont la compétence consiste à «se tromper selon les règles» – pour paraphraser Valéry) nous conduit à l’abîme» (p. 23 de sa préface).
Il y a tout de même quelques raisons d'espérer un avenir meilleur, à condition, remarquons ce point étrange sous la plume du si peu passéiste Broswimmer, que nous sachions tirer les leçons d'un passé encore récent puisque c'est celui du Moyen Âge : «Toutes les notions modernes de sécurité, aussi bien personnelle que nationale, découlent de la privatisation du monde. Le passage d’un monde médiéval d’accords communautaires et sacrés à un monde industriel régi par des forces profanes de marché a engendré la chute de l’homme public et la montée éclatante de l’individu privé» (p. 149).
Quel avenir, dès lors, pour celui que Broswimmer surnomme, méchamment, l'Homo œsophagus colossus ? «Le monde deviendra-t-il, se demande l'auteur dans son Épilogue, une friche écologique d’espèces exterminées, d’hommes expulsés de leurs forêts, de bidonvilles urbains boursouflés, de millions d’hectares de pâtures dégradées et de rivières empoisonnées ?» (p. 224).
Il n'y en aura aucun, d'avenir, à moins que nous ne décidions, afin de nous extraire comme nous le pourrons de notre époque destructrice qui est un «âge d'écocide» (cf. p. 225), afin encore de nous libérer de notre cage d'écureuil géante (7) qui est une prison néo-libérale (8), d'opter pour une «démocratie écologique» aux contours pour le moins assez imprécis qui semblent toutefois annoncer une espèce de communautarisme bon teint, débarrassé de ses excès communistes : «La propriété privée et l’économie à la poursuite du profit, louées au sein d’un système de nations-entreprises, détruisent le patrimoine naturel de la planète, ressource qui doit être partagée par tous sous la responsabilité de chacun» (p. 169).
 À propos de Hervé Juvin, Le renversement du monde. Politique de la crise (Éditions Gallimar/Le Débat, 2010).
À propos de Hervé Juvin, Le renversement du monde. Politique de la crise (Éditions Gallimar/Le Débat, 2010).Une autre lecture est éclairante qui, disséquant la très récente crise financière, rejoint par ses analyses un certain nombre des constats que pose l'ouvrage de Broswimmer : il s'agit du Renversement du monde (sous-titré Politique de la crise) d'Hervé Juvin. Malgré quelques défauts (trop de technicité dans les pages qui décrivent les mécanismes complexes de la crise, des répétitions et un flottement dans le deuxième chapitre, bien éloigné de la rigueur avec laquelle Broswimmer convoque différents travaux de scientifiques), le livre de Juvin, bellement écrit et riche d'images percutantes, affirme que nous n'avons encore strictement rien vu des ravages que notre condition de serfs du marché, de l'argent nomade et de l'idéologie de la mondialisation nous promettent.
Je me contente de citer ces quelques lignes : «La production de l’homme mondialisé, l’homme nouveau, l’homme sans qualités, l’homme «en miettes» est la seule perspective véritable de la sortie de la crise, et du dispositif planétaire qui l’accompagne. Il s’agit d’un projet global, celui de la transformation anthropologique de l’homme de sa terre, de sa foi et des siens, en homme de marché, du contrat et du désir. Il s’agit d’un projet politique, celui de la destruction du citoyen, armé d’une identité contre la confusion et d’une culture contre les séductions de l’instant, au profit du consommateur, errant au gré des sollicitations du moment, nomade, métis, n’importe qui capable de n’importe quoi que lui dicte la mode de saison ou le cours du jour. Et il s’agit d’un projet de destruction de toute société constituée, de toute hiérarchie et de toute différence, au nom de l’égalité factice devant le marché, de la sujétion réelle au couple de l’État et des acteurs du marché mondialisé» (pp. 84-5).
Pour Juvin, il faut de toute urgence que l'Occident, l'Europe en particulier, non seulement atterrisse sur le plancher des vaches duquel la bulle financière l'a durablement éloigné, mais refasse l'histoire, c'est-à-dire accepte d'ancrer des personnes et non plus des individus dans une histoire, sur une terre clairement définie, au milieu d'autres nations acceptées dans leurs richesses.
Nous voici bien éloignés des fadaises pieuses sur le métissage, la diversité et la nécessaire universalité des aspirations transcendant les abominables particularismes hérités d'une tradition haïe qui ne sont, comme d'ailleurs Alain Badiou (voir à ce sujet le livre de Kostas Mavrakis, De quoi Alain Badiou est-il le nom ?, L'Harmattan, 2010), que le masque grotesque, faussement réputé à l'extrême gauche, d'une dilution dans la Matrice dévoreuse du Marché.
Notes
(1) Préface intitulée L’écocide, ou l’assassinat de la vie de de Jean-Pierre Berlan à Franz Broswimmer, Une brève histoire de l’extinction en masse des espèces, op. cit., p. 15.
(2) «[…] la notion d’«écocide» a été originellement élaborée dans les années 1950 et 1960 pour désigner le terrorisme environnemental et la politique de terre brûlée des armées impériales dans le Sud-Est asiatique» (p. 157). Dans son introduction, Franz Broswimmer écrit encore que son étude «traite d’un aspect particulier de la mondialisation, à savoir les processus d’ensemble qui conduisent à la colonisation et à la destruction des écosystèmes dont la vie dépend» (p. 5).
(3) «L’agriculture sumérienne s’effondre effectivement en 1 600 av. J.-C., provoquant la disparition de cette civilisation glorieuse» (p. 83).
(4) «L’expansion démographique et économique des cités-États grecques mène à la destruction progressive des riches forêts de pins et de chênes pour satisfaire un appétit insatiable de bois d’œuvre, de feu et de charbon de bois» (p. 84).
(5) «L’Empire épuisa les terres de l’Ancien Monde méditerranéen, et ce faisant, il sapa lui-même ses chances de survie. Les Romains laissèrent aux civilisations suivantes un effrayant monument à leur folie écologique : les zones humides fertiles d’Afrique du Nord qui avaient un jour rempli les silos de l’Empire étaient devenus des déserts» (p. 98).
(6) «L’augmentation de la population ajoute une contrainte supplémentaire importante sur les ressources de la région. Lorsque les terres ne suffisent plus à faire vivre la population, la culture anasazi disparaît en même temps que le milieu écologique sur lequel elle est basée» (p. 101).
(7) «Le système mondial du moulin de discipline [de production], largement responsable du rythme accéléré de l’écocide, est «une sorte de cage d’écureuil géante» où tout le monde est enfermé sans que personne ne puisse ou ne veuille en sortir» (p. 200). Sur ce moulin de discipline qui était en fait un instrument de torture utilisé au Moyen Âge et dans les prisons anglaises du XIXe siècle, voir John Kenneth Gaibraith, How to Get the Poor Off Out Conscience, Harpers Magazine, novembre 1985.
(8) Selon l'auteur, «le processus social de «mondialisation néolibérale» [est] caractérisé par la transnationalisation de la production, la stimulation du rendement, la perméabilité des frontières nationales [et] la compression du temps et de l’espace alimentée par la révolution des technologies des communications et des transports» (p. 184).
20/10/2010 | Lien permanent
Apocalypses sans royaume de Jean-Paul Engélibert
 Rappel : Au-delà de l'effondrement.
Rappel : Au-delà de l'effondrement.Ce type d'ouvrage présente au moins deux défauts majeurs. Étant donné tout d'abord que ses chapitres ne sont que l'assemblage d'articles provenant de diverses sources, sa cohérence n'est pas absolument évidente, de même que son corpus d’œuvres étudiées, qui peut être tout à fait contestable. L'auteur a ainsi raison d'évoquer un certain nombre de romans post-apocalyptiques comme Terre brûlée de John Christopher, Le dernier homme de Margaret Atwood ou La Possibilité d'une île de Michel Houellebecq, trois ouvrages étudiés sur ce blog, mais pourquoi, dans ce cas, ne point se pencher sur des romans aussi ambitieux que le sont par exemple La Mort du fer de S. S. Held ou bien encore La Terre demeure de George R. Stewart ?
On me répondra que, par définition, ce type d'étude ne peut être exhaustif, ce qui est bien évidemment vrai, mais je pense que l'explication de ces étonnants oublis réside bien davantage dans le fait que Jean-Paul Engélibert a soigneusement choisi des exemples de romans dont l'analyse était susceptible de conforter son propre horizon idéologique, assez peu discret. Ainsi a-t-il évoqué des ouvrages susceptibles de pouvoir être analysés au travers de ses petites grilles herméneutiques, procédé qui bien sûr est l'exact opposé de ce que doit être une véritable démarche de lecteur, a fortiori de commentateur : une liberté absolue par rapport au texte, qu'il ne faut jamais chercher à faire rentrer dans un moule, forcément étriqué.
C'est là le second défaut principal de ce livre qui, s'appuyant sur les analyses d'auteurs tels que Günther Anders (dont la très belle expression d'apocalypse sans royaume a donné son titre au livre, publié par Garnier) mais aussi, hélas allions-nous dire, sur les indéboulonnables catalogues de formules toutes prêtes pour khâgneux et éternels universitaires que sont les textes de Foucault, Freud, Barthes, Genette ou Agamben, répète sa petite leçon antilibérale convenue à tendance psychanalo-derrido-marxiste, et cite longuement ce que Deleuze et Guattari ont appelé critique mineure comme modèle herméneutique, laquelle «ne cherche pas les influences, les déterminations, l'identité générique des textes [et] n détermine pas de valeurs ni ne dresse de hiérarchies : elle s'intéresse aux œuvres en raison de leur puissance de déplacement des savoirs, des croyances, des identités. Elle ne rapporte pas cette puissance à une individualité, elle ne cherche pas à caractériser des auteurs, mais bien plus à repérer la teneur collective de ce qu'ils énoncent». En somme, c'est affirmer que ladite critique mineure engage la lecture sur le triple terrain consistant à «évaluer la puissance de déplacement des textes, leur puissance d'anonymat et la dynamique qui se compose ainsi» (p. 24).
Ce beau programme, pas franchement littéraire puisque les «apocalypses sans royaume [qui] ne sont pas nihilistes», sont des «tragédies d'un monde postpolitique qu'elles délivrent de la nostalgie comme de l'utopie» (p. 25), ce beau programme qui n'est bien évidemment pas sans rappeler la prétendue mort de l'auteur, n'est toutefois pas respecté par Jean-Paul Engélibert qui, justement, nous délivre souvent des précisions concernant les écrivains qu'il évoque, qu'il s'agisse d'Aldous Huxley ou de J. G. Ballard, auteur de quelques-uns des romans de science-fiction les plus soporifiques qu'il m'a été donné de lire.
C'est encore, ce beau programme, ce qu'il y a de plus intéressant dans ce livre littéralement truffé de fautes, jargonnant en bien de ses pages (cf. pp. 72 et sq.), qui devient franchement ridicule lorsqu'il psychanalyse les textes (cf. p. 111), qui plaque non pas une mais plusieurs grilles de lecture (par exemple : L'Aveuglement de Saramago réinterprété par le biais des catégories du biopolitique chères à Agamben) (1), qui raconte des bêtises sur La Route de Cormac McCarthy (cf. p. 18), se trompe lorsqu'il affirme par exemple que «l'apocalyptisme de Ballard est critique, quand celui de Houellebecq (2) est nihiliste» (p. 49), est tout bonnement inutile lorsqu'il évoque les textes oubliables d'Antoine Volodine (cf. pp. 135-52), et constitue en bref un exemple pas franchement abouti d'une critique et d'une théorie littéraires qui, sur les brisées d'une «galaxie qui va de Derrida à Rancière en passant par Alain Badiou, Jean-Christophe Bailly, Jean-Luc Nancy et Jean-Claude Milner» (p. 144), nous propose une multiplicité peu convaincante de catégories où ranger des romans (cf. p. 179) dont, une fois refermé ce livre, nous ne savons à peu près rien si ce n'est que Jean-Paul Engélibert s'en est servi pour rendre «soutenable» un travail qui est un combat, et un combat politique (cf. p. 183).
Nous l'avions deviné à vrai dire, tant l'idéologue bien davantage que le critique avance à vrai dire peu masqué, comme sûr de son bon droit, comme s'il était parfaitement assuré que, en France du moins, la critique littéraire universitaire demeure rivée à ses vieilles lunes si peu discrètement gauchisantes.
 Signalons, également sur ce beau sujet, que la Maison d'Ailleurs a publié aux Éditions ActuSF un livret assez plaisant sur le thème du post-apocalyptique, alors qu'elle organise du 15 septembre 2013 au 2 mars 2014 une exposition intitulée Stalker / Expérimenter la Zone à Yverdons-les Bains en Suisse. Plus de renseignements sur cet événement sur le site de La Maison d'Ailleurs. Le dossier de presse est disponible ici.
Signalons, également sur ce beau sujet, que la Maison d'Ailleurs a publié aux Éditions ActuSF un livret assez plaisant sur le thème du post-apocalyptique, alors qu'elle organise du 15 septembre 2013 au 2 mars 2014 une exposition intitulée Stalker / Expérimenter la Zone à Yverdons-les Bains en Suisse. Plus de renseignements sur cet événement sur le site de La Maison d'Ailleurs. Le dossier de presse est disponible ici.Notes
(1) Giorgio Agamben n'est pas seulement cité pour le livre de Saramago : «On peut en effet lire ces romans à partir de la théorie du pouvoir souverain développé par Giorgio Agamben, qui se réfère beaucoup à Hobbes. Aussi bien dans The Death of Grass [de John Christopher] que dans The Tide went out [de Charles Eric Maine], l'exception devient la règle : le souverain qui émerge après la catastrophe s'arroge le droit de vie et de mort sur ses sujets» (p. 41). Ce n'est hélas pas la seule fois que l'auteur plaquera ainsi, sans beaucoup de cérémonie, les thèses de tel ou tel intellectuel, comme Jacques Rancière (cf. pp. 32 ou 53) sur les livres qu'il évoque.
(2) «Toute l'intrigue des Particules élémentaires fonctionne comme un fantasme masochiste qui ne satisfait le fabulateur qu'au prix de le dégrader» (p. 69).
06/01/2014 | Lien permanent
Charles Péguy selon Jean-Noël Dumont : l'axe de détresse

Alain Finkielkraut, Le mécontemporain.
 Si Monique Gosselin-Noat a été mon piètre professeur pendant quelques mois, Jean-Noël Dumont l'a été, excellemment je dois le dire, pendant quatre longues années (de la classe de terminale jusqu'à ma seconde khâgne, externat Sainte-Marie) lorsque j'habitais encore Lyon.
Si Monique Gosselin-Noat a été mon piètre professeur pendant quelques mois, Jean-Noël Dumont l'a été, excellemment je dois le dire, pendant quatre longues années (de la classe de terminale jusqu'à ma seconde khâgne, externat Sainte-Marie) lorsque j'habitais encore Lyon. Oublions l'anecdote pour établir un second point commun, sans doute plus pertinent, entre ces deux enseignants qui l'un comme l'autre ont publié un essai dans la collection intitulée Le bien commun (Michalon) évoquant deux grands figures des lettres françaises plus ou moins (plutôt plus que moins, hélas) tombées dans l'oubli. Cependant, si le petit ouvrage que Monique Gosselin-Noat a écrit sur Georges Bernanos n'est finalement pas très intéressant, en plus d'être écrit dans un non-style universitaire absolument épouvantable et de tenter, à tout prix, de faire de Bernanos une espèce de porte-parole sociétal (pour utiliser le sabir de Gosselin-Noat) né avant-hier, l'essai que Jean-Noël a consacré à Charles Péguy est d'une fort belle plume et d'une rigueur philosophique évidente bien que contestable.
Cette qualité d'écriture évidente, la problématique choisie par l'auteur (nous y reviendrons) et tenue de bout en bout de cet ouvrage ne doivent cependant point occulter quelques défauts. Le plus léger, sans doute, est celui consistant à insister, un peu trop lourdement à mon goût, sur le fait que l'homme qui devient père de famille est ispo facto le plus grand héros moderne, bien que dissimulé volontairement aux regards des badauds, persuadés qu'une vie de patachon aisé, pourvue qu'elle soit médiatisée, est la clé de la réussite sociale. Mon ironique remarque prend tout son poids lorsque l'on sait que Jean-Noël Dumont, lui-même père d'une famille pour le moins fort nombreuse, n'a cessé, durant ces années d'enseignement que j'évoquais, de nous marteler cette vérité quasiment révélée, sans doute parce que ce grand lecteur de Kierkegaard devait s'imaginer assez bien correspondre à l'humble modèle du chevalier de la foi, simple bourgeois pressé de rentrer chez lui, afin de s'attabler devant un ragoût de tête de veau amoureusement préparé par son épouse...
Plus grave en revanche me semble être le tour de force final par lequel Dumont biaise en quelque sorte la problématique de son ouvrage et en pervertit le sens. Il s'agit donc moins d'un essai tentant de conserver une certaine neutralité que d'un exercice de maïeutique. En effet, suppose notre auteur, les textes de Péguy ne peuvent être compris que si l'on admet, à leur origine et accompagnant leur maturation, la transformation d'une quête de justice en justification : «On peut dire que l’œuvre de Péguy commence en utopie, se prolonge en polémique et s’accomplit en poésie et même en prière. Porte-parole de la colère, Péguy n’est-il pas devenu porte-parole de la plainte, approfondissant ainsi l’exigence de justice ?» (p. 117). La justice est du côté du droit, de l'action politique visant l'établissement, utopique bien sûr, d'une cité harmonieuse qui serait authentiquement socialiste. La justice est même, de nos jours, du côté d'une représentation prétendument cathartique : «Sans doute peut-on dire que la transformation du théâtre en spectacle, ainsi que la désertion des sanctuaires, prive nos contemporains d’un lieu où la plainte puisse prendre forme. Forme de chant, forme de prière. Tout vient alors se presser dans le prétoire. Mais le juge ne peut être investi sans abus du rôle cathartique de l’acteur ni du rôle sacramentel du prêtre» (p. 119). La justification, elle, n'est plus d'ordre politique puisqu'elle appartient au domaine poétique de la contemplation. Avouons que notre auteur ne parvient guère à définir cette notion de justification, la noyant en fin de compte dans une dimension (un peu trop facilement) éminemment littéraire si peu compatible avec la rigueur de la démarche philosophique.
De plus, la contemplation, menée jusqu'à son degré de libération intérieure le plus extrême, aboutit à la vision de Dieu qui, c'est une banalité du discours mystique, se passe de toute médiation littéraire, fût-elle poétique.
La justification appartient donc à la fine pointe de l'âme du croyant, ce chrétien que Péguy n'a finalement jamais cessé d'être, y compris durant ses années anarchistes. La justification nous place en face du Créateur, nous faisant ainsi sortir, écrit Dumont, du «projet d'une organisation juste, d'une justice qui calcule et mesure», la «pitié seule» rendant désormais justice à l'incommensurable «qui est en chacun». Autant écrire que la justification seule est du côté de l'authentique croyant, non point la justice, dont le démon s'amusera à pervertir les bonnes intentions.
C'est supposer de fait, c'est même plutôt faire le pari qu'un peu plus de cent pages auront suffi à faire des lecteurs de cet essai des chrétiens, s'ils ne l'étaient point au moment d'ouvrir le livre.
Finalement, considérant la qualité de son essai, je ne puis en vouloir vraiment à Jean-Noël Dumont d'avoir tenté ce coup de force, en fin disciple de Socrate qu'il est, ayant bien retenu la leçon d'ironie du maître antique. Je lui en veux en revanche de s'être avancé aussi peu masqué car, plus discrètement posé, ce piège pour bécasse confite eût sans doute servi à attraper de plus gros gibiers.
17/04/2007 | Lien permanent
Joris-Karl Huysmans, le forçat de l'écriture
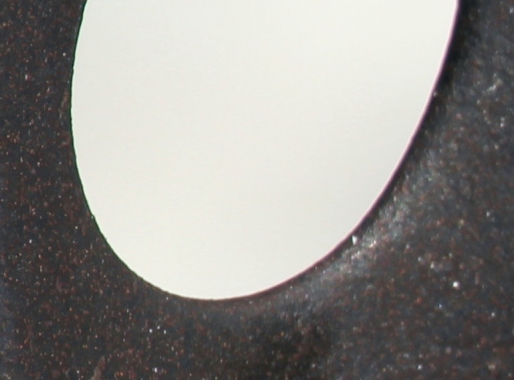
 «Le genre humain n’avait péri que par la voie de solidarité, c’est-à-dire par l’effet de sa communauté substantielle et morale avec Adam, son premier auteur; il était donc juste qu’il pût être sauvé dans la mesure et selon le mode de sa perte, c’est-à-dire par voie de solidarité… Où la solidarité du mal avait tout perdu, la solidarité du bien a tout rétabli.»
«Le genre humain n’avait péri que par la voie de solidarité, c’est-à-dire par l’effet de sa communauté substantielle et morale avec Adam, son premier auteur; il était donc juste qu’il pût être sauvé dans la mesure et selon le mode de sa perte, c’est-à-dire par voie de solidarité… Où la solidarité du mal avait tout perdu, la solidarité du bien a tout rétabli.»Lacordaire, Conférences de Notre-Dame de Paris, 1855, 66e conférence.
«Après avoir scruté et mis à nu tous les bas fonds de l’ordre social : après avoir mis à nu les mystères sataniques, à coup sûr il ne faut pas laisser vos lecteurs au milieu de ces Ténèbres. Dante après avoir décrit les lieux de la souffrance, monte en Haut, et veut nous dévoiler les gloires du ciel. Là il a été peu de choses ! Mais vous, vous aurez pour base de votre Livre les cieux nouveaux et la nouvelle terre…».
Abbé Joseph-Antoine Boullan, 27 janvier 1891, cité par Maurice M. Belval, Des ténèbres à la lumière. Étapes de la pensée mystique de J.-K. Huysmans (éditions Maisonneuve et Larose, 1968), p. 94.
 Joris-Karl Huysmans est un écrivain finalement assez peu évoqué dans la Zone, peut-être parce que je ne suis jamais vraiment parvenu à passer outre telle remarque à mon sens fort juste que Pierre Glaudes fit dans notre entretien au sujet des livres de l'écrivain, jugés inférieurs à ceux de Léon Bloy.
Joris-Karl Huysmans est un écrivain finalement assez peu évoqué dans la Zone, peut-être parce que je ne suis jamais vraiment parvenu à passer outre telle remarque à mon sens fort juste que Pierre Glaudes fit dans notre entretien au sujet des livres de l'écrivain, jugés inférieurs à ceux de Léon Bloy.Quoi qu'il en soit, je reviens, ces derniers temps, à mes vieilles amours en lisant ou relisant des essais consacrés à Charles Péguy, Georges Bernanos ou, depuis peu, Joris-Karl Huysmans donc, visiblement infiniment plus goûté par les universitaires qu'un Ernest Hello, dont ils ignorent à vrai dire la simple existence. Il est vrai que, ayant multiplié les audaces formelles et stylistiques, Huysmans ne peut que passionner, de façon bien légitime, le monde de la recherche qui, fort prudemment, déclarera toutefois ne guère s'intéresser à ses tout derniers romans, catholiques en diable si je puis dire.
D'emblée, je dois dire qu'il s'agit, avec le livre de Patrice Locmant, d'évoquer une agréable petite biographie, qui plus est parue aux éditions Bartillat qui ne ménagent pas leurs efforts pour nous faire découvrir ou redécouvrir des textes beaucoup moins connus de Huysmans que ne le sont ses romans les plus célèbres, À rebours et Là-bas. L'auteur écrit, évoquant l'admiration, quelque peu oubliée, qu'un Breton témoignait au romancier décrivant les aventures esthétiques de Des Esseintes (je suppose qu'il n'apprécia guère la suite romanesque, durtalienne, accomplissant par la foi le destin littéraire du torturé Floressas) : «Huysmans est un visionnaire. Il a prévu la décadence des arts et la venue du tout-marchand, provoqué la mort du roman romanesque en inventant l’autofiction, déboulonné les fondements du réalisme matérialiste de Zola pour ouvrir la voie au surréalisme» (Patrice Locmant, J.-K. Huysmans. Le forçat de la vie, Bartillat, 2007, p. 184). Je ne sais si Huysmans a prévu quoi que ce soit : je crois qu'un écrivain véritable n'a absolument pas besoin de prévoir puisque l'analyse qu'il donne du monde qu'il décrit est toujours une évocations maux secrets qui le rongent. Un grand romancier se moque donc du futur, sa tâche étant de sonder les abîmes du présent. Cette radiographie, si elle est puissante, sera après tout riche de bien des enseignements.
M'a de plus considérablement gêné cette facilité commise par l'auteur, évoquant plusieurs fois la double personnalité de Huysmans, écrivant, de nouveau un peu trop souvent à mon goût, qu'il y avait en lui un docteur Jekill et un Mr. Hyde, métaphore convenue au possible on me l'accordera en lieu et place d'analyses littéraires plus poussées.
Que Locmant ne nous donne pas. Que d'autres qu'il a forcément lus nous donnent.
Belval, ainsi, tentait de souligner «l’influence de Baudelaire sur Huysmans» (op. cit., p. 178) et cet auteur n'a certes pas été le dernier, on s'en doute, à évoquer de possibles ou évidentes influences des écrits de tel ou tel écrivain sur l'auteur des Foules de Lourdes. Locmant poursuit son développement qui gagne, comme dans le passage suivant, à être débarrassé de ses facilités quelque peu condamnables même si, rigoureusement, ces lignes pourraient presque être écrites sur n'importe quel écrivain de quelque importance, qu'il s'agisse d'un Baudelaire, d'un Barbey d'Aurevilly ou, bien sûr, d'un Bloy : «En concevant l’expérience humaine comme une globalité fusionnant sans contradiction le vécu et l’inexplicable, les dégoûts de l’existence à l’extase la plus pure, les noirceurs de l’âme humaine à ses élévations mystiques, Huysmans a anticipé la littérature postmoderne. Il a permis l’avènement d’un art total, établi des correspondances inédites entre la résonance des tons, la musicalité du verbe, la clarté du plain-chant et les senteurs harmonieuses de la peinture. Il a fusionné sa vie et son œuvre pour faire de l’une et de l’autre une œuvre expérimentale unique.»
Aussi agréable à lire qu'on le voudra, le livre de Locmant ne va donc guère plus loin, in fine, que tel mince article paru dans un recueil de textes datant de quelques années, où Françoise Court-Perez écrivait : «On voit que la description de l’expérience mystique prolonge l’inclination esthétique et qu’il y a une nette continuité dans l’œuvre. La transposition d’art est inscrite au cœur de l’œuvre et suppose l’échec de la tentative d’évacuation du regard et de la représentation» (in Alain Vircondelet (sous la direction de), Huysmans. Entre grâce et péché, Beauchesne, coll. Cultures et christianisme, n°3, 1995, p. 18).
À venir dans la Zone, un entretien avec Rémi Soulié, auteur d'un beau Péguy de combat publié par Les provinciales puis un dialogue à trois voix (Raphaël Dargent, Francis Moury et Germain Souchet) consacré aux thèses défendues par Dargent dans son premier essai ô combien polémique, Ils veulent défaire la France édité par L'Âge d'Homme.
Je n'oublie pas vous avoir promis quelques lignes sur Le Tunnel de William H. Gass...
12/05/2007 | Lien permanent
Judas en serial killer, Gustave Thibon en vieille fille

15/03/2004 | Lien permanent
L'Imbécile, Topo, La Sœur de l'Ange, Conférence
Heureusement qu’existent encore les revues, respiration essentielle (mais souffreteuse, chaotique et difficile, en un mot : fragile) d’une vie intellectuelle qui n’est pas encore inféodée au journalisme ou, plus prosaïquement, noyée dans un bidet de phrases sales. J’ai donc lu quelques articles (quelques-uns seulement, c’est mon droit) de deux revues, Topo et L’Imbécile. Cette dernière consacre à Nietzsche, le penseur indémodable de toutes les modes, y compris les plus ineptes, un dossier pour le moins inégal, dont le texte de Pascal Imaho consacré aux transpositions cinématographiques de la pensée nietzschéenne, m’a semblé le plus intéressant. Une bizarrerie toutefois, concernant l’interprétation d’un passage célèbre du film de Tarkovski, Stalker : comme d’ailleurs l’indique l’illustration choisie, ce n’est pas l’Ecrivain qui se recroqueville en position fœtale dans un cours d’eau (ou plutôt, une espèce de marécage à moitié asséché), mais bel et bien le passeur, c’est-à-dire le stalker, innocent touché par la grâce qui, lui, à la différence des deux autres personnages, est désespéré de constater le peu de foi qui anime les faits et gestes des hommes qui l’accompagnent et qui pensent que la Zone n’est rien d’autre qu’une vaste foire mystérieuse leur réservant d’agréables surprises. Quant au fait de prétendre, Pascal Imaho, que le chien noir est la « personnification » (ânerie monumentale : il s’agit d’une animalisation) du Malin, allons allons !, laissez donc ce symbolisme poussif aux rédactrices d’Elle… et regardez de nouveau le film de Tarkovski, puisque le chien, au contraire de vos affirmations, apparaît dans la Zone, d’où pourtant toute vie est exclue, puis suit le stalker et, d’une certaine façon, l’adopte. Les approximations me paraissent heureusement moins visibles dans le deuxième article d’Imaho, qui évoque bellement les films de Jarmush, Gallo et Yu Lik Wai, respectivement Coffee and Cigarettes, The Brown Bunny et All Tomorrow’s Parties. C’est à peu près tout ce qui m’a frappé dans ce numéro de L’Imbécile redivivus, hormis peut-être l’article de Frédéric Schiffter consacré au phénomène du fanatisme (qui pourtant jamais n’évoque cette évidence : aujourd’hui, le fanatisme est celui de certains musulmans). J’évoque rapidement le papier bizarre de Frédéric Pajak sur François Hollande (on hésite à parler de portrait doucement ironique ou de dénonciation feutrée s’accordant bien, après tout, avec l’insignifiance de l’homme politique croqué), celui de Florian Zeller sur Aznar (d’une écriture nulle qui accumule les poncifs et critiques d’arrière-comptoir à l’égard de l’ex-dirigeant espagnol) et, enfin, le meilleur des trois, l’article de Guy Protche sur Marc-Olivier Fogiel. Ah, non, j’allais oublier le texte très drôle de Philippe Muray sur le fléau du rire, récupérant (cette fois avec intelligence) les tics de langage (donc d’esprit) propres au petite peuple de gauche.Voilà tout. C’est peu mais la tentative (ou plutôt sa redite) est intéressante à mon sens même si elle manque de maturité.C’est ce même reproche que j’adresserai à Topo, le «mensuel de tous les livres» (le sous-titre fait déjà rire… et frémir), dont la dernière livraison est consacrée à la question de Dieu, plus précisément à celle du Christ et de ses représentations cinématographiques, littéraires et mystiques. J’établis une gradation là où les rédacteurs de Topo se contentent de juxtaposer des textes dans une mise en page capable d’infliger une migraine ophtalmique à un adepte du fauvisme. Les deux articles consacrés au polémique film de Mel Gibson sont ridicules et traduisent assez le parti-pris idéologique de la revue, dont Prieur et Mordillat sont les rédacteurs en chef invités (avant le grand philosophe Alain Souchon et après Bashung, Isabelle Carré et Josiane Balasko…A quand un numéro piloté par Steevy ?). Il y a cependant des articles intéressants et, je dois le dire, assez surprenants par les figures qu’ils évoquent, qu’elles soient profanes ou mystiques : par exemple celui, sous la plume de Delphine Hautois, présentant Charles Du Bos dans son immense Journal. Celui encore de Jean-Marc Talpin sur l’expérience mystique féminine qui lui permet de mentionner une de mes collections favorites, Atopia, chez Jérôme Millon, que je n’inviterai jamais assez à découvrir. Je mentionne encore l’entretien avec Denis Podalydès relatant ses expériences de lectures enregistrées et, cette fois pour insister sur sa nullité critique qui n’est pas même celle d’une quatrième de couverture, le texte de Lorraine Rossignol évoquant les amours païennes, dont le collectif de Cancer !, Gueules d’amour, remarquablement analysé par une plume qui ferait fortune, je crois, si elle se cantonnait à la rédaction des notices d’utilisation pour aspirateurs.Apparemment, puisque le mot «hasard» est réservé aux imbécile selon Léon Bloy, il était nécessaire (de toute éternité aurait ajouté l’écrivain) que je lise cette revue durant le long trajet qui me conduisait en train vers l’insignifiante, laide et commerçante ville (plutôt bourgade) de Lourdes. Je n’ai d’ailleurs pas eu besoin de me souvenir des textes d’une violence qui nous semble aujourd’hui inouïe que lui consacrèrent Huysmans et Bloy pour trouver cette verrue miraculeuse (au superbe paysage qui l’entoure mais aussi à toute conception d’une foi exigeante et solitaire), immédiatement et sans hésitation, d’une vulgarité extraordinaire, pas seulement, hélas !, commerçante.Il fallait donc, aussi, que je revienne à Paris pour parcourir (parcourir seulement, hélas) le superbe travail accompli par Matthieu Baumier pour le premier numéro de La Sœur de l’Ange dont je reparlerai bien évidemment dès que j’aurai quelque instant à lui consacrer. Je songe toutefois, en tournant les pages nombreuses de La Sœur, pour celles et ceux qui la connaissent, à la revue (le terme est faible) intitulée Conférence, créée par Christophe Carraud qui, à présent, dirige une collection chez Jérôme Millon, Nomina. Je suis de même certain que Matthieu Baumier saura éviter à sa très belle revue de sombrer dans le détestable clanisme qui est le cruel, l’impardonnable défaut de Conférence, à la fois admirable lorsqu’elle publie des textes (bien souvent inédits) d’auteurs tels que Pétrarque, Anders ou Hill et pitoyable lorsqu’elle ouvre ses colonnes à des auteurs contemporains (presque toujours la même clientèle de cueilleurs de champignons poétiques et de rimailleurs spécialisés dans l’ode aux petits étangs, il suffit de jeter un œil sur le «cahier de création» de chacun des numéros pour s’en convaincre) qui en déparent la qualité et la profondeur évidentes.
20/04/2004 | Lien permanent
Ecce Nunc
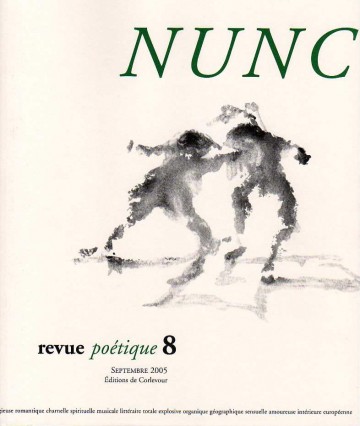
 Je connais trois magnifiques revues : Conférence (dirigée par Christophe Carraud) qui, je l'ai écrit dans la Zone, m'a beaucoup déçu par l'indigence de certains de ses textes d'auteurs contemporains. Lorsque l'on évoque Pétrarque, saint Augustin, Günther Anders ou Maria Zambrano, on n'ouvre point, par lamentable copinage, ses belles pages à de petits auteurs de textes rimailleurs et indigents. Il y avait aussi (déjà le passé avant, peut-être, sa renaissance, ailleurs que chez A contrario) la monstrueuse et fascinante Sœur de l'Ange de Matthieu Baumier. Il y a enfin Contrelittérature créée par Alain Santacreu, à l'actualité riche puisqu'un livre vient de paraître (aux éditions du Rocher) qui regroupe différentes contributions consacrées à l'essence contrelittéraire des arts. A présent, voici Nunc, magnifique revue (présentée par un site très laid que l'on espère simplement informatif), que dirigent Réginald Gaillard et Franck Damour avec lesquels j'ai échangé quelques mots, samedi soir sur le stand convivial de Contrelittérature, au Salon de la revue littéraire. J'ai évoqué avec Réginald, en quelques trop brèves phrases hélas, les efforts fournis par sa poignée d'amis (comme toujours, une revue est d'abord, pardonnez-moi la comparaison disgrâcieuse, un oignon : au fil du temps, les pelures superficielles disparaissent pour découvrir le noyau véritable, qui lui-même sera stable ou instable, se désintégrera ou pas...), tel auteur d'importance présent au dernier numéro, le huitième, Jean-Louis Chrétien auquel il y a maintenant bien longtemps j'avais proposé de participer à ma propre revue, Dialectique, et qui refusa cette participation pour d'indignes raisons (disons-le : ridiculement et prétendument politiques, notre penseur éminent s'imaginant sans doute tomber dans quelque piège tendu par l'horrible infréquentable que je suis et reste...). Les lecteurs habitués de Jean-Louis Chrétien ne découvriront, dans les pages qui lui sont consacrées (dans la rubrique intitulée Shekhina), rien qu'ils n'aient su de longue date après avoir lu le crépusculaire Lueur du secret (L'Herne, 1985) par lequel je découvris l'auteur, L'inoubliable et l'inespéré (Desclée de Brouwer, 2000) dont la lecture m'aida (avec d'autres, Gadenne, Kierkegaard) à surmonter telle épreuve ou encore, ouvrage remarquable, L'arche de la parole (PUF, 1998). En revanche, celles et ceux qui ne savent rien de Chrétien trouveront de quoi nourrir de belles interrogations grâce aux différentes études regroupées dans ce même dossier (au demeurant parfaitement pensé) dont la plus intéressante me semble être celle de Catherine Pickstock intitulée La poétique cosmique de Jean-Louis Chrétien.
Je connais trois magnifiques revues : Conférence (dirigée par Christophe Carraud) qui, je l'ai écrit dans la Zone, m'a beaucoup déçu par l'indigence de certains de ses textes d'auteurs contemporains. Lorsque l'on évoque Pétrarque, saint Augustin, Günther Anders ou Maria Zambrano, on n'ouvre point, par lamentable copinage, ses belles pages à de petits auteurs de textes rimailleurs et indigents. Il y avait aussi (déjà le passé avant, peut-être, sa renaissance, ailleurs que chez A contrario) la monstrueuse et fascinante Sœur de l'Ange de Matthieu Baumier. Il y a enfin Contrelittérature créée par Alain Santacreu, à l'actualité riche puisqu'un livre vient de paraître (aux éditions du Rocher) qui regroupe différentes contributions consacrées à l'essence contrelittéraire des arts. A présent, voici Nunc, magnifique revue (présentée par un site très laid que l'on espère simplement informatif), que dirigent Réginald Gaillard et Franck Damour avec lesquels j'ai échangé quelques mots, samedi soir sur le stand convivial de Contrelittérature, au Salon de la revue littéraire. J'ai évoqué avec Réginald, en quelques trop brèves phrases hélas, les efforts fournis par sa poignée d'amis (comme toujours, une revue est d'abord, pardonnez-moi la comparaison disgrâcieuse, un oignon : au fil du temps, les pelures superficielles disparaissent pour découvrir le noyau véritable, qui lui-même sera stable ou instable, se désintégrera ou pas...), tel auteur d'importance présent au dernier numéro, le huitième, Jean-Louis Chrétien auquel il y a maintenant bien longtemps j'avais proposé de participer à ma propre revue, Dialectique, et qui refusa cette participation pour d'indignes raisons (disons-le : ridiculement et prétendument politiques, notre penseur éminent s'imaginant sans doute tomber dans quelque piège tendu par l'horrible infréquentable que je suis et reste...). Les lecteurs habitués de Jean-Louis Chrétien ne découvriront, dans les pages qui lui sont consacrées (dans la rubrique intitulée Shekhina), rien qu'ils n'aient su de longue date après avoir lu le crépusculaire Lueur du secret (L'Herne, 1985) par lequel je découvris l'auteur, L'inoubliable et l'inespéré (Desclée de Brouwer, 2000) dont la lecture m'aida (avec d'autres, Gadenne, Kierkegaard) à surmonter telle épreuve ou encore, ouvrage remarquable, L'arche de la parole (PUF, 1998). En revanche, celles et ceux qui ne savent rien de Chrétien trouveront de quoi nourrir de belles interrogations grâce aux différentes études regroupées dans ce même dossier (au demeurant parfaitement pensé) dont la plus intéressante me semble être celle de Catherine Pickstock intitulée La poétique cosmique de Jean-Louis Chrétien.  Je termine enfin par l'article qui eût pu être intitulé Archéologie sacrée du signe, en fait un passionnant entretien mené par Nunc au sujet du livre d'Irène Rosier-Catach intitulé La parole efficace. Signe, rituel, sacré (Seuil, 2004). L'existence, toujours fragile rappelons-le, d'une revue telle que Nunc est l'un des rares témoignages écrits de la survivance, dans notre merveilleux pays oublieux de tout et d'abord d'une tradition de culture, de savoir et de poésie qui se forgea souvent dans de précieuses et éphémères revues, d'une pensée qui ose et, osant, n'a pas besoin de la criaillerie publicitaire.
Je termine enfin par l'article qui eût pu être intitulé Archéologie sacrée du signe, en fait un passionnant entretien mené par Nunc au sujet du livre d'Irène Rosier-Catach intitulé La parole efficace. Signe, rituel, sacré (Seuil, 2004). L'existence, toujours fragile rappelons-le, d'une revue telle que Nunc est l'un des rares témoignages écrits de la survivance, dans notre merveilleux pays oublieux de tout et d'abord d'une tradition de culture, de savoir et de poésie qui se forgea souvent dans de précieuses et éphémères revues, d'une pensée qui ose et, osant, n'a pas besoin de la criaillerie publicitaire.
22/10/2005 | Lien permanent
Contre-jour critique

 Je fais aujourd'hui le point, comme disent les pédants, sur la réception critique de mon dernier essai, La littérature à contre-nuit, publié il y a quelques mois par Matthieu Baumier pour les éditions A contrario. La liste qui suit n'obéit à aucune espèce de logique, donc de classement, pas même d'ordre temporel. Toutes ces critiques se complètent bien évidemment et, chaque fois qu'il m'a semblé nécessaire d'y répondre, je l'ai fait sans la moindre hésitation : depuis quand l'auteur d'un ouvrage, dont il connaît mieux que tout autre les faiblesses mais aussi le labeur qu'il lui a demandé, serait-il donc en droit d'abandonner son propre livre même si, je le dis sans aucune complaisance, j'ai été très favorablement impressionné par la qualité de tous ces textes qui, je le sais, ont coûté à leurs auteurs respectifs ? Du reste, la tactique de la terre brûlée n'est pas dans mes habitudes et je préfère de loin, comme face à la critique pour le moins elliptique et ironique d'un Cormary, rendre coup pour coup. Les imbéciles partiront d'un grand rire jaune mais je ne puis faire autrement que remercier ici toutes celles et ceux qui ont pris la peine de m'écrire, anonymes ou célèbres, quelques mots ou plusieurs pages sur ce livre difficile. Enfin, je rappelle que les lecteurs peuvent d'ores et déjà lire deux des chapitres de ce livre, l'un consacré à Ernesto Sabato, l'autre à Monsieur Ouine de Georges Bernanos. D'autres, sans doute, suivront... Voici donc, à ce jour, les auteurs des critiques rédigées sur mon ouvrage. Dominique Autié sur son excellent blog, Balles de match, Balles perdues suivi de ma réponse dans la Zone. Pierre Cormary (pseudonyme) pour le Journal de la culture (n°14) de Joseph Vebret, article repris sur son blog suivi de ma réponse, bien évidemment dans la Zone. Sarah Vajda, courriel. Je publierai, le jour de sa parution (le 5 janvier), une critique consacrée au premier roman (Insomnie édité par le Rocher) de Sarah Vajda. Ce livre est tout simplement absolument remarquable. Marc Alpozzo pour Boojum puis E-Torpedo. Renaud Camus, lettre. Axelle Felgine, sur le site Le-Mort-Qui-Trompe. Pol Vandromme pour Valeurs actuelles, n°3580, du 8 au 14 juillet 2005, article repris dans Le Bulletin célinien n°269, novembre 2005. Michel Crépu pour La Revue des deux mondes, numéro du mois de septembre 2005. Lucien Suel, dans une longue méditation intitulée Dans la gorge de l'ombre, publiée dans la Zone. Le Vif L'Express, week-end du 22 avril 2005, compte rendu signé par M.E.B. Alain Santacreu pour Contrelittérature, n°16, été 2005. Laurent Mabire sur son site, Iaboc. A priori, cet article sera bientôt repris par Liberté politique. Olivier Noël, dans la troisième partie d'une remarquable critique consacrée à Cosmos Incorporated de Maurice G. Dantec, évoque mon livre de la façon suivante : «Non, Cosmos Incorporated, après l’explosion-révélation, refuse d’enregistrer le réel; en fait, le Réel n’est pour Dantec que ce néant originel évoqué par Saint Augustin. Ambition aporétique s’il en est, d’un projet faustien désavoué in extremis : écrire le contre-roman du contre-monde, écrire l’impossibilité de décrire l’indicible, se défaire de son innocence pour retrouver l’innocence. Entendu au sens burroughsien de virus, le langage est ici plus contaminé qu’il ne contamine; il finit par tuer son hôte – Plotkine, et le roman lui-même. Le langage ne transcende plus, il est une substance-mort. En d’autres termes, au Trou Noir du Contre-Monde relativiste succède un autre Trou Noir, celui du livre, celui de la littérature de Dantec. Dans La Littérature à contre-nuit, le recueil de textes critiques de Juan Asensio, figure un passage intitulé «De la littérature considérée comme un trou noir» où il est opportunément rappelé que cette singularité fut aussi désigné par de Nerval comme l’œil de Dieu. «[N]ous mettons en rapport la négativité d’un espace aboli, celle d’un astre inversé ou retourné, et l’apparition, au sein d’une écriture romanesque, d’un vide qui la creusera jusqu’à son amuïssement final.» D’amuïssement, il ne saurait être question dans Cosmos Incorporated puisque la parole – contre-verbe – y est déjà vaincue. On saisit quel abîme sépare irrémédiablement le roman de Maurice G. Dantec et le chef-d’œuvre de Georges Bernanos, Monsieur Ouine, dont Juan Asensio, qui lui consacre les plus belles pages de son livre, écrit à juste titre qu’il est une révélation, ce que Cosmos Incorporated, à trop vouloir tutoyer les dieux, ne parvient jamais à être. Il semblerait toutefois que Dantec en soit douloureusement conscient, lui qui réduit Plotkine au silence – qui le rend à sa liberté – dans les dernières pages de son roman. Mais avant cette consomption finale, en dépit de son échec littéraire, Dantec et sa substance-mort auront au moins réussi, ce n’est pas rien, à nous communiquer l’essence de ce qui manque cruellement à sa fiction, et qui fit le succès et l’importance de 1984 : l’insurrection du Verbe au royaume du Novlangue.»
Je fais aujourd'hui le point, comme disent les pédants, sur la réception critique de mon dernier essai, La littérature à contre-nuit, publié il y a quelques mois par Matthieu Baumier pour les éditions A contrario. La liste qui suit n'obéit à aucune espèce de logique, donc de classement, pas même d'ordre temporel. Toutes ces critiques se complètent bien évidemment et, chaque fois qu'il m'a semblé nécessaire d'y répondre, je l'ai fait sans la moindre hésitation : depuis quand l'auteur d'un ouvrage, dont il connaît mieux que tout autre les faiblesses mais aussi le labeur qu'il lui a demandé, serait-il donc en droit d'abandonner son propre livre même si, je le dis sans aucune complaisance, j'ai été très favorablement impressionné par la qualité de tous ces textes qui, je le sais, ont coûté à leurs auteurs respectifs ? Du reste, la tactique de la terre brûlée n'est pas dans mes habitudes et je préfère de loin, comme face à la critique pour le moins elliptique et ironique d'un Cormary, rendre coup pour coup. Les imbéciles partiront d'un grand rire jaune mais je ne puis faire autrement que remercier ici toutes celles et ceux qui ont pris la peine de m'écrire, anonymes ou célèbres, quelques mots ou plusieurs pages sur ce livre difficile. Enfin, je rappelle que les lecteurs peuvent d'ores et déjà lire deux des chapitres de ce livre, l'un consacré à Ernesto Sabato, l'autre à Monsieur Ouine de Georges Bernanos. D'autres, sans doute, suivront... Voici donc, à ce jour, les auteurs des critiques rédigées sur mon ouvrage. Dominique Autié sur son excellent blog, Balles de match, Balles perdues suivi de ma réponse dans la Zone. Pierre Cormary (pseudonyme) pour le Journal de la culture (n°14) de Joseph Vebret, article repris sur son blog suivi de ma réponse, bien évidemment dans la Zone. Sarah Vajda, courriel. Je publierai, le jour de sa parution (le 5 janvier), une critique consacrée au premier roman (Insomnie édité par le Rocher) de Sarah Vajda. Ce livre est tout simplement absolument remarquable. Marc Alpozzo pour Boojum puis E-Torpedo. Renaud Camus, lettre. Axelle Felgine, sur le site Le-Mort-Qui-Trompe. Pol Vandromme pour Valeurs actuelles, n°3580, du 8 au 14 juillet 2005, article repris dans Le Bulletin célinien n°269, novembre 2005. Michel Crépu pour La Revue des deux mondes, numéro du mois de septembre 2005. Lucien Suel, dans une longue méditation intitulée Dans la gorge de l'ombre, publiée dans la Zone. Le Vif L'Express, week-end du 22 avril 2005, compte rendu signé par M.E.B. Alain Santacreu pour Contrelittérature, n°16, été 2005. Laurent Mabire sur son site, Iaboc. A priori, cet article sera bientôt repris par Liberté politique. Olivier Noël, dans la troisième partie d'une remarquable critique consacrée à Cosmos Incorporated de Maurice G. Dantec, évoque mon livre de la façon suivante : «Non, Cosmos Incorporated, après l’explosion-révélation, refuse d’enregistrer le réel; en fait, le Réel n’est pour Dantec que ce néant originel évoqué par Saint Augustin. Ambition aporétique s’il en est, d’un projet faustien désavoué in extremis : écrire le contre-roman du contre-monde, écrire l’impossibilité de décrire l’indicible, se défaire de son innocence pour retrouver l’innocence. Entendu au sens burroughsien de virus, le langage est ici plus contaminé qu’il ne contamine; il finit par tuer son hôte – Plotkine, et le roman lui-même. Le langage ne transcende plus, il est une substance-mort. En d’autres termes, au Trou Noir du Contre-Monde relativiste succède un autre Trou Noir, celui du livre, celui de la littérature de Dantec. Dans La Littérature à contre-nuit, le recueil de textes critiques de Juan Asensio, figure un passage intitulé «De la littérature considérée comme un trou noir» où il est opportunément rappelé que cette singularité fut aussi désigné par de Nerval comme l’œil de Dieu. «[N]ous mettons en rapport la négativité d’un espace aboli, celle d’un astre inversé ou retourné, et l’apparition, au sein d’une écriture romanesque, d’un vide qui la creusera jusqu’à son amuïssement final.» D’amuïssement, il ne saurait être question dans Cosmos Incorporated puisque la parole – contre-verbe – y est déjà vaincue. On saisit quel abîme sépare irrémédiablement le roman de Maurice G. Dantec et le chef-d’œuvre de Georges Bernanos, Monsieur Ouine, dont Juan Asensio, qui lui consacre les plus belles pages de son livre, écrit à juste titre qu’il est une révélation, ce que Cosmos Incorporated, à trop vouloir tutoyer les dieux, ne parvient jamais à être. Il semblerait toutefois que Dantec en soit douloureusement conscient, lui qui réduit Plotkine au silence – qui le rend à sa liberté – dans les dernières pages de son roman. Mais avant cette consomption finale, en dépit de son échec littéraire, Dantec et sa substance-mort auront au moins réussi, ce n’est pas rien, à nous communiquer l’essence de ce qui manque cruellement à sa fiction, et qui fit le succès et l’importance de 1984 : l’insurrection du Verbe au royaume du Novlangue.»
28/12/2005 | Lien permanent
2009 dans la Zone

À titre purement informatif, je précise que quatre de mes notes* ont été, il y a quelques semaines, supprimées par mon hébergeur, pour la raison qu'elles évoquaient Valérie Scigala et (de façon marginale) Jean-Yves Pranchère qui ont tous deux porté plainte contre moi.
Ces plaintes, pour trois motifs que je commenterai je l'espère lors de mon procès (dont la date n'a pas encore été fixée), m'ont valu de passer 12 (bien lire : douze) heures en garde à vue dans les locaux d'une brigade de gendarmerie fort réputée, spécialisée dans les affaires de cybercriminalité, l'une des meilleures, dit-on, de France.
Si cette garde à vue ne m'a pas poussé, comme l'a fait Frédéric Beigbeder, à me plonger dans mon passé pour en écrire un livre qui aurait ému les âmes les plus insensibles, elle m'a toutefois permis, entre autres vertus roboratives, d'accélérer considérablement mes connaissances en cette matière très intéressante qu'est le droit pénal, surtout lorsqu'il est appliqué à l'univers, stupidement et faussement réputé hors de portée des services policiers, d'Internet.
* Dont une datant de... 2007 (théoriquement, donc, à l'abri d'une suppression; nous dirons qu'il s'agit d'un excès de zèle, puisque la note, comme cela m'a été confirmé par la gendarmerie, n'était même pas visée par ladite plainte), note consacrée à la Société des Lecteurs de Renaud Camus.
Demeures de l'esprit de Renaud Camus, par Jean-Gérard Lapacherie.
Fahreinheit 451 de Ray Bradbury.
Antoine de Baecque et l'ontologie historiale du cinéma, par Francis Moury.
Cristina Campo, mystique absolue..., par Réginald Gaillard.
Les Impardonnables de Cristina Campo.
Eat shit ! Billions of flies can't be wrong !
Nostromo de Joseph Conrad.
La connerie de Philippe Sollers se porte bien.
Fayard, l'éditeur le plus radin de France.
La Tour de Gustaw Herling.
L'édition se porte mal mon bon monsieur.Notes pour une revue de jeunes, par Cristina Campo.
Alain Zannini de Marc-Édouard Nabe.
The Possibility of an Island by Michel Houellebecq.
L'ombre des forêts de Jean-Pierre Martinet.
Les deux Républiques françaises de Philippe Nemo, par Roman Bernard.
Hélas Nabe !
Ricardo Paseyro est mort.
L'âme de Léon Bloy.
Cormac McCarthy dans la Zone.
Georges Bernanos, encore.*
Poésie journalistique.
La vie et la mort du système de G. W. F. Hegel, par Francis Moury.
Dans l'intimité douloureuse de Paul Gadenne : La Rupture, Carnets, 1937-1940.
Gothique charpentier de William Gaddis.
Retour vers l’OTAN, affaire Chauprade : comment piller le cadavre national, par Samuel Gelb.
Ô mort, où est ta victoire ?
Toute la nuit devant nous de Marcus Malte, par Jean-Baptiste Morizot.
Florilège (horriblement) orienté, voire (visiblement) réactionnaire.
À quoi bon des poètes en un temps de détresse ?, par Élisabeth Bart.
La visite du Tribun de David Jones.
Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos.
Apologia pro Vita Kurtzii 2 : Blood Meridian by Cormac McCarthy.
Futurologie de la mémoire.
À quoi sert Josyane Savigneau ?
Berserker, 3 : Ismail Ax.*
Pourquoi ils ne m'ont pas mentionné ?
Un prêtre marié de Jules Barbey d’Aurevilly, par Germain Souchet.
Verticalité de la littérature, donc de la critique.
Au-delà de l'effondrement. L'Effondrement de Hans Erich Nossack.
D'une nouvelle position des vieux problèmes, par Francis Moury.
En lisant Leo Strauss : pourquoi écrire sous la persécution ?
Paradis noirs de Pierre Jourde, par Nunzio Casalaspro.
La blogosphère littéraire n'est hélas pas une rapière.
La masse manquante de la littérature.
Bernard Quiriny, moins vipère littéraire que ver de terre ?
L’abordage de la peinture, lettre à Marcel Moreau, par Nicolas Rozier.*
Sur les Carnets noirs de Gabriel Matzneff.
Maudit soit Andreas Werckmeister ! Un extrait.
Peut-on moraliser le capitalisme ? Brèves notes critiques sur les réponses de Nicolas Tenzer et André Comte-Sponville, par Francis Moury.
Au-delà de l'effondrement, 2 : L'Apocalypse russe de Jean-François Colosimo.
Prélude à la délivrance de Yannick Haenel et François Meyronnis.
L'île de Jersey, un paradis infernal.
Pour un modèle occidental de l'idée d'Occident, par Jean-Paul Rosaye.*
La malfrance, la vraie.
Roberto Bolaño à Bruges.
Le crétinisme, stade suprême du socialisme français ?, par Germain Souchet.*
Au-delà de l'effondrement, 3 : L'époque de la sécularisation d'Augusto Del Noce.
Le navire poursuit sa route de Nordahl Grieg.
Les plaisantins de la Toile : Wikipédia, BSC News.
Entretien avec Nils Aucante.
Entretien avec Ludovic Maubreuil.
Entretiens/Dialogues.
Conte de la barbarie ordinaire, par Sarah Vajda.*
Joseph Conrad dans la Zone.
Moi, Youssouf F., né le 13 février 2006, meurtrier.
Au-delà de l'effondrement, 4 : Les Anneaux de Saturne de W. G. Sebald.
Banalité chevillardienne.
L'Invitation chez les Stirl de Paul Gadenne.
L'état de la parole depuis Joseph de Maistre.
Témoins du futur de Pierre Bouretz.*
La Sorbonne présidée par un grotesque, Georges Molinié, par René Pommier.*
Le dernier travail de Platon, par Francis Moury.
Gabriel Matzneff est-il un maître de l'érotisme ? Ab-so-lu-ment-pas !
L'argent.
Que faire ?
Identification du démoniaque.*
Le canard Vaissié à l’assaut de L’Île. Défense de Pavel Lounguine, par Timothée Gérardin.
L'état de la parole depuis Joseph de Maistre, 2.
William H. Gass dans la Zone.
In memoriam Dominique Autié.
Au-delà de l'effondrement, 5 : Les ruines de Paris en 4908 d'Alfred Franklin.
L'état de la parole depuis Joseph de Maistre.
De l'anarchisme considéré comme déchéance de la raison : sur Julien Coupat, par Francis Moury.
Ludivine Cissé : mystère et confiture.
L'état de la parole depuis Joseph de Maistre, 4.
Paul Gadenne l'oublié, préface à un texte impubliable, et de fait impublié.*
580.
La Zone dans la Zone.
Au-delà de l'effondrement, 6 : Les aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe.
Paul Gadenne l'oublié.
Tant de morts de la littérature.
Avec Poe jusqu'au bout de la prose d'Henri Justin.
Paul Gadenne dans la Zone.
Le démon de la perversité : Youssouf Fofana et l'aveu.
Valérie Scigala déshonore-t-elle la blogosphère gersoise ?
14/01/2010 | Lien permanent | Commentaires (21)
François Bayrou ou les impasses de l’extrême centre, par Germain Souchet

Ségolène Royal, Chevalière de la mort.
Crétinisme et socialisme.
Jacques Chirac, gaulliste de foire.
Jacques Chirac en Bartleby.
Impossible, désormais, d’ignorer le «phénomène» François Bayrou. Cela fait plusieurs semaines que, dans les enquêtes d’opinion, il a franchi la barre des 10%. Depuis une bonne vingtaine de jours, il dépasse régulièrement les 15% d’intentions de vote et a atteint, de manière répétée, des scores compris entre 17 et 19% des voix au premier tour, les derniers sondages le plaçant même au-delà du chiffre symbolique des 20%.
D’aucuns persistent à n’y voir qu’un feu de paille et prédisent à François Bayrou la même dégringolade que celle de Jean-Pierre Chevènement en 2002. C’est oublier un peu vite que les mêmes commentaires sarcastiques avaient accompagné la montée en puissance de Ségolène Royal au printemps dernier, en vue des primaires socialistes. C’est ne pas se souvenir que Jean-Pierre Chevènement n’avait atteint le seuil des 14% d’intentions de vote que dans une poignée de sondages à la mi-janvier 2002, alors que nous sommes déjà mi-mars. C’est ignorer enfin que toutes les élections présidentielles, depuis 1965, nous ont réservé leur lot de surprises : du ballottage du général de Gaulle à la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour, en passant par la défaite cuisante de Jacques Chaban-Delmas au profit de Valéry Giscard d’Estaing, ou des victoires inattendues de Jacques Chirac sur Raymond Barre en 1988 et sur Édouard Balladur en 1995, aucune élection ne s’est déroulée selon les prédictions des observateurs politiques les plus aguerris.
Est-ce à dire que François Bayrou créera la surprise lors de l’élection présidentielle de 2007 ? Il paraît difficile de le voir passer devant Ségolène Royal pour retrouver Nicolas Sarkozy au second tour, même si, dans le passé, un affrontement entre la droite et le centre-droit a déjà eu lieu (entre Alain Poher et Georges Pompidou en 1969). Mais il s’agissait là d’une autre époque, la famille socialiste étant alors totalement décomposée, tandis que Ségolène Royal devrait cette fois bénéficier du vote utile suite au traumatisme qu’a connu la gauche en 2002.
Néanmoins, il est fort vraisemblable que François Bayrou obtienne un score à deux chiffres et qu’il s’établisse en troisième position, aux alentours de 15% des suffrages exprimés, devançant de peu Jean-Marie Le Pen. À cela, trois raisons : la première est que la base structurelle de l’UDF est d’au moins 10% de l’électorat. En effet, la droite et le centre ont, lors des précédentes élections, totalisé au premier tour entre 35 et 40% des voix. Si Nicolas Sarkozy récolte 28% des voix – ce qui serait un score très solide, en comparaison de ceux obtenus par Jacques Chirac en 2002 et en 1995 – il reste donc entre 10 et 12 points «disponibles» pour François Bayrou. À ce socle quasi-incompressible pourraient s’ajouter les voix du centre-gauche, déçu par la candidature Royal qu’ils espéraient plus sociale-démocrate que socialo-marxiste, et sur lequel le candidat de l’UDF a grignoté plusieurs points ces dernières semaines. Enfin, contrairement à 2002, tout semble indiquer cette fois que les électeurs disperseront beaucoup moins leurs suffrages, ce qui devrait profiter au quatuor Sarkozy – Royal – Bayrou – Le Pen (1). Or, même s’il ne faut jamais sous-estimer les ressources de ce dernier – ni l’exaspération profonde des Français –, son âge avancé et l’impasse du second tour de 2002 ne devraient pas jouer en sa faveur. Un espace politique existe donc pour François Bayrou qui a choisi la posture contestataire comme stratégie de campagne, mais qui reste plus fréquentable que le chef historique du Front National.
(Im)posture anti-système
La popularité nouvelle de François Bayrou s’est avant tout construite sur la dénonciation du rôle des médias, accusés de décider à la place des Français en annonçant des mois à l’avance, à grands renforts de sondages, un second tour entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. La percée médiatique du député béarnais a d’ailleurs eu lieu début 2007, suite à une interview mémorable conduite par Claire Chazal, au cours de laquelle il a réussi à déstabiliser la présentatrice vedette de TF1 en lui rappelant que tout le monde prédisait un affrontement droite – gauche en 2002… avec le résultat final que l’on sait.
Le discours fait mouche car il est en partie fondé. Il est vrai que pour l’élection présidentielle de 2002, les médias et les enquêtes d’opinion avaient systématiquement ignoré le premier tour, se concentrant sur le duel annoncé entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, respectivement président de la République et Premier ministre sortants. Et pourtant, ce que tout le monde avait prévu pendant cinq ans n’a finalement pas eu lieu, Jean-Marie Le Pen renvoyant chez lui le dirigeant socialiste dès le premier tour, et créant un «séisme» dans le microcosme parisien, qui redécouvrait soudain l’existence du peuple souverain (2). Le pari de François Bayrou est d’être en 2007 le trouble-fête que fut cinq ans plus tôt Jean-Marie Le Pen, d’où son insistance à rappeler que le peuple est libre et qu’il n’accepte pas qu’on désigne à sa place les deux «finalistes» de l’élection.
La posture d’exclu du concert médiatique adoptée par François Bayrou, d’ailleurs empruntée au dirigeant du Front National – qui en a fait, depuis vingt-cinq ans, sa marque de fabrique – relève néanmoins d’une grande hypocrisie. Car, depuis que les sondages le portent au pinacle, ses critiques se sont brutalement tues. Maintenant qu’il est entré dans le cercle très fermé de ceux que l’on invite dans toutes les émissions politiques, le ton se fait beaucoup moins mordant à l’encontre des journalistes. Ne serait-ce pas parce que ceux-ci, en lui ouvrant leurs portes, lui ont brutalement permis de nourrir des ambitions plus élevées ? La question mérite en tout cas d’être posée. De la même façon, personne n’a entendu François Bayrou se plaindre de l’existence de sondages évaluant les intentions de vote en cas de second tour l’opposant à Ségolène Royal ou à Nicolas Sarkozy. Est-ce parce que ces enquêtes lui donnent près de dix points d’avance dans les deux cas ? Doit-on en conclure que ce qui n’était pas acceptable pour les autres le devient pour M. Bayrou ?
Incidemment, le président de l’UDF a longtemps expliqué qu’il existait une collusion d’intérêts entre les médias, les grands groupes économiques et certains hommes politiques, citant par exemple l’amitié liant Nicolas Sarkozy à Arnaud Lagardère. Il est même allé jusqu’à proposer que les entreprises ayant des contrats avec l’État ne puissent plus, à l’avenir, détenir d’organes de presse, ce qui pourrait concerner, entre autres, le groupe Lagardère ou Bouygues. Or, si François Bayrou a raison de pointer l’existence d’intérêts communs entre des cercles de pouvoir différents – pouvoirs médiatique, économique ou politique – pouvant expliquer pourquoi la démocratie française a dérivé vers une forme d’oligarchie, sa critique repose néanmoins sur une variation habile, mais peu crédible, de la théorie du complot. Peut-on vraiment croire qu’il suffit à un ministre de décrocher son téléphone pour étouffer telle ou telle information ou, au contraire, pour mettre en avant un thème le favorisant ? En réalité, il semble plus raisonnable de penser que des liens complexes et des causalités multiples, qui mériteraient des développements plus approfondis, expliquent le faible taux de renouvellement de la classe politique et la confiscation du pouvoir par quelques dizaines d’individus sur de longues périodes. De fait, le discours du député béarnais sombre dans un populisme un peu facile, consistant à opposer le peuple aux classes dirigeantes, sans proposer de réelle solution pour combler ce fossé, ou, pour être plus précis, en suggérant une forme de gouvernement qui ne ferait que renforcer le poids des partis au détriment de la volonté populaire, comme je le montrerai ultérieurement.
Notons par ailleurs que «l’homme du terroir» François Bayrou, le candidat «authentique» refusant toute compromission avec le système, ne se vante pas de fréquenter quelques-unes des personnes les plus influentes du pouvoir médiatique. En effet, dans son édition du 16 février 2007, Le Parisien a révélé que le leader centriste «figur[ait] parmi les vingt-deux membres associés du comité France Galop», association gérant le hippisme français, et dans laquelle il est entré «parrainé par Jean-Luc Lagardère». Dans ce comité directeur, «il côtoie les plus grands patrons de presse, Arnaud Lagardère, propriétaire du groupe Hachette (Europe 1, Paris Match, Le Journal du dimanche) et le baron Édouard de Rotschild, propriétaire de Libération […]». On apprend également «qu’à la commission permanente de France Galop, François Bayrou peut [aussi] discuter avec Michel Denisot, président de la commission Image» et présentateur du Grand Journal sur Canal +. De plus en plus, la posture de rebelle adoptée par le président de l’UDF apparaît être une véritable imposture.
Mais les choses s’aggravent quand on revient sur un terrain strictement politique. En effet, celui qui veut faire triompher la volonté populaire contre les logiques d’appareil, et qui déclarait, dans un épanchement de lyrisme, que «c’est une chose très émouvante et très forte que de voir un peuple qui, tout d’un coup, a décidé de sortir des schémas habituels dans lesquels on l’enfermait depuis un quart de siècle» (3), a réussi, par je ne sais quel miracle, à faire oublier qu’il était un des plus fervents tenants du «oui» lors du référendum de mai 2005 sur la constitution européenne, qui s’est soldé, pour mémoire, par une victoire éclatante du «non» (55% des suffrages exprimés). Quand, sur un enjeu aussi majeur que la construction européenne, on n’a pas su voir le décalage qui existait entre les discours des hommes du sérail et la perception populaire de «l’Europe de Bruxelles», quand on a été incapable de voir venir un rejet aussi massif du modèle technocratique européen proposé par tous les partis politiques au pouvoir, justement, depuis plus de vingt-cinq ans, peut-on encore prétendre savoir, mieux que les autres, quelles sont les aspirations profondes du peuple français ?
Au-delà de la seule question européenne, qui, une fois de plus, ne sera que très peu abordée au cours de la campagne présidentielle, François Bayrou réussit également à tromper son monde en déclarant vouloir sortir de l’affrontement entre la droite et la gauche, source, selon lui, d’immobilisme, pour fonder un «grand parti démocrate» réunissant les talents des deux bords de l’échiquier politique. Pourtant, jusqu’au milieu de l’actuelle législature, l’UDF a toujours été un parti du centre-droit allié, pour le meilleur et pour le pire, à la droite représentée par le RPR puis par l’UMP. Entre 1978 et 2002, toutes les majorités de droite ont en réalité reposé sur une coalition réunissant l’UDF et le RPR; de même, ces deux partis ont partagé le statut d’opposant aux gouvernements de gauche successifs. François Bayrou a été élu député pour la première fois en 1986, à l’époque où Jacques Chirac semblait – encore – être le tenant d’une droite moderne et réformatrice. Entre 1993 et 1997, il a été ministre de l’Éducation nationale (et de l’enseignement supérieur à partir de 1995) des gouvernements Balladur et Juppé, que l’on peut difficilement qualifier de centristes. En 1995, il a même soutenu la candidature du RPR Édouard Balladur, plus libérale que celle de Jacques Chirac, dont le discours sur la «fracture sociale» et le thème de campagne «La France pour tous» lorgnaient clairement en direction du centre, voire du centre gauche de type radical-socialiste.
Après avoir été pendant vingt ans l’allié indéfectible de la droite, et alors même que tous les élus UDF – députés, conseillers régionaux ou généraux, maires – ne doivent leurs places qu’aux voix des électeurs de droite et du centre-droit, voilà que François Bayrou s’est joint en 2006 aux socialistes, aux communistes et aux Verts pour voter la censure du gouvernement Villepin (sur la base bien fragile de la sombre affaire Clearstream). En 2007, il va encore plus loin en osant prétendre que l’alternance entre la droite et la gauche est stérile et inutile, reposant sur des clivages dépassés. Et d’annoncer qu’il pourrait tout aussi bien nommer un Premier ministre de droite qu’un Premier ministre de gauche, comme par exemple Dominique Strauss-Kahn. Or, entre Édouard Balladur et Alain Juppé, d’un côté, et DSK de l’autre, il y a un gouffre qu’il paraît bien difficile de combler.
Il est tout de même troublant que la soudaine prise de conscience par M. Bayrou de la nécessaire émergence d’une «troisième voie» à la française intervienne au moment même où son parti est menacé de disparition par la création de l’UMP, grande famille politique du centre-droit et de la droite enfin unifiés. Alors que les principaux cadres de l’UDF – notamment Philippe Douste-Blazy et Jean-Louis Borloo – ont rejoint l’UMP dès 2002, il était de l’intérêt bien compris du président de l’UDF d’adopter un discours protestataire utopique, seul capable d’assurer sa survie en attirant à lui les déçus des deux bords dans un vote de défiance plus que d’adhésion. Il est ainsi permis de nourrir des doutes sur la franchise de M. Bayrou, dans la mesure où son nouveau positionnement politique aboutit à servir ses seuls intérêts, au mépris de tous ses engagements passés.
D’ailleurs, alors qu’il prône «l’ouverture» aux hommes de bonne volonté, d’où qu’ils viennent, le président de l’UDF dirige son parti de façon autocratique et attend de ses troupes qu’elles le suivent sans broncher. En témoigne la suspension d’André Santini, un des derniers ténors restés dans la famille centriste en 2002, coupable d’avoir rallié Nicolas Sarkozy et surtout d’avoir déclaré, le 10 février dernier, qu’il était «le seul candidat en mesure de l’emporter». Dès le 21 février, avec une rapidité de réaction exceptionnelle, la commission nationale d’arbitrage et de contrôle de l’UDF sanctionnait le charismatique député-maire d’Issy-les-Moulineaux et lui retirait la présidence de la fédération UDF des Hauts-de-Seine. L’argument de bon sens avancé par M. Santini, selon lequel «[il] ne ralli[ait] pas un parti mais un homme […] un projet» et qu’il «demeur[ait] libre dans un parti qui se dit libre» a donc été promptement écarté. Est-ce ainsi, à coup de sanctions et d’exclusions, que François Bayrou entend dépasser les clivages et réconcilier les Français entre eux et avec les hommes politiques ? La méthode ne paraît pas très nouvelle et le grand démocrate désintéressé ne semble en fait capable d’accepter qu’une liberté de parole : la sienne.
La grande tromperie des exemples étrangers
François Bayrou se plaît à citer les exemples de l’Allemagne, de l’Autriche ou encore de l’Italie pour montrer qu’une autre façon de gouverner – avec des grandes coalitions réunissant la droite et la gauche – est possible. Mais, outre que ces exemples n’ont en réalité que très peu de rapport entre eux, ils prouvent, chacun à leur façon, que le projet du président de l’UDF n’est qu’une dangereuse utopie.
Commençons par l’Autriche : depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, le pays a connu une majorité de gouvernements de grande coalition formés par le parti social-démocrate (SPÖ) et le parti conservateur (ÖVP) (4). On peut donc dire que les alliances entre la droite et la gauche sont très ancrées dans les mœurs politiques et, en tout état de cause, qu’elles ne constituent pas une nouveauté souhaitée par les Autrichiens pour faire face à des problèmes que l’un ou l’autre courant n’aurait pas été capable de résoudre seul (5). Or, à la fin des années 1990, ce brouillage des repères entre la droite et la gauche, combinée à une absence d’alternance de fait, ont ouvert un boulevard au FPÖ, le parti d’extrême droite de Jörg Haider. Fin 1999, le FPÖ a atteint le score historique de 27% des suffrages exprimés, devenant ainsi – bien provisoirement – le deuxième parti d’Autriche. L’ÖVP a alors pris la décision de former une coalition inédite avec le FPÖ, ce qui lui a permis de remporter très largement les élections de 2002 avec plus de 42% des voix – un score historique – et de faire imploser le parti d’extrême droite, désormais divisé entre une aile «réaliste» (le BZÖ), souhaitant devenir un parti de gouvernement respectable, et une aile radicale (le FPÖ «canal historique», si l’on peut dire). Si le chancelier conservateur Wolfgang Schüssel a, de manière surprenante, perdu les élections de 2006, et si une nouvelle grande coalition a finalement été formée, ce mode de gouvernement a cependant montré ses limites : en privant les citoyens de la possibilité d’une véritable alternance, il peut en effet conduire à une inquiétante montée des extrêmes. Une leçon à retenir.
Passons à l’Allemagne : M. Bayrou n’a de cesse de vanter les mérites de la «große Koalition» formée en octobre 2005 et dirigée par la chancelière Angela Merkel. Pourtant, peut-on vraiment le croire quand il nous affirme que les citoyens allemands, déçus par les alternances successives, ont «imposé» – terme qu’il a employé à plusieurs reprises – aux deux grands partis (le SPD social-démocrate et la CDU/CSU démocrate-chrétienne) de coopérer et de gouverner ensemble dans l’intérêt supérieur de la nation (6) ?
La réalité est tout autre : contrairement à l’Autriche, l’Allemagne n’avait jusqu’alors connu qu’un seul gouvernement de grande coalition, entre 1966 et 1969, brève intermède entre la très longue domination de la CDU/CSU et l’élection de Willy Brandt à la chancellerie. Cette première expérience n’avait pas laissé un souvenir impérissable aux Allemands, loin s’en faut. En 2005, c’est donc plutôt à une crise de la représentation et à une perte de confiance dans les partis que nous avons assisté : en effet, la coalition entre le
13/02/2007 | Lien permanent

























































