Rechercher : alain soral
Au régal des Vermines ou les poisons inoffensifs de Marc-Édouard Nabe

 Nabe, Nabe, Nabe… J’en ai plus qu’assez d’entendre ce écrivain prolifique se plaindre, le pauvre, de n’être point soutenu par les médias qui lui préfèrent, devinez qui, celui auquel la chance a souri bien sûr, ce maraudeur timide arpentant la rue de la Convention que Nabe lui-même habitait au numéro 103, je veux bien sûr parler de Michel Houellebecq, le romancier raté qui pourtant, selon l’auteur d’Alain Zannini, a tout réussi, y compris à vivre de sa plume alors que Nabe, lui, il nous le répète assez, ne vit point ou, c'est la même chose, vit misérablement. J’ai enfin terminé mon éprouvante lecture, longue de plusieurs semaines et bien des fois, de guerre lasse, abandonnée, du Régal des vermines, le premier livre de Nabe publié en 1985. Qu’en dire ? Certes, la préface, intitulée Le Vingt-septième Livre, est assez drôle, cruelle de mordacité même, ne serait-ce que par son évidente et truculente mauvaise foi mais le reste du livre, mon Dieu, le reste du livre ! Je ne vois dans toutes ces pages verbeuses qu’une sous-parodie des tics céliniens montée à la diable en une sauce indigeste où flottent péniblement quelques grumeaux d’un Lautréamont barbotant dans l’ordure de potache et surtout d’immondes trouvailles littéraires, le plus souvent d’une vulgarité sans borne, qui vrillent l’esprit l’espace d’une milliseconde et le fatiguent ensuite pendant des heures entières de bâillement réflexif. Les pages les plus intéressantes de ce bouquin indigeste, mal fichu et parfois mal écrit, je l’ai dit concernent le jazz, mais aussi les œuvres de Bloy, Céline et Rebatet. Et dans ce domaine même, que de sépulcrales facilités se permet l’auteur, un vrai gamin qui découvre son corps, s'assurant que nul ne le regarde (ce qui suffit à nous prouver que Nabe, au contraire, est un pervers), que son petit vit, correctement manipulé, lâchera (presque) à la demande un jus gluant. Quel extraordinaire mauvais goût dans telle image, que Nabe, de peur de la perdre, s’empresse d’engrosser (je suis sûr que ses lecteurs empressés ont eu sur la langue un autre terme ô combien plus nabique, dont la pauvre Béatrice se souvient encore) afin de la reproduire jusqu’à la nausée, non pas celle de la provocation mais de l’insignifiance ! Par exemple, sur Léon Bloy : «Il coupe les pages avec un crucifix. C’est le prodige comme exégèse. Bloy est très exactement semblable à un pianiste qui joue, pendant que Jésus-Christ lui tourne les pages.» D’accord, magnifique même si on y tient, comme l'annote sur la copie crasseuse le professeur, amusé et agacé, par les facilités de son bizarre élève, non pas le plus intelligent de la classe mais certainement le plus habile. Oui mais… Et alors ? En voici un autre de ces chromos criards, en voici une autre de ces tirades toutes impeccablement formatées pour être gravées sur le marbre friable de la sentence faussement paradoxale : «Si je ne crois pas en Dieu, c’est que je crois en Bloy.» Fort bien, encore une fois mais… est-ce bien tout ? La maxime idiote, bourgeonnant à l'infini, comme parangon de la littérature contemporaine ? Rien de plus mon petit Marc-Édouard, vraiment, s'amuse à objecter Angot qui n'est pourtant pas exactement une adversaire intimidante ? Il est vrai que, comme beaucoup d’autres, je n’ai pas attendu de lire le graphomane Nabe, pour découvrir le géant qui eût négligemment tambouriné la face maigre de son facétieux et auto-proclamé héritier si ce dernier s’était avisé de se jucher commodément sur ses épaules rugueuses. Seulement, de Bloy, Nabe n’a rien de plus que la facilité, une facilité, dans son cas, dédouanée de tout impératif transcendant que je pourrais résumer commodément par ma petite tirade personnelle : là où Bloy prétend servir, par son génie, Dieu seul, Nabe, lui, moins génial mais infiniment plus prétentieux, n'écrit que pour se lire. Il est vrai que d’un autre modèle littéraire voué aux gémonies par les prudents (que l'auteur a ainsi toutes les raisons de moquer), modèle louangé jusqu’à l’orgasme, je veux parler de Céline, le style de Nabe n’est parvenu qu’à reproduire les fameux points de suspension. Bel exploit stylistique sans doute mais pour ce qui est de la profondeur de la vision commune à ces deux maudits, pour ce qui est de l’évidence même du sérieux inhumain avec lequel Bloy et Céline ont assumé leur vocation, le pauvre Nabe, affligé des écrouelles de l’insulte la plus commune, quelque chose comme le rhume du potache, serait bien avisé d’aller laper un lait moins coruscant pour son fragile estomac de petit minet parisien. Je parlai de mauvaise foi : nouvel abîme que Nabe ne craint point de parcourir, armé de sa seule lampe de nain licencieux, lorsqu’il déclare par exemple que tout grand livre mérite la prison, au sens premier de cette expression. Cela donne : «La Littérature gagne à être emprisonnée. De De profundis aux Deux Étendards, c’est vérifiable… Ne vous leurrez pas : tout écrivain écrit pour être écroué.» Parfait. Je ne puis que donner entièrement raison à Nabe et, sans rappeler l’illustre exemple que constitue à mes yeux La persécution et l’art d’écrire de Leo Strauss, il est évident que le cliché de l’artiste maudit, payant de son sang la naissance de l’œuvre douloureuse, crevant à petit feu comme Sade au fond d’une geôle, devrait être utilement médité dans les temps actuels d’immonde confort, où le seul danger qui guette tel écrivain médiatique concerne plutôt que sa vie (que d’autres, beaucoup moins connus que Nabe, perdent et qui témoignent de la liberté de l’esprit face aux hordes fanatiques des barbus), la bonne santé de son sexe paraît-il toujours saillant, hampe dressée aux vents de l'imprécation pourtant menacée d’une vulgaire chaude pisse à force d’être sollicitée par des hordes vénériennes de lectrices amoureuses. Continuons pourtant de lire la tirade de l’auteur, puisque les quelques mots qui suivent notre précédent exemple nous rappellent heureusement sur terre, à vrai dire dans le douillet intérieur que Nabe n’a quitté qu’une seule fois depuis qu’il est né, et encore, pour se réfugier dans l’hôtel quatre étoiles de Bagdad ceinturé de plus de militaires que notre téméraire romancier n’en verra jamais au cours de toute une vie d'insouciante inactivité, pardon, d'activité littéraire intense. Le voici qui écrit, cet Alexandre de brocante : «La littérature est une telle magie noire qu’elle ne s’opère bien qu’en cellule, dans un cocon, surprise un petit matin, sans autre danger mortel que l’ablation d’un mot ou son rétablissement, ce qui, du reste, finit par se confondre.» Ce n’était donc que cela ? Mais oui. Sade devenant fou à force de privations carcérales parce qu’il a raté la chute de sa phrase. Wilde arpentant son minuscule cachot obscur durant des mois afin de glisser telle précieuse virgule à l’endroit de son texte prévu de toute éternité. Dostoïevski chahutant ses gardes pour que, ligoté au poteau d’exécution, l’inspiration lui vienne une dernière fois, dans un coup de rein prodigieux, avant de sombrer dans l’inconscience et peut-être même, allez savoir, la mort bien réelle.Nous voici donc rassurés quant aux risques réellement énormes que l’intrépide écrivain désire affronter, lui qui est prêt, comme le chevalier à la triste figure, à défier tous les moulins de l’édition qui ont pourtant contribué non seulement à moudre le grain amassé par notre rusée fourmi mais à lui offrir le four banal où notre maître es littérature a cuit ses plus racoleuses pâtisseries.Je ne puis résister au plaisir de citer l’un des derniers apophtegmes de ce père du dessert : «Il y a une tentation qui fait que Céline écrase tous les autres. Écrire, c’est jouer avec cette tentation.» Belle évidence serais-je tenté de dire, une de plus qui gagne à être répétée sans relâche. Quel dommage toutefois que Marc-Édouard Nabe, avant d’écrire ce premier livre suivi de beaucoup d’autres tout aussi inutiles et néanmoins publiés, n’ait pas jugé bon de fixer ce trop furtif éclair de lucidité bien capable de griller en une seconde ses plus fumeuses prétentions. N'est certes pas qui veut, comme Paul Léautaud (voire Joë Bousquet) en offrit l'incandescent et modeste exemple, un anachorète repoussant les putains splendides et, s'il fallait rapprocher Nabe d'un modèle paillardo-mystique, c'est au bouc en croix de Félicien Rops que je songerais immédiatement plutôt qu'au Saint-Antoine de Flaubert.
Nabe, Nabe, Nabe… J’en ai plus qu’assez d’entendre ce écrivain prolifique se plaindre, le pauvre, de n’être point soutenu par les médias qui lui préfèrent, devinez qui, celui auquel la chance a souri bien sûr, ce maraudeur timide arpentant la rue de la Convention que Nabe lui-même habitait au numéro 103, je veux bien sûr parler de Michel Houellebecq, le romancier raté qui pourtant, selon l’auteur d’Alain Zannini, a tout réussi, y compris à vivre de sa plume alors que Nabe, lui, il nous le répète assez, ne vit point ou, c'est la même chose, vit misérablement. J’ai enfin terminé mon éprouvante lecture, longue de plusieurs semaines et bien des fois, de guerre lasse, abandonnée, du Régal des vermines, le premier livre de Nabe publié en 1985. Qu’en dire ? Certes, la préface, intitulée Le Vingt-septième Livre, est assez drôle, cruelle de mordacité même, ne serait-ce que par son évidente et truculente mauvaise foi mais le reste du livre, mon Dieu, le reste du livre ! Je ne vois dans toutes ces pages verbeuses qu’une sous-parodie des tics céliniens montée à la diable en une sauce indigeste où flottent péniblement quelques grumeaux d’un Lautréamont barbotant dans l’ordure de potache et surtout d’immondes trouvailles littéraires, le plus souvent d’une vulgarité sans borne, qui vrillent l’esprit l’espace d’une milliseconde et le fatiguent ensuite pendant des heures entières de bâillement réflexif. Les pages les plus intéressantes de ce bouquin indigeste, mal fichu et parfois mal écrit, je l’ai dit concernent le jazz, mais aussi les œuvres de Bloy, Céline et Rebatet. Et dans ce domaine même, que de sépulcrales facilités se permet l’auteur, un vrai gamin qui découvre son corps, s'assurant que nul ne le regarde (ce qui suffit à nous prouver que Nabe, au contraire, est un pervers), que son petit vit, correctement manipulé, lâchera (presque) à la demande un jus gluant. Quel extraordinaire mauvais goût dans telle image, que Nabe, de peur de la perdre, s’empresse d’engrosser (je suis sûr que ses lecteurs empressés ont eu sur la langue un autre terme ô combien plus nabique, dont la pauvre Béatrice se souvient encore) afin de la reproduire jusqu’à la nausée, non pas celle de la provocation mais de l’insignifiance ! Par exemple, sur Léon Bloy : «Il coupe les pages avec un crucifix. C’est le prodige comme exégèse. Bloy est très exactement semblable à un pianiste qui joue, pendant que Jésus-Christ lui tourne les pages.» D’accord, magnifique même si on y tient, comme l'annote sur la copie crasseuse le professeur, amusé et agacé, par les facilités de son bizarre élève, non pas le plus intelligent de la classe mais certainement le plus habile. Oui mais… Et alors ? En voici un autre de ces chromos criards, en voici une autre de ces tirades toutes impeccablement formatées pour être gravées sur le marbre friable de la sentence faussement paradoxale : «Si je ne crois pas en Dieu, c’est que je crois en Bloy.» Fort bien, encore une fois mais… est-ce bien tout ? La maxime idiote, bourgeonnant à l'infini, comme parangon de la littérature contemporaine ? Rien de plus mon petit Marc-Édouard, vraiment, s'amuse à objecter Angot qui n'est pourtant pas exactement une adversaire intimidante ? Il est vrai que, comme beaucoup d’autres, je n’ai pas attendu de lire le graphomane Nabe, pour découvrir le géant qui eût négligemment tambouriné la face maigre de son facétieux et auto-proclamé héritier si ce dernier s’était avisé de se jucher commodément sur ses épaules rugueuses. Seulement, de Bloy, Nabe n’a rien de plus que la facilité, une facilité, dans son cas, dédouanée de tout impératif transcendant que je pourrais résumer commodément par ma petite tirade personnelle : là où Bloy prétend servir, par son génie, Dieu seul, Nabe, lui, moins génial mais infiniment plus prétentieux, n'écrit que pour se lire. Il est vrai que d’un autre modèle littéraire voué aux gémonies par les prudents (que l'auteur a ainsi toutes les raisons de moquer), modèle louangé jusqu’à l’orgasme, je veux parler de Céline, le style de Nabe n’est parvenu qu’à reproduire les fameux points de suspension. Bel exploit stylistique sans doute mais pour ce qui est de la profondeur de la vision commune à ces deux maudits, pour ce qui est de l’évidence même du sérieux inhumain avec lequel Bloy et Céline ont assumé leur vocation, le pauvre Nabe, affligé des écrouelles de l’insulte la plus commune, quelque chose comme le rhume du potache, serait bien avisé d’aller laper un lait moins coruscant pour son fragile estomac de petit minet parisien. Je parlai de mauvaise foi : nouvel abîme que Nabe ne craint point de parcourir, armé de sa seule lampe de nain licencieux, lorsqu’il déclare par exemple que tout grand livre mérite la prison, au sens premier de cette expression. Cela donne : «La Littérature gagne à être emprisonnée. De De profundis aux Deux Étendards, c’est vérifiable… Ne vous leurrez pas : tout écrivain écrit pour être écroué.» Parfait. Je ne puis que donner entièrement raison à Nabe et, sans rappeler l’illustre exemple que constitue à mes yeux La persécution et l’art d’écrire de Leo Strauss, il est évident que le cliché de l’artiste maudit, payant de son sang la naissance de l’œuvre douloureuse, crevant à petit feu comme Sade au fond d’une geôle, devrait être utilement médité dans les temps actuels d’immonde confort, où le seul danger qui guette tel écrivain médiatique concerne plutôt que sa vie (que d’autres, beaucoup moins connus que Nabe, perdent et qui témoignent de la liberté de l’esprit face aux hordes fanatiques des barbus), la bonne santé de son sexe paraît-il toujours saillant, hampe dressée aux vents de l'imprécation pourtant menacée d’une vulgaire chaude pisse à force d’être sollicitée par des hordes vénériennes de lectrices amoureuses. Continuons pourtant de lire la tirade de l’auteur, puisque les quelques mots qui suivent notre précédent exemple nous rappellent heureusement sur terre, à vrai dire dans le douillet intérieur que Nabe n’a quitté qu’une seule fois depuis qu’il est né, et encore, pour se réfugier dans l’hôtel quatre étoiles de Bagdad ceinturé de plus de militaires que notre téméraire romancier n’en verra jamais au cours de toute une vie d'insouciante inactivité, pardon, d'activité littéraire intense. Le voici qui écrit, cet Alexandre de brocante : «La littérature est une telle magie noire qu’elle ne s’opère bien qu’en cellule, dans un cocon, surprise un petit matin, sans autre danger mortel que l’ablation d’un mot ou son rétablissement, ce qui, du reste, finit par se confondre.» Ce n’était donc que cela ? Mais oui. Sade devenant fou à force de privations carcérales parce qu’il a raté la chute de sa phrase. Wilde arpentant son minuscule cachot obscur durant des mois afin de glisser telle précieuse virgule à l’endroit de son texte prévu de toute éternité. Dostoïevski chahutant ses gardes pour que, ligoté au poteau d’exécution, l’inspiration lui vienne une dernière fois, dans un coup de rein prodigieux, avant de sombrer dans l’inconscience et peut-être même, allez savoir, la mort bien réelle.Nous voici donc rassurés quant aux risques réellement énormes que l’intrépide écrivain désire affronter, lui qui est prêt, comme le chevalier à la triste figure, à défier tous les moulins de l’édition qui ont pourtant contribué non seulement à moudre le grain amassé par notre rusée fourmi mais à lui offrir le four banal où notre maître es littérature a cuit ses plus racoleuses pâtisseries.Je ne puis résister au plaisir de citer l’un des derniers apophtegmes de ce père du dessert : «Il y a une tentation qui fait que Céline écrase tous les autres. Écrire, c’est jouer avec cette tentation.» Belle évidence serais-je tenté de dire, une de plus qui gagne à être répétée sans relâche. Quel dommage toutefois que Marc-Édouard Nabe, avant d’écrire ce premier livre suivi de beaucoup d’autres tout aussi inutiles et néanmoins publiés, n’ait pas jugé bon de fixer ce trop furtif éclair de lucidité bien capable de griller en une seconde ses plus fumeuses prétentions. N'est certes pas qui veut, comme Paul Léautaud (voire Joë Bousquet) en offrit l'incandescent et modeste exemple, un anachorète repoussant les putains splendides et, s'il fallait rapprocher Nabe d'un modèle paillardo-mystique, c'est au bouc en croix de Félicien Rops que je songerais immédiatement plutôt qu'au Saint-Antoine de Flaubert.
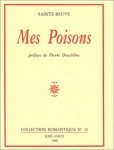 Fatigué de ne point en finir avec Nabe, j'étais prêt à lire absolument n'importe quel livre qui ne fût pas de lui, y compris à me plonger dans la flache certes peu profonde d'un de ces romans érotico-prétentieux lus par les mères de famille approchant la périlleuse quarantaine, l'âge où ces vaillantes redeviennent de consternantes gamines dès que les effleure la première ride d'ennui bourgeois. Heureusement, l'acrimonieux Sainte-Beuve dont un volume s'était égaré dans l'enfer rose de ma bibliothèque (celui des mauvais livres), m'a sauvé du dangereux péril de l'auto-célébration amoureusement dédiée à elle-même dans laquelle se complaît telle écrivainE (je suis un homme n'hésitant jamais à célébrer l'excellence féminine, qu'on se le dise) uniquement préoccupée de la bonne tenue de son cul artistique, et cela quel que soit le copieux verbiage censé enrober la douce praline que s'arracheront les libraires les plus inflexibles. Passons. Il existe un seul et unique point commun j’en suis certain (il ne peut donc s’agir de leur méchanceté légendaire) entre Sainte-Beuve et Nabe. Tous deux ont vécu dans la même rue que celle où résidait celui qui représentait à leur yeux le modèle même du grand écrivain et (surtout dans le cas de Nabe l’envieux), de l’écrivain ayant réussi. En effet, l’éminent critique, dont je viens de lire les peu acides textes composant Mes Poisons (José Corti, 1988; une réédition en poche sera bientôt disponible dans la collection La petite Vermillon), a vécu au 94 rue de Vaugirard alors même que Victor Hugo logeait au 90. Ensuite, Sainte-Beuve a eu la surprise de constater que, alors qu’il avait déménagé pour s’installer au 19, rue Notre-Dame-des-Champs, le poète des Contemplations résidait au… 11. Je ne reviens pas sur la proximité géographique qui a suggéré à Nabe un étonnant et bien tardif texte de louche admiration criée à l’endroit du voisin de pallier Michel Houellebecq. De même, j’avoue relire avec beaucoup de plaisir, ces derniers mois, les ouvrages jaunis de ces critiques du prodigieux et imbécile XIXe siècle comme Thibaudet, Brunetière, Renan ou Benda, eux-mêmes bien ignorés voire méprisés, on se demande pourquoi, par nos tonitruants journalistes littéraires à la mémoire courte, à la culture presque nulle. J’ai noté dans le livre de Sainte-Beuve cette pensée de laquelle Julien Gracq a dû se souvenir lorsqu’il a magistralement évoqué les mœurs de la critique dans sa Littérature à l’estomac : «La vraie critique à Paris se fait en causant : c’est en allant au scrutin de toutes les opinions que le critique composerait son résultat le plus complet et le plus juste.» J’ai encore goûté cette ironique appréciation à l’endroit de sa propre activité : «Un souverain, qui vient de monter sur le trône, et surtout de l’usurper, n’est pas plus jaloux de refondre toute la monnaie de ses prédécesseurs et de refrapper chaque pièce en circulation à son effigie, que les critiques nouveau-venus ne se montrent en général actifs à casser et à refrapper à neuf tous les jugements littéraires de leurs devanciers. Leurs successeurs leur rendront la pareille. Chacun, à son tour, se pique de régner.»Nous verrons bientôt, évoquant les essais d'Olivier Larizza et de William Marx, si ce règne tant décrié du critique littéraire traditionnel (disons, sans craindre la caricature répandue en masse dans nos universités : pieusement imbibé de structuralisme, enduit d'une couche plus ou moins fine de psychocritique et soucieux de saine déconstruction, autant dire, en un mot heureux, bien-pensant comme l'est tout imbécile) est près de s'achever.Permettez-moi d'en douter.
Fatigué de ne point en finir avec Nabe, j'étais prêt à lire absolument n'importe quel livre qui ne fût pas de lui, y compris à me plonger dans la flache certes peu profonde d'un de ces romans érotico-prétentieux lus par les mères de famille approchant la périlleuse quarantaine, l'âge où ces vaillantes redeviennent de consternantes gamines dès que les effleure la première ride d'ennui bourgeois. Heureusement, l'acrimonieux Sainte-Beuve dont un volume s'était égaré dans l'enfer rose de ma bibliothèque (celui des mauvais livres), m'a sauvé du dangereux péril de l'auto-célébration amoureusement dédiée à elle-même dans laquelle se complaît telle écrivainE (je suis un homme n'hésitant jamais à célébrer l'excellence féminine, qu'on se le dise) uniquement préoccupée de la bonne tenue de son cul artistique, et cela quel que soit le copieux verbiage censé enrober la douce praline que s'arracheront les libraires les plus inflexibles. Passons. Il existe un seul et unique point commun j’en suis certain (il ne peut donc s’agir de leur méchanceté légendaire) entre Sainte-Beuve et Nabe. Tous deux ont vécu dans la même rue que celle où résidait celui qui représentait à leur yeux le modèle même du grand écrivain et (surtout dans le cas de Nabe l’envieux), de l’écrivain ayant réussi. En effet, l’éminent critique, dont je viens de lire les peu acides textes composant Mes Poisons (José Corti, 1988; une réédition en poche sera bientôt disponible dans la collection La petite Vermillon), a vécu au 94 rue de Vaugirard alors même que Victor Hugo logeait au 90. Ensuite, Sainte-Beuve a eu la surprise de constater que, alors qu’il avait déménagé pour s’installer au 19, rue Notre-Dame-des-Champs, le poète des Contemplations résidait au… 11. Je ne reviens pas sur la proximité géographique qui a suggéré à Nabe un étonnant et bien tardif texte de louche admiration criée à l’endroit du voisin de pallier Michel Houellebecq. De même, j’avoue relire avec beaucoup de plaisir, ces derniers mois, les ouvrages jaunis de ces critiques du prodigieux et imbécile XIXe siècle comme Thibaudet, Brunetière, Renan ou Benda, eux-mêmes bien ignorés voire méprisés, on se demande pourquoi, par nos tonitruants journalistes littéraires à la mémoire courte, à la culture presque nulle. J’ai noté dans le livre de Sainte-Beuve cette pensée de laquelle Julien Gracq a dû se souvenir lorsqu’il a magistralement évoqué les mœurs de la critique dans sa Littérature à l’estomac : «La vraie critique à Paris se fait en causant : c’est en allant au scrutin de toutes les opinions que le critique composerait son résultat le plus complet et le plus juste.» J’ai encore goûté cette ironique appréciation à l’endroit de sa propre activité : «Un souverain, qui vient de monter sur le trône, et surtout de l’usurper, n’est pas plus jaloux de refondre toute la monnaie de ses prédécesseurs et de refrapper chaque pièce en circulation à son effigie, que les critiques nouveau-venus ne se montrent en général actifs à casser et à refrapper à neuf tous les jugements littéraires de leurs devanciers. Leurs successeurs leur rendront la pareille. Chacun, à son tour, se pique de régner.»Nous verrons bientôt, évoquant les essais d'Olivier Larizza et de William Marx, si ce règne tant décrié du critique littéraire traditionnel (disons, sans craindre la caricature répandue en masse dans nos universités : pieusement imbibé de structuralisme, enduit d'une couche plus ou moins fine de psychocritique et soucieux de saine déconstruction, autant dire, en un mot heureux, bien-pensant comme l'est tout imbécile) est près de s'achever.Permettez-moi d'en douter.
08/03/2006 | Lien permanent
Dreuse de Louis Jeanne

 À propos de Louis Jeanne, Dreuse (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2012).
À propos de Louis Jeanne, Dreuse (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2012).Qu'est-ce donc que Dreuse, le premier roman de Louis Jeanne ?
À cette question, Michel Marmin répond, dans un entretien avec Rémi Soulié (paru dans le numéro 144 de la revue Éléments), en affirmant qu'il s'agit d'un «admirable premier roman» «où, par delà les décombres de la cité et la déchéance de ceux qui la peuplent, le réenchantement de la langue est consubstantiel au retour du mythe».
Cette langue ainsi réenchantée, il est vrai que la quatrième de couverture dudit roman nous la présente comme étant faulknérienne puisqu'il suffit sans doute, dans l'esprit de celui qui l'a rédigée, de dépasser l'empan d'une phrase composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément, pour mériter ce qualificatif glorieux et intimidant.
Je serai beaucoup moins élogieux que Michel Marmin (avec quelques autres, tout pressés de saluer un livre meilleur que bien d'autres qui ont paru durant cette rentrée dite littéraire, pas nécessairement bon pour autant) qui, sans doute, a oublié de vraiment lire ce premier roman pour ce qu'il est, non pas un roman après tout plaisant à lire, dont certaines pages sont belles qui le nierait, et même intéressant mais la mort de tout roman, c'est-à-dire : une œuvre à thèse.
Celle de Louis Jeanne est simple, précise, nette, aussi simple et précise que ses phrases sont longues et, souvent, peu nettes, en tous les cas jamais vraiment faulknériennes, en cette qualité qui paraît les avoir rendues primitives, instinctives, toutes préoccupées d'avancer et de dire et non d'expliquer ou plutôt, d'expliciter, d'illustrer : la France (un certain art de vivre, une certaine façon de se tenir dans et par la langue, une certaine façon de bien vivre, cuisiner, parler, se vêtir, prendre sa douche, faire l'amour, se moucher, etc.) n'existe plus ailleurs que dans tel coin reculé de sa campagne la moins exposée aux ravages d'une époque honnie.
Il se pourrait, à dire vrai, qu'une autre thèse, plus discrète, moins directement appuyée, infuse les pages du texte de Louis Jeanne : Hadrien Dreuse seul maintient la pureté de la langue, qui parle peu et, surtout, qui publie des textes qui jamais ne paraîtront. Nous savons l'époque obsédée par la figure mystérieuse de Bartleby le scribe, plus pathétique et digne de commisération, par exemple lorsqu'elle est exposée en des centaines de lettres déchirantes, par un Vincent La Soudière, que sujette à un culte qui pourrait s'apparenter à celui de l'impuissance.
Lisant ce roman, j'ai songé à plusieurs images susceptibles de le décrire : tout d'abord, s'impose, avec Dreuse, le personnage principal, quelque lointain descendant du Durtal de Huysmans, l'inquiétude métaphysique en moins, la curiosité insatiable aussi, un Durtal qui se serait égaré, plutôt que dans le logis bienfaisant du sonneur de cloches Carhaix de Là-bas, dans la maison d'En rade, au milieu de paysans qui, contrairement à la vision cauchemardesque développée par Huysmans, représenteraient le dernier reste d'humanité digne d'éloge.
D'autres influences, beaucoup moins littéraires, peuvent être suggérées, puisque de nombreuses pages contre la laideur des banlieues (cf. p. 153), la mode immonde des graffitis (cf. p. 155), celle des baladeurs et des téléphones portables, l'atrocité infernale que constitue un déplacement en métro dans une grande ville (Paris, bien sûr), la faillite de l'enseignement tel qu'il est dispensé dans des établissements qui ne méritent plus le nom d'école, etc., ne peuvent que nous faire songer à un Richard Millet éructant contre la décadence de sa chère patrie, blanche et chrétienne, ou à un Renaud Camus pestant, en laborieuses circonlocutions bien incapables de nous cacher la trouille et la haine qui constituent les tripes transparentes de ce tout petit monsieur, contre ce qu'il nomme le Grand Remplacement ou encore enfin, et c'est peut-être la référence la plus littéraire de notre sainte trinité de gardiens de la pureté française, à Alain Finkielkraut analysant la déconfiture morale, intellectuelle et même spirituelle de notre cher pays, naguère phare de l'humanité, devenu à présent son cloaque.
C'est beaucoup mais, hélas, très peu, d'un point de vue strictement littéraire, pour un premier roman, et un premier roman, je le disais, qui n'en est pas vraiment un puisque la moindre de ses phrases (il s'agit là d'un euphémisme, les phrases de Jeanne s'étendant souvent sur des pages entières; son faulknérisme, je suppose...) nous martèle l'antienne convenue que tout est fichu mon bon monsieur : «[ces récits venus tout droit du XIXe siècle] et dans lesquels ils étaient plusieurs, pauvres bougres, à se mirer la nostalgie, non pas regrettant une époque qui n'était pas non plus radieuse, mais regrettant celle dans laquelle ils étaient plongés comme des survivants, ce qui leur faisait presque dire que la justice sociale n'avait été qu'un attrape-nigaud avec lequel on avait brisé les foules pour mieux les supplicier, invoquant la crise pour rendre tolérables des privations qui ne l'étaient pas, tolérables, aimant ce temps parce que se sentant ficelés dans le leur, prêts, sans l'ombre d'un doute, à être définitivement sacrifiés comme des mémoires trouées, bientôt jetés aux oubliettes de l'Histoire et irrémédiablement, sans que l'époque, la leur, en eût aucun remords, charriés qu'ils seraient bientôt, avait fini par lâcher encore Le Bret, comme des alluvions insignifiantes, tous mués bientôt, sitôt sous terre, en déchets organiques et informes de l'Histoire» (1).
De fait, si certaines pages sont assez belles, surtout celles où Louis Jeanne oublie de stigmatiser les transports en commun (cf. pp. 159-60) et l'incurie de l'École (cf. pp. 169 ou 256) pour s'élever à la déploration du temps passé et perdu (2), si certaines pages, comme celles qui décrivent la rencontre entre Dreuse et son éditrice qu'il aimera durant une seule nuit ou bien celles qui décrivent la stature réelle de Dreuse (3), écrivain dont les textes ont été refusés par cette éditrice qu'il aimera (4), bref, si certaines pages sont belles lorsque Louis Jeanne se contente d'écrire, ce qu'il sait à l'évidence faire, force est de constater que la grande majorité d'entre elles est poussive, ridicule, involontairement comiques, comme d'un Proust ou d'un Claude Simon décrivant en de longues périodes un battement de cil amibien (5), comme celles qui commencent à la page 87 et qui évoquent un Des Esseintes (toujours Dreuse) qui serait à l'aise dans la bucolique maison champêtre de Kerpantric où il ferait son miel du temps qui passe méticuleusement, comme les toutes dernières, d'un grotesque fini (6) et qui signent, à mon sens, la facile capitulation devant la modernité, par le recours au mythe et amalgament, à la mode bretonne si reconnaissable depuis Tristan et Yseult, Barbey et Gracq, comme celles (pp. 105-6) encore qui nous peignent par le menu, c'est le cas de le dire, la recette d'un délicieux lapin bien évidemment préparé à l'ancienne, cette expression nous paraissant constituer le sésame ouvre-toi de la pensée et de l'écriture de Louis Jeanne, telles que celles évoquant les ablutions matinales du personnage principal (cf. pp. 138-9) et, je l'ai dit, toutes celles enfin qui n'en finissent pas de pester contre les laideurs et les promiscuités de la vie moderne, comme si Renaud Camus, enfin, avait acquis un certain souffle littéraire en décollant son nez de son nombril et nous livrait le roman faulknérien du Gers, dernier refuge de la culture et de l'humanisme (voire de l'humanité), face aux hordes déchaînées de la Laideur et de la Nocence universelles.
Notes
(1) Louis Jeanne, Dreuse (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2012), pp. 38-9.
(2) «Repoussant le journal, il avait soudain ressenti la rouillure du monde, l'égarement de l'époque, et celle-ci, l'époque, reconduite en lui depuis de nombreuses années avec cette fissure s'accroissant, et ressentant cela bien que n'étant pas, à proprement parler, un passéiste ou un nostalgique invétéré, juste un homme flottant sur des mémoires trouées, cet homme-là, le maire, n'ayant pu comprendre cela qui l'occupait, ce frêle équilibre de la superposition de deux paysages, de deux temps se supportant, quand l'image qui vous a porté et poussé à être ce que vous êtes en grande part s'incline déjà dans les traits mêlés de l'autre, la plus contemporaine, chaque ligne s'évaporant peu à peu, déjà s'effaçant, comme dans les fondus enchaînés du cinéma, cette mort programmée depuis trop longtemps n'ayant rien à voir avec le regret d'une période bénie et disparue, vraiment, côtoyant juste l'effroi de la perdition radicale, en passe de devenir, lui, une victime collatérale d'une histoire sans fond, sans déterminant historique fort, sans événement fondateur, et lui, bien que demeuré en dehors de la vanité, touchant pour prix de cette humilité, construite sur l'évidence du temps, le nom d'une mémoire bientôt épuisée» (pp. 79-80).
(3) «[...] seul le tenant encore son salut particulier, ce qui ne le faisait pas déchoir à ses yeux, sa façon de vivre étant devenue à elle seule une manière de langue morte, un détour prolongé dans la mémoire, dans une lisière persistante, échappant à la grande nuit totale et lumineuse du spectacle» (p. 233).
(4) Pour Dreuse, le texte est «devenu absent parce que plus nécessaire à dire ce qu'il vivait, son retrait, ses émotions, la langue uniquement vouée à la lecture, l'écriture enserrée en lui comme un mystère inavouable, comme on conserve en soi, profondément, la mémoire d'un paysage que l'on sait ne plus devoir traverser» (p. 218).
(5) À force de trop en faire, la structuration implicite de notre langue a vite fait de reprendre le dessus sur le lyrisme, témoin cette drôle de phrase, point incorrecte d'un point de vue grammatical mais assez laide et tortue, marquant un pénible bégaiement : «[...] il ne regrettait pas Kerpantric, devenue terre d'adoption dans laquelle s'était mêlée son autre terre, celle de ses origines, qui le verrait, dans quelques jours, faire halte du côté de ces tombes qui étaient aussi sa vie, la mort étant le second cœur de son existence, cette part de mémoire assimilée qui faisait de lui cet homme terriblement présent au monde, contrairement à ce que sa vie aurait pu laisser croire, les basses évidences étant devenues la fosse commune des idées reçues et qui, avec la bien-pensance, cette morale des bons sentiments fluctuants, étaient devenues les deux cancers les plus purulents de ce bas-monde, devenu bas par manque de clarté et excès d'artifices et de gesticulations» (pp. 163-4).
(6) Dreuse se laisse mourir de froid après avoir fait l'amour à une femme mystérieuse qui aura écrit (et publié, à titre posthume, puisqu'elle se laisse mourir avec son amant) un texte salué par la critique et que par son propre métier (celui de lecteur), Dreuse aura qualifié de remarquable dans une note adressée à son éditrice, celle-là même qui a refusé tous les textes que lui a envoyés Dreuse et avec lequel elle aura pourtant couché, qu'elle finira même par aimer follement et à qui, mais un peu tard, elle reconnaîtra la qualité d'écrivain, vous me suivez ? À ce propos, Claire Vajou Le Tallec (pour le n°27, remarquable au demeurant, de la revue Nunc, juin 2012, p. 157), affirme qu'il n'y a «Rien de passéiste pourtant chez Louis Jeanne, qui possède l’oreille absolue et des moyens littéraires extrêmement sophistiqués, mais qui n’en fait pas une manière, une virtuosité d’apparat». Si un tel livre n'est point passéiste, je me demande bien quel texte, dans ce cas, pourrait être taxé de passéiste aux yeux de Claire Vajou Le Tallec qui me semble également n'avoir point insisté sur cette dimension d'apparat, la prose de Louis Jeanne n'étant, pour l'heure, qu'un moyen d'enrober ses idées.
20/09/2012 | Lien permanent
Dracula, 8 : Dracula prince des ténèbres de Terence Fisher, par Francis Moury

 CritiqueDracula Prince of Darkness [Dracula prince des ténèbres] (Grande-Bretagne, 1965) de Terence Fisher se veut la suite de son Dracula / Horror of Dracula [Le cauchemar de Dracula] (Grande-Bretagne, 1958), les deux films n’entretenant qu’un lien ténu en dépit de son titre avec son The Brides of Dracula [Les maîtresses de Dracula] (Grande-Bretagne, 1960). De facto ils constituent la trilogie fishérienne sur le thème du vampirisme mais sur le plan strictement thématique, il faudrait plutôt parler d’un diptyque stokérien entrecoupé par une variation para-stokérienne. Les premières images du film de 1965 sont celles de la dernière séquence du film de 1958 représentées d’une manière assez belle et originale, en guise d’introduction et de résumé à ce qu’on doit savoir si on veut comprendre ce qui va se passer ici et maintenant. Christopher Lee reprend le rôle pour la seconde fois de sa carrière. Le scénariste John Elder (de son véritable nom Anthony Hammer, alias Anthony Hinds et quelques autres pseudonymes encore) introduit l’idée d’un rite inconnu mais sanglant permettant de faire revivre le vampire. Il la reprendra quelques années plus tard en l’étendant aux dimensions d’une messe noire, plus spectaculaire encore, dans le scénario du Taste the Blood of Dracula [Une messe pour Dracula] (Grande-Bretagne, 1969) de Peter Sasdy. Elder réintroduit un personnage-clef du roman original de Stoker qui manquait en 1958 : Renfield, sous le nom de Ludwig. Et Elder invente un terrifiant domestique Klove, totalement absent du roman. Elder donne surtout à Fisher l’occasion d’approfondir sa syntaxe et sa thématique.Les 47 premières minutes du film sont constituées par une action qui dure un après-midi puis toute la nuit suivante : le restant se déroule sur plusieurs jours et nuits. Le rythme du récit est donc inhabituel et novateur. Tout comme dans Horror of Dracula, et bien que le mot anglais Horror soit absent du titre, il s’agit d’une structure cauchemardesque où les événements fantastiques ne s’immiscent que progressivement dans la réalité puis la déchirent et l’entraînent alors à un rythme effréné vers le dénouement. Barbara Shelley incarne à merveille la conscience opérant ce travail de reconnaissance. Le spectateur s’identifie naturellement à elle d’abord résistante puis investie progressivement par l’angoisse, la peur puis la terreur : elle définit elle-même ce qu’elle vit comme étant un cauchemar qui finit par la posséder en révélant son double démoniaque. C’est le plus beau rôle de Barbara Shelley, le plus achevé et le plus puissant de sa carrière. La nuit au château est l’occasion pour Fisher de mettre au point certains de ses plus complexes et beaux mouvements de caméra jamais filmés. Confinant parfois à une abstraction formelle, ils sont absolument nécessaires à la progression du piège construit sous nos yeux. La violence graphique monte pour sa part d’un cran par rapport aux deux films de 1958 et de 1960 : égorgements, brûlures, démentielle purification de la femme-vampire en une scène d’inquisition dont l’effet est encore aujourd’hui, en raison de son rythme, de sa composition picturale et de la musique paroxystique composée par James Bernard, presque insoutenable. La structure sophistiquée du script consiste en une succession de reconfigurations d’éléments amicaux ou inamicaux, de confirmations ou d’infirmations d’identité, de confirmations ou d’infirmations de pensées exactes ou fausses sur une situation continuellement mouvante et tendue. Fisher use d’un symbolisme à résonance psychanalytique : Éros et Thanatos se combattent de manière efficace, réelle, active. La manière dont les éléments antagonistes, ressortant de chacune des deux instances, sont disséminés par l’intrigue, sa construction, ses dialogues même, est élaborée jusqu’au degré le plus raffiné. Le film manifeste une sorte de positivisme symboliste rigoureusement maîtrisé, à la plastique mi-baroque mi-classique. Le château de Dracula ne figure sur aucune carte : ce point évoque éventuellement une autre filiation que le roman de Stoker, celle des vieux récits yidich [sic] (2) d’Europe centrale.Une belle idée enfin que Gaston Bachelard aurait, sans doute, appréciée en raison de sa poésie élémentaire : la mort originale de Dracula que le scénario écrit par le même Elder deux ans plus tard pour Dracula Has Risen From the Grave [Dracula et les femmes] (Grande-Bretagne, 1968) de Freddie Francis, trouvera encore le moyen de surmonter. On peut dès lors dire que la série Hammer film des Dracula stokériens, donc tous ceux interprétés par Christopher Lee, s’apparente véritablement à un cycle de morts et de renaissances, structurellement semblable à l’éternel retour primitif qui fascinait tant Schopenhauer et Nietzsche lorsqu’ils étudiaient en Occidentaux métaphysiquement inquiets les religions de l’Asie.Note additionnelle sur la réception critique du film en FranceC’est l’un des films de Fisher les plus méconnus et les plus malmenés par la critique française au moment de sa sortie parisienne en décembre 1966, et même encore par la suite. On peut parler d’une totale incompréhension aussi bien de la part des cinéphiles amoureux du genre que de la part des critiques généraliste alors que c’est un des films de Fisher ayant rencontré le plus grand succès public en France, compte tenu des chiffres de son exploitation en salles depuis sa sortie en exclusivité. Exemple symptomatique de la réception décalée du cinéma fantastique en France, le critique généraliste Jacques Zimmer publie sur la même page 60 de la Saison cinématographique 1967 une critique du Dracula (États-Unis, 1931) de Tod Browning à l’occasion de sa reprise et une critique du Dracula prince des ténèbres (Grande-Bretagne, 1965) de Terence Fisher. Celle du Browning est élogieuse, sa valeur esthétique et culturelle est reconnue ; celle du Fisher est négative, parée d’une objectivité froidement méprisante. La page 61 n’est pas en reste puisqu’on peut y lire une critique particulièrement ignoble du pourtant très beau et très remarquable Duel au couteau (Italie, 1966) de Mario Bava sous la plume d’Henri Moret, le futur directeur de la revue Écran qui sera pourtant par la suite très ouverte, du temps de Moret lui-même, au cinéma fantastique dans les années 1975-1980. Michel Caen dans Midi-Minuit Fantastique n°17 se montre à demi-injuste envers le film pour des raisons plus intéressantes mais qui ratent sa cohérence esthétique et thématique comme son originalité. On doit lire le commentaire historique et sociologique publié dans le volume intitulé Dans les griffes de la Hammer par Nicolas Stanzick pour avoir une idée de la manière absurde et incohérente avec laquelle Dracula prince des ténèbres fut reçu. René Prédal avait déjà rassemblé et commenté une partie d’entre elles dans son Terence Fisher (in Anthologie du cinéma, vol. 11) : le travail de Stanzick est très complémentaire du sien.Notes(1) Le format TechniScope (non pas TechnoScope, parfois mentionné par erreur) ici utilisé correspond à un aspect ratio de 2.70 et non pas du tout de 1.85 contrairement à ce qu’affirmait W.W. Dixon, The Charm of Evil : the Life and Films of Terence Fisher, Scarecrow Press, USA 1992. Erreur relevée par Tim Lucas dans son admirable critique du livre, parue sa revue Video Watchdog n°9 (États-Unis, janvier-février 1992, p.61. Le même Tim Lucas, dans la même critique bibliographique, se permet une belle remarque sur les trois Dracula (1958, 1960 et 1965) de Terence Fisher qui seraient d’une part des méditations dramaturgiques sur l’inversion des concepts traditionnels du christianisme (communion, discipline, résurrection, virginité) d’autre part des méditations intellectuelles sur les concepts de culte, de persuasion, de croyance. Un mot encore sur l’image du film : il existe, comme souvent, deux tirages distincts utilisant deux procédés couleur distincts, selon que c’est un laboratoire anglais ou américain qui a effectué le travail. Les deux tirages sont beaux (l’un favorise les verts et les bleus, l’autre favorise plutôt les rouges et les ocres), et la précision des couleurs demeure, dans les deux cas, tout à fait admirable, qu’il s’agisse de copie chimique visionnée en salle de cinéma ou de vidéo magnétique puis numérique visionnée sur une télévision.(2) Cf. la nouvelle de I. L. Peretz (1851-1915), La Ville morte in Cécile Cerf, Regards sur la littérature yidich (éditions Académie d’histoire, 1974, pp. 24-37) dans lequel il est aussi question d’un lieu mort ne figurant sur aucune carte mais pourtant bien réel.
CritiqueDracula Prince of Darkness [Dracula prince des ténèbres] (Grande-Bretagne, 1965) de Terence Fisher se veut la suite de son Dracula / Horror of Dracula [Le cauchemar de Dracula] (Grande-Bretagne, 1958), les deux films n’entretenant qu’un lien ténu en dépit de son titre avec son The Brides of Dracula [Les maîtresses de Dracula] (Grande-Bretagne, 1960). De facto ils constituent la trilogie fishérienne sur le thème du vampirisme mais sur le plan strictement thématique, il faudrait plutôt parler d’un diptyque stokérien entrecoupé par une variation para-stokérienne. Les premières images du film de 1965 sont celles de la dernière séquence du film de 1958 représentées d’une manière assez belle et originale, en guise d’introduction et de résumé à ce qu’on doit savoir si on veut comprendre ce qui va se passer ici et maintenant. Christopher Lee reprend le rôle pour la seconde fois de sa carrière. Le scénariste John Elder (de son véritable nom Anthony Hammer, alias Anthony Hinds et quelques autres pseudonymes encore) introduit l’idée d’un rite inconnu mais sanglant permettant de faire revivre le vampire. Il la reprendra quelques années plus tard en l’étendant aux dimensions d’une messe noire, plus spectaculaire encore, dans le scénario du Taste the Blood of Dracula [Une messe pour Dracula] (Grande-Bretagne, 1969) de Peter Sasdy. Elder réintroduit un personnage-clef du roman original de Stoker qui manquait en 1958 : Renfield, sous le nom de Ludwig. Et Elder invente un terrifiant domestique Klove, totalement absent du roman. Elder donne surtout à Fisher l’occasion d’approfondir sa syntaxe et sa thématique.Les 47 premières minutes du film sont constituées par une action qui dure un après-midi puis toute la nuit suivante : le restant se déroule sur plusieurs jours et nuits. Le rythme du récit est donc inhabituel et novateur. Tout comme dans Horror of Dracula, et bien que le mot anglais Horror soit absent du titre, il s’agit d’une structure cauchemardesque où les événements fantastiques ne s’immiscent que progressivement dans la réalité puis la déchirent et l’entraînent alors à un rythme effréné vers le dénouement. Barbara Shelley incarne à merveille la conscience opérant ce travail de reconnaissance. Le spectateur s’identifie naturellement à elle d’abord résistante puis investie progressivement par l’angoisse, la peur puis la terreur : elle définit elle-même ce qu’elle vit comme étant un cauchemar qui finit par la posséder en révélant son double démoniaque. C’est le plus beau rôle de Barbara Shelley, le plus achevé et le plus puissant de sa carrière. La nuit au château est l’occasion pour Fisher de mettre au point certains de ses plus complexes et beaux mouvements de caméra jamais filmés. Confinant parfois à une abstraction formelle, ils sont absolument nécessaires à la progression du piège construit sous nos yeux. La violence graphique monte pour sa part d’un cran par rapport aux deux films de 1958 et de 1960 : égorgements, brûlures, démentielle purification de la femme-vampire en une scène d’inquisition dont l’effet est encore aujourd’hui, en raison de son rythme, de sa composition picturale et de la musique paroxystique composée par James Bernard, presque insoutenable. La structure sophistiquée du script consiste en une succession de reconfigurations d’éléments amicaux ou inamicaux, de confirmations ou d’infirmations d’identité, de confirmations ou d’infirmations de pensées exactes ou fausses sur une situation continuellement mouvante et tendue. Fisher use d’un symbolisme à résonance psychanalytique : Éros et Thanatos se combattent de manière efficace, réelle, active. La manière dont les éléments antagonistes, ressortant de chacune des deux instances, sont disséminés par l’intrigue, sa construction, ses dialogues même, est élaborée jusqu’au degré le plus raffiné. Le film manifeste une sorte de positivisme symboliste rigoureusement maîtrisé, à la plastique mi-baroque mi-classique. Le château de Dracula ne figure sur aucune carte : ce point évoque éventuellement une autre filiation que le roman de Stoker, celle des vieux récits yidich [sic] (2) d’Europe centrale.Une belle idée enfin que Gaston Bachelard aurait, sans doute, appréciée en raison de sa poésie élémentaire : la mort originale de Dracula que le scénario écrit par le même Elder deux ans plus tard pour Dracula Has Risen From the Grave [Dracula et les femmes] (Grande-Bretagne, 1968) de Freddie Francis, trouvera encore le moyen de surmonter. On peut dès lors dire que la série Hammer film des Dracula stokériens, donc tous ceux interprétés par Christopher Lee, s’apparente véritablement à un cycle de morts et de renaissances, structurellement semblable à l’éternel retour primitif qui fascinait tant Schopenhauer et Nietzsche lorsqu’ils étudiaient en Occidentaux métaphysiquement inquiets les religions de l’Asie.Note additionnelle sur la réception critique du film en FranceC’est l’un des films de Fisher les plus méconnus et les plus malmenés par la critique française au moment de sa sortie parisienne en décembre 1966, et même encore par la suite. On peut parler d’une totale incompréhension aussi bien de la part des cinéphiles amoureux du genre que de la part des critiques généraliste alors que c’est un des films de Fisher ayant rencontré le plus grand succès public en France, compte tenu des chiffres de son exploitation en salles depuis sa sortie en exclusivité. Exemple symptomatique de la réception décalée du cinéma fantastique en France, le critique généraliste Jacques Zimmer publie sur la même page 60 de la Saison cinématographique 1967 une critique du Dracula (États-Unis, 1931) de Tod Browning à l’occasion de sa reprise et une critique du Dracula prince des ténèbres (Grande-Bretagne, 1965) de Terence Fisher. Celle du Browning est élogieuse, sa valeur esthétique et culturelle est reconnue ; celle du Fisher est négative, parée d’une objectivité froidement méprisante. La page 61 n’est pas en reste puisqu’on peut y lire une critique particulièrement ignoble du pourtant très beau et très remarquable Duel au couteau (Italie, 1966) de Mario Bava sous la plume d’Henri Moret, le futur directeur de la revue Écran qui sera pourtant par la suite très ouverte, du temps de Moret lui-même, au cinéma fantastique dans les années 1975-1980. Michel Caen dans Midi-Minuit Fantastique n°17 se montre à demi-injuste envers le film pour des raisons plus intéressantes mais qui ratent sa cohérence esthétique et thématique comme son originalité. On doit lire le commentaire historique et sociologique publié dans le volume intitulé Dans les griffes de la Hammer par Nicolas Stanzick pour avoir une idée de la manière absurde et incohérente avec laquelle Dracula prince des ténèbres fut reçu. René Prédal avait déjà rassemblé et commenté une partie d’entre elles dans son Terence Fisher (in Anthologie du cinéma, vol. 11) : le travail de Stanzick est très complémentaire du sien.Notes(1) Le format TechniScope (non pas TechnoScope, parfois mentionné par erreur) ici utilisé correspond à un aspect ratio de 2.70 et non pas du tout de 1.85 contrairement à ce qu’affirmait W.W. Dixon, The Charm of Evil : the Life and Films of Terence Fisher, Scarecrow Press, USA 1992. Erreur relevée par Tim Lucas dans son admirable critique du livre, parue sa revue Video Watchdog n°9 (États-Unis, janvier-février 1992, p.61. Le même Tim Lucas, dans la même critique bibliographique, se permet une belle remarque sur les trois Dracula (1958, 1960 et 1965) de Terence Fisher qui seraient d’une part des méditations dramaturgiques sur l’inversion des concepts traditionnels du christianisme (communion, discipline, résurrection, virginité) d’autre part des méditations intellectuelles sur les concepts de culte, de persuasion, de croyance. Un mot encore sur l’image du film : il existe, comme souvent, deux tirages distincts utilisant deux procédés couleur distincts, selon que c’est un laboratoire anglais ou américain qui a effectué le travail. Les deux tirages sont beaux (l’un favorise les verts et les bleus, l’autre favorise plutôt les rouges et les ocres), et la précision des couleurs demeure, dans les deux cas, tout à fait admirable, qu’il s’agisse de copie chimique visionnée en salle de cinéma ou de vidéo magnétique puis numérique visionnée sur une télévision.(2) Cf. la nouvelle de I. L. Peretz (1851-1915), La Ville morte in Cécile Cerf, Regards sur la littérature yidich (éditions Académie d’histoire, 1974, pp. 24-37) dans lequel il est aussi question d’un lieu mort ne figurant sur aucune carte mais pourtant bien réel.
31/03/2010 | Lien permanent
Dracula 6 : Le cauchemar de Dracula de Terence Fisher, par Francis Moury

 «[…] La petite-fille de Bram Stoker est venue me voir sur le plateau pendant le tournage et a eu la bonté de m’assurer que mon interprétation était excellente et qu’elle était sûre que son grand-père l’aurait appréciée. Bien sûr, il y avait, dans le scénario, une grande différence avec le roman, mais j’ai toujours essayé de mettre en évidence la solitude du Mal et particulièrement de bien montrer que, quelque terrible que puissent être les actions du comte Dracula, il était possédé par une force occulte qui échappait entièrement à son contrôle. C’est le Démon le tenant en son pouvoir, qui l’obligeait à commettre ces crimes horribles, car il avait pris possession de son corps depuis des temps immémoriaux. Cependant, son âme, qui subsistait sous l’enveloppe charnelle, était immortelle et ne pouvait être détruite d’aucune façon. Tout ceci pour expliquer la grande tristesse que j’ai essayée de mettre dans mon interprétation. […]»Christopher Lee, lettre à la revue Midi-Minuit fantastique n°s 4-5 (éditions Le Terrain vague, janvier 1963, pp. 161-162).Le cauchemar de Dracula [Dracula / Horror of Dracula] (Grande-Bretagne, 1958) de Terence Fisher est le premier des trois films que Fisher consacra au vampirisme, et historiquement le plus important des trois. Le scénario écrit par Jimmy Sangster est à la fois plus proche et plus éloigné du roman de Stoker que ceux des versions cinématographiques antérieures. Fisher avait écrit à Tony Faivre en avril 1963 une lettre dans laquelle il lui précisait avoir voulu serrer de plus près que ses prédécesseurs le roman initial. Christopher Lee – que ce rôle rendit aussi célèbre que Bela Lugosi : l’année précédente, Lee avait tenu le rôle de la créature dans The Curse of Frankenstein [Frankenstein s’est échappé] de Fisher avec Peter Cushing dans le rôle de Frankenstein – partageait comme on le sait cette conception puisqu’il indiquait dans une lettre à Midi-Minuit Fantastique (loc. cit.), qu’il avait lu maintes et maintes fois le roman de Stoker mais regrettait que certains épisodes (Harker et les loups, Harker et le miroir, le bateau de Dracula voguant vers l’Angleterre) n’aient pu être intégrés. Il aurait pu ajouter l’absence du personnage de Renfield (réintroduit d’une manière originale, et sous un autre nom, dans le troisième Dracula de Fisher : Dracula prince des ténèbres, 1965) et l’idée originale que Harker sait déjà que Dracula est un vampire, qu’il vient en son château dans le but d’abord caché puis avoué de le tuer car il est un correspondant de Van Helsing ! Fisher a l’intelligence de ne pas le faire savoir d’emblée au spectateur tant l’innovation de ce surcroît de conscience et de savoir est importante. Ce qui n’empêche pas Faivre de considérer, dans sa remarquable introduction à la traduction française de la version intégrale du roman Dracula de Bram Stoker (Éditions Gérard, Bibliothèque Marabout, série fantastique, Verviers, 1963) que c’est à cause de cette fidélité supérieure au roman que Le cauchemar de Dracula a davantage de succès public que Les Maîtresses de Dracula tourné par Fisher en 1960.Plastiquement, il faut bien considérer le génie de la mise en scène de Fisher : elle organise durant tout le film une terreur sournoise qui repose sur l’organisation de l’espace comme sur celle du temps du récit. Dès le générique d’ouverture, la description du château impressionne par sa construction sophistiquée, précise et inquiétante : on tourne autour des donjons, des remparts, on traverse un pont, et la caméra s’approche d’un escalier dissimulé, donnant sur une cave… où se cache le cercueil sur lequel vient, en gros plan, se fixer le nom Dracula, au-dessus duquel tombent alors des gouttes de sang toujours plus nombreuses : mi-réaliste, mi-symbolique. Cette étrange poésie dialectique correspond à la photographie de Asher : la couleur y augmente le réalisme dans les scènes d’extérieurs mais elle est souvent traitée de manière baroque dans les scènes d’intérieurs : la chambre de Harker, la bibliothèque de Dracula, la chambre londonienne de Lucy, les caveaux soigneusement décorés par Bernard Robinson. Le spectaculaire et la suggestion, la litote et l’ellipse, l’allusion et la monstration alternent avec une virtuosité et un art consommé qui finissent par devenir obsédant. La musique paroxystique, pléonastique, de James Bernard va dans le même sens. Le titre d’exploitation français comme le titre d’exportation international anglais l’exprimaient ostensiblement : un cauchemar. Cauchemar de Dracula dans lequel tout est possible : la résurgence issue de la mentalité primitive du sang comme facteur de puissance, source ambivalente de vie et de mort, le vertige d’un érotisme interdit et de rites anciens mais encore actifs. Les modalités phénoménologiques du sacré de respect, décrites par Caillois et tant d’autres, sont ici convoquées. Personne n’est plus à l’abri : Harker qui croyait pouvoir venir à bout du monstre, en devient la victime ; une enfant est même, à un moment, menacée de le devenir ! Certes, James Whale avait déjà montré une enfant tuée par la créature de Frankenstein en 1931 mais c’était une sorte d’accident. Ici il n’y pas d’accident, ni d’optimisme rousseauiste sous-jacent. Le vampire est une créature du Diable qui nie l’humanité… et dont la devise pourrait être mors illorum, vita nostra.L’emploi de l’écran large et de la couleur, la modernité des trucages à la brutalité très impressionnante et d’une qualité technique supérieure à tout ce qui avait précédé, ajoutèrent à l’effet obtenu. Alain Le Bris disserta filmologiquement sur Une constante fishérienne : le sang et Michel Caen sur la Psychopathologia Sexualis (1) dans l’œuvre de Terence Fisher (in Midi-Minuit Fantastique n°1 spécial Terence Fisher, mai-juin 1962) car le sang, filmé par Fisher, était en effet un sang nouveau, si on ose dire, que l’on n’avait jamais vu dispensé avec une telle crudité et une telle cruauté, et un sang auquel la couleur conférait une terrible présence. La critique française généraliste fut pourtant, d’une manière générale, révulsée, très hostile au film. René Prédal, dans sa remarquable monographie sur Terence Fisher (in Anthologie du cinéma, tome 11, 1983) puis Nicolas Stanzick (Dans les griffes de la Hammer – La France livrée au cinéma d’épouvante (1957-2007, Scali, 2008) ont rendu compte d’une manière détaillée et très complémentaire de l’histoire critique française des films de Fisher. Elle oscilla, de 1957 [date de son premier film fantastique adapté sous licence Universal pour la Hammer : The Curse of Frankenstein] à 1973 [date de son ultime, l’épure désespérée qu’est Frankenstein et le monstre de l’Enfer] entre fascination et répulsion, mépris et sarcasme. Un long travail critique initié par une élite vers 1960 aboutit vers 2010 à sa reconnaissance au moins universitaire et cinéphilique. Mais il faut bien mesurer que Fisher, qui avait redonné une vie anglaise nouvelle à tout le cycle fantastique et à tous les personnages mythiques de la Universal américaine de 1931-1945, mourut en 1980 dans l’indifférence la plus totale, la même année que les cinéastes Mario Bava et… Alfred Hitchcock. C’est quelques années avant 2010, soit presque trente ans après sa mort, que la Cinémathèque française (2) lui rendit enfin un hommage officiel sous la forme d’une rétrospective générale de son œuvre pré-fantastique comme fantastique qui s’ouvrit non pas par Le cauchemar de Dracula mais par… Les maîtresses de Dracula que nous considérons pour notre part comme certainement plus novateur et plus impressionnant encore.Notes(1) Ce titre latinisant était naturellement inspiré par R. v. Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis, étude médico-légale à l’usage des médecins et des juristes, parue en Allemagne pour la première fois en 1869 puis en 16e et 17e éditions refondues par le Dr. Albert Moll, trad. française par René Lobstein, préface du Dr. Pierre Janet (Éditions Payot, Bibliothèque médicale, 1931).(2) Cinémathèque qui programmait ses films mais très irrégulièrement : nous avons relaté dans nos souvenirs des cinémas parisiens – parus initialement dans Les Temps modernes n° 617, puis sur www.cinéastes.net mais dont la version la plus à jour pour l’instant se trouve ici : http://herbertmathese.free.fr/images/divers/souvenirs-de-Cinemas-parisiens.pdf comment Dracula prince des Ténèbres annoncé dans son programme, avait été cavalièrement remplacé au pied levé, dans les années 1980-1985, par son plus rare mais non moins passionnant Les Étrangleurs de Bombay (1959).
«[…] La petite-fille de Bram Stoker est venue me voir sur le plateau pendant le tournage et a eu la bonté de m’assurer que mon interprétation était excellente et qu’elle était sûre que son grand-père l’aurait appréciée. Bien sûr, il y avait, dans le scénario, une grande différence avec le roman, mais j’ai toujours essayé de mettre en évidence la solitude du Mal et particulièrement de bien montrer que, quelque terrible que puissent être les actions du comte Dracula, il était possédé par une force occulte qui échappait entièrement à son contrôle. C’est le Démon le tenant en son pouvoir, qui l’obligeait à commettre ces crimes horribles, car il avait pris possession de son corps depuis des temps immémoriaux. Cependant, son âme, qui subsistait sous l’enveloppe charnelle, était immortelle et ne pouvait être détruite d’aucune façon. Tout ceci pour expliquer la grande tristesse que j’ai essayée de mettre dans mon interprétation. […]»Christopher Lee, lettre à la revue Midi-Minuit fantastique n°s 4-5 (éditions Le Terrain vague, janvier 1963, pp. 161-162).Le cauchemar de Dracula [Dracula / Horror of Dracula] (Grande-Bretagne, 1958) de Terence Fisher est le premier des trois films que Fisher consacra au vampirisme, et historiquement le plus important des trois. Le scénario écrit par Jimmy Sangster est à la fois plus proche et plus éloigné du roman de Stoker que ceux des versions cinématographiques antérieures. Fisher avait écrit à Tony Faivre en avril 1963 une lettre dans laquelle il lui précisait avoir voulu serrer de plus près que ses prédécesseurs le roman initial. Christopher Lee – que ce rôle rendit aussi célèbre que Bela Lugosi : l’année précédente, Lee avait tenu le rôle de la créature dans The Curse of Frankenstein [Frankenstein s’est échappé] de Fisher avec Peter Cushing dans le rôle de Frankenstein – partageait comme on le sait cette conception puisqu’il indiquait dans une lettre à Midi-Minuit Fantastique (loc. cit.), qu’il avait lu maintes et maintes fois le roman de Stoker mais regrettait que certains épisodes (Harker et les loups, Harker et le miroir, le bateau de Dracula voguant vers l’Angleterre) n’aient pu être intégrés. Il aurait pu ajouter l’absence du personnage de Renfield (réintroduit d’une manière originale, et sous un autre nom, dans le troisième Dracula de Fisher : Dracula prince des ténèbres, 1965) et l’idée originale que Harker sait déjà que Dracula est un vampire, qu’il vient en son château dans le but d’abord caché puis avoué de le tuer car il est un correspondant de Van Helsing ! Fisher a l’intelligence de ne pas le faire savoir d’emblée au spectateur tant l’innovation de ce surcroît de conscience et de savoir est importante. Ce qui n’empêche pas Faivre de considérer, dans sa remarquable introduction à la traduction française de la version intégrale du roman Dracula de Bram Stoker (Éditions Gérard, Bibliothèque Marabout, série fantastique, Verviers, 1963) que c’est à cause de cette fidélité supérieure au roman que Le cauchemar de Dracula a davantage de succès public que Les Maîtresses de Dracula tourné par Fisher en 1960.Plastiquement, il faut bien considérer le génie de la mise en scène de Fisher : elle organise durant tout le film une terreur sournoise qui repose sur l’organisation de l’espace comme sur celle du temps du récit. Dès le générique d’ouverture, la description du château impressionne par sa construction sophistiquée, précise et inquiétante : on tourne autour des donjons, des remparts, on traverse un pont, et la caméra s’approche d’un escalier dissimulé, donnant sur une cave… où se cache le cercueil sur lequel vient, en gros plan, se fixer le nom Dracula, au-dessus duquel tombent alors des gouttes de sang toujours plus nombreuses : mi-réaliste, mi-symbolique. Cette étrange poésie dialectique correspond à la photographie de Asher : la couleur y augmente le réalisme dans les scènes d’extérieurs mais elle est souvent traitée de manière baroque dans les scènes d’intérieurs : la chambre de Harker, la bibliothèque de Dracula, la chambre londonienne de Lucy, les caveaux soigneusement décorés par Bernard Robinson. Le spectaculaire et la suggestion, la litote et l’ellipse, l’allusion et la monstration alternent avec une virtuosité et un art consommé qui finissent par devenir obsédant. La musique paroxystique, pléonastique, de James Bernard va dans le même sens. Le titre d’exploitation français comme le titre d’exportation international anglais l’exprimaient ostensiblement : un cauchemar. Cauchemar de Dracula dans lequel tout est possible : la résurgence issue de la mentalité primitive du sang comme facteur de puissance, source ambivalente de vie et de mort, le vertige d’un érotisme interdit et de rites anciens mais encore actifs. Les modalités phénoménologiques du sacré de respect, décrites par Caillois et tant d’autres, sont ici convoquées. Personne n’est plus à l’abri : Harker qui croyait pouvoir venir à bout du monstre, en devient la victime ; une enfant est même, à un moment, menacée de le devenir ! Certes, James Whale avait déjà montré une enfant tuée par la créature de Frankenstein en 1931 mais c’était une sorte d’accident. Ici il n’y pas d’accident, ni d’optimisme rousseauiste sous-jacent. Le vampire est une créature du Diable qui nie l’humanité… et dont la devise pourrait être mors illorum, vita nostra.L’emploi de l’écran large et de la couleur, la modernité des trucages à la brutalité très impressionnante et d’une qualité technique supérieure à tout ce qui avait précédé, ajoutèrent à l’effet obtenu. Alain Le Bris disserta filmologiquement sur Une constante fishérienne : le sang et Michel Caen sur la Psychopathologia Sexualis (1) dans l’œuvre de Terence Fisher (in Midi-Minuit Fantastique n°1 spécial Terence Fisher, mai-juin 1962) car le sang, filmé par Fisher, était en effet un sang nouveau, si on ose dire, que l’on n’avait jamais vu dispensé avec une telle crudité et une telle cruauté, et un sang auquel la couleur conférait une terrible présence. La critique française généraliste fut pourtant, d’une manière générale, révulsée, très hostile au film. René Prédal, dans sa remarquable monographie sur Terence Fisher (in Anthologie du cinéma, tome 11, 1983) puis Nicolas Stanzick (Dans les griffes de la Hammer – La France livrée au cinéma d’épouvante (1957-2007, Scali, 2008) ont rendu compte d’une manière détaillée et très complémentaire de l’histoire critique française des films de Fisher. Elle oscilla, de 1957 [date de son premier film fantastique adapté sous licence Universal pour la Hammer : The Curse of Frankenstein] à 1973 [date de son ultime, l’épure désespérée qu’est Frankenstein et le monstre de l’Enfer] entre fascination et répulsion, mépris et sarcasme. Un long travail critique initié par une élite vers 1960 aboutit vers 2010 à sa reconnaissance au moins universitaire et cinéphilique. Mais il faut bien mesurer que Fisher, qui avait redonné une vie anglaise nouvelle à tout le cycle fantastique et à tous les personnages mythiques de la Universal américaine de 1931-1945, mourut en 1980 dans l’indifférence la plus totale, la même année que les cinéastes Mario Bava et… Alfred Hitchcock. C’est quelques années avant 2010, soit presque trente ans après sa mort, que la Cinémathèque française (2) lui rendit enfin un hommage officiel sous la forme d’une rétrospective générale de son œuvre pré-fantastique comme fantastique qui s’ouvrit non pas par Le cauchemar de Dracula mais par… Les maîtresses de Dracula que nous considérons pour notre part comme certainement plus novateur et plus impressionnant encore.Notes(1) Ce titre latinisant était naturellement inspiré par R. v. Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis, étude médico-légale à l’usage des médecins et des juristes, parue en Allemagne pour la première fois en 1869 puis en 16e et 17e éditions refondues par le Dr. Albert Moll, trad. française par René Lobstein, préface du Dr. Pierre Janet (Éditions Payot, Bibliothèque médicale, 1931).(2) Cinémathèque qui programmait ses films mais très irrégulièrement : nous avons relaté dans nos souvenirs des cinémas parisiens – parus initialement dans Les Temps modernes n° 617, puis sur www.cinéastes.net mais dont la version la plus à jour pour l’instant se trouve ici : http://herbertmathese.free.fr/images/divers/souvenirs-de-Cinemas-parisiens.pdf comment Dracula prince des Ténèbres annoncé dans son programme, avait été cavalièrement remplacé au pied levé, dans les années 1980-1985, par son plus rare mais non moins passionnant Les Étrangleurs de Bombay (1959).
18/03/2010 | Lien permanent
Boccacce de Marco Lodoli

 «Il a parlé comme il faut de la vivisection et de l'héroïne, des supermarchés et de la pollution, de la dépression et des hémorroïdes.» Marco Lodoli, Boccacce (Éditions L'Arbre vengeur, coll. Selva Selvaggia dirigée par Lise Chappuis, 2007), pp. 79-80.L'une des nouvelles les plus intéressantes qui composent ce drôle de petit livre grimaçant de Marco Lodoli (1) qu'est Boccacce, bien illustré par Alban Caumont, est sans nul doute celle qui s'intitule Le philologue : nous y voyons un jeune auteur désireux de connaître l'avis, sur les poèmes qu'il lui a soumis, d'un éminent spécialiste de littérature. Le philologue essaie certes de ménager l'apprenti poète (pensez donc, une jeune âme littéraire, un poète en herbe encore, c'est tellement fragile !) mais, lorsqu'il lit à voix haute ses vers, c'est pour lui en montrer toutes les limites et les défauts, petits ou grands, comme par exemple le fait qu'ils ont un incontestable air de déjà-vu : «Toujours j'aimai cette hauteur déserte / Et cette haie qui du plus ultime horizon / Cache au regard une telle étendue».Qui donc moque, dans ce texte, Marco Lodoli ? Le jeune poète prétentieux qui ne fait que répéter, à la virgule près, des vers célèbres et singulièrement connus de tous les petits Italiens puisqu'ils sont ceux de Leopardi ? (2) Le vieux philologue qui paraît ne même plus se souvenir qu'il a lu ces vers il y a bien des années, justement en ouvrant un recueil devenu classique depuis quelques lustres ? La leçon n'est-elle pas finalement bien plus profonde, sous l'ironie et l'alacrité de ces quelques pages ?Peut-être Marco Lodoli veut-il tout simplement établir cette vérité qui n'eut jamais de meilleur témoin que Borges (3) : nous écrivons et commentons tous, mauvais ou excellents écrivain, bons critiques littéraires ou tartuffes, le même livre.Un détail m'a amusé : l'une des seules fautes de frappe (4) que j'ai repérées dans le petit livre de Lodoli concerne une nouvelle intitulée Le Correcteur mais je ne voudrais pas pousser l'amusement vaguement érudit jusqu'à suggérer que cette faute a été intentionnelle...Je recommande aussi chaudement, à certains des membres les moins doués ( A Country For Old Men [ce blog n'existe plus] de ThomZ, Pedro Babel, l'esc@rgot g@rpien, La Mygale pourpre [ce blog n'existe plus lui aussi] de Moolz) de ce raout guignolo-avant-gardiste (beaucoup de bruit pour rien, disons pour des auteurs ayant le culte du pur référent, des signifiants flottants que l'on soumet à toutes les tortures linguistico-sémantiques, des jeux éculés aussitôt qu'inventés sur la matière verbale...) qui se nomme Fric-Frac Club, un agrégat de talents et de nullités pour le moins hétéroclite, de lecteurs et de critiques de très bon ou maigre niveau (5) qui paraissent presque tous amoureux de la moindre virgule pynchonienne ayant été traduite par Christophe Claro puis publiée dans sa collection Lot 49, je leur recommande vivement de se pénétrer de la leçon d'une nouvelle fort ironique intitulée Le rebelle décrivant en ces termes la trame convenue d'un quelconque roman banal dit, justement, d'avant-garde (cf. p. 80) : «Son premier livre s'intitulait : Castrons le pitre. En couverture, il y avait la sempiternelle image éculée d'un clown en larmes, mais avec le ventre ouvert et les tripes phosphorescentes. En deux mots, l'histoire était celle d'un apprentissage de la vengeance. Un toxico épuisé et enragé capture à l'extérieur du cirque Togni, un paillasse proche de la retraite. Il l'amène chez lui et lui fait subir des sévices pendant des jours et des jours. Le clown est un petit bourgeois, de ceux qui tentent encore de faire rire les enfants avec des culbutes et des chaussures anormales, qui voudrait finir sa vie en paix, dans sa petite maison sur le lac de Bracciano. Le pitre le paie cher, on lui arrache un à un les ongles, ensuite on lui coupe la langue, on lui verse de la chaux sur les pupilles; le toxico et ses amis dansent nus autour de lui. Pour finir, arrive ce qui devait arriver et donne son titre au livre».
«Il a parlé comme il faut de la vivisection et de l'héroïne, des supermarchés et de la pollution, de la dépression et des hémorroïdes.» Marco Lodoli, Boccacce (Éditions L'Arbre vengeur, coll. Selva Selvaggia dirigée par Lise Chappuis, 2007), pp. 79-80.L'une des nouvelles les plus intéressantes qui composent ce drôle de petit livre grimaçant de Marco Lodoli (1) qu'est Boccacce, bien illustré par Alban Caumont, est sans nul doute celle qui s'intitule Le philologue : nous y voyons un jeune auteur désireux de connaître l'avis, sur les poèmes qu'il lui a soumis, d'un éminent spécialiste de littérature. Le philologue essaie certes de ménager l'apprenti poète (pensez donc, une jeune âme littéraire, un poète en herbe encore, c'est tellement fragile !) mais, lorsqu'il lit à voix haute ses vers, c'est pour lui en montrer toutes les limites et les défauts, petits ou grands, comme par exemple le fait qu'ils ont un incontestable air de déjà-vu : «Toujours j'aimai cette hauteur déserte / Et cette haie qui du plus ultime horizon / Cache au regard une telle étendue».Qui donc moque, dans ce texte, Marco Lodoli ? Le jeune poète prétentieux qui ne fait que répéter, à la virgule près, des vers célèbres et singulièrement connus de tous les petits Italiens puisqu'ils sont ceux de Leopardi ? (2) Le vieux philologue qui paraît ne même plus se souvenir qu'il a lu ces vers il y a bien des années, justement en ouvrant un recueil devenu classique depuis quelques lustres ? La leçon n'est-elle pas finalement bien plus profonde, sous l'ironie et l'alacrité de ces quelques pages ?Peut-être Marco Lodoli veut-il tout simplement établir cette vérité qui n'eut jamais de meilleur témoin que Borges (3) : nous écrivons et commentons tous, mauvais ou excellents écrivain, bons critiques littéraires ou tartuffes, le même livre.Un détail m'a amusé : l'une des seules fautes de frappe (4) que j'ai repérées dans le petit livre de Lodoli concerne une nouvelle intitulée Le Correcteur mais je ne voudrais pas pousser l'amusement vaguement érudit jusqu'à suggérer que cette faute a été intentionnelle...Je recommande aussi chaudement, à certains des membres les moins doués ( A Country For Old Men [ce blog n'existe plus] de ThomZ, Pedro Babel, l'esc@rgot g@rpien, La Mygale pourpre [ce blog n'existe plus lui aussi] de Moolz) de ce raout guignolo-avant-gardiste (beaucoup de bruit pour rien, disons pour des auteurs ayant le culte du pur référent, des signifiants flottants que l'on soumet à toutes les tortures linguistico-sémantiques, des jeux éculés aussitôt qu'inventés sur la matière verbale...) qui se nomme Fric-Frac Club, un agrégat de talents et de nullités pour le moins hétéroclite, de lecteurs et de critiques de très bon ou maigre niveau (5) qui paraissent presque tous amoureux de la moindre virgule pynchonienne ayant été traduite par Christophe Claro puis publiée dans sa collection Lot 49, je leur recommande vivement de se pénétrer de la leçon d'une nouvelle fort ironique intitulée Le rebelle décrivant en ces termes la trame convenue d'un quelconque roman banal dit, justement, d'avant-garde (cf. p. 80) : «Son premier livre s'intitulait : Castrons le pitre. En couverture, il y avait la sempiternelle image éculée d'un clown en larmes, mais avec le ventre ouvert et les tripes phosphorescentes. En deux mots, l'histoire était celle d'un apprentissage de la vengeance. Un toxico épuisé et enragé capture à l'extérieur du cirque Togni, un paillasse proche de la retraite. Il l'amène chez lui et lui fait subir des sévices pendant des jours et des jours. Le clown est un petit bourgeois, de ceux qui tentent encore de faire rire les enfants avec des culbutes et des chaussures anormales, qui voudrait finir sa vie en paix, dans sa petite maison sur le lac de Bracciano. Le pitre le paie cher, on lui arrache un à un les ongles, ensuite on lui coupe la langue, on lui verse de la chaux sur les pupilles; le toxico et ses amis dansent nus autour de lui. Pour finir, arrive ce qui devait arriver et donne son titre au livre».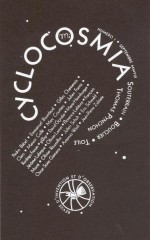 Il n'y a pas de chapitre, dans le petit et truculent livre de Lodoli, consacré aux revues. Quel dommage, tant celles-ci me paraissent constituer, à l'heure même où des blogs comme le nôtre cumulent tous les avantages d'une revue sans connaître ses nombreux défauts et lourdeurs, un laboratoire où la littérature se cherche, s'épanouit et, il faut le dire, disparaît aussi rapidement qu'elle est née, qu'il s'agisse de ses perles en croissance (puisque, bien souvent, les textes parus en revues seront repris par leurs auteurs en volume) ou de quelques dés à coudre de cendres, dont nul ne gardera la mémoire, pas même le philologue érudit de Lodoli. Ma carrière littéraire, comme disent les gommeux, est toute jeune et pourtant, combien de revues auxquelles j'ai participé existent encore ? Certes, la très belle revue Nunc continue, tant bien que mal, à paraître mais Cancer! n'est plus, comme Esprits Libres, Les Brandes, La Sœur de l'Ange sombrant pour sa part dans l'insignifiance conceptualo-gauchiste depuis qu'elle est éditée par Le Grand Souffle, un éditeur lui-même moribond selon toute vraisemblance. Immédiatement est devenu une feuille royaliste distribuée exclusivement à la sortie des messes ou des Procure, Contrelittérature, la revue d'Alain Santacreu que Matthieu Baumier et Jacques de Guillebon ont rejoint paraît avoir amorcé une étrange et ésotériste métamorphose qui va la conduire jusqu'au cœur paraît-il de la symbolique chrétienne et Tsimtsoûm, du fantasque Bruno Deniel-Laurent, n'aura même pas dépassé sa première livraison, ce qui est tout de même assez rare, y compris dans l'univers labile des revues. Quoi d'autre ? Ah oui, Impur dirigée par Laurent Schang aimant les tanks camouflés et les petites Japonaises vicieuses, qui ne dépassera probablement pas trois numéros... Il faut donc saluer l'initiative du courageux Antonio Werli, maître d'œuvre de Cyclocosmia, dont le dossier du tout premier numéro (à la réalisation superbe), il fallait s'en douter venant d'un membre du FFC, est consacré à Thomas Pynchon. Comme tout dossier, celui-ci est inégal, les bons articles et les très mauvais, voire franchement insignifiants, se partageant, miraculeusement, selon la même ligne de crête évoquée en note 5...Une dernière remarque, moins futile qu'il n'y paraît : Cyclocosmia se veut une revue d'invention et d'observation. Regardons autour de nous : l'invention (comme pour la revue Conférence, la partie la plus inutile de Cyclocosmia) il n'y a que cela, dans une France qui se veut littéraire, inventive donc et qui n'est plus que bavarde, c'est-à-dire ressassant ses souvenirs comme un vieillard, des centaines de revues qui inventent ou prétendent inventer de nouvelles formes de littérature, alors que toutes les formes existent depuis les premiers textes bibliques, peut-être même, mais les plus savants de mes lecteurs contesteront ce point, depuis les premières traces déposées sur les parois rocheuses des cavernes profondes. Je conseillerai donc à Antonio Werli d'ajouter à ces deux qualités une troisième (ou alors, de remplacer l'observation, un peu trop froide, par), l'attention, vertu que Cristina Campo, dans un texte remarquable (6), oppose justement à la trop commune et vantée invention, cette tarte à la crème rancie faisant les maigres délices de tous les avant-gardistes.Notes(1) Assez peu connu en France, Marco Lodoli, né en 1956 à Rome où il réside encore est l'auteur de plusieurs romans publiés aux éditions P.O.L comme Chronique d'un siècle qui s'enfuit (1987, prix Viareggio de la première œuvre), Le Clocher brun (1991), Les Fainéants (1992) et enfin Courir, mourir (1994). I Fiori (édité par Einaudi), que d'aucuns considèrent comme son ouvrage le plus abouti, n'a toujours pas été traduit en français. La Fosse aux Ours doit faire paraître en février 2009 un ouvrage intitulé Île, guide vagabond de Rome.(2) Extrait de L'infini recueilli dans Canti avec un choix des Œuvres morales (traductions de F.-A. Aulard, Juliette Bertrand, Philippe Jaccottet et Georges Nicole, présentation de Jean-Michel Gardair, Gallimard, coll. Poésie, 1982), p. 68.(3) Délicieusement borgésienne est cette autre nouvelle, intitulée Le correcteur, où Lodoli écrit : «Durant son dernier mois de travail dans la maison d’édition, Fantin fut implacable. Par exemple il corrigea le mot «labyrinthe», utilisé par le jeune auteur d’un essai. Il le récrivit correctement sur le bord blanc : «labyrinthe». Le rédacteur en chef convoqua Fantino dans son bureau et exigea une explication. Selon cet homme, qui se considérait expérimenté et attentif, le mot était exactement le même. Fantino resta bouche bée de tant de superficialité : était-il possible que le rédacteur en chef ne voie pas la différence, qu’il ne comprenne pas à quel point la correction était exacte et inévitable ? Soyez attentif au cœur du mot, ne vous arrêtez pas aux apparences…», in op. cit., p. 51.(4) Il commanda une bouteille de vin rouge très côté et la but au goulot, op. cit., p. 50.(5) Trois membres du FFC sont tout de même à signaler, tant ils volent au-dessus de leurs calamiteux collègues, non seulement par certaines de leurs analyses sur des titres de littérature étrangère mais, aussi, j'allais dire surtout, par une culture littéraire qui leur fait supposer, à raison, qu'un Pynchon, un Vollmann, un Gaddis, un Gass ou un DeLillo ne sont point apparus comme par génération spontanée. La critique littéraire, du moins lorsqu'elle est pratiquée avec un peu de sérieux, est avant tout un art d'établir des correspondances et, surtourt, de savoir remonter un fleuve jusqu'à son amont, sans avoir peur de se noyer dans une vaguelette se fondant dans la mer indifférenciée : il s'agit de François Monti, Antonio Werli et de Bartleby, lesquels ne se contentent pas, leur petite gueule rose de chiots littéraires ouverte et la queue frétillante, de rendre humidement compte, pardon, de s'extasier, sans la plus petite distance que l'on souhaiterait vaguement objective, sur chacune des traductions de Claro mais, du moins dans leurs meilleurs textes, critiquent véritablement.(6) Dans un texte intitulé Attention et poésie recueilli dans le splendide recueil que constitue Les impardonnables (Gallimard, coll. L'Arpenteur, 2002), pp. 208-214. On peut y lire (p. 210) : «L'art d'aujourd'hui est en très grande partie imagination, c'est-à-dire contamination chaotique d'éléments et de plans. Tout cela, naturellement, s'oppose à la justice (dont l'art d'aujourd'hui ne se préoccupe d'ailleurs pas). Si l'attention est attente, acceptation fervente et impavide du réel, l'imagination est impatience, fuite dans l'arbitraire : éternel labyrinthe sans fil d'Ariane. C'est pourquoi l'art antique est synthétique, l'art moderne analytique; il donne la préséance à la pure décomposition comme il sied à une époque nourrie de terreur.»
Il n'y a pas de chapitre, dans le petit et truculent livre de Lodoli, consacré aux revues. Quel dommage, tant celles-ci me paraissent constituer, à l'heure même où des blogs comme le nôtre cumulent tous les avantages d'une revue sans connaître ses nombreux défauts et lourdeurs, un laboratoire où la littérature se cherche, s'épanouit et, il faut le dire, disparaît aussi rapidement qu'elle est née, qu'il s'agisse de ses perles en croissance (puisque, bien souvent, les textes parus en revues seront repris par leurs auteurs en volume) ou de quelques dés à coudre de cendres, dont nul ne gardera la mémoire, pas même le philologue érudit de Lodoli. Ma carrière littéraire, comme disent les gommeux, est toute jeune et pourtant, combien de revues auxquelles j'ai participé existent encore ? Certes, la très belle revue Nunc continue, tant bien que mal, à paraître mais Cancer! n'est plus, comme Esprits Libres, Les Brandes, La Sœur de l'Ange sombrant pour sa part dans l'insignifiance conceptualo-gauchiste depuis qu'elle est éditée par Le Grand Souffle, un éditeur lui-même moribond selon toute vraisemblance. Immédiatement est devenu une feuille royaliste distribuée exclusivement à la sortie des messes ou des Procure, Contrelittérature, la revue d'Alain Santacreu que Matthieu Baumier et Jacques de Guillebon ont rejoint paraît avoir amorcé une étrange et ésotériste métamorphose qui va la conduire jusqu'au cœur paraît-il de la symbolique chrétienne et Tsimtsoûm, du fantasque Bruno Deniel-Laurent, n'aura même pas dépassé sa première livraison, ce qui est tout de même assez rare, y compris dans l'univers labile des revues. Quoi d'autre ? Ah oui, Impur dirigée par Laurent Schang aimant les tanks camouflés et les petites Japonaises vicieuses, qui ne dépassera probablement pas trois numéros... Il faut donc saluer l'initiative du courageux Antonio Werli, maître d'œuvre de Cyclocosmia, dont le dossier du tout premier numéro (à la réalisation superbe), il fallait s'en douter venant d'un membre du FFC, est consacré à Thomas Pynchon. Comme tout dossier, celui-ci est inégal, les bons articles et les très mauvais, voire franchement insignifiants, se partageant, miraculeusement, selon la même ligne de crête évoquée en note 5...Une dernière remarque, moins futile qu'il n'y paraît : Cyclocosmia se veut une revue d'invention et d'observation. Regardons autour de nous : l'invention (comme pour la revue Conférence, la partie la plus inutile de Cyclocosmia) il n'y a que cela, dans une France qui se veut littéraire, inventive donc et qui n'est plus que bavarde, c'est-à-dire ressassant ses souvenirs comme un vieillard, des centaines de revues qui inventent ou prétendent inventer de nouvelles formes de littérature, alors que toutes les formes existent depuis les premiers textes bibliques, peut-être même, mais les plus savants de mes lecteurs contesteront ce point, depuis les premières traces déposées sur les parois rocheuses des cavernes profondes. Je conseillerai donc à Antonio Werli d'ajouter à ces deux qualités une troisième (ou alors, de remplacer l'observation, un peu trop froide, par), l'attention, vertu que Cristina Campo, dans un texte remarquable (6), oppose justement à la trop commune et vantée invention, cette tarte à la crème rancie faisant les maigres délices de tous les avant-gardistes.Notes(1) Assez peu connu en France, Marco Lodoli, né en 1956 à Rome où il réside encore est l'auteur de plusieurs romans publiés aux éditions P.O.L comme Chronique d'un siècle qui s'enfuit (1987, prix Viareggio de la première œuvre), Le Clocher brun (1991), Les Fainéants (1992) et enfin Courir, mourir (1994). I Fiori (édité par Einaudi), que d'aucuns considèrent comme son ouvrage le plus abouti, n'a toujours pas été traduit en français. La Fosse aux Ours doit faire paraître en février 2009 un ouvrage intitulé Île, guide vagabond de Rome.(2) Extrait de L'infini recueilli dans Canti avec un choix des Œuvres morales (traductions de F.-A. Aulard, Juliette Bertrand, Philippe Jaccottet et Georges Nicole, présentation de Jean-Michel Gardair, Gallimard, coll. Poésie, 1982), p. 68.(3) Délicieusement borgésienne est cette autre nouvelle, intitulée Le correcteur, où Lodoli écrit : «Durant son dernier mois de travail dans la maison d’édition, Fantin fut implacable. Par exemple il corrigea le mot «labyrinthe», utilisé par le jeune auteur d’un essai. Il le récrivit correctement sur le bord blanc : «labyrinthe». Le rédacteur en chef convoqua Fantino dans son bureau et exigea une explication. Selon cet homme, qui se considérait expérimenté et attentif, le mot était exactement le même. Fantino resta bouche bée de tant de superficialité : était-il possible que le rédacteur en chef ne voie pas la différence, qu’il ne comprenne pas à quel point la correction était exacte et inévitable ? Soyez attentif au cœur du mot, ne vous arrêtez pas aux apparences…», in op. cit., p. 51.(4) Il commanda une bouteille de vin rouge très côté et la but au goulot, op. cit., p. 50.(5) Trois membres du FFC sont tout de même à signaler, tant ils volent au-dessus de leurs calamiteux collègues, non seulement par certaines de leurs analyses sur des titres de littérature étrangère mais, aussi, j'allais dire surtout, par une culture littéraire qui leur fait supposer, à raison, qu'un Pynchon, un Vollmann, un Gaddis, un Gass ou un DeLillo ne sont point apparus comme par génération spontanée. La critique littéraire, du moins lorsqu'elle est pratiquée avec un peu de sérieux, est avant tout un art d'établir des correspondances et, surtourt, de savoir remonter un fleuve jusqu'à son amont, sans avoir peur de se noyer dans une vaguelette se fondant dans la mer indifférenciée : il s'agit de François Monti, Antonio Werli et de Bartleby, lesquels ne se contentent pas, leur petite gueule rose de chiots littéraires ouverte et la queue frétillante, de rendre humidement compte, pardon, de s'extasier, sans la plus petite distance que l'on souhaiterait vaguement objective, sur chacune des traductions de Claro mais, du moins dans leurs meilleurs textes, critiquent véritablement.(6) Dans un texte intitulé Attention et poésie recueilli dans le splendide recueil que constitue Les impardonnables (Gallimard, coll. L'Arpenteur, 2002), pp. 208-214. On peut y lire (p. 210) : «L'art d'aujourd'hui est en très grande partie imagination, c'est-à-dire contamination chaotique d'éléments et de plans. Tout cela, naturellement, s'oppose à la justice (dont l'art d'aujourd'hui ne se préoccupe d'ailleurs pas). Si l'attention est attente, acceptation fervente et impavide du réel, l'imagination est impatience, fuite dans l'arbitraire : éternel labyrinthe sans fil d'Ariane. C'est pourquoi l'art antique est synthétique, l'art moderne analytique; il donne la préséance à la pure décomposition comme il sied à une époque nourrie de terreur.»
04/12/2008 | Lien permanent
Hélas Nabe !

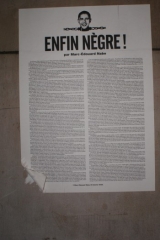 «Pour en arriver à élire un Noir, c'est que les Yankees étaient à bout… Obama n'a pas été élu parce qu'il est noir, mais parce que les Blancs au pouvoir ont compris qu'en mettant un Noir devant, l'Amérique allait pouvoir revenir au 1er rang en effaçant ses saloperies. Son image était tellement noircie par ses crimes qu'il fallait bien un Noir pour la nettoyer. Obama blanchit l'Amérique.»Marc-Édouard Nabe, extrait d'Enfin nègre !, 20 janvier 2009.«Celui qui lance une grêle de paroles ne peut que s’attendre à recevoir en échange une grêle de pierres…»Du même, Alain Zannini (éditions du Rocher, 2002), p. 712.L'un des signes les plus incontestables que la puissance de feu de Marc-Édouard Nabe, naguère crainte bien que très surestimée par les demi-mondaines jeunes et moins jeunes de Saint-Germain-des-Prés, n'est maintenant plus qu'un pétard mouillé, est le visible empressement avec lequel Philippe Sollers, petit timonier des lettres françaises, s'est dépêché d'embarquer, sur sa canonnière déglinguée remontant le cours d'un Yang-Tse de banalités, le turbulent et inoffensif pirate d'eau saumâtre, reprenant, pour lancer d'inoffensives boules puantes sur la Rive gauche, les thèses les plus explosives que Nabe expose dans son dernier tract, Enfin nègre !, placardé sur tous les bons murs de la capitale, ici photographié par les soins d'un des courageux admirateurs de l'écrivain.La légende forcément noire illustrant cette photographie mentionne qu'elle a été prise, au péril de la vie de l'intrépide apôtre, dans les discrètes toilettes publiques se trouvant à quelques dizaines de mètres seulement du Flore, duquel le christique Marc-Édouard, ayant écrit sa philippique contre l'antéchristique Obama (en tant que représentant de l'Empire; j'évoquerai ce point dans une prochaine note consacrée à La Visite du tribun de David Jones), venait de sortir après une légère collation, que l'on devine toute animée du souffle ayant porté les saints martyrs du christianisme le plus pur vers leur glorieuse persécution.Dans les deux cas, il s'agit d'ériger l'Unique réclamé par Kierkegaard contre le Système, l'Empire n'est-ce pas mais, alors que les premiers chrétiens n'hésitaient pas à être embrasés pour amuser les banquets nocturnes des belles dames romaines, les défenseurs de Nabe, eux, organisent des expéditions virtuelles d'agit-prop où il s'agit, en donnant de Nabe et de ses zélateurs une pitoyable image de Bonobos en rut perpétuel lâchés dans un temple de vestales, certes de convertir de force, y compris par le rapt et le viol des consciences, tout ennemi déclaré ou caché de la Sainte Cause mais encore d'ériger (l'érection, c'est le mot essentiel, ça, c'est capital, personne ne l'avait vu(e), écrirait Philippe Sollers dans son inimitable prosodie) d'un phallus géant à la gloire du petit Marc-Édouard.De ce tract la lecture est aisée quoique sans le moindre plaisir et l'exégèse simplifiée substantiellement par les bons soins de l'auteur lui-même qui paraît avoir décidé, en se voulant parfaitement transparent, d'être ridiculement plat, donc tout ce que l'on voudra (un colleur d'affichettes par procuration, un polémiste au rabais, pas même digne de fermer le clapet malodorant de Gérard Miller lorsque ce dernier cite quelques-une des phrases de l'auteur, extraites de l'inoffensif Régal des vermines, un adepte involontaire de la gratuité par ces temps difficiles, etc.), tout ce que l'on voudra sauf un écrivain digne de ce nom, lequel, selon le bon mot de Cioran, ne répugne à rien tant qu'à l'explication de texte, est riche et fascinant de ses ambiguïtés mêmes. Voici don la thèse, étirée trop longuement dans Enfin nègre !, résumable en une seule ligne d'une éloquente platitude, alors même que je ne désire pourtant pas refaire le monde (1) : Barack Obama, pas vraiment Noir mais encore Nègre sans le savoir, Nègre insouciant donc, peut-être même Blanc véritable puisqu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour donner à ses anciens maîtres de solides gages de loyauté, a été et reste, bien qu'il ait été porté au plus haut poste de pouvoir des États-Unis, le candidat des petits Blancs américains et plus largement occidentaux. Monarque de l'Occident, Barack Obama continuera donc de faire ce que ses prédécesseurs (et maîtres) ont fait : humilier l'Orient, le vieil Orient déchu sous la sentence irrémédiable de la ruine impérialiste que le nouvel Orient, l'homme-Christ Jésus, disons, ici, Marc-Édouard Nabe, a fécondé de la rosée de son sang (ces mots que je cite de mémoire, bien évidemment réduits et transposés pour notre parodique sujet, constituent les toutes premières lignes du célèbre Malleus Maleficarum de Sprenger et Institoris).Si Obama n'est qu'un Noir honteux, c'est donc qu'il est le candidat heureux et rayonnant, parce qu'élu, du racisme ordinaire qui, consacrant le paltoquet le plus anodin puisque le plus consensuel, joue son unique gambit qui semble pourtant systématiquement gagner toutes les parties entreprises contre les pauvres pions que nous sommes. Ce gambit a même un nom qui n'a de réalité que par celle qu'un nom contraire lui accorde péniblement : l'antiracisme.Est-ce tout de cette thèse médusante ? Oui, c'est absolument tout et je vous mets au défi de trouver, dans le dernier placard nabien, hormis encore quelques maigres trouvailles de potache zélé, une idée qui dépasserait de l'épaisseur d'un seul cheveu ce paradoxe qui n'en est même pas un : c'est parce que Barack Obama n'est pas un vrai Noir qu'il n'est même pas un vrai Blanc et c'est donc parce que son statut est indéfinissable, à la fois Noir récalcitrant et Blanc pas complètement affirmé, disons pâle, qu'il n'est même pas antiraciste éploré ou raciste éhonté mais, en tant que consécration démocratique (et encore, on ne la fait pas à Nabe, la blague de la démocratie !) issue, platement, moyennement, du règne de la moyenne absolue qu'est la société nord-américaine, que Barack Obama, pour le dire en termes nabiens, est le vecteur le plus visible de l'incapacité occidentale d'érection, de coup de foutre, donc vie truquée, inutile, impuissante, honteuse dans son incapacité à jouir.Déchet pas même politique mais rebut issu des milieux affairistes qui l'ont élu. Peut-être même, l'avenir nous le dira, zélé continuateur de George W. Bush, d'autant plus décomplexé que la plus grande puissance du monde, avec désormais, pour la diriger, un Noir, aura les coudées franches.On me rétorquera que Marc-Édouard Nabe est un écrivain, un vrai et que cette embarrassante notion d'idée, appliquée à un écrivain, un vrai, est toujours aisément réductible à la philosophie d'un Florian Zeller qui aurait bu, un matin, allez savoir par quelle sombre malchance, un petit bol de lait hégélien où flotteraient quelques miettes de pain bourdieusiennes. Nabe d'ailleurs est à ce point un véritable écrivain que son texte est uniquement tendu entre deux pôles pas si contraires que cela, le blanc et le noir, le Président des États-Unis, finalement gris, n'étant que la commode navette faisant l'aller-retour convenu et décidé par les patrons entre ces faux zénith et nadir, le Blanc et le Noir, le Noir et le Blanc ou, pour le dire plus artistement, donc comme le fait Nabe pour masquer l'indigence de sa découverte, entre racisme triomphant puisque retourné et simulacre de tolérance, d'antiracisme d'apparence et de vrai-faux bonheur, d'intolérance elle-même irréelle, à moins que toutes ces propositions ne soient parfaitement interchangeables, tant les catégories de pensée de l'écrivain, de même que son style que, dans le meilleur des cas, on peut dire vulgaire, paraissent floues.Marc-Édouard Nabe qui, selon une légende bien évidemment apocryphe, serait l'héritier le plus digne ou plutôt, le moins indigne de Léon Bloy, est pourtant parfaitement incapable de se hisser, avec ce tract comme avec ceux qui l'ont précédé et, hélas, le suivront, au niveau de la plus anodine des exégèses que le Mendiant ingrat eût donné dans son Journal (il l'a sans doute d'ailleurs fait mais je n'ai pas mes notes sous les yeux...), on l'imagine sans peine, d'un événement de moindre importance que celle de cette fausse bonne nouvelle tel que la presse de son époque eût pu le relater. Événement effectivement insignifiant, dont la signification profonde, en fait, serait cachée aux yeux des mortels et encore plus de ces taupes pressées que sont les journalistes. Événement déchiffré par les yeux apotropéens de Léon Bloy et par ceux, de myope, collés aux lignes péniblement répétées et traduites en une logomachie répétitive, de Marc-Édouard Nabe.Bien pire, c'est l'indigence de l'écriture de pareil texte, la monotonie poussive des images attirées facilement par des tropismes infantiles, les antiennes convenues (la haine du capitalisme et de son corollaire, l'impérialisme férocement blanc, l'antisémitisme obsessionnel, la certitude que la politique n'est rien, et que l'art, du moins le jazz, est tout...) qui risque de faire tomber le très peu bloyen Marc-Édouard Nabe dans la rigole sale où barbote le Bourgeois, ici éreinté par Bloy écrivant : «Le répertoire des locutions patrimoniales qui lui suffisent est extrêmement exigu et ne va guère au-delà de quelques centaines. Ah ! Si on était assez béni pour lui ravir cet humble trésor, un paradisiaque silence tomberait aussitôt sur notre globe consolé !» (2).Le répertoire de Nabe, lui, remarquons-le, est de seulement quelques dizaines de ces locutions mais, comme elles ont été puisées, selon les plus subtils des docteurs traquant la moindre référence biblique dans les textes de cet auteur, dans les fulgurances de l'apôtre Paul...C'est dire que le langage du Bourgeois lui-même, cette langue souveraine et secrète des lieux communs (3) pourtant signe des dieux dans sa mystérieuse impassibilité, son omnipotence spéculaire, est affligé d'un transmissible (o)nanisme qui en aura raboté jusqu'aux plus communes aspérités. Finalement, Marc-Édouard Nabe n'est que l'Yvan Labejof de la littérature française : un artiste de cabaret dont le public, de plus en plus fanatique à mesure qu'il se réduit, finira par sombrer dans la solitude envieuse du comique interdit de plateaux de télévision. Finalement, l'écrivain qui se veut le plus libre de France, la victime la plus consentante de la servitude involontaire, est aussi le plus enchaîné, non pas, comme il le souhaiterait, à une croix mais à la branche pourrie d'un marronnier : pour exister, il est bien forcé d'attendre, comme n'importe lequel des crétins qu'il vomit (qu'il a raison de vomir, dois-je préciser), que les médias relatent, comme il leur semblera c'est-à-dire tout de même avec moins de bêtise qu'il ne le suggère en choisissant des exemples caricaturaux, l'événement sur lequel il tissera sa parabole afin que n'importe quel voyant voie et que n'importe quel entendant entende...Finalement, Marc-Édouard Nabe, dont la prose toute relative se relâche visiblement avec la publication, ces dernières années, de quelques textes qui nous paraissent inutiles, n'est peut-être rien de plus, pour retourner sa propre sentence martiale, qu'un bourgeois honteux, dont la seule croix est de n'avoir point souffert (4) : «Et le sang riche du Pauvre, c’est la langue. Ici, nous achoppons tous bras en croix, veines tranchées, rires jaunes… À peine l’échancrure pour laisser passer Céline : les autres ne rentrent pas, l’issue est trop petite, il faut être unicellulaire pour entrer dans ce palais : le Style… On sous-estime beaucoup Bloy. Bloy, c’est la prose absolue» (5).Notes(1) «Si on n’écrit pas dans l’intention de refaire le monde en une seule phrase, alors c’est pas la peine : autant rester «à sa place», dans le strapontin, bien au chaud dans le noir, anonyme…», affirme Marc-Édouard Nabe dans L'Impubliable, in Au régal des vermines [1985] (Le Dilettante, 2006), p. 9.(2) Exégèse des lieux communs (Première série), Œuvres de Léon Bloy (Mercure de France, t. VIII, 1983), p. 19.(3) «[...] la langue des Lieux Communs, la plus étonnante des langues, a cette particularité merveilleuse de dire toujours la même chose, comme celle des Prophètes», in Ibid., p. 37.(4) «Je suis cloué sur la croix de celui qui n’a jamais souffert», Nabe’s dream, Journal intime, 1 (éditions du Rocher, 1991), p. 36.(5) Notre-Dame de la pourriture in Au régal des vermines, op. cit., p. 122.
«Pour en arriver à élire un Noir, c'est que les Yankees étaient à bout… Obama n'a pas été élu parce qu'il est noir, mais parce que les Blancs au pouvoir ont compris qu'en mettant un Noir devant, l'Amérique allait pouvoir revenir au 1er rang en effaçant ses saloperies. Son image était tellement noircie par ses crimes qu'il fallait bien un Noir pour la nettoyer. Obama blanchit l'Amérique.»Marc-Édouard Nabe, extrait d'Enfin nègre !, 20 janvier 2009.«Celui qui lance une grêle de paroles ne peut que s’attendre à recevoir en échange une grêle de pierres…»Du même, Alain Zannini (éditions du Rocher, 2002), p. 712.L'un des signes les plus incontestables que la puissance de feu de Marc-Édouard Nabe, naguère crainte bien que très surestimée par les demi-mondaines jeunes et moins jeunes de Saint-Germain-des-Prés, n'est maintenant plus qu'un pétard mouillé, est le visible empressement avec lequel Philippe Sollers, petit timonier des lettres françaises, s'est dépêché d'embarquer, sur sa canonnière déglinguée remontant le cours d'un Yang-Tse de banalités, le turbulent et inoffensif pirate d'eau saumâtre, reprenant, pour lancer d'inoffensives boules puantes sur la Rive gauche, les thèses les plus explosives que Nabe expose dans son dernier tract, Enfin nègre !, placardé sur tous les bons murs de la capitale, ici photographié par les soins d'un des courageux admirateurs de l'écrivain.La légende forcément noire illustrant cette photographie mentionne qu'elle a été prise, au péril de la vie de l'intrépide apôtre, dans les discrètes toilettes publiques se trouvant à quelques dizaines de mètres seulement du Flore, duquel le christique Marc-Édouard, ayant écrit sa philippique contre l'antéchristique Obama (en tant que représentant de l'Empire; j'évoquerai ce point dans une prochaine note consacrée à La Visite du tribun de David Jones), venait de sortir après une légère collation, que l'on devine toute animée du souffle ayant porté les saints martyrs du christianisme le plus pur vers leur glorieuse persécution.Dans les deux cas, il s'agit d'ériger l'Unique réclamé par Kierkegaard contre le Système, l'Empire n'est-ce pas mais, alors que les premiers chrétiens n'hésitaient pas à être embrasés pour amuser les banquets nocturnes des belles dames romaines, les défenseurs de Nabe, eux, organisent des expéditions virtuelles d'agit-prop où il s'agit, en donnant de Nabe et de ses zélateurs une pitoyable image de Bonobos en rut perpétuel lâchés dans un temple de vestales, certes de convertir de force, y compris par le rapt et le viol des consciences, tout ennemi déclaré ou caché de la Sainte Cause mais encore d'ériger (l'érection, c'est le mot essentiel, ça, c'est capital, personne ne l'avait vu(e), écrirait Philippe Sollers dans son inimitable prosodie) d'un phallus géant à la gloire du petit Marc-Édouard.De ce tract la lecture est aisée quoique sans le moindre plaisir et l'exégèse simplifiée substantiellement par les bons soins de l'auteur lui-même qui paraît avoir décidé, en se voulant parfaitement transparent, d'être ridiculement plat, donc tout ce que l'on voudra (un colleur d'affichettes par procuration, un polémiste au rabais, pas même digne de fermer le clapet malodorant de Gérard Miller lorsque ce dernier cite quelques-une des phrases de l'auteur, extraites de l'inoffensif Régal des vermines, un adepte involontaire de la gratuité par ces temps difficiles, etc.), tout ce que l'on voudra sauf un écrivain digne de ce nom, lequel, selon le bon mot de Cioran, ne répugne à rien tant qu'à l'explication de texte, est riche et fascinant de ses ambiguïtés mêmes. Voici don la thèse, étirée trop longuement dans Enfin nègre !, résumable en une seule ligne d'une éloquente platitude, alors même que je ne désire pourtant pas refaire le monde (1) : Barack Obama, pas vraiment Noir mais encore Nègre sans le savoir, Nègre insouciant donc, peut-être même Blanc véritable puisqu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour donner à ses anciens maîtres de solides gages de loyauté, a été et reste, bien qu'il ait été porté au plus haut poste de pouvoir des États-Unis, le candidat des petits Blancs américains et plus largement occidentaux. Monarque de l'Occident, Barack Obama continuera donc de faire ce que ses prédécesseurs (et maîtres) ont fait : humilier l'Orient, le vieil Orient déchu sous la sentence irrémédiable de la ruine impérialiste que le nouvel Orient, l'homme-Christ Jésus, disons, ici, Marc-Édouard Nabe, a fécondé de la rosée de son sang (ces mots que je cite de mémoire, bien évidemment réduits et transposés pour notre parodique sujet, constituent les toutes premières lignes du célèbre Malleus Maleficarum de Sprenger et Institoris).Si Obama n'est qu'un Noir honteux, c'est donc qu'il est le candidat heureux et rayonnant, parce qu'élu, du racisme ordinaire qui, consacrant le paltoquet le plus anodin puisque le plus consensuel, joue son unique gambit qui semble pourtant systématiquement gagner toutes les parties entreprises contre les pauvres pions que nous sommes. Ce gambit a même un nom qui n'a de réalité que par celle qu'un nom contraire lui accorde péniblement : l'antiracisme.Est-ce tout de cette thèse médusante ? Oui, c'est absolument tout et je vous mets au défi de trouver, dans le dernier placard nabien, hormis encore quelques maigres trouvailles de potache zélé, une idée qui dépasserait de l'épaisseur d'un seul cheveu ce paradoxe qui n'en est même pas un : c'est parce que Barack Obama n'est pas un vrai Noir qu'il n'est même pas un vrai Blanc et c'est donc parce que son statut est indéfinissable, à la fois Noir récalcitrant et Blanc pas complètement affirmé, disons pâle, qu'il n'est même pas antiraciste éploré ou raciste éhonté mais, en tant que consécration démocratique (et encore, on ne la fait pas à Nabe, la blague de la démocratie !) issue, platement, moyennement, du règne de la moyenne absolue qu'est la société nord-américaine, que Barack Obama, pour le dire en termes nabiens, est le vecteur le plus visible de l'incapacité occidentale d'érection, de coup de foutre, donc vie truquée, inutile, impuissante, honteuse dans son incapacité à jouir.Déchet pas même politique mais rebut issu des milieux affairistes qui l'ont élu. Peut-être même, l'avenir nous le dira, zélé continuateur de George W. Bush, d'autant plus décomplexé que la plus grande puissance du monde, avec désormais, pour la diriger, un Noir, aura les coudées franches.On me rétorquera que Marc-Édouard Nabe est un écrivain, un vrai et que cette embarrassante notion d'idée, appliquée à un écrivain, un vrai, est toujours aisément réductible à la philosophie d'un Florian Zeller qui aurait bu, un matin, allez savoir par quelle sombre malchance, un petit bol de lait hégélien où flotteraient quelques miettes de pain bourdieusiennes. Nabe d'ailleurs est à ce point un véritable écrivain que son texte est uniquement tendu entre deux pôles pas si contraires que cela, le blanc et le noir, le Président des États-Unis, finalement gris, n'étant que la commode navette faisant l'aller-retour convenu et décidé par les patrons entre ces faux zénith et nadir, le Blanc et le Noir, le Noir et le Blanc ou, pour le dire plus artistement, donc comme le fait Nabe pour masquer l'indigence de sa découverte, entre racisme triomphant puisque retourné et simulacre de tolérance, d'antiracisme d'apparence et de vrai-faux bonheur, d'intolérance elle-même irréelle, à moins que toutes ces propositions ne soient parfaitement interchangeables, tant les catégories de pensée de l'écrivain, de même que son style que, dans le meilleur des cas, on peut dire vulgaire, paraissent floues.Marc-Édouard Nabe qui, selon une légende bien évidemment apocryphe, serait l'héritier le plus digne ou plutôt, le moins indigne de Léon Bloy, est pourtant parfaitement incapable de se hisser, avec ce tract comme avec ceux qui l'ont précédé et, hélas, le suivront, au niveau de la plus anodine des exégèses que le Mendiant ingrat eût donné dans son Journal (il l'a sans doute d'ailleurs fait mais je n'ai pas mes notes sous les yeux...), on l'imagine sans peine, d'un événement de moindre importance que celle de cette fausse bonne nouvelle tel que la presse de son époque eût pu le relater. Événement effectivement insignifiant, dont la signification profonde, en fait, serait cachée aux yeux des mortels et encore plus de ces taupes pressées que sont les journalistes. Événement déchiffré par les yeux apotropéens de Léon Bloy et par ceux, de myope, collés aux lignes péniblement répétées et traduites en une logomachie répétitive, de Marc-Édouard Nabe.Bien pire, c'est l'indigence de l'écriture de pareil texte, la monotonie poussive des images attirées facilement par des tropismes infantiles, les antiennes convenues (la haine du capitalisme et de son corollaire, l'impérialisme férocement blanc, l'antisémitisme obsessionnel, la certitude que la politique n'est rien, et que l'art, du moins le jazz, est tout...) qui risque de faire tomber le très peu bloyen Marc-Édouard Nabe dans la rigole sale où barbote le Bourgeois, ici éreinté par Bloy écrivant : «Le répertoire des locutions patrimoniales qui lui suffisent est extrêmement exigu et ne va guère au-delà de quelques centaines. Ah ! Si on était assez béni pour lui ravir cet humble trésor, un paradisiaque silence tomberait aussitôt sur notre globe consolé !» (2).Le répertoire de Nabe, lui, remarquons-le, est de seulement quelques dizaines de ces locutions mais, comme elles ont été puisées, selon les plus subtils des docteurs traquant la moindre référence biblique dans les textes de cet auteur, dans les fulgurances de l'apôtre Paul...C'est dire que le langage du Bourgeois lui-même, cette langue souveraine et secrète des lieux communs (3) pourtant signe des dieux dans sa mystérieuse impassibilité, son omnipotence spéculaire, est affligé d'un transmissible (o)nanisme qui en aura raboté jusqu'aux plus communes aspérités. Finalement, Marc-Édouard Nabe n'est que l'Yvan Labejof de la littérature française : un artiste de cabaret dont le public, de plus en plus fanatique à mesure qu'il se réduit, finira par sombrer dans la solitude envieuse du comique interdit de plateaux de télévision. Finalement, l'écrivain qui se veut le plus libre de France, la victime la plus consentante de la servitude involontaire, est aussi le plus enchaîné, non pas, comme il le souhaiterait, à une croix mais à la branche pourrie d'un marronnier : pour exister, il est bien forcé d'attendre, comme n'importe lequel des crétins qu'il vomit (qu'il a raison de vomir, dois-je préciser), que les médias relatent, comme il leur semblera c'est-à-dire tout de même avec moins de bêtise qu'il ne le suggère en choisissant des exemples caricaturaux, l'événement sur lequel il tissera sa parabole afin que n'importe quel voyant voie et que n'importe quel entendant entende...Finalement, Marc-Édouard Nabe, dont la prose toute relative se relâche visiblement avec la publication, ces dernières années, de quelques textes qui nous paraissent inutiles, n'est peut-être rien de plus, pour retourner sa propre sentence martiale, qu'un bourgeois honteux, dont la seule croix est de n'avoir point souffert (4) : «Et le sang riche du Pauvre, c’est la langue. Ici, nous achoppons tous bras en croix, veines tranchées, rires jaunes… À peine l’échancrure pour laisser passer Céline : les autres ne rentrent pas, l’issue est trop petite, il faut être unicellulaire pour entrer dans ce palais : le Style… On sous-estime beaucoup Bloy. Bloy, c’est la prose absolue» (5).Notes(1) «Si on n’écrit pas dans l’intention de refaire le monde en une seule phrase, alors c’est pas la peine : autant rester «à sa place», dans le strapontin, bien au chaud dans le noir, anonyme…», affirme Marc-Édouard Nabe dans L'Impubliable, in Au régal des vermines [1985] (Le Dilettante, 2006), p. 9.(2) Exégèse des lieux communs (Première série), Œuvres de Léon Bloy (Mercure de France, t. VIII, 1983), p. 19.(3) «[...] la langue des Lieux Communs, la plus étonnante des langues, a cette particularité merveilleuse de dire toujours la même chose, comme celle des Prophètes», in Ibid., p. 37.(4) «Je suis cloué sur la croix de celui qui n’a jamais souffert», Nabe’s dream, Journal intime, 1 (éditions du Rocher, 1991), p. 36.(5) Notre-Dame de la pourriture in Au régal des vermines, op. cit., p. 122.
05/02/2009 | Lien permanent
La revue Cancer ! est-elle immortelle ?

05/04/2004 | Lien permanent
La boulangère de Monceau et La carrière de Suzanne d’Éric Rohmer, par Francis Moury

11/01/2010 | Lien permanent
Au-delà de l'effondrement, 58 : La Vérité avant-dernière de Philip K. Dick

 L'effondrement de la Zone.
L'effondrement de la Zone.Qu'il est plaisant de relire, après plus de 30 années, l'un des meilleurs romans de Philip K. Dick, initialement paru en 1966, dans une édition qui, si elle n'a absolument pas été débarrassée de ses fautes (trop nombreuses, dûment relevées sur mon exemplaire), bénéficie au moins d'une belle première de couverture, effort graphique notable concernant d'ailleurs tous les romans de l'Américain édités par J'Ai Lu. Enfin, quelque éditeur français s'avise, à l'instar des éditeurs anglo-saxons qui le savent depuis des lustres, qu'un livre est beaucoup de choses mais, en premier lieu, un objet !
S'il n'est pas aussi maîtrisé que le remarquable Maître du Haut Château, ce roman n'en est pas moins intéressant, tant il condense les interrogations habituelles de l'auteur, autour de trois thématiques principales que sont les distorsions temporelles, la perception d'une réalité truquée et mensongère, grand classique dickien, et enfin la révolte contre le règne de l'imposture généralisée.
 Nicolas Saint-James est le président de «l'abri souterrain communautaire antimicrobien Tom Mix, ouvert en l'an 1 de la Troisième Guerre mondiale, soit en juin 2010, de longues, longues années auparavant» (1) et, comme des millions d'autres réfugiés terrés sous terre, il est persuadé que la surface de la planète n'est qu'un immense champ de ruines, balayées par de pestilentielles maladies qu'il s'agit d'éviter à tout prix. Le seul lien unissant ces populations à ce qu'elles pensent être le monde dévasté par la guerre tient aux nouvelles télévisées que Talbot Yancy, leur dirigeant, surnommé le Protecteur, leur fournit régulièrement : nous sommes toujours en guerre, leur dit-il, contre les ennemis de l'Est, la surface de la Terre est encore plus polluée, par les maladies et les radiations, qu'elle ne l'était voici quelques années, et nous avons besoin que vous continuiez, dans vos abris, à travailler d'arrache-pied pour nous fournir les robots-soldats dont nous avons besoin pour continuer de livrer bataille à un ennemi, le Pacif-Pop, qui n'hésite pas à raser des villes entières de la carte, images à l'appui, que je vous invite du reste à regarder.
Nicolas Saint-James est le président de «l'abri souterrain communautaire antimicrobien Tom Mix, ouvert en l'an 1 de la Troisième Guerre mondiale, soit en juin 2010, de longues, longues années auparavant» (1) et, comme des millions d'autres réfugiés terrés sous terre, il est persuadé que la surface de la planète n'est qu'un immense champ de ruines, balayées par de pestilentielles maladies qu'il s'agit d'éviter à tout prix. Le seul lien unissant ces populations à ce qu'elles pensent être le monde dévasté par la guerre tient aux nouvelles télévisées que Talbot Yancy, leur dirigeant, surnommé le Protecteur, leur fournit régulièrement : nous sommes toujours en guerre, leur dit-il, contre les ennemis de l'Est, la surface de la Terre est encore plus polluée, par les maladies et les radiations, qu'elle ne l'était voici quelques années, et nous avons besoin que vous continuiez, dans vos abris, à travailler d'arrache-pied pour nous fournir les robots-soldats dont nous avons besoin pour continuer de livrer bataille à un ennemi, le Pacif-Pop, qui n'hésite pas à raser des villes entières de la carte, images à l'appui, que je vous invite du reste à regarder. Nos réfugiés, parqués comme des rats, ne savent pas que ces images sont fausses, tout comme les discours de leur dirigeant, le Protecteur Talbot Yancy qui n'est qu'un robot (mais aussi, complication quelque peu inutile, l'un des personnages réels du roman, par le biais d'un artifice temporel peu convaincant), et que la surface terrestre a eu le temps de reverdir, et qu'elle est désormais partagée en d'immenses propriétés (cf. p. 148) où une toute petite poignée de privilégiés vivent à l'abri du besoin, protégés par ces mêmes robots que fabriquent sans relâche les habitants du sous-sol.
Nos réfugiés, parqués comme des rats, ne savent pas que ces images sont fausses, tout comme les discours de leur dirigeant, le Protecteur Talbot Yancy qui n'est qu'un robot (mais aussi, complication quelque peu inutile, l'un des personnages réels du roman, par le biais d'un artifice temporel peu convaincant), et que la surface terrestre a eu le temps de reverdir, et qu'elle est désormais partagée en d'immenses propriétés (cf. p. 148) où une toute petite poignée de privilégiés vivent à l'abri du besoin, protégés par ces mêmes robots que fabriquent sans relâche les habitants du sous-sol.Ajoutons qu'un certain Louis Runcible, l'homme qui loge les arrivants des abris souterrains «montés en surface en croyant y trouver la guerre, pour découvrir que celle-ci avait pris fin des années auparavant et que la superficie de la planète n'était qu'un immense parc» (p. 68), est en lutte ouverte contre le tout-puissant Stanton Brose, disposant pour sa solde personnelle d'une armée de robots et puisant sans aucun scrupule dans le stock rarissime d'organes de synthèse dont il se sert afin de prolonger son existence ventripotente et maléfique.
C'est sur cette trame d'irréalité ou de simulacres, assez classique chez Dick, et dont l'imposture semble toujours indiquée par quelque mystérieux élément extérieur venant perturber la quiétude d'une vie en apparence banale et tranquille (2), que se greffera la thématique des paradoxes temporels, à vrai dire superfétatoires dans ce roman, comme je l'ai dit, et qui ne saurait nous intéresser.
Il s'agira donc, bien sûr, une fois de plus, de tenter de dissiper les apparences, en sortant de la caverne où sont projetées de grandes ombres déformées de l'inaccessible réalité, en s'extrayant des souterrains, et en se dirigeant vers la surface, comme le fera Nicolas Saint-James, à la recherche d'une greffe organique pour l'un de ses amis qui se meurt. Ces apparences et faux-semblants ne peuvent qu'être assez clairement indiqués par la mention, dès les premières pages du roman, d'Alice au pays des merveilles, un livre devenu rarissime dans ces temps de guerre, mais moins rare quand même qu'un animal, pourquoi pas un écureuil, comme a cru en voir un Joseph Adams (cf. p. 12), alors que tous les animaux ont été exterminés.
Ces jeux entre la réalité et ce qui la double, à tous les sens de ce terme, sont directement mentionnés par ce syllogisme : «Tout ce que je dis est un mensonge. Donc je mens en prétendant mentir. Donc je dis bien la vérité en affirmant que je mens. Donc...» (p. 53), et ainsi de suite à l'infini, tandis que dans ce que nous pourrions appeler, goûtant le paradoxe de l'expression, «l'or factice véritable» (p. 54) se niche comme en un miroir déformant un univers labyrinthique sans commencement ni fin : «Et cet univers, réfléchissait-il, dont on pourrait croire qu'une fois la porte d'entrée franchie on puisse le traverser en deux minutes avant d'atteindre la sortie... cet univers, comme les monceaux d'accessoires dans les studios d'Eisenbludt [chargés de falsifier la réalité] à Moscou, était sans fin, il était composé d'une enfilade infinie de pièces : la sortie de chacun n'était que l'entrée de la suivante» (p. 55).
Comme toujours chez Dick, un mensonge en cache un autre, un enfer s'emboîte dans un autre, qui semblait pourtant paradisiaque, mais à bien y regarder, finalement... Ainsi, bien que la vie des réfugiés, dans leurs clapiers souterrains, soit immonde et abjecte, Philip K. Dick se garde bien d'affirmer que celle qui attend ceux qui parviennent à gagner la surface serait meilleure. Rien n'est moins sûr ! Ils sont en effet parqués dans les conapts, sortes d'immenses immeubles tout de même confortables, construits par Runcible : «les «hôtes» de Runcible sont en fait des prisonniers, et les conapts constituent des réserves» ou, ajoute immédiatement l'un des personnages, «pour employer un mot plus moderne, des camps de concentration» (p. 68, l'auteur souligne).
Nous savons quelle fascination le nazisme a exercé, en tant que romancier, sur Dick qui, quelques pages plus loin, évoque le fait que les nazis «n'avaient pas d'ordres écrits concernant la solution finale, le génocide des juifs. Tout se passait oralement, de supérieur à subordonné, de bouche à oreille» (p. 73), alors que les principaux personnages sont en train de mettre au point un plan machiavélique destiné à perdre Runcible, cet idéaliste qui veut faire remonter à la surface de la planète des centaines de millions de femmes et d'hommes enfermés durant des années sous terre. C'est une perspective tout à fait impossible pour Stanton Brose, l'un de ceux qui jouit du pouvoir : «Qu'est-ce qui se passerait si la terre s'entrouvrait pour laisser sortir ces millions d'humains emprisonnés quinze ans sous la surface, jusqu'alors persuadés qu'une guerre faisait rage à l'air libre, que la planète entière était un champ de bataille couvert de décombres, ravagé par les missiles et les bactéries ? Le système des domaines subirait un coup mortel, et l'immense parc qu'il survolait deux fois par jour redeviendrait une zone densément habitée, pas tout à fait autant qu'avant-guerre, mais il s'en faudrait de peu. Les routes referaient leur apparition. Ainsi que les villes. Et, en fin de compte, une autre guerre éclaterait» (p. 75, l'auteur souligne).
Décrire la situation des habitants privés de surface amène Dick à évoquer les «Nibelungen, les nains au fond des mines» mais aussi, via un discours de Talbot Yancy, une parabole (cf. p. 91 pour ces deux références) censée apporter quelque consolation à celles et ceux qui écoutent la «matière verbale» du Protecteur, unique lien avec la surface censée être dévastée. Il est à noter que c'est Lantano qui a composé le discours que le robot Yancy sera chargé de prononcer, ce même Lantano qui assume le rôle de l'auteur de La Sauterelle pèse lourd dans Le Maître du Haut Château, même si le pouvoir qu'il détient semble infiniment plus dangereux et trouble voire mortel (cf. p. 113) que celui du tout-puissant Stanton Brose : c'est lui qui dit la vérité aux captifs, qui leur apprend que l'univers dans lequel ils vivent depuis des années est truqué, mais il possède pourtant la faculté de se déplacer dans le temps, et est même la source de plus d'une distorsion dans la réalité historique, ayant assumé plusieurs fois, comme il l'apprendra à l'un des personnages, des rôles de chefs et de dirigeants, apparaissant sur des films de propagande où Dick s'amuse, à partir d'une situation bien réelle, à la saturer de mensonges (cf. p. 108). En d'autres termes, David Lantano est le représentant d'une puissance occulte, que Dick a toujours figurée avec crainte, et qui n'est autre que le temps, ou bien, alors, la volonté insoupçonnable, mystérieuse, qui s'y cache et s'amuse avec les hommes. Nous apprendrons même que la marionnette Talbot Yancy n'est autre que... le double de Lantano, ce dernier lui ayant prêté ses traits, puisqu'il était l'acteur d'un des films de propagande qui a éduqué des millions de réfugiés ! De fait, il est clair qu'un «personnage supplémentaire, que ni moi [Foote], ni Runcible ni Brose n'envisageons, est descendu dans l'arène afin de s'immiscer dans la lutte pour le pouvoir» (p. 185, l'auteur souligne), et ce personnage n'est autre que Lantano.
Dick résume ces jeux constants avec la réalité historique et la vérité, qui n'est jamais celle que l'on croit, par cette formule ironique mais probablement, en réalité, désespérée : «Quand nous passons notre temps à fabriquer des mensonges, nous sommes fatalement voués, un jour ou l'autre, à faire des bourdes» (p. 112), tout comme Dick lui-même d'ailleurs, lorsqu'il semble par exemple oublier que l'un de ses personnages, Joseph Adams, est marié, alors qu'il ne manifeste qu'une seule hâte : se réfugier, mais sans sa femme, dans un abri souterrain pour échapper à la menace qui pèse sur lui, ou bien lorsqu'il greffe, sur l'habituelle trame d'une réalité fausse, des distorsions temporelles et des jeux improbables d'identités, qui embrouillent le récit, sans réelle ni profonde utilité.
La force de ce roman n'en est pas moins réelle, ne serait-ce que par sa description d'une vie réduite, parquée, cachée, coupée de la réalité prétendûment luxuriante et qui n'est qu'un leurre, une vie falsifiée par le seul pouvoir d'une immense et constante manipulation médiatique. La critique est imparable et, plus d'un demi-siècle après la parution de ce roman, nous ne pouvons que saluer le génie visionnaire de l'auteur qui, stigmatisant les travers de notre époque, semble avoir vu la nôtre bien mieux que tant de romanciers contemporains qui, après tout, profitent de l'imposture bien davantage qu'ils ne la dénoncent. En effet, en quelques mots résumée, l'histoire de L'avant-dernière vérité est d'une simplicité biblique (la Bible, souvent citée dans ce roman, notons-le) et rejoint celle d'Ubik dans sa dessillante violence (Je suis vivant et vous êtes morts) : Nul homme n'est jamais libre, et le moins libre de tous les hommes est encore celui qui à tout prix veut briser ses chaînes, et ce ne sont pas les derniers mots, inquiétants, du roman qui pourraient nous laisser espérer quelque libération définitive.
Notes
Philip K. Dick, La Vérité avant-dernière (traduction d'Alain Dorémieux, éditions Robert Laffont, 1974, puis J'ai Lu, 2014), p. 46.
(2) C'est Louis Runcible qui sera soupçonné, un temps, d'envoyer aux réfugiés souterrains d'étranges messages les avertissant que la réalité à laquelle ils croient depuis des années est en réalité une immense mascarade (cf. pp. 69 et 74), avant que nous n'apprenions que c'est en fait l'un des personnages centraux, David Lantano, qui est l'auteur de ces messages. Quoi qu'il en soit, ce dernier joue le rôle assumé, dans Le Maître du Haut Château, par l'auteur de La Sauterelle pèse lourd, qui révèle aux différents personnages que le monde dans lequel ils vivent n'est pas le vrai.
27/09/2015 | Lien permanent
Qu’avons-nous fait de Marc-Édouard Nabe ?, par Guillaume Sire

 Aux rats des pâquerettes : quand Netchaïev voit rouge, Marc-Édouard Nabe rit jaune.
Aux rats des pâquerettes : quand Netchaïev voit rouge, Marc-Édouard Nabe rit jaune.Nabe est un écrivain majeur. Au régal des vermines, son premier livre, publié en 1985 aux éditions Barrault, a donné le ton à une œuvre magistrale. Et puis celle-ci a été gâchée, piétinée, j’expliquerai ici pourquoi et comment.
Clarifions tout de suite les idées de ceux d’entre vous qui en seraient restés au «Nabe antisémite» après avoir vu (et mal regardé) son fameux passage sur le plateau de l’émission Apostrophe. Si le Régal a été mal compris c’est parce qu’en 1985 on ne savait déjà presque plus lire. La manière dont les critiques s’y prennent pour juger ce livre reviendrait à traiter de salaud un réalisateur qui se serait attribué le rôle d’Hitler dans son propre film. En écrivant le Régal, Nabe avait pourtant un projet artistique clair et, somme toute, assez facile à comprendre. Son idée consistait à pousser la subjectivité sadique jusqu’au bout (le sadisme étant la part d’ombre des Lumières et, donc, de la modernité), pour emmener «je» aux confins de la haine des autres, et voir si là-bas, au bout du délire existentialiste, il serait encore un autre, ou si enfin «je» serait devenu «moi-même». Et dans ce cas, ange ou bête ? Cette idée géniale aurait dû rassembler autour d’elle tous les lecteurs dotés d’un peu de jugeote. Hélas, en 1985, ils commençaient à manquer cruellement.
Constatant à quel point ce projet, si simple à comprendre, était incompris, Nabe aurait pu s’arrêter là. Il aurait pu s’en tenir à ses portraits, ses dessins humoristiques et sa guitare, et ne plus jamais écrire un livre. Il en a écrit, pourtant, et avec quel talent, et avec quelle générosité ! Qui n’a pas lu Le Bonheur, L’âge du Christ, Lucette, Je suis Mort, les quatre tomes du journal intime et Alain Zannini, ne peut savoir de quoi je parle. Quant à ceux qui les ont lus il leur sera difficile d’attaquer d’une part le style de chacun de ces ouvrages, d’autre part la cohérence de ces publications successives, sans avouer, au moins du bout des lèvres, qu’il y a là un projet artistique, une œuvre véritable, comme on en compte peu dans un siècle.
Nabe est également un lecteur, dont l’œuvre hagiographique et exégétique a projeté une lumière nouvelle sur le mystère de plusieurs grands artistes du vingtième siècle. Quel lecteur, quel universitaire, quel lettré pourra nier le fait que ce qui est écrit dans le recueil Oui à propos de Lautréamont, de Bernanos, de Claudel, de Suarès, etc., est d’une justesse rare et d’une originalité édifiante ? Ceux qui ne l’ont jamais fait n’auront qu’à écouter Nabe évoquer Artaud ou Céline pour se demander comment il est possible aujourd’hui dans nos universités de faire l’économie de tels commentaires !
Pour conclure ce rapide panorama, quelques mots à propos du jazz. Quel écrivain a réussi à intégrer le jazz dans la littérature contemporaine, sinon Marc-Édouard Nabe ? Quand ils s’y risquent les autres à part lui écrivent à côté du jazz, ils sont sages, ils sont verbeux, ils sont anti-swing. Leur littérature a l’air de dire : «vous voyez, les livres, c’est de la merde, parce que les livres sont moralisateurs, condamnés au commentaire, à la pédagogie, à la grammaire chiante et à la fiction débile, ils n’ont aucun pouvoir magique, alors un petit conseil : écoutez de la musique au lieu de perdre votre temps». On dirait des livres écrits pour qu’on les referme. Un aveu d’impuissance. Nabe est le seul poète, à ma connaissance, à avoir évoqué le jazz sans aussitôt l’avoir trahi. Il fallait écrire cru, craquant, claquant, en paquets d’eau et de sable balancés sur la charlest ! Idem pour la boxe : Nabe a inventé la phrase uppercut, réussissant grâce à elle à dire la sueur, le jeu de jambes et les gros yeux noirs au beurre sans tout de suite avoir l’air d’un vendeur de tickets ou d’un journaliste sportif.
Nabe est un artiste, donc, cela ne fait aucun doute. Mais qu’est-ce au juste qu’un artiste ? Un artiste n’est ni un chef ni un saint. Il est l’inverse à la fois du chef et du saint. Le chef conduit, c’est pour cela qu’il est chef. Le saint se conduit, c’est pour cela qu’il est saint. L’artiste quant à lui ne conduit ni les autres ni lui-même. Au contraire, il est conduit, il se laisse conduire. Il se laisse emporter vers la forge intersidérale. Il est sur le siège arrière d’une bagnole lancée à vive allure ; et au lieu de regarder devant lui pour savoir qui conduit (le chef ? le saint ? personne ?) et s’il y a ou non un ravin mortel, il regarde, peinard, le paysage par la fenêtre à côté. Au lieu d’essayer de changer son époque (comme le chef) ou de la sauver (comme le saint) l’artiste a décidé de la boire par grandes lampées. Il la boit par les yeux, les oreilles, la bouche, les mains. Il couche avec elle, il se corrompt dans ses draps. Il l’implore, il y retourne, elle le maltraite et le trompe mais il y revient encore, chez son amante ivrogne, dans la machine à claques du potier. Ce n’est pas l’artiste qui choisit ce qu’il devient, c’est son époque qui le transforme en ceci ou cela. Elle fait de lui ce qu’elle veut. Elle en dispose; elle le dépose ou l’élève.
Une nouvelle époque a commencé en 2001. Cette année-là, nous avons eu coup sur coup deux émissions de téléréalité atroces, deux hymnes à la laideur, deux grandes tatanes dans la gueule de l’altérité. Il y a eu d’abord, d’avril à juillet, la première émission Loft Story. Puis en septembre, l’attentat des tours jumelles. Ces deux événements présentaient une triple similitude troublante : 1/ on n’avait encore jamais rien vu de semblable en direct à la télévision, 2/ beaucoup ont douté que ce qu’ils étaient en train de voir était vrai (on imaginait que c’était scénarisé, préparé de l’intérieur, etc.), 3/ chacun avait l’impression d’avoir déjà vu exactement les mêmes images que celles qui étaient diffusées depuis New York ou le Loft. Un nouveau type de rapport au réel, appelé «complotisme», est né. Et une nouvelle époque a commencé. Ce serait celle de Wikipédia (arrivé en 1999), de Matrix (1999), des réseaux sociaux (2004), des Daft Punk (Premier album 1997 – Deuxième album 2001), de Youporn (2006), des guerres d’Afghanistan (2001) et d’Irak (2003) et d’un président français réélu avec un score de roi africain (82%) contre Jean-Marie Le Pen (2002).
Si l’art de Marc-Édouard Nabe n’avait pas changé, s’il avait écrit après 2001 le même genre de phrases qu’avant il n’aurait pas été un artiste véritable, mais un malin, un finaud, un type qui sait y faire, un marchand, un animateur. Je le clame haut et fort : tous les créateurs qui n’ont pas changé de style en 2001 étaient soit des vieillards soit des imposteurs. Après 2001 comme avant, Nabe a assumé le réel. Hélas son verbe s’est affadi, et son propos est devenu de plus en plus inintéressant, mais parce que le réel s’est affadi (qu’est-ce que c’est Daft Punk devant Thelonious Monk ?) et parce qu’il est devenu inintéressant (qu’est-ce que c’est Jeff Koons ?). Le dernier grand texte de Nabe fut son roman L’homme qui arrêta d’écrire auto-publié («antipublié» comme il dit) en 2007, et pourtant il était beaucoup plus fade et inintéressant que tout ce que Nabe avait écrit jusque-là. Et L’homme qui arrêta d’écrire ne porte pas son nom par hasard. Après celui-là en effet, Nabe s’est arrêté d’écrire. Il a couché des phrases sur le papier, mais il n’écrivait plus, elles n’étaient pas écrites. Fini le langage. Finie la phrase. Le problème de L’enculé ou des Porcs n’est pas la haine mais la fadeur et l’absence d’intérêt.
Je pense sincèrement que ce n’est pas de la faute de Marc-Édouard Nabe si son site internet est irregardable. Pas plus que ce n’est de sa faute si les vidéos de la rue Sauton dévoilent un orateur à mille lieues en-dessous des sommets d’autrefois. Nabe obéit à la voix du Temps, à son ordre cosmique, comme seuls les artistes sont capables d’y obéir, de s’y abandonner. Ce temps aurait été à l’héroïsme, Nabe aurait été héroïque. Mais ce temps est lamentable, donc Nabe est devenu lamentable. Il publie dans le dernier opus de sa revue Patience 150 photos pornographiques de lui et sa «meuf», nous dit-il, en réaction au mouvement #metoo et #balancetonporc. Il se convertit au protestantisme, et vit en Suisse. On en est là. Voilà ce que notre époque a fait «à» et surtout «de» ce grand écrivain. Voilà ce qu’est devenu celui qui s’était voué corps et âme, dès l’adolescence, à la beauté. Nabe il y a trente ans aurait été prêt à coucher avec Iphigénie sur l’autel devant les Achéens médusés, pourtant le voilà devenu boutiquier rue Sauton, parpaillot chez les horlogers, et «performeur». Ce n’est pas une honte pour lui mais pour nous. Honte à nous, car Nabe nous appartenait. Nous en étions responsables : nous en répondions, il nous répondait.
L’art c’est la forme. Le fond entre dans l’art, il est partout dans l’art, mais n’est pas du ressort de l’artiste. L’artiste ne produit pas, autrement dit, la pensée de son époque. Il n’est pas responsable du système politique, marchand et moral de l’époque dans laquelle il vit. Il le subit, comme tout le monde (à part le chef, responsable, et le saint, rescapé). L’artiste doit donner à son époque la forme qu’elle mérite; aussi Nabe a-t-il donné ce qu’elle méritait à cette époque. Cette époque qui, faut-il le rappeler, a humilié son cher professeur Choron, adoubé l’écrivassier minable qui n’était autre que son ancien voisin de palier, remplacé le jazz par le rock puis la techno, et fini par tuer des gens au hasard dans des concerts de rock et aux terrasses des cafés.
Dans ses écrits récents, Nabe ne fait rien d’autre que d’encourager toute l’immondice et toute l’immonde fatalité de notre Temps. Ce qui nous choque à leur lecture est moins leur violence je crois que l’amor fati. Nabe ose prétendre que tout ce que nous vivons n’est rien d’autre que ce que nous vivons, et que c’est très bien, et que ce sera très bien quoi qu’il arrive. Lorsque je lis ses dernières œuvres, bien sûr il m’arrive d’être amusé ou intéressé, Nabe n’est pas devenu idiot, il ne le sera jamais, il y a encore des éclairs dans la cacabouillasse, mais je ne peux m’empêcher de ressentir d’amers regrets à l’idée que je vis dans un siècle capable de troquer l’auteur du Régal et du Bonheur pour celui de L’enculé et des Porcs.
03/04/2020 | Lien permanent

























































