« Georges Darien, un barbare intolérant, par Nicolas Massoulier (Infréquentables, 7) | Page d'accueil | Excellences et nullités, une année de lecture : 2010 »
09/12/2010
La révolte des masses de José Ortega y Gasset

Crédits photographiques : Vincent Yu (AP Photo).
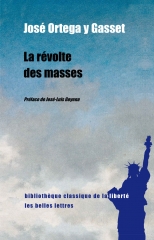 Acheter La révolte des masses sur Amazon.
Acheter La révolte des masses sur Amazon.LRSP (livre reçu en service de presse).
Essai paradoxal (ainsi de ses images, bien souvent frappantes), dans une époque de «descentes et de chutes», de «sérénité dans la tourmente», exploration altière mais jamais prétentieuse du problème de l'homme actuel pour laquelle «il faudrait se résoudre à endosser la tenue des abîmes, vêtir le scaphandre» (1) voici quelques-unes des expressions que l'auteur utilise au sujet de son propre livre.
Observons de quel étrange éclat se parent les mots que José Ortega y Gasset écrivit dans sa Préface pour le lecteur français ajoutée en 1937 à son ouvrage le plus connu, si l'on se souvient que Malcolm Lowry, après la publication de Sous le volcan en 1947, lut le livre et l'aima, lui qui n'hésita point, pour accompagner le Consul là où il fallait qu'il descende, à revêtir un scaphandre capable de le mener aux plus terrifiantes profondeurs.
Sans doute le grand romancier trouva-t-il aussi dans le livre du philosophe, comme le remarque José Luis Goyenna dans son intéressante (quoique pleine de fautes) préface, en plus d'images étonnantes bien propres à enthousiasmer l'écrivain, une authentique philosophie de la liberté comme accomplissement métaphysique du moi qui, à la différence de celle de Sartre qualifiée par l'auteur d'Ultramarine de «pensée de seconde main» (2), ne se dépêcherait pas bien vite de déposer aux pieds de l'idole le fardeau trop pesant, enchaînant ainsi la liberté à la seule discipline stupide des masses. Tout lecteur de La révolte des masses aime je crois, en tout premier lieu, l'écriture de ce livre érudit, pressé, menaçant, parfois prodigieusement lucide et même, osons ce mot tombé dans l'ornière journalistique, prophétique.
Peut-être trouva-t-il aussi dans ce livre, outre de fulgurantes vues (3), une intention purement kierkegaardienne, aussi rusée que profondément ironique, la sourde volonté consistant à faire comprendre à son lecteur que ce texte, sous les dehors débonnaires d'un essai sur la situation de l'homme européen au sortir de la Première Guerre mondiale, se proposait rien de moins que retourner comme un gant son esprit (et son âme ?), comme veulent toujours le faire, même s'ils prétendent le contraire, les plus grands romans : «C’est la raison pour laquelle le livre doit devenir de plus en plus comme un dialogue caché; il faut que le lecteur y retrouve son individualité, prévue, pour ainsi dire, par l’auteur; il faut que, d’entre les lignes, sorte une main ectoplasmique qui nous palpe, souvent nous caresse ou bien nous lance, toujours poliment, de bons coups de poing» (p. 49). La main ectoplasmique et le coup de poing, nouveaux moyens de réveiller les consciences libres du sommeil dogmatique dans lequel un sort mystérieux les a plongées ?
Quoi qu'il en soit, nous comprenons que l'intention du penseur espagnol est double. Le livre d'Ortega y Gasset semble fonctionner, à vrai dire, comme les ouvrages si profondément retors et érudits de Leo Strauss. D'abord, l'exposé des thèses qui permettent de caractériser le désarroi que constate l'auteur dans le monde occidental. Ensuite (si je puis dire, maladroitement, puisque ces deux phases exotériques ne forment qu'une seule et même phrase complexe, voire ésotérique), ayant défini ce qu'il entendait par l'homme-masse, le fait, subrepticement, de confronter celui qui le lit à une interrogation dont la réponse ne pourra que le glacer ou bien le conforter : est-il, oui ou non, un des innombrables représentants de la masse ? Est-il, ce lecteur lisant un livre qui claque comme un fouet (ou vous administre, poliment, un roboratif coup de poing), un homme creux ou bien un homme qui, après avoir lu, se convertira et agira ?
Intention éminemment existentialiste disais-je et nous pourrions ajouter, socratique, kierkegaardienne bien sûr, puisqu'il s'agit de faire prendre conscience que l'homme des masses n'est jamais l'autre, mais, bien sûr, soi-même non pas comme un autre selon la belle expression de Paul Ricœur, mais soi-même comme tous les autres, soi-même comme termite perdue au sein de la termitière à laquelle, patiemment, inexorablement, nous œuvrons.
Examinons ce qu'est, aux yeux d'Ortega y Gasset, l'homme-masse, au travers de quelques-unes de ses caractéristiques comme, en premier lieu, l'oubli (ou plutôt l'occultation) du passé. «Cet homme-masse écrit l'auteur, c’est l’homme vidé au préalable de sa propre histoire, sans entrailles de passé, et qui, par cela même, est docile à toutes les disciplines dites «internationales». Plutôt qu’un homme c’est une carapace d’homme, faite de simples idola fori. Il lui manque un «dedans», une intimité inexorablement, inaliénablement sienne, un moi irrévocable» (p. 58).
La volonté de faire table rase, si propre aux révolutions (4), ne peut que conduire à la ruine, mener l'homme jusqu'à la barbarie : «Le vrai trésor de l’homme, c’est le trésor de ses erreurs. Nietzsche définit pour cela l’homme supérieur comme l’être «à la plus longue mémoire». Rompre la continuité avec le passé, vouloir commencer de nouveau, c’est aspirer à descendre et plagier l’orang-outang» (p. 77).
C'est aussi s'engluer dans un présent définitif. Assez ironiquement bien que cette ironie ne puisse d'aucune façon être mise sur le compte, nous le verrons, d'une velléité réactionnaire, José Ortega y Gasset critique la croyance au progrès indéfini des connaissances et des techniques : «Sous le masque d’un généreux futurisme, l’amateur de progrès ne se préoccupe pas du futur; convaincu de ce qu’il n’offrira ni surprises, ni secrets, nulle péripétie, aucune innovation essentielle; assuré que le monde ira tout droit, sans dévier ni rétrograder, il détourne son inquiétude du futur et s’installe dans un présent définitif. On ne s’étonnera pas de ce que le monde paraisse aujourd’hui vide de projets, d’anticipations et d’idéals» (pp. 116-7).
Cette volonté maladive de détruire le passé, de vivre dans le perpétuel présent de l'animal, porte ses conséquences néfastes sur le présent comme sur l'avenir : «Et cela c’est être un peuple d’hommes : pouvoir prolonger son hier dans son aujourd’hui sans cesser pour cela de vivre pour le futur, pouvoir exister dans le vrai présent, puisque le présent n’est que la présence du passé et de l’avenir, le lieu où ils sont effectivement passé et avenir» (p. 79). C'est ainsi que, a contrario, l'Angleterre sera analysée par Ortega y Gasset comme le peuple de l'infinie prévoyance, le peuple composé d'hommes qui ne sont point encore les rouages d'une immense machine même si, comme le soulignera le philosophe, ce même peuple a pu se fourvoyer dans le pacifisme : «Ce peuple circule dans tout son temps; il est véritablement seigneur de ses siècles dont il conserve l’active possession» (pp. 78-9).
La révolte des masses, due à la désertion des élites («La désertion des minorités dirigeantes se trouve toujours au revers de la révolte des masses», pp. 116-7), doit aussi sa cause directe dans le fait que la société dans laquelle vivent les hommes ne les contraint plus à vouloir se dépasser. Si le monde ancien était le monde d'un danger permanent, fulgurant, notre époque est celle de la paralysie provoquée par le triomphe du machinisme, la réduction des territoires inexplorés, le prodigieux accroissement des sciences et des techniques contraints de se cantonner dans l'hyper-spécialisation, de la fuite des dieux : «Le monde qui entoure l’homme nouveau depuis sa naissance ne le pousse pas à se limiter dans quelque sens que ce soit, ne lui oppose nul veto, nulle restriction, mais au contraire avive ses appétits, qui peuvent, en principe, croître indéfiniment. Il arrive donc – et cela est très important – que ce monde du XIXe siècle et des débuts du XXe siècle non seulement a toutes les perfections et l’ampleur qu’il possède de fait, mais encore suggère à ses habitants une certitude totale que les jours qui vont suivre seront encore plus riches, plus vastes, plus parfaits, comme s’ils bénéficiaient d’une croissance spontanée et inépuisable» (pp. 130-1).
Ainsi, la vie des hommes du passé, quoique truffée de dangers, était synonyme de dépassement, du moins de possibilité de se dépasser. L'homme-masse est l'homme étriqué, fermé, tandis que l'homme du passé est celui de l'ouverture dans un monde lui-même ouvert à ses innombrables et sanglantes conquêtes : «De cette manière la vie noble reste opposée à la vie médiocre ou inerte, qui, statiquement, se referme sur elle-même, se condamne à une perpétuelle immanence tant qu’une force extérieure ne l’oblige à sortir d’elle-même. C’est pourquoi nous appelons «masse» ce type d’homme, non pas tant parce qu’il est multitudinaire que parce qu’il est inerte» (p. 139).
L'homme-masse est un être dépossédé. Il n'a plus de passé et, parce qu'il l'a perdu, il n'a plus de futur. Il n'est même pas certain, nous l'avons vu, qu'il puisse se targuer de vivre dans la paix perpétuelle d'un présent sans bornes, délesté du poids de ce qui l'a forgé : «L’homme-masse, écrit encore Ortega y Gasset, est l’homme dont la vie est sans projets et s’en va à la dérive. C’est pourquoi il ne construit rien, bien que ses possibilités et que ses pouvoirs soient énormes» (p. 121).
L'homme-masse est un être doublement dépossédé puisqu'il ne sait plus parler. Étrangement, José Ortega y Gasset évoque la dégénérescence du langage de l'homme-masse, qu'il assimile, pour les besoins de sa démonstration, à un habitant de l'Empire, en la rapprochant de celle du latin vulgaire : ainsi, «le symptôme et en même temps le document le plus accablant de cette forme à la fois homogène et stupide – et l’un par l’autre – que prend la vie d’un bout à l’autre de l’empire se trouve où l’on s’y attendait le moins et où personne, que je sache, n’a encore songé à le chercher : dans le langage» (p. 67). L'auteur poursuit en donnant la caractéristique principale du latin vulgaire : «Le premier [trait] est l’incroyable simplification de son organisme grammatical comparé à celui du latin classique» (p. 68), poursuivant : «Le second trait qui nous atterre dans le latin vulgaire, c’est justement son homogénéité. Les linguistes qui, après les aviateurs, sont les moins pusillanimes des hommes, ne semblent pas s’être particulièrement émus du fait que l’on ait parlé la même langue dans des pays aussi différents que Carthage et la Gaule, Tingis et la Dalmatie, Hispalis et la Roumanie. Mais moi qui suis peureux et tremble quand je vois le vent violenter quelques roseaux, je ne puis, devant ce fait, réprimer un tressaillement de tout le corps. Il me paraît tout simplement atroce» (Ibid).
Cette perte du passé qui doit être éradiqué pour laisser se lever de nouveaux soleils d'acier sur une humanité rédimée, cette destruction de toute conscience historique, cette rupture de la continuité, pour employer les mots de Max Picard, ainsi que la simplification du langage, sont les marques des deux principales forces politiques (bolchevisme et fascisme) qui se partagent l'Europe à l'époque où Ortega y Gasset écrit son essai, deux forces remarquablement décrites comme étant des puissances régressives, entropiques, une intuition qui ne deviendra une évidence voire un cliché, pour nombre d'auteurs comme Elias Canetti et à propos du nazisme (5), que des années après la parution de La Révolte des masses : «Mouvements typiques d’hommes-masses écrit d'eux l'auteur, dirigés, comme tous ceux qui le sont, par des hommes médiocres, intempestifs, sans grande mémoire, sans «conscience historique», ils se comportent, dès leur entrée en scène, comme s’ils était déjà du passé, comme si, arrivant à l’heure actuelle, ils appartenaient à la faune d’autrefois» (p. 167). Et l'auteur de poursuivre : «L’un et l’autre – bolchevisme et fascisme – sont deux fausses aurores; ils n’apportent pas le matin de demain; mais celui d’un jour ancien, qui a servi une ou plusieurs fois; ils relèvent du primitivisme. Et il en sera ainsi de tous les mouvements sociaux qui seront assez naïfs pour engager une lutte avec telle ou telle portion du passé, au lieu de chercher à l’assimiler» (pp. 168-9).
L'homme-masse, sans passé, ne vivant que dans un présent qui refuse d'envisager l'avenir autrement que comme la réalisation de rêves somptueux, colossaux (6), l'homme-termite qui est un homme creux, démoralisé, ne peut que se révolter. L'homme-masse, même, n'a pas de vie, et c'est cette absence de vie qui le livrera tout entier, comme un seul homme à la voix envoûtante des dictateurs, dont le règne est annoncé par l'auteur : «Car vivre, c’est avoir à faire quelque chose de déterminé – remplir une charge –, et dans la mesure où nous évitons de vouer notre existence à quelque chose, nous rendrons notre vie de plus en plus vide. On entendra bientôt par toute la planète un immense cri, qui montera vers les étoiles, comme le hurlement de chiens innombrables, demandant quelqu’un, quelque chose qui commande, qui impose une activité ou une obligation» (p. 212).
Cette révolte des masses, provoquée par n'importe quel événement (7), n'est elle-même qu'un leurre, puisqu'elle choisit comme vecteurs le fascisme et le nazisme qui sont condamnés à disparaître, qui ne sont qu'un interrègne (8) : «Je vais maintenant résumer la thèse de cet essai : le monde souffre aujourd’hui d’une grave démoralisation qui se manifeste – entre autres symptômes – par une révolte effrénée des masses; cette démoralisation générale a son origine dans une démoralisation de l’Europe dont les causes sont multiples. L’une des principales est le déplacement de ce pouvoir que notre continent exerçait autrefois sur le reste du monde et sur lui-même. L’Europe n’est plus sûre de commander, ni le reste du monde d’être commandé. La souveraineté historique se trouve aujourd’hui en pleine dispersion» (p. 254).
Ayant soigneusement posé son diagnostic sur la maladie du siècle, Ortega y Gasset, en bon docteur, délivre son ordonnance qui, elle aussi, a valeur d'étonnante prémonition, de véritable prophétie (9) : l'Europe !
C'est sans doute la grande thèse de José Ortega y Gasset, s'accompagnant d'une remise en question cinglante de l'idée, si répandue, de la décadence de l'Occident, qui fait qu'on ne peut l'accuser d'être passéiste ou même réactionnaire, comme tant de mauvais lecteurs l'affirmèrent au moment de la parution du magistral essai : «Mais arrêtez l’individu qui l’énonce [l’idée de décadence de l’Europe] d’un geste léger, et demandez-lui sur quels phénomènes concrets et évidents il fonde son diagnostic; vous le verrez faire aussitôt des gestes vagues, et pratiquer cette agitation des bras vers la rotondité de l’univers, caractéristique de tout naufragé. De fait, il ne sait pas où s’accrocher. La seule chose qui apparaisse sans grandes précisions lorsqu’on veut définir l’actuelle décadence de l’Europe, c’est l’ensemble des difficultés économiques devant lesquelles se trouve aujourd’hui chacune des nations européennes. Mais quand on veut préciser un peu le caractère de ces difficultés, on remarque qu’aucune d’elles n’affecte sérieusement le pouvoir de création de richesses, et que l’Ancien Continent est passé par des crises de ce genre beaucoup plus graves» (p. 221).
L'Europe, incontestablement la puissance civilisatrice du monde, est appelée par l'auteur à son propre dépassement afin, une nouvelle fois, de montrer la voie à prendre et, ainsi, sauver le monde qui se trouve au bord de l'abîme : «La véritable situation de l’Europe en arriverait donc à être celle-ci : son vaste et magnifique passé l’a fait parvenir à un nouveau stade de vie où tout s’est accru; mais en même temps, les structures survivantes de ce passé sont petites et paralysent son expansion actuelle. L’Europe s’est constituée sous forme de petites nations. En un certain sens, l’idée et les sentiments nationaux ont été son invention la plus caractéristique. Et maintenant elle se voit obligée de se dépasser elle-même. Tel est le schéma du drame énorme qui va se jouer dans les années à venir. Saura-t-elle se libérer de ses survivances ou en restera-t-elle prisonnière ? car il est déjà arrivé une fois dans l’histoire qu’une grande civilisation est morte de n’avoir pu modifier son idée traditionnelle de l’État…» (p. 225).
Et une nouvelle fois d'exhorter les élites éclairées et les gouvernements à unir les nations européennes pour donner un nouveau sens à l'idée, caduque ou du moins figée dans la tradition (10), d'État-nation : «On ne voit guère quelle autre chose d’importance nous pourrions bien faire, nous qui existons de ce côté de la planète, si ce n’est de réaliser la promesse que, depuis quatre siècles, signifie le mot Europe. Seul s’y oppose le préjugé des vieilles «nations», l’idée de nation en tant que passé» (p. 254).
Je ne sais s'il ne serait pas trop facile de faire remarquer à l'auteur, s'il vivait encore, que l'édification de l'Europe qu'il appelait de ses vœux les plus ardents allait être à la source de l'hyperdémocratie routinière qu'il accablait par ailleurs, comme illustration monstrueuse d'une démocratie directe, la démocratie des masses (11) qui s'exerce par une force qui n'est plus ultima mais prima ratio (12) : «Aujourd’hui nous assistons au triomphe d’une hyperdémocratie dans laquelle la masse agit directement sans loi, imposant ses aspirations et ses goûts au moyen de pressions matérielles» (p. 89).
Et, de cette action de la masse fascinée par les mots vides pas encore totalement débarrassés de leur ancien prestige (13), l'intelligence de José Ortega y Gasset ne consiste-t-elle pas à nous avoir donné un synonyme, la barbarie, qui est du reste l'inverse même, notons-le, de ce recours aux forêts prôné par Jünger ? : «La civilisation n’est pas vraiment là, elle ne subsiste pas par elle-même, elle est artifice et requiert un artiste ou un artisan. Si vous voulez profiter des avantages de la civilisation, mais sans vous préoccuper de la soutenir… tant pis pour vous ; en un clin d’œil, vous vous trouverez sans civilisation. Un instant d’inattention, et lorsque vous regarderez autour de vous, tout se sera volatilisé. Comme si l’on avait brusquement détaché les tapisseries qui dissimulent la nature vierge, la forêt primitive reparaîtra, comme à son origine. La forêt est toujours primitive, et vice versa, tout le primitif est forêt» (p. 163).
Notes
(1) Voir la Préface pour le lecteur français, pp. 47, 71 et 81. Voici l'une des expressions qu'utilise le philosophe dans son contexte : «Il y a des époques surtout où la réalité humaine, toujours mobile, précipite sa marche, s’emballe à des vitesses vertigineuses. Notre époque est de celles-là. C’est une époque de descentes et de chutes», José Ortega y Gasset, La Révolte des masses [La rebellión de las masas, 1930] (Les Belles Lettres, traduit de l’espagnol par Louis Parrot, préface de José Luis Goyena, coll. Bibliothèque classique de la liberté, 2010), p. 47. Toutes les pages entre parenthèses renvoient à cette édition.
(2) Voir José Lasaga Medina, Malcolm Lowry, lector de Ortega, suivi de Malcolm Lowry, Carta a Downey Kirk, Revista de Estudios Orteguianos, n°18, 2009, Fundación José Ortega y Gasset.
(3) «Tout destin est dramatique et tragique si on le scrute jusqu’au fond. Celui qui n’a pas senti sous sa main palpiter le péril du temps n’est pas arrivé jusqu’au cœur du destin, et, si l’on peut dire, n’a fait qu’en effleurer la joue morbide» (p. 93).
(4) «Dans les révolutions, l’abstraction essaie de se soulever contre le concret. Aussi la faillite est-elle consubstantielle à toute révolution» (p. 75).
(5) Elias Canetti qui décrit, d'une façon toute expressionniste, l'atmosphère explosive du Berlin de l'entre-deux guerres : «L'aspect animal et l'aspect intellectuel, mis au jour et portés à leur apogée, se trouvaient en interaction, comme une sorte de courant alternatif. Quiconque s'était éveillé à sa propre animalité avant d'arriver à Berlin devait la pousser à son maximum pour pouvoir s'affirmer contre celle des autres et se retrouvait ensuite usé et ruiné, si l'on n'était pas d'une solidité exceptionnelle. Celui qui en revanche était dominé par son intellect et qui n'avait encore que peu cédé à son animalité ne pouvait que succomber à la richesse complexe de ce qui était proposé à son esprit. [...] On se traînait ainsi dans Berlin comme un morceau de viande avancée, on ne se sentait pourtant pas encore assez battu et l'on guettait les nouveaux coups», in Histoire d'une vie. Le flambeau dans l'oreille, 1921-1931 (Albin Michel, 1982), p. 314.
(6) «L’époque des masses, c’est l’époque du colossal» (p. 91).
(7) Voir cette image saisissante, où s'annonce un danger que José Ortega y Gasset semble voir confusément : «Quant à l’occasion qui subitement portera le processus à son terme, elle peut être Dieu sait quoi ! la natte d’un Chinois émergeant de derrière les Ourals ou bien une secousse du grand magma islamique» (p. 55).
(8) Notons la justesse de cette vue : «La vie actuelle est le fruit d’un interrègne, d’un vide entre deux organisations du commandement historique : celle qui fut et celle qui sera. C’est ce qui explique pourquoi elle est essentiellement provisoire. Les hommes ne savent pas plus quelles institutions ils doivent vraiment servir que les femmes ne savent quels types d’hommes elles préfèrent réellement. Les Européens ne savent pas vivre, s’ils ne sont engagés dans une grande entreprise qui les unit. Quand elle fait défaut, ils s’avilissent, s’amollissent, leur âme se désagrège. Nous avons aujourd’hui un commencement de désagrégation sous nos yeux. Les cercles qui, jusqu’à nos jours, se sont appelés nations, parvinrent, il y a un siècle, ou à peu près, à leur plus grande expansion. On ne peut plus rien faire avec eux si ce n’est que les dépasser» (p. 256).
(9) «Il est de moins en moins possible de mener une politique saine sans une large anticipation historique, sans prophétie. Les catastrophes actuelles parviendront peut-être à rouvrir les yeux des politiques sur le fait évident que certains hommes, de par les sujets auxquels ils consacrent presque tout leur temps, ou grâce à leurs âmes aussi sensibles que des sismographes ultra-perfectionnés, sont visités avant les autres par les signes du futur» (pp. 279-80).
(10) «[…] notre vie, si nous la considérons comme un ensemble de possibilités, est magnifique, exubérante, supérieure à toutes celles que l’on a connues jusqu’ici dans l’histoire. Mais par le fait même que ses limites sont plus vastes, elle a débordé tous les cadres, tous les principes, normes et idéals légués par la tradition» (p. 119).
(11) «La caractéristique du moment, c’est que l’âme médiocre, se sachant médiocre, a la hardiesse d’affirmer les droits de la médiocrité et les impose partout» (p. 90, l’auteur souligne).
(12) «La force était autrefois l’ultima ratio. Assez sottement d’ailleurs, on a pris la coutume d’interpréter ironiquement cette formule qui exprime fort bien la soumission préalable de la force aux normes rationnelles. La civilisation n’est rien d’autre que la tentative de réduire la force à l’ultima ratio. Nous commençons à le voir clairement maintenant, parce que «l’action directe» consiste à pervertir l’ordre et à proclamer la violence comme «prima ratio», et même comme unique raison. C’est la norme qui propose l’annulation de toute norme, qui supprime tout intermédiaire entre nos projets et leur mise en pratique. C’est la Magna Carta de la barbarie» (p. 149).
(13) «La violence est devenue la rhétorique de notre temps. Les rhéteurs, les cerveaux vides s’en emparent. Quand une réalité a accompli son histoire, a fait naufrage, est morte, les vagues la rejettent sur les rivages de la rhétorique, où, cadavre, elle subsiste longuement. La rhétorique est le cimetière des réalités humaines; tout au moins son hôpital d’invalides. Le nom survit seul à la chose; et ce nom, bien qu’il ne soit qu’un nom, est en fin de compte un nom, c’est-à-dire qu’il conserve quelque reste de son pouvoir magique» (pp. 192-3).




























































 Imprimer
Imprimer