« Je n'ai aucune idée sur Hitler de Karl Kraus | Page d'accueil | Être homme c'est ne pas se contenter. Sur quelques poèmes ésotériques de Fernando Pessoa »
06/09/2014
Les Anneaux de Saturne de W. G. Sebald

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 W. G. Sebald dans la Zone.
W. G. Sebald dans la Zone.Le texte ci-dessous est la version considérablement remaniée d'une note ayant initialement paru dans la série intitulé Au-delà de l'effondrement.
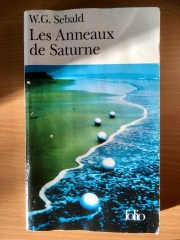 Acheter Les Anneaux de Saturne sur Amazon.
Acheter Les Anneaux de Saturne sur Amazon.W. G. Sebald est un homme hanté de plus d'une façon. Ainsi, comme lui-même l'avoue dans un des textes recueillis dans Campo Santo, c'est la gravure que lui a offert le peintre Jan Peter Tripp représentant le président Daniel Paul Schreber, «le magistrat mentalement dérangé, avec une araignée dans le crâne» qui a peut-être été à l'origine de son art d'écrire, puisque «de nombreux textes [qu'il a] écrits par la suite remontent à cette gravure, y compris le procédé, le respect scrupuleux de la perspective historique, le patient travail de ciselure et la mise en relation, dans le style de la nature morte, de choses qui semblent fort éloignées entre elles» (1). C'est dans ce même texte qu'il écrit aussi que «l'incendie est toujours au-dessus de nos têtes et que depuis la terreur des dernières années de la guerre nous vivons une sorte de vie souterraine, en dépit du fait que tout, autour de nous, soit si merveilleusement reconstruit» ou encore que «c'est seulement dans la littérature que l'on a affaire, au-delà de l'enregistrement des faits et au-delà de la science, à une tentative de restitution» (2).
La mémoire d'un monde perdu, peu à peu détruit par la mise en place de forces puissantes de production et, le plus souvent, d'exploitation, qu'il s'agisse des vers à soie, des harengs ou des hommes, l'écriture comme médecine plus ou moins efficace du vide qui menace de submerger l'auteur, comme il l'écrit dès les toutes premières lignes de son livre, vide qui est aussi le signe d'une «fêlure» (p. 32), vide qui est celui d'une «horreur paralysante qui [l']avait saisi à plusieurs reprises en constatant qu'ici également [dans le comté de Suffolk], les traces de la destruction remontaient jusqu'au plus lointain passé (p. 13), vide dont l'expérience conduit l'auteur à passer des semaines dans une chambre de «l'hôpital de la capitale régionale, Norwich» (p. 14), lieu de préparation mentale des pages qui composent le livre tout entier que nous lisons.
Les errances de W. G. Sebald ne doivent rien au hasard (3), même si elles le conduisent sur des routes qui traversent des paysages que l'on dirait avoir survécu à une «civilisation anéantie» (p. 48) ou bien inexplorés (cf. p. 305) et dans des contrées apparemment ravagées par la guerre (cf. p. 274), le mènent encore à des villes marquées «de toutes parts des stigmates d'un marasme rampant» (p. 68), puisque ces déambulations sont secrètement ordonnées par plusieurs chemins, réels ou mémoriels (cf. p. 244) qui en constituent les motifs, souvent discrets comme ceux qu'étudie une certaine Janine Rosalind Dakyns, romaniste de son état, motifs parfois quelque peu artificiels, et qui ne permettent pas, malgré l'extraordinaire fluidité des textes de Sebald, des raccords absolument parfaits. Ainsi, c'est la vision pour le moins inattentive d'une émission sur Roger Casement diffusée par la BBC qui est le prétexte à une paraphrase plutôt qu'à un véritable commentaire de l'expérience de Joseph Conrad au Congo belge ayant donné, on le sait, l'un des textes les plus puissants du siècle passé, Cœur des ténèbres. Quoi qu'il en soit, ces pages dont les plus belles évoquent l'enfance du grand écrivain, dénoncent le massacre de victimes anonymes qu'aucun «rapport annuel ne consigne» (p. 157), et se terminent par une curieuse remarque de Sebald, qui lie l'homosexualité de Roger Casement et son combat pour l'émancipation de populations entières bafouées et exterminées par les colons et de reconnaître, «par-delà les différences de classes sociales et de races la permanence de l'oppression, de l'exploitation, de l'asservissement et de la dégradation de ceux qui étaient les plus éloignés des centres de pouvoir» (p. 176).
Les livres géniaux et érudits de Thomas Browne, évoqué au début et à la fin du livre, ceux de Jorge Luis Borges, les associations d'images ou plutôt de souvenirs, une déambulation bien réelle le long de la côte Est (le comté de Suffolk), pratiquement désolée, de l'Angleterre, des motifs familiers (celui des cercles concentriques, cf. pp. 58 et 108, plutôt que des quinconces de Browne, cf. p. 34), des figures récurrentes, comme ces très fugaces (4) mais inoubliables épiphanies (pp. 97, 111, 121, 240, etc.) parfois cauchemardesques (p. 226 ou encore p. 131, sur les oustachis croates), mais qui paraissent constituer de mystérieux points d'intersection entre plusieurs trames temporelles (p. 243) que lie l'écriture, l'indécision entre rêve et réalité (5) ou bien la résurgence de l'image de la brume (pp. 30, 109, etc.), comparable à celle du sable dans les textes de Flaubert selon l'une des amies de Sebald, enfin la certitude, hélas vite contredite par le réveil, d'être revenu comme par enchantement à un état de plénitude et d'âge d'or (6), autant de signes que tout lecteur attentif de Sebald aura vite fait de retrouver dans ce livre, autant de traces et d'éléments, dirait-on, capables d'expliquer «l'énigmatique survivance de l'écrit» (p. 127).
Le thème essentiel reste bien évidemment, avec cet étrange auteur qui semble insaisissable, celui de la destruction, thème (et son corollaire : comment survivre à celle-ci) que j'évoque à plusieurs reprises dans la série que j'ai intitulée Au-delà de l'effondrement. Nul ne peut se représenter l'étendue de la destruction puisqu'elle dépasse, selon Günther Anders qui avait créé un mot pour évoquer ce phénomène (désigné par la catégorie du supraliminaire), nos capacités de représentation (7). On ne peut même pas se souvenir de pareil événement, parce que l'esprit des hommes semble ainsi fait qu'il paraît se fermer devant le spectacle d'un événement qui pourrait détruire ses mécanismes infiniment subtils (8).
Incapable de fixer ce point intense de rayonnement, le témoin confiera à la littérature la très douloureuse mission de tenter de s'approcher de la zone interdite, protégée de toute intrusion par de hauts barbelés électrifiés.
Sebald pas davantage ne parvient, du moins directement, à nous donner quelque idée du ravage, de sa grandeur terrible ni même de ce qui a pu se dérouler à une toute petite échelle, humaine et non plus planétaire (9), autrefois, dans un lieu à présent abandonné de l'Orfordness, qu'il parcourt à pied, lieu dont la description n'est pas sans nous rappeler immédiatement celle des chambres à gaz (alors qu'il ne s'agit que de bases utilisées par l'armée britannique) : «Cependant écrit-il, plus je m’approchais des ruines, plus se dissipait l'image d'une mystérieuse île des morts et plus je me crus, ajoute-t-il, au beau milieu des vestiges de notre propre civilisation anéantie au cours d'une catastrophe future. Exactement comme à un étranger, né ultérieurement et qui se retrouverait, sans rien savoir de la nature de notre société, parmi les montagnes de débris métalliques et de machines détruites que nous aurions laissés derrière nous, tout cela se présentait, à moi aussi, comme une énigme indéchiffrable, et j'étais là à me demander quelles étaient les créatures qui avaient vécu et travaillé ici jadis, et à quoi avaient bien pu servir ces rails d'acier sous les plafonds, ces crochets aux murs encore partiellement carrelés, ces pommeaux de douche grands comme des assiettes, ces rampes et ces puisards» (pp. 308-9).
Impossible à écrire, l'histoire de la destruction ou, simplement, l'Histoire, puisque cette dernière n'est «faite de rien d'autre que du malheur et des affections qui déferlent sur nous, sans trêve ni repos, comme les vagues sur le rivage de la mer, si bien [...] que tout au long de nos jours terrestres nous ne vivons pas un seul instant qui soit véritablement exempt de peur» (pp. 200-1), Histoire «progressant aveuglément d'un malheur à l'autre» (p. 332), n'est peut-être rien de plus que celle d'une littérature qui, à l'exemple des meilleurs ouvrages de Sebald, n'en finit pas de se rapprocher d'une colossale masse manquante (je doute qu'il s'agisse d'une géante gazeuse, fût-elle magnifique comme Saturne) qui la détruit tout en lui permettant de nous délivrer ses secrets les plus humbles.
En somme, et pour le dire en peu de mots, la littérature,considérée comme étant un véritable tourment pour l'auteur (cf. p. 237) participe aussi à la destruction, malgré son goût des listes d'êtres et de réalités plus ou moins réels (Browne encore, cf. p. 354). La littérature aussi est destruction : vérité ténébreuse, ultime peut-être, «mot clé dissimulé dans la charade» (p. 232) que W. G. Sebald semble avoir été tout près de découvrir dans certains de ses textes les plus troublants et mélancoliques, et qu'il a refusé de coucher par écrit, ou bien alors qu'il a découverte mais que, prudemment, il a tue, fixant cette preuve supplémentaire d'une horreur, d'une «catastrophe jamais aussi proche que lorsque l'avenir se présente sous le jour le plus radieux» (p. 295), catastrophe inéluctable, quoi que nous fassions, que rien ne semble décidément pouvoir prévenir, fléau impossible à contrer, ténèbres amoncelées au-dessus du fleuve que Marlow et ses compagnons fixent en silence.
Notes
(1) W. G. Sebald, Une tentative de restitution in Campo Santo (Actes Sud, traduit de l'allemand par Sibylle Muller et Patrick Charbonneau, 2009), p. 234. L'auteur souligne.
(2) Ibid., respectivement pages 235 et 238.
(3) Contre l'avis même de l'auteur qui écrit : «Peut-être chacun de nous perd-il la vue d’ensemble au fur et à mesure qu’il bâtit sa propre œuvre et peut-être est-ce pour cette raison que nous sommes disposés à nous imaginer que le progrès de la connaissance se mesure à l’aune de la complexité croissante de nos constructions intellectuelles, et cela bien que nous pressentions en même temps que jamais nous ne saisirons les impondérables qui, en réalité, déterminent notre parcours», W. G. Sebald, Les Anneaux de Saturne [Die Ringe des Saturn, 1995] (Actes Sud, 1999, Gallimard, coll. Folio, 2003. Sans autre précision, les pages indiquées renvoient à cette édition), p. 236. La citation en exergue est extraite des pages 188-189.
(4) «Une seconde d’effroi, comme je le pense souvent, et toute une époque est révolue», p. 50.
(5) «Il ne m’était pas facile de partager ces impressions tandis que je me trouvais moi-même à arpenter la Parkstraat en direction de Scheveningen. Il y avait bien ça et là une belle villa dans un jardin, mais à part cela, pas de quoi s’extasier. […] À Scheveningen, où j’avais espéré voir la mer de loin, je dus marcher longtemps, comme au fond d’une gorge, à l’ombre d’immeubles comptant de nombreux étages. Lorsque enfin j’atteignis la plage, j’étais si fatigué que je m’étendis et dormis jusqu’au beau milieu de l’après-midi. J’entendais la rumeur de la mer, comprenais, à moitié en rêve, chaque mot de hollandais et, pour la première fois de ma vie, je me crus rendu chez moi. À mon réveil encore, j’eus l’impression, au premier moment, que je me trouvais parmi mon peuple et que ceci était une halte au cours de notre marche à travers le désert», p. 116. Cf. encore page 235.
(6) Voir ainsi la dernière phrase de l'extrait précédent faisant écho à celui-ci, p. 76 : «On dirait [Sebald évoque des abris qui se dressent en bordure immédiate de la mer] les derniers représentants d'un peuple de nomades qui se seraient posés là, à l'extrême bord de la terre, en attente du miracle depuis toujours espéré, en vertu duquel privations et errances se trouveraient somme toute justifiées.»
(7) «Les souffrances endurées, toute l’œuvre de destruction dépassent largement notre faculté de représentation […]», p. 106.
(8) «Mais en réalité, on ne se rappelle évidemment pas. Trop d’édifices se sont écroulés, trop de gravats se sont accumulés, insurmontables sont les dépôts sédimentaires et les moraines», p. 230.
(9) «L’histoire géologique de cette triste contrée [la lande solitaire qui domine Dunwich] est étroitement liée non seulement à la nature du sol et aux influences du climat océanique mais aussi, de manière beaucoup plus déterminante, au refoulement et à la destruction, poursuivie durant des siècles et même des millénaires, des épaisses forêts qui, après la dernière ère glaciaire, se sont propagées sur la totalité des îles britanniques», p. 219. Et encore, quelques lignes plus bas : «Notre propagation sur terre passe par la carbonisation des espèces végétales supérieures et, d’une manière plus générale, par l’incessante combustion de toutes substances combustibles», pp. 220-1.





























































 Imprimer
Imprimer