« L'Amérique en guerre (6) : Jack Kerouac de guerre lasse, par Gregory Mion | Page d'accueil | L’insécurité culturelle de Laurent Bouvet, par Gregory Mion »
28/08/2016
Le Territoire de l'homme d'Elias Canetti

Photographie (détail) de Juan Asensio.
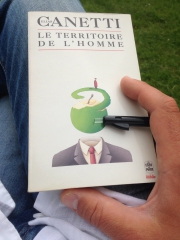 Acheter Le Territoire de l'homme sur Amazon.
Acheter Le Territoire de l'homme sur Amazon.C'est peut-être lorsqu'il mentionne directement son plus grand labeur, Masse et Puissance, que nous pénétrons réellement dans Le Territoire de l'homme, le Journal consignant ses belles réflexions plus que ses tracas quotidiens qu'Elias Canetti tint des années 1942 à 1972 (1). Précédant Le Cœur secret de l'horloge (1973-1985) et suivant les trois premiers volumes que sont La Langue sauvée (1905-1921), Le Flambeau dans l'oreille (1921-1931) et enfin Jeux de regard (1931-1937) (2), Le Territoire de l'homme surprend par la fragmentation progressive de ce que Canetti nomme ses réflexions, qui peuvent s'étendre sur plusieurs pages, lorsque par exemple il évoque des auteurs qu'il considère comme ses ennemis (tels Hobbes et Joseph de Maistre) ou ne pas dépasser quelques mots. Cette fragmentation est une réalité pour l'année 1959, où il remarque, sobrement, qu'il a envoyé le manuscrit de Masse et Puissance à Hambourg pour y être édité, ajoutant, tout aussi sobrement, que l'idée de l'ouvrage remonte à 34 ans, en 1925, précisant encore son souvenir, lequel, puisqu'il évoque Walter Rathenau, ne peut que nous faire songer à Ernst von Salomon : «Mais la source véritable est plus ancienne : elle date d'une manifestation d'ouvriers qui eut lieu à Francfort à l'occasion de la mort de Rathenau. J'avais alors dix-sept ans» (p. 273). Il poursuit en affirmant que, sous quelque jour qu'il la regarde, son «existence d'adulte [lui] apparaît toujours comme préparant ce livre» car, depuis qu'il vit «en Angleterre (plus de vingt ans donc)», il n'a «guère travaillé qu'à cela, bien qu'aient eu lieu de tragiques interruptions» (pp. 273-4). C'est en tout cas ce livre, dont l'écriture, comme il le soupçonne, lui a sans doute fait manquer d'autres livres, qui lui a permis de «prendre ce siècle à la gorge" (p. 274). Il n'est ainsi pas étonnant, comme d'ailleurs Canetti l'admet dans sa Préface, que la plupart des réflexions contenues dans son ouvrage concernent, directement ou pas Masse et Puissance, œuvre agissant comme une espèce d'aimant ou de trou noir qui avale toute forme de matière passant près de lui et qui, d'une façon que nous pourrions nommer aporétique, constitue le centre absent, inatteignable d'une vie de labeur intellectuel. De toute façon nous prévient Elias Canetti, «l'unité profonde d'une vie étant toujours insaisissable, c'est souvent lorsqu'elle semble le plus se cacher qu'elle est, en fait, le plus efficace» (p. 11).
 Si l'unité d'une vie est insaisissable, a fortiori celle d'une vie de labeur intellectuel, celle de la pensée d'Elias Canetti, elle, peut à tout le moins se caractériser, dans ce volume de réflexions, par quelques constantes thématiques, comme la haine de la mort, la mention du sort cruel réservé aux animaux, la méfiance, instinctive, devant toute forme de religion, la lecture constante des grands mythes de l'humanité (cf. p. 32 : «Il est ce qu'il y de plus durable dans ce que les hommes ont été capables de produire»), l'attention, de toutes les heures elle aussi, aux mots et, soubassement de ces différentes thématiques comme je le pense, la volonté, agaçante mais admirable, de se vouloir libre de tout dogme, en veillant à nourrir une perpétuelle soif d'apprendre. Nous verrons plus loin comme la thématique principale du langage et des mots n'est finalement qu'une des facettes, mais la plus réfléchissante, de la volonté, bien souvent héroïque et même, osons ce terme, faustienne, de se vouloir libre de toute influence dogmatique. Combien de fois Elias Canetti ne nous répète-t-il pas qu'il veut «appréhender ce que nous sommes» et «connaître toutes les affirmations» puisque rien ne l'intéresse «en dehors d'elles» (p. 247, l'auteur souligne) ?
Si l'unité d'une vie est insaisissable, a fortiori celle d'une vie de labeur intellectuel, celle de la pensée d'Elias Canetti, elle, peut à tout le moins se caractériser, dans ce volume de réflexions, par quelques constantes thématiques, comme la haine de la mort, la mention du sort cruel réservé aux animaux, la méfiance, instinctive, devant toute forme de religion, la lecture constante des grands mythes de l'humanité (cf. p. 32 : «Il est ce qu'il y de plus durable dans ce que les hommes ont été capables de produire»), l'attention, de toutes les heures elle aussi, aux mots et, soubassement de ces différentes thématiques comme je le pense, la volonté, agaçante mais admirable, de se vouloir libre de tout dogme, en veillant à nourrir une perpétuelle soif d'apprendre. Nous verrons plus loin comme la thématique principale du langage et des mots n'est finalement qu'une des facettes, mais la plus réfléchissante, de la volonté, bien souvent héroïque et même, osons ce terme, faustienne, de se vouloir libre de toute influence dogmatique. Combien de fois Elias Canetti ne nous répète-t-il pas qu'il veut «appréhender ce que nous sommes» et «connaître toutes les affirmations» puisque rien ne l'intéresse «en dehors d'elles» (p. 247, l'auteur souligne) ?Revenons aux mots : ils vivent une vie secrète, indépendante (Fritz Mauthner le pense aussi) qui n'est que partiellement en rapport avec celles et ceux qui les emploient, ne cesse de nous dire Canetti, qui écrit ainsi en 1942 : «Si les hommes avaient l’intuition, même la plus fugitive, de la vie secrète et des agissements de bien des mots et des locutions qu’ils emploient, ils en seraient saisis d’horreur, comme devant un aspic» (p. 23). L'importance des mots et, plus largement, du langage, est cruciale dans l’œuvre de Canetti, qui toujours oscille entre un sentiment d'admiration et d'horreur devant le puits, la fosse eût dit Abellio, que représentent les mots, dans le passage qui suit admirablement exprimés : «Qu’il existe une multiplicité de langues est un fait mais c’est la chose la plus inquiétante du monde. Cela revient à dire que chaque chose porte des noms différents, au point qu’on peut se demander s’il s’agit bien de la même chose. Toute la science du langage recouvre le désir de ramener à une souche unique la multitude des idiomes. L’histoire de la tour de Babel est celle de la seconde chute de l’homme. Après avoir perdu son innocence avec le paradis, c’est artificiellement qu’il voulut rejoindre le ciel. Il avait goûté à l’arbre défendu, il en étudiait maintenant la science secrète afin d’assouvir ce désir. Mais il perdit alors ce qu’il avait conservé lors de sa première chute : l’unité des noms» (pp. 22-3).
Les réflexions de Canetti sur le pouvoir du langage s'inscrivent dans une tradition qui inclut Karl Kraus, qu'il admira et dont il tenta à tout prix de se libérer, et rejoint certaines des analyses de Mauthner (3) ou de Klemperer (4).
Autant d'exemples d'études sur ce que j'ai appelé le langage vicié, mais aussi de notations étranges, comme borgésiennes (5) qui nous dévoilent un monde invisible, à la fois bruyant et silencieux ou plutôt mutique, et évoquent une mystérieuse destitution des mots et des récits, autrefois sacrés, maintenant tournant à vide de bouche en bouche. Ainsi, tandis qu'il a existé, incontestablement, une aube dorée où la toute première nomination des choses et des êtres était gage d'innocence et de réelle présence : «Le monde est si riche ! combien de bêtes, de plantes, de pierres n’a-t-il jamais connues ? Lorsqu’il se donne la peine de s’inquiéter d’elles, c’est avec la première impression qu’il reçoit de leurs formes qu’il va leur donner des noms, inattaquables, encore aussi frais, aussi beaux qu’ils le sont pour l’enfant qui apprend à parler» (p. 81), il faut aussi admettre que la puissance est perdue : «Il n’y a plus de mots puissants. On dit quelquefois «Dieu», mais c’est seulement pour prononcer un mot qui, autrefois, était puissant» (p. 76) (6).
Cette destitution, il est certes bien peu probable que Canetti, toujours extraordinairement méfiant face aux religions, en fasse le résultat d'une perte de puissance du sacré. C'est bien davantage je crois parce que l'homme a perdu la mesure de l'homme qu'il a aussi perdu celle de l'univers dans lequel il vit, et nomme, mais sans plus croire à la puissance du langage : «Il n’y a plus de mesure pour rien depuis que la vie humaine n’est plus la mesure» (p. 26). En tout cas, tout s'est réduit, le monde entier des choses comme dit le poète : «Les anciens récits de voyage deviendront aussi précieux que les plus vénérés des chefs-d’œuvre de l’art, car la terre inconnue était sacrée et plus jamais, non, jamais plus elle ne pourra l’être» (p. 43, l'auteur souligne), remarque voisine de cette autre, notée en 1944 : «Il ne restera bientôt plus aucune écriture ancienne qui n’ait été déchiffrée et il n’apparaîtra plus d’écriture nouvelle à déchiffrer. De sorte que l’écriture aura perdu son caractère sacré» (p. 95), comme si le caractère sacré d'une réalité réalisait dans son voilement, la force de dévoilement caractérisant l'homme moderne n'étant que l'arraisonnement du monde (7), la perte de l'innocence, la relégation du sacré dans les vieux mythes de l'humanité ne vivant plus que dans les rayonnages des bibliothèques.
Du coup, le rôle de l'écrivain, singulièrement celui du poète, semble clair, à lire Elias Canetti : le véritable art littéraire est celui qui parvient à redonner aux mots leur ancienne fraîcheur, leur primesautière grâce, leur puissance lustrale, non celle des mots anonymes, souillés par des millions d'hommes, les mots de la masse, qui elle-même ne semble plus pouvoir être excitée, levée, par un Christ ou un Bouddha, mais par un Mahomet (cf. p. 363). Ainsi, en 1948, Canetti affirme que : «Le principe de l’art [consiste à] retrouver plus que ce qui s’est perdu» (p. 173), puisque, «En tant que poète, [il vit] encore au temps d’avant l’écriture, au temps des appels», puisque pour lui, «les mythes signifient plus que les mots. Par cela, je diffère profondément de Joyce. Mais j’ai aussi une autre façon de respecter les mots. Leur intégrité m’est presque sacrée» (p. 148). Si les mythes sont supérieurs aux mots, c'est probablement parce qu'ils peuvent se passer de gloses, de béquilles, à la différences des mots alourdis par d'autres mots et qui sont passés dans tant de bouches, point toutes recommandables. Voici ce que Canetti a écrit en 1947 : «Où les mots ont-ils été ? Dans quelles bouches ? Sur quelles langues ? Qui devra, qui pourra encore les reconnaître après ces pèlerinages en enfer, après ces horribles gouffres ?» (p. 154). Jamais mieux que dans une réflexion de l'année 1969 Elias Canetti n'exprime sa fascination pour le mot : «Il faudrait trouver un mot plus fort pour l'amour, un mot comme un vent soufflant de sous la terre, n'ayant pas besoin de montagnes mais d'immenses cavernes, dont il ferait son gîte. Il en sortirait en se ruant sur les vallées et les plaines, ainsi que l'eau, sans toutefois lui ressembler. Du feu alors, mais qui ne brûle pas. Un mot brillant dans toutes ses parties, à l'image du cristal, mais sans tranchant. Un mot transparent, tout prêt, ressemblant aux voix des animaux», «un mot comme les morts» (p. 370) ajoute Canetti, ayant bien conscience que le mot qu'il appelle de ses vœux, tout comme la «phrase unique» (cf. p. 393) n'existe dans aucune langue.
Il faut donc «Chanter ! Mais chanter quoi ! Les grandes choses anciennes qui sont mortes. La guerre aussi mourra» (p. 63), conclut Elias Canetti et, s'il est décidément devenu impossible de chanter réellement, véritablement, en ne pouvant rien faire d'autre que de tenter de faire miroiter une grandeur enfouie, il faut, à tout le moins, se faire le gardien du langage : «Mais à présent, avec l’effondrement de l’Allemagne, tout cela a complètement changé pour lui. Les gens, là-bas, vont se mettre très bientôt à la recherche de leur langue, qu’on leur avait volée et défigurée. Et celui qui l’a gardée propre et pure dans les années de la pire folie se trouvera contraint de la lâcher. […] Mais il y a que maintenant il doit leur langue aux Allemands. Il l’a maintenue saine, mais il faut maintenant qu’il la lâche et la rende avec amour et gratitude, avec les intérêts et les intérêts composés !» (p. 111).
Les mots, vivants ou morts, lumineux ou ténébreux, bénéfiques ou maléfiques (8), voilà la grande affaire d'Elias Canetti, qui ne semble pouvoir concevoir le plus grand des cauchemars qu'à la condition d'en exclure les mots : «Les lettres de ton propre nom ont une effrayante magie, comme si le monde en étant composé. Un monde sans nom serait-il concevable ?» (p. 129), mais qui ne cesse toutefois, en grand écrivain mesurant son ambition, d'appeler de ses vœux une illusoire révélation par les mots, puisque ceux-ci, comme des organismes vivants, se consument et finissent par mourir (9) : «Que personne n’ait encore ouï les mots véritables, ceux grâce auxquels on entend, que tous écoutent et écoutent encore et attendent, ces mots véritables !» (p. 154).
Si les mots sont tout («L’homme, par ses mots, touche en tous sens le commencement, la fin et le centre du monde», p. 234), s'ils parviennent même à se nourrir les uns des autres, à s'épier, à se détruire, à se cannibaliser, comme si la guerre réelle n'était jamais, idée chère à Karl Kraus, que la traduction de la guerre que les mots se livrent entre eux (10), ils composent l'essence même de celui qui ne cesse de les employer en y quêtant la magie et le prestige perdus : «Tous les rapports arithmétiques, les proportions, les dessins elliptiques et autres trajectoires me laissent froid; tous les rapports basés sur des noms, par contre, me paraissent émouvants et véridiques. Mon dieu est le nom; le souffle de ma vie est le mot. Lorsque leurs noms pâlissent, les lieux ne m’intéressent plus. Je ne suis jamais allé quelque part sans y être attiré par le nom. Je redoute la dissection et l’explication des noms; je les redoute plus qu’un assassinat» (p. 235). Cette dernière notation est intéressante, car elles nous permettent de comprendre que c'est justement par l'attention au langage qu'Elias Canetti peut se dire esprit éternellement mouvant, en quête d'une vérité qui ne soit entachée par aucune chaîne trop humaine, philosophique, politique ou spirituelle. C'est en fait dans et par les mots que s'anime la formidable liberté d'Elias Canetti, qui toujours veille à faire de leur emploi un exercice de courage, de sincérité et d'une certaine transparence qui ne peut avoir pour but que de ne point enfermer soi-même et autrui dans une prison de mots fatidiques, ensorceleurs : «Ne pouvant exister sans les mots, je dois avoir confiance en eux; et cela n’est réalisable qu’en ne les déguisant pas. Ainsi, toute revendication extérieure, basée sur des mots, m’est impossible. Je puis écrire ces mots et les garder quelque part en toute tranquillité. Mais je ne puis les jeter à la tête de quelqu’un ni faire aucun commerce avec eux» (p. 240). A contrario, le mage prestidigitateur, le maître des mots corrompus, Hitler dont les images prennent feu quand on les regarde (cf. p. 43), est celui qui ne craint pas de voir les mots sales, corrompus, s'échapper et sauter à la gorge des passants : «Toute langue est composée et animée par des créatures auxquelles va le plus grand mépris. Ne parle-t-on pas de crapauds, de vermine, de serpents, de vers et de cochons ? Qu’arriverait-il si tous ces mots, tous ces objets de mépris, venaient tout à coup à nous échapper !» (p. 225). La liberté à laquelle Elias Canetti aspire est celle de l'homme qui a tout lu, certes, mais dont le savoir ne s'est pas encore desséché, qui connaît la valeur des mots et n'hésite pas à les soustraire au bruit et à la fureur, et il serait tout à fait possible d'inverser terme à terme les propositions de l'extrait suivant, pour imaginer les caractéristiques de la fausse parole disséquée admirablement par Armand Robin : "les noms qu’on garde longtemps ont un tout autre effet : ils opèrent en vous une concentration venue de l’intérieur, agissent en catalyseurs, engendrent votre recristallisation, vous trempent et vous donnent la lumière» (p. 337).
La liberté d'Elias Canetti est encore d'une autre sorte car, s'il faut avec lui constater que «Trop de chemins dans le langage» existent, ce qui produit le fait que «tout est tracé d’avance» (p. 265), il faut encore louer la hauteur à laquelle il a placé l'écriture, non point conçue comme un témoignage, mais, à tout le moins, comme le reflet sans cesse mouvant d'une pensée elle-même en perpétuel mouvement. Mouvement double à vrai dire, de remerciement vers ceux qui ont été les grands inspirateurs, amis (Hermann Broch) ou ennemis (Hobbes, De Maistre et, suivant les époques, Karl Kraus) (11), puisque l'exercice de la parole et plus encore celui de l'écriture ne sauraient être considérés comme une activité insouciante, comme ce parisianisme effréné qui a ôté tout poids aux lettres françaises contemporaines : en somme, il s'agit de couver ses phrases comme des œufs (12), de n'être pas l'un de ces médiocres que Canetti dépeint sous le portrait du Lettré (cf. pp. 265-8) mais aussi de ne pas hésiter, après Auschwitz et Hiroshima, à plonger son regard dans le gouffre puisque notre âge, définitivement, nous a fait perdre notre innocence, et que le langage lui-même a été souillé, peut-être irrémédiablement : «Même après la Première Guerre mondiale, il était encore possible, pour certains poètes, de respirer et de tailler leur cristal. À présent, alors que la Seconde a eu lieu, après les chambres à gaz et les bombes atomiques, le fait d’être un homme, avec tout le danger et l’humiliation que cela comporte, exige infiniment plus. Il faut faire face à la brutalité telle qu’elle fut toujours et, à son contact, s’endurcir les mains et l’esprit. Il faut prendre l’homme tel qu’il est, dur et non racheté. Mais il faut lui interdire de mettre la main sur l’espérance, celle-ci ne devant avoir sa source que dans la connaissance la plus noire» (p. 281). En d'autres mots, comme il le note en 1971, peut-être que notre rôle est désormais de parvenir à inventer une langue capable de dire l'horreur, une langue digne, qui rejette la force (13), «une langue assez longue pour rejoindre l'enfer» (p. 396), non pour s'y délecter ou même y séjourner (14) mais pour tenter de dire ce qui peut être, encore, sauvé puisqu'en fait «il n'y a plus de mesure pour rien depuis que la vie humaine n'est plus la mesure» (p. 26).
Peut-être approcherons-nous donc de la vérité en disant que la tentative forcenée d'Elias Canetti n'eut d'autre but, devant l'imminence de la catastrophe (15), le triomphe des masses qu'il avait pu constater de ses propres yeux et le dévoiement d'une puissance n'étant plus qu'arraisonnement du monde (16), que de tenter de bâtir une nouvelle mesure de l'homme.
Notes
(1) Elias Canetti, Le Territoire de l'homme (1973, Carl Hanser Verlag, Munich, puis, dans une magnifique traduction d'Armel Guerne, 1978, Albin Michel. Notre édition est la version publiée en poche de cette traduction : Le Livre de proche, coll. Biblio, 1998).
(2) Je signale que j'avais évoqué dans cette note Les Années anglaises, souvenirs rassemblés par la fille d'Elias Canetti de la période pendant laquelle son père vécut en Angleterre, dès 1939.
(3) Fritz Mauthner insistait sur l'importance absolue du langage, tout en analysant son absolue artificialité, que nous pourrions retrouver dans ce propos d'Elias Canetti : «Les animaux ne se doutent pas que nous leur avons donné des noms. Ou peut-être que si, et c’est alors pourquoi ils ont peur de nous» (p. 34). L'importance des mots, elle, y compris dans leur façon de désigner la réalité, est bien visible dans cette belle notation de Canetti : «C’est seulement après avoir lu le poème de Blake que j’ai su ce qu’était réellement un tigre» (p. 38).
(4) Il écrit ainsi en 1943 : «Les phrases tout comme les pensées ont considérablement raccourci depuis le début de la guerre pour s’adapter à la syntaxe des ordres» (p. 40). En 1945 : «Les locutions les plus fausses ont le plus grand pouvoir d’attraction aussi longtemps qu’il existe encore des gens qui les utilisent sérieusement» (p. 110).
(5) «Il [le livre] est parvenu maintenant au terme de sa route, il se dévoile et éclaire les vingt années de mutisme écoulées dans son ombre. Il ne pourrait pas autant révéler s’il ne s’était tu si longtemps, et je ne sais pas quel imbécile oserait prétendre que son contenu fût toujours le même» (p. 46).
(6) Voir cette belle remarque unissant visible et invisible, verbes et Verbe : «Les voix des hommes sont le pain de Dieu» (p. 28).
(7) «La terre abandonnée, surchargée de lettres de l’alphabet, étouffée sous les connaissances; et plus aucune oreille qui soit à l’écoute dans le froid» (p. 99).
(8) «Au conservateur des mots, quel qu’il soit : donne-m’en de sombres, donne-m’en de clairs, mais surtout pas de fleurs. Garde pour toi la fragrance. Je ne veux pas de mots caducs, qui se fanent» (p. 226).
(9) «Les langues défaillent; à force d’être utilisées, les mots ne comptent plus» (pp. 223-4).
(10) «À propos des noms dans l’histoire : Des noms puissants seulement, car les autres meurent. Donc on peut évaluer d’après le nom la force de survivance. Jusqu’à ce jour, c’est la seule vraie forme de survivance. Mais comment le nom survit-il ? Son étrange gloutonnerie : le nom est cannibale. […] Il y a des noms qui n’ont d’appétit que lorsque leur possesseur est mort. D’autres forcent ces derniers à avaler tout ce que, durant leur vie, ils rencontraient sur leur chemin; ce sont des noms insatiables. D’autres jeûnent de temps en temps. D’autres hivernent. D’autres doivent rester cachés longtemps pour surgir brusquement, pleins de voracité; ils sont très dangereux. […] Des noms innocents, enfin, qui vivent pour s’être abstenus de toute nourriture» (pp. 236-7).
(11) C'est dans un bel ouvrage intitulé La Conscience des mots (traduction de Roger Lewinter, Le Livre de poche, coll. Biblio Essais, 1989) qu'Elias Canetti évoquera les figures d'Hermann Broch et de Karl Kraus, ce dernier par deux fois.
(12) «Il pond des phrases comme des œufs, mais il oublie de les couver» (p. 296).
(13) D'où l'importance, aux yeux de Canetti, d'un auteur tel que Kafka : «Avec Kafka, quelque chose de neuf a surgi dans le monde : un sentiment plus précis de son essence problématique, plutôt lié au respect qu’à la haine de la vie» (p. 352). Plus loin : «De quoi as-tu tellement honte en lisant Kafka ? – Tu as honte de ta force» (p. 353). La dernière mention de l'écrivain l'oppose à Proust : «En face de quelques auteurs à l'esprit créateur mais aux œuvres trop brèves, tout amour-propre m'abandonne. Il ne s'agit pas de ceux qui ont réalisé les plus grands exploits, mais plutôt de ceux qui, au-delà de leur accomplissement, ont deviné quelque chose de plus important et d'inaccessible; si bien que, comparé à cela, cet accomplissement s'amenuise jusqu'à devenir inexistant. Kafka, à mon avis, fait partie de ces personnages. C'est pourquoi il me touche davantage que Proust, par exemple, dont l’œuvre est pourtant incomparablement plus vaste» (pp. 357-8). Canetti évoque aussi l'humble figure de Walser (cf. p. 333), puisqu'il s'efforce de se tenir aux côtés des faibles, comme l'indique cette notation ironique : «Je me demande s'il y en a un seul qui ait honte, parmi ceux qui établissent leur vie académique aisée, assurée, bien droite, sur celle d'un poète qui a vécu dans la misère et le désespoir» (p. 334).
(14) Car, si «Au purgatoire, les hommes parlent beaucoup; en enfer, ils se taisent» (p. 311).
(15) D'où ces vignettes qui évoquent en quelques lignes un scénario digne d'un roman de science-fiction, où Canetti imagine le futur, pour le moins sombre, de l'humanité : cf. pp. 332, 364, 406.
(16) Exerçant son attraction sur tous et, d'abord, sur les plus sensibles représentants de l'humanité, les écrivains. Voir le beau portrait que fait Canetti du Tasse, comme désireux de se soumettre à la puissance quelle qu'elle soit (cf. pp. 399-400). Canetti de conclure : «Point de salut pour les poètes dont l'angoisse veille et qui veulent rester eux-mêmes. Ils peuvent, un certain temps, se rendre à l'une des grandes unités collectives, mais non lui rester dévoués lorsqu'ils vivent dans son domaine» (p. 400).




























































 Imprimer
Imprimer