« Léon Bloy ou le pont sur l'abîme de Jacques Vier | Page d'accueil | Martin Eden de Jack London : des causes d’une grandeur et des raisons d’une déchéance, par Gregory Mion »
19/07/2018
Trois buccins de l’Apocalypse : Baudouin de Bodinat, Matthieu Grimpret et Leonardo Castellani

En attendant la fin du monde de Baudouin de Bodinat (éditions Fario)
 Acheter En attendant la fin du monde sur Amazon.
Acheter En attendant la fin du monde sur Amazon.Quelque chose me gêne dans le dernier texte de Baudouin de Bodinat, En attendant la fin du monde paru chez Fario, un éditeur aussi discret qu’intéressant qui a d’ailleurs publié, en livre ou en revues, plusieurs textes du grand Sebald. Bien avant Baudouin de Bodinat, ce dernier avait pour coutume de proposer des textes comprenant des photographies ayant une signification directe, ou bien indirecte mais pas moins flagrante, avec le récit proposé. Mais, là où l’auteur de Vertiges n’en finissait pas de suivre une piste que lui seul savait pouvoir suivre, en déployant une écriture aussi attentive aux plus extrêmes détails que capable d’attirer notre attention sur les correspondances subtiles existant entre les cercles concentriques s’étendant depuis un abîme de noirceur, Baudouin de Bodinat ne nous mène nulle part et même, comble de l’ironie, nous laisse sur place.
Ce quelque chose qui me frappe puis, dans le même mouvement ou presque, me gêne dans le livre de Baudouin de Bodinat qui eût pu s’intituler Petit précis de phraséologie à usage réactionnaire, c’est rien de moins que l’écriture même de l’auteur. Sa structure n’est que faussement complexe, puisqu’elle est décomposable en un usage monomaniaque de participes présents et d’infinitifs qui sont moins enchaînés que juxtaposés et nous donnent ainsi l’impression d’un emboîtement de phrases entre parenthèses et d’incises s’étendant avant qu’un point final ne vienne, passagèrement du moins – avant une nouvelle explosion obéissant au même principe de gonflement irrésistible – clore cette expansion qu’on dirait invincible, et qui ne semble devoir faire halte que lorsqu’elle est figée par une photographie de rue déserte de village perdu, photographies prises, nous dit-on, par le biais de pellicules périmées, et qui apportent un contrepoint utile, par leur extrême dépouillement et même pauvreté volontaire, aux tortillements des phrases butant sur des rues désertes, où sont banalement garées des voitures banales, sous un ciel bleu lui-même insignifiant, ou bien «sous le ciel diffus; ou quand l’été s’étiole, se perd en rêverie du proche automne» (p. 68). Michel Houellebecq, désormais considéré comme un photographe, eût montré plus de volonté d’enjoliver le vide d’une bourgade de province où rien ne se passe, «moindre ville de province indécise» comme l’écrit l’auteur, mais c’est justement de cette volonté que Baudouin de Bodinat se tient éloigné, aussi sûrement qu’il se tient éloigné, du moins c’est ce que l’on veut nous faire croire (et, pour m’amuser, je l’imagine envoyer par courriel son manuscrit à son éditeur, ou bien, plus désuet encore, en l’enregistrant sur une clé USB) d’un des moyens modernes de communication par lesquels l’essence de notre monde, s’il n’a pas complètement plié bagage comme l’aura selon Walter Benjamin, se dilue et dissout. C'est donc moins la fausse complexité du style de Baudouin de Bodinat que la maigreur des résultats obtenus : quoi, tant d'incises, d'escaliers embranchés sur des escaliers, tant de portes ouvertes pour nous mener dans une cabane pas même débranchée mais équipée d'un ordinateur dernier cri et bien sûr d'une connexion, depuis laquelle nous pouvons envoyer notre texte soulevé d'une indignation qu'un livre de Jacques Ellul, qu'une ligne de Gustave Thibon eût aisément concentrée.
Une seule fois, à la dernière page de son livre, cette écriture syncopée, comme désireuse de mimer la froideur minérale ou plutôt machinale de notre modernité décriée, une seule fois l’écriture de Baudouin de Bodinat se risque à ne pas ahaner mais à s’élancer en trois phrases qui n’en sont qu’une et qui annoncent ce que d’autres livres, ceux qui suivront peut-être, auront à charge d’explorer, «cette transparence où quelque chose en soi semble sur le point de s’ouvrir et tout réconcilier» (p. 70). J’exagère, car ce village, lieu de la déambulation photographique de l’auteur, apparaissait dès les premières lignes sous la forme de tel «vieux quartier de ce gros bourg», mais aussi du beffroi demeurant «inflexible à égrener les heures» (p. 12) comme s’il fallait, pour que la banderole des récriminations de Baudouin de Bodinat soit déployée au-dessus de nos têtes diantrement modernes, qu’elle soit plantée entre deux piquets champêtres d’un de ces lieux, si communs dès que nous quittons les grandes villes, si communs qu’ils ne peuvent que nous faire suspecter que c’est le texte lui-même de l’auteur qui est une série de clichés, et sa volonté d’encadrer de simplicité (prétendument) provinciale voire paysanne un texte savant.
Cliché du cadre bucolique où le dernier sage attend la catastrophe qui vient, la catastrophe qui est déjà là plutôt, la catastrophe qu’il est trop tard pour éviter mais non point pour déplorer, ce sera un livre de plus pour les journalistes après tout. Clichés que tous ces termes, parfois des trouvailles heureuses, mais noyées dans une foule d’autres termes rapidement entrechoqués, que l’on dirait avoir été moins inventés que méthodiquement alignés par un Renaud Camus qui n’aurait pas complètement perdu le sens de la phrase et saurait, partant, que son empilement de «que» et de «&» n’a d’autre sens que se fondre dans le silence minéral d’une fin d’après-midi de bourg oublié, autant de piquets devant lesquels toutes les vaches journalistiques vont venir mâcher leur ration de lieux communs agrémentés d’un peu de fortifiant aux hormones, «sage expansif» (p. 11), «édifice social», «radiovision» ou «optiphone» (p. 12) plusieurs fois répétés, «sonorisation distractive» (p. 13), «économie d’exploitation et de pillage» (p. 17), «économie concurrentielle» (p. 23) ou encore, et ce sont les trouvailles dont j’ai parlé, «hypoxie spirituelle» (p. 57), «dégénérescence maculaire de la conscience» (p. 58), «lumignons [qui] filent, s’étouffent et puis charbonnent» (p. 18), comme si l’auteur, sur lequel tant de spéculations courent, pour gagner sa vie avant que le Septième Sceau ne rende définitivement caducs ses efforts de vigie, officiait en tant que rédacteur des débats et par ce biais alimentait son lexique professionnel de tous les termes entendus lors de réunions de Conseil d’Administration ou de Comité d’Entreprise, sans oublier celles des CHSCT, ou Comités d’hygiène et de sécurité au travail.
Nous ne sortons guère quoi qu’il en soit, écriture savante et même précieuse ou pas, plates photographies suintant l’ennui et choisies pour cette raison, de la réaction, au sens le plus commun et banal du terme, long ver cavernicole dont Renaud Camus tiendrait la queue translucide et Alain Finkielkraut la tête aveugle (à moins que ce ne soit l’inverse, pour éviter toute allusion graveleuse dont on me supposerait coupable) en passant par Éric Zemmour, la poissonnière de Causeur et toute la clique piaillante des oisillons martiaux recevant la becquée dans le nid de L’Incorrect, de l’indigent écrivant Yrieix Denis écrivant avec un organe par lequel tout mammifère expulse ce dont son corps n’a pas besoin jusqu’à Matthieu Baumier écrivant avec les pieds de Philippe Sollers, en passant par Romaric Sangars qui, lui, aimerait bien écrire avec sa main et doit se contenter d’un moignon d’esthète gourmé, sans oublier le légendaire phénix de ces hauts lieux de la consanguinité Jacques de Guillebon qui, lui, n’écrit avec rien du tout mais remplit quand même des pages entières de ses fulminations apoplectiques d’adolescent brûlé par la vision du Buisson ardent et qui doit je le suppose beaucoup aimer les textes de Baudoin de Bodinat, pour cette exquise raison que l’auteur lui donne des mots bien frappés, journalistiques donc, qu’il pourra citer dans ses revues de presse nulles.
C’est finalement peut-être cela qui manque au maniéré Baudouin de Bodinat, l’un des plus récents surgeons de ce que Julien Benda appelait le byzantinisme, sorte de croisement puissant mais instable entre le matois pessimiste Michel Houellebecq et le remarquable Jaime Semprun qui a tout dit avant lui, et dans des phrases dont la mordacité le dispute à la perfection, c’est cela qui manque à l’auteur de La Vie sur Terre, la simplicité militante d’une foi farouche, de charbonnier si l’on veut bien que cette honorable profession n’existe plus en France ni même, sans doute, en Europe, une ligne de basse en somme à son chant trop travaillé pour être autre chose que l’un des rhizomes surprenants mais point aberrants de la modernité qu’il décrie à longueur de phrase à enchâssements se voulant antimodernes et n’étant que l’extrême proue du navire rutilant mais aveugle sans son pesant barda électronique qu’est notre époque terminale. Ligne de basse qui, comme «le beffroi [qui] demeure inflexible à égrener les heures» (p. 12), permettrait à Baudouin de Bodinat de ne point se contenter de se lamenter sur le monde comme il ne va plus du tout mais accepterait de souffrir pour lui et, d’une certaine façon absolument scandaleuse, kierkegaardienne, évangélique, le rachèterait. Pour le dire encore plus simplement, et je m’étonne que Sébastien Lapaque, d’habitude si attentif à détecter les failles les plus intimes, ne l’ait pas vu, Baudoin de Bodinat est un homme, du moins un auteur triste, à la différence des deux autres que nous allons évoquer, Matthieu Grimpret et le fou écrivant qu’est Eduardo Castellani. Il manque à Baudouin de Bodinat une échappée que laissent entrevoir, je l’ai dit, les toutes dernières lignes de son texte mélancolique et peut-être même désespéré, un solide maillet pour entamer l’édifice coruscant de tant de phrases qui l’emprisonnent : «& aussi que peut-être tout le monde se doute qu’au point où en sont les choses (en vision cavalière, ou aérienne à survoler ces périphéries de lotissements, de banlieues informes qui vont s’épaissir en entassements chaotiques d’habitations et de fonctions urbaines, et ainsi de suite à perte de vue recouvrant la Terre de cette densité de peuplement en survie assistée), c’est tout simplement sans solution. Sans plus aucun moyen pour l’espèce humaine de se dégager de ce piège où elle est entrée et qui la tient» (p. 59).
Notre royaume de Matthieu Grimpret (LGM Éditions)
 Acheter Notre royaume sur Amazon.
Acheter Notre royaume sur Amazon.J’avoue avoir été tout proche de sombrer dans le plus mélancolique découragement en lisant quelques-uns des plus récents ouvrages de ce qui passe pour de la littérature ou bien des témoignages d’inspiration chrétienne, voire spécifiquement catholique. Je n’évoquerai pas de nouveau le juvénilement martial Conversion de Romaric (Beau) Sangars, qui finira bien par dépasser son maître et ami en palabres creuses Jacques de Guillebon, ou bien tel essai, le millième sans doute, de la florissante petite entreprise Hadjadj & Cie, qui d’ici peu lancera sur le marché une compilation de comptines chantées et jouées par notre petite famille apostoliquement consacrée, des bougies sentant bon la myrrhe et l’encens, et peut-être même des harmonicas qui se déclencheront automatiquement pour jouer de petits airs entraînants et ainsi marquer d’utiles bien que répétitives prières toutes les heures d’une journée dévotement dédiée à Dieu. Tout cela, c’est-à-dire si peu voire rien, aurait déjà disparu si je n’en avais parlé, même s’il est dit que Dieu n’ignore rien du tout du dernier brin d’herbe perdu au fin fond d’une grotte inexplorée.
Matthieu Grimpret, dont je ne savais jusqu’alors strictement rien si ce n’est que nous avions un ami commun qui m’est très cher, m’a demandé la permission de m’envoyer son texte paru en 2017 aux éditions LGM, intitulé Notre royaume ou plutôt Notre Royaume. Je n’y ai plus du tout pensé je l’avoue jusqu’à ce que je commence sa lecture, achevée très vite tant ce beau texte dit l’essentiel, sans aucune de ces fioritures jaculatoires insupportables dont usent sans vergogne nos récents convertis qui, comme tous les convertis, se croient obligés de gueuler sur tous les clochers que Dieu a soulevé leur cœur et même peut-être tel autre organe, ce qui leur fait immédiatement penser qu’ils ont pour unique destin, outre celui de nous bassiner, le martyre, en étant soumis aux plus atroces souffrances qui leur seraient infligées par de mécréants islamistes, du moins qu’ils sont autorisés à le haranguer lors de soirées parisiennes où il fait bon se graisser la main d’eau bénite et de compliments évangéliques : «Que ton dernier livre est beau !, mon cher Jacques !»; «Que ton article qui salue la beauté de mon dernier livre est juste, mon cher Yrieix !»; «Que ta maison d’édition est riche de grands livres, mon cher Léo !»; «Quelle joie je me fais de t’y publier, mon cher Romaric !» et puis, enfin, avant que tous ces animalcules à antennes et dents longues quoique translucides : «Quelle grande chose que nous nous empoissions de bave en gaie farandole œcuménique, mes chers tous !».
Matthieu Grimpret, se tenant à ma connaissance loin de ces petits raouts moins sanguins que consanguins où ces premiers de cordée transcendantale se reconnaissent les uns les autres à leur tatouage ecclésial, a rappelé quelle doit être la première exigence du chrétien, que ne manqua d’ailleurs pas de crier dans son premier (et dernier, hélas) beau livre Fabrice Hadjadj, Et les violents s’en emparent . Cet impératif catégorique est, d’abord, moral ou, allais-je dire, vital : s’élancer, marcher, ne jamais s’arrêter, afin que notre marche et notre mouvement s’accordent avec le mouvement initial prodigieux par lequel Dieu a créé l’univers en perpétuelle expansion. Seule cette mise en branle de toutes les ressources du corps et de l’esprit, de l’âme bien sûr aussi, peut nous laisser entrevoir que notre royaume, le Royaume, est pure densité, dimension qui nous leste d’une poids et même d’une gravité que nous n’avons pas le droit de refuser, ni même d’écarter de nos épaules : «Le Père me l’a encore dit, lors de notre dernière rencontre : l’homme est fait pour la densité. Il est fait pour recevoir la mesure bien pleine, bien tassée, débordante, dont parle l’Écriture. Il est fait pour que toutes les dimensions de sa vie se tiennent fermement ensemble, réunies sous un même chef et dans un même rayonnement, comme la chair d’un fruit s’alourdit au soleil, comme les doigts d’une main paternelle forment un poing qui, élevé bien haut dans le ciel, inspire confiance. Non pas d’abord une confiance en quelqu’un d’ici-bas pour quelque chose d’ici-bas – une confiance tout court, une confiance ontologique, une confiance d’un autre ordre, une confiance qui vient d’ailleurs et que nul ne saurait qualifier convenablement, la confiance simple de l’homme vivant et debout» (pp. 16-7). Matthieu Grimpret commente ici de la façon la plus succincte et juste Charles Péguy, en mimant son style fait de répétitions qui pourtant jamais ne nous donnent l’impression de la redite ou de la phrase qui s’encalmine, encore moins du petit rythme haletant par lequel les béjaunes plus haut cités expulsent leurs ridicules créations verbales, mais au contraire évoque le mouvement de la vie reçue qui toujours doit s’inscrire dans le grand fleuve du monde, puisque l’homme, parmi tant d’autres définitions possibles, est celui qui comprend, à moins d’être aussi emmuré qu’une veine d’or au sein de son bloc de roches inamovibles, qu’il y a sous les choses «autre chose de plus puissant, de plus efficace, de plus vivant que ces milliards de molécules si simples» (p. 18) : un cœur qui bat, une âme à ouvrir, un souffle du vent qui est «le signe de l’histoire en marche», qui «rappelle à nos cœurs et à nos corps que la figure de ce monde passe, et qu’il faut avancer» (p. 58).
Qu’il s’agisse d’habiter le Royaume qu’il faudra une vie pour parvenir à entrevoir bien davantage qu’à espérer fouler sa terre chaude, maternelle, de ses pieds, et encore, en ayant réussi à s’extirper de la boue puante du Chantier, ou qu’il s’agisse d’apprendre à aimer, Matthieu Grimpret n’a de cesse de nous redire que l’homme n’est pas à l’origine de l’homme, et cela jusqu’en ses actes les plus communs et humbles, puisque la vie n’est pas produite par lui, mais qu’elle vient d’ailleurs (cf. p. 19), comme le vent qui nous précède et qui pourtant, toujours, est là, comme le Royaume plus tremblant qu’un mirage et qui, pourtant, lui aussi, se trouve sous nos pas, en nos cœurs : «Cette demeure, ces conditions d’habitation doivent venir d’ailleurs, l’homme doit les recevoir d’un autre, d’un père, d’un père qui soit le père des choses, le père des êtres, et leur architecture intentionnelle prend la forme d’un désir – et donc d’un mouvement, et donc d’un temps, et donc d’un espace» (p. 23). Je ne sais si Matthieu Grimpret a lu les plus beaux livres (beaux, ils le sont tous à vrai dire) de Max Picard, mais je l’invite sans tarder à se procurer un ouvrage comme La fuite devant Dieu, où il trouvera thématisées ses interrogations sous une forme plus philosophique que la sienne, pas moins poétique cependant.
Ce n’est pas le seul auteur, avec Péguy je l’ai dit, des textes duquel nous pouvons rapprocher ce que nous donne à voir et comprendre Matthieu Grimpret, car nous pourrions tout autant songer, en lisant Notre royaume, à un très beau récit symbolique comme L’Avenue de Paul Gadenne, où l’architecture, le plus souvent en ruine, des bâtiments que découvre le narrateur n’a de sens que de nous faire assez vite supposer l’existence d’un invisible qui ajointe entre elles les dimensions par lesquelles le monde et le temps s’éploient, et qui mastique les différentes composantes de telle ou telle construction énigmatique, pour les dresser comme des signes à déchiffrer. Évoquer Paul Gadenne à propos du beau texte limpide de Matthieu Grimpret, c’est aussitôt, cela va de soi, éloigner ce dernier du rivage où le pédalo réactionnaire de Romaric Sangars prend la pose d’un Béhémoth gonflé à l’hélium et piteusement encalminé dans la flache de la prétention et de la pose éternellement adolescente.
Je ne voudrais pas écraser le texte de Matthieu Grimpret, texte dont la première vertu est après tout de se tenir debout sans béquilles, sous de trop pesantes références, mais j’avoue que cette recherche de la seule liberté qu’il importe de conquérir, du seul «Royaume à habiter» (p. 27) m’a rappelé la tentative réellement extraordinaire d’un Carlo Michelstaedter qui, lui aussi, n’eut de cesse qu’il trouvât la «densité absolue» (p. 35) de la vie, qu’il désignât «un dynamisme de densification qui s’achèvera dans cette plénitude que nous […], nous les héritiers, avons déjà goûtée» (p. 34), densité absolue donc et réelle présence en somme derrière laquelle tente de courir tout homme un peu lucide, et que, désespérant de savoir que jamais il n’y accèderait, ce même Carlo Michelstaedter décida au moins de rejoindre par un acte définitif, mettant enfin en résonance ses propos et ses actes, le suicide par lequel il décida de conclure sa vie intranquille et foudroyante.
Le parcours de Matthieu Grimpret semble moins tourmenté que ne l’a été celui de l’auteur de La persuasion et la rhétorique, même si nous ne savons rien des gouffres qu’il a peut-être dû traverser sans trop tenter d’en apercevoir le fond, même si nous ne savons pas grand-chose de l’enseignement que le Père lui a délivré, si ce n’est qu’il faut passer « de l’aisance à la présence » (p. 86), mais il n’en reste pas moins que Notre royaume semble garder la trace secrète de bien des épreuves, la confiance rayonnante de l’auteur pouvant après tout être considérée comme l’obole donnée en gage pour payer la rude traversée, la traversée exténuante de la mer de poix dans laquelle mon propre Judas n’a pas craint de s’aventurer. Hypothèse folle, mais qu’autorise je crois une certaine forme de lecture interprétative et symbolique typiquement bloyenne : Notre royaume de Matthieu Grimpret est la découverte du territoire sur lequel le narrateur de mon propre livre de prière n’a pu ou n’a voulu s’avancer.
Affirmant cela, je vérifie, une fois de plus, qu’un texte véritablement littéraire s’ouvre, se déploie à partir de son axe de giration, se place pour ainsi dire dans la route ouverte (via rupta) par ce qui le précède depuis des siècles, des millénaires, de toute éternité mais cette image est fausse nous apprend l’astrophysique puisque l’univers a un début; un beau texte célèbre et chante, remercie ce qui l’a précédé et qui a existé alors qu’il n’existait pas, et qui fait office de catapulte vers un ailleurs qu’il ne fait qu’entrevoir et attendre impatiemment, attendre comme tout grand texte sait attendre, c’est-à-dire en étant frémissant devant ce grand rideau qui ne pourra, un jour, demain, dans une minute ou un milliard d’années, se déchirer. Au contraire d’un grand texte, un petit texte, pourquoi pas l’un de ces crachats verdâtres qu’un Édouard Louis n’en finit pas de jeter autour de lui pour, croit-il, marquer son territoire si lamentablement étriqué, se replie frileusement sur lui-même et, plutôt que se dresser la main en visière pour scruter ce qui se trouve devant lui, hors de sa portée mais point d’une nature cependant différente, tape sur l’épaule de son voisin, lui aussi nain, se réconforte à si bon compte, roule des yeux à son adresse et lui demande de le rassurer si possible bien vite dans leur commune médiocrité : «Tout homme qu’une histoire saisit peut la saisir en retour, et chaque chose émet alors pour lui la musique d’un univers qui avance, un univers dont il fait partie et qu’il contemple, à tout instant, au quotidien, du plus haut sommet» (p. 40). Une fois encore, il importe infiniment moins de localiser le Royaume, de quitter le Chantier en s’extrayant de «cette cinétique désordonnée, ces parcours désespérés [qui] tissent un maillage de peurs qui n’est pas une densité, mais une nuit» (p. 47), que de se mettre en branle, de décider de le chercher, et de se laisser porter par le flux ou le flot du monde, d’avancer, «de partir, d’obéir aux inclinations libératrices de notre nature vouée à un enrichissement, à un perfectionnement, à une imprégnation, à une densification» (p. 53), en unissant son chant au chant d’un monde qui semble lui-même se hâter d’aller vers quelque destination mystérieuse, apocalyptique par essence nous soutiennent les plus vieux textes et tous les textes qui croient bon de rendre hommage à ces derniers, même d’une seule lettre, où seront consommés sa course folle et son destin, puisque quelque chose finira bien par surprendre les hommes (cf. p. 43).
«Une puissance s’exerce qui secrète une histoire – une histoire qui donne sa consistance à ma propre histoire, une histoire fondamentale» (p. 61), s’il est vrai que «l’histoire est un mouvement, une aventure, un frisson qui parcourt la chair des hommes elle-même» (p. 62), qu’importe si se dressent alors assez vite devant notre regard rivé sur l’horizon quelques mirages qui après tout ont pu fasciner un Rimbaud, un Dominique de Roux, un Michel Vieuchange ou un François Augiéras, et que le Père aura pour charge de désigner comme des mirages, des mannequins perclus remplis d’un peu de bourre, et que l’Aimé, amant de chair qu’il ne s’agit certes pas d’imaginer, lui pour le coup, comme un épouvantail chétif et étique, fixera de son regard confiant où plonge le vôtre : «Notre attrait si profond pour le désert, pour les savanes immenses, pour les pistes rectilignes, pour tous les horizons qui se donnent à l’âme et aux yeux dans leur brutalité prometteuse nous avaient peut-être conduits aussi dans les coulisses de quelque chefferie Coca-Cola, au Mozambique, au Tadjikistan, barbouzes en esprit sans vérité, éminences grises aux biceps de poulet, trafiquants de soufre à lunettes fumées. Et nous aurions joué les Rimbaud, qui ne voulait plus entendre parler de «ça» – mais nos estomacs ne tenaient même pas la littérature, nous n’avions rien d’autre à fuir que les plates névroses de notre siècle» (pp. 63-4).
De fait, comme chez Péguy, il y a dans le texte de Matthieu Grimpret une vision puissante de l’ordonnancement du monde qui jamais n’oublie l’humble vie des jours, l’«hommerie périssable» (p. 99) qui, aussi, est cet aimé perdu et plus que lui, l’ensemble des femmes et des hommes que nous croisons au moins une fois dans notre vie, car seule une perte vous pousse à avancer sur la voie que vous refusiez d’emprunter lorsque vous enchaînait la réconfortante mais fallacieuse proximité de la chair douce, d’un corps délié à vos caresses et leur répondant merveilleusement. La discrétion avec laquelle Matthieu Grimpret alterne ces deux chants, l’un de la perte et l’autre de la mise en mouvement, de l’élan ou, pour le dire avec Kierkegaard, de la Reprise, est admirable et, une nouvelle fois, le nom du grand Gadenne nous est soufflé, qui dans l’un de ses textes, La rue profonde, affirmait qu’il fallait parvenir à écrire comme l’océan parvient durant des siècles à polir un galet : «En soufrant de ton absence aujourd’hui, à chaque minute du jour, ce n’est pas de la privation d’une jouissance que je souffre; c’est de la privation d’une promesse – la promesse d’un autre chemin vers Lui. Cette promesse, c’était ton rire, ta main, tes yeux, ton chant, ta pureté, ta prière» (p. 95). C’est peut-être cette perte, en ce qu’elle nous arrache brutalement aux illusions par lesquelles nous engourdissions notre vitalité et nous attachions trop craintivement notre élan irrépressible, qui nous apprend à nous lancer sur la route mordorée sur laquelle Bernanos jette ses personnages les plus habités de milles voix, point toutes bienveillantes on le sait et sur laquelle, à son tour, en souriant bien davantage qu’en riant trop fort comme tous ces convertis de salle de rédaction, Matthieu Grimpret s’est élancé.
Note
(1) Matthieu Grimpret, Notre royaume (éditions LGM, 2017). Le texte a été soigneusement relu, dans lequel nous n’avons relevé que deux fautes, un accord au féminin absent («sur les parois dorés des montagnes soumises», p. 76) et un «que» manquant («Responsabilité qu’on nous arracherait moins facilement une main ou un œil», p. 78).
Le Verbe dans le sang de Leonardo Castellani (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, introduction, choix des textes et traduction de l’espagnol par Érick Audouard)
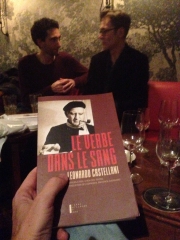 Acheter Le Verbe dans le sang sur Amazon.
Acheter Le Verbe dans le sang sur Amazon.C’est parce qu’il attend impatiemment l’Apocalypse, tout en ne cessant de se plaindre de la bêtise et de la dégénérescence de notre époque que Leonardo Castellani ne retient, comme Léon Bloy auquel il a consacré une belle note, aucun de ses coups. Ne trouve-t-on pas, dans un ouvrage intitulé Les Chansons de Militis dont le seul titre nous laisse augurer quelques réjouissantes tournées de baffes, l'affirmation selon laquelle il est un homme en guerre ? Ne savons-nous pas que ses dernières paroles auraient été :«Me rindo», autrement dit «Je me rends» ? Ailleurs, ne nous parle-t-il pas avec fort peu d'aménité de la démocratie, dont il oppose la faiblesse intrinsèque à la force de la monarchie chrétienne qui, «en dépit de ses péchés et de ses crimes, fit les cathédrales et les épopées» ? (voir La démocasserie libérale, p. 165).
Érick Audouard, dans sa très belle introduction (1), affirme de ce «curé maudit», «homme à l’envers dans un monde à l’endroit» (p. 14) (curieusement, nous aurions affirmé l’inverse !) manifestant une «intolérance absolue au vague dans les choses de l’esprit» (p. 17), ou encore «né pour forcer son temps à reconnaître l’absolu chrétien» (p. 15), qu’écrire «des livres, donner des cours ne suffit pas, il faut descendre de sa chaire dans la fosse à purin, dans les lieux louches où turbine à plein régime, avec une efficacité prodigieuse, cette industrie à polluer toutes les sources de la pensée qu’on appelle la presse» (p. 24). D’ailleurs, servant au mieux la pensée de celui qui sans cesse fut rejeté par ses supérieurs jésuites, dont il se venge en pointant la médiocrité de la Compagnie de Jésus dans un magnifique article sur Gerard Manley Hopkins, Audouard lui-même n’hésite pas à se montrer offensif en rangeant celui dont il sera définitivement l’introducteur en France, cet homme d’un bloc d’intelligence, d’humour et de volonté «qui cria de toutes ses forces dans les oreilles ensablées du désert argentin» comme me l’a écrit Érick Audouard dans sa dédicace, «et dont la voix résonne ici pour la première fois dans le nôtre», dans la catégorie assez peu recommandable de ceux qui servent la vérité, et qui par conséquent toujours subiront les railleries de ceux qui se servent de la vérité : «les premiers n’ont pas d’endroit où reposer leur tête, les seconds s’établissent. Les seconds sont normaux, les premiers sont exceptionnels» (p. 19).
Insupportable Castellani qui nous réveille en hurlant à nos oreilles, qui accable, comme le fit le Christ, les pharisiens, qui, dans un autre ordre d'idées (encore que), raille la verroterie dans laquelle le prestidigitateur Borges parvient tout de même à glisser quelques authentiques diamants, qui moque Wells mais aussi Anatole France (2), Albert le Suisse (Albert Schweitzer) ou Teilhard de Chardin et loue au contraire le dernier Oscar Wilde, qui gueule encore, seul ou presque contre tous et d’abord contre ses supérieurs mithridatisés contre toute forme d’art véritable, depuis la perte qu’est notre époque : «Il n’y a pas lieu de discuter avec ceux qui n’en partagent pas l’évidence; croupions au vent et becs dans le sable, les autruches se voient un bel avenir. Jamais la volonté d’ignorer n’aura été aussi forte, jamais elle n’aura été aussi satisfaite. Sous la pression de l’ignorance volontaire, le sens commun a basculé dans l’insensé collectif, et notre pauvre langage est tellement corrompu qu’il est presque hors d’usage» a ainsi raison d’écrire notre traducteur et préfacier, qui ne fait que suivre attentivement la leçon de Leonardo Castellani qui lui, discrètement mais avec une constance qui ne peut être le fruit du hasard, affirme que nul «n'ignore que tous les mots ont été démocratisés par notre époque démocratique» (Albert le Suisse, p. 228). Et quand on sait comment l'auteur se moque de la démocratie qu'il compare, au terme d'une hilarante parodie d'un dialogue socratique (voir Le nouveau Socrate, pp. 219-22), non seulement à une autruche mais au nazisme qui est son plus évident frère jumeau au terme de cet exercice de raison raisonnante poussée au bout...
Il est à ce titre étonnant de constater que lui aussi, comme Baudouin de Bodinat, stigmatise la défiguration du monde à laquelle l’homme se livre, tel passage éclairant pouvant même condenser utilement les phrases inutilement savantes, parfois obscures, de cet auteur : «La chair, désanctifiée, s’attriste, tandis que l’air devient irrespirable, comme si nous avions interdit à l’Esprit de souffler. La pollution industrielle et le «réchauffement climatique» n’y sont pour rien : seul l’imbécilité et le gel des cœurs ont rendu possible la grande clinique en quoi nous tâchons désormais de changer la terre après l’avoir défigurée» (p. 46) alors même que, «phase terminale de l’humanisme, le mal nommé «transhumanisme» culmine au sommet de ce long procès qu’aura représenté notre expulsion de Dieu» (p. 47). Ailleurs (Vous avez dit révolution ?, p. 157), Castellani affirme qu’il y a «un tel chaos dans le langage et une telle purée de pois dans l’époque» que la mission du «vigile chargé de veiller sur les concepts» qu’il déclare être «devient chaque jour plus terrifiante» et c’est dans ce même article qu’il affirme que «le terrible phénomène de «la confusion des personnes», déploré par Dante, s’est propagé en prenant des proportions universelles : «il ne reste plus aucune doctrine qui ne puisse être falsifiée depuis la falsification de la doctrine catholique elle-même dans cette monstrueuse hérésie appelée modernisme» (p. 158, l’auteur souligne).
C’est dans ce monde que sonne la voix railleuse, érudite et méchante de Leonardo Castellani, voix «puisant son timbre et sa bonté au saloir des Évangiles» (p. 48), voix qu’il faut donc à présent relayer en espérant nous aussi qu’elle ait le «coffre nécessaire pour résonner dans une époque aux enjeux d’autant plus grands que les hommes y sont petits» (p. 49).
Ainsi planté, le décor a de quoi épouvanter, mais nous n’avons encore rien vu, car il s’agit maintenant d’écouter ce que ne cesse de nous répéter celui qui proclame l’aridité totale et le désespoir de notre époque, sur les brisées d’Hilaire Belloc (cf. p. 57), désespoir d’un «monde tombé des mains de Dieu» et qui, conséquemment, «agonise et crève à la pelle parce qu’il lui manque une raison de vivre» (p. 63, Le désespoir païen, l’auteur souligne), alors même que les hommes semblent avoir oublié quel en était le Père, puisque, pour «le monde moderne, Satan est mort, et les poètes ne craignent plus d’utiliser sa chair et ses tripes pour farcir leurs poétiques andouilles» (p. 121, Papé Satán, papé Satán aleppe). «Depuis Blake jusqu’à Dostoïevski, écrit Castellani dans un autre article (Perception du démoniaque), depuis Baudelaire jusqu’à Kierkegaard, les grands hommes de lettres du XIXe siècle ont vu et senti avec une grande lucidité le phénomène de la perversité, c’est-à-dire du démoniaque» (l’auteur souligne), et cela alors même que notre époque a tout abâtardi, «que le criminel s’est désormais transformé en malade, le pervers en individu blessé par la vie, le possédé en hystérique ou en épileptique», l’objectif ayant été de «sauver le diable avec élégance, en le fardant et en le maquillant» (p. 142).
Ce monde qui ne croit plus à rien ni en quoi que ce soit, Dieu ou diable, se voit déserté par la grâce qui, «de nos jours, avec l’empoisonnement de ses sources naturelles, ne fonctionne plus que de manière souterraine et quasi sauvage» (p. 113, La geôle d’Oscar Wilde), par exemple en touchant, en foudroyant peut-être, le Wilde sortant de prison et qui y comprit que, «en tant que poète, la douleur de tous, c’est-à-dire la douleur de l’homme, était amenée à se refléter à l’infini dans les facettes de son âme cristalline» (p. 111).
S’il est moqué, exclu, ignoré puis oublié, Leonardo Castellani ne se prive pas de nous avertir que ses frères d’armes sont puissants, même si, à la différence de ces derniers, lui ne semble pas avoir découvert la foi «à travers le péché» : «si le pharisianisme» oppresse et persécute Charles Baudelaire, Oscar Wilde et Léon Bloy, «c’est pour la simple raison qu’ils se refusent à le servir, en vertu du privilège de l’artiste, de son droit souverain à la liberté, privilège et droit dont ils se sont faits les douloureux défenseurs, tout en sachant qu’ils n’avaient pas les nerfs assez solides pour gagner ce combat» (p. 105).
Entendons-nous bien sur ce mot de liberté, qui ne doit certes pas être compris au sens rousseauiste du terme, puisque, nous le savons, l’art meurt de libertés et vit de contraintes, ce que Castellani affirme non seulement en moquant Rousseau mais en évoquant Leopoldo Lugones disant que «seul le mauvais poète exige le vers libre», alors que «le bon poète multiplie les attaches de son matériau pour rendre plus visible le triomphe de la forme, en quoi consiste la beauté» (À l’école de Rousseau, p. 153). Ironiquement, Castellani ne goûte guère ce parangon de la conquête de la liberté selon les modernes qu’est la Révolution française, qui lui permet de lancer une vacherie à la tête des socialistes : «Cet abus de langage s’est clairement manifesté quand un socialiste déclara un jour à Donoso Cortés : «Jésus-Christ fut le premier révolutionnaire du monde» – ce à quoi l’orateur espagnol répondit : «Certes. Mais Jésus-Christ ne versa pas d’autre sang que le sien.» Si Donoso Cortés, en plus d’être orateur, avait été philosophe et saint, avec une petite dose d’homme d’action», poursuit ironiquement Castellani, «il lui aurait répondu plus laconiquement : «Diable !», avant de lui flanquer une gifle dans la figure, le libérant ainsi d’une erreur, et libérant à jamais l’humanité de cette stupide manie de mélanger les concepts qui est propre aux orateurs. Propre aux orateurs socialistes, toujours; aux autres, trop souvent» (Vous avez dit révolution ?, p. 159).
Dans un monde «devenu frénétique» (Charles Quint et l'imprimeur, p. 187), cette attention au sens des mots, «ces maudits mots fumeux qui sèment la confusion» (L'ultime hérésie, p. 175), est du reste constante dans l'ensemble des textes de Leonardo Castellani, la corruption du langage, son chaos («Il y a un tel chaos dans le langage et une telle purée de pois dans l'époque», Vous avez dit révolution ?, p. 157), dus à l'explosion journalistique (3) elle-même fruit de la reproduction sans limites des mots (4), étant probablement à l'origine de ce que l'auteur appelle la «falsification de la culture», falsification contre laquelle nous ne pouvons que faire pénitence, autrement dit, d'un point de vue étymologique, changer d'esprit, se mettre à voir les choses telles qu'elles sont, dire et penser profondément la vérité. Prendre la peine d'approcher la vérité. Car on ne peut l'approcher sans peine» (Professionnels, p. 183, l'auteur souligne). Il y a autre chose que cette falsification de la culture : il y a «le risque de la perversion interne du christianisme» (Culture ou culturopathie, p. 173, l'auteur souligne) que Castellani rapproche du risque pointé par Kierkegaard (qu'il nomme comme il le prononce, soit Kirkegord) concernant un glissement sur le seul plan esthétique puisque, après tout, comme l'auteur l'écrit non sans beaucoup de malice, le «Christ n'est pas mort sur la croix pour qu'existe un jour La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach» (Ibid., p. 172). Nous pourrions d'ailleurs évoquer plus longuement ce que Castellani écrit sur Kierkegaard, qu'il a comparé dans un livre encore inédit dans notre langue à saint Thomas d'Aquin, Kierkegaard (pardon, Kirkegord), qualifié d'«authentique Hamlet», «vivant signal qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark», objet d'une belle méditation à valeur générale que nous pourrions résumer par cette sentence aussi admirable que juste : «Un homme seul n'a pas le pouvoir de sauver une société de la ruine, mais Dieu peut faire d'un seul homme le signe qu'une société court à sa perte» (Le geste de Kirkegord, p. 236).
Ailleurs, Leonardo Castellani évoque ce qu'il nomme la fiction du catholicisme, qu'il définit comme étant le libéralisme qui, «avec les faux dogmes de ses fausses libertés, est un protestantisme larvé et un catholicisme adultérin» (Une bonne leçon, p. 232). Cependant, et parce qu'il nous faut bien conclure ces quelques lignes qui, je l'espère, donneront à mes lecteurs l'envie de découvrir ce diable d'auteur, la phrase que nous avons notée à propos de Kierkegaard nous permet d'aborder la dernière partie du volume si intelligemment conçu par Érick Audouard, intitulée Nouvelles de l'Apocalypse. Cette partie pourrait nous faire croire que, obsédé par l'ouverture du septième sceau, Castellani serait un de ces incurables pessimistes nous alertant de la catastrophe qui nous guette, sans bien sûr consentir à se retrousser les manches, ce qui est tout autre chose que de broder au petit point, comme Baudouin de Bodinat le fait, sur le thème du monde qui court à sa ruine, qui est à vrai dire déjà ruiné, raison impérieuse pour laquelle il ne faut pas manquer d'écrire plutôt que de se taire ou d'agir.
Or, la vie même de Leonardo Castellani nous montre qu'il est absolument tout ce que l'on voudra, un puissant érudit, un homme de combat, un esprit radicalement libre, un emmerdeur qui aura empêché ses collègues de prier en rond, mais qu'il n'est assurément pas un de ces universitaires planqués qui montrent amplement leur courage en signant des pétitions contre des morts comme Charles Maurras, morts pourtant plus vivants que ces sépulcres blanchis, ce qui veut donc dire que Leonardo Castellani n'est évidemment pas l'un de ces innombrables semi-lettrés qui, lorsqu'ils «règnent sur le domaine des lettres», ne concourent qu'à permettre à la mystification de se répandre inéluctablement et à se propager «de façon épidémique» (Semi-lettrés, p. 225). N'oublions pas que cet homme a été véritablement harcelé, moqué et même cassé, le terme n'est hélas point trop fort, par sa hiérarchie de la Compagnie de Jésus, et que ce genre d'expérience suffirait parfaitement, puisqu'il ne l'a point brisé, à forger un caractère moins trempé que celui de Leonardo Castellani, veilleur annonçant «l'époque parousique qui vient» (Demain, Thomas d'Aquin, p. 243) laquelle, si nous ne savons par définition ce qu'elle est, a fort peu de chances d'être similaire au rêve inepte de ces Toynbee, Wells ou Teilhard de Chardin appelant de leurs vœux une «super-fédération des nations en une seule puissance planétaire», une «palingénésie totale de l'univers visible, œuvre de la science moderne» (Vision religieuse de la crise, p. 250), cauchemar d'une société aseptisée que le monde moderne «tente fiévreusement de [...] construire sans Dieu : en s'apostasiant, en niant le Christ, en abominant cette ébauche d'unité qui vit le jour en Europe sous le nom de chrétienté, en opprimant et en persécutant férocement jusqu'aux principes essentiels de la nature humaine, à travers la suppression revendiquée de tous les liens et de toutes les appartenances (familiales, patriotiques, etc.)» (Ibid., p. 252).
Ces dernières pages, qui une nouvelle fois citent d'abondance Kierkegord qui a semblé à si juste raison fasciner Castellani, évoquent le martyre, autrement dit le fait de concilier «le devoir de parler», «l'impossibilité physique de se taire» avec le fait de défendre non point sa vérité mais la vérité, par le biais d'une démarche paradoxale, donc scandaleuse aux yeux des badauds que nous sommes, le grand philosophe danois assurant qu'il fallait «se rendre infâme», s'humilier en somme, «se rabaisser en dessous de celui qui se trompe» (La provocation, p. 270). Autrement dit, nous avons, par ces temps d'Apocalypse, bien moins besoin de phraseurs que de témoins, ce que fut, sans le moindre doute, Leonardo Castellani.
Notes
(1) Entre parenthèses et sans autre mention, les pages indiquées renvoient à la seule introduction d’Érick Audouard. Je mentionne dans tous les autres cas le titre choisi par le traducteur, qui ne correspond pas toujours aux titres originaux des articles de Castellani. Je signale enfin quelques menues fautes, comme l’absence d’une parenthèse fermante en haut de la page 98 ou encore : «Qu’as-tu fait du l’Étoile du matin» (p. 121), «Même Mgr Piccirilli peut accéder la foi» (p. 143) et «non moins qu'un grand plume» (p. 251).
(2) «Ôtez-leurs les éclats de haine et de luxure qui servent maladroitement à les galvaniser, les œuvres d’Anatole France sont mortes. Ce sont des faïences, des mosaïques, des porcelaines, ce que vous voulez : elles sont froides. Sa pensée reste femelle, passive, elle ne féconde rien : elle est engrossée par ce que lui injectent les livres. Il n’a créé aucun personnage, n’a pénétré aucune existence, n’a épousé aucun amour, n’a maintenu aucune conviction dont son esprit irrémédiablement épidermique qui se contentait de badiner dans le monde multicolore des images. Ses héros sont des pantins, et la trame de leurs agitations n’est qu’ironie, raillerie perpétuelle, sûre d’elle-même et blasée, c’est-à-dire tout le contraire d’une philosophie» (p. 124, l’auteur souligne, in Anatole philosophe).
(3) Et c'est donc en jouant sur le sens des mots, en rappelant leur origine, que Castellani va nous rappeler quelques évidences comme celle-ci : «l'information se résume désormais aux nouvelles», lesquelles sont «destinées pour la plupart à duper, à désorienter, à anesthésier. En latin, informer signifie donner forme, ce qui revient à donner l'être. Donner une forme accidentelle qui suppose l'existence d'une forme substantielle. Pour être informé, il faut d'abord être formé» (Professionnels, p. 183).
(4) Voir à ce sujet l'excellent texte intitulé Charles Quint et l'imprimeur qui n'est autre que le fameux sieur Bonmont ou Gutenberguen venu réclamer de l'argent au potentat en échange des bienfaits de son invention qui permettra de reproduire «des livres qui ne seront écrits qu'avec des bouts d'autres livres», et même des «quantités faramineuses de livres dont les titres seront empruntés à d'autres livres, des bibliothèques entièrement composées de livres composés de listes d'autres livres !» (p. 186).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, écologie, apocalypse, matthieu grimpret, baudouin de bodinat, érick audouard, leonardo castellani, éditions fario, éditions lgm, éditions pierre-guillaume de roux, w. g. sebald, carlo michelstaedter, michel houellebecq, paul gadenne, sören kierkegaard, jaime semprun |  |
|  Imprimer
Imprimer



























































