Rechercher : pommier girard
René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète, 2, par René Pommier

18/05/2010 | Lien permanent
René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète, 3, par René Pommier

01/06/2010 | Lien permanent
René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète, 1, par René Pommier

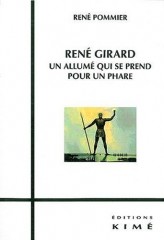 Publication, en plusieurs notes, des pages 83 à 117 (composant le chapitre intitulé René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète) de l'excellent (et comme toujours très drôle) petit ouvrage de René Pommier, René Girard, un allumé qui se prend pour un phare aux Éditions Kimé.La démarche qui a conduit René Girard à finir par se rallier à la foi chrétienne ne laisse pas d’être originale. Il n’a pas été touché par la grâce, à laquelle d’ailleurs, mais ce n’est pas moi qui le lui reprocherai, il ne semble guère croire. Parce qu’il était sans doute intimidé à l’idée de rencontrer un tel prodige de la pensée et qu’il avait peur d’être incapable de soutenir une conversation avec lui, Dieu ne s’est jamais manifesté à René Girard. Le Christ ne lui est pas apparu sur le mur de chambre, comme ce fut le cas pour Max Jacob. Il n’a pas rencontré Dieu près d’un pilier de Notre Dame, comme Claudel ou dans l’église Notre-Dame des Victoires, comme Georges Desvallières. Il n’a pas eu de subite illumination en lisant les Confessions de saint Augustin, les Pensées de Pascal ou les écrits du cardinal Newman. Il n’a pas, non plus, succombé au charisme d’un abbé Mugnier, comme beaucoup des «convertis de la Belle Époque (1)». Non, pour aller à Dieu, René Girard n’avait besoin ni d’un abbé Mugnier, ni de Pascal, ni de Dieu lui-même : il avait René Girard.En fait René Girard a toujours cru : il a toujours cru en René Girard et la foi en Dieu n’a été pour lui que le prolongement, l’approfondissement, l’aboutissement de sa foi en René Girard. Il le dit très clairement, c’est le girardisme qui l’amené au christianisme : «ce sont les résultats de mon travail, ceux que je suis en train de vous exposer, qui m’ont orienté vers le christianisme et convaincu de sa vérité. Ce n’est pas parce que je suis chrétien que je pense comme je le fais; c’est parce que mes recherches m’ont amené à penser ce que je pense que je suis devenu chrétien (2)». Notons d’abord que cette conversion dans laquelle Dieu n’intervient en rien, se contentant de se laisser dénicher par un chercheur exceptionnellement perspicace et persévérant, comme une statue antique enfouie dans le sable se laisse déterrer par un archéologue, ne devrait pas être tout à fait du goût de l’Église, pour qui la foi est toujours et d’abord un don de Dieu (3). Certes l’Église a toujours déclaré que la seule raison naturelle pouvait permettre à l’homme de découvrir Dieu à travers ses œuvres. Mais cette connaissance de Dieu, si elle peut préparer à la foi, ne saurait suffire à la faire naître. L’homme ne peut aller à Dieu, si Dieu ne l’appelle à lui. Quels que soient ses mérites, ses vertus, la force de son esprit, sa soif de Dieu, il ne peut jamais le trouver tout seul, fût-il René Girard.Comme l’indique l’étymologie («se convertir», c’est «se tourner vers»), la conversion implique normalement un changement d’orientation, une transformation intérieure. Rien de tel chez le «converti» René Girard. Loin de modifier en quoi que ce soit sa façon de penser, c’est lui, je l’ai dit dans l’introduction, qui invite les chrétiens qu’il vient de rejoindre à abandonner au plus vite leur vision du christianisme pour se rallier à la sienne. Arrivé au christianisme par le girardisme, René Girard découvre que le christianisme est, en réalité, un girardisme qui s’ignore et il invite tous les chrétiens à en prendre enfin conscience. D'ordinaire le nouveau converti est modeste, timide, et déférent; le converti René Girard est présomptueux, sûr de lui, et volontiers dédaigneux. D’ordinaire le nouveau converti se regarde comme un pauvre égaré à qui l’on vient enfin d’apporter la lumière. Le converti René Girard prétend, au contraire, apporter la lumière à ceux qu’il vient de rejoindre, qui, selon lui, la détenaient sans la voir. D’ordinaire le nouveau converti est avide de conseils; il cherche à s’instruire et demande des précisions sur ce qu’il doit faire et ce qu’il doit croire. Le converti René Girard ne pense qu’à faire la leçon à ses nouveaux coreligionnaires et n’attend d’eux qu’une chose : qu’ils l’écoutent respectueusement et qu’ils adoptent au plus vite toutes ses idées.«Il faut, ne craint pas de dire René Girard, que “meure” effectivement cette divinité sacrificielle et avec elle le christianisme historique dans son ensemble, pour que le texte évangélique puisse resurgir à nos yeux non pas comme un cadavre que nous aurions déterré, mais comme la chose la plus nouvelle, la plus belle, la plus vivante et la plus vraie que nous ayons jamais contemplée» (4). C’est donc rien moins que «le christianisme historique dans son ensemble» qu’il entend mettre au placard pour le remplacer par le christianisme girardien. C’est tellement gros, tellement énorme que tout le monde aurait dû sauter au plafond ou se rouler par terre en se tenant les côtes. René Girard aurait dû être aussitôt salué comme le plus grand bouffon du siècle. Au lieu de cela, on l’a célébré comme l’un des plus grands penseurs de tous les temps, sinon le plus grand, et on l’a élu à l’Académie française à la quasi unanimité. J’ai reçu une solide éducation religieuse, ayant fait toutes mes études secondaires chez les Pères et j’ai par la suite beaucoup pratiqué certains grands auteurs chrétiens, à commencer par Pascal et Bossuet. J’étais donc persuadé que, pour les chrétiens, le Christ était venu racheter les hommes du péché originel. Je n’avais jamais entendu dire ni lu nulle part qu’il était venu sur terre pour mettre fin à la rivalité mimétique. On m’avait toujours appris que le malheur de l’homme venait du fait que, depuis le péché originel et à cause de lui, il s’était détourné de Celui qui est sa seule fin, Dieu, pour se tourner vers lui-même et faire de sa propre personne le centre de tout, n’étant plus mû par «la charité», c’est-à-dire l’amour de Dieu, mais par «l’amour-propre», c’est-à-dire l’amour de lui-même. Je n’ai pourtant pas l’intention de m’interroger longuement sur l’orthodoxie de la conception que René Girard se fait du christianisme. Les théologiens sont mieux placés que moi pour le faire. Je préfère rester sur un terrain plus étroit, plus modeste et qui m’est familier, celui de l’analyse des textes. Je me contenterai donc d’examiner la manière dont René Girard se sert des textes bibliques et évangélique pour essayer d’imposer sa conception. Car je crois retrouver dans ses analyses tous les défauts que j’ai passé un bonne partie de ma vie à dénoncer chez les «décodeurs» en tout genre et notamment ceux de la «nouvelle critique».Pour René Girard, nous l’avons vu «les chrétiens n’ont pas compris la véritable originalité des Évangiles». Selon lui, «ils s’imaginent que les Évangiles ne peuvent pas être originaux à moins de parler de toute autre chose que les mythes». C’est pourquoi «ils tendent à voir dans le procès de Jésus, dans l’intervention de la foule, dans la crucifixion, un événement incomparable en lui-même, en tant qu’événement du monde. Les Évangiles disent, au contraire que Jésus est à la même place que toutes les victimes passés présentes et futures. Les théologiens ne voient là que des métaphores plus ou moins métaphysiques et mystiques. Ils ne prennent pas les Évangiles à la lettre et ils tendent à fétichiser la passion» (5). Mais, objecte René Girard, «la preuve qu’il ne faut pas agir ainsi, c’est que dans le texte même des Évangiles figure un second exemple de meurtre collectif, différent dans le détail des faits mais tout à fait identique à la passion sous le rapport des mécanismes qu’il fait jouer et des rapports entre les participants» (6).Ce meurtre, c’est celui de Jean-Baptiste et René Girard va se livrer tout d’abord à une très longue analyse du court récit de sa mort (7). Pour lui, en effet, il ne fait aucun doute que ce récit nous offre «un exemple de meurtre collectif» dont l’origine est, bien sûr, le désir mimétique, illustrant de façon saisissante le mécanisme de la crise mimétique : «Bien qu’il soit de dimensions réduites, ce texte donne aux désirs mimétiques puis aux rivalités mimétiques et enfin à l’effet du bouc émissaire qui résulte de l’ensemble un relief étonnant» (8). René Girard nous dit suivre le texte de Marc et il le résume en ces termes : «Hérode désirait épouser en secondes noces Hérodiade, l’épouse de son propre frère. le prophète avait condamné cette union. Hérode l’avait fait emprisonner pour le protéger, semble-t-il autant et plus que pour châtier son audace. Hérodiade réclamait sa tête avec acharnement. Hérode ne voulait pas la lui donner. L’épouse finit pourtant par l’emporter en faisant danser sa fille au cours d’un banquet en présence d’Hérode et de ses convives. Endoctrinée par la mère et soutenue par les convives la fille demanda la tête de Jean-Baptiste qu’Hérode n’osa pas lui refuser (Mc, 6, 14-28)» (9).Comme à son habitude, René Girard, bien qu’ancien élève de l’Ecole des Chartes, se montre incapable de nous donner un résumé rigoureusement exact du récit de Marc. Il nous dit qu’Hérodiade réussit enfin à avoir le tête de Jean-Baptiste «en faisant danser sa fille». Mais Marc, non plus d’ailleurs que Matthieu (Luc ne parle pas de la décapitation de Jean-Baptiste), ne dit nullement que c’est Hérodiade qui a fait danser sa fille. Il est certes possible, voire probable, qu’elle l’ait fait à la demande de sa mère. Toujours est-il que les évangiles ne le disent pas. René Girard, qui entend résumer le récit de Marc, dit aussi que Salomé est «endoctrinée par sa mère». Or cette formule se trouve dans Matthieu mais non dans Marc. Le plus étrange, nous le verrons, c’est que René Girard va reprocher plus loin à Matthieu d’avoir ajouté cette précision au récit de Marc. Ce n’est donc pas seulement au texte des évangiles, que René Girard ne prête pas une attention suffisante : c’est aussi à ce qu’il a écrit lui-même Il affirme enfin que Salomé est «soutenue par les convives», ce que ne disent ni Marc ni Matthieu. Mais là encore je vais y revenir.Quand Jean-Baptiste dit à Hérode qu’il ne lui est pas permis d’épouser la femme de son frère, «ce n’est pas, nous dit René Girard,, sur la légalité stricte du mariage, que le prophète met l’accent» (10). En réalité, «le prophète met son auditeur royal en garde contre les effets du désir mimétique» (11). Pour René Girard, il ne fait pas de doute, en effet, que, si Hérode a voulu épouser Hérodiade, c’est moins parce qu’il était attirée par elle, que parce qu’elle était la femme de son frère et qu’il voulait ainsi supplanter celui-ci. Il a donc succombé a un désir d’origine mimétique qui va avoir un effet contagieux et déclencher le processus qui aboutira à la mort du prophète : «À l’orée de notre texte, l’avertissement de Jean désigne le type de rapport qui domine l’ensemble du récit et qui débouche, à son paroxysme, sur le meurtre du prophète. Le désir foisonne et s’exaspère parce qu’Hérode ne tient pas compte de l’avertissement et tout le monde suit son exemple. Tous les incidents, tous les détails du texte illustrent les moments successifs de ce désir, chacun d’eux produit par la logique démente d’une surenchère qui se nourrit de l’échec des moments antérieurs» (12).Que vaut cette interprétation ? On aimerait tout d’abord être sûr qu’Hérode a effectivement épousé Hérodiade pour damer le pion à son frère. Rien n’est pourtant moins sûr. René Girard, lui, n’en doute pas : «La preuve qu’Hérode désire avant tout triompher de son frère c’est qu’une fois possédée, Hérodiade perd toute influence directe sur son époux. Elle ne peut même pas obtenir de lui qu’il fasse mourir un insignifiant petit prophète» (13). Mais, quoi qu’en pense René Girard, le refus d’Hérode de faire mourir Jean-Baptiste ne prouve nullement qu’Hérodiade a perdu toute influence sur lui. S’il répugne à le faire mourir, c’est, nous dit l’évangéliste, «parce qu’Hérode craignait Jean, sachant que c’était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l’avait entendu, il était fort perplexe, et c’était avec plaisir qu’il l’écoutait» (Marc 6, 20). Aux yeux d’Hérode, Jean-Baptiste n’est manifestement pas «un insignifiant petit prophète». Il le considère si peu comme «un insignifiant petit prophète» que, lorsque les miracles de Jésus commencent à le rendre célèbre, il croit que le baptiste est ressuscité en la personne du Christ : «C’est Jean que j’ai fait décapiter, qui est ressuscité» (Marc 6, 16) (14).Notes(1) Voir Les Convertis de la Belle Époque, préface de Jean Pommier, Éditions rationalistes, 1971, livre dans lequel Henriette Psichari raconte et commente la conversion de son frère Ernest, ainsi que celles de Jacques Maritain, de Jacques Rivière, de Jean Cocteau, de Louis Massillon et de quelques autres.(2) Les Origines de la culture (Desclée de Brouwer, 2004), p. 58.(3) «La foi est un don gratuit que Dieu fait à l’homme», Catéchisme de l’Église catholique (Presses Pocket, 1999), p. 52, article 162.(4) Des Choses cachées depuis la fondation du monde (Grasset, 1978, Le Livre de poche, coll. Biblio Essais), p. 339.(5) Le Bouc émissaire (Grasset, 1982, Le Livre de poche, coll. Biblio Essais), p. 189-190. (6) Ibid., p. 190.(7) Ibid., pp. 190-219.(8) Ibid., p. 190.(9) Ibid., pp. 190-191.(10) Ibid., p. 191.(11) Ibid., p. 192.(12) Ibid., p. 193.(13) Ibid., pp. 193-194.(14) Dans Matthieu (14, 2) Hérode dit à ses proches : «cet homme est Jean-Baptiste. Le voilà ressuscité des morts : d’où les pouvoirs miraculeux qui se déploient en sa personne».
Publication, en plusieurs notes, des pages 83 à 117 (composant le chapitre intitulé René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète) de l'excellent (et comme toujours très drôle) petit ouvrage de René Pommier, René Girard, un allumé qui se prend pour un phare aux Éditions Kimé.La démarche qui a conduit René Girard à finir par se rallier à la foi chrétienne ne laisse pas d’être originale. Il n’a pas été touché par la grâce, à laquelle d’ailleurs, mais ce n’est pas moi qui le lui reprocherai, il ne semble guère croire. Parce qu’il était sans doute intimidé à l’idée de rencontrer un tel prodige de la pensée et qu’il avait peur d’être incapable de soutenir une conversation avec lui, Dieu ne s’est jamais manifesté à René Girard. Le Christ ne lui est pas apparu sur le mur de chambre, comme ce fut le cas pour Max Jacob. Il n’a pas rencontré Dieu près d’un pilier de Notre Dame, comme Claudel ou dans l’église Notre-Dame des Victoires, comme Georges Desvallières. Il n’a pas eu de subite illumination en lisant les Confessions de saint Augustin, les Pensées de Pascal ou les écrits du cardinal Newman. Il n’a pas, non plus, succombé au charisme d’un abbé Mugnier, comme beaucoup des «convertis de la Belle Époque (1)». Non, pour aller à Dieu, René Girard n’avait besoin ni d’un abbé Mugnier, ni de Pascal, ni de Dieu lui-même : il avait René Girard.En fait René Girard a toujours cru : il a toujours cru en René Girard et la foi en Dieu n’a été pour lui que le prolongement, l’approfondissement, l’aboutissement de sa foi en René Girard. Il le dit très clairement, c’est le girardisme qui l’amené au christianisme : «ce sont les résultats de mon travail, ceux que je suis en train de vous exposer, qui m’ont orienté vers le christianisme et convaincu de sa vérité. Ce n’est pas parce que je suis chrétien que je pense comme je le fais; c’est parce que mes recherches m’ont amené à penser ce que je pense que je suis devenu chrétien (2)». Notons d’abord que cette conversion dans laquelle Dieu n’intervient en rien, se contentant de se laisser dénicher par un chercheur exceptionnellement perspicace et persévérant, comme une statue antique enfouie dans le sable se laisse déterrer par un archéologue, ne devrait pas être tout à fait du goût de l’Église, pour qui la foi est toujours et d’abord un don de Dieu (3). Certes l’Église a toujours déclaré que la seule raison naturelle pouvait permettre à l’homme de découvrir Dieu à travers ses œuvres. Mais cette connaissance de Dieu, si elle peut préparer à la foi, ne saurait suffire à la faire naître. L’homme ne peut aller à Dieu, si Dieu ne l’appelle à lui. Quels que soient ses mérites, ses vertus, la force de son esprit, sa soif de Dieu, il ne peut jamais le trouver tout seul, fût-il René Girard.Comme l’indique l’étymologie («se convertir», c’est «se tourner vers»), la conversion implique normalement un changement d’orientation, une transformation intérieure. Rien de tel chez le «converti» René Girard. Loin de modifier en quoi que ce soit sa façon de penser, c’est lui, je l’ai dit dans l’introduction, qui invite les chrétiens qu’il vient de rejoindre à abandonner au plus vite leur vision du christianisme pour se rallier à la sienne. Arrivé au christianisme par le girardisme, René Girard découvre que le christianisme est, en réalité, un girardisme qui s’ignore et il invite tous les chrétiens à en prendre enfin conscience. D'ordinaire le nouveau converti est modeste, timide, et déférent; le converti René Girard est présomptueux, sûr de lui, et volontiers dédaigneux. D’ordinaire le nouveau converti se regarde comme un pauvre égaré à qui l’on vient enfin d’apporter la lumière. Le converti René Girard prétend, au contraire, apporter la lumière à ceux qu’il vient de rejoindre, qui, selon lui, la détenaient sans la voir. D’ordinaire le nouveau converti est avide de conseils; il cherche à s’instruire et demande des précisions sur ce qu’il doit faire et ce qu’il doit croire. Le converti René Girard ne pense qu’à faire la leçon à ses nouveaux coreligionnaires et n’attend d’eux qu’une chose : qu’ils l’écoutent respectueusement et qu’ils adoptent au plus vite toutes ses idées.«Il faut, ne craint pas de dire René Girard, que “meure” effectivement cette divinité sacrificielle et avec elle le christianisme historique dans son ensemble, pour que le texte évangélique puisse resurgir à nos yeux non pas comme un cadavre que nous aurions déterré, mais comme la chose la plus nouvelle, la plus belle, la plus vivante et la plus vraie que nous ayons jamais contemplée» (4). C’est donc rien moins que «le christianisme historique dans son ensemble» qu’il entend mettre au placard pour le remplacer par le christianisme girardien. C’est tellement gros, tellement énorme que tout le monde aurait dû sauter au plafond ou se rouler par terre en se tenant les côtes. René Girard aurait dû être aussitôt salué comme le plus grand bouffon du siècle. Au lieu de cela, on l’a célébré comme l’un des plus grands penseurs de tous les temps, sinon le plus grand, et on l’a élu à l’Académie française à la quasi unanimité. J’ai reçu une solide éducation religieuse, ayant fait toutes mes études secondaires chez les Pères et j’ai par la suite beaucoup pratiqué certains grands auteurs chrétiens, à commencer par Pascal et Bossuet. J’étais donc persuadé que, pour les chrétiens, le Christ était venu racheter les hommes du péché originel. Je n’avais jamais entendu dire ni lu nulle part qu’il était venu sur terre pour mettre fin à la rivalité mimétique. On m’avait toujours appris que le malheur de l’homme venait du fait que, depuis le péché originel et à cause de lui, il s’était détourné de Celui qui est sa seule fin, Dieu, pour se tourner vers lui-même et faire de sa propre personne le centre de tout, n’étant plus mû par «la charité», c’est-à-dire l’amour de Dieu, mais par «l’amour-propre», c’est-à-dire l’amour de lui-même. Je n’ai pourtant pas l’intention de m’interroger longuement sur l’orthodoxie de la conception que René Girard se fait du christianisme. Les théologiens sont mieux placés que moi pour le faire. Je préfère rester sur un terrain plus étroit, plus modeste et qui m’est familier, celui de l’analyse des textes. Je me contenterai donc d’examiner la manière dont René Girard se sert des textes bibliques et évangélique pour essayer d’imposer sa conception. Car je crois retrouver dans ses analyses tous les défauts que j’ai passé un bonne partie de ma vie à dénoncer chez les «décodeurs» en tout genre et notamment ceux de la «nouvelle critique».Pour René Girard, nous l’avons vu «les chrétiens n’ont pas compris la véritable originalité des Évangiles». Selon lui, «ils s’imaginent que les Évangiles ne peuvent pas être originaux à moins de parler de toute autre chose que les mythes». C’est pourquoi «ils tendent à voir dans le procès de Jésus, dans l’intervention de la foule, dans la crucifixion, un événement incomparable en lui-même, en tant qu’événement du monde. Les Évangiles disent, au contraire que Jésus est à la même place que toutes les victimes passés présentes et futures. Les théologiens ne voient là que des métaphores plus ou moins métaphysiques et mystiques. Ils ne prennent pas les Évangiles à la lettre et ils tendent à fétichiser la passion» (5). Mais, objecte René Girard, «la preuve qu’il ne faut pas agir ainsi, c’est que dans le texte même des Évangiles figure un second exemple de meurtre collectif, différent dans le détail des faits mais tout à fait identique à la passion sous le rapport des mécanismes qu’il fait jouer et des rapports entre les participants» (6).Ce meurtre, c’est celui de Jean-Baptiste et René Girard va se livrer tout d’abord à une très longue analyse du court récit de sa mort (7). Pour lui, en effet, il ne fait aucun doute que ce récit nous offre «un exemple de meurtre collectif» dont l’origine est, bien sûr, le désir mimétique, illustrant de façon saisissante le mécanisme de la crise mimétique : «Bien qu’il soit de dimensions réduites, ce texte donne aux désirs mimétiques puis aux rivalités mimétiques et enfin à l’effet du bouc émissaire qui résulte de l’ensemble un relief étonnant» (8). René Girard nous dit suivre le texte de Marc et il le résume en ces termes : «Hérode désirait épouser en secondes noces Hérodiade, l’épouse de son propre frère. le prophète avait condamné cette union. Hérode l’avait fait emprisonner pour le protéger, semble-t-il autant et plus que pour châtier son audace. Hérodiade réclamait sa tête avec acharnement. Hérode ne voulait pas la lui donner. L’épouse finit pourtant par l’emporter en faisant danser sa fille au cours d’un banquet en présence d’Hérode et de ses convives. Endoctrinée par la mère et soutenue par les convives la fille demanda la tête de Jean-Baptiste qu’Hérode n’osa pas lui refuser (Mc, 6, 14-28)» (9).Comme à son habitude, René Girard, bien qu’ancien élève de l’Ecole des Chartes, se montre incapable de nous donner un résumé rigoureusement exact du récit de Marc. Il nous dit qu’Hérodiade réussit enfin à avoir le tête de Jean-Baptiste «en faisant danser sa fille». Mais Marc, non plus d’ailleurs que Matthieu (Luc ne parle pas de la décapitation de Jean-Baptiste), ne dit nullement que c’est Hérodiade qui a fait danser sa fille. Il est certes possible, voire probable, qu’elle l’ait fait à la demande de sa mère. Toujours est-il que les évangiles ne le disent pas. René Girard, qui entend résumer le récit de Marc, dit aussi que Salomé est «endoctrinée par sa mère». Or cette formule se trouve dans Matthieu mais non dans Marc. Le plus étrange, nous le verrons, c’est que René Girard va reprocher plus loin à Matthieu d’avoir ajouté cette précision au récit de Marc. Ce n’est donc pas seulement au texte des évangiles, que René Girard ne prête pas une attention suffisante : c’est aussi à ce qu’il a écrit lui-même Il affirme enfin que Salomé est «soutenue par les convives», ce que ne disent ni Marc ni Matthieu. Mais là encore je vais y revenir.Quand Jean-Baptiste dit à Hérode qu’il ne lui est pas permis d’épouser la femme de son frère, «ce n’est pas, nous dit René Girard,, sur la légalité stricte du mariage, que le prophète met l’accent» (10). En réalité, «le prophète met son auditeur royal en garde contre les effets du désir mimétique» (11). Pour René Girard, il ne fait pas de doute, en effet, que, si Hérode a voulu épouser Hérodiade, c’est moins parce qu’il était attirée par elle, que parce qu’elle était la femme de son frère et qu’il voulait ainsi supplanter celui-ci. Il a donc succombé a un désir d’origine mimétique qui va avoir un effet contagieux et déclencher le processus qui aboutira à la mort du prophète : «À l’orée de notre texte, l’avertissement de Jean désigne le type de rapport qui domine l’ensemble du récit et qui débouche, à son paroxysme, sur le meurtre du prophète. Le désir foisonne et s’exaspère parce qu’Hérode ne tient pas compte de l’avertissement et tout le monde suit son exemple. Tous les incidents, tous les détails du texte illustrent les moments successifs de ce désir, chacun d’eux produit par la logique démente d’une surenchère qui se nourrit de l’échec des moments antérieurs» (12).Que vaut cette interprétation ? On aimerait tout d’abord être sûr qu’Hérode a effectivement épousé Hérodiade pour damer le pion à son frère. Rien n’est pourtant moins sûr. René Girard, lui, n’en doute pas : «La preuve qu’Hérode désire avant tout triompher de son frère c’est qu’une fois possédée, Hérodiade perd toute influence directe sur son époux. Elle ne peut même pas obtenir de lui qu’il fasse mourir un insignifiant petit prophète» (13). Mais, quoi qu’en pense René Girard, le refus d’Hérode de faire mourir Jean-Baptiste ne prouve nullement qu’Hérodiade a perdu toute influence sur lui. S’il répugne à le faire mourir, c’est, nous dit l’évangéliste, «parce qu’Hérode craignait Jean, sachant que c’était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l’avait entendu, il était fort perplexe, et c’était avec plaisir qu’il l’écoutait» (Marc 6, 20). Aux yeux d’Hérode, Jean-Baptiste n’est manifestement pas «un insignifiant petit prophète». Il le considère si peu comme «un insignifiant petit prophète» que, lorsque les miracles de Jésus commencent à le rendre célèbre, il croit que le baptiste est ressuscité en la personne du Christ : «C’est Jean que j’ai fait décapiter, qui est ressuscité» (Marc 6, 16) (14).Notes(1) Voir Les Convertis de la Belle Époque, préface de Jean Pommier, Éditions rationalistes, 1971, livre dans lequel Henriette Psichari raconte et commente la conversion de son frère Ernest, ainsi que celles de Jacques Maritain, de Jacques Rivière, de Jean Cocteau, de Louis Massillon et de quelques autres.(2) Les Origines de la culture (Desclée de Brouwer, 2004), p. 58.(3) «La foi est un don gratuit que Dieu fait à l’homme», Catéchisme de l’Église catholique (Presses Pocket, 1999), p. 52, article 162.(4) Des Choses cachées depuis la fondation du monde (Grasset, 1978, Le Livre de poche, coll. Biblio Essais), p. 339.(5) Le Bouc émissaire (Grasset, 1982, Le Livre de poche, coll. Biblio Essais), p. 189-190. (6) Ibid., p. 190.(7) Ibid., pp. 190-219.(8) Ibid., p. 190.(9) Ibid., pp. 190-191.(10) Ibid., p. 191.(11) Ibid., p. 192.(12) Ibid., p. 193.(13) Ibid., pp. 193-194.(14) Dans Matthieu (14, 2) Hérode dit à ses proches : «cet homme est Jean-Baptiste. Le voilà ressuscité des morts : d’où les pouvoirs miraculeux qui se déploient en sa personne».
04/05/2010 | Lien permanent
René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète, 4, par René Pommier

19/06/2010 | Lien permanent
René Pommier dans la Zone

 Cacographes.
Cacographes. Le français en capilotade.
Le français en capilotade. Phallus farfelus.
Phallus farfelus. Le Sur Racine de Roland Barthes.
Le Sur Racine de Roland Barthes. La Sorbonne présidée par un grotesque, Georges Molinié. Également, sur Georges Molinié, déclaré prince des cacographes.
La Sorbonne présidée par un grotesque, Georges Molinié. Également, sur Georges Molinié, déclaré prince des cacographes. Salade freudienne.
Salade freudienne. Les étranges contresens d'un grand érudit, Georges Couton.
Les étranges contresens d'un grand érudit, Georges Couton. René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète, 1.
René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète, 1. René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète, 2.
René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète, 2. René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète, 3.
René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète, 3. René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète, 4.
René Girard est le Messie et Jésus-Christ est son prophète, 4.
12/06/2012 | Lien permanent
Phallus farfelus, par René Pommier

12/10/2007 | Lien permanent
Le français en capilotade, par René Pommier

16/09/2007 | Lien permanent
Salade freudienne, par René Pommier

 Examinons maintenant un autre rêve que j’ai évoqué tout à l’heure, le «rêve du marché» que voici : «Une jeune femme intelligente et fine, réservée, du type de l’ “eau qui dort”, raconte : “J’ai rêvé que j’arrivais trop tard au marché et que je ne trouvais plus rien chez le boucher et chez la marchande de légumes.” Voilà assurément un rêve innocent; mais un rêve ne se présente pas de cette manière; je demande un récit détaillé. Le voici : Elle allait au marché avec sa cuisinière qui portait le panier. Le boucher lui a dit, après qu’elle lui eût demandé quelque chose : “on ne peut plus en avoir”, et il a voulu lui donner autre chose en disant : “c’est bon aussi.” Elle a refusé et est allée chez la marchande de légumes. Celle-ci a voulu lui vendre des légumes d’une espèce singulière, attachés en petits paquets, mais de couleur noire. Elle a dit : “Je ne sais pas ce que c’est, je ne prends pas ça”». Et voici le point de départ de l’analyse de Freud : «Il est aisé de rattacher ce rêve aux événements de la journée. Elle était réellement allée au marché trop tard et n’avait plus rien trouvé. On est tenté de dire : la boucherie était déjà fermée. Mais n’y a-t-il pas là – ou plutôt dans l’expression inverse – une manière très vulgaire d’indiquer une négligence dans l’habillement d’un homme. La rêveuse n’a d’ailleurs pas employé ces mots, elle les a peut-être évités.» Comme pour le rêve de la bouchère, on peut tout d’abord s’étonner que Freud tienne à tout prix à décrypter un rêve aussi simple et aussi clair. Et on peut d’autant plus s’en étonner que ce rêve paraît s’expliquer tout naturellement par le fait que la rêveuse «était réellement allée au marché trop tard et n’avait plus rien trouvé». Ce rêve semble donc n’être que le simple souvenir nullement déformé d’un petit déboire de la vie quotidienne. Mais Freud ne saurait admettre qu’un rêve ne soit pas l’accomplissement d’un désir et encore moins qu’il corresponde à un échec, fût-il anodin. Il lui faut donc à tout prix arriver à démontrer que ce rêve, qui semble si innocent, ne l’est aucunement et qu’il constitue bien la réalisation déguisée d’un désir inavoué.Le point de départ et le pivot de toute son interprétation est l’expression la boucherie était fermée. Comme l’indique en note le traducteur, cette expression, à la condition, bien sûr, de la considérer, ainsi que le fait Freud, comme l’équivalent de «l’expression inverse», «appartient à l’argot viennois : Du hast deine Fleischbank offen qui signifie littéralement “la devanture de ta boucherie est ouverte”, c’est-à-dire : “ta braguette n’est pas boutonnée”». Mais, outre que tout le monde n’est pas forcément disposé à admettre aisément que «la boucherie était fermée» doit nécessairement se traduire par «la boucherie était ouverte», la rêveuse n’a pas dit que la boucherie était fermée. Elle a seulement dit, tout d’abord, qu’il n’y avait plus rien chez le boucher, ce qu’elle a corrigé ensuite en disant qu’il n’y avait plus ce qu’elle cherchait. Freud le reconnaît : «La rêveuse, dit-il, n’a d’ailleurs pas employé ces mots» et on appréciera l’humour involontaire de ce «d’ailleurs». Il est tout de même bien étrange de considérer qu’il est somme toute assez indifférent que les patients disent ou ne disent pas telle ou telle chose, quand on prétend, comme Freud, faire reposer toute sa méthode sur les libres associations des patients à qui l’on demande de dire le plus spontanément possible tout ce qui leur passe par la tête. Non content d’estimer qu’il n’est pas gênant que sa patiente n’ait pas employé ces mots, Freud, en disant «elle les a peut-être évités», suggère que son silence est sans doute encore plus révélateur. Mais, outre qu’on peut juger que cet argument, dont il use si souvent, est décidément trop commode, pour pouvoir éviter ces mots, il aurait d’abord fallu que sa patiente les eût connus. Freud raisonne comme si sa patiente connaissait nécessairement l’expression Du hast deine Fleischbank offen. Rien pourtant n’est moins sûr, rien n’est même plus improbable. Outre qu’en général les femmes connaissent beaucoup moins l’argot que les hommes (ce sont le plus souvent eux qui l’ont inventé), la patiente était, a-t-il précisé, une jeune femme «réservée, du type de l’ “eau qui dort”» devant laquelle personne n’aurait sans doute osé employé cette expression que Freud nous dit, mais on l’aurait deviné, être «très vulgaire». Certes, si, comme lui, elle avait fait des études de médecine, elle aurait pu l’entendre et beaucoup d’autres de ce genre en salle de garde. Mais ce n’est pas le cas. On peut donc s’étonner que Freud n’ait pas pensé à lui demander si elle connaissait cette expression. Ou peut-être l’a-t-il fait et, la réponse ayant été négative, s’est-t-il bien gardé de nous le dire. On peut être sûr, en tout cas, que, s’il lui avait posé la question et qu’elle lui eût répondu affirmativement, il n’aurait alors pas manqué de nous le dire. On le voit, l’interprétation du rêve du marché est tout entière construite à partir d’une association d’idées qui est venue à l’esprit du seul Freud. Non seulement elle n’est pas venue à l’esprit de sa patiente, mais, selon toute vraisemblance, elle ne pouvait pas lui venir à l’esprit. Pour qu’on pût, par conséquent, ne pas la rejeter d’emblée comme entièrement gratuite, il aurait fallu d’abord que la patiente eût effectivement dit que la boucherie était fermée, ce qu’elle n’a pas fait; il aurait fallu ensuite admettre qu’elle voulait dire par là que la boucherie était ouverte, ce qui, quoi que puisse dire Freud, ne va pas de soi; il aurait fallu enfin qu’elle connût l’expression Du hast deine Fleischbank offen, ce qui est fort invraisemblable. Dans ces conditions, il peut paraître tout à fait inutile d’examiner la suite de l’interprétation de Freud. Nous allons quand même le faire rapidement.«Quand, poursuit donc Freud, dans un rêve, quelque chose a le caractère d’un discours, est dit ou entendu au lieu d’être pensé – on le distingue ordinairement sans peine –, cela provient de discours de la vie éveillée.» Cela peut arriver, en effet, et l’on peut même admettre sans difficultés que cela doit arriver assez souvent. Mais pourquoi supposer que cela arrive toujours ? Freud lui n’en doute pas : «d’où viennent alors les paroles du boucher : “on ne peut plus en avoir” ? Je les ai prononcées moi-même, en lui expliquant, quelques jours avant, que nous ne pouvions plus avoir (évoquer) les événements de notre première enfance comme tels, mais qu’ils nous étaient rendus par des “transferts” et des rêves lors de l’analyse. C’est donc moi qui suis le boucher, et elle repousse ce “transfert” d’anciennes manières de penser et de sentir. – d’où viennent les paroles qu’elle prononce dans le rêve : “je ne sais pas ce que c’est, je ne prends pas ça” ? L’analyse doit diviser la phrase. Elle-même, la veille, au cours d’une discussion, a dit à sa cuisinière : “je ne sais pas ce que c’est”, mais elle a ajouté “soyez correcte, je vous prie.” Nous saisissons ici le déplacement : des deux phrases employées contre sa cuisinière, elle n’a gardé dans le rêve que celle qui était dépourvue de sens; mais celle qu’elle a refoulée correspondait seule au sens du rêve. On dira : “soyez correct, je vous prie” à quelqu’un qui a osé faire des suggestions inconvenantes, et a oublié de “fermer sa devanture”.» On le voit, s’étant convaincu que, puisque «la boucherie est fermée» ne pouvait vouloir dire que «ta braguette est ouverte», ce rêve apparemment si innocent ne l’était aucunement, Freud a cru pouvoir confirmer et préciser son intuition grâce à deux phrases aussi simples que banales que tout le monde a de nombreuses occasions de prononcer et qui, à première vue, n’avaient nul besoin d’être décryptées : «on ne peut plus en avoir» et «je ne sais pas ce que c’est». La première phrase a pourtant permis à Freud de jeter, c’est du moins ce qu’il croit, une lumière nouvelle et décisive sur le rêve en lui permettant de comprendre qu’il y jouait lui-même un rôle essentiel, celui du boucher. Et cela parce qu’il a eu l’occasion, les jours précédents, d’employer la même phrase avec sa patiente. Il ne suffit pourtant pas que, dans un rêve, une personne vous dise : «il fait beau aujourd’hui» ou «comment allez-vous, ce matin ?», pour que vous puissiez en conclure que cette personne en représente une autre qui vous a dit la même chose le jour précédent, même si par ailleurs elle semble n’avoir rien de commun avec elle. Certes, il en irait autrement, s’il s’agissait d’une phrase un peu longue, un peu complexe, contenant un ou quelques mots rares, et l’on pourrait peut-être alors envisager une telle hypothèse. De plus, il est très vraisemblable que c’est Freud qui s’est rappelé avoir employé cette expression avec sa patiente que celle-ci peut fort bien avoir complètement oubliée. En tout cas, si c’était elle qui l’avait rappelée, soyons sûr que Freud l’aurait indiqué, et même souligné. Il est donc bien difficile de ne pas juger la conclusion que Freud tire de cette phrase, pour le moins aventureuse. Celle qu’il tire de la seconde phrase l’est pourtant encore beaucoup plus. Freud commence, en effet, par transformer complètement la phrase, «je ne sais pas ce que c’est» devenant «soyez correcte, je vous prie». Il prétend que la patiente, qui a prononcé ces deux phrases à la suite à l’adresse de sa cuisinière, «n’a gardé dans le rêve que celle qui était dépourvue de sens; mais celle qu’elle a refoulée correspondait seule au sens du rêve». Il décrète que la seule phrase importante, la seule phrase vraiment significative est précisément celle qui ne figure pas dans le rêve. La première, dit-il, est «dépourvue de sens». Voilà une affirmation assez étrange puisque cette phrase a bien un sens et qu’il est de plus parfaitement clair : il est assez banal de dire «je ne prends pas cela» à une commerçante. Mais, pour Freud, ce «sens» n’en est pas un, puisqu’il ne correspond pas au véritable «sens du rêve», c’est-à-dire au sens qu’il a décidé de lui donner. La seconde phase qui, si elle avait effectivement fait partie du rêve, aurait pourtant été, elle, assez incongrue et aurait appelé une explication (ce n’est pas tous les jours que l’on dit : «soyez correcte, je vous prie» à une marchande de légumes) lui paraît, au contraire, correspondre parfaitement au «sens du rêve» et il nous explique pourquoi : «on dira : “soyez correct, je vous prie” à quelqu’un qui a osé faire des suggestions inconvenantes, et a oublié de “fermer sa devanture”. » Notons tout d’abord que Freud ne nous dit pas pour quelle raison la patiente avait dit à sa cuisinière : «soyez correcte, je vous prie». Il aurait pourtant été important de le savoir puisqu’il a décidé que cette phrase, bien qu’elle ne figurât aucunement dans le rêve manifeste, faisait partie des «pensées du rêve» et était même particulièrement révélatrice. Peut-être n’a-t-il pas pris la peine de le lui demander, à moins, plus vraisemblablement, qu’elle ne lui ait fait une réponse dont il n’a pas souhaité nous faire part, parce qu’elle n’allait aucunement dans le sens qu’il aurait souhaité. En tout cas, il est fort peu probable que la cuisinière ait fait des avances à la jeune femme, et encore moins qu’elle ait porté un pantalon d’homme dont la braguette était ouverte. Notons encore que la patiente, qui s’adressait à une femme, (c’est d’ailleurs aussi à une femme, la marchande de légumes, qu’elle s’adresse dans le rêve) a dit : «soyez correcte» et non : «soyez correct». Ainsi, non content de remplacer la première phrase par la seconde, Freud corrige encore celle-ci en remplaçant le féminin par le masculin, puisque le «sens du rêve» implique qu’elle soit adressée à un homme, en l’occurrence Freud lui-même qui, outre le rôle du boucher, s’attribue aussi celui de la marchande de légumes. Il est donc persuadé d’avoir trouvé une preuve de plus à l’appui de son interprétation. Et il va encore nous en proposer une autre.«L’exactitude de notre interprétation est prouvée, continue-t-il, par son accord avec les allusions qui sont au fond de l’incident de la marchande de légumes. Un légume allongé que l’on vend en bottes (elle a ajouté ensuite qu’il était allongé) un légume noir, cela peut-il être autre chose que la confusion, produite par le rêve, de l’asperge et du radis noir, je n’ai besoin d’interpréter l’asperge pour personne, mais l’autre légume me paraît aussi une allusion à ce même thème sexuel que nous avons deviné dès le début, quand nous voulions symboliser tout le récit par la phrase : la boucherie est fermée. Nous n’avons pas besoin de découvrir ici tout le sens de ce rêve; il suffit d’avoir démontré qu’il est plein de signification et n’est nullement innocent. » On le voit, Freud est maintenant tout à fait sûr d’avoir «démontré» que ce rêve n’était rien moins qu’innocent. Mais il n’a rien «démontré» du tout : il n’a fait, depuis le début de son analyse, que décréter. Et c’est ce qu’il fait encore à propos des légumes que la marchande a voulu vendre à la patiente : aucun doute n’est possible, il ne peut s’agir («cela peut-il être autre chose que») que d’asperges et de radis noir, qui symbolisent l’un et l’autre – mais Freud semble admettre que, si c’est tout à fait évident pour l’asperge («je n’ai besoin d’interpréter l’asperge pour personne»), pour le radis noir, ce n’est que très probable - un sexe masculin. Mais avant de décider que ces légumes constituent des symboles phalliques, il aurait fallu pouvoir être sûr qu’il s’agissait bien d’asperges et de radis. Or rien n’est moins évident. Pour décréter qu’il s’agit d’asperges, Freud commence par déformer légèrement les propos de la patiente en parlant de légumes «que l’on vend en bottes», alors qu’elle n’a pas parlé de «bottes», mais de «petits paquets». Mais son principal argument réside, bien sûr, dans le fait qu’il s’agit d’un «légume allongé». On notera cependant, outre qu’il ne suffit pas, pour qui n’est pas freudien, qu’un légume soit allongé pour qu’il faille lui attribuer une signification phallique, que la patiente ne semble pas avoir dit spontanément que c’était un légume allongé : elle l’a «ajouté», nous dit Freud, ce qui semble indiquer que c’est lui qui le lui a suggéré et qu’elle a acquiescé. Mais peu importe que le légume ait été ou non allongé, de toute façon en disant qu’il était «d’une espèce singulière», la patiente avait indiqué qu’il ne pouvait s’agir ni d’asperges ni de radis noirs, ni d’aucun autre légume connu. Elle avait de plus dit : «je ne sais pas ce que c’est». Et, si Freud a préféré oublier cette phrase, ce n’est peut-être pas seulement parce qu’il ne savait pas qu’en faire, mais aussi parce qu’elle pouvait le gêner. Quoiqu’il en soit, il croit avoir apporté une preuve supplémentaire de la validité de son interprétation, mais il n’a fait que nous donner un exemple de plus du singulier manque de rigueur de sa démarche.Peut-être s’est-il d’ailleurs rendu compte que sa démonstration pouvait paraître peu convaincante, puisqu’il semble avoir hésité pour savoir s’il devait aller ou non jusqu’au bout de son analyse en explicitant clairement la conclusion à laquelle il était arrivé. Il avait apparemment opté d’abord pour la seconde solution puisqu’il met un terme à son analyse en disant : «Nous n’avons pas besoin de découvrir ici tout le sens de ce rêve; il suffit d’avoir démontré qu’il est plein de signification et n’est nullement innocent.» Mais sans doute a-t-il eu peur d’avoir l’air de se dérober, puisque finalement il a fait en note ce qu’il avait dit ne pas avoir besoin de faire. Voici cette note : «À ceux qui voudraient l’approfondir, je ferai remarquer que ce rêve recouvre un fantasme : conduite provocante de ma part, défense de la sienne. On sait combien les médecins ont à subir d’accusations de cette sorte de la part de femmes hystériques, chez qui ces fantasmes ne sont point déformés et présentés comme rêves, mais apparaissent sans dissimulation et sous formes de constructions morbides. Ce rêve a correspondu au début du traitement psychanalytique de la malade. Je compris plus tard qu’il reproduisait le trauma initial d’où provenait sa névrose. D’autres personnes qui avaient subi dans leur enfance des attentats à la pudeur et en souhaitaient le retour dans leurs rêves, m’ont souvent donné l’occasion d’observer les mêmes phénomènes.» Ainsi, selon Freud, la patiente, qui avait fait l’objet d’un attentat à la pudeur dans son enfance, souhaitait revivre cette expérience et comptait sur Freud pour lui permettre de réaliser son souhait. «Ce rêve recouvre un fantasme», nous dit Freud : pour le «recouvrir», il le recouvre. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que le rêve latent n’a plus aucun rapport avec le rêve manifeste. Quand une femme vous dit qu’elle est arrivée trop tard au marché et qu’elle n’a plus rien trouvé, vous n’être guère préparé à comprendre qu’en réalité elle vous demande de la violer. Récapitulons tous les tours de passe-passe auxquels se livre Freud au cours de cette analyse : il fait tout d’abord comme si la patiente avait dit que la boucherie était fermée; il fait ensuite comme si, en disant que la boucherie était fermée, elle avait dit qu’elle était ouverte; il fait comme si, en disant que la boucherie était ouverte, la patiente, qui pourtant ignorait sans doute l’expression argotique qui constitue le pivot de son interprétation, avait dit en réalité que la braguette du boucher était déboutonnée; il s’introduit alors dans le rêve en prenant la place du boucher sous prétexte qu’il a employé, dans un contexte totalement différent, la même expression très banale que lui avec sa patiente; après avoir pris la place du boucher, il prend aussi celle de la marchande de légumes; pour ce faire, il commence par écarter la phrase effectivement adressée par la patiente à la marchande de légumes, sous prétexte que cette phrase, tout à fait claire et tout à fait naturelle dans le contexte du rêve, n’a selon lui pas de sens; il fait ensuite comme si la patiente avait dit à la marchande de légumes ce qu’elle a dit à sa cuisinière, à ceci près qu’ayant décidé que la marchande était en réalité un homme, en l’occurrence lui-même, il remplace le féminin par le masculin; il prête de plus à cette phrase une significa
Examinons maintenant un autre rêve que j’ai évoqué tout à l’heure, le «rêve du marché» que voici : «Une jeune femme intelligente et fine, réservée, du type de l’ “eau qui dort”, raconte : “J’ai rêvé que j’arrivais trop tard au marché et que je ne trouvais plus rien chez le boucher et chez la marchande de légumes.” Voilà assurément un rêve innocent; mais un rêve ne se présente pas de cette manière; je demande un récit détaillé. Le voici : Elle allait au marché avec sa cuisinière qui portait le panier. Le boucher lui a dit, après qu’elle lui eût demandé quelque chose : “on ne peut plus en avoir”, et il a voulu lui donner autre chose en disant : “c’est bon aussi.” Elle a refusé et est allée chez la marchande de légumes. Celle-ci a voulu lui vendre des légumes d’une espèce singulière, attachés en petits paquets, mais de couleur noire. Elle a dit : “Je ne sais pas ce que c’est, je ne prends pas ça”». Et voici le point de départ de l’analyse de Freud : «Il est aisé de rattacher ce rêve aux événements de la journée. Elle était réellement allée au marché trop tard et n’avait plus rien trouvé. On est tenté de dire : la boucherie était déjà fermée. Mais n’y a-t-il pas là – ou plutôt dans l’expression inverse – une manière très vulgaire d’indiquer une négligence dans l’habillement d’un homme. La rêveuse n’a d’ailleurs pas employé ces mots, elle les a peut-être évités.» Comme pour le rêve de la bouchère, on peut tout d’abord s’étonner que Freud tienne à tout prix à décrypter un rêve aussi simple et aussi clair. Et on peut d’autant plus s’en étonner que ce rêve paraît s’expliquer tout naturellement par le fait que la rêveuse «était réellement allée au marché trop tard et n’avait plus rien trouvé». Ce rêve semble donc n’être que le simple souvenir nullement déformé d’un petit déboire de la vie quotidienne. Mais Freud ne saurait admettre qu’un rêve ne soit pas l’accomplissement d’un désir et encore moins qu’il corresponde à un échec, fût-il anodin. Il lui faut donc à tout prix arriver à démontrer que ce rêve, qui semble si innocent, ne l’est aucunement et qu’il constitue bien la réalisation déguisée d’un désir inavoué.Le point de départ et le pivot de toute son interprétation est l’expression la boucherie était fermée. Comme l’indique en note le traducteur, cette expression, à la condition, bien sûr, de la considérer, ainsi que le fait Freud, comme l’équivalent de «l’expression inverse», «appartient à l’argot viennois : Du hast deine Fleischbank offen qui signifie littéralement “la devanture de ta boucherie est ouverte”, c’est-à-dire : “ta braguette n’est pas boutonnée”». Mais, outre que tout le monde n’est pas forcément disposé à admettre aisément que «la boucherie était fermée» doit nécessairement se traduire par «la boucherie était ouverte», la rêveuse n’a pas dit que la boucherie était fermée. Elle a seulement dit, tout d’abord, qu’il n’y avait plus rien chez le boucher, ce qu’elle a corrigé ensuite en disant qu’il n’y avait plus ce qu’elle cherchait. Freud le reconnaît : «La rêveuse, dit-il, n’a d’ailleurs pas employé ces mots» et on appréciera l’humour involontaire de ce «d’ailleurs». Il est tout de même bien étrange de considérer qu’il est somme toute assez indifférent que les patients disent ou ne disent pas telle ou telle chose, quand on prétend, comme Freud, faire reposer toute sa méthode sur les libres associations des patients à qui l’on demande de dire le plus spontanément possible tout ce qui leur passe par la tête. Non content d’estimer qu’il n’est pas gênant que sa patiente n’ait pas employé ces mots, Freud, en disant «elle les a peut-être évités», suggère que son silence est sans doute encore plus révélateur. Mais, outre qu’on peut juger que cet argument, dont il use si souvent, est décidément trop commode, pour pouvoir éviter ces mots, il aurait d’abord fallu que sa patiente les eût connus. Freud raisonne comme si sa patiente connaissait nécessairement l’expression Du hast deine Fleischbank offen. Rien pourtant n’est moins sûr, rien n’est même plus improbable. Outre qu’en général les femmes connaissent beaucoup moins l’argot que les hommes (ce sont le plus souvent eux qui l’ont inventé), la patiente était, a-t-il précisé, une jeune femme «réservée, du type de l’ “eau qui dort”» devant laquelle personne n’aurait sans doute osé employé cette expression que Freud nous dit, mais on l’aurait deviné, être «très vulgaire». Certes, si, comme lui, elle avait fait des études de médecine, elle aurait pu l’entendre et beaucoup d’autres de ce genre en salle de garde. Mais ce n’est pas le cas. On peut donc s’étonner que Freud n’ait pas pensé à lui demander si elle connaissait cette expression. Ou peut-être l’a-t-il fait et, la réponse ayant été négative, s’est-t-il bien gardé de nous le dire. On peut être sûr, en tout cas, que, s’il lui avait posé la question et qu’elle lui eût répondu affirmativement, il n’aurait alors pas manqué de nous le dire. On le voit, l’interprétation du rêve du marché est tout entière construite à partir d’une association d’idées qui est venue à l’esprit du seul Freud. Non seulement elle n’est pas venue à l’esprit de sa patiente, mais, selon toute vraisemblance, elle ne pouvait pas lui venir à l’esprit. Pour qu’on pût, par conséquent, ne pas la rejeter d’emblée comme entièrement gratuite, il aurait fallu d’abord que la patiente eût effectivement dit que la boucherie était fermée, ce qu’elle n’a pas fait; il aurait fallu ensuite admettre qu’elle voulait dire par là que la boucherie était ouverte, ce qui, quoi que puisse dire Freud, ne va pas de soi; il aurait fallu enfin qu’elle connût l’expression Du hast deine Fleischbank offen, ce qui est fort invraisemblable. Dans ces conditions, il peut paraître tout à fait inutile d’examiner la suite de l’interprétation de Freud. Nous allons quand même le faire rapidement.«Quand, poursuit donc Freud, dans un rêve, quelque chose a le caractère d’un discours, est dit ou entendu au lieu d’être pensé – on le distingue ordinairement sans peine –, cela provient de discours de la vie éveillée.» Cela peut arriver, en effet, et l’on peut même admettre sans difficultés que cela doit arriver assez souvent. Mais pourquoi supposer que cela arrive toujours ? Freud lui n’en doute pas : «d’où viennent alors les paroles du boucher : “on ne peut plus en avoir” ? Je les ai prononcées moi-même, en lui expliquant, quelques jours avant, que nous ne pouvions plus avoir (évoquer) les événements de notre première enfance comme tels, mais qu’ils nous étaient rendus par des “transferts” et des rêves lors de l’analyse. C’est donc moi qui suis le boucher, et elle repousse ce “transfert” d’anciennes manières de penser et de sentir. – d’où viennent les paroles qu’elle prononce dans le rêve : “je ne sais pas ce que c’est, je ne prends pas ça” ? L’analyse doit diviser la phrase. Elle-même, la veille, au cours d’une discussion, a dit à sa cuisinière : “je ne sais pas ce que c’est”, mais elle a ajouté “soyez correcte, je vous prie.” Nous saisissons ici le déplacement : des deux phrases employées contre sa cuisinière, elle n’a gardé dans le rêve que celle qui était dépourvue de sens; mais celle qu’elle a refoulée correspondait seule au sens du rêve. On dira : “soyez correct, je vous prie” à quelqu’un qui a osé faire des suggestions inconvenantes, et a oublié de “fermer sa devanture”.» On le voit, s’étant convaincu que, puisque «la boucherie est fermée» ne pouvait vouloir dire que «ta braguette est ouverte», ce rêve apparemment si innocent ne l’était aucunement, Freud a cru pouvoir confirmer et préciser son intuition grâce à deux phrases aussi simples que banales que tout le monde a de nombreuses occasions de prononcer et qui, à première vue, n’avaient nul besoin d’être décryptées : «on ne peut plus en avoir» et «je ne sais pas ce que c’est». La première phrase a pourtant permis à Freud de jeter, c’est du moins ce qu’il croit, une lumière nouvelle et décisive sur le rêve en lui permettant de comprendre qu’il y jouait lui-même un rôle essentiel, celui du boucher. Et cela parce qu’il a eu l’occasion, les jours précédents, d’employer la même phrase avec sa patiente. Il ne suffit pourtant pas que, dans un rêve, une personne vous dise : «il fait beau aujourd’hui» ou «comment allez-vous, ce matin ?», pour que vous puissiez en conclure que cette personne en représente une autre qui vous a dit la même chose le jour précédent, même si par ailleurs elle semble n’avoir rien de commun avec elle. Certes, il en irait autrement, s’il s’agissait d’une phrase un peu longue, un peu complexe, contenant un ou quelques mots rares, et l’on pourrait peut-être alors envisager une telle hypothèse. De plus, il est très vraisemblable que c’est Freud qui s’est rappelé avoir employé cette expression avec sa patiente que celle-ci peut fort bien avoir complètement oubliée. En tout cas, si c’était elle qui l’avait rappelée, soyons sûr que Freud l’aurait indiqué, et même souligné. Il est donc bien difficile de ne pas juger la conclusion que Freud tire de cette phrase, pour le moins aventureuse. Celle qu’il tire de la seconde phrase l’est pourtant encore beaucoup plus. Freud commence, en effet, par transformer complètement la phrase, «je ne sais pas ce que c’est» devenant «soyez correcte, je vous prie». Il prétend que la patiente, qui a prononcé ces deux phrases à la suite à l’adresse de sa cuisinière, «n’a gardé dans le rêve que celle qui était dépourvue de sens; mais celle qu’elle a refoulée correspondait seule au sens du rêve». Il décrète que la seule phrase importante, la seule phrase vraiment significative est précisément celle qui ne figure pas dans le rêve. La première, dit-il, est «dépourvue de sens». Voilà une affirmation assez étrange puisque cette phrase a bien un sens et qu’il est de plus parfaitement clair : il est assez banal de dire «je ne prends pas cela» à une commerçante. Mais, pour Freud, ce «sens» n’en est pas un, puisqu’il ne correspond pas au véritable «sens du rêve», c’est-à-dire au sens qu’il a décidé de lui donner. La seconde phase qui, si elle avait effectivement fait partie du rêve, aurait pourtant été, elle, assez incongrue et aurait appelé une explication (ce n’est pas tous les jours que l’on dit : «soyez correcte, je vous prie» à une marchande de légumes) lui paraît, au contraire, correspondre parfaitement au «sens du rêve» et il nous explique pourquoi : «on dira : “soyez correct, je vous prie” à quelqu’un qui a osé faire des suggestions inconvenantes, et a oublié de “fermer sa devanture”. » Notons tout d’abord que Freud ne nous dit pas pour quelle raison la patiente avait dit à sa cuisinière : «soyez correcte, je vous prie». Il aurait pourtant été important de le savoir puisqu’il a décidé que cette phrase, bien qu’elle ne figurât aucunement dans le rêve manifeste, faisait partie des «pensées du rêve» et était même particulièrement révélatrice. Peut-être n’a-t-il pas pris la peine de le lui demander, à moins, plus vraisemblablement, qu’elle ne lui ait fait une réponse dont il n’a pas souhaité nous faire part, parce qu’elle n’allait aucunement dans le sens qu’il aurait souhaité. En tout cas, il est fort peu probable que la cuisinière ait fait des avances à la jeune femme, et encore moins qu’elle ait porté un pantalon d’homme dont la braguette était ouverte. Notons encore que la patiente, qui s’adressait à une femme, (c’est d’ailleurs aussi à une femme, la marchande de légumes, qu’elle s’adresse dans le rêve) a dit : «soyez correcte» et non : «soyez correct». Ainsi, non content de remplacer la première phrase par la seconde, Freud corrige encore celle-ci en remplaçant le féminin par le masculin, puisque le «sens du rêve» implique qu’elle soit adressée à un homme, en l’occurrence Freud lui-même qui, outre le rôle du boucher, s’attribue aussi celui de la marchande de légumes. Il est donc persuadé d’avoir trouvé une preuve de plus à l’appui de son interprétation. Et il va encore nous en proposer une autre.«L’exactitude de notre interprétation est prouvée, continue-t-il, par son accord avec les allusions qui sont au fond de l’incident de la marchande de légumes. Un légume allongé que l’on vend en bottes (elle a ajouté ensuite qu’il était allongé) un légume noir, cela peut-il être autre chose que la confusion, produite par le rêve, de l’asperge et du radis noir, je n’ai besoin d’interpréter l’asperge pour personne, mais l’autre légume me paraît aussi une allusion à ce même thème sexuel que nous avons deviné dès le début, quand nous voulions symboliser tout le récit par la phrase : la boucherie est fermée. Nous n’avons pas besoin de découvrir ici tout le sens de ce rêve; il suffit d’avoir démontré qu’il est plein de signification et n’est nullement innocent. » On le voit, Freud est maintenant tout à fait sûr d’avoir «démontré» que ce rêve n’était rien moins qu’innocent. Mais il n’a rien «démontré» du tout : il n’a fait, depuis le début de son analyse, que décréter. Et c’est ce qu’il fait encore à propos des légumes que la marchande a voulu vendre à la patiente : aucun doute n’est possible, il ne peut s’agir («cela peut-il être autre chose que») que d’asperges et de radis noir, qui symbolisent l’un et l’autre – mais Freud semble admettre que, si c’est tout à fait évident pour l’asperge («je n’ai besoin d’interpréter l’asperge pour personne»), pour le radis noir, ce n’est que très probable - un sexe masculin. Mais avant de décider que ces légumes constituent des symboles phalliques, il aurait fallu pouvoir être sûr qu’il s’agissait bien d’asperges et de radis. Or rien n’est moins évident. Pour décréter qu’il s’agit d’asperges, Freud commence par déformer légèrement les propos de la patiente en parlant de légumes «que l’on vend en bottes», alors qu’elle n’a pas parlé de «bottes», mais de «petits paquets». Mais son principal argument réside, bien sûr, dans le fait qu’il s’agit d’un «légume allongé». On notera cependant, outre qu’il ne suffit pas, pour qui n’est pas freudien, qu’un légume soit allongé pour qu’il faille lui attribuer une signification phallique, que la patiente ne semble pas avoir dit spontanément que c’était un légume allongé : elle l’a «ajouté», nous dit Freud, ce qui semble indiquer que c’est lui qui le lui a suggéré et qu’elle a acquiescé. Mais peu importe que le légume ait été ou non allongé, de toute façon en disant qu’il était «d’une espèce singulière», la patiente avait indiqué qu’il ne pouvait s’agir ni d’asperges ni de radis noirs, ni d’aucun autre légume connu. Elle avait de plus dit : «je ne sais pas ce que c’est». Et, si Freud a préféré oublier cette phrase, ce n’est peut-être pas seulement parce qu’il ne savait pas qu’en faire, mais aussi parce qu’elle pouvait le gêner. Quoiqu’il en soit, il croit avoir apporté une preuve supplémentaire de la validité de son interprétation, mais il n’a fait que nous donner un exemple de plus du singulier manque de rigueur de sa démarche.Peut-être s’est-il d’ailleurs rendu compte que sa démonstration pouvait paraître peu convaincante, puisqu’il semble avoir hésité pour savoir s’il devait aller ou non jusqu’au bout de son analyse en explicitant clairement la conclusion à laquelle il était arrivé. Il avait apparemment opté d’abord pour la seconde solution puisqu’il met un terme à son analyse en disant : «Nous n’avons pas besoin de découvrir ici tout le sens de ce rêve; il suffit d’avoir démontré qu’il est plein de signification et n’est nullement innocent.» Mais sans doute a-t-il eu peur d’avoir l’air de se dérober, puisque finalement il a fait en note ce qu’il avait dit ne pas avoir besoin de faire. Voici cette note : «À ceux qui voudraient l’approfondir, je ferai remarquer que ce rêve recouvre un fantasme : conduite provocante de ma part, défense de la sienne. On sait combien les médecins ont à subir d’accusations de cette sorte de la part de femmes hystériques, chez qui ces fantasmes ne sont point déformés et présentés comme rêves, mais apparaissent sans dissimulation et sous formes de constructions morbides. Ce rêve a correspondu au début du traitement psychanalytique de la malade. Je compris plus tard qu’il reproduisait le trauma initial d’où provenait sa névrose. D’autres personnes qui avaient subi dans leur enfance des attentats à la pudeur et en souhaitaient le retour dans leurs rêves, m’ont souvent donné l’occasion d’observer les mêmes phénomènes.» Ainsi, selon Freud, la patiente, qui avait fait l’objet d’un attentat à la pudeur dans son enfance, souhaitait revivre cette expérience et comptait sur Freud pour lui permettre de réaliser son souhait. «Ce rêve recouvre un fantasme», nous dit Freud : pour le «recouvrir», il le recouvre. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que le rêve latent n’a plus aucun rapport avec le rêve manifeste. Quand une femme vous dit qu’elle est arrivée trop tard au marché et qu’elle n’a plus rien trouvé, vous n’être guère préparé à comprendre qu’en réalité elle vous demande de la violer. Récapitulons tous les tours de passe-passe auxquels se livre Freud au cours de cette analyse : il fait tout d’abord comme si la patiente avait dit que la boucherie était fermée; il fait ensuite comme si, en disant que la boucherie était fermée, elle avait dit qu’elle était ouverte; il fait comme si, en disant que la boucherie était ouverte, la patiente, qui pourtant ignorait sans doute l’expression argotique qui constitue le pivot de son interprétation, avait dit en réalité que la braguette du boucher était déboutonnée; il s’introduit alors dans le rêve en prenant la place du boucher sous prétexte qu’il a employé, dans un contexte totalement différent, la même expression très banale que lui avec sa patiente; après avoir pris la place du boucher, il prend aussi celle de la marchande de légumes; pour ce faire, il commence par écarter la phrase effectivement adressée par la patiente à la marchande de légumes, sous prétexte que cette phrase, tout à fait claire et tout à fait naturelle dans le contexte du rêve, n’a selon lui pas de sens; il fait ensuite comme si la patiente avait dit à la marchande de légumes ce qu’elle a dit à sa cuisinière, à ceci près qu’ayant décidé que la marchande était en réalité un homme, en l’occurrence lui-même, il remplace le féminin par le masculin; il prête de plus à cette phrase une significa
01/05/2008 | Lien permanent
Le Sur Racine de Roland Barthes, par René Pommier

15/12/2007 | Lien permanent
La Sorbonne présidée par un grotesque, Georges Molinié, par René Pommier

15/05/2009 | Lien permanent


























































