« Serge Rivron dans la Zone | Page d'accueil | Përshpirtje për një dashnore të William Faulkner »
05/04/2013
Ultramarine de Malcolm Lowry

Crédits photographiques : Mike Ehrmann (Getty Images).
Rappel.
 Malcolm Lowry, Samuel Taylor Coleridge, David Jones, Thomas De Quincey.
Malcolm Lowry, Samuel Taylor Coleridge, David Jones, Thomas De Quincey. Salut à Hart Crane.
Salut à Hart Crane. Sous le volcan de Malcolm Lowry : les livres sous le livre, le Livre sous les livres.
Sous le volcan de Malcolm Lowry : les livres sous le livre, le Livre sous les livres.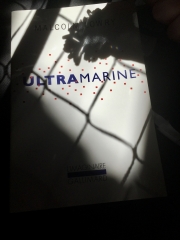 Acheter Ultramarine sur Amazon.
Acheter Ultramarine sur Amazon.Malcolm Lowry, bien davantage que d'autres écrivains toujours pressés de courir derrière leur propre légende romanesque comme Hemingway, pourrait être décrit comme l'écrivain statique par excellence. Ainsi, dès son premier roman, Ultramarine publié le 12 juin 1933 chez Jonathan Cape, nous pouvons lire les principaux thèmes qui composeront le motif pour le moins complexe, hermétique par moments, de Sous le volcan, à l'exclusion, me semble-t-il, de la préoccupation que le romancier y développa pour l'ésotérisme. En somme, rien ou presque rien ne différencie le premier du dernier roman (publié du vivant de l'auteur) si ce n'est, au sens propre du terme, un approfondissement. Patrick White se souviendra peut-être du roman de Lowry lorsqu'il écrira le plus célèbre de ses livres, Voss, qui décrit le long voyage d'un explorateur allemand sur la terre australienne, voyage qui n'a d'autre sens que de délivrer une troublante et fugace révélation intérieure, avant que la nature ne sacrifie dirait-on (mais à quel rite propitiatoire ?) l'impudent voyageur, sorte de Christ égaré sur la terre tout autant que dans les méandres de sa conscience.
Le statisme du premier roman de Malcolm Lowry, voire celui de l'écrivain lui-même, est bien évidemment trompeur. S'il semble ne point s'être réellement déplacé, lui qui a pourtant bourlingué sur les vastes mers du monde (et a écrit : «Pourtant, la mer est toujours la mer. L'homme égare au loin, de plus en plus loin, l'empreinte de ses pas d'exilé», p. 54), lui qui s'est embarqué en 1927 comme matelot de pont sur un cargo de Liverpool, le S. S. Pyrrhus, adolescent de dix-sept ans en rupture d'études qui y fut conduit par la Rolls de son père (anecdote lourde de sens dans Ultramarine), direction l'Extrême-Orient, Lowry a en revanche creusé profondément sous ses pieds, travaillant sans relâche à ce que Raymond Abellio, en une trouvaille poético-ésotérique géniale, a appelé la fosse de Babel, fosse qu'un Fernando Pessoa a peut-être tenté de figurer dans son Livre de l'intranquillité, autre puissant drame statique, et qu'un Conrad Aiken a assurément prétendu explorer dans son Blue Voyage (traduit, assez intelligemment, par Voyage au-dessus de l'abysse) qui laissa une impression si vivace dans l'esprit de Lowry qu'il déclara sans ambages à l'auteur tout ce qu'Ultramarine lui devait. Son titre par exemple, qui provient d'une expression de Conrad Aiken, the ultramarine abyss.
Babel justement, qu'évoque l'un des traducteurs d'Ultramarine en des termes d'une justesse contestable, surtout pour ce qui concerne le chef-d’œuvre romanesque de l'auteur : «La différence entre Ultramarine et le Volcan est celle qui existe entre une métaphysique fabulée du langage qui, se laissant piéger par son propre mirage, s'extrapole en mythologie de la révélation et du salut, et un nihilisme frénétique qui, par angoisse du vide et vertige de l'absence de Dieu, bâtit, sur le modèle d'une tour à étages, un édifice en creux fait des débris de toutes les illusions de Babel» (p. 259).
Ultramarine bruit ainsi d'une multitude de langues (voir par exemple le chapitre 3, au rythme particulièrement syncopé), celles des matelots croisés, l'espace d'un regard ou bien de quelques verres, dans les ports où fait escale le bateau sur lequel le jeune Dana Hilliot s'est embarqué, qui s'appelle, drôle de nom tout de même dans sa volonté de nous étaler son faux complexe, l'Œdipus Tyrannus.
Cette multitude de langues est l'une des figures du chaos qui, dans le roman de Lowry (comme dans ses principaux textes et bien sûr, le centrifuge Sous le volcan), ne cesse d'être repoussé, de port en port bien que chacun de ces ports soit identique à tous les autres, puisque le voyage n'est qu'intérieur, n'est rien de plus en somme qu'un tunnel creusé dans les strates de la mémoire, des langues, des visages croisés : «Cette fois, nous avons vadrouillé en Amérique du Sud – Santos et le Paraguay, San Francisco, Florianopolis, Port-Allegre. Nous avons bourlingué tout autour du monde, tu vois. Ach ! Mais c'est partout pareil» (p. 103). C'est après avoir poussé ce cri de dégoût, déjà répété sans relâche par Baudelaire, autre voyageur éminemment immobile, que Des Esseintes s'est enfermé dans sa thébaïde illusoire, comme s'il s'agissait d'un navire statique flottant cette fois-ci sur l'océan de la médiocrité du monde moderne, ou bien quelque bathyscaphe décadent s'enfonçant dans les profondeurs d'un temps reconquis, à rebours justement du temps présent exécré, image tremblante d'une mythique origine qui épuisera les faibles forces du reclus original, et le conduira vers la folie.
L'impression est curieuse de toute lecteur confronté à cet étrange roman qu'est Ultramarine, où rien, voire absolument rien ne se passe, alors même que, sous le calme apparent, Lowry continue de creuser et semble ne pas vouloir s'arrêter de creuser jusqu'à ce qu'il ait débouché de l'autre côté de la Terre où peut-être, du moins il l'espère mais sait bien qu'il se trompe, le jeune Dana pourra faire halte, non pas pour exercer son endurance amoureuse en refusant les tentations nichées dans les recoins troubles des villes portuaires, mais pour respirer à pleins poumons un air pur, plus pur que celui qu'il tente d'oublier et qu'il n'arrive bien évidemment pas à oublier, l'air où les mots de toutes les langues, les mots de tous les livres (cf. pp. 114-5), n'en constitueraient enfin qu'une seule, n'en formeraient enfin qu'un seul, une langue et un livre où se perdre à jamais sans voir le temps passer.
Cette stratégie est vouée à l'échec, qui évoque l'exemple des immortels de Borges, immobiles parce que la vie a cessé de les intéresser. Ils sont donc bel et bien morts, quoique immortels. Dana Hilliot, Malcolm Lowry tout autant, n'auront, eux, de cesse, de refuser l'engourdissement stérile, la longue mort immobile que l'immortalité accorde, moins en dissipant leurs forces sur toutes les mers du monde et en explorant les étranges contrées qu'ouvre la consommation frénétique d'alcool qu'en plongeant dans leur esprit, la seule terre qui, en fin de compte, jamais ne pourra être totalement connue ni même explorée.
Ne cessant de creuser, c'est donc aussi le même ouvrage que Malcolm Lowry n'a cessé d'écrire tout au long de sa vie tumultueuse. Oublions la faiblesse de l'image, tellement utilisée qu'elle en est presque devenue transparente, en nous souvenant de ce que Margerie Lowry crut bon de consigner dans son avant-propos à l'édition américaine d'Ultramarine : Malcolm Lowry avait décidé que son roman, «revu et corrigé constituerait le premier volume d'une série de six ou sept romans dont le titre serait Le Voyage qui ne finit jamais», changeant même le nom du bateau de Nawab en celui que nous avons précédemment mentionné, Œdypus Tyrannus donc, «afin de l'assimiler à celui de Hugh» dans Sous le volcan (2). De la même façon, Dana Hilliot, le personnage principal du livre, n'est que le masque de Malcolm Lowry plus tard dédoublé en fascinant Consul, qui se met en scène lorsqu'il s'agit d'évoquer les tentations d'écriture auxquelles le jeune homme est confronté (3).
Nous reconnaissons, dans cette volonté consistant à créer un univers romanesque cohérent, ce que nous pourrions appeler le syndrome Faulkner, pressé de résumer l'univers dans un monde inventé de la taille d'un timbre poste affranchi dans le comté de Yoknapatawpha, et, surtout, de lutter contre un désordre que son roman met pourtant en scène de façon prodigieuse, lui qui n'est que descriptions centrifuges, irruptions de langues, de remarques et de références parfois incompréhensibles, du moins dont la clé est absente puisque, comme Rimbaud, Lowry a réservé certaines de ses traductions : «Jamais il ne serait à même de comprendre les tortueuses énigmes des câbles d'un derrick, des leviers d'un treuil; ces machines immobiles qui, au terme d'un long voyage, n'en continuaient pas moins, à leur manière à elles, de haleter, de chuinter, il les considérait avec le même désespoir – impossible de les estimer à leur vrai poids de réalité –, elles lui demeuraient tout aussi impénétrables, au milieu du foisonnant chaos de la mer», cette description étant immédiatement suivie de celle de l'aspiration la plus profonde de Dana Hilliot, l'ordre bien sûr, perceptible «en puissance [dans] cette unité dynamique de systèmes connexes à laquelle, lui-même, aspirait» (p. 46), ordre désiré par celui qui embarque et quitte tout ce qui lui est cher, que ce désir soit conscient ou pas puisque c'est bien «toujours l'éternelle tentation de l'étrange, l'appel des contrées féériques, la promesse merveilleuse, extra-terrestre d'une récompense, une fois surmontés les orages de l'océan» (p. 54).
Les orages de l'océan sont en fait peut-être moins terrifiants que ceux qui explosent à l'intérieur d'une conscience, fût-elle, comme Blaise Cendrars l'écrivait, celle qui est logée dans le crâne d'un sourd. Ce que Dana Hilliot, qui se pique de littérature, cherche, ce n'est ni plus ni moins, comme son frère d'aventures, qu'une vérité à étreindre (et éteindre ? Non !) dans une âme et un corps : les siens bien évidemment (4), mais aussi l'âme idéale qui, dans ce roman de la quête extatique, est moins la femme aimée, et perdue, aimée, sans doute, à mesure qu'elle a été perdue, que Dieu et surtout le Christ, dont la présence est continuellement rappelée par Lowry (5).
Ainsi le matelot moqué par tous les marins expérimentés peut-il utilement se prendre pour un Christ en toc ou «en papier d'étain» (p. 110), puisqu'il est né à «Christiana, dans le Christian den 4 des gade, noms dangereux pour [lui]» (p. 111), ainsi peut-il croire en une mortification qu'il s'infligerait à seule fin de reconquérir la promise désormais si lointaine, gardée en tête par la seule vertu d'une remémoration maladive bien davantage que par les lettres qu'elle écrit et qui semblent malicieusement se perdre en route, ainsi peut-il répéter sans relâche, comme une moderne actualisation de l'antienne maléfique du Marin de Coleridge, «l'histoire de [son] ignorance hébétée de boisson, de [son] idéalisme crotté jusqu'aux dents, de [son] insincérité sans fond» (ibid.), afin de mieux jouer le seul rôle qui compte finalement, et poser de surcroît la seule question qui vaille : «Est-il quelqu'un qui puisse, jusqu'à toucher du doigt l'unique et suprême, l'infaillible vérité, s'approcher d'elle, et pourtant, ne jamais la saisir, ni l'étreindre ? Quelle existât, quelqu'un, s'y heurtant accidentellement, s'en était-il jamais trouvé frappé comme d'un éclair, et aveuglé ? C'était-il arrivé au Christ ? À Bouddha ? À Confucius ? Et qu'était-ce donc, cette vérité ? La vérité absolue, la beauté absolue, la bonté absolue, l'absolu n'importe quoi – tout cela ne constituait-il qu'une seule et même chose ? Sacrebleu ! Tout cela convergeait-il, comme à une pomme de grand mât, en un seul faîteau d'absolution ? On n'en savait tout bonnement rien. Mais demeurait toujours le faible espoir, la falote prémonition qu'un jour, piquant la rouille sur le pont ou épissant un câble, ou lisant Pierre le Bleu, du gouffre de la nescience, on verrait cristalliser, resplendir en toute évidence, l'unique vérité qui signifierait puissance absolue, félicité absolue» (pp. 133-4).
Quête perdue d'avance bien sûr, comme toute quête véritable qui pourtant confère à l'homme sa stature, et sans la poursuite de laquelle il ne serait rien de plus qu'un porc. Quête interminable, puisque le soupçon que le bateau où se trouve Dana Hilliot n'a aucune destination véritable a vite fait de germer dans l'esprit du héros (cf. p. 177), alors même qu'il sait bien que tous les ports, comme l'horreur, universelle (6), se valent qui ne sont même plus des villes, «mais des rivières congestionnées, encombrées d'algues, qui charriaient des corps sans vie, les groupaient, les séparaient et de nouveau les rassemblaient comme des courants rivaux» (p. 179), alors même qu'il lui semble avoir été abandonné par Dieu (cf. p. 187) et que, plus que jamais, le désordre et le chaos mènent la danse, et ne sont acharnés qu'à ruiner l'ordre et l'harmonie : «Pourquoi ne supportait-il pas, d'une âme égale, la dissonance comme l'harmonie, pourquoi ne pouvait-il faire en sorte que l'ordre émergeât du chaos même ? Dieu, de toute évidence, avait créé l'homme libre – cela dès l'origine, dès qu'il l'eut tiré de la boue, de cette mixture croupie, régurgitée du fond des entrailles du chaos. Tout, se disait-il, dans l'esprit de l'homme ainsi que sur le navire, ressortissait au chaos, à la désunion, non pas à la loi, ni à l'ordre» (pp. 193-4).
Pourtant, c'est dans le chaos même que croît ce qui sauve, et nous savons bien que Dana Hilliot, ailleurs que sur le bateau détesté mais qu'il apprendra à aimer, vivant une autre vie que celle qu'il abhorre, est tout simplement impossible à imaginer. C'est d'ailleurs sur son bateau au nom si lourdement symbolique que le héros aura, le temps d'une fulgurance, l'intuition que la disharmonie n'est rien de plus que notre incapacité à percevoir l'ordre, où qu'il se trouve, fût-ce en enfer : «Et, tout d'un coup, le tintamarre tourbillonnant des mécanismes enchevêtrés et des aciers étincelants fit place, en son esprit, à une claire intuition des relations logiques qui commandaient les impitoyables cadences de ces barres en mouvement; les leviers se mirent à danser en mesure avec une étrange cantilène que Hilliot, inconsciemment, avait modelée sur leur murmure, et il lui apparut qu'à travers tout ce complexe engrenage [...], c'étaient sa propre raison d'être, ses propres conflits qui étaient en cause» (pp. 194-5).
Cette claire mais fugace perception de l'harmonie n'aurait elle-même guère d'intérêt si, comme tout écrivain aventurier de race, Dana Hilliot ne cherchait à trouver une vérité incarnée, autrement dit s'il ne cherchait pas, en tout premier lieu, une praxis qui permettrait aux livres, à ses propres livres, d'être autre chose qu'un peu d'encre sur des feuilles, et à son écriture de déboucher sur une réelle présence qu'elle ne cesse d'évoquer et d'invoquer mais devant laquelle, ô cruel paradoxe, elle doit s'effacer, sauf à condamner à l'impuissance la réelle présence se passant de mots redevenus trompeurs. Mais posséder la claire perception du chaos menaçant de dévorer l'ordre est finalement assez peu de chose, rien de plus que le constat banal que pourrait faire, entre deux collations, tel esthète blasé au désespoir de salon, et qui à sa façon grotesque mais néanmoins louable tenterait de lutter contre l'entropie menaçant de dévorer sa fragile thébaïde. Toute autre est la volonté de lutter contre le désordre en fondant, en agissant, bref, en surmontant le désespoir et la férocité douloureuse de l'esprit lucide qu'incarne si merveilleusement Dana Hilliot, masque transparent de Malcolm Lowry, moins voyageur qu'homme politique, au sens le plus noble et ancien de ce terme bien sûr.
C'est tout le sens du passage qui suit, magnifique, et qui nous semble comme l'écho en creux, rêvé (car nulle part le personnage ne met à exécution son projet) de l'action, chimérique ou diabolique, d'un Rimbaud, d'un Kurtz ou même d'un Lord Jim, phrases qui, au passage, me semblent contredire l'assertion de Jean-Roger Carroy déclarant qu'Ultramarine n'est pas «un roman d'action», puisque nous assisterions au contraire à une psychanalyse», la belle affaire (cf. p. 241, dans une postface belle mais contestable quant à nombre de ses conclusions) : «Mais un jour, je trouverai un pays exténué, aveuli au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, où les enfants meurent de faim faute de lait, un pays qui a même passé la connaissance de son malheur, et je crierai : «Jusqu'à ce que par moi, il fasse bon vivre dans ce lieu, j'y resterai.» Oh, ce n'est pas assez de dire : «Je me sens solidaire de tout combat perdu d'avance», ou : «Je suis vivant, ne voyez-vous pas l'amour de la vie inscrit sur mon visage ?» ou encore : «Je suis las de ces musiques et de ces pavés, las de ces réverbères et des toiles d'araignées, las de la poussière. Je veux être un homme ! Aller de nouveau, à la mer !». Mais ce n'est pas assez, non plus, de le faire, si c'est pour offrir ses épaules au fardeau de montagnes plus belles, se fondre dans la gloire d'un théâtre plus beau. Mieux vaudrait fouetter l'océan, ou mettre à sac la maison de sa mère, – sonder les profondeurs. Ainsi la question se pose, urgente - où est la tâche à quoi s'atteler ? Où les choses demandent-elles à être améliorées, où le pourrissement peut-il tourner à la germination ? Où, la difficulté avec quoi je puisse me battre ? Où sont-ils, les esclaves à désenchaîner, les enfants à pourvoir de lait ? Je les trouverai, il le faut» (p. 213), parce que, Dana Hilliot a raison de le croire, «la pire souffrance est celle dont il ne reste rien» (p. 234 et dernière) et qu'une action, même éphémère et fragile par essence, même vouée à l'échec, vaudra toujours plus qu'un texte, fût-il celui d'un superbe écrivain.
Notes
(1) N'oublions pas également la source d'inspiration que représenta le roman de Nordahl Grieg intitulé Le navire poursuit sa course, évoqué dans cette note. Malcolm Lowry découvrit ce roman à bord d'un bateau, le S.S. Cedric, qui n'est autre que le navire où Conrad Aiken a situé l'action de son propre roman ! En juin 1931, Lowry s'embarquera sur un cargo norvégien en partance pour Leningrad et Arkhangelsk, pour débarquer à Oslo et tenter d'y rencontrer Grieg.
(2) Malcolm Lowry, Ultramarine (traduction de Clarisse Francillon et Jean-Roger Carroy, postface de Jean-Roger Carroy, Gallimard, coll. L'Imaginaire, 2004), p. 12. Toutes les pages entre parenthèses renvoient à cette édition.
(3) «Ja, peut-être, dis-je. C'est une idée. Mais le désir d'écrire est une maladie comme n'importe quelle autre maladie, et ce que l'on écrit, si l'on veut être un tant soit peu efficace, doit être solidement ancré dans une sorte d'autochtonie. Et là j'abdique. Je ne suis pas plus capable de créer que de voler dans les airs. Ce que je pourrais achever serait le sempiternel, timide premier roman dont il serait rendu compte à la morgue du Times Literary Supplement, «une œuvre indigeste et mal agencée», quelque chose de cette nature, dont le principal personnage ne serait ni plus ni moins pris d'alcool ou d'amour que l'abominable auteur en personne. Et puis, je crains que ça ne soit qu'une maladie infantile, diarrhea scribendi, rien de plus» (p. 107).
(4) «Croire encore en une mortification que je m'inflige, à travers ce besoin que j'éprouve de resserrer sur moi d'infrangibles, terrifiantes barrières, de façon qu'un procès de justification à ton égard s'instaure jusqu'à n'en plus finir ? Très bien alors, prépare-toi à des désillusions car, tel Melville, j'éplucherai ma cause comme un oignon, jusqu'au plus intime bulbe de la dégradation» (p. 111).
(5) Cf. pp. 48, 110, 111, 230, 233, etc.
(6) Voir à ce sujet la discrète quoique puissante évocation de la colonisation belge du Congo : «Le vieux roi Léopold, hein ? Oreilles coupées, poignets coupés... femmes indigènes. Mon vieux, tu devrais voir ces nègres, là-bas, ce qu'ils s'envoient comme quinine» (p. 207).




























































 Imprimer
Imprimer