« Excellences et nullités, une année de lectures : 2018 | Page d'accueil | Les Décombres de Lucien Rebatet »
09/01/2019
La Jeunesse est lente à mourir de Grégoire Dubreuil
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Mâles lectures.
Mâles lectures. De Grégoire Dubreuil qui publia deux ouvrages sans beaucoup de relief sous le pseudonyme d'Hugues Montseugny, nous nous intéresserons seulement à La Jeunesse est lente à mourir. C'est le second titre édité par La Table Ronde en 1984, le premier, Au large du siècle, ne nous ayant pas laissé beaucoup plus de souvenirs que l'un des livres maniérés et creux du gommeux Romaric Sangars : de la réaction lyrique donc séborrhéique, de grandes professions de foi qui sous la plume d'un Jacques de Guillebon, dernier Mohican armé de flèches en plastique, deviennent des slogans creux pour amateurs d'incorrection bourgeoise, toute cette écume plus légère que des gouttelettes de brumisateur déjà tamisée des dizaines de fois, mais tout de même plus bouillonnante lorsqu'elle débordait des pages de la revue Matulu que Dubreuil, justement, dirigea jusqu'à son dernier numéro. J'ajoute immédiatement qu'une toute petite chose sépare tout de même Grégoire Dubreuil de ces deux caniches permanentés de la droite à prétentions littéraires et collier de perles que sont Guillebon et Sangars : le style bien sûr qui, incontestablement, fuse de la moindre ligne de sa prose, même quand celle-ci cède aux facilités de la répétition, même quand elle s'aplatit quelque peu, par manque de cette tension qui tétanisera en revanche La Jeunesse est lente à mourir lorsque, dans les plus belles pages de ce roman, Grégoire Dubreuil chantera le sel brûlant des amours perdues et la beauté saumâtre du désir et du corps des femmes.
De Grégoire Dubreuil qui publia deux ouvrages sans beaucoup de relief sous le pseudonyme d'Hugues Montseugny, nous nous intéresserons seulement à La Jeunesse est lente à mourir. C'est le second titre édité par La Table Ronde en 1984, le premier, Au large du siècle, ne nous ayant pas laissé beaucoup plus de souvenirs que l'un des livres maniérés et creux du gommeux Romaric Sangars : de la réaction lyrique donc séborrhéique, de grandes professions de foi qui sous la plume d'un Jacques de Guillebon, dernier Mohican armé de flèches en plastique, deviennent des slogans creux pour amateurs d'incorrection bourgeoise, toute cette écume plus légère que des gouttelettes de brumisateur déjà tamisée des dizaines de fois, mais tout de même plus bouillonnante lorsqu'elle débordait des pages de la revue Matulu que Dubreuil, justement, dirigea jusqu'à son dernier numéro. J'ajoute immédiatement qu'une toute petite chose sépare tout de même Grégoire Dubreuil de ces deux caniches permanentés de la droite à prétentions littéraires et collier de perles que sont Guillebon et Sangars : le style bien sûr qui, incontestablement, fuse de la moindre ligne de sa prose, même quand celle-ci cède aux facilités de la répétition, même quand elle s'aplatit quelque peu, par manque de cette tension qui tétanisera en revanche La Jeunesse est lente à mourir lorsque, dans les plus belles pages de ce roman, Grégoire Dubreuil chantera le sel brûlant des amours perdues et la beauté saumâtre du désir et du corps des femmes.Plusieurs ombres peuvent être convoquées autour de ce roman vif quoique parfois verbeux qui n'a pas été réédité par La Table Ronde dirigée par la piètre Alice Déon, sans doute parce que cette femme, qui est à l'édition ce que Francis Lalanne est à la poésie, une cocasserie restons aimable, est bien trop occupée à publier des médiocrités et surtout parce que tel ou tel passage du roman de Dubreuil tomberait de nos jours sous la double accusation infamante d'homophobie et de misogynie; plusieurs ombres disais-je, outre celles que cite l'auteur un peu trop facilement (Morgan, Mann, Nietzsche, Montherlant, Brasillach, Drieu la Rochelle, Rebatet, etc.) et comme s'il avait besoin de se rassurer, qu'il s'agisse du Julien Gracq du Beau ténébreux ou de Jean-René Huguenin, d'ailleurs plus l'auteur du Journal que le romancier de La Côte sauvage, Grégoire Dubreuil étant d'abord essayiste et polémiste plus que véritable romancier, romancier pur pour ainsi dire, ne se contentant pas d'habiller ses colères de défroques portées par les personnages qu'il invente à seule fin de servir ces dernières, les plantant dans un décor qui, lui-même, est théâtral, «austère paysage d'hiver qui semblait être le décor parfait des déchirures de ces êtres» (p. 134).
 Acheter La Jeunesse est lente à mourir sur Amazon.
Acheter La Jeunesse est lente à mourir sur Amazon.Ces ombres sont les moins tenaces ou les plus transparentes si l'on veut et occuperaient aimablement quelque universitaire désœuvré car une autre, bien plus épaisse, exsude lentement, jusqu'à former une espèce de brouillard noir, du roman de Grégoire Dubreuil et cette ombre, bien sûr, n'a que peu de rapports, y compris esthétiques, avec de quelconques modèles littéraires, même quand ils se laissent si facilement entrevoir à force d'être attachés à de criards poteaux de couleur.
Cette ombre est celle d'un passage, celui de la jeunesse qui, contrairement à ce qu'affirme le titre, n'est pas lente mais fort prompte à mourir, vers l'âge d'homme, autrement dit la solidification de «l'illusion amoureuse de la jeunesse» dans «le désespoir de l'âge d'homme», un désespoir lucide qui serait l'apanage d'une «forme de gouvernement fasciste, réservé aux élites de l'âme», un désespoir viril, lucide, véritable «pouvoir de création» et non un «désespoir niais», dangereuse «puissance de destruction», autant de facettes de ce que Grégoire Dubreuil n'hésite pas à appeler «un nihilisme ascétique» (1) qui contentera surtout les petits Jünger de papier. Ce désespoir lucide, nul doute que Pierre Drumond ne le considère comme «une revanche à ses défaites» (p. 43) mais aussi à ses amours perdues, dont le plus torturant est sans conteste Fanny Heller, maîtresse qui ne cesse, tout au long du roman, de hanter l'esprit et le corps du personnage principal qui se perd dans les corps plus que dans les esprits que finalement il méprise, d'autres belle jeunes femmes, Inès, Blandine, Claire, la liste n'est pas exhaustive.
Si Pierre Drumond, comme tous les séducteurs, jouit de la capacité, bien plus douloureuse qu'épisodiquement plaisante, de «prendre mentalement possession de tout ce qu'il aimait» (p. 46), c'est pourtant le fantôme (encore un !) de Fanny qui ne cesse de le poursuivre, alimentant de son suc aussi puissant qu'aigre «la dimension tragique de l'existence nietzschéenne» qui, bien davantage que «le message d'amour et d'espérance délivré par le Christ» (p. 58) (2) qu'il essaie sans trop de succès de faire cohabiter sous un même toit crevé d'orages, est son unique empan pour mesurer le monde. Les plus belles pages du roman, d'ailleurs, plus que de vagues épanchements tentant de concilier être et action, femmes et écriture, vie réelle et songe de vie, sont celles que Grégoire Dubreuil emploie à tenter de caractériser la fascination qu'éprouve son héros pour celle qui fut sa maîtresse, écrivant ainsi : «Et s'il était un hérétique en ce monde qui dilapidait chaque jour ce qu'il aimait, il était un hérétique que la mutilation du visage aimé de Fanny Heller avait rendu à ses chimères, et qui perdait, comme un blessé son sang, la foi en ses hérésies» (p. 73). Grégoire Dubreuil ne possède assurément pas la puissance d'abstraction des grands romanciers qui suggèrent plus qu'ils ne disent explicitement, mais il est cependant d'une justesse prodigieuse lorsqu'il évoque les plus fins dessins de la peau d'une femme, les linéaments complexes des hésitations, atermoiements et lâchetés d'un séducteur empêtré dans les mangroves du désir aussitôt perdu que caractérisé, mais inexistant s'il n'est justement pas longuement couché par écrit puis disséqué.
Comme tous les séducteurs, Pierre Drumond est un homme non point seulement triste mais dont la tristesse est le fond réel, véritable, unique, quelles que soient les grimaces de plaisir ou de joie qui déforment son visage méprisant plutôt qu'altier, dont le secret est scellé à tous autant qu'il est libéralement exposé : il s'ennuie, et, s'il multiplie les conquêtes, ce n'est pas tant pour caresser le vertige du nombre, ce n'est pas tant parce qu'il serait persuadé, naïvement, que «la multiplicité des corps [ouvrirait] une vie plus intense» que parce que le hante la certitude qu'au-delà de Fanny Heller «il n'y aurait rien d'autre comme horizon que la froide multiplicité des corps» (p. 79).
Il n'y a pas que les femmes que Pierre Drumond prend de moins en moins de plaisir à perdre, au deux sens de ce verbe, puisque la littérature, elle aussi, sans doute beaucoup plus que ses autres maîtresses, semble prendre un malin plaisir à lui échapper : «Et quand il ne croquait pas les fruits du jardin des corps, la nuit, les yeux fiévreux, le visage émacié, ce solitaire renversait la littérature sur sa couche dans l'espoir de féconder des œuvres trempées de sang, de boue et de lumière» (p. 80) soit, à la lettre, le rêve de tous ceux qui rêvent d'écrire plutôt qu'ils n'écrivent, et ne sont jamais, dans le meilleur des cas, que les auteurs tourmentés de romans qu'ils sont les seuls à avoir composés et lus, mais en imagination. Perdre une femme, croire qu'on l'a aimée et, pour tenter d'en recomposer l'image brisée, se perdre dans une méthodique mais illusoire quête d'unité en les voulant toutes, en les baisant toutes, en les détestant toutes, en les ratant toutes, c'est finalement essayer, tout aussi vainement, d'écrire le seul livre qui jamais ne s'est donné à vous, celui que d'autres ont écrit, possédé, créé.
Nous comprenons assez vite pourquoi Pierre Drumond ne cesse de convoquer le souvenir obsédant de Fanny Heller, lui qui se joue «la comédie de la mise en bière de ses souvenirs» immédiatement suivie par la contemplation du cadavre déterré des souvenirs de son ancienne amante, afin de «se combler de son visage, se gorger de ses rêves insensés, s'abreuver à ses mots, promesses, serments, mots d'adoration, paroles de don, toute cette litanie secrète de leur intimité, et boire jusqu'à la lie l'ultime liqueur qu'elle avait déposée à ses pieds : la liqueur de la trahison» (p. 96). Cette liqueur, du reste, est un doux cordial plutôt qu'un robuste alcool : Pierre Drumond, avant même de poser son regard sur sa nouvelle proie, ne l'a-t-il pas trahie mille fois ? S'il se plaît tant à faire tourner follement la farandole des souvenirs douloureux, c'est parce que Pierre, contemplant ce spectacle douloureux de la maîtresse adorée surtout depuis qu'elle est passée dans d'autres mains (3), s'évite un travail qui nécessite une discipline de fer bien supérieure aux petits jeux vite appris et encore plus vite mornement répétés de la séduction, et ce travail est celui de l'écriture. Ce n'est pas pour rien que Grégoire Dubreuil nous indique que l'imagination de son personnage ne sait créer que «dans la nostalgie de ce qui [vient] d'être englouti» (p. 92).
Le beau dialogue que Pierre Drumond nouera avec l'abbé Croisic est à cet égard très riche d'enseignements qui, sous la classique impossibilité tant de fois rebattues par les Don Juan de tous les siècles, pour un artiste digne de ce nom ou se voulant tel, de passer tous les jours de sa vie avec une femme et, dans le même temps, de parvenir à créer, extraie des profondeurs les véritables causes des tourments du héros : la perte de l'enfance heureuse, prodigieuse, merveilleuse car, oui, décidément, «cette jeunesse est vraiment trop lente à mourir» (p. 135; la phrase sera plus d'une fois répétée), jeunesse réelle du personnage mais, bien sûr, dans le même mouvement, jeunesse du monde, âge où la foi semblait naturelle, coulait de source, ruisselait sur les êtres et les choses et leur donnait cette inimitable patine, ce lustre propre à la grandeur perdue, aux dieux enfuis, à l'aura évadée du monde délibérément aplati, définitivement désenchanté. Ce n'est pas sur la plage de Douvres que se tient Pierre Drumond comme une statue hiératique, le regard perdu mais, comme Matthew Arnold, lui aussi peut affirmer que la mer de la foi s'est retirée.
Grégoire Dubreuil, dans de très belles pages que nous saluerons pour leur éclat, néanmoins n'invente rien : derrière les tourments d'un séducteur se rêvant écrivain, l'étant même peut-être lorsqu'il ne pense pas à conquérir un nouveau corps et, le perdant, s'invente de nouvelles façons de souffrir, se cachent les affres du désespéré qui, à tort sans doute, par manque cruel de volonté peut-être, estime qu'il n'a pu se baigner dans les eaux de la foi ou que, s'il l'a fait, l'expérience a été trop rude, trop brève, que sais-je encore de toutes ces raisons que Pierre Drumond, malin comme un démon, aura vite fait d'opposer à son ami l'abbé Croisic, qui n'a qu'un seul tort, celui de ne pas être aussi intraitable qu'un de ces curés pétris d'une naïve mais inébranlable douceur que Bernanos a jetés à la face des impénétrables Cénabre !
Et encore, Cénabre ne tangue ni ne balance mais a la dureté du diamant, alors que l'abbé Croisic est un doux, d'ailleurs point trop ignorant de la passion dévorante consistant à désirer une femme et la conquérir, qui déclare aimer son ami Pierre Drumond, auquel il montrera que son désespoir, s'il n'est certainement pas feint, n'est en tout cas pas si ténébreux que cela : «Écoutez-moi, Pierre, vous n'êtes pas rejeté au néant quand les yeux de votre âme savent encore s'ouvrir à la lumière ! Or, votre nostalgie d'un élan amoureux est bien la preuve, si faible soit-elle en vous, que vos yeux regardent toujours vers la lumière, même si vous ne la voyez plus. Croyez encore à la lumière, Pierre ! Croyez encore à la nostalgie du respect amoureux ! Je suis convaincu qu'en vous les puissances de la création finiront par vaincre les forces nihilistes» (p. 137), ces forces qui sont celles qui entretiennent plus qu'elles ne le produisent le «déchirement intérieur», que Drumond qualifie de «seule réalité palpable de [sa] vie, et sans quoi» (p. 136), affirme-t-il à son ami, il n'écrirait pas.
Mais Pierre Drumond, s'il est un esthète et n'est peut-être que cela, est tout de même lucide sur ce qu'il est, lui qui certes aime jouer avec un nihilisme relatif, le papillonnage des corps et des esprits, mais redoute un véritable nihilisme, ce qu'il appelle un «nihilisme absolu qui ouvrirait une absolue dérision» (p. 135), nihilisme provoqué par sa défaite avec Fanny Heller qui le fait glisser vers le néant (cf. p. 134), s'enfoncer dans un monde vieilli et qui se disloque, épave qui, parvenue à son terme pitoyable, «n'est plus qu'à l'image d'un Sparkenbroke [le personnage donnant son nom au titre d'un roman de l'oublié Charles Morgan] éclaté dans la débauche» (p. 102).
Finalement, le mal qui ronge le personnage principal de ce roman de l'entrée sans cesse rejouée et comme telle impossible dans l'âge d'homme qu'est La Jeunesse est lente à mourir réside dans son incapacité à étreindre la vie pleine si puissamment analysée par Carlo Michelstaedter, ce dont il a conscience car, je l'ai dit, Dubreuil est un analyste bien davantage qu'un romancier, lorsqu'il déclare que tel «pauvre bougre des champs» est plus capable que nous d'étreindre «la terre et la vie» comme jamais «nous n'oserions plus les étreindre» (p. 130).
Pourtant, s'il n'a su étreindre correctement et se perd dans la conciliation impossible de l'amour et de l'écriture qui, déclare-t-il pompeusement, sont les «seules préoccupations terrestres qui peuvent [lui] permettre de connaître le Christ» (p. 108), Pierre Drumond n'est pas un cynique qui cracherait sur le passé de son propre manquement, et nous réalisons que Grégoire Dubreuil tente, dans son roman, de reconquérir un passé enfui, perdu, raillé peut-être, comme si la vraie vie ne pouvait décidément être conquise ou reconquise que par le lent travail de la mémoire et de l'écriture, de la mémoire alimentant le puissant courant de l'écriture qu'il s'agirait non point tant de faire se dissoudre dans la mer immense du langage que de provoquer à remonter vers sa source et son origine. En cela pourrions-nous rapprocher la tentative que Grégoire Dubreuil a menée dans ce roman de celle que Christian Guillet a poursuivie de livre en livre. Voyez ce très beau passage, qui concerne une fois de plus la douloureuse remémoration, par Pierre Drumond, du bonheur abîmé mais pourtant brûlant encore d'une ardeur terrible dès que le foyer de l'écriture en concentre les rayons épars : «À l'aube, le soleil la réveillait, comme jadis il réveillait la Grèce. Il arrêtait l'automobile blanche le long d'une crique du domaine marin retrouvé, et le soleil crachait ses langues de feu, mauves et bleues, sur les flots apaisés du lointain. Elle sortait, et regardait le soleil en un long face-à-face, avec dans ses yeux cet orgueil de l'adolescence et dans son âme cette puissance intérieure des souverains bonheurs», et alors elle capturait le soleil, poursuit Dubreuil, «pour l'offrir à l'amant en humble présent. Il venait vers elle, la remerciait de son présent, et à son tour il la regardait en un long face-à-face, avec dans ses yeux cet orgueil de l'amant et dans son âme cette puissance intérieure de la création», et alors «il la capturait», cette Fanny Heller boussole véritable de toute intériorité qui pourtant finira par haïr Pierre Drumond et jamais plus ne lui adressera la parole, «car elle était devenue son soleil, il baisait ses jeunes lèvres, en un baiser ouvert, il descendait en elle et elle en lui pour goûter la douce humidité de leurs bouches» (p. 114).
Il n'est, à ce stade, pas très étonnant que cette quête éperdue de la réelle présence convoque la personne du Christ confondue avec la certitude immédiate, au sens propre du terme, sans aucune médiation, du monde entier des choses, que procure l'enfance. En effet, l'homme «en son esprit d'enfance était encore capable de croire» car, «dans la spontanéité de son âge, dans l'ignorance d'une dialectique intellectuelle ouvrant progressivement aux spéculations de toute sorte, l'homme était encore capable de certaines gestes : je veux parler de la geste de la prière, par exemple. Il y eut aussi la geste des larmes. La prière, les larmes, autant d'oblations que la science et la dialectique ont fini par ridiculiser» (p. 106), tout comme elles n'auront pas manqué de tenter de ridiculiser le Christ que Pierre Drumond caractérise, et ce n'est pas un hasard bien sûr, comme un «enfant abandonné sur la croix de la déchirure» (p. 107), notre personnage, sur les brisées de Berdiaev (orthographié, encore, Berdiaeff dans notre roman), estimant que le Christ, «en abolissant la Loi, avait aboli l'ancienne religion de la soumission au Père pour ouvrir la nouvelle religion de la libération par le Fils» (pp. 107-8). Nous retrouverons le Christ aux toutes dernières lignes, assez confuses il faut bien le dire, du roman, mais retenons seulement que, bien plus que Nietzsche, il représente l'ultime môle absolument stable autour duquel tourne le monde labile.
La deuxième partie du roman de Dubreuil, en mêlant l'évocation de la vie aux côtés de l'une des maîtresses de Pierre Drumont et les articles politiques qu'il écrit mais qui ne sont publiés nulle part, comme cela ne cessera de nous être répété, peut être vue comme la tentative de fondre en une seule illustration les deux thématiques principales de notre livre, afin de parvenir à signifier cette réelle présence de la vie fondue dans l'écriture. C'est bien sûr la partie la plus faible du roman parce que Grégoire Dubreuil, qui ne parvient pas à se débarrasser de sa veine polémistique, didactique, nous donne à voir, certes à l'intérieur d'un roman et rattaché à sa trame de façon assez lâche, son don principal, celui d'un excellent journaliste qui, sa vie durant, eût pu se contenter de prolonger les cris non point tant de Bernanos qu'il goûte (qui, d'abord, fut romancier et abandonna ses chères créatures de papier pour se consacrer à des essais) que d'un Jean Cau par exemple. Je pense même qu'il eût pu utilement remplacer la désinvolture de plus en plus empesée et morne dans laquelle un Gabriel Matzneff tente d'envelopper ses restes de vitalité. Il renouvelle d'ailleurs ces incises didactiques dans les lettres que Pierre Drumond adresse à son ami l'abbé ou à telle de ses anciennes maîtresses, et qui sonnent comme autant de douloureuses déclarations sur l'impossibilité de vivre dans une époque comme la nôtre, qui ne peut conduire un être comme Pierre Drumond qu'à se consumer, à céder chaque jour un peu plus à son «ancien élan de destruction» (p. 131), à ne jamais parvenir à aimer une femme ou à n'aimer que celle qui l'a fui, à ne même plus parvenir à désirer son corps, leur corps, les corps de toutes, à jouer la comédie du trouillard et de l'intellectuel qu'au fond il est, un de ces hommes vains qui connaît «toutes les ficelles du jeu, qui les tend jusqu'au moment où, prêtes à craquer, il s'en sort par une pirouette dont il s'abuse lui-même» (pp. 135-6) tout en appelant au secours le Christ, considéré comme «un être abandonné», comme lui, «dans la tragédie de sa singularité» (p. 138) et toujours incapable de faire le grand saut, moins celui dans le vide que dans la foi car «Pierre Drumond était de ces pécheurs qui n'auraient su vivre sans leurs péchés» (p. 144), preuve s'il en est, glisserions-nous malicieusement, que la christologie de Grégoire Dubreuil est pour le moins esthétisante avant que d'être rigoureuse ou simplement plausible.
L'inquiétude, bien évidemment bouleversante, demeure, et les plus beaux cris de Pierre Drumond résonnent je l'ai dit dans une époque creuse, refusant «les hommes authentiques de la clandestinité» alors que triomphent «les agitateurs du paraître, ces imposteurs spécialisés dans l'esbroufe» (p. 160), devant se contenter de gueuler sa rage dans des articles que nul ne lira car, nous dit Dubreuil, il fait partie de ces malheureux, plus nombreux qu'on ne le pense, qui ne peuvent se contenter de fredonner la vie ou d'accepter, «les yeux clos, le verbe muet, les mots à l'étable, qu'on la trahisse» (p. 163).
Ce que Pierre Drumond dans l'un de ses articles non publiés appelle l'«involution vers la médiocrité finale» (p. 166) n'est point en marche mais, littéralement, galope dans un pays vidé de sa substance, «Marianne la démocrate [n'étant plus] qu'une vieille maquerelle retirée dans sa maison de passe de l’Élysée», alors que ni Pierre Drumond ni son créateur n'ont l'envie de perdre leur temps «à coucher les yeux fermés dans le plumard d'une vieille peau fripée qui [leur] roucoule toujours les impostures douceâtres qu'elle roucoulait déjà aux jeunes députés de la Constituante» (pp. 170-1).
Rendons-nous à l'évidence, car l'écrivain authentique, tout autant que le polémiste de talent et le grand journaliste, si tant est que ces deux derniers termes puissent être rapprochés l'un de l'autre sans immédiatement détaler le plus loin possible, «sont des faucons empaillés» (p. 173) dans une société qui, à force de promouvoir le féminisme au détriment de la féminité selon Grégoire Dubreuil (cf. p. 204) et l'homosexualité à la virilité véritable, est devenue totalement anémique.
Que nous sommes loin des mâles vertus, tout droit acquises par l'expérience de la guerre et que n'a évidemment pas connues le personnage de Grégoire Dubreuil, que nous sommes donc loin d'une «insurrection chrétienne» (p. 175), alors que nous sommes condamnés à barboter dans une société où «bientôt courage, volonté et puissance ne s'inscriraient plus que dans une suspicion fasciste» (p. 177), Pierre Drumond ne se faisant aucune illusion, du reste, sur son propre courage lui qui déclare, dans une lettre à l'abbé Croisic, qu'au bout de son chemin, il se retrouve seul avec sa lâcheté (cf. p. 186), comme s'il avait été finalement parfaitement incapable de se conformer aux deux hommes qui ont illuminé sa vie, le Christ et Nietzsche (cf. p. 187), se laissant dès lors mollement choir dans la décadence considérée comme un «rouage irrémédiable dans l'émergence de tous les barbarismes» (p. 188). Je cite ce passage éloquent, évoquant le grand modèle que fut Drieu, mais aussi Bernanos, ou encore Céline, Montherlant ou Morand dont Dubreuil se veut l'héritier et qu'il ne prolonge hélas que dans leurs aspects les moins essentiels : «Pour devenir des conquérants de territoires neufs, d'une éthique brûlante, il nous faudrait au moins quelque chose à conquérir. Or il n'est plus rien qu'une vaste massification de la médiocrité. La massification de la pensée par les médias, ces porte-parole de l'égalitarisme, le réductionnisme matérialiste ont rendu dérisoire le cri d'un poète. Nous savons que le nouveau cycle d'une civilisation solaire n'est pas pour demain» alors même, poursuit Pierre Drumond, que «nous n'avons d'autre tâche que celle de défendre le meilleur d'anciennes valeurs en ruine. Nos livres pourraient-ils être autre chose que des histoires d'esthètes oisifs qui s'ennuient, et comblent leur ennui à penser ?» (p. 192).
Que reste-t-il à Pierre Drumond sinon ruiner ce qu'il est incapable d'étreindre correctement puisque, selon Grégoire Dubreuil, c'est un impuissant (cf. p. 237) (4) ? Coucher la beauté perdue dans de belles phrases que l'on rêve de jeter comme des poignards à la face bovine du troupeau et qui pourtant, comme tout le reste, tombent dans la molle rigole menant nos cervelles remplies d'un peu de bourre vers la grande mer informe de la dissolution; saluer la beauté dans une dernière tétanisation de la volonté; mettre la main en visière pour tenter d'apercevoir, au loin, les «dernières îles fortunées» (p. 215) et puis, d'un claquement de doigt, se jeter du haut d'une falaise et tout éteindre, la merveilleuse lumière méditerranéenne, plus dure d'être tranchante, la frivolité de Fanny Heller jouant, mais avec un autre que Pierre Drumond, la comédie du regard mouillé (cf. p. 219), cette «géographie des ruptures» (p. 232) qui pourrait être le magnifique sous-titre de La Jeunesse est lente à mourir, rejeter sans un regard en arrière les femmes qui sont la ou plutôt les passions de Pierre Drumond, et l'alliance impossible entre «les femmes et ses passions» (p. 240), et se débarrasser même l'écriture, même si nous doutons que Pierre Drumond soit cet écrivain authentique dont le douloureux portrait entaille les toutes dernières pages du roman de Grégoire Dubreuil, écrivain authentique qui, nous dit-il, «a pour lui et contre lui cette sanglante particularité qui fait de lui un homme possédé par les pouvoirs qu'il possède» (p. 244) ? : «Elle le quitta dans l'aube déjà tiède, et si vivante, de ces matins méditerranéens, saisir par ce silence qui s'allongeait de toute sa froideur sur l'ultime page blanche de leur rencontre, et qui soulignait, d'une suprême cruauté, la silencieuse solitude de l'avant-mort» (p. 210). Dans ce passage, le pronom personnel elle est évidemment mis pour une femme, Inès en l'occurrence qui, comme toutes les autres et même si celle-ci a tenté de retrouver la trace de Pierre, n'aura su le retenir, mais ce pronom personnel eût parfaitement pu remplacer la maîtresse que Pierre Drumond semble décidément incapable de saisir pleinement, comme nous tous d'ailleurs, je veux parler de la vraie vie, peut-être parce que cet impuissant n'aura su que lentement descendre vers l'abîme, sans jamais en toucher le fond, comme c'est le cas de tous les esthètes qui ne sont en fin de compte que des lâches, qu'il ne sera descendu, chacune de ses stations inversées étant marquée par le sacrifice d'une femme, sans pouvoir donc remonter, s'il est vrai que «les forces de la chute [ne peuvent] s'inverser en force d'élévation qu'à l'instant où elles se fracassent dans l'abîme» (p. 241).
Notes
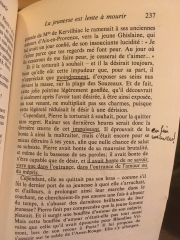 (1) Grégoire Dubreuil, La Jeunesse est lente à mourir (La Table Ronde, 1984), p. 42.
(1) Grégoire Dubreuil, La Jeunesse est lente à mourir (La Table Ronde, 1984), p. 42.(2) Notons que l'un des personnages, De Kervilhiac, parle du christianisme comme d'un «fruit artificiellement conservé, un anesthésique contre un désespoir sain» (p. 72).
(3) «Les mains de Pierre Drumond pétrissaient la terre de sa mémoire, et les caresses qu'il abandonnait sur le ventre des femmes n'étaient jamais que les caresses dont il ne pouvait plus faire don à Fanny Heller» (p. 97).
(4) Mon exemplaire du roman de Grégoire Dubreuil porte, à cette même page, le commentaire d'un précédent lecteur, pour le moins éloquent : «enfin un aveu !».






























































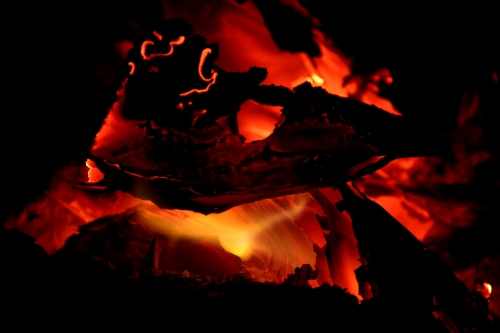

 Imprimer
Imprimer