« Entretien avec Paul Serey, auteur du Carrousel des ombres | Page d'accueil | L’opium et le bâton de Mouloud Mammeri, par Gregory Mion »
20/07/2019
Le Voyage du centurion d'Ernest Psichari
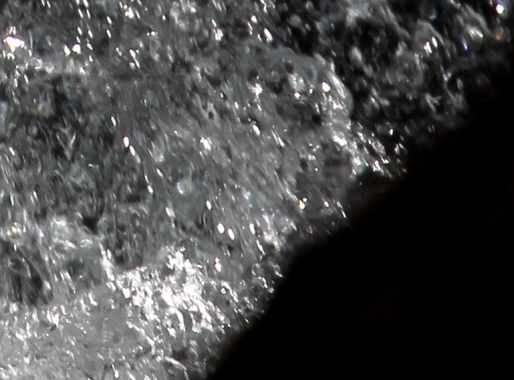
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Mâles lectures.
Mâles lectures.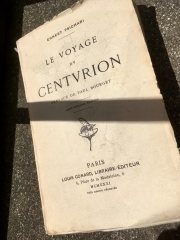 Je connais des catholiques, n'ayant que le doux nom de Jésus (béni soit-il) à la bouche et qui sucent ses deux merveilleuses syllabes comme un bâton de réglisse, qui ont lu, parce qu'il faut bien varier les plaisirs et faire succéder, à la sucrerie, de la mélasse, Conversion de Romaric Sangars, l'homme qui n'a pas craint de s'aventurer sur le chemin de la Croix-des-Ânes avec sa canne à pommeau en bakélite et son étendard en flanelle, et qui ne savent strictement rien du Voyage du centurion d'Ernest Psichari. Faisons donc ce que nous ne faisons jamais, en donnant quelques précisions d'ordre bibliographique sur cet écrivain. Le petit-fil d'Ernest Renan qui reçut une éducation pour le moins laïque s'engageat dans l'armée en 1903, à la suite d'une grave crise de conscience qui le mena au bord du suicide. Servant au Congo en 1906, il publie à son retour de Mauritanie L'Appel des armes en 1913. C'est au contact de la foi musulmane des Maures qu'il semble s'être converti et qu'il recevra le baptême le 4 février 1913, non sans que les cléricaux et les époux Maritain ne s'en félicitent bruyamment (mais la femme de Jacques, Raïssa, consacrera à Psichari de très belles pages dans ses Grandes amitiés). Psichari pensait devenir religieux ou prêtre de Saint-Sulpice quand la mobilisation d'août 1914 l'envoie au combat et mourir au front, à Saint-Vencent-Rossignol près de Vitron en Belgique le 22 août 1914, quelques jours à peine avant Charles Péguy, dont le superbe exemple compta tant pour lui. De lui, nous reste des carnes de route dans la façon de Pierre Loti, Terres de soleil et de sommeil, un drame en un acte, La nuit d'Afrique, son premier roman, L'Appel des armes et enfin le canevas de son dernier roman, Les Voix qui crient dans le désert. Souvenirs d'Afrique, à la fois carnet de bord et journal spirituel. Enfin, avec une préface de Paul Claudel, nous pouvons aussi lire les Lettres du centurion.
Je connais des catholiques, n'ayant que le doux nom de Jésus (béni soit-il) à la bouche et qui sucent ses deux merveilleuses syllabes comme un bâton de réglisse, qui ont lu, parce qu'il faut bien varier les plaisirs et faire succéder, à la sucrerie, de la mélasse, Conversion de Romaric Sangars, l'homme qui n'a pas craint de s'aventurer sur le chemin de la Croix-des-Ânes avec sa canne à pommeau en bakélite et son étendard en flanelle, et qui ne savent strictement rien du Voyage du centurion d'Ernest Psichari. Faisons donc ce que nous ne faisons jamais, en donnant quelques précisions d'ordre bibliographique sur cet écrivain. Le petit-fil d'Ernest Renan qui reçut une éducation pour le moins laïque s'engageat dans l'armée en 1903, à la suite d'une grave crise de conscience qui le mena au bord du suicide. Servant au Congo en 1906, il publie à son retour de Mauritanie L'Appel des armes en 1913. C'est au contact de la foi musulmane des Maures qu'il semble s'être converti et qu'il recevra le baptême le 4 février 1913, non sans que les cléricaux et les époux Maritain ne s'en félicitent bruyamment (mais la femme de Jacques, Raïssa, consacrera à Psichari de très belles pages dans ses Grandes amitiés). Psichari pensait devenir religieux ou prêtre de Saint-Sulpice quand la mobilisation d'août 1914 l'envoie au combat et mourir au front, à Saint-Vencent-Rossignol près de Vitron en Belgique le 22 août 1914, quelques jours à peine avant Charles Péguy, dont le superbe exemple compta tant pour lui. De lui, nous reste des carnes de route dans la façon de Pierre Loti, Terres de soleil et de sommeil, un drame en un acte, La nuit d'Afrique, son premier roman, L'Appel des armes et enfin le canevas de son dernier roman, Les Voix qui crient dans le désert. Souvenirs d'Afrique, à la fois carnet de bord et journal spirituel. Enfin, avec une préface de Paul Claudel, nous pouvons aussi lire les Lettres du centurion.Ces précisions figent un homme mais ne contribuent guère à nous rendre sa mémoire vivante, ni même à parvenir à imaginer l'ébranlement que provoqua son exemple. La «grande ombre» d'Ernest Psichari, comme l'écrivit Georges Bernanos dans une lettre, a été chassée comme un insecte importun. L'écrivain magnifique est oublié, même dans ses propres rangs, certes de plus en plus clairsemés et qui lisent de moins en moins. Nous ne nous en étonnerons pas, encore moins sera-t-il utile de nous scandaliser de cet oubli car, de tous les types d'êtres, le catholique, heureusement en voie de disparition accélérée, en France du moins, est celui qui va le plus naturellement, par un instinct plus sûr que celui d'un chien de chasse sur les traces d'une bécasse, vers la médiocrité. Pernichon est consubstantiellement médiocre, c'est ainsi qu'il se veut et s'aime, et le grand reflux de la marée chrétienne, en France, aura laissé, à l'estran, bien plus de palourdes et de bulots que de traces, mêmes fugaces, de grandes et mystérieuses créatures des profondeurs. Nous sommes devenus petits alors que nous ne cessons plus de nous hisser sur les talonnettes du progrès technique et, de façon logique, nous sommes rebutés par la grandeur et lisons nos semblables et frères, eux aussi petits. Par souci de respecter la diversité bientôt inscrite au fronton de la République, nous ne dédaignons pas, à l'occasion, lire des nains. Avoir lu Romaric Sangars et ne rien savoir de Psichari, rien de plus normal. Avoir lu Eugénie Bastié et ne rien savoir de Claudel, quoi de moins extraordinaire ? Avoir lu Jacques de Guillebon aligner des fadaises, des stupidités et des erreurs sur un anarchisme chrétien étendu à la Terre entière et ne rien savoir d'Ernest Hello, autant de clairs signes de la plongée, tranquille mais résolue, des catholiques français dans la mare de l'insignifiance. Comme j'envie, en fin de compte, celles et ceux qui ont découvert Céline et Bloy en lisant Nabe alors que, d'ici peu si ce n'est déjà le cas, les enfants de ces mêmes lecteurs liront probablement, pour la première fois, les noms de Léon Bloy ou de Barbey d'Aurevilly dans un article de Laurent Dandrieu ou d’Étienne de Montety, imagine-t-on ce que cela veut dire ? Je l'ai sans cesse écrit et le répèterai je l'espère jusqu'à mon dernier souffle : nous avons les auteurs, qu'ils soient vagues penseurs ou tout aussi vagues écrivains, que nous méritons, et j'interprète comme un clin d’œil funeste et ironique le fait que tant de ces têtards de bénitier, pullulant dans les salles de rédaction du Figaro, de La Croix ou de Valeurs actuelles, ne cessent d'écrire donc de bavarder, n'ayant pas même le talent d'un Henry Bordeaux ou d'un René Bazin, les troisièmes couteaux de la grande renaissance de la littérature chrétienne qui caractérisa le début du siècle passé. Nous avions alors Bourget, les deux que je viens de nommer (ce trio formant, du coup, les «trois B»), mais que dire d'exemples plus fameux comme Claudel, Mauriac, Bernanos, Jammes, Marie Noël, Patrice de La Tour du Pin, Maritain, Du Bos, Marcel, sans oublier évidemment Péguy ou encore Julien Green ? Même constat chez les théologiens, avec Rudolf Bultman, Paul Tillich, Karl Barth, Henri de Lubac et Hans Urs von Balthasar chez les catholiques, Teilhard de Chardin même ! Dieu, quelle époque, quel foisonnement intellectuel, à mille univers des petits articles aigris de nos catholiques bellamystes contemporains, dont certains semblent même en être venus à confondre une blonde peroxydée à queue de cheval certes impeccable avec la Pucelle voire, qui sait, avec la Vierge Marie !
Le chameau qui blatère a vite fait de se débarrasser des menus parasites qui le démangent, et s'enfonce alors dans le désert sans presque plus boire une goutte d'eau, fût-elle bénite. Notre monture s'ébroue, impatiente; elle sent que nous allons partir. Dans le silence du désert, mieux vaut choisir un texte qui ne se paie pas de mots et ne cherche pas absolument à combler le vide qui se fait en nous ! Mieux vaut lire, dans le désert, un texte qui assèche mais, comble du masochisme, creuse notre soif ! Le texte le plus connu de Psichari, préfacé, de manière superbe il faut bien l'écrire, par Paul Bourget, doit être lu d'une traite, comme on boit une rasade d'eau après des heures de marche sous le soleil brûlant, notre lecture devant mimer comme elle le peut le voyage du centurion, l'élan vers Dieu et, tout autant, l'élan qui fut celui de Psichari, mort bien trop jeune, héroïquement, au combat comme tant d'autres qui n'eurent pas la chance mais surtout l'honneur de laisser aux vivants un témoignage de feu. Paul Bourget ne s'y trompe pas qui écrit que le texte de Psichari «s'accorde à la mort de celui qui l'a écrit», écriture et mort étant à ses yeux «deux actes de foi qui se ressemblent, qui s'appelaient l'un l'autre» (1). Autrement dit, Ernest Psichari, pour la légende, a bien fait de mourir jeune, mais nous avons toutefois beaucoup de mal à l'imaginer comme l'un de ces vieux briscards du catholicisme salonnard, expert en petits fours et en casuistique ou, pire encore, les fesses grasses vissées sur un superbe fauteuil depuis lequel ce genre de nonce laïc ou de prélat exclusivement mondain exercent leur magistrature intellectuelle creuse et vaine qui, pour le coup, prétendra non pas étancher notre soif mais la tromper.
Aussi paradoxal que celui puisse paraître pour un texte qui n'est absolument pas avare en superbes métaphores et images (2), Ernest Psichari ne cherche pas à jouer avec les codes littéraires, petits amusements pour forts en thème, encore moins à prendre la pose : il nous fait suivre Maxence dans sa traversée du désert qui, faisant mentir l'expression aujourd'hui figée dans un sens grotesque et réducteur, est une illumination et, aussi, une plongée dans le silence, merveilleusement défini comme étant «un peu de ciel qui descend vers l'homme» (p. 149). Comme tout homme un peu digne de ce nom, ce n'est pas dans les bars parisiens et dans le confortable boudoir du Bedford, où nos plus grands publicistes incorrects manient le verbe en s'imaginant qu'il s'agit d'une épée de feu, que Psichari abandonne son héros, mais dans le désert, dans la terre d'Afrique (3) aujourd'hui haïe et crainte, puisqu'elle nous envoie ses cohortes de pauvres et d'affamés qu'aucune barrière ne semble plus pouvoir contenir. Il l'abandonne et le remet pourtant à la grâce de Dieu, comme il se doit, et cette marche pleine de dangers dans un paysage somptueux est le plus bel acte de confiance qui soit : je me remets entre tes mains, Seigneur, voilà ce que nous dit Maxence, et je sais qu'il ne pourra rien m'arriver, même si j'étais pris de vertige à l'idée que, dans le désert profond, je suis absolument seul et que, même si je criais de toutes mes forces, nul homme ne viendrait me secourir, car le désert est le dernier recès où Tu sembles désormais parvenir à Te cacher et à nous parler, car le désert est Ta demeure, car le désert est tout entier vibrant de Ta parole mais, avant de parvenir à l'écouter, je dois me taire, et oublier la palabre qui fut naguère mon élément. Bien des fois, sans beaucoup d'originalité puisque ce mouvement est celui de tout homme qui se déprend de son passé, Ernest Psichari opposera le vide plénier du désert africain au plein trompeur de la ville : «Ô vous tous qui souffrez d'un mal inconnu, qui êtes désemparés et dégréés, faites comme Maxence, fuyez le mensonge des cités, allez vers ces terres incultes qui semblent sortir à peine, fumantes encore, des mains du Créateur, remontez à votre source, et, vous carrant solidement au sein des éléments, tâchez d'y retrouver les linéaments de l'immuable et très tranquille Vérité !» (p. 11). Le mouvement est désormais inverse, parce que l'homme ne veut plus écouter la voix de Dieu qui est sa propre voix mais préfère recouvrir l'une et l'autre par le tintamarre des grandes villes.
C'est aux hommes qui hésitent, «avancent un pied, puis le retirent, comme l'homme de la ville sur les grèves», et aussi à «tous ceux qui trembleraient devant une vérité trop forte, comme l'homme de la ville cligne des yeux devant les facettes ensoleillées de l'océan» (p. 23) que Psichari s'adresse, sans jamais songer à les flatter, bien au contraire. Tout est commandement et, ma foi, il faut, dans ce livre comme dans le désert, marcher ou crever, s'extirper, d'abord, d'inter mundanas varietates puis se mettre en route per speculum in aenigmate, les titres de certains chapitres du Voyage du centurion mimant plus que clairement, sans l'ombre d'une ambiguïté, comme il convient à une opération militaire, une progression qui est une naissance, une révélation, l'arrachage du voile, lorsque, a finibus terrae ad te clamavi.
Si la traversée du désert est une expérience aussi profondément bouleversante c'est parce que, en creusant notre solitude, elle nous met en quête, en attente vibrante d'une réelle présence (4) qui jamais ne se donnera dans le bruit et l'agitation des villes. C'est une constante des textes décrivant une conversion, comme le montre encore l'exemple de Smara de Michel Vieuchange qui, lui aussi, s'enfonce sans hésiter dans les profondeurs inconnues du désert, y compris sous des vêtements de femme pour tromper l'attention. Pour être recueilli, il faut être abandonné et même, il faut se dépouiller de sa propre vanité comme d'une peau morte, croûteuse : «La douce chaleur des hommes ne soutient plus l'abandonné. Et c'est pourtant de ce néant qu'il devra tirer quelque chose qui soit, de cette carence qu'il devra tirer une surabondance. Ou sinon, plus misérable que jamais, il rentrera dans sa patrie ayant consommé le total échec de sa vie, les mains vides et le front honteux» (p. 28). Qui ne voit, dans ces lignes faisant écho à celles, somptueuses, d'Ernest Hello sur le désert, mais aussi la plus claire évocation de l'aventure d'Arthur Rimbaud, sa grandeur monstrueuse, sa fin sordide ?
Les étapes auxquelles le texte de Psichari nous convie (mais le mot est bien trop faible pour désigner l'impérieux geste de commandement militaire) ne sont pas franchement de repos, puisque la traversée du désert signifie que l'on s'est séparé des hommes et, surtout, de soi-même comme un autre, que l'on a admis comme une nécessité intérieure le fait de garder l'action secrète, la lente action de la grâce en nous, l'action de la grâce sûre et lente, obstinée à nous ravir à l'insignifiance qui nous transforme de manière si infiniment subtile, et parce qu'il ne faut pas craindre de vivre «cet universel délaissement lui-même» qu'incarne bien davantage qu'il ne symbolise le désert où les hommes, s'il en reste, vont chercher le dieu des déserts et, tout autant, où les hommes deviennent sérieux, deviennent hommes, redeviennent des affamés de la Parole, des chercheurs de Dieu : «Ainsi le Sahara a d'abord une valeur négative» (p. 35) car il nous dépouille de tout, et il faut être une fripouille comme François Augiéras pour en revenir encore plus soucieux qu'avant de petites afféteries et mondanités.
Cette valeur négative mime un retrait, une coupure, une séparation et, plus que cela, une véritable agonie, celle par laquelle nous devons passer avant de renaître, et cette agonie est celle du désespoir, qui tombe comme un couperet après une longue période d'hébétude, de lente dépossession de tout ce que nous pensions devoir nous constituer : «En sorte que, perdu très loin de tout, sur un de ces cercles que trace le géographe sur la mappemonde et ne sachant plus à quelle latitude il en était, sentant toute la dérision de cette mort africaine où l'on souffrait, de ce néant d'où émergeait le seul lotus de la souffrance, de ce néant où l'âme n'est plus étourdie par le bruit du monde et se mesure pour ce qu'elle vaut, défaillant sous la longue patience de la nuit, il était tout près de la plus grande et salutaire désespérance» (pp. 50-1). La nuit ne peut que déboucher sur les premières lueurs du soleil, au petit matin, en sommes-nous vraiment certains ? Assurément, répondra Tribulat Bonhommet mais ce banal constat, que l'expérience quotidienne confirme depuis que le monde est monde et que des hommes l'habitent, le pensent et le modèlent, le pèlent et le défigurent, n'est pas celui du désespéré, car le royaume des ténèbres, pour lui, est absolument tout, et qu'il est qui plus est obligé de s'enfoncer car, «au désert la pensée va plus en profondeur qu'en étendue» (p. 67), cette certitude de descendre, encore et encore, étant confortée par l'évocation des cercles concentriques de l'Enfer de Dante (cf. p. 70). En somme, pour le désespéré, comme le remarqua si justement Gabriel Marcel, le désespoir est tout, et nous ne devons pas nous étonner que le désert dans lequel il s'est perdu cristallise sa haine, avant que de devenir le sas qui lui permettra de s'aventurer dans un monde tout autre, que les meilleurs d'entre nous n'auront fait que soupçonner.
Mais il faut descendre, assurément. Il faut se perdre, volontairement, sans jamais être assuré de pouvoir voir le jour qui se lève.
Après tout, Maxence n'obéit-il pas, puisqu'il est militaire, à une discipline de fer, voisine sinon sœur de celle à laquelle celui qui s'avance vers Dieu doit se soumettre ? Oui, car, écrit Psichari, la «loyauté devant la France mène vite à la loyauté devant le Christ» (pp. 91-2), maxime d'un autre âge qui, durant plusieurs siècles n'a pas vraiment été contestée, sinon par quelques coquins et francs hérétiques. Oui encore, car le Christ lui-même, en désignant le centurion romain, a choisi le soldat, «afin que la grandeur et la servitude du soldat fussent la figuration, sur la terre, de la grandeur et de la servitude du chrétien» (p. 179), nouvelle assertion marmoréenne qui ferait aujourd'hui rire au sein des casernes, ne serait-ce que par l'emploi antithétique de deux termes que l'on n'est plus franchement habitués à coller ensemble. Mais, sur cette voie, outre le désespoir, la colère guette contre la demi-mesure et, bien vite, la tentation se lève de commettre, si l'on n'est décidément pas capable de s'engager dans la voie si étroite de la lumière, une action qui obscurcira sa conscience et même, si elle est grande, la mémoire pourtant labile des hommes. Si «tout est lié dans le système de l'ordre» mais aussi dans «le système du désordre» (pp. 77-8), Ernest Psichari ne pourra donc que poser cette évidence : «Donc, dit Maxence, il faut être un homme de reniement ou un homme de fidélité. Il faut être avec ceux qui se révoltent ou contre eux» (p. 78), version virile ou plutôt, politique, du fameux argument de Pascal. Quelques pages plus loin nous trouvons ce beau passage qu'il vaut la peine de citer tout entier, puisqu'il évoque une même force que le pécheur orientera vers les ténèbres ou au contraire vers la lumière, puisqu'il montre que seule la vérité peut être le garant ultime du sens de l'engagement et des actes d'un homme et que, sans cette vérité, il importera tout autant à un homme de s'agenouiller et de remercier que de supplicier puis démembrer un corps : «rien n'est beau que le vrai. Rien n'est digne d'un homme libre que l'amour, ou que la haine de l'amour». Et encore ce passage, qui décidément nous semble d'une trempe non seulement héroïque mais surhumaine et qui, une fois encore, admet seulement le triomphe de la vérité ou le bain de boue au milieu des pourceaux : «Que cette nef elle-même de Notre-Dame soit rasée à tout jamais si Marie n'est pas vraiment Notre-Dame et notre très véritable Impératrice. Que cette France périsse, que ces vingt siècles de chrétienté soient à tout jamais rayés de l'histoire, si cette chrétienté est mensonge. Que cette France chrétienne soit maudite, si elle a été édifiée sur l'erreur et l'iniquité» (p. 105).
En serions-nous donc arrivés, aujourd'hui que le catholicisme se réduit, en France, à de petits réduits de ferveur, que bientôt les touristes viendront photographier comme des animaux rares au zoo, à quelques raouts bruyants de béjaunes et de Pucelles de papier glacé se rêvant violents prêts au combat et à forcer les portes du Royaume, à des bancs d'églises surtout occupés par de vieilles personnes mais tout de même, et heureusement, dans ce marasme ressemblant à une fin de partie, alors que veillent depuis tant de siècles des solitaires dans le silence et la prière, en serions-nous donc venus à la malédiction ou bien, tout au contraire, est-ce que c'est parce que nous n'avons plus l'audace d'oublier notre âme de France, notre âme brisée, perdue, démolie, «et ces claquements de dents, sur le pavé de Paris, dans l'enveloppe circulaire de la pluie» comme l'écrit Psichari dès l'ouverture de son livre de feu, parce que nous n'avons plus le courage de forer le désert comme une balle traçante, parce que, dans notre pathétique délire œcuménique, nous n'avons même plus la force de trouver de la grandeur à la sourate 109, dite des Infidèles (5), est-ce que c'est parce que nous avons renié et même craché sur notre baptême que la France catholique est menacée de disparition ?
Qu'elle disparaisse alors, et nous saurons, au moins, sur quel sable fut bâti le mensonge de sa grandeur.
Notes
(1) Ernest Psichari, Le Voyage du centurion (Louis Conard, 1931, pp. 26 et 27 de la Préface de Paul Bourget).
(2) «Maxence, sur le roc le plus haut, regardait simplement la plaine qui était déroulée à ses pieds, comme la feuille du livre qui a été lue et que l'on va tourner» (p. 19). Autre exemple : «L'homme nouveau se dresse, et, tandis que le regard prend possession du monde, et rentre dans la grande amitié des choses créées, tout ce qui fut d'hier est aboli et le trait noir de la nuit a été tiré au bas d'une page finie...» (p. 108). Je pourrais multiplier les citations qui, toutes, quel que soit le registre des métaphores ou des comparaisons, montreraient la lourde matière du texte de Psichari, matière qu'il s'agit toujours de spiritualiser, non pour la rendre évanescente ou aussi futile qu'un angelot peint au plafond d'une coupole, mais pour témoigner du fait que la beauté et l'esprit la traversent. Je parle d'un âge point si éloigné que cela où les catholiques écrivains savaient donc écrire parce que, en tout premier lieu et contrairement aux apparences, ils se préoccupaient de l'écriture comme un bon potier commence par choisir avec soin la terre qu'il va utiliser alors que, maintenant, n'ayant plus que le mot Dieu à la bouche, ils ne savent que baver et bêtifier.
(3) Bien des passages évoquent superbement ce magnifique continent, conçu comme une terre édénique, moins primitive que primordiale, dont la douceur est pastorale, chacun de ceux qui l'ont connue, nous dit Psichari, ayant éprouvé «ce jaillissement original de la vie» (p. 214), une terre expiatoire, de mission et de conversion, y compris intérieure, qui permet non un élargissement mais une concentration (cf. pp. 114-5, où l'auteur parle d'«extension» et d'«approfondissement»). En voici un exemple : «Ainsi le voyageur, sur la terre d'Afrique, quoi qu'il fasse et quoi qu'il veuille, est toujours Christophe avec son long bâton, portant, auprès de sa tête inclinée, l'Enfant avec le globe et l'auréole de la lumière invisible» (p. 122).
(4) Attente vibrante, puisque «l'homme est en plein contact avec le monde, il est comme un gong où le temps frappe à petits coups et les ondes de métal s'élargissent, et s'amplifient, selon des lois mathématiques» (p. 96).
(5) Ernest Psichari la cite dans son texte, mais aussi dans Les Voix qui crient dans le désert : «Ô Infidèles ! Je n'adorerai point ce que vous adorez. Vous n'adorerez point ce que j'adore. J'abhorre votre culte. Vous avez votre religion et moi la mienne».





























































 Imprimer
Imprimer