« Au plus noir de la nuit d’André Brink : l’Apartheid démantelé, par Gregory Mion | Page d'accueil | On ne se méfie jamais assez de l'avis des amimots, par Damien Taelman »
26/07/2019
L'Immoraliste d'André Gide est-il plus qu'un pédéraste au désert ?
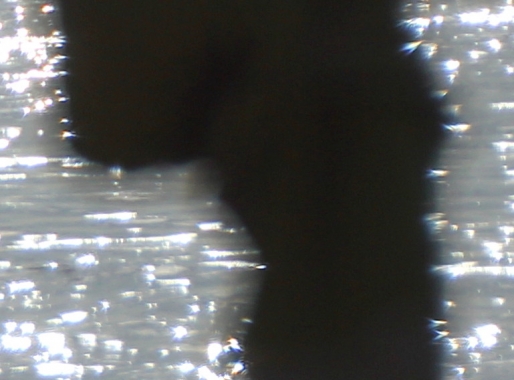
Photographie (détail) de Juan Asensio.
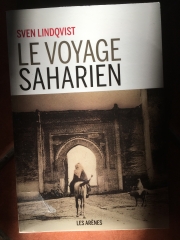 Acheter Le Voyage saharien sur Amazon.
Acheter Le Voyage saharien sur Amazon.Quelle étrange enquête que ces Plongeurs du désert (1) de Sven lindqvist, le sujet du titre n'étant directement abordé que dans les dernières pages de ce livre moins connu qu'Exterminez toutes ces brutes !, référence directe à la noire aventure de Marlow à la recherche de Kurtz, et que les éditions des Arènes ont eu la judicieuse idée de proposer avec le premier texte en un seul volume.
Mêlant habilement description de rêves et de cauchemars, carnet de bord de l'avancée au fond du désert et évocation de plusieurs grandes figures ayant été fascinées par celui-ci, qu'il s'agisse de Joseph Kessel, Saint-Exupéry, Michel Vieuchange ou Isabelle Eberhardt, sans oublier Pierre Loti et Eugnène Fromentin, nous ne nous intéresserons qu'aux quelques pages qui évoquent directement L'Immoraliste d'André Gide, plus particulièrement à la thèse, pour le moins expéditive, de l'auteur, moins sur ce roman qui ne nous a jamais laissé un grand souvenir que sur tel désir inavoué qui, selon lui, creuse le texte gidien de sentines puantes, aujourd'hui largement exposées par les continuateurs pédérastiques de Gide : «Il n'est pas certain que les colonies aient jamais procuré le pouvoir ou les revenus que leurs défenseurs espéraient et qui leur servaient à motiver les troupes. Mais dans la vie spirituelle de l'Europe, elles eurent une fonction importante», faisant ainsi office de «soupape de sécurité», et représentant un «exutoire à la cruauté et à l'arrogance qui, à l'intérieur de l'Europe, n'étaient pas tolérées» (p. 138) (2). Lindqvist précise, à la suite de ce passage que, «dans les colonies, on pouvait, tout en continuant d'incarner le summum de la civilisation, échapper à beaucoup de ses désagréments» que sont «la banalité bourgeoise, la tristesse conjugale, le contrôle répressif de ses pulsions» et, dès lors, «s'adonner au massacre de masse, à l'agression des enfants, aux orgies sexuelles et autres formes de libération de ses pulsions, qui chez soi ne pouvaient avoir lieu qu'en rêve» (p. 139). André Gide, du moins son personnage, serait ainsi un agresseur d'enfants selon Sven Lindqvist. Nous allons voir que son personnage principal, Michel, plus d'une fois semblera s'approcher de pensées encore plus sombres que les amusements avec les enfants et les adolescents.

Acheter L'Immoraliste sur Amazon.
Il est clair que Lindqvist n'a guère de doutes sur les intentions réelles que Gide, qu'il ne semble pas franchement apprécier, feint de cacher, non seulement dans L'Immoraliste mais aussi dans Les Nourritures terrestres, qui furent pourtant son livre préféré et le firent se considérer comme le frère spirituel de Nathanaël, jusqu'à ce qu'un homme, lui-même adepte de tripotages de chairs nubiles lui ouvre l'esprit, qui lui fait cette remarque : «Toi qui as lu Les Nourritures terrestres, tu ne comprends pas de quoi il s'agit dans ton livre préféré ?», avant de lui lire certains passages, apparemment pas vraiment équivoques : «Je n'avais pas vu que parmi les Arabes se trouvaient aussi «des enfants» lui semblant «beaucoup trop jeunes, dis ?, pour connaître déjà l'amour». Le jeune Sven finira par fuir son hôte, plus âgé que lui et initiateur malheureux, avant de le menacer de le dénoncer à la police : «Tu es fou ? dit-il. Tu veux m'envoyer en prison ?» Puis il lui parle, logiquement, d'Oscar Wilde : «C'était Oscar Wilde qui était le modèle de Ménalque», poursuivant en déclarant que : «Wilde était mondialement connu», alors que le «jeune André Gide n'avait pas encore débuté quand ils se sont rencontrés à Paris en 1891. Ils sont restés ensemble chaque jour sans exception pendant trois semaines. Gide a arraché les pages de son journal concernant ces trois semaines» (pp. 110-1). Le jeune Sven ne dénoncera pas John, mais, dans son esprit, «le message dans Les Nourritures terrestres s'était soudain réduit» : «Je ne m'appelais plus Nathanaël» (p. 111).
Il n'y a donc pas, selon l'auteur, que les puits du Sahara qui, comme ceux de Laghouat, sont remplis de cadavres, mais aussi «l'histoire de l'impérialisme» (p. 78) et, donc, tel roman dont les sucs venimeux semblaient pourtant depuis longtemps à nos yeux s'être éventés. Car enfin, comment accorder beaucoup de temps à ce texte qui ne vaut probablement d'être rappelé que pour telles fameuses assertions («Les plus belles œuvres des hommes sont obstinément douloureuses. Que serait le récit du bonheur ? Rien, que ce qui le prépare, puis ce qui le détruit, ne se raconte»), du reste battues en brèche par cette histoire assez convenue de transformation ou plutôt, de libération d'un homme engoncé dans des règles morales qu'il rejette peu à peu à l'occasion de son mariage puis de son voyage en Afrique du Nord, occasion de découvrir son irrésistible penchant pour la jeunesse ? (3) Bien loin de nous épouvanter par sa hardiesse, le personnage de Gide nous ennuie, qui ne cesse d'évoquer son attrait pour les adolescents (ainsi qu'Athalaric, mort à dix-huit ans au terme d'une «vie violente, voluptueuse et débridée», pp. 76-7) ou les enfants, toujours aperçus à moitié nus ou dans une «nudité dorée» (p. 50). François Augiéras a croqué en quelques phrases cruelles le pathétique de cet écrivain pédérastique et affamé de jeunesse(s) (4). Sa transformation nous fait bailler, elle qui ne semble être rien d'autre que la découverte de la vie par un esthète plutôt habitué aux recherches universitaires, elle qui, surtout, a depuis été mille et mille fois répétée par d'autres esthètes et jouisseurs, tous des moitrinaires comme les surnomma Léon Daudet, comme Renaud Camus ou le Gabriel Matzneff des Moins de 16 ans qui, non contents de confondre Monsieur leur nombril avec l'introuvable centre de l'univers, en détaillent le moindre quark d'insignifiance. Le Michel de Gide, lui, semble se pâmer... d'un bain de soleil ! : «Vite transi, je quittai l'eau, m'étendis sur l'herbe, au soleil. Là, des menthes croissaient, odorantes; j'en cueillis, j'en froissai les feuilles, j'en frottai tout mon corps humide mais brûlant. Je me regardai longuement, sans plus de honte aucune, avec joie. Je me trouvais, non pas robuste encore, mais pouvant l'être, harmonieux, sensuel, presque beau» (p. 66).
S'il n'y avait que cela, cette découverte de la sensualité, cette menue monnaie pédérastique quotidienne qui, du moins dans ce texte, n'ose pas encore se dire pleinement comme ce sera le cas dans Corydon, nous ne lirions qu'un texte, un parmi tant d'autres, du vieux faune Matzneff, perpétuellement jouisseur et qui, dans son cercueil, continuera de bander et rêvera d'enculer les angelots. Ce n'est pas désagréable ma foi, car Gide, encore plus que Matzneff, entonne une musique inimitable mais, assez vite tout de même, quel ennui de constater que l'un comme l'autre ne roulent des yeux que dès qu'ils aperçoivent un bout de chair moins flasque que la leur, qu'ils s'évertuent à faire paraître belle, tendue, désirable ! Heureusement, il y a plus, du moins chez Gide, qui arrache L'Immoraliste à la rigole de l'insignifiance, et c'est Ménalque qui va faire qu'un ferment d'ivraie contamine tout le texte, même si Gide, en jardinier distrait, ne l'arrosera que fort parcimonieusement : ce n'est pas dans L'Immoraliste que la plante dangereuse poussera, mais ce n'est pas vraiment non plus dans quelque autre texte d'André Gide. C'est bien ce personnage, tout droit sorti des laborieuses Nourritures terrestres, n'aimant certes pas le danger mais «la vie hasardeuse» qui désire qu'elle exige de lui, «à chaque instant, tout [son] courage, tout [son] bonheur et toute [sa] santé» (p. 113), qui lira clair dans le double jeu (5) de Michel. Plus, même, que cette thématique de la dissipation des apparences héritée du Portrait de Dorian Gray, c'est Ménalque lui-même qui, présenté de manière assez anodine, a de quoi inquiéter tout de même, et n'est pas sans nous rappeler l'exemple de Kurtz de Joseph Conrad. Nous savons ainsi que le ministère des Colonies charge Ménalque, aux prises avec une sombre affaire de mœurs, d'une nouvelle mission, les journaux, qui la veillent l'avaient insulté, ne trouvant désormais pas «de termes assez vifs pour le louer. Ils exagéraient à l'envi les service rendus au pays, à l'humanité tout entière par les étranges découvertes de ses dernières explorations, tout comme s'il n'entreprenait rien que dans un but humanitaire; et l'on vantait de lui des traits d'abnégation, de dévouement, de hardiesse, tout comme s'il eût dû trouver une récompense en ces éloges» (p. 118). Kurtz encore, qui, comme le narrateur gidien, ne semble pas avoir immodérément souffert d'une quelconque «agoraphobie morale», lui qui n'a jamais eu peur de «se trouver seul» (p. 119) !
Nous pourrions tracer d'autres parallèles entre les deux œuvres, en dépit même du fait que les deux auteurs, au moment où ils publièrent L'Immoraliste et Cœur des ténèbres, ne se connaissaient point et étaient encore moins les amis qu'ils finiraient par devenir (à partir des années 1910), Gide lisant puis traduisant, superbement d'ailleurs, Conrad, mais il n'en reste pas moins que quelques ressemblances frappantes existent entre les deux textes, d'autant plus troublantes que la chronologie exclut tout rapport direct. Ainsi, Michel, le narrateur de Gide (ou plutôt, l'un des narrateurs, le plus important en tout cas par la place qu'il occupe), remonte lui aussi, géographiquement, à la source de son amour, redéfaisant pas à pas son premier voyage avec sa femme Marceline (cf. p. 171) alors que, dans les toutes dernières pages du livre, Michel, comme Marlow, raconte à ses amis son histoire, ce qui est un point commun avec le texte de Conrad, moins intéressant tout de même que le fait que le narrateur premier, celui qui nous livre le récit de Michel, estime que ni lui ni ses amis n'ont le droit de condamner celui qui, ne poursuivant que son seul plaisir, est devenu inhumain (cf. p. 180) et a laissé mourir sa femme, voire l'a inconsciemment tuée puisqu'il faut finalement, comme les brutes de Kurtz, non point exterminer mais supprimer les faibles (cf. p. 166) : «Il nous semblait hélas ! qu'à nous la raconter, Michel avait rendu son action plus légitime. De ne savoir où la désapprouver, dans la lente explication qu'il en donna, nous en faisait presque complices» (p. 184). Cette tentative de dédouanement nous en rappelle une autre, celle de Marlow qui essaiera de faire du démoniaque Kurt l'un des nôtres (nostromo, autrement dit : notre homme), allant même jusqu'à mentir à la fiancée de l'explorateur, ainsi qu'il le fit pour un autre damné, Lord Jim. Avec ces éléments, nous dépassons la lamentable marotte pédérastique. Y aura-t-il plus, encore, dans le texte de Gide ?
Du reste, le narrateur lui-même ne s'y trompe pas, qui bien vite n'est attiré que par les gens louches, de petite vertu, consanguins même, et qui vit sa transformation non seulement comme une libération des vieilles servitudes, mais comme la naissance, de plus en plus indubitable, d'un homme fort. Passant ainsi de l'exemple concernant la bonne gestion de ses domaines agricoles à sa propre vie, le voici qui déclare : «Et je me laissais rêver à telles terres où toutes forces fussent si bien réglées, toutes dépenses si compensées, tous échanges si stricts, que le moindre déchet devînt sensible; puis, appliquant mon rêve à la vie, je me construisais une éthique qui devenait une science de la parfaite utilisation de soi par une intelligence contrainte» (p. 84).
N'est-ce pas là, en quelques mots, définir le projet même du personnage de Kurtz ? Ne faut-il pas encore remarquer que, si l'ancienne vie, désormais morte, est synonyme de faiblesse, la nouvelle, celle où l'on s'est dépouillé de tous ses oripeaux petit-bourgeois, est en conséquence assimilée à la vraie vie, la vie aventureuse, exaltante, qui n'aura plus aucune limite puisqu'elle n'obéira plus aux impératifs catégoriques de l'Europe aux vieux parapets. Il s'agit bien, dès lors, d'un «secret de ressuscité» (p. 106) et, aussi, de rejeter non seulement les convenances mais une raison qui, poussée trop loin, devient assez rapidement stérile, délétère. Le narrateur, évoquant «l'extrême civilisation latine», peint ainsi «la culture artistique, montant à fleur de peuple, à la manière d'une sécrétion, qui d'abord indique pléthore, surabondance de santé, puis aussitôt se fige, se durcit, s'oppose à tout parfait contact de l'esprit avec la nature, cache sous l'apparence persistante de la vie la diminution de la vie, forme graine où l'esprit gêné languit et bientôt s'étiole, puis meurt. Enfin, poussant à bout ma pensée, je disais la Culture, née de la vie, tuant la vie» (p. 107).
Quelques pages plus loin, il nous a semblé lire quelque anticipation des préoccupations d'un Carlo Michelstaedter dans ce jugement de Ménalque qui contient, d'ailleurs, un mot point inconnu de ce jeune philosophe génial : «Savez-vous ce qui fait de la poésie aujourd'hui et de la philosophie surtout, lettres mortes ? C'est qu'elles se sont séparées de la vie. La Grèce, elle, idéalisait à même la vie; de sorte que la vie de l'artiste était elle-même déjà une réalisation poétique; la vie du philosophe, une mise en action de sa philosophie; de sorte aussi que, mêlées à la vie, au lieu de s'ignorer, la philosophie alimentant la poésie, la poésie exprimant la philosophie, cela était d'une persuasion admirable. Aujourd'hui la beauté n'agit plus; l'action ne s'inquiète plus d'être belle; et la sagesse opère à part» (p. 125).
Une pensée véritable ne saurait donc être séparée de l'action qui la réalisera au monde, et inversement, une action digne de ce nom doit s'appuyer sur une pensée en perpétuel mouvement et ayant délaissé les livres : Kurtz, encore une fois, peut être dit l'exemple romanesque d'une telle alliance rimbaldienne. Remarquons à ce titre que le narrateur de L'Immoraliste, une fois qu'il a a réussi à «désembarrasser» son esprit «de cette insupportable logique» (p. 174), n'aura de cesse de retourner auprès des Arabes (surtout, bien sûr, les plus jeunes d'entre eux, dont Moktir et le petit Ali, qui deviendra son serviteur) car, dit-il, «le peuple arabe a ceci d'admirable que, son art, il le vit, il le chante et le dissipe au jour le jour; il ne le fixe point et ne l'embaume en aucune œuvre» (p. 175).
Kurtz rôde dans ces parages où il s'agit de ne point laisser se creuser un écart trop profond entre la pensée, le rêve d'action et l'action proprement dite : il faut que la parole retrouve sa vertu effective ou efficiente (en somme : quand dire c'est faire), qu'elle ne gâche point l'action mais soit comme son ombre portée ou, mieux, qu'elle soit elle-même action, voire que l'action dévore toute parole, toute pensée, toute logique et toute morale. Ainsi Michel, comme Kurtz, peut-il découvrir des trésors inviolés, des «richesses intactes» couvertes, cachée, étouffées par «les cultures, les décences, les morales» et, comme Kurtz aurait pu le dire, il affirme qu'il est «né pour une sorte inconnue de trouvailles», ajoutant qu'il se passionne «étrangement dans [sa] recherche ténébreuse», pour laquelle il sait, nous répète-t-il, qu'il doit «abjurer et repousser de lui culture, décence et morale» (pp. 162-3).
Nous pouvons je crois répondre par l'affirmative à la question provocante volontairement que nous avons posée dans notre titre : Michel, l'immoraliste de Gide, que nous ne ferons certes pas l'erreur de confondre avec ce dernier comme il nous en avertit dans sa Préface (cf. p. 7), est plus qu'un banal pédéraste et Sven Lindqvist n'a donc pas tort d'affirmer, lui aussi de façon provocante, qu'il voit dans l'histoire gidienne l'une des illustrations de sa thèse selon laquelle, dans les colonies, l'homme occidental abaisse, volontairement ou pas, sa garde, et se laisse pénétrer par des influences mauvaises, émanations méphitiques venues du fin fond de la jungle congolaise ou bien encanaillements dorés par les sables du désert. Mais, Gide, malgré la présence de Ménalque dont il eût pu faire un véritable Claudius Ethal ou bien un Lord Henry Wotton, ne semble s'en être véritablement tenu qu'à une exploration de surface d'une terre dangereuse alors que Joseph Conrad, lui, n'a pas craint de s'y aventurer profondément. L'horrible travailleur exigé par Rimbaud, n'hésitant pas à cultiver des verrues sur sa propre peau, c'est évidemment Kurt, infiniment plus que Ménalque ou Michel, l'un et l'autre obsédés par un secret qui ne ferait même pas sourire le psychanalyste le plus sourcilleusement moral.
Notes
(1) Sven Lindqvist, Le Voyage saharien (traductions du suédois d'Hélène Hervieu et Alain Gnaedig, Les Arènes, 2018). Sans autre mention, les pages entre parenthèses renvoient seulement au premier texte composant ce volume, Plongeurs du désert, donc, paru en Suède deux ans avec le second titre, soit en 1990.
(2) Je signale une coquille dans le texte imprimé, qui porte n'était.
(3) André Gide, L'Immoraliste (Gallimard, coll. Folio, 1984), p. 79. Il s'agit des dernières lignes de la première partie du livre.
(4) Extrait de cette note : «Il tient mon bras de nouveau, avec une force incroyable, presque sauvage, et je sens s'enfoncer lentement dans les veines de mon poignet les ongles durs de Gide, pénétrant toujours plus profondément dans ma jeune chair, cherchant le sang, cherchant la vie. Je ne bronche pas sous cette dure étreinte, le temps passe; soudain, il porte mes veines à ses lèvres, et s'abreuve à moi, longtemps. Puis me quitte. - Adieu, lui dis-je».
(5) La duplicité (avec le mensonge sous les apparences, le jeu perpétuel avec celles-ci, où le plus malin est rarement, en fait, le narrateur), est l'une des thématiques évidentes de l'ouvrage. Ainsi ce passage révélateur : «et, tandis qu'au long de mon cours je m'occupais, avec une hardiesse que l'on me reprocha suffisamment dans la suite, d'exalter l'inculture et d'en dresser l'apologie, je m'ingéniais laborieusement à dominer sinon à supprimer tout ce qui la pouvait rappeler autour de moi comme en moi-même. Cette sagesse, ou bien cette folie, jusqu'où ne la poussai-je pas ?» (p. 96). Oui, en effet, «on ne peut à la fois être sincère et le paraître» (p. 104).





























































 Imprimer
Imprimer