« Dialogues de vaincus de Lucien Rebatet et Pierre-Antoine Cousteau | Page d'accueil | La Colline inspirée de Maurice Barrès »
04/12/2021
Notre jeunesse de Charles Péguy

Photographie (détail) de Juan Asensio.
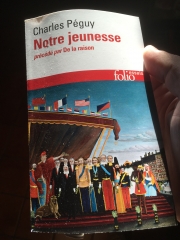 Acheter Notre jeunesse sur Amazon.
Acheter Notre jeunesse sur Amazon.Notre jeunesse (1), que Charles Péguy fit paraître dans ses fameux Cahiers de la Quinzaine en juillet 1910, n'est pas seulement un remarquable portrait de Bernard-Lazare considéré comme un prophète voire un saint ou du grand Georges Sorel auquel il est rendu justice, ni même une évocation de haute volée de l'affaire Dreyfus.
Notre jeunesse est plus que cela, plus, aussi, qu'un portrait dévastateur de Jean Jaurès.
Ce n'est pas davantage et seulement une charge de très ample portée contre l'antisémitisme, déjà fort virulent à l'époque de Péguy, sous la personne du redoutable polémiste qui fut le maître, jamais renié, de Georges Bernanos, Édouard Drumont. Nous évoquerons ici ou là le Grand d'Espagne qui, en somme, est un nom habituel à prononcer ou écrire quand on évoque celuiv de Péguy, Bernanos qui ne se tient jamais très loin lorsque Charles Péguy, devant lui comme il se doit puisqu'il est son aîné, avance sur les champs crevés de trous d'obus pour, nous assure-t-il, réclamer justice pour un homme, un seul homme, Dreyfus bien sûr (en fait, non, deux : Bernard-Lazare aussi, la mémoire de Bernard-Lazare qui aussi réclame justice), obéissant ainsi à un impératif catégorique intime, mieux que cela, car je doute que Péguy se fût bien longtemps rangé sous la bannière pulvérulente de Kant : mieux que cela donc, un commandement qui est appel, vocation (vocatus répètera Bernanos à l'envi) pour, tenant ferme la règle de l'honneur, ne lâchant pas de vue «la vieille poussée cornélienne», qui n'est, à ses yeux, pas bien différente de «la poussée chrétienne», laver la tache salissant la grandeur d'un peuple qui «est d'un seul tenant» (p. 293). Si l'un de ses innocents est accusé à tort, c'est toute la France, c'est tout le peuple de France qui, selon Péguy, est accusé à tort et souillé.
Se lever pour défendre l'honneur d'un homme injustement accusé de trahison n'est pas seulement un acte d'héroïsme bien réel même si, plusieurs fois, Péguy rappelle que ceux qui ont défendu, comme lui, Dreyfus, ont été, pourquoi ne pas le dire bien clairement, des héros; ce n'était donc pas seulement affaire d'héroïsme et de courage mais, beaucoup plus profondément, il s'agissait de se soucier du seul salut qui importe, qui est le salut éternel, et non pas le salut temporel, basse affaire de l'engeance politicarde, une faille que Péguy voit radicalement séparer les deux bords diamétralement opposés, les deux adversaires (et même, bien souvent, ennemis) en présence : «Tout au fond nous étions les hommes du salut éternel et nos adversaires étaient les hommes du salut temporel. Voilà la vraie, la réelle division de l'affaire Dreyfus» (p. 294). Voilà la seule peut-être, si l'on tient pour établi que, lors de la Guerre d'Espagne, Georges Bernanos, aussi, opposera le salut temporel, bien capable de bénir par l'évêque le front des Républicains qui allaient être exécutés d'une belle, et le salut éternel, dans le royaume duquel ces horreurs continueront de rayonner leur noire lumière jusqu'à la fin des temps.
Notre jeunesse contient toutes ces questions, ces thématiques, comme diraient les universitaires que Péguy n'aima guère, ces sujets et d'autres encore, ces portraits-là et d'autres encore (2).
C'est, aussi, avant tout peut-être, une critique implacable menée contre la modernité ou plutôt, contre ce que Charles Péguy appelle le modernisme, donc contre une évidence qu'il a été un des rares à avoir vue avec une telle pénétration, une telle acuité du regard : le modernisme ne peut être concilié avec la chrétienté qui, en conséquence, n'est plus qu'une chimère aux yeux de Péguy, et cela depuis quelques siècles tout de même. La chrétienté, ce n'est même plus ce monde passé, paysan, rude, fruste, économe, que Paul Milliet apporte aux Cahiers de la Quinzaine, la preuve et le témoignage, de première main selon l'auteur, de la vitalité de cette «culture du temps qu'il y avait une culture; comment c'est presque indéfinissable, tout un âge, tout un monde dont aujourd'hui nous n'avons plus l'idée» (p. 99), «l'histoire de tous les jours de la semaine» et pas seulement «une histoire endimanchée» tout juste bonne à moisir dans les livres des historiens, «c'est un peuple dans la texture, dans la tissure, dans le tissu de sa quotidienne existence, dans l'acquêt, dans le gain, dans le labeur du pain de chaque jour, panem quotidianum, c'est une race dans son réel, dans son épanouissement profond» (p. 98), c'est en bref ce à quoi Charles Péguy veut donner ou redonner voix, et célébrer en rappelant que le temps où il écrit est déjà celui d'une perte, non point irrémédiable comme elle l'est de nos jours, mais sur le point de basculer dans un gouffre plus vertigineux que le passé : l'oubli.
La façon la plus commode d'aborder cette grande problématique de la modernité que Péguy appelle modernisme, sur laquelle un Antoine Compagnon a fait son pain et même son miel, sans compter quelques brioches au beurre universitaire, jamais très naturel on le sait, consiste sans doute par citer, au préalable, De la raison, petit texte datant de la fin de l'année 1901 joint à notre édition, où Charles Péguy peut constater que «nous sommes aujourd'hui sous le gouvernement de la démagogie beaucoup plus que sous le gouvernement de la démocratie» (p. 69). Cette démagogie, apparemment fort répandue à l'époque de Charles Péguy, où la presse, pourtant, n'avait bien évidemment pas connu la foudroyante expansion, l'extension du domaine de son putanat actuel, s'explique pourtant par l'action de cette dernière car, déjà, elle constituait «un quatrième pouvoir» (p. 80), celui que l'auteur appelle le «véritable libertaire» sachant parfaitement «qu'il y a vraiment un gouvernement des journaux et des meetings, une autorité des journalistes et des orateurs populaires comme il y a un gouvernement des ministres et des orateurs parlementaires».
Charles Péguy ne se laisse conter aucune histoire à dormir debout, et c'est sans doute son imparable lucidité qui lui commande d'établir une comparaison, aussi savoureuse qu'ironique, entre le règne de la démocratie parlementaire et celui de la presse, tout aussi parlementaire dans sa propension intarissable au bavardage, parlement et Presse étant comme deux émanations moins concurrentes que jumelles de cette «clasa discutidora» moquée par Juan Donoso Cortés : «Quand un journaliste exerce dans son domaine un gouvernement de fait, quand il a une armée de lecteurs fidèles, quand il entraîne ces lecteurs par la véhémence, l'audace, l'ascendant, moyens militaires, par le talent, moyen vulgaire, par le mensonge, moyen politique, et ainsi quand le journaliste est devenu vraiment une puissance dans l’État, quand il a des lecteurs exactement comme un député a des électeurs, quand un journaliste a une circonscription lectorale, souvent beaucoup plus vaste et beaucoup plus solide, il ne peut pas venir ensuite nous jouer le double jeu; il ne peut pas venir pleurnicher» (p. 81). Bref, la raison, la droite raison que Péguy place si haut a été remplacée par autre chose que la raison ou plutôt : c'est sous des dehors mensongers, qui ne sont pas la raison mais son simulacre, qui ne sont pas la raison mais la démagogie (ou le mensonge, ou les deux) que l'on veut faire croire au bon peuple que triomphe la raison : «Nous demandons que l'on ne fasse pas croire au peuple qu'on parle au nom de la raison quand on emploie des moyens qui ne sont pas les moyens de la raison» (p. 91), tout comme Péguy s'insurge, ne cesse de s'insurger, s'insurgera toujours contre le fait de croire que la mystique galvaudée en politique est encore de la mystique. C'est même le crime, le «détournement inexpiable», cela : «Faire de la politique et la nommer politique, c'est bien. Faire de la politique et la nommer mystique, prendre de la mystique et en faire de la politique», c'est comme «voler les pauvres», c'est donc «voler deux fois», c'est «tromper les simples», donc «c'est tromper deux fois» (p. 213). S'il faut faire crédit à Charles Péguy d'un chose, ce doit être cette fulgurance du jugement, cette honnêteté intellectuelle aussi qui jamais ne lui a fait confondre des vessies avec des lanternes, la mystique avec ce qu'elle n'est pas (la politique), la raison avec ce qu'elle n'est pas (la démagogie, quel que soit le champ où elle s'exerce). D'où son extraordinaire solitude. Littéralement : sa solitude de prophète, comparable à celle de Bernard-Lazare, comparable à celle de Léon Bloy, comparable à celle de Georges Bernanos, comparable à toutes les solitudes de ces penseurs et écrivains qui non seulement ont annoncé qu'à l'horizon les nuages s'amoncelaient dangereusement, mais que la terre, à vrai dire, était d'ores et déjà battue par les pluies diluviennes du terrifiant orage sous les éclairs duquel un Ernst Jünger contempla les cadavres atrocement démembrés des combattants des deux camps, des hommes tout bonnement, crevant sous l'implacable tempête d'acier et de feu.
Car enfin, c'est bien la première fois, selon Péguy que, «dans l'histoire du monde», «tout un monde vit et prospère, paraît prospérer contre toute culture» (p. 103, l'auteur souligne), l'auteur estimant même qu'il fait partie des derniers, presque des «après-derniers» puisque, «aussitôt après [eux] commence un autre âge, un tout autre monde, le monde de ceux qui ne croient plus à rien, qui s'en font gloire et orgueil». Ce monde c'est évidemment «le monde moderne», à savoir : «le monde qui fait le malin», «le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remontre pas, de ceux à qui on n'en fait pas accroire», «le monde de ceux à qui on n'a plus rien à apprendre. Le monde de ceux qui font le malin. Le monde de ceux qui ne sont pas des dupes, des imbéciles», comme le sont ceux dans la catégorie desquels Charles Péguy n'hésite pas à se ranger, lui qui a toujours moqué le monde des prétentieux, le «parti intellectuel» comme il le désigne, qui parasiterait la République (cf. p. 119), donc la société et le monde de ceux qui font le malin, des universitaires, des pédants, de ces «intraitables», de ces «bien fermés», des «anciens intellectuels devenus députés, notamment les anciens professeurs, nommément les anciens normaliens» (comme Péguy lui-même, qui ne fut admis dans la prestigieuse école qu'à sa troisième tentative, en 1894 !) qui ont, contre la culture, «une sorte de haine véritablement démoniaque» (p. 131), des savants, de ceux que l'on appelle aujourd'hui, d'un terme épouvantable, les sachants, même s'il faut remarquer qu'un Georges Hyvernaud ne manquera pas de retourner contre Péguy en personne sa volonté de se croire, de prétendre être, en tout cas de se dire simple, dans un texte ironiquement intitulé Leur cher Péguy.
En somme, selon l'auteur du Wagon à vaches, Charles Péguy, tout autant sinon plus que ceux contre lesquels il n'aura pas eu de mots assez durs, a trahi les pauvres et les miséreux, la pauvreté et la misère, en prétendant parler à leur place et, d'un certaine façon, en se contentant lui aussi de mots, de grands mots, en jouant lui aussi au journaliste disposant d'un auditoire, de l'homme politique qui, en exerçant son magistère, a déchu la mystique au rang de politique, a figé ce qui était vivant car, «quand un régime, d'organique est devenu logique, et de vivant historique, c'est un régime qui est par terre» (p. 107).
La chrétienté n'existe plus selon Péguy ? C'est donc bel et bien que la politique a remplacé la mystique, Péguy liant même le mouvement de «dérépublicanisation de la France» à celui de «sa déchristianisation car en fait, «c'est ensemble un même, un seul mouvement profond de démystication» (p. 102, l'auteur souligne), Péguy jouant même au prophète et, visiblement, se trompant lourdement quand il prédit que «tout fait croire que les deux mystiques vont refleurir à la fois, la républicaine et la chrétienne», là encore «du même mouvement» (p. 105). L'optimisme, même chez les plus grands, même chez ceux que l'on ne louera jamais suffisamment pour leur lucidité, rend bête.
Avançons à présent et venons-en à cette grande affaire de la politique dévorant la mystique, de la mystique déchue par et dans la politique, en citant le passage qui est probablement l'un des plus connus de son auteur : «Tout commence en mystique et finit en politique. Tout commence par la mystique, par une mystique, par sa (propre) mystique et tout finit par de la politique» (p. 115), l'article partitif signalant assez que nous nous trouvons-là dans le règne qu'un Guénon appellera celui de la quantité. Ailleurs, quelques pages plus loin, il écrira que «toute mystique est créancière de toutes politiques» (p. 150), puis liera la simplicité essentielle, celle qu'il a vantée au début de son texte telle qu'elle est incarnée par la famille Milliet, à la mystique, autrement dit «les hommes qui se taisent, les seuls qui importent, les silencieux, les seuls qui comptent, les tacites, les seuls qui compteront» et encore «toutes les petites gens» (p. 152). C'est bien simple : «La mystique est la force invincible des faibles» (p. 177), autrement dit celle de Bernard-Lazare, faible parmi les faibles et pourtant le plus supérieurement fort, nous allons le constater.
«Loin d'être contre la politique, affirme avec justesse Jean Bastaire, Péguy est contre son affaissement, son aliénation, processus d'entropie inévitable lorsque la politique n'est plus soutenue, animée, portée par un élan, ou pour parler plus précisément lorsque LE politique cesse d'être un instrument au service de tous pour ne plus être qu'un moyen commode de garder des places» ou, pour citer cette fois-ci Péguy ferraillant, à la fin de son texte, contre Charles Maurras : «La mystique républicaine, c'était quand on mourait pour la République, la politique républicaine, c'est à présent qu'on en vit» (pp. 21-2 de la Préface).
C'est peut-être à ce point que ne peuvent qu'éclore un Péguy ou un Bernanos, lorsque la mystique s'est dégradée en politique, lorsque la mystique a été trahie par la politique, par des hommes politiques qui, tels «Jaurès en tête» (3), l'ont déformée, l'ont dégradée (cf. p. 217), c'est «quand à sa place se creuse le vide de la désinvolture, de l'affairisme et du scepticisme», c'est alors qu'il «ne faut pas s'étonner que des mystiques sauvages se développent et déraisonnent là où la raison n'a pas été accueillie dans son rôle de clarificatrice des valeurs et d'éducatrice du souffle» (pp. 23-4). Des mystiques sauvages, la tournure de la phrase ne nous permettant pas de savoir si Péguy évoque des mouvements plus ou moins suspects aux yeux sourcilleux de l’Église ou bien des individus, que cette dernière aura du reste assez vite fait de prudemment observer, voire éloigner de son sein. En tout cas, nous sommes à l'âge où nous pouvons parler des seuls sauvages, sans beaucoup et même : sans aucune mystique.
C'est peut-être au creuset de notre histoire, dans ce monde moderne qui fait le malin, nous dit Charles Péguy, au sein même de «cette incurable lâcheté du monde moderne» (p. 195), au plus creux de cette «contamination», de cette «dégénération», de ce «déshonneur», de cette «déviation», de cette «dégradation de [la] mystique en politique» (p. 210), de ce «détournement total», de ce «détournement grossier» (p. 200) de la mystique en politique, c'est peut-être de là que devait émerger, que ne pouvait qu'apparaître un Bernard-Lazare, «cet athée, ce professionnellement athée, cet officiellement athée en qui retentissait, avec une force, avec une douceur incroyable, la parole éternelle», «cet athée ruisselant de la parole de Dieu» (p. 193), paradoxe bloyen et même bernanosien (4) qui n'a d'autre sens que celui de montrer la radicale liberté de cet homme, ayant placé non seulement la raison, mais la conscience et la liberté de la conscience au-dessus de tout : jamais, en effet, jamais, écrit Péguy, «je n'ai vu un homme je ne dis pas croire, je dis savoir à ce point je ne dis pas seulement qu'une conscience est au-dessus de toutes les juridictions, mais qu'elle est, qu'elle exerce elle-même dans la réalité une juridiction, qu'elle est la suprême juridiction, la seule» (p. 191). C'est encore Bernard-Lazare qui proclamera, selon Péguy, la royauté de la mystique sur la politique, de la «puissance spirituelle [gardant] aussi intérieurement pour ainsi dire des distances horizontales aussi méprisantes envers les puissances temporelles» (p. 189), et c'est encore Bernard-Lazare qui saura, saura inébranlablement, saura «à ce point que les plus grandes puissances temporelles, que les plus grands corps de l’État ne tiennent, ne sont que par des puissances spirituelles intérieures» (p. 187).
Bernard-Lazare, ce nom que Charles Péguy, pourtant si haut dans notre estime, a placé bien plus haut que lui ! Imaginons quel serait son rayonnement, à condition, bien sûr, qu'un tel homme soit ne serait-ce qu'imaginable, envisageable, à notre époque !, imaginons quel serait le rayonnement d'un homme présenté de la façon suivante : «Il faut penser que c'était un homme, j'ai dit très précisément un prophète, pour qui tout l'appareil des puissances, la raison d’État, les puissances temporelles, les puissances politiques, les autorités de tout ordre, politiques, intellectuelles, mentales même ne pesaient pas une once devant une révolte, devant un mouvement de la conscience propre. On ne peut même en avoir aucune idée. Nous autres ne pouvons en avoir aucune idée», répète Péguy dans son style inimitable fait d'un prompt recueillement des forces qui tout à coup, non pas se libèrent, mais se contractent de nouveau autour d'un mot cherché, recherché, trouvé, apparaissant presque miraculeusement au bord de la phrase, mot autour duquel, de nouveau, l'athlète va bander ses forces et en faire jaillir le trait qui se plantera quelques mètres plus loin, mais vibrera d'une nouvelle force chichement gagnée qu'il s'agira, encore et encore, de décupler jusqu'à l'explosion finale : «Je ne sais même pas comment représenter à quel point il méprisait les autorités, temporelles, comment il méprisait les puissances, comment en donner une idée. Il ne les méprisait même pas. Il les ignorait, et même plus. Il ne les voyait pas, il ne les considérait pas. Il était myope. Elles n'existaient pas pour lui. Elles n'étaient pas de son grade, de son ordre de grandeur, de sa grandeur. Elles lui étaient totalement étrangères. Elles étaient pour lui moins que rien, égales à zéro. Elles étaient comme des dames qui n'étaient point reçues dans son salon. Il avait pour l'autorité, pour le commandement, pour le gouvernement, pour la force, temporelle, pour l’État, pour la raison d’État, pour les messieurs habillés d'autorité, vêtus de raison d’État une telle haine, une telle aversion, un ressentiment constant tel que cette haine les annulait, qu'ils n'entraient point, qu'ils n'avaient point l'honneur d'entrer dans son entendement» (pp. 183-4). Je ne sais, pour mon humble part, rien de comparable à une telle liberté d'esprit si ce n'est peut-être le cri de colère colossale et inapaisée d'un Georges Darien dans La Belle France.
Ce penseur, Bernard-Lazare, rare à ce point, aux yeux de son ami Péguy, qu'il peut estimer que la conscience d'un homme est «un absolu, un invincible, un éternel, un libre», et qu'elle s'oppose «victorieuse, éternellement triomphante, à toutes les grandeurs de la terre» (p. 214), peut à bon droit être considéré comme l'anti-Jaurès absolu puisqu'il se tient, se retient et ne se tient que dans la mystique, fût-elle la mystique dreyfusiste s'opposant à la politique du même nom (ou plutôt, ici, adjectif), cet auteur est, comme Péguy, un homme du «salut éternel» alors que leurs adversaires, Jaurès le tout premier, «étaient les hommes du salut temporel» (p. 294) et, parce qu'il se tient et se retient dans la mystique sans la dévaluer ni même la confondre avec la politique, refuse donc de se situer dans «une vie diminuée, une vie dénaturée», un «fantôme, un squelette, un plan, une projection de vie» (p. 297), un monde tout entier dominé par l'argent, «tout à la tension de l'argent, cette tension à l'argent contaminant le monde chrétien» (p. 234), l'argent, qui «est tout, [qui] domine tout» et cela à «un tel point, si entièrement, si totalement que la séparation horizontale des riches et des pauvres est devenue infiniment plus grave, plus coupante, plus absolue [...] que la séparation, verticale de race des juifs et des chrétiens» (p. 271).
Cet homme, Bernard-Lazare, une poignée de fidèles encore regroupés autour de l'animateur des Cahiers de la Quinzaine, ont pu voir, sous les dehors rassurants de l'ordre, le désordre véritable, sous le discours de la mystique, le charabia combinard de la politique la plus effrénée, sous l'ordre de surface, «un ordre gangrené, mortifère, mort, une chair morte» (p. 290), autant de qualités si je puis dire propres à «cette gueuse de société moderne» (p. 289).
Cet homme, pour lequel il ne saurait être dit qu'un chrétien de la même trempe qu'un Bernanos qui lui aussi témoignera, n'a pas témoigné pour lui (cf. p. 271), cet homme et une toute petite poignée d'autres hommes, des héros, comme n'hésite pas à l'affirmer plus d'une fois Charles Péguy, ces hommes inflexibles (5) ont vu, sous les apparences rassurantes de l'ordre qui est en fait désordre, la réalité sourde, non pas invisible des autres, du camp menteur, du camp affairiste, du camp traître, mais très prudemment tenu hors de portée et de regard, ont donc vu ce qu'il importait de voir, «un saisissement de besoin, un très profond besoin de gloire, de guerre, d'histoire qui à un moment donné saisit tout un peuple, toute une race, et lui fait faire une explosion, une éruption», un «mystérieux besoin d'une sorte de fécondité historique», un «mystérieux besoin d'inscrire une grande histoire dans l'histoire éternelle», toute autre explication concernant l'affaire Dreyfus étant dès lors «vaine, raisonnable, rationnelle, inféconde, irréelle» (p. 287).
Ce qu'il nous a été donné de voir, selon Péguy, au moment de l'affaire Dreyfus, c'est un souffle très ancien, une fécondité, une charge, une destination, une élection même, «passant par-dessus un historien, par-dessus les épaules d'un historien, rompant toutes les méthodes, rompant toutes les métaphysiques positivistes, rompant toutes les disciplines modernes, rompant toutes les histoires et toutes les sociologies»; nous avons vu passer ce que Péguy appelle très bellement, mystérieusement aussi, les «au-delà de l'histoire» (p. 280), que Bernard-Lazare, sans doute, a devinés, tout athée qu'il fût, que Péguy, assurément, a vus, lui, comme il a vu l'immense marée de forces mécaniques s'acharnant à forclore les hommes, ce qu'il reste d'hommes libres.
C'est un aperçu de cet au-delà de l'histoire qu'à un moment Péguy, évoquant les antisémites, nous donne; c'est un véritable coup de sonde aussi que de dire, quelques années avant l'irruption des camps d'extermination sur le sol de l'Europe précédemment labouré, qu'au fond, ce que voudraient les antisémites, c'est que les Juifs n'existent pas, l'écrivain n'allant pas plus loin et terminant, et ces mots anodins vibrent d'une force noire qui n'a même pas besoin d'être suggérée par trois points de suspension : «Mais cela, c'est une autre question» (p. 274).
C'est aussi une autre question, à peine moins profonde, que de se demander comme Charles Péguy le fait ce qui pourrait rendre la joie aux hommes englués dans un monde moderne qu'il qualifie de maladie (cf. p. 267), lui qui souffre de constater que «tout le monde est malheureux dans le monde moderne», car «nul n'en profite et tout le monde en souffre. Tout le monde en est atteint, aussi bien «ceux qui s'en vantent, s'en glorifient, qui s'en réjouissent» que «ceux mêmes que l'on croit qui n'en souffrent pas» et qui, oui, en souffrent eux aussi car, « dans le monde moderne tout le monde souffre du mal moderne» (p. 268).
Le monde moderne a «entamé, réussi à entamer, il a modernisé, entamé la chrétienté», assurant un ordre de surface, ayant fait sacrifier la foi et les mœurs du monde chrétien «au maintien de sa paix économique et sociale» (p. 234). Péguy, quelques lignes plus bas, ne craint pas de dire que «l'effrayant modernisme du monde moderne» a «rendu véreux, dans la charité, dans les mœurs il a rendu véreux le christianisme même».
C'est donc «ce modernisme du cœur, ce modernisme de la charité», c'est donc «ce grand modernisme du cœur, ce grave, cet infiniment grave modernisme de la charité» (p. 223) qui, selon Péguy, «a fait la défaillance, la déchéance, dans l’Église, dans le christianisme, dans la chrétienté même qui a fait la dégradation de la mystique en politique» (p. 224) et il faudra donc que l’Église, toujours selon l'écrivain, ne craigne pas de faire les frais comme il dit «d'une révolution économique, d'une révolution sociale, d'une révolution industrielle, pour dire le mot d'une révolution temporelle pour le salut éternel» (p. 225, l'auteur souligne). Stricto sens, un au-delà de l'histoire, que la sensibilité extrême d'un Péguy, d'un Bloy, d'un Bernanos, ont entrevu.
Autrement dit : il nous faut retrouver la charité, la mettre au centre de la société moderne, devenue folle comme le prétendra Chesterton repris par Bernanos, retrouver une Église primitive aussi, car «c'est sans doute le plus beau coup du modernisme et du monde moderne que d'avoir en beaucoup de sens, presque en tous les sens, rendu moderne le christianisme même, l’Église et ce qu'il y avait encore de chrétienté» (p. 222). Et, ce que Péguy appelle «le salut temporel de l'humanité», il le cherche, comme le Paul Gadenne du dernier somptueux roman, Les hauts-quartiers, comme la Simone Weil de La condition ouvrière dans et «par l’assainissement du monde ouvrier, par l'assainissement du travail et du monde du travail, par la restauration du travail et de la dignité du travail, par un assainissement, par une réfection organique, moléculaire du monde du travail, et par lui de tout le monde économique, industriel» (p. 220), puisqu'il considère «qu'il n'y a point d'outil de perdition mieux adapté que l'atelier moderne» (p. 221).
Cette refonte, pour commencer, du monde ouvrier qui, «remontant de proche en proche», finira par assainir «le monde bourgeois et ainsi toute la société, toute la cité même» (p. 232), cette refonte, ce recommencement qui assurément aura l'ampleur d'une véritable révolution où «le réel recommence brusquement à couler à pleins bords» comme Péguy l'écrit dans De la raison (p. 71), permettra peut-être de retrouver «la culture du temps que les professeurs ne l'avaient point écrasée», donc une culture qui est «infiniment autre», infiniment plus précieuse «qu'une science, une archéologie, un enseignement, un renseignement, une érudition et naturellement un système» (p. 99), permettra aussi, qui sait, de retrouver la grandeur, si le combat, tel que le définit Péguy et, à sa suite, tel que le définira Bernanos, «est contre ceux qui haïssent la grandeur même», contre ceux «qui se sont faits les tenants officiels de la petitesse, de la bassesse, et de la vilenie» (p. 120), permettra, enfin, de redonner à la mystique sa place, qui est première, alors qu'elle a été parasitée, dévorée par «la dévorante politique» (p. 127).
Ce que Péguy appelle «une once de charité» (p. 222), quelques dizaines de grammes donc, c'est si peu, cela suffira-t-il, vraiment, à sauver le monde étouffant sous «des ordres apparents qui recouvrent, qui sont les pires désordres» (p. 290), ordre ou plutôt apparence d'ordre qu'un Bernanos dénonça en suivant Péguy, contre son propre camp qui ne lui pardonna jamais véritablement ce qu'il appela une véritable trahison, lorsqu'il fut imposé par la force par les partisans de Franco, cette minuscule parcelle de charité suffira-t-elle ? Vraiment ? La charité suffira-t-elle, même en aussi petite quantité, à retrouver une mystique qui ne serait pas aussitôt délavée, dégradée, traduite en «des bassesses politiques», de «basses politiques» (p. 297) ? Ce recouvrement, cette restauration, ce nouveau départ aura-t-il permis de retrouver non seulement la mystique mais ce que Charles Péguy appelle «la mystique républicaine», qu'il définit, imparablement, minéralement, durement, sans laisser la moindre place à quelque ambiguïté ou tentative jésuitique d'interprétation, de la façon suivante : «la mystique républicaine, c'était quand on mourait pour la République», alors que «la politique républicaine, c'est à présent qu'on en vit» (p. 300) ?
Nous aurions bien sûr toutes les raisons de répondre par la négative à ces différentes questions qui n'en sont qu'une seule mais enfin, ce serait tenir comme nuls et non avenus le sacrifice et le combat inlassables (il fallut une balle en plein front pour le stopper) de Charles Péguy, et ce serait même considérer comme peu de poids un texte aussi admirable que Notre jeunesse, certainement, ce qu'a fait sortir de plus beau cette étonnante affaire Dreyfus, comme l'avoua un lecteur admiratif à l'écrivain (6).
Notes
(1) Charles Péguy, Notre jeunesse précédé par De la raison (Gallimard, coll. Folio Essais, préface et notes de Jean Bastaire, 2020). Signalons une faute dans la Préface (des et non «aux droits légitimes de nations», p. 35), quelques fautes dans le corps du texte comme un curieux «chevau de bois» (p. 130) et un non moins étrange «beaucoup de monde aujourd'hui s'en moquent» (p. 205) et, encore, un trait d'union manquant («nous mêmes») à la page 242. Signalons enfin un l' par erreur indiqué en italiques (p. 144) et, une fois n'est pas coutume, un très vaguement hispanisant «colleccion» en toute dernière page du volume. Assez peu de fautes finalement pour une édition de poche parue chez Gallimard, qui semble ne plus relire que les volumes de La Pléiade, même si, a priori, ce texte a été lu et relu, aurait dû l'être en tout cas, une bonne cinquantaine de fois depuis sa première édition en 1993.
(2) Plus discrètement bien sûr que Bernard-Lazare, Jean Jaurès ou même Georges Sorel (qui, apprenons-nous, «aimait beaucoup deviser» avec Bernard-Lazare, cf. p. 170), nous trouvons mentionnés un Georges Valois, l'auteur de La Révolution nationale, qui s'opposa à Notre jeunesse.
(3) Jaurès, auquel nous pouvons sans peine appliquer les analyses de Péguy, à condition bien sûr de les retourner, quant à la figure du traître. En effet, reprenant une accusation qui lui a été portée, l'écrivain montre que sa trahison est, en fait, un retour aux sources, puisqu'il n'a trahi, en somme, qu'un idéal lui-même perverti, trahi : «Au point où la politique se substitue à la mystique, dévore la mystique, trahit la mystique, celui-là seul qui laisse aller, qui abandonne, qui trahit la politique est aussi le seul qui demeure fidèle à la mystique, celui-là seul qui trahit la politique est aussi le seul qui ne trahit pas la mystique» (p. 135).
(4) Bernanos, qui aurait pu faire sienne cette parole sur «telle vocation de la pauvreté, de la misère même, si profonde, si intérieure» (p. 203), se souviendra sans doute plus d'une fois de cette dureté de Charles Péguy contre l’Église : «Ce qui a pu donner le change, c'est que toutes les forces politiques de l’Église étaient contre le dreyfusisme. Mais les forces politiques de l’Église ont toujours été contre la mystique. Notamment contre la mystique chrétienne» (p. 203, l'auteur souligne). Bernanos se souviendra tout autant bien des fois de cette affirmation que l'on dirait même avoir été écrite par lui : «La méconnaissance des saints par les pécheurs et pourtant le salut des pécheurs par les saints, c'est toute l'histoire chrétienne» (pp. 163-4). Peut-être se souviendra-t-il aussi, lorsqu'il rendra hommage aux héros du ghetto de Varsovie, de Péguy évoquant son ami Bernard-Lazare et parlant d'un «cœur qui saignait dans tous les ghettos du monde» (p. 175). Plus simplement, plus généralement, plus profondément aussi, Georges Bernanos, comme Bernard-Lazare selon Charles Péguy, est celui qui, «instantanément», voit poindre la théologie «partout où en effet elle point, elle-même ou quelque imitation, quelque contrefaçon, elle-même ou contrefaite» (p. 216), et qui n'hésitera pas à les condamner lorsque, sous les dehors d'une croisade catholique, elle n'hésitera pas à verser le sang.
(5) «Parlons plus simplement de ces grands hommes. Et moins durement. Leur politique est devenue un manège de chevaux de bois. Ils nous disent : Monsieur, vous avez changé, vous n'êtes plus à la même place. La preuve, c'est que vous n'êtes plus en face du même cheval de bois. Pardon, monsieur le député, ce sont les chevaux de bois qui ont tourné» (pp. 129-30, l'auteur souligne; j'ai corrigé la faute plus haut indiquée).
(6) Il s'agit d'un certain Louis Gilet dans une lettre à Péguy du 18 juillet 1910, cité dans le petit dossier consacré à la réception de Notre jeunesse (p. 316).





























































 Imprimer
Imprimer