« Le seigneur des porcheries de Tristan Egolf ou le péché de lèse-évolution | Page d'accueil | Stella Maris de Cormac McCarthy »
22/05/2023
Melvill de Rodrigo Fresán

Photographie (détail) de Juan Asensio.
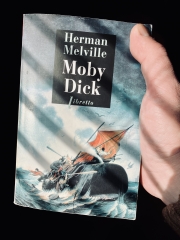 J'ai évoqué Moby Dick d'Herman Melville directement, en le rapprochant de Méridien de sang de Cormac McCarthy, ce qui fut un travail pour le moins conséquent mais un réel plaisir même si je n'ai point remarqué de fulgurantes parentés entre les deux œuvres, et indirectement, et cela à deux reprises, avec les ouvrages de Pierre Senges et des jumeaux phocomèles, désormais orphelins depuis que Philippe Sollers a été rappelé aux limbes, Yannick Haenel et François Meyronnis, ce qui fut aussi un travail quand même bien réel mais un plaisir franchement beaucoup plus chiche, voire, tout simplement : inexistant. Je viens de me souvenir, écrivant ces lignes d'introduction, que j'avais rédigé une quatrième note, perdue dans le labyrinthe qu'est devenue la Zone au fil des années, consacrée à un ouvrage d'Olivier Rey évoquant l'énigmatique conte qu'est Billy Budd.
J'ai évoqué Moby Dick d'Herman Melville directement, en le rapprochant de Méridien de sang de Cormac McCarthy, ce qui fut un travail pour le moins conséquent mais un réel plaisir même si je n'ai point remarqué de fulgurantes parentés entre les deux œuvres, et indirectement, et cela à deux reprises, avec les ouvrages de Pierre Senges et des jumeaux phocomèles, désormais orphelins depuis que Philippe Sollers a été rappelé aux limbes, Yannick Haenel et François Meyronnis, ce qui fut aussi un travail quand même bien réel mais un plaisir franchement beaucoup plus chiche, voire, tout simplement : inexistant. Je viens de me souvenir, écrivant ces lignes d'introduction, que j'avais rédigé une quatrième note, perdue dans le labyrinthe qu'est devenue la Zone au fil des années, consacrée à un ouvrage d'Olivier Rey évoquant l'énigmatique conte qu'est Billy Budd.Melvill de Rodrigo Fresán ne mentionne le grand roman baleinier que parmi d'autres textes, comme Pierre ou les ambiguïtés, de l'immense écrivain, puisqu'il se donne pour objet, l'auteur nous le dit en fin d'ouvrage, dans telle apostille assez prétentieuse intitulée Vos Noms Ici, ou Remerciements, d'évoquer «les mystères de la vocation littéraire et la façon dont elle irradie les mystères encore plus insondables de la paternité» (1). Comme toutes les pétitions de principe, celle-ci n'est pas plus lumineuse ou intéressante qu'une autre et demande, dans tous les cas, à être illustrée par l'exemple, la littérature se nourrissant d’œuvres, non de déclarations ou de programmes plus ou moins fidèlement suivis.
 Melvill se lit point trop désagréablement, à condition que l'on apprécie de calmer sa faim littéraire dévorante avec des potages postmodernes, dont la particularité consiste à reprendre une vieille recette ayant fait ses preuves gustatives au cours de patientes dégustations, ruminations et même longues digestions, et qui sera agrémentée non pas de nouveaux ingrédients, ce qui aurait pu suffire à qualifier une forme d'originalité, fût-elle minimaliste, mais d'ingrédients non seulement peu frais mais en plus longuement bouillis, parfaitement insipides, résolument insapides, bref : infects. Il s'agit, en somme, plutôt que de planter ses dents sans trop se soucier des procédés complexes de la mastication, et en se moquant en outre des plus saints commandements végans, dans le gras-double du dragon ou du Béhémoth et de se régaler d'un festin carnassier digne de sauvages endiablés faisant bombance de leur dernière chasse, de réduire la meilleure pièce de viande du monstre en l'essorant à l'autocuiseur, et le plus longtemps possible je l'ai dit, jusqu'à la transformer en une espèce de répugnante semelle, pratiquement rigide et d'une couleur indéfinissable, qui rebuterait jusqu'à l'appétit d'un rat affamé depuis plusieurs jours.
Melvill se lit point trop désagréablement, à condition que l'on apprécie de calmer sa faim littéraire dévorante avec des potages postmodernes, dont la particularité consiste à reprendre une vieille recette ayant fait ses preuves gustatives au cours de patientes dégustations, ruminations et même longues digestions, et qui sera agrémentée non pas de nouveaux ingrédients, ce qui aurait pu suffire à qualifier une forme d'originalité, fût-elle minimaliste, mais d'ingrédients non seulement peu frais mais en plus longuement bouillis, parfaitement insipides, résolument insapides, bref : infects. Il s'agit, en somme, plutôt que de planter ses dents sans trop se soucier des procédés complexes de la mastication, et en se moquant en outre des plus saints commandements végans, dans le gras-double du dragon ou du Béhémoth et de se régaler d'un festin carnassier digne de sauvages endiablés faisant bombance de leur dernière chasse, de réduire la meilleure pièce de viande du monstre en l'essorant à l'autocuiseur, et le plus longtemps possible je l'ai dit, jusqu'à la transformer en une espèce de répugnante semelle, pratiquement rigide et d'une couleur indéfinissable, qui rebuterait jusqu'à l'appétit d'un rat affamé depuis plusieurs jours. Essayons de nous montrer impartial en déclarant que le potage que Rodrigo Fresán nous propose n'est pas extraordinairement pimenté, ce qui prouve, à tout le moins, son honnêteté et ce qui est appréciable puisque notre estomac, fort délicat, a ainsi évité d'être brûlé et même révulsé, comme lorsqu'il s'est infligé, par pur vice dirait-on et goût passablement détraqué, le pénible supplice de consommer la bouillabaisse écœurante que Christophe Claro, auteur indigent, traducteur calamiteux et cuistot désastreux sinon fumeux, tient pour un texte digne de ce nom. Le procédé est hélas connu, bien que lamentable et dangereux : il est possible de ragaillardir le plus filandreux morceau de viande sur le point de moucheronner en l'assaisonnant massivement, ce qui ne suffira pas à lui rendre sa fraîcheur et sa tendreté mais contribuera quelque peu à rassurer notre palais, tout en le saturant d'épices. Je crois savoir que Claro, en infâme écrivant qu'il est se prenant pour un écrivain, salue Rodrigo Fresán comme un véritable géant doublé d'un génie, ce qui ne laissera jamais de nous paraître suspect et nous invitera à la plus extrême circonspection au moment où ces messieurs poseront sur la table, sans trop de manières il faut bien le dire tant la qualité surfaite de leur établissement a été vantée par une critique paraît-il spécialisée mais sans goût, la soupière ne dégageant qu'une faible odeur d'encaustique, où quelques morceaux indéfinissables surnagent.
Quels ingrédients Rodrigo Fresán y a-t-il jeté ? Il a été avare, visiblement mais que voulez-vous, les meilleures intentions, à notre époque où tout s'envole et s'exponentialise, sont assez vite réfrénées par la cherté des produits utilisés : nous avons donc, au fond de notre louche, des comparaisons et métaphores faussement variées puisqu'elles ne sont que filées, et filées comme une corde de marin, qu'il déclinera sans beaucoup d'inventivité, en tirant sur la ficelle culinaire ou plutôt, donc, en filant la métaphore; le procédé, en bouche, surtout si vous vous y attardez pour prétendre en extraire les sucs les plus fins, perd de sa saveur dès la deuxième cuiller, fatigue à la troisième, indispose aux suivantes, bien qu'il faille se forcer pour tout avaler : «J'ignore ce qui arrivera quand je passerai de l'Autre Côté. Mais quoi qu'il en soit et quoi qu'il se passe, je me dirigeai vers cet endroit avec le sourire. Un sourire de plus. Un dernier sourire. Le sourire qui, en vie, est le navire sur lequel s'enrôlent, naviguent et naufragent toutes les ambiguïtés, et qui sera enfin (très vite, je crois le sentir lever l'ancre aux coins de ma bouche) authentique et sincère» (p. 321). Pour que l'on ne m'accuse pas de partialité, voici un autre exemple du procédé, étiré jusqu'à son point de rupture dans notre livre, du moins exploré à fond de cale et qui ne nous évitera guère, je le crains, d'encalminer notre attention dans une Sargasse d'ennui (moi aussi, remarquez-le, j'use et abuse de cette facilité, c'est de bonne guerre) : «J'ai simplement aspiré (et je continuerai jusqu'à ce que j'expire) à une Réalité Suprême naviguant toujours aux côtés d'une Fiction Absolue : deux galions supposés rivaux et pourtant animés d'une ambition corsaire très complémentaire» (p. 324). Parfois, tout de même, quand l'auteur ne cherche pas à nous faire comprendre qu'il sait tout de Melville et, surtout, de ses textes, une comparaison, dans sa simplicité, sonne juste ou plutôt, et, ira même jusqu'à se révéler piquante : «Les chants de marins qui se balancent comme des singes des mets au sommet des mâts» (p. 129) ou encore : «Plus rien n'aura de sens, les étoiles mortes ressembleront à des baleines de fer gravitant magnétiquement vers leur cimetière jusqu'à ce qu'elles soient aussi englouties dans un tourbillon de vapeur qui ne laissera que le vide et le silence et, qui sait, tout recommencera peut-être alors...» (p. 157).
Je n'ai sans doute pas besoin de continuer à citer des extraits du texte de Rodrigo Fresán pour marteler une évidence qui éclate tout de même assez rapidement (ici, à la page 19, lorsque l'auteur nous confie qu'il s'agit d'imaginer «un livre qui serait toujours en haute mer», «un livre à la dérive dérivant en digressions tourbillonnantes et esquivant non pas des icebergs à petite pointe, mais des glaciers compacts ayant autant à montrer qu'à cacher»), évidence qui, lorsqu'elle ne me met pas en colère, me rend triste et amer, évidence tenant en bien peu de mots où se résume le malheur de ces auteurs qui, n'ayant rien ou pas grand-chose à dire, se croient tout de même obligés de le dire et de l'écrire en s'appuyant sur la béquille de grands textes ou, pour fondre forme et fond de notre sarcastique propos, seraient comme des parasites transportés à dos de baleine, ou même de risibles Candaule assistant aux ébats de leur maître, n'éprouvant aucune gêne à le faire mais nous entretenant bien au contraire, et par le menu, des caractéristiques de leur eunuquat sempiternellement bavard.
Ces incises, censées nous révéler l'envers du décor, en somme, ne sont pas rares, l'auteur les multipliant par exemple en notes (cf. pp. 25 ou 53, 85 et suivantes) et nous rappelant que c'est Melville, pour le coup, qui l'a «initié au plaisir addictif des épigraphes» (p. 337); j'appelle ce plaisir un plaisir de lettré, moins fin que décomposé, blet, tavelé, comme un fruit n'en finissant pas de se saponifier, et dont l'odeur, de plus en plus aigre puis disparaissant à peu près, serait bien incapable de nous rappeler la fragrance évanouie, aussi puissante qu'enivrante. Je réclame des textes forts et sûrs de leur force, non des textes de paltoquets ou de vieux beaux, dans les deux cas des textes impuissants, mimant, devant une glace à fort pouvoir grossissant de préférence, l'attitude et les gestes de la force : Melville et non Haenel, Meyronnis, Senges ou Rodrigo Fresán, Villon, Rabelais ou Léon Daudet et non Philippe Bordas, Tristan Egolf, qui eût pu se contenter de broder sa délicate capeline sur Swift mais nous a donné Le Seigneur des porcheries et non l'un de ces innombrables et inutiles spirites qui, convoquant d'inquiets esprits, se laissent aussitôt envahir et agitent leurs lèvres en transe, comme des pythies non pas écumantes mais à la recherche de l'index des mots rares et inusités.
On m'objectera que, ici ou là, nos commentateurs infatués se rappellent, tout à coup, qu'ils sont ou peuvent être des auteurs; en effet, et ce genre de brisure peut donner de beaux passages (2), et rendre, de la sorte, plus cuisante la désillusion : ce n'était, après tout, qu'un beau passage, noyé dans un texte qui n'en est pas vraiment un puisqu'il n'est que le commentaire d'un autre, qu'importent les dehors qu'il se donne, fictionnels ou, disent les pédants, méta-fictionnels. Ainsi, c'est toujours le même sentiment que j'éprouve à la lecture de ces textes : ces auteurs en font toujours trop, se donnent le beau rôle, jamais n'auraient l'idée de s'effacer («Peu importe : quoi qu'il en soit, ces images me cherchent comme les dossiers égarés d'une époque à venir, et réclament pour ainsi dire mon aval afin de pouvoir passer la douane», p. 195), mais nous imposent bien au contraire leur fichue présence par la répétition, je l'ai dit, de leur insupportable idiosyncrasie métaphorique (3).
Il n'est peut-être pas si étonnant que nos modernes écrivants, qui savent bien ce qui les fait ressembler à un Bartleby et, surtout, du côté de chez Hawthorne, à un Wakefield (cf. p. 285) désireux de ne surtout rien faire et de disparaître de la surface de la planète, ne parviennent pas à être réellement, à vouloir, à faire; tenez, ils sont tellement impuissants qu'ils ne réussissent même pas, ne serait-ce que le temps d'un livre, à s'effacer du devant de la scène puisque, généralement obsédés qu'ils sont par la filiation, la transmission, la paternité, autant de questions difficiles qui tourmentent Rodrigo Fresán. Dès lors, parce qu'ils savent, comme le Melville de l'auteur, que «la prestesse et l'impulsion des raconteurs d'histoires, des récits qu'ils échangent comme des biens très précieux qu'il faut partager pour que d'autres se les approprient et les améliorent, sont des qualités vraiment mystérieuses qui remontent probablement à loin et coudoient, côtoient cet autre mystère qu'est la vocation religieuse et la célérité d'un Pouvoir Supérieur» (p. 287), ils ne peuvent que surjouer leur rôle de fils problématique, d'héritiers stochastiques, de descendants chlorotiques, en quête de ce qui les précède et, bien souvent, les dépasse de plusieurs têtes, ne cesse en tout cas de les harceler à la façon d'un esprit frappeur, faméliquement pressé de réclamer son dû, ainsi qu'un vampire, aux vivants.
Ce n'est ainsi évidemment pas un hasard si quelques-unes des plus belles pages de Melvill sont consacrées aux morts et, plus précisément, aux enfants morts (cf. pp. 269 et sq.) comme ceux de Melville, ou bien, pour le fils, à une patiente remémoration d'une mémorable nuit vécue par le père, peu importe qu'elle ait été inventée pour les besoins du roman, comme si la mémoire paternelle était promenée à l'instar d'un «perroquet perché sur [son] épaule qui [lui] parle tout au long de [ses] pérégrinations au bord des berges et des falaises des avenues de Manhattan, cet animal immergé au dos hérissé de gratte-ciel» (p. 319).
Mais nous savons hélas tous quel est le don principal du perroquet : il ne sait que répéter et, à force d'attention et d'habitude, parvient, assez souvent tout de même, à glisser quelque mots de son cru dans la longue phrase où il n'est même pas une toute banale syllabe.
Note
(1) Rodrigo Fresán, Melvill (traduction de l'espagnol par Isabelle Gugnon, Seuil, 2024), p. 338. La copie manuscrite a été très bien relue. Je n'y ai détecté qu'une petite faute : l'absence d'un je (2) Comme celui-ci : «Descendant direct de féroces guerriers écossais qui couraient dans la lande du XIIIe siècle, brandissant leurs épées et leurs masses au nom de monarques quasi sauvages, aux châteaux à peine édifiés avec des pierres gigantesques posées les unes sur les autres de manière astrologique et mégalithique, dans l'attente de conjonctions astrales et d'instructions que plus personne ne pouvait appliquer à rien, mais néanmoins inamovibles et unies par une mousse de plusieurs millénaires» (p. 51).
(3) C'est joliment dit, non ? J'ai affirmé ne pas vouloir multiplier les exemples du tic fresanien, mais en voici encore un : «Et il s'est débrouillé pour que ce soit moi qui (frappé d l'influenza de son influence) mette à l'eau le bateau de sa vocation littéraire broyée et jamais sortie de l'arsenal» (p. 247).




























































 Imprimer
Imprimer