Rechercher : bernanos, lapaque
2009 dans la Zone

À titre purement informatif, je précise que quatre de mes notes* ont été, il y a quelques semaines, supprimées par mon hébergeur, pour la raison qu'elles évoquaient Valérie Scigala et (de façon marginale) Jean-Yves Pranchère qui ont tous deux porté plainte contre moi.
Ces plaintes, pour trois motifs que je commenterai je l'espère lors de mon procès (dont la date n'a pas encore été fixée), m'ont valu de passer 12 (bien lire : douze) heures en garde à vue dans les locaux d'une brigade de gendarmerie fort réputée, spécialisée dans les affaires de cybercriminalité, l'une des meilleures, dit-on, de France.
Si cette garde à vue ne m'a pas poussé, comme l'a fait Frédéric Beigbeder, à me plonger dans mon passé pour en écrire un livre qui aurait ému les âmes les plus insensibles, elle m'a toutefois permis, entre autres vertus roboratives, d'accélérer considérablement mes connaissances en cette matière très intéressante qu'est le droit pénal, surtout lorsqu'il est appliqué à l'univers, stupidement et faussement réputé hors de portée des services policiers, d'Internet.
* Dont une datant de... 2007 (théoriquement, donc, à l'abri d'une suppression; nous dirons qu'il s'agit d'un excès de zèle, puisque la note, comme cela m'a été confirmé par la gendarmerie, n'était même pas visée par ladite plainte), note consacrée à la Société des Lecteurs de Renaud Camus.
Demeures de l'esprit de Renaud Camus, par Jean-Gérard Lapacherie.
Fahreinheit 451 de Ray Bradbury.
Antoine de Baecque et l'ontologie historiale du cinéma, par Francis Moury.
Cristina Campo, mystique absolue..., par Réginald Gaillard.
Les Impardonnables de Cristina Campo.
Eat shit ! Billions of flies can't be wrong !
Nostromo de Joseph Conrad.
La connerie de Philippe Sollers se porte bien.
Fayard, l'éditeur le plus radin de France.
La Tour de Gustaw Herling.
L'édition se porte mal mon bon monsieur.Notes pour une revue de jeunes, par Cristina Campo.
Alain Zannini de Marc-Édouard Nabe.
The Possibility of an Island by Michel Houellebecq.
L'ombre des forêts de Jean-Pierre Martinet.
Les deux Républiques françaises de Philippe Nemo, par Roman Bernard.
Hélas Nabe !
Ricardo Paseyro est mort.
L'âme de Léon Bloy.
Cormac McCarthy dans la Zone.
Georges Bernanos, encore.*
Poésie journalistique.
La vie et la mort du système de G. W. F. Hegel, par Francis Moury.
Dans l'intimité douloureuse de Paul Gadenne : La Rupture, Carnets, 1937-1940.
Gothique charpentier de William Gaddis.
Retour vers l’OTAN, affaire Chauprade : comment piller le cadavre national, par Samuel Gelb.
Ô mort, où est ta victoire ?
Toute la nuit devant nous de Marcus Malte, par Jean-Baptiste Morizot.
Florilège (horriblement) orienté, voire (visiblement) réactionnaire.
À quoi bon des poètes en un temps de détresse ?, par Élisabeth Bart.
La visite du Tribun de David Jones.
Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos.
Apologia pro Vita Kurtzii 2 : Blood Meridian by Cormac McCarthy.
Futurologie de la mémoire.
À quoi sert Josyane Savigneau ?
Berserker, 3 : Ismail Ax.*
Pourquoi ils ne m'ont pas mentionné ?
Un prêtre marié de Jules Barbey d’Aurevilly, par Germain Souchet.
Verticalité de la littérature, donc de la critique.
Au-delà de l'effondrement. L'Effondrement de Hans Erich Nossack.
D'une nouvelle position des vieux problèmes, par Francis Moury.
En lisant Leo Strauss : pourquoi écrire sous la persécution ?
Paradis noirs de Pierre Jourde, par Nunzio Casalaspro.
La blogosphère littéraire n'est hélas pas une rapière.
La masse manquante de la littérature.
Bernard Quiriny, moins vipère littéraire que ver de terre ?
L’abordage de la peinture, lettre à Marcel Moreau, par Nicolas Rozier.*
Sur les Carnets noirs de Gabriel Matzneff.
Maudit soit Andreas Werckmeister ! Un extrait.
Peut-on moraliser le capitalisme ? Brèves notes critiques sur les réponses de Nicolas Tenzer et André Comte-Sponville, par Francis Moury.
Au-delà de l'effondrement, 2 : L'Apocalypse russe de Jean-François Colosimo.
Prélude à la délivrance de Yannick Haenel et François Meyronnis.
L'île de Jersey, un paradis infernal.
Pour un modèle occidental de l'idée d'Occident, par Jean-Paul Rosaye.*
La malfrance, la vraie.
Roberto Bolaño à Bruges.
Le crétinisme, stade suprême du socialisme français ?, par Germain Souchet.*
Au-delà de l'effondrement, 3 : L'époque de la sécularisation d'Augusto Del Noce.
Le navire poursuit sa route de Nordahl Grieg.
Les plaisantins de la Toile : Wikipédia, BSC News.
Entretien avec Nils Aucante.
Entretien avec Ludovic Maubreuil.
Entretiens/Dialogues.
Conte de la barbarie ordinaire, par Sarah Vajda.*
Joseph Conrad dans la Zone.
Moi, Youssouf F., né le 13 février 2006, meurtrier.
Au-delà de l'effondrement, 4 : Les Anneaux de Saturne de W. G. Sebald.
Banalité chevillardienne.
L'Invitation chez les Stirl de Paul Gadenne.
L'état de la parole depuis Joseph de Maistre.
Témoins du futur de Pierre Bouretz.*
La Sorbonne présidée par un grotesque, Georges Molinié, par René Pommier.*
Le dernier travail de Platon, par Francis Moury.
Gabriel Matzneff est-il un maître de l'érotisme ? Ab-so-lu-ment-pas !
L'argent.
Que faire ?
Identification du démoniaque.*
Le canard Vaissié à l’assaut de L’Île. Défense de Pavel Lounguine, par Timothée Gérardin.
L'état de la parole depuis Joseph de Maistre, 2.
William H. Gass dans la Zone.
In memoriam Dominique Autié.
Au-delà de l'effondrement, 5 : Les ruines de Paris en 4908 d'Alfred Franklin.
L'état de la parole depuis Joseph de Maistre.
De l'anarchisme considéré comme déchéance de la raison : sur Julien Coupat, par Francis Moury.
Ludivine Cissé : mystère et confiture.
L'état de la parole depuis Joseph de Maistre, 4.
Paul Gadenne l'oublié, préface à un texte impubliable, et de fait impublié.*
580.
La Zone dans la Zone.
Au-delà de l'effondrement, 6 : Les aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe.
Paul Gadenne l'oublié.
Tant de morts de la littérature.
Avec Poe jusqu'au bout de la prose d'Henri Justin.
Paul Gadenne dans la Zone.
Le démon de la perversité : Youssouf Fofana et l'aveu.
Valérie Scigala déshonore-t-elle la blogosphère gersoise ?
14/01/2010 | Lien permanent | Commentaires (21)
Lettre à Yann Moix

En revanche, que ce même personnage à peu près inculte pense qu'il est absolument nécessaire de proclamer ses goûts en matière de femmes publiquement, qu'il y ait même, en France, des organes de presse ayant songé à interroger cet écrivant sur lesdits goûts, que ce pitre prétentieux, une fois que ses commentaires sur les femmes (et la paternité, pour laquelle il n'a aucun goût et qu'il réduit à une tâche ménagère aussi stupide que sordide) paraisse étonné par les réactions outrées que ses propos ont provoquées est par définition une affaire qui intéresse une plus large sphère, certes considérable, que celle de Yann Moix et de son nombril.
S'il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'un pitre exerce le seul art qu'il possède à fond, celui de faire des pitreries, il est bien davantage regrettable que la Presse française, qui, je le rappelle en passant, a tenté de nous faire croire que Yann Moix était autre chose qu'un clown et même qu'il était un écrivain au moins aussi considérable que Céline voire Philippe Sollers, offre ne serait-ce que la plus ridicule tribune à cet étalage de stupidité.
Juan Asensio, ajout du 8 janvier 2019.
Monsieur,
Je vous adresse cette courte lettre pour vous dire que la honte et le dégoût que je ressens d’être le lecteur de votre prose eunuque quand vous êtes récompensé dans votre indignité de pseudo-écrivain n’est rien, absolument rien, au regard de la lassitude et même de la colère que je ressens face à la permanente démonstration de votre nullité épistolaire, romanesque, littéraire.
Il n’est pas question, ici, de politique, même si tout grand roman, toute grande œuvre propose, du monde, une vision politique inégalable. Mais seulement de reconnaître, en vous, tandis que pleuvent sur vous mille compliments et quantité de blandices, une de ces figures qui font, à l’aise dans les clapiers journalistiques, capoter notre vieille République, rongée par votre démagogie crasse et celle de vos innombrables semblables et commis.
Je crois bien qu’en d’autres temps, Charles Péguy, ou Georges Bernanos encore, furent confrontés, de par l’ampleur de leur vision spirituelle avant que d’être ridiculement sociétale, de par la force de leurs convictions et la puissance de leur volonté, de par la grandeur de leur écriture et la profondeur de leurs textes qui vous font paraître quark de suffisance tout pressé de vendre sa naissance phocomèle, à la haine provisoire mais pas moins féroce des Allocataires et des Assis.
Vous aurez, non sans ridicule et battage médiatique, endossé et provoqué plus de reculades intellectuelles et littéraires en quelques années, que d’autres pendant quelques décennies, ce qui n’est pas rien.
Votre personne, comme une sorte de caisse de résonance, la résonnance (sic) étant réservée aux cancres, présente cette particularité, franchement peu inédite, de dévoiler à elle seule, de stigmatiser sur elle seule, les nombreuses maladies dont notre pays est aujourd’hui atteint : cacographie pompeuse, confusion des esprits, renversement du laid et du beau, du bien et du mal, imposture littéraire, artistique, intellectuelle, politique, spirituelle, d’officiants publicitaires tels que vous, qui osent se croire investis d'une mission de garde de la parole et de vigie de la morale et parlent au nom de Français qu'ils méprisent copieusement.
Puissiez-vous, Monsieur, disparaître le plus rapidement possible, et ne plus incarner ce Tartuffe au visage idiot, laid et poupin, moins humain, moins digne, tellement plus lisse aussi, que celui dont rêvent les bretteurs d’une France éternelle par ses seules productions de l’esprit, ses œuvres d’art, ses découvertes, ses héroïsmes petits ou grands, ses gestes littéraires admirables et magnifiques de simplicité qui assurent l’existence de ce qui n’a plus le beau nom, le nom désormais honni alors qu'il a été trempé dans le sang de la Révolution, le nom conspué de nation, laquelle, pour notre grand malheur et l’éclosion spontanée d’hommes comme vous, possède de moins en moins de réalité et ne semble plus survivre ailleurs que dans les esprits et les cœurs de quelques courageux, laquelle n’existera probablement jamais ailleurs que dans ces esprits et ces cœurs, ces âmes que vous insultez par votre ignorance si pressée de se publier et de s'étaler, votre nullité d’écrivain et votre criant manque de talent ne serait-ce que bassement, strictement, médiocrement, vulgairement journalistique.
J’ai l’impression que, depuis quelques lustres, c’est la République des lettres, qui ne sera jamais la nôtre mais celle où les singes médiatiques s’épouillent méticuleusement les uns les autres, sautant de branche en branche en se montrant leurs culs versicolores, qui est tout entière devenue bananière.
Pensez toujours à Bernanos, qui n’a jamais raté les idiots : «Quand que je n'aurai plus qu'une paire de fesses pour penser, j'irai l'asseoir à l'Académie française.»
11/11/2013 | Lien permanent
En attendant la fin du monde de Baudouin de Bodinat

 Cette note, à l'origine, constituait le premier volet d'un triptyque. Je n'ai apporté que quelques menues corrections de forme au texte initial.
Cette note, à l'origine, constituait le premier volet d'un triptyque. Je n'ai apporté que quelques menues corrections de forme au texte initial. Acheter En attendant la fin du monde sur Amazon.
Acheter En attendant la fin du monde sur Amazon.Quelque chose me gêne dans le dernier texte de Baudouin de Bodinat, En attendant la fin du monde paru chez Fario, un éditeur aussi discret qu’intéressant qui a d’ailleurs publié, en livre ou en revues, plusieurs textes du grand Sebald. Bien avant Baudouin de Bodinat, ce dernier avait pour coutume de proposer des textes comprenant des photographies ayant une signification directe, ou bien indirecte mais pas moins flagrante, avec le récit proposé. Mais, là où l’auteur de Vertiges n’en finissait pas de suivre une piste que lui seul savait pouvoir suivre, en déployant une écriture aussi attentive aux plus extrêmes détails que capable d’attirer notre attention sur les correspondances subtiles existant entre les cercles concentriques s’étendant depuis un abîme de noirceur, Baudouin de Bodinat ne nous mène nulle part et même, comble de l’ironie, nous laisse sur place.
Ce quelque chose qui me frappe puis, dans le même mouvement ou presque, me gêne dans le livre de Baudouin de Bodinat qui eût pu s’intituler Petit précis de phraséologie à usage réactionnaire, c’est rien de moins que l’écriture même de l’auteur. Sa structure n’est que faussement complexe, puisqu’elle est décomposable en un usage monomaniaque de participes présents et d’infinitifs qui sont moins enchaînés que juxtaposés et nous donnent ainsi l’impression d’un emboîtement de phrases entre parenthèses et d’incises s’étendant avant qu’un point final ne vienne, passagèrement du moins – avant une nouvelle explosion obéissant au même principe de gonflement irrésistible – clore cette expansion qu’on dirait invincible, et qui ne semble devoir faire halte que lorsqu’elle est figée par une photographie de rue déserte de village perdu, photographies prises, nous dit-on, par le biais de pellicules périmées, et qui apportent un contrepoint utile, par leur extrême dépouillement et même pauvreté volontaire, aux tortillements des phrases butant sur des rues désertes, où sont banalement garées des voitures banales, sous un ciel bleu lui-même insignifiant, ou bien «sous le ciel diffus; ou quand l’été s’étiole, se perd en rêverie du proche automne» (p. 68). Michel Houellebecq, désormais considéré comme un photographe, eût montré plus de volonté d’enjoliver le vide d’une bourgade de province où rien ne se passe, «moindre ville de province indécise» comme l’écrit l’auteur, mais c’est justement de cette volonté que Baudouin de Bodinat se tient éloigné, aussi sûrement qu’il se tient éloigné, du moins c’est ce que l’on veut nous faire croire (et, pour m’amuser, je l’imagine envoyer par courriel son manuscrit à son éditeur, ou bien, plus désuet encore, en l’enregistrant sur une clé USB) d’un des moyens modernes de communication par lesquels l’essence de notre monde, s’il n’a pas complètement plié bagage comme l’aura selon Walter Benjamin, se dilue et dissout. C'est donc moins la fausse complexité du style de Baudouin de Bodinat que la maigreur des résultats obtenus : quoi, tant d'incises, d'escaliers embranchés sur des escaliers, tant de portes ouvertes pour nous mener dans une cabane pas même débranchée mais équipée d'un ordinateur dernier cri et bien sûr d'une connexion, depuis laquelle nous pouvons envoyer notre texte soulevé d'une indignation qu'un livre de Jacques Ellul, qu'une ligne de Gustave Thibon eût aisément concentrée.
Une seule fois, à la dernière page de son livre, cette écriture syncopée, comme désireuse de mimer la froideur minérale ou plutôt machinale de notre modernité décriée, une seule fois l’écriture de Baudouin de Bodinat se risque à ne pas ahaner mais à s’élancer en trois phrases qui n’en sont qu’une et qui annoncent ce que d’autres livres, ceux qui suivront peut-être, auront à charge d’explorer, «cette transparence où quelque chose en soi semble sur le point de s’ouvrir et tout réconcilier» (p. 70). J’exagère, car ce village, lieu de la déambulation photographique de l’auteur, apparaissait dès les premières lignes sous la forme de tel «vieux quartier de ce gros bourg», mais aussi du beffroi demeurant «inflexible à égrener les heures» (p. 12) comme s’il fallait, pour que la banderole des récriminations de Baudouin de Bodinat soit déployée au-dessus de nos têtes diantrement modernes, qu’elle soit plantée entre deux piquets champêtres d’un de ces lieux, si communs dès que nous quittons les grandes villes, si communs qu’ils ne peuvent que nous faire suspecter que c’est le texte lui-même de l’auteur qui est une série de clichés, et sa volonté d’encadrer de simplicité (prétendument) provinciale voire paysanne un texte savant.
Cliché du cadre bucolique où le dernier sage attend la catastrophe qui vient, la catastrophe qui est déjà là plutôt, la catastrophe qu’il est trop tard pour éviter mais non point pour déplorer, ce sera un livre de plus pour les journalistes après tout. Clichés que tous ces termes, parfois des trouvailles heureuses, mais noyées dans une foule d’autres termes rapidement entrechoqués, que l’on dirait avoir été moins inventés que méthodiquement alignés par un Renaud Camus qui n’aurait pas complètement perdu le sens de la phrase et saurait, partant, que son empilement de «que» et de «&» n’a d’autre sens que se fondre dans le silence minéral d’une fin d’après-midi de bourg oublié, autant de piquets devant lesquels toutes les vaches journalistiques vont venir mâcher leur ration de lieux communs agrémentés d’un peu de fortifiant aux hormones, «sage expansif» (p. 11), «édifice social», «radiovision» ou «optiphone» (p. 12) plusieurs fois répétés, «sonorisation distractive» (p. 13), «économie d’exploitation et de pillage» (p. 17), «économie concurrentielle» (p. 23) ou encore, et ce sont les trouvailles dont j’ai parlé, «hypoxie spirituelle» (p. 57), «dégénérescence maculaire de la conscience» (p. 58), «lumignons [qui] filent, s’étouffent et puis charbonnent» (p. 18), comme si l’auteur, sur lequel tant de spéculations courent, pour gagner sa vie avant que le Septième Sceau ne rende définitivement caducs ses efforts de vigie, officiait en tant que rédacteur des débats et par ce biais alimentait son lexique professionnel de tous les termes entendus lors de réunions de Conseil d’Administration ou de Comité d’Entreprise, sans oublier celles des CHSCT, ou Comités d’hygiène et de sécurité au travail.
Nous ne sortons guère quoi qu’il en soit, écriture savante et même précieuse ou pas, plates photographies suintant l’ennui et choisies pour cette raison, de la réaction, au sens le plus commun et banal du terme, long ver cavernicole dont Renaud Camus tiendrait la queue translucide et Alain Finkielkraut la tête aveugle (à moins que ce ne soit l’inverse, pour éviter toute allusion graveleuse dont on me supposerait coupable) en passant par Éric Zemmour, la poissonnière de Causeur et toute la clique piaillante des oisillons martiaux recevant la becquée dans le nid de L’Incorrect, de l’indigent écrivant Yrieix Denis écrivant avec un organe par lequel tout mammifère expulse ce dont son corps n’a pas besoin jusqu’à Matthieu Baumier écrivant avec les pieds de Philippe Sollers, en passant par Romaric Sangars qui, lui, aimerait bien écrire avec sa main et doit se contenter d’un moignon d’esthète gourmé, sans oublier le légendaire phénix de ces hauts lieux de la consanguinité Jacques de Guillebon qui, lui, n’écrit avec rien du tout mais remplit quand même des pages entières de ses fulminations apoplectiques d’adolescent brûlé par la vision du Buisson ardent et qui doit je le suppose beaucoup aimer les textes de Baudoin de Bodinat, pour cette exquise raison que l’auteur lui donne des mots bien frappés, journalistiques donc, qu’il pourra citer dans ses revues de presse nulles.
C’est finalement peut-être cela qui manque au maniéré Baudouin de Bodinat, l’un des plus récents surgeons de ce que Julien Benda appelait le byzantinisme, sorte de croisement puissant mais instable entre le matois pessimiste Michel Houellebecq et le remarquable Jaime Semprun qui a tout dit avant lui, et dans des phrases dont la mordacité le dispute à la perfection, c’est cela qui manque à l’auteur de La Vie sur Terre, la simplicité militante d’une foi farouche, de charbonnier si l’on veut bien que cette honorable profession n’existe plus en France ni même, sans doute, en Europe, une ligne de basse en somme à son chant trop travaillé pour être autre chose que l’un des rhizomes surprenants mais point aberrants de la modernité qu’il décrie à longueur de phrase à enchâssements se voulant antimodernes et n’étant que l’extrême proue du navire rutilant mais aveugle sans son pesant barda électronique qu’est notre époque terminale. Ligne de basse qui, comme «le beffroi [qui] demeure inflexible à égrener les heures» (p. 12), permettrait à Baudouin de Bodinat de ne point se contenter de se lamenter sur le monde comme il ne va plus du tout mais accepterait de souffrir pour lui et, d’une certaine façon absolument scandaleuse, kierkegaardienne, évangélique, le rachèterait. Pour le dire encore plus simplement, et je m’étonne que Sébastien Lapaque, d’habitude si attentif à détecter les failles les plus intimes, ne l’ait pas vu, Baudoin de Bodinat est un homme, du moins un auteur triste, à la différence des deux autres que nous allons évoquer, Matthieu Grimpret et le fou écrivant qu’est Eduardo Castellani. Il manque à Baudouin de Bodinat une échappée que laissent entrevoir, je l’ai dit, les toutes dernières lignes de son texte mélancolique et peut-être même désespéré, un solide maillet pour entamer l’édifice coruscant de tant de phrases qui l’emprisonnent : «& aussi que peut-être tout le monde se doute qu’au point où en sont les choses (en vision cavalière, ou aérienne à survoler ces périphéries de lotissements, de banlieues informes qui vont s’épaissir en entassements chaotiques d’habitations et de fonctions urbaines, et ainsi de suite à perte de vue recouvrant la Terre de cette densité de peuplement en survie assistée), c’est tout simplement sans solution. Sans plus aucun moyen pour l’espèce humaine de se dégager de ce piège où elle est entrée et qui la tient» (p. 59).
23/09/2018 | Lien permanent
Raphaël Dargent et Sarah Vajda sur La Critique meurt jeune

***
Il est des livres dont on sort grandi, comme si à les lire on se trempait dans un bain de savoirs, comme si du coup ils nous éclairaient, nous montraient un chemin qu’on n’avait pas aperçu jusqu’alors (ou qu’on ne voulait pas apercevoir, détournant la tête), une issue à l’enfermement du monde finissant. Ces livres sont difficiles, mais ce sont des livres d’espoir, d’espoir justement parce que difficiles. Ils surnagent sur l’océan de la sous-littérature contemporaine, non-écrite ou obscène, facile, beaucoup trop facile à lire et à oublier, cette littérature jetable, cette littérature de naufragé. Ces livres sont nos bouées. Je crois qu’on peut dire en un mot que ce sont des livres d’élévation, oui d’élévation. C’est le cas de La Critique meurt jeune de Juan Asensio. «Un écrivain est d’abord un homme fidèle» écrit Juan Asensio page 222. La formule me plaît beaucoup, et elle est juste. Justement, comme critique et comme écrivain, Asensio est un homme fidèle. Car Asensio est un écrivain. Ceux qui lui demandent, ici ou là, s’il écrira demain son premier roman, ne comprennent pas son travail, ne le jugent pas à la bonne hauteur. Ceux-là croient que la critique n’est pas, ne sera jamais, un genre à part entière, un genre noble, reconnu comme tel, et que le critique n’est qu’un écrivain raté ou inaccompli, un écrivant sans vocation. Habitués que nous sommes, il est vrai, aux critiques plates, superficielles et même creuses, nous n’imaginons pas un instant que la critique puisse être autre chose qu’une dissertation banale distinguant d’un côté les qualités, de l’autre les défauts d’un roman ou d’un film. Au point où la hisse Asensio, la critique est une œuvre en soi. La critique telle qu’il la pratique est un art. Je sais qu’il aime parler de dissection, comme il l’écrit sur son blog où il fouille et remue le cadavre de la littérature, et aussi celui de la France. Pourtant, il me semble qu’Asensio fait mieux que disséquer. Il ne se contente pas en vérité de disséquer un livre comme un chirurgien mettrait à jour, étalés sur la table, chacun des organes d’un corps couché; ce corps démembré, éviscéré, il le reconstitue, le réassemble morceau par morceau, mieux encore que ne le ferait le docteur Frankenstein. Car Asensio non seulement reforme le livre, le remet en forme, mais il en exacerbe la forme, les formes, en accentue les pleins et les creux. Il creuse ici, remplit là, et c’est ainsi qu’il va au cœur du livre lu, c’est ainsi qu’il va jusqu’au tréfonds, au point même de toucher du doigt le cœur de l’ouvrage, ce qu’il appelle le motif dans le tapis, au point de mettre le doigt dessus et d’appuyer, jusqu’à en faire jaillir la grandeur ou la petitesse, la profondeur ou la fatuité. Procédant ainsi, œuvrant ainsi, il n’est pas simplement fidèle aux auteurs qu’il étudie – ce qu’on attend généralement d’un critique et qui n’est pourtant pas si fréquent – : il est fidèle à lui-même, ce qui est bien mieux. Ses critiques, ouvrage de dissection puis de reconstitution, sont aussi des exercices de construction personnelle. Juan Asensio, critique re-créateur de Dantec, de Dostoïevski, de Joseph Conrad, de Léon Bloy, de Gershom Scholem, de Pierre Boutang, de Georges Bernanos, d’Hermann Broch, est créateur de lui-même, en tant qu’écrivain. Oui, le critique révèle l’écrivain. Derrière chacun des livres qu’il chapitre, se dessine un peu mieux son propre visage. Mais Juan Asensio est fidèle encore sur un autre plan. Grand lecteur et parfait apôtre de Bloy et de Bernanos, fasciné tout comme eux par la question du Mal, il ferraille contre notre monde dévitalisé, déspiritualisé, vidé de sa substance proprement humaine au profit de l’Argent et de la Machine. Dans ce combat qui autrefois fit la dignité de la France, il enrage de ne trouver aujourd’hui à ses côtés que fort peu de Français, sinon un infime résidu de solitaires. Tel est Asensio : fidèle à la littérature (et non à sa dégradation, qu’il dénonce), fidèle à sa langue (qu’il écrit avec exactitude), fidèle à la France (qui n’est plus), fidèle enfin ou d’abord, à Dieu, c’est-à-dire à la parole [qui] souffle sur notre poussière, titre de son essai sur George Steiner. Fidèle parmi les fidèles, ou plutôt parmi les Infidèles, Juan Asensio a la Foi au milieu de ceux qui ne l’ont plus. Fidèle, je crois, c’est encore mieux que religieux. Raphaël DargentTu fustiges l’art contemporain, «qui fait beaucoup parler, [mais] n’a strictement rien à nous dire.» Notre époque, c’est vrai, se caractérise par la perte du goût, non pas seulement lorsqu’il s’agit de nourritures au sens propre, mais aussi lorsqu’il s’agit de nourritures spirituelles. On n’a plus ni repères, ni valeurs, tout se vaut, tout devient égal, tout est mis sur le même plan, on ne sait plus distinguer le bon grain de l’ivraie. C’est vrai en musique où Mc Solaar est qualifié de poète; c’est vrai en peinture où le tag est considéré comme une œuvre, c’est vrai en littérature aussi où le meilleur voisine (rarement) avec le pire. Tous ces livres qui paraissent chaque jour, cela devient proprement écœurant, et si l’on n’y prend garde en effet, cela dégoûte, au sens justement de la perte du goût, car ces livres je ne veux plus les goûter, je ne sais plus lesquels goûter, et donc je finis par ingurgiter n’importe quelle pitance, exactement comme au Mc Do. Faut-il tout jeter et revenir aux classiques, comme à de bonnes vieilles valeurs sûres ? Quel est le tri que fait le critique lorsqu’il est en librairie ?Juan AsensioCher Raphaël, je reste prudent. Je ne condamne pas tout l’art contemporain, mais simplement l’un des domaines que je connais tout de même quelque peu, par exemple celui des arts plastiques. Ayant fréquenté, il y a quelques années, certains membres de la bohème artistique lyonnaise (je rougis d’employer une expression aussi ridicule), j’ai pu assister à beaucoup de vernissages de galeries, me rendre dans des musées d’art contemporain mais surtout suivre ces créateurs dans leur vie et leur travail quotidiens. Je n’en ai gardé qu’une pénible impression de fumisterie, ces créateurs, femmes et hommes confondus, parfois doués, c’est un fait, qui s’affublaient en un clin d’œil du qualificatif de «rebelle» et faisaient de chacune des expériences qu’ils vivaient la caisse de résonance de leur art s’étant trop souvent joué de leur propre talent. Bien peu d’entre eux, en somme, accepteraient de concéder le fait que les 99% de l’art contemporain ou plutôt de ce que les imbéciles autorisés appellent de ce nom sont d’un parfait ridicule, d’une inculture prodigieuse, d’une nullité de laquelle ils extraient, à l’attention des seuls médias, un élixir enivrant dont la concentration extrême est l’inverse même de la plénitude d’inconsistance de leur art. Je me tais sur les œuvres de la musique contemporaine en revanche, que je connais mal et qui me semblent, inversement, souvent intéressantes. Je songe par exemple au travail d’un Philippe Hersant ou encore celui d’un Thierry Machuel, tous deux, ce n’est sans doute pas un hasard, pétris de culture littéraire. Pour ce qui est de la littérature justement… Qu’en dire ? Effacement des repères, effacement, plus profond, à vrai dire dramatique, de tout sens de la verticalité, de tout horizon d’attente d’une transcendance, moins que cela même : d’une aspiration à la transcendance, et ce dans bien trop de livres, romans, recueils poétiques ou même essais que l’on nous présente comme des chefs-d’œuvre de hardiesse formelle. Tout jeter ? Non, certainement pas, je ne puis m’y résoudre. J’évoque tout de même un certain nombre d’auteurs qui, justement, ont encore et contre toute forme d’adversité quelque chose à nous dire, qui ne tiennent pas une plume pour rigoler, selon le mot de Bernanos paraphrasant Angèle de Foligno. Pour ce qui est du tri, je ne lis que ce que j’aime lire, je ne relis que les œuvres qui me semblent inépuisables. Est-ce affirmer là une sorte de principe de dilection parfaitement idiot au sens étymologique du terme ou, plus sommairement, une très plate évidence ? Sans doute mais la critique, pour être juste, se doit d’être paradoxalement partiale, Baudelaire, mais avant lui Diderot, ont exposé avec force cette conception, d’une certaine façon quelque peu galvaudée par les textes d’un Charles Du Bos par exemple, toujours soucieux, à mon sens trop soucieux, de faire en sorte que ce soit lui, le critique, qui puisse merveilleusement s’adapter à l’œuvre commentée. Ma nuque est beaucoup plus raide et ma colonne vertébrale n’est pas exactement gidienne dans sa consistance. Certains me le reprochent. Peu importe, je suis persuadé qu’ils ont tort : je n’aime, en matière de livres, que les œuvres qui, s’adressant à leurs lecteurs, n’ont jamais ménagé leurs efforts. En somme, je n’aime, je ne suis capable d’aimer qu’une œuvre qui, par avance, dès son élaboration mentale en quelque sorte, a été pensée comme un acte d’amour, une prière à l’adresse des lecteurs. Je prends un exemple qui illustrera la proposition contraire : à quoi me servirait-il de me ruer sur le dernier navet signé de Philippe Sollers, puisque celui-ci n’a strictement plus rien à nous dire depuis des années, peut-être depuis, proposition je le sais extrême, Une curieuse solitude ? Pourquoi lire Sollers puisque ce dernier, c’est une platitude qu’il me coûte de devoir répéter, se contrefiche de ses lecteurs comme il se moque d’avoir côtoyé, encore jeune, un écrivain de race qu’il n’égalera jamais, qu’il semble s’être forcé à oublier, Jean-René Huguenin, qui d’ailleurs, dans son splendide Journal, a très vite éventé la baudruche sollersienne ?Raphaël DargentTu écris que «si les artistes ne valent presque plus rien dans leur immense majorité, c’est que celles et ceux qui sont chargés de les critiquer, donc de nous dévoiler ce que nous ne savions pas lire, voir ou écouter dans une œuvre, ne sont que trop souvent de pauvres nullités intellectuelles.» Tu as des noms ? Juan AsensioDes noms ? L’immense magma indifférencié de la critique journalistique, qui englobe à mes yeux les plumes les plus fameuses du Monde des Livres ou de Libération tout comme, dans un registre à peine moins superficiel, celles du Nouvel Observateur, du Magazine littéraire, du Matricule des Anges. Je n’évoque pas même le cas d’une revue telle que Lire, qui n’a à mes yeux franchement rien de littéraire. Les noms sont donc faciles, je crois, à trouver. Du reste, après les avoir lus, oh, assez rarement, je tiens à ce que mes yeux conservent une certaine virginité, je ne les lis plus, puisqu’ils ne me servent à rien, hormis à avoir flatté mon penchant, acquis très jeune, pour les expériences de physique sympathique : par exemple, j’ai pu ainsi me rendre compte du fait que les abîmes des salles de rédaction étaient fréquentés par des créatures précieuses et bavardes qui, à la différence de leurs proches cousins invertébrés, refusaient de vivre dans les ténèbres et, pour se parer d’un maigre reflet de lumière artificielle, seraient prêts à tuer père et mère. Vois-tu, aussi monstrueuses qu’on les voudra, les bêtes étranges qui broutent placidement le fond des profondeurs de l’océan aspirent à l’obscurité et, de plus, ne dévorent que bien rarement leurs propres congénères, se contentant d’attendre que leur vienne d’en haut la manne pourrie des cadavres. Il y a une certaine noblesse, une certaine humilité aussi, à la différence des bruyantes agapes caractérisant le quotidien insignifiant d’un critique couru, dans le rôle de ces équarrisseurs discrets des mers.Raphaël DargentCe qui court aussi tout au long de ton ouvrage, c’est cette préoccupation de la langue. Tu cites évidemment Steiner qui parle de «retraite du mot» à l’ère de la vidéosphère, pour parler comme Debray. Ce n’est pas seulement une dénonciation de la novlangue propre à notre temps, ce politiquement correct qui subvertit le langage, et donc réduit la pensée ; il s’agit aussi, et peut-être surtout, de combattre cette langue déspiritualisée et proprement mécanisée, mécanique, comme si la Machine, comme si le Robot (celui que dénonçait Bernanos dans La France contre les robots) avait investi le langage, l’avait corrompu, au point d’en faire un outil fonctionnaliste sans aucune transcendance, sans souffle, sans âme. C’est cela ?Juan AsensioOui, c’est tout à fait clair; le refus de la transcendance, sans laquelle, comme l’affirme dans un livre somptueux Vladimir Weidlé, les arts ne valent strictement rien de plus qu’une place (fort chère au demeurant) dans l’une de ces ridicules foires dédiées à l’art contemporain, ce refus n’est jamais plus manifeste que dans notre langue, aussi bien parlée qu’écrite. Dans un texte mystérieux, Gershom Scholem affirmait de la langue hébraïque qu’elle finirait par se venger des outrages qu’on lui faisait subir, que sa réserve sacrée jaillirait un jour pour confondre tous les eunuques et les profanateurs du Verbe moqué. Plutôt que d’évoquer le style eunuque, maintes fois punaisé, de nos journalistes, je me suis amusé, ces derniers jours, à tenter d’écouter les propos de Ségolène Royal, paraît-il notre futur Président de la République. Mal m’en a pris car cette personne est tout simplement parfaitement incapable de former autre chose que des phrases de sémantisme vide, d’une telle banalité, d’une telle absolue platitude béate que la prose cadencée de n’importe quelle ritournelle mièvre du chanteur Raphaël acquiert immédiatement un statut de complexité joycienne, voire poundienne… ! Tu me parlais plus haut d’un critère de sélection. J’en ai un seul, mais que je ne suis prêt à brader sous aucun prétexte : un artiste qui ne cherche point, par son art, une image de Dieu est un imbécile, plus souvent malheureux qu’heureux d’ailleurs. Raphaël DargentJe ne crois pas me tromper en affirmant que beaucoup des auteurs que tu affectionnes (Bernanos, Bloy, Dantec, Steiner, Conrad, Dostoïevski, Kafka, Broch, Gadenne) entretiennent dans leur écriture, par leur écriture, un questionnement sur le Mal et donc un rapport au divin. Je dis bien «au divin» et non pas à la spiritualité, ce qui est bien différent. Pardonnes-moi cette question profane et volontairement naïve, mais pourquoi cette attirance ? Juan AsensioPour être tout à fait clair : je n’en sais rien. J’ai toujours été attiré par le Mal dans ses formes artistiques les plus diverses et ai consacré de nombreuses années à étancher ma soif de lectures dans un domaine bien précis, peu frayé et quelque peu «sulfureux», ce que je pourrais appeler, avec Mario Brelich, la satanologie, c’est-à-dire non seulement l’ensemble des textes sacrés relatifs à l’existence du diable, mais encore les traités patristiques et l’immense littérature démonologique, tant érudite que littéraire. Cette fascination demeure, peut-être parce qu’en son dernier et plus profond recès elle n’est qu’une quête détournée, ardente, du Bien. Et puis, il est tout de même facile de constater que ce sont les plus grands auteurs qui, immanquablement, ont évoqué avec crainte et tremblement le mystère d’iniquité. A contrario, note que les imbéciles qui, aujourd’hui, passent pour des auteurs de valeur n’ont, sur le Mal, que des sornettes mielleuses à nous proposer. Bien évidemment, ayant entendu ce pseudo-argument des centaines de fois, les belles âmes me répondront que la littérature ne se doit en aucune façon d’être obsédée par le Mal mais qu’elle doit être légère, ironique, souriante, bécasse en un mot ? Ah bon mes agneaux ? Et par quoi d’autre que par le Mal, si ce n’est Dieu, la littérature devrait-elle être littéralement obsédée, comme l’affirmait dans un remarquable entretien avec Édith de la Héronnière, un superbe écrivain récemment disparu, Gustaw Herling ? Raphaël DargentTu écris à propos de l’œuvre de Gershom Scholem – qu’entre parenthèses, tu me fais découvrir, merci –, et Auschwitz, ou plutôt l’après-Auschwitz si tant est qu’il puisse y avoir un après-Auschwitz, que la question juive est au cœur de certains de tes choix littéraires. Il semble bien que le judaïsme, la pensée juive, je ne sais comment dire, constituent comme une sorte d’arrière-plan de ta réflexion sur la littérature. Juan AsensioEffectivement : la Modernité tout entière est tombée dans le trou noir qu’e22/07/2006 | Lien permanent
Pierre-Emmanuel Dauzat et Michel Surya ou Judas revu et corrigé

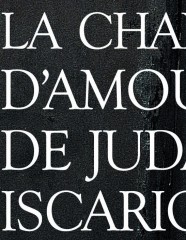
 Le Cerf vient de publier, dans une traduction française augmentée par l'auteur, le petit livre très dense, extraordinairement précis et documenté bref, maîtrisant remarquablement un sujet difficile et source de sempiternelles querelles entre spécialistes, de Hans-Josef Klauck consacré à Judas (Judas, un disciple de Jésus, dans la collection Lectio Divina). Pour caractériser en revanche l'ouvrage (lui aussi ayant pour thème Judas) de Pierre-Emmanuel Dauzat que j'évoquais ci-dessous, et afin de ne point trop accabler son auteur..., je pourrais utiliser l'adjectif impressionniste ou plutôt, comme Klauck l'écrit lui-même, romantique : «On pourra être surpris, écrit Klauck, de ce que dans ce qui précède on n’a pas tenté d’absoudre Judas de toute faute. Il me semble qu’une telle tentative, quel que soit le caractère honorable de ses motifs, est le fruit d’un faux romantisme qui ne résiste pas à un examen réfléchi des textes» (Hans-Josef Klauck, op. cit. (Cerf, coll. Lectio Divina, 2006 [1987]), p. 165).
Le Cerf vient de publier, dans une traduction française augmentée par l'auteur, le petit livre très dense, extraordinairement précis et documenté bref, maîtrisant remarquablement un sujet difficile et source de sempiternelles querelles entre spécialistes, de Hans-Josef Klauck consacré à Judas (Judas, un disciple de Jésus, dans la collection Lectio Divina). Pour caractériser en revanche l'ouvrage (lui aussi ayant pour thème Judas) de Pierre-Emmanuel Dauzat que j'évoquais ci-dessous, et afin de ne point trop accabler son auteur..., je pourrais utiliser l'adjectif impressionniste ou plutôt, comme Klauck l'écrit lui-même, romantique : «On pourra être surpris, écrit Klauck, de ce que dans ce qui précède on n’a pas tenté d’absoudre Judas de toute faute. Il me semble qu’une telle tentative, quel que soit le caractère honorable de ses motifs, est le fruit d’un faux romantisme qui ne résiste pas à un examen réfléchi des textes» (Hans-Josef Klauck, op. cit. (Cerf, coll. Lectio Divina, 2006 [1987]), p. 165).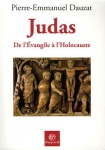 Bordant, presque systématiquement, mes longues, difficiles et périlleuses recherches en démonologie, la figure maudite de Judas n'a jamais cessé de me fixer de son regard mauvais, à la fois torve et désespéré. J'ai d'ailleurs écrit, sur l'apôtre-félon, un étrange manuscrit dont je m'étais résolu à en publier, dans la Zone, quelque extrait [avant de le supprimer], presque définitivement résigné à ne pouvoir faire paraître mon texte, pourtant court et, selon les commentaires autorisés d'un Michel Surya (nous y reviendrons) fasciné par le difficile sujet, excellent.J'attendais donc avec une réelle impatience la publication de ce livre tout entier consacré à l'histoire et au mythe de Judas que Pierre-Emmanuel Dauzat, rencontré lors d'un cocktail saluant la parution du Cahier de l'Herne consacré à George Steiner, m'avait déclaré, alors, de sa voix prudente et timide, écrire sans relâche. Je viens d'en terminer la lecture et mon sentiment est pour le moins foncièrement dubitatif, pas tant sur le seul travail de compilation (encore que...) accompli par Dauzat que sur les conclusions auxquelles parvient son enquête et surtout sur l'étrange sueur qui transpire de ces lignes. Quant à la méthode analytique choisie, l'essai de Dauzat hésite entre une approche rigoureusement historique, balayant les représentations littéraires (avec quelques trop rares excursions dans les domaines de la peinture et de la musique) de Judas au travers des âges, et une autre voie, plus thématique, davantage consacrée à dresser un portrait physique de l'apôtre : l'extrême foisonnement des mentions de Judas dans la littérature apocryphe chrétienne est ainsi bien trop vite balayé.Des défauts beaucoup plus graves que cette drôle de forme entachent cependant cet essai. D'abord, il est pour le moins étonnant, alors que des dizaines de pages sont consacrées au cas tout de même peu intéressant, d'un strict point de vue littéraire, du Judas de Roman Gary ou de celui de Scholem Asch, parfait inconnu, que la plus petite ligne n'évoque point le Judas de Chesterton ou encore celui de Conrad tel que le génial romancier l'a peint dans Lord Jim. On me rétorquera que le principe d'un corpus est justement d'opérer un tri et je répondrai qu'il eût mieux valu dans ce cas, plutôt que de recycler de vieilles pages (Dauzat ayant déjà écrit sur Romain Gary), évoquer, pourquoi pas sous un nouvel éclairage, des textes moins célèbres mais tout aussi riches, sinon plus, que ceux que Dauzat a retenus. J'ai tout de même été sensible au fait que l'auteur mentionne, toutefois bien trop sommairement et comme s'il était pressé de passer à autre chose, la figure du traître, fort discrète au demeurant mais pas moins complexe, que Paul Gadenne imagine dans ses remarquables Hauts-Quartiers. Dauzat, tout de même, aurait encore pu signaler, fût-ce de quelques mots, la figure démoniaque telle que Georges Bernanos (qui, nous rappelle pourtant l'essayiste, priait, enfant, pour le salut de l'âme de l'apôtre félon) l'a campée dans La Joie : énigmatique suicidé dressé en face du Christ agonisant, que Chantal de Clergerie, l'âme pure, ne peut se résigner à abandonner dans son cachot infernal. Bernanos n'a pas attendu Dauzat pour appliquer la parole folle, extraordinaire, du saint : ad in inferno damnatos extendebat caritatem suam, et cela même sans tenter d'excuser le traître. Foin des pleurnicheries et des gémissements contristés : il s'agit d'aller chercher le maudit où il se trouve, en Enfer. Bernanos et d'autres grands romanciers, à coup sûr, y sont descendus. Dauzat, lui, plane loin au-dessus de la fournaise, au chaud, si je puis dire, dans son petit bimoteur larmoyant, se contentant de lâcher quelques tracts avertissant les damnés de l'imminence du pardon universel, distribuant les bons et les mauvais points. Sur un tel sujet, n'étions-nous pas en droit d'attendre autre chose que le devoir appliqué, moralisateur, d'un pion dolent ? Peut-être, oui, une véritable plongée dans les ténèbres...D'autres défauts, rhédibitoires cette fois-ci, font de cet essai une étude à mon sens partiellement ratée, à la fois ambitieuse par son sujet et ridiculement atrophiée dans ses pourtant vagues prétentions universitaires, à vrai dire quasiment inexistantes : la rigueur scientifique est pour le moins, sous la plume de notre essayiste, une constante floue, une constante inconstante si je puis dire. On me fera remarquer, une fois de plus, que le lectorat visé par ce type d'ouvrage n'est pas forcément élitiste. J'aurais toutefois beau jeu de répondre que la précision est une donnée appréciable, y compris des non-spécialistes, surtout, peut-être, dans ce genre d'ouvrage bâtard, voguant entre deux eaux. C'est donc moins la méthodologie (même si les premiers chapitres de l'ouvrage, je l'ai dit, ont quelque peine à choisir entre l'étude historique et la voie thématique) suivie par le célèbre traducteur de George Steiner que ses commentaires, à vrai dire constants et singulièrement sots, qui m'ont profondément agacé. Ces curieuses incises sans incisives, le jeu de mots facile convient assez bien à la désinvolture de roquet herméneutique que pratique à l'occasion Dauzat, à la fois coléreuses et étrangement femmelines, c'est-à-dire aigries, impuissantes, l'auteur semble, avec une magnifique obstination, les réserver à un seul écrivain, Pierre Boutang et, au travers de sa remarquable Ontologie du secret que Dauzat devrait d'ailleurs se dépêcher de vite relire en ne tentant point d'y flairer quelque antisémitisme larvé, à ces auteurs qui, tels Drumont et Maurras (surnommé, un peu facilement, le «fou du roi»), ont stigmatisé, à travers Judas, le Juif. Certes, ces commentaires ne seraient que stupides et désobligeants, suffisant donc à nous détourner d'un essai splendide (ce que le livre de Dauzat n'est point) s'il n'y avait, là aussi d'une façon récurrente et proprement accablante pour le lecteur, de sempiternelles jérémiades versées d'abondance sur le sort ignoble qui, au travers des âges, a été réservé à Judas. C'est que Pierre-Emmanuel Dauzat, partant du constat que tous nous avons, en quelque sorte, condamné l'apôtre à se pendre, n'a de cesse de larmoyer sur son sort et de tenter, de fait, de l'arracher de la Géhenne dans laquelle il s'est volontairement exilé, afin de précipiter le triomphe du Fils de Dieu : bien sûr, c'est là que l'intention dépasse, de très loin, la réalité de l'acte, le sauvetage est moins réel que fantasmé puisque Dauzat, je l'ai dit, refuse de suivre le guide dans le royaume ténébreux. L'idée, d'ailleurs, n'est point nouvelle, empruntée à des auteurs tels que Thomas De Quincey, John Donne (Dauzat a été l'impeccable traducteur de son étonnant Biathanatos, ce livre admiré de Borges) ainsi qu'à de vieux ouvrages de patristique comme l'Adversus Haereses d'Irénée de Lyon, qui déjà s'insurgeaient contre les écrits apocryphes présentant Judas comme le nécessaire collaborateur de la mission christique.Ce dernier reproche est à mon sens d'infiniment plus de poids, qui pourrit de l'intérieur les bonnes intentions affichées par l'essayiste et grève radicalement la portée de l'ouvrage, dès lors rien de moins que suspect, voire insidieusement traître. D'un côté en effet, Dauzat, à juste titre me semble-t-il, se scandalise, dès l'introduction de son essai, que le christianisme ne soit plus qu'un pieux lavement pour ectoplasmes érotico-sulpiciens. De l'autre pourtant, son essai lui-même contribue à cet affadissement généralisé, nous verrons pourquoi : «Quand la déchristianisation progresse, écrit-il, que des livres mal fagotés rêvent on ne sait trop quelles amours mortes entre Marie-Madeleine et le Christ ou Judas, à moins qu’on ne fantasme quelque refoulement homosexuel, que le sens même de l’onction se perd parce qu’on ne sait plus le sens des mots, on est frappé du peu qui subsiste, et qui subsiste envers et contre tout. On n’est plus sûr de rien, mais s’il n’en reste qu’un, ce sera celui-là : Judas.» (11; les pages entre parenthèses renvoient à notre ouvrage). une fois le Christ mort et enterré si je puis dire, seul subsiste dans nos cervelles confuses, surtout depuis le siècle passé amateur de diableries (cf. p. 22), la figure de l'éternel pendu, oscillant au-dessus du puits de notre mauvaise conscience. Judas deviendrait dès lors de chair, réalisant à rebours le miracle de l'incarnation, alors que le Christ se perdrait définitivement dans les limbes d'une mythologisation commode (cf. p. 24 : «Qui consent encore quelque droit à la foi ne manquera pas de se désoler d’un temps où l’on met les morts à table, où l’on croit plus à Judas qu’à Jésus, où l’on rend le second au mythe pour mieux accabler le premier»). Judas serait en somme comme une espèce de bubon dans lequel toute la haine occidentale se serait concentrée à l'endroit d'une unique cible que l'on soupçonnera vite être : le Juif. Qu'importe même, nous dit Pierre-Emmanuel Dauzat, que la haine contre le Juif se soit cristallisée dans la figure du proscrit absolu, de cet usurier maudit à l'époque du Moyen Âge (cf. p. 117) puisque la «récupération laïque, athée et psychologique [de la figure du traître donne] de nouveaux usages aux mythes quand le filon chrétien» s'épuise. «Ce basculement du sacré vers le profane, poursuit l'auteur, explique en même temps l’universalisation du mythe de Judas […]» (223). En somme, chaque époque doit avoir son Judas comme elle a aussi son Juif, sorte de bouc émissaire idéalement fabriqué pour servir de combustible perpétuel pour des autodafés qui n'ont point toujours, hélas, été de purs symboles. Dauzat écrit ainsi, fort justement : «Le XXe siècle avait vu très tôt une renaissance de l’association Judas/Juif sous sa forme la plus néfaste. Tout Juif est un Judas et ne mérite en aucune façon notre compassion. N’en avons-nous pas déjà assez avec la Passion ? Et Judas, malgré le XVIIe siècle, malgré sa promotion dans quelques grandes œuvres de fiction modernes, plus rarement de théologie, restait la trame implicite de nos haines» (312-313).Tous ces développements, comme tant d'autres qui n'ajoutent strictement rien de plus au propos étiré un peu trop longuement par l'auteur, sont convenus qui analysent la permanence de la figure de Judas comme l'ersatz ténébreux de nos frayeurs, de notre haine qui, pour se vider, doit diriger son venin contre une chair éternellement souffletée, brutalisée, torturée. Permettez-moi une image qui me vient immédiatement à l'esprit : les bourreaux ont besoin d'avoir sous la main un innocent, un Ilan Halimi qui aura eu le tort de croiser, un jour, le chemin implacable des chiens. Judas tire sa grandeur noire du fait que sa torture durera, elle, pour les siècles et les siècles, sans rémission possible : plus que l'Inconsolé, il est le Martyrisé par excellence. Reste à savoir de quelle nature est cette haine. S'agit-il seulement de celle manifestée, d'âge en âge brutal, à l'endroit du Juif qui a livré le Christ ? S'agit-il, comme le soutient plus insidieusement George Steiner (et Dauzat ne peut tout de même méconnaître, sur cette question, les positions de l'auteur dont il a traduit en français pratiquement tous les ouvrages), de la haine que les chrétiens vouent, par Juifs interposés si je puis dire, à l'endroit du Christ qui les empêcherait, par l'observation rigoureuse des Béatitudes, de se vautrer dans la fange, tentante, du pourceau ? Je crois que c'est effectivement cette haine seconde, retournée contre le propre principe d'absolue innocence qui l'a stigmatisée et vaincue, haine seconde plus discrète mais pas moins infiniment dangereuse, dont Dauzat suggère l'existence derrière toute promotion d'un Judas antisémite. «Alors que Judas, écrit ainsi l'auteur, dans la tradition chrétienne occidentale, était une figure de la «haine nécessaire», sa transplantation en Orient en a fait une figure du pardon ou de la compassion nécessaire. La migration géographique de Judas s’est doublée d’une migration mentale positive, dont les retombées se manifestent dans les meilleurs fictions occidentales» (303). Peut-être, oui. Mais à trop prétendre que le salut se trouve en Orient, on risque alors de ne point comprendre quelle étrange sophistique conduit Dauzat à affirmer une si pathétique ineptie : «Nous n’avons toujours rien compris. Nous avons voulu la mort de Judas, nous l’avons eue. Et la haine est inassouvie. Il ne reste qu’à la retourner contre nous. Si enfin la prétendue «haine de soi du Juif» pouvait devenir une «haine de soi du chrétien» ! Ce serait une forme d’œcuménisme contrite, mais peut-être plus efficace. Une eucharistie un peu moins imbécile» (314). Une eucharistie qui, en somme, alimenterait la perpétuelle mauvaise conscience de l'Occident chrétien ? Une communion qui ferait sa chair non point d'un Corps glorieux mais d'une charogne, de ce cadavre que, tous, nous cachons voluptueusement dans quelque placard, comme Hanecke le pense ? C'est bien, j'en ai hélas peur, le pain rassis, l'ignoble eucharistie que Dauzat veut nous faire goûter.Nous voici donc parvenu au pli le plus secret de l'argumentation élaborée par Dauzat qui, je l'ai écrit plus haut, est aussi l'ultime retournement inscrivant son propre essai dans une logique auto-destructrice. D'un côté, l'auteur se lamente de la confusion généralisée dont se nourrit notre époque insouciante, pleure sur son idéal perdu. De l'autre, obstinément désireux de délivrer le pauvre Judas du poids de sa trop grande faute, que nous aurions tous finalement commise, il décide de jouer les bons Samaritains, se charge, tel un moderne christophore, non seulement de sa part du fardeau pesant mais distribue en outre, à chacun d'entre nous, sa petite quantité de peine, son bout de ficelle tragique, avec laquelle il faudra ne point hésiter à se pendre avec maints cris de repentance. Bref, en déresponsabilisant Judas, en le rendant finalement sympathique, digne de pitié, en conspuant ces auteurs de toute façon suspects (Maurras, Boutang, etc.) qui ont insisté sur le caractère proprement démoniaque du geste de l'apôtre sans lui témoigner la plus petite compassion (prétend-il), Pierre-Emmanuel Dauzat accroît il me semble la confusion, mélange un peu plus les identités, fait du Christ un diable de Fils de Dieu et de Judas un sympathique mais piteux ladre, condamné au tragique par son mauvais calcul, son marchandage d'amateur. L'ambivalence borgésienne est au comble de la confusion lorsque l'auteur écrit : «À supposer que la geste chrétienne ait eu une dimension métaphysique, Jésus, dit le Christ, et Judas, dit l’Iscariote, incarnaient deux rapports au monde, deux options sur l’ici-bas et l’au-delà, deux réponses à la question de la vie avant la mort ou après. C’est selon. Le monde désenchanté ne nous laisse même plus un tombeau vide, mais deux instruments de supplice : la croix et la corde» (319-320). Il n'y a donc plus ni Christ, depuis longtemps évadé de son tombeau de toute façon vide, ni Judas, simple défroque qui finalement pourrait recouvrir n'importe quelle dépouille pourvu qu'elle présente ce caractère de complexité (plutôt que d'ambivalence) propre à la figure de Judas. L'adultération (cf. p. 305) des deux figures, ni bonnes ni mauvaises mais toutes deux profondément ambiguës, à la fin de notre «déprimant dossier Judas» (27), est donc totale, puisque, nous affirme Dauzat, le christianisme est suffisamment pervers pour nous demander de croire à une rédemption qui a nécessité, pour se réaliser, une trahison (cf. p. 311).Comment dénouer cet inextricable enchevêtrement de fausses évidences, d'apparents paradoxes qui, s'ils ne peuvent assurément conforter une foi sincère, robuste, se nourrissant du mystère plutôt que cherchant à le tabuler sottement, offriront tout de même quelques minutes de récréation esthétique aux dévots les plus crédules ? Peut-être en opposant aux petits jeux goûtés par l'auteur les exemples de ces romanciers qu'il n'a pas cru bon d'évoquer de plus de quelques lignes insignifiantes (ainsi de Bernanos) ou louvoyantes, ridicules et tout simplement fausses (de Gadenne, absurdement qualifié de «très chrétien», Dauzat suspecte les «amours délicates» et moque le personnage de «valet de Judas, hybride du père lubrique et suicidaire de Maurras et du pudique et compatissant abbé Oegger» qu'il mettra en scène dans Les Hauts-Quartiers cf. p. 216). Une étude détaillée, chez ces deux romanciers, de la figure de Judas, suffirait je pense à éclairer Pierre-Emmanuel Dauzat quant à l'ineptie confondante de sa thèse : atténuer le Mal, tenter, à tout prix, de sauver Judas, quitte à le transformer en une espèce pour le moins comique d'usurier de la rédemption c'est non seulement, à coup sûr, excuser l'apôtre, le décrocher mollement de sa branche mais encore, tout aussi assurément, affadir la puissance miraculeuse du Christ. Pourtant, je me dois de rappeler que ni Gadenne ni même Bernanos n'ont cru bon de devoir accabler Judas : le peignant dans son horreur, ils l'ont estimé digne de compassion, car c'est l'éviden
Bordant, presque systématiquement, mes longues, difficiles et périlleuses recherches en démonologie, la figure maudite de Judas n'a jamais cessé de me fixer de son regard mauvais, à la fois torve et désespéré. J'ai d'ailleurs écrit, sur l'apôtre-félon, un étrange manuscrit dont je m'étais résolu à en publier, dans la Zone, quelque extrait [avant de le supprimer], presque définitivement résigné à ne pouvoir faire paraître mon texte, pourtant court et, selon les commentaires autorisés d'un Michel Surya (nous y reviendrons) fasciné par le difficile sujet, excellent.J'attendais donc avec une réelle impatience la publication de ce livre tout entier consacré à l'histoire et au mythe de Judas que Pierre-Emmanuel Dauzat, rencontré lors d'un cocktail saluant la parution du Cahier de l'Herne consacré à George Steiner, m'avait déclaré, alors, de sa voix prudente et timide, écrire sans relâche. Je viens d'en terminer la lecture et mon sentiment est pour le moins foncièrement dubitatif, pas tant sur le seul travail de compilation (encore que...) accompli par Dauzat que sur les conclusions auxquelles parvient son enquête et surtout sur l'étrange sueur qui transpire de ces lignes. Quant à la méthode analytique choisie, l'essai de Dauzat hésite entre une approche rigoureusement historique, balayant les représentations littéraires (avec quelques trop rares excursions dans les domaines de la peinture et de la musique) de Judas au travers des âges, et une autre voie, plus thématique, davantage consacrée à dresser un portrait physique de l'apôtre : l'extrême foisonnement des mentions de Judas dans la littérature apocryphe chrétienne est ainsi bien trop vite balayé.Des défauts beaucoup plus graves que cette drôle de forme entachent cependant cet essai. D'abord, il est pour le moins étonnant, alors que des dizaines de pages sont consacrées au cas tout de même peu intéressant, d'un strict point de vue littéraire, du Judas de Roman Gary ou de celui de Scholem Asch, parfait inconnu, que la plus petite ligne n'évoque point le Judas de Chesterton ou encore celui de Conrad tel que le génial romancier l'a peint dans Lord Jim. On me rétorquera que le principe d'un corpus est justement d'opérer un tri et je répondrai qu'il eût mieux valu dans ce cas, plutôt que de recycler de vieilles pages (Dauzat ayant déjà écrit sur Romain Gary), évoquer, pourquoi pas sous un nouvel éclairage, des textes moins célèbres mais tout aussi riches, sinon plus, que ceux que Dauzat a retenus. J'ai tout de même été sensible au fait que l'auteur mentionne, toutefois bien trop sommairement et comme s'il était pressé de passer à autre chose, la figure du traître, fort discrète au demeurant mais pas moins complexe, que Paul Gadenne imagine dans ses remarquables Hauts-Quartiers. Dauzat, tout de même, aurait encore pu signaler, fût-ce de quelques mots, la figure démoniaque telle que Georges Bernanos (qui, nous rappelle pourtant l'essayiste, priait, enfant, pour le salut de l'âme de l'apôtre félon) l'a campée dans La Joie : énigmatique suicidé dressé en face du Christ agonisant, que Chantal de Clergerie, l'âme pure, ne peut se résigner à abandonner dans son cachot infernal. Bernanos n'a pas attendu Dauzat pour appliquer la parole folle, extraordinaire, du saint : ad in inferno damnatos extendebat caritatem suam, et cela même sans tenter d'excuser le traître. Foin des pleurnicheries et des gémissements contristés : il s'agit d'aller chercher le maudit où il se trouve, en Enfer. Bernanos et d'autres grands romanciers, à coup sûr, y sont descendus. Dauzat, lui, plane loin au-dessus de la fournaise, au chaud, si je puis dire, dans son petit bimoteur larmoyant, se contentant de lâcher quelques tracts avertissant les damnés de l'imminence du pardon universel, distribuant les bons et les mauvais points. Sur un tel sujet, n'étions-nous pas en droit d'attendre autre chose que le devoir appliqué, moralisateur, d'un pion dolent ? Peut-être, oui, une véritable plongée dans les ténèbres...D'autres défauts, rhédibitoires cette fois-ci, font de cet essai une étude à mon sens partiellement ratée, à la fois ambitieuse par son sujet et ridiculement atrophiée dans ses pourtant vagues prétentions universitaires, à vrai dire quasiment inexistantes : la rigueur scientifique est pour le moins, sous la plume de notre essayiste, une constante floue, une constante inconstante si je puis dire. On me fera remarquer, une fois de plus, que le lectorat visé par ce type d'ouvrage n'est pas forcément élitiste. J'aurais toutefois beau jeu de répondre que la précision est une donnée appréciable, y compris des non-spécialistes, surtout, peut-être, dans ce genre d'ouvrage bâtard, voguant entre deux eaux. C'est donc moins la méthodologie (même si les premiers chapitres de l'ouvrage, je l'ai dit, ont quelque peine à choisir entre l'étude historique et la voie thématique) suivie par le célèbre traducteur de George Steiner que ses commentaires, à vrai dire constants et singulièrement sots, qui m'ont profondément agacé. Ces curieuses incises sans incisives, le jeu de mots facile convient assez bien à la désinvolture de roquet herméneutique que pratique à l'occasion Dauzat, à la fois coléreuses et étrangement femmelines, c'est-à-dire aigries, impuissantes, l'auteur semble, avec une magnifique obstination, les réserver à un seul écrivain, Pierre Boutang et, au travers de sa remarquable Ontologie du secret que Dauzat devrait d'ailleurs se dépêcher de vite relire en ne tentant point d'y flairer quelque antisémitisme larvé, à ces auteurs qui, tels Drumont et Maurras (surnommé, un peu facilement, le «fou du roi»), ont stigmatisé, à travers Judas, le Juif. Certes, ces commentaires ne seraient que stupides et désobligeants, suffisant donc à nous détourner d'un essai splendide (ce que le livre de Dauzat n'est point) s'il n'y avait, là aussi d'une façon récurrente et proprement accablante pour le lecteur, de sempiternelles jérémiades versées d'abondance sur le sort ignoble qui, au travers des âges, a été réservé à Judas. C'est que Pierre-Emmanuel Dauzat, partant du constat que tous nous avons, en quelque sorte, condamné l'apôtre à se pendre, n'a de cesse de larmoyer sur son sort et de tenter, de fait, de l'arracher de la Géhenne dans laquelle il s'est volontairement exilé, afin de précipiter le triomphe du Fils de Dieu : bien sûr, c'est là que l'intention dépasse, de très loin, la réalité de l'acte, le sauvetage est moins réel que fantasmé puisque Dauzat, je l'ai dit, refuse de suivre le guide dans le royaume ténébreux. L'idée, d'ailleurs, n'est point nouvelle, empruntée à des auteurs tels que Thomas De Quincey, John Donne (Dauzat a été l'impeccable traducteur de son étonnant Biathanatos, ce livre admiré de Borges) ainsi qu'à de vieux ouvrages de patristique comme l'Adversus Haereses d'Irénée de Lyon, qui déjà s'insurgeaient contre les écrits apocryphes présentant Judas comme le nécessaire collaborateur de la mission christique.Ce dernier reproche est à mon sens d'infiniment plus de poids, qui pourrit de l'intérieur les bonnes intentions affichées par l'essayiste et grève radicalement la portée de l'ouvrage, dès lors rien de moins que suspect, voire insidieusement traître. D'un côté en effet, Dauzat, à juste titre me semble-t-il, se scandalise, dès l'introduction de son essai, que le christianisme ne soit plus qu'un pieux lavement pour ectoplasmes érotico-sulpiciens. De l'autre pourtant, son essai lui-même contribue à cet affadissement généralisé, nous verrons pourquoi : «Quand la déchristianisation progresse, écrit-il, que des livres mal fagotés rêvent on ne sait trop quelles amours mortes entre Marie-Madeleine et le Christ ou Judas, à moins qu’on ne fantasme quelque refoulement homosexuel, que le sens même de l’onction se perd parce qu’on ne sait plus le sens des mots, on est frappé du peu qui subsiste, et qui subsiste envers et contre tout. On n’est plus sûr de rien, mais s’il n’en reste qu’un, ce sera celui-là : Judas.» (11; les pages entre parenthèses renvoient à notre ouvrage). une fois le Christ mort et enterré si je puis dire, seul subsiste dans nos cervelles confuses, surtout depuis le siècle passé amateur de diableries (cf. p. 22), la figure de l'éternel pendu, oscillant au-dessus du puits de notre mauvaise conscience. Judas deviendrait dès lors de chair, réalisant à rebours le miracle de l'incarnation, alors que le Christ se perdrait définitivement dans les limbes d'une mythologisation commode (cf. p. 24 : «Qui consent encore quelque droit à la foi ne manquera pas de se désoler d’un temps où l’on met les morts à table, où l’on croit plus à Judas qu’à Jésus, où l’on rend le second au mythe pour mieux accabler le premier»). Judas serait en somme comme une espèce de bubon dans lequel toute la haine occidentale se serait concentrée à l'endroit d'une unique cible que l'on soupçonnera vite être : le Juif. Qu'importe même, nous dit Pierre-Emmanuel Dauzat, que la haine contre le Juif se soit cristallisée dans la figure du proscrit absolu, de cet usurier maudit à l'époque du Moyen Âge (cf. p. 117) puisque la «récupération laïque, athée et psychologique [de la figure du traître donne] de nouveaux usages aux mythes quand le filon chrétien» s'épuise. «Ce basculement du sacré vers le profane, poursuit l'auteur, explique en même temps l’universalisation du mythe de Judas […]» (223). En somme, chaque époque doit avoir son Judas comme elle a aussi son Juif, sorte de bouc émissaire idéalement fabriqué pour servir de combustible perpétuel pour des autodafés qui n'ont point toujours, hélas, été de purs symboles. Dauzat écrit ainsi, fort justement : «Le XXe siècle avait vu très tôt une renaissance de l’association Judas/Juif sous sa forme la plus néfaste. Tout Juif est un Judas et ne mérite en aucune façon notre compassion. N’en avons-nous pas déjà assez avec la Passion ? Et Judas, malgré le XVIIe siècle, malgré sa promotion dans quelques grandes œuvres de fiction modernes, plus rarement de théologie, restait la trame implicite de nos haines» (312-313).Tous ces développements, comme tant d'autres qui n'ajoutent strictement rien de plus au propos étiré un peu trop longuement par l'auteur, sont convenus qui analysent la permanence de la figure de Judas comme l'ersatz ténébreux de nos frayeurs, de notre haine qui, pour se vider, doit diriger son venin contre une chair éternellement souffletée, brutalisée, torturée. Permettez-moi une image qui me vient immédiatement à l'esprit : les bourreaux ont besoin d'avoir sous la main un innocent, un Ilan Halimi qui aura eu le tort de croiser, un jour, le chemin implacable des chiens. Judas tire sa grandeur noire du fait que sa torture durera, elle, pour les siècles et les siècles, sans rémission possible : plus que l'Inconsolé, il est le Martyrisé par excellence. Reste à savoir de quelle nature est cette haine. S'agit-il seulement de celle manifestée, d'âge en âge brutal, à l'endroit du Juif qui a livré le Christ ? S'agit-il, comme le soutient plus insidieusement George Steiner (et Dauzat ne peut tout de même méconnaître, sur cette question, les positions de l'auteur dont il a traduit en français pratiquement tous les ouvrages), de la haine que les chrétiens vouent, par Juifs interposés si je puis dire, à l'endroit du Christ qui les empêcherait, par l'observation rigoureuse des Béatitudes, de se vautrer dans la fange, tentante, du pourceau ? Je crois que c'est effectivement cette haine seconde, retournée contre le propre principe d'absolue innocence qui l'a stigmatisée et vaincue, haine seconde plus discrète mais pas moins infiniment dangereuse, dont Dauzat suggère l'existence derrière toute promotion d'un Judas antisémite. «Alors que Judas, écrit ainsi l'auteur, dans la tradition chrétienne occidentale, était une figure de la «haine nécessaire», sa transplantation en Orient en a fait une figure du pardon ou de la compassion nécessaire. La migration géographique de Judas s’est doublée d’une migration mentale positive, dont les retombées se manifestent dans les meilleurs fictions occidentales» (303). Peut-être, oui. Mais à trop prétendre que le salut se trouve en Orient, on risque alors de ne point comprendre quelle étrange sophistique conduit Dauzat à affirmer une si pathétique ineptie : «Nous n’avons toujours rien compris. Nous avons voulu la mort de Judas, nous l’avons eue. Et la haine est inassouvie. Il ne reste qu’à la retourner contre nous. Si enfin la prétendue «haine de soi du Juif» pouvait devenir une «haine de soi du chrétien» ! Ce serait une forme d’œcuménisme contrite, mais peut-être plus efficace. Une eucharistie un peu moins imbécile» (314). Une eucharistie qui, en somme, alimenterait la perpétuelle mauvaise conscience de l'Occident chrétien ? Une communion qui ferait sa chair non point d'un Corps glorieux mais d'une charogne, de ce cadavre que, tous, nous cachons voluptueusement dans quelque placard, comme Hanecke le pense ? C'est bien, j'en ai hélas peur, le pain rassis, l'ignoble eucharistie que Dauzat veut nous faire goûter.Nous voici donc parvenu au pli le plus secret de l'argumentation élaborée par Dauzat qui, je l'ai écrit plus haut, est aussi l'ultime retournement inscrivant son propre essai dans une logique auto-destructrice. D'un côté, l'auteur se lamente de la confusion généralisée dont se nourrit notre époque insouciante, pleure sur son idéal perdu. De l'autre, obstinément désireux de délivrer le pauvre Judas du poids de sa trop grande faute, que nous aurions tous finalement commise, il décide de jouer les bons Samaritains, se charge, tel un moderne christophore, non seulement de sa part du fardeau pesant mais distribue en outre, à chacun d'entre nous, sa petite quantité de peine, son bout de ficelle tragique, avec laquelle il faudra ne point hésiter à se pendre avec maints cris de repentance. Bref, en déresponsabilisant Judas, en le rendant finalement sympathique, digne de pitié, en conspuant ces auteurs de toute façon suspects (Maurras, Boutang, etc.) qui ont insisté sur le caractère proprement démoniaque du geste de l'apôtre sans lui témoigner la plus petite compassion (prétend-il), Pierre-Emmanuel Dauzat accroît il me semble la confusion, mélange un peu plus les identités, fait du Christ un diable de Fils de Dieu et de Judas un sympathique mais piteux ladre, condamné au tragique par son mauvais calcul, son marchandage d'amateur. L'ambivalence borgésienne est au comble de la confusion lorsque l'auteur écrit : «À supposer que la geste chrétienne ait eu une dimension métaphysique, Jésus, dit le Christ, et Judas, dit l’Iscariote, incarnaient deux rapports au monde, deux options sur l’ici-bas et l’au-delà, deux réponses à la question de la vie avant la mort ou après. C’est selon. Le monde désenchanté ne nous laisse même plus un tombeau vide, mais deux instruments de supplice : la croix et la corde» (319-320). Il n'y a donc plus ni Christ, depuis longtemps évadé de son tombeau de toute façon vide, ni Judas, simple défroque qui finalement pourrait recouvrir n'importe quelle dépouille pourvu qu'elle présente ce caractère de complexité (plutôt que d'ambivalence) propre à la figure de Judas. L'adultération (cf. p. 305) des deux figures, ni bonnes ni mauvaises mais toutes deux profondément ambiguës, à la fin de notre «déprimant dossier Judas» (27), est donc totale, puisque, nous affirme Dauzat, le christianisme est suffisamment pervers pour nous demander de croire à une rédemption qui a nécessité, pour se réaliser, une trahison (cf. p. 311).Comment dénouer cet inextricable enchevêtrement de fausses évidences, d'apparents paradoxes qui, s'ils ne peuvent assurément conforter une foi sincère, robuste, se nourrissant du mystère plutôt que cherchant à le tabuler sottement, offriront tout de même quelques minutes de récréation esthétique aux dévots les plus crédules ? Peut-être en opposant aux petits jeux goûtés par l'auteur les exemples de ces romanciers qu'il n'a pas cru bon d'évoquer de plus de quelques lignes insignifiantes (ainsi de Bernanos) ou louvoyantes, ridicules et tout simplement fausses (de Gadenne, absurdement qualifié de «très chrétien», Dauzat suspecte les «amours délicates» et moque le personnage de «valet de Judas, hybride du père lubrique et suicidaire de Maurras et du pudique et compatissant abbé Oegger» qu'il mettra en scène dans Les Hauts-Quartiers cf. p. 216). Une étude détaillée, chez ces deux romanciers, de la figure de Judas, suffirait je pense à éclairer Pierre-Emmanuel Dauzat quant à l'ineptie confondante de sa thèse : atténuer le Mal, tenter, à tout prix, de sauver Judas, quitte à le transformer en une espèce pour le moins comique d'usurier de la rédemption c'est non seulement, à coup sûr, excuser l'apôtre, le décrocher mollement de sa branche mais encore, tout aussi assurément, affadir la puissance miraculeuse du Christ. Pourtant, je me dois de rappeler que ni Gadenne ni même Bernanos n'ont cru bon de devoir accabler Judas : le peignant dans son horreur, ils l'ont estimé digne de compassion, car c'est l'éviden
09/04/2010 | Lien permanent
Maurras : le bonheur est-il dans le pré ?, suivi d'un article de Rémi Soulié sur La Maison un dimanche de Pierre Boutang

Lecture du remarquable Éloge de la France de Philippe Barthelet qui n’a pas de mots assez durs pour condamner les errances savantes et félibresques du maurrassisme et les égarements lettrés de l’inaction française. Maurras y est décrit comme un «médecin imaginaire» ou encore un érudit à ranger parmi les «infinis bavards de la Constituante» dont le «rasoir national eût peut-être abrégé [l’] éloquence». Finalement, comme Bernanos au moment de sa très virulente polémique contre le Maître sourd, Barthelet reproche à Maurras de s’être gonflé de beaux mots alors que d’autres, moins savants sans doute mais plus courageux, ont risqué leur vie en croyant que le coup de force ne pouvait être indéfiniment reporté. Comme Bernanos encore, Barthelet pense que la monarchie française n’a pas disparu dans le vortex de la Révolution mais qu’elle s’est au contraire métamorphosée dans et par sa violence terrible, apocalyptique. Nous vivons ainsi, idée chère à Scholem (mais aussi à Bloy), dans un monde dont l’histoire apparente, telle qu’elle est illustrée dans nos manuels et glosée par nos professeurs, est fausse, le Roi caché des vieilles légendes étant bel et bien le Monarque au trône vide ou, écrit superbement Barthelet, «l’étalon secret des événements». Il apparaît vite que les derniers surgeons aigris du royalisme ne servant donc à strictement rien, si ce n’est peut-être larmoyer sur quelque dolente tête coupée au cours de pieux et érudits raouts parisiens, puisque l’essence royale s’est depuis des lustres transformée en tout autre chose que de débiles descendants condamnés à engrosser des putains télévisuelles et étaler leur morgue de nantis, l’honneur de nommer le sacré, en France, a toujours résidé et résidera encore auprès des humiliés et des offensés et de ceux qui, comme Bernanos (et d’autres), les ont défendus. Bernanos le raillé, le traître à la cause royale, le désespéré piteusement réfugié dans la jungle brésilienne : voilà ce qu’on pouvait encore lire il y a quelques semaines, de façon à peine discrète, dans tel billet méprisant (je crois rédigé par un certain Antoine Foncin) publié dans Les Épées.
Heureusement, il y a Boutang, semble dire Barthelet… Heureusement oui, il y a le génial et fulgurant Boutang (l’article qui suit est signé par Rémi Soulié et concerne le premier roman du philosophe) pour sauver l’honneur de cette poignée de plastronneurs endimanchés, qui à vrai dire, je l’ai vérifié à mes dépends, ne se privent jamais de vous inculquer le sens de la morale naturelle ou le goût de la littérature véritable. Ainsi, pour tel ou tel (un Stéphane Giocanti) respectueux s’il en est, comme le dit la presse branchée, des différences, combien de petits moutons avides de suivre le derrière du mouton qui les précède, décochant au passage, à celui qu’ils ont flairé comme étant un intrus (un loup dans la bergerie ?) telle excommunication fulminée du haut d’une chaire de prétentieuse imbécillité et d'odieuse rectitude morale ?
Oui, heureusement, il y a Boutang, le seul capable, après tout, de sauver l’honneur sali du maître de Martigues dans un livre difficile et splendide, y compris en infléchissant sa caricaturale position sur Bernanos, dont il comprit le génie littéraire bien avant de vaincre les invincibles répugnances héritées de Maurras.
 Pierre Boutang dans la Zone.
Pierre Boutang dans la Zone.«Les pères ont mangé des raisins verts et les fils en ont eu les dents agacées.»
Saint Augustin.
Il faudra bien un jour réévaluer la relation de Pierre Boutang avec la psychanalyse, relire sérieusement L’Apocalypse du désir, par exemple, et ne pas conclure, dans la hâte, à une fin de non-recevoir. Il faudra, aussi, relire son œuvre romanesque, si maline, au sens premier du terme, sous l’influence des nombreux génies qui la travaillent — et dont la nomenclature reste à établir. Boutang publie en 1947 son premier roman, La Maison un dimanche. Il l’a écrit en juillet 1944; il n’a pas encore tordu le cou à celui qu’il appelle «le sorcier de Vienne». Mieux : il joue avec ses topiques. Certes, nous ne serons pas dupes jusqu’au bout, mais ce jeu de dupes, me semble-t-il, en vaut la chandelle ou, si l’on veut, la Ménorah.
Roman familial ?
La Maison un dimanche est un roman nauséeux : boue des chemins bernanosiens et de certaines âmes qui les arpentent, flaccidité sartrienne, aussi, sentiment camusien de l’absurde. Ce dimanche-là est de Laforgue : il fermente dans l’ennui, le vide, l’accablement et la torpeur. Cavalièrement résumé : la pesanteur sans la grâce. Ce Dies domini, aussi long qu’une prière baudelairienne à Satan, singe le repos. Dans la rue de la Visitation, seule nommée, pas un utérus pour tressaillir de joie, nulle Marie pour y rencontrer une Élisabeth. (Dans l’Évangile, deux attentes fructueuses ; ici, une attente diabolique). Une visite mime la Visitation, mais de Sainte Famille, point. Au contraire, partout, Vipère au poing, Nœud de vipères, «affreux nœud de serpent des liens du sang», en langue Eluard. Et puis il y a la luxure, «le mot le plus laid» (1), esquisse du Quatrième chant d’un Purgatoire que Pierre Boutang commence à peine à fredonner. La chair, la mort, le diable, dirait Mario Praz.
Littéralement, La Maison un dimanche est une histoire de revenants : le fils, Georges, revient sur les lieux de la faute paternelle, faute obsédante, obsessionnelle, qui lui fit surprendre, par la malveillance d’une domestique, la nudité de Catherine, maîtresse “accidentelle” de son géniteur. Effroi, stupeur devant le stupre et la nudité de la femme, de cette femme. Immédiatement tombe la sanction mortifère : Georges est condamné à l’infernale répétition. C’est dit : il rejouera la scène primitive avec une enfant de Marie prénommée Marthe (pardi !) et le beau-fils Limouzin dans le rôle du diabolus ex machina (pas de cintres, mais une tenture d’épais rideaux. C’est la même chose). Comment “désengluer” Georges, ce «démon», cette âme damnée, comment le sortir de sa compulsion, de ce cercle très vicieux, comme l’Enfer de Dante ?
Mais quelle faute George porte-t-il, au juste ? Celle de son père ? La sienne, qui fut d’arriver au mauvais moment, par un décret tragique du destin ? Et son angoisse devant la nudité de Catherine, est-ce de l’avoir vue castrée et donc de se poser des questions quant à l’inamovibilité de son service trois pièces ? Est-ce d’avoir pris conscience, un peu tard, de la différence des sexes ? Boutang répond, dans Le Purgatoire, toujours au Quatrième chant, celui de Dame Luxure : les fils paient pour les pères, surtout «les pères de famille nombreuse» (2) — l’addition est plus salée ; on repasse les plats plus souvent. Sacré Montalte ! Et puis, Catherine pourrait être la mère, n’est-ce pas ? Voilà que le roman familial se complique. Jean-Pierre Bernès, l’éditeur de Borges dans La Pléiade, raconte que le jeune Jorge Luis fut amené par son père dans un bordel, à seule fin — louable — de lui faire perdre son pucelage. Avouons que la suite des opérations risque d’être perturbée. Qui voudrait inviter à l’inceste n’aurait pas mieux fait. Allez donc courir après l’innocence de la chair ! Pierre Boutang évoque bien l’éducation chrétienne, mais n’a-t-il pas l’intuition que la culpabilité préexiste à la faute ? N’est-ce pas, au demeurant, l’un des sens du péché originel ? (3)
La compulsion de répétition : bis repetita non semper placent
Le Wiederholungszwang freudien suppose un trauma, puis l’émergence du sentiment de culpabilité qui pousse certains sujets à répéter des actes mortifères. Ainsi, la finalité des actions humaines ne tendrait-elle pas toujours vers le principe de plaisir, mais vers un «au-delà du principe de plaisir» que Freud appelle pulsion de mort.
«répète-le voir un peu» (4), dans le roman, en serait un bon indice textuel. Il y a traumatisme lorsque le sujet ne peut intégrer un événement dans le cours de ses représentations ni l’abstraire du champ de sa conscience en le refoulant. Le retour du même (i.e. la répétition) ne manifeste rien moins qu’une tentative maladroite de maîtrise (d’où le scénario de répétition élaboré par Georges) par l’intégration du trauma à l’organisation symbolique de la victime. Freud radicalise la perspective en affirmant que le premier trauma est celui de la naissance. Quelle faute d’être né ! Cioran le prétend, et Boutang aussi (nous sommes loin de «Chaque fois qu’un petit enfant naît, tout recommence…») : «Je ne devais pas descendre. Toutes ces premières causes selon le moment tantôt c’est d’avoir accepté de donner des leçons à Catherine, tantôt d’être descendu alors que Catherine, immobile, attentive… ou que la mère Limouzin cinq minutes après ait dit à Georges, ou qu’il y avait une fête le huit décembre — mais toutes ces causes vraies ou fausses aboutissent à cela, à Georges, au désastre, à ce regard de Georges maintenant sur moi ; il n’y a qu’une vraie cause, d’être né et d’engendrer : tout revient à cela, et si j’avais eu le temps de savoir le pourquoi de cette naissance, la mienne et celle de Georges…» (5)
(Cause toujours, c’est la faute qui m’intéresse). En mourant, le père de Georges, M. Brun, reprend sur lui le fardeau ; il délivre son fils de la pulsion de mort qui le tenaille ; il l’autorise donc à vivre, autant dire à aimer (aussi bien la nudité des femmes). La fin de la répétition implique la fin de la tentation archaïque du retour à l’origine (des traumas).
«Althusser à rien, et Lacan à pas grand chose», répétait symptomatiquement Pierre Boutang. Ouais. Et Lacan répète Freud, en partant du concept aristotélicien de tûché, ce qui est à l’origine de la répétition, soit le trauma (rencontre insupportable qui n’a pas pu être évitée par le sujet — la nudité de Catherine en l’occurrence). Cet insupportable, Lacan l’appelle le réel ou l’impossible — à symboliser, à affronter. Le scénario de répétition élaboré par Georges témoigne de ce qu’il reste en-deçà de cette symbolisation. La délivrance, au sens gynécologique, surviendra donc à la mort du père, permettant la (re)-naissance symbolique du fils. Parturition réussie. On peut se demander si le secret qui obsède Boutang n’est pas une autre forme de ce réel impossible… La question mérite en tout cas d’être posée.
Les occurrences bibliques qui structurent le roman signifient, je crois, la même chose, d’autant plus que la première d’entre elles (Cf. op. cit., p. 8), comme par hasard, concerne le sacrifice d’Abraham dont on sait combien Boutang, à plusieurs reprises, l’interrogea. De quoi s’agit-il, dans cet épisode, entre mille autres sens possibles, sinon de la naissance symbolique d’un fils, dès lors que le père renonce à entretenir avec lui une relation duelle ? (6)
Au début de La Maison un dimanche, la «mine» — le ventre de la terre-mère, comme un tombeau — menace d’évidence le fils “mal né”. Georges devra se garder sur sa gauche et sur sa droite, en amont et en aval. La catastrophe ne sera pas celle attendue. Au fond, grammaticalement, c’est un pronom très démonstratif qui menace le plus Georges, «cela». Boutang l’utilise de nombreuses fois, au point même d’en faire l’en-tête d’un chapitre. Il faut que la menace soit bien grande, indéfinie comme ces «marais» dont il est question, magma inorganique, chaos informe, pour refuser de nommer l’innommable… Derrière «cela», ça se cache mal. «Wo Es war, soll Ich werden», écrit Freud. C’est tout le problème : que Georges sorte de ça pour devenir Je, «un fils libre», dirait Marie Balmary, un fils enfin advenu à son être (7).
Inquiétante étrangeté
La Maison un dimanche, nous l’avons dit, est une histoire de revenants, et dans une maison par définition hantée. Boutang aime bien les histoires de fantômes, ces êtres qui n’en sont plus tout à fait. La famille Brun est naturellement fantomatique (traduction possible de unheimlich), hantée par le souvenir d’un corps nu. Ce roman est donc aussi l’histoire d’un exorcisme — le bon Docteur Sigmund dirait d’une cure : le sortilège qui retient Georges prisonnier doit cesser, le charme doit se rompre, les démons s’enfuir. Qu’est-ce que l’Unheimlich freudien, sinon ce qui n’appartient pas à la maison et qui pourtant y demeure ? (8)
En logocrate, Boutang connaît son étymologie : Heim, c’est Home, le chez soi, la familiarité de la maison, Heimlich, ce qui fait partie de la maison, non étranger, familier, apprivoisé. Die Heimlichen désigne ceux qui habitent sous le même toit. Dans Heim, il y a le calme recherché en toutes lettres par Georges, la protection sûre comme l’enceinte de la maison que l’on habite. Mais il y a plus, mais il y a mieux : heimlich, c’est aussi ce qui est caché, dissimulé, disons le mot… secret (Geheim). Bigre ! L’auteur de L’Ontologie du secret a de la suite dans les idées. Et quand on sait que Heimat renvoie à la patrie, alors… Mais nous ne pouvons pas aller trop loin dans le cadre de cet article. Revenons à nos moutons noirs. Que sont les lieux heimlich du corps humain ? Des pudenda ! Et voilà qu'Adam et Eve reconnurent qu’ils étaient nus, et le père Noé dévoilé, figures qui, comme par hasard, une fois de plus, traversent le roman de Boutang (sur la “préparation” à la nudité, cf. op. cit., pp. 25-26). Ça ne suffit pas ? De quoi meurt M. Brun ? De spasmes Ibid., p. 249). Il semble sujet aux crises d’épilepsie. Quand il cherche à définir l’Unheimlich, que donne Freud comme exemple ? L’épilepsie, bien entendu (ce moment où un corps d’apparence saine semble habité par un démon). Un autre exemple unheimlich ? Le thème du double. Yves, dans le roman de Boutang, duplique la scène originelle, en fidèle doublure de Georges. Telle est sa place dans le scénario écrit pour lui. Et de notre côté, tout est en place pour mettre en évidence l’association freudienne de l’Unheimlich à la compulsion de répétition : «Toutes les analyses précédentes nous préparent à reconnaître que sera ressenti comme étrangement inquiétant ce qui peut nous rappeler cette compulsion intérieure de répétition» (Freud, op. cit., p. 242).
Georges le Revenant, dans la maison hantée, un dimanche, éprouve le sentiment d’inquiétante étrangeté, à l’instar de tous les protagonistes du roman. Freud toujours : «Ce qui paraît au plus haut point étrangement inquiétant à beaucoup de personnes est ce qui se rattache à la mort, aux cadavres et au retour des morts, aux esprits et aux fantômes. Nous avons d’ailleurs vu que nombre de langues modernes ne peuvent pas du tout rendre notre expression : une maison unheimlich autrement que par la formule : une maison hantée. Nous aurions pu à vrai dire commencer notre investigation par cet exemple, peut-être le plus frappant de tous…» (Ibid., p. 246).
Faut-il enfoncer le clou ? Alors lisez le Quatrième chant du Purgatoire, celui de la Luxure, encore et toujours, où Boutang revient — en monomaniaque — sur les revenants et les fantômes, oui, en ce chapitre précis, lointain écho du premier roman : «Le fantôme de Jean Ruo, image de ce mort captif, accompagne Montalte sur la place d’Alésia…» Le Purgatoire, op. cit., p. 207. Cf. également pp. 204 et 205).
La chute de la maison Brun
«Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père», assure l’Evangile. Oui. Mais ce qui est valable pour le Royaume des Cieux ne vaut pas pour la maison du père Brun, fût-ce un dimanche après-midi. «[…]est-ce que l’on peut se manquer totalement à soi, ne pas avoir été tout à fait, voilà la question» (9) posée par Pierre Boutang. Autrement dit : les fantômes existent-ils ? Sans doute, mais Dieu les délivre (Dieu qui, pour Pierre Boutang, à la différence de Freud, n’est pas le Général en chef de l’armée des ombres, le patron des fantômes, quoi — du grec, phantasma). «De ce là-bas, de cet ailleurs, je ne sais rien, même si c’est un ailleurs plutôt que l’être vrai de tous les ici, la répétition qui les révèle tels qu’ils ne parvenaient pas à être» (Ibid., p. 81).
Oui, c’est encore toute la question.
«Ce n’est pas la peine de répéter, puisque tout est dès maintenant répété — en Dieu — et y trouve son être» (p. 83).
Notes
(1) Le Purgatoire, éditions du Sagittaire, 1976 (puis éditions de La Différence, 1991), p. 173.
(2) Ibid., p. 180.
(3) La Mais
26/04/2004 | Lien permanent
Maurice G. Dantec est dans la Zone

18/09/2006 | Lien permanent
Les abeilles de Delphes de Pierre Boutang

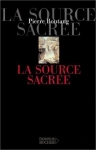 Voici l'article que j'écrivis pour saluer la publication, aux éditions des Syrtes alors dirigées par Pierre-Guillaume de Roux, des Abeilles de Delphes, recueil d'articles éblouissants de style, d'imprécation et d'érudition signés par Pierre Boutang. Depuis, le tome 2 de ces Abeilles a été édité en 2003, intitulé La source sacrée, toujours sous les auspices de Pierre-Guillaume, cette fois-ci aux éditions du Rocher. J'attends la suite, non pas celle de ces Abeilles (bien qu'existent une multitude d'articles politiques qui mériteraient d'être regroupés et présentés, comme Olivier Véron directeur des Provinciales en avait d'ailleurs le projet si je ne m'abuse...) mais la publication, par exemple, de certains des textes les plus intéressants que Pierre Boutang écrivit sans jamais désirer les publier dans son Journal. Aux dernières nouvelles, déjà passablement anciennes elles aussi, Stéphane Giocanti et Jean-François Colosimo se chamaillaient quant à l'opportunité de faire paraître partie ou totalité (!) de ces milliers de pages manuscrites. Apparemment, la dispute, qui n'est sans doute point médiévale dans sa finesse argumentative, doit toujours durer puisque aucune publication partielle ou prétendument exhaustive de ces textes à l'écriture fulgurante et presque illisible (si ce n'est de la veuve de l'auteur), n'a vu le jour. Pour l'heure, seuls quelques extraits de ces Cahiers, rédigés tout au long d'une vie, sont reproduits dans le Dossier H qui est consacré à Boutang.
Voici l'article que j'écrivis pour saluer la publication, aux éditions des Syrtes alors dirigées par Pierre-Guillaume de Roux, des Abeilles de Delphes, recueil d'articles éblouissants de style, d'imprécation et d'érudition signés par Pierre Boutang. Depuis, le tome 2 de ces Abeilles a été édité en 2003, intitulé La source sacrée, toujours sous les auspices de Pierre-Guillaume, cette fois-ci aux éditions du Rocher. J'attends la suite, non pas celle de ces Abeilles (bien qu'existent une multitude d'articles politiques qui mériteraient d'être regroupés et présentés, comme Olivier Véron directeur des Provinciales en avait d'ailleurs le projet si je ne m'abuse...) mais la publication, par exemple, de certains des textes les plus intéressants que Pierre Boutang écrivit sans jamais désirer les publier dans son Journal. Aux dernières nouvelles, déjà passablement anciennes elles aussi, Stéphane Giocanti et Jean-François Colosimo se chamaillaient quant à l'opportunité de faire paraître partie ou totalité (!) de ces milliers de pages manuscrites. Apparemment, la dispute, qui n'est sans doute point médiévale dans sa finesse argumentative, doit toujours durer puisque aucune publication partielle ou prétendument exhaustive de ces textes à l'écriture fulgurante et presque illisible (si ce n'est de la veuve de l'auteur), n'a vu le jour. Pour l'heure, seuls quelques extraits de ces Cahiers, rédigés tout au long d'une vie, sont reproduits dans le Dossier H qui est consacré à Boutang. Qu'y a-t-il de plus pur et délié que l'écriture de ces nombreux articles parus jadis dans Aspects de la France et réunis en 1952 par les soins de La Table Ronde, de moins tourmenté et violent, de plus éloigné de la prose stochastique d'un Hadjadj [Nda : Et les violents s'en emparent, L'âge d'homme/Les provinciales, 1999] et du verbe irascible d'un Soulié [Les châteaux de glace de Dominique de Roux, L'âge d'homme/Les provinciales, 1999] ? Pourtant, pour les pieuses galantes qui me liraient, dois-je rappeler quelle espèce d'infréquentable fut Pierre Boutang, qui écrivit d'aussi furieux pamphlets que Sartre est-il un possédé ? en 1947 ou La République de Joinovici l'année suivante ? Les lions ont de ces haltes, purs émerveillements d'une force concentrée dans la chair musculeuse de l'esprit qui, contrairement à ce que pensent les imbéciles, ces freluquets zoologistes qui s'imaginent que la lionne seule chasse pour son mâle paresseux, est la violence prodigue qui réellement capture la proie, autrement invisible, indestructible comme le vif-argent, inexistante et insapide. Boutang, dans ces articles de critique, ne voyage pas comme il le fait dans son odysséenne Ontologie, toujours proche d'être envoûtée par le chant maléfique des sirènes du non-être, bien près d'être capturée par la trame circéenne du secret ou, s'il le fait effectivement, c'est en nous ouvrant la halte protectrice de nombreux refuges sur la route limpide qu'il parcourt en poète, c'est-à-dire en homme qui n'a jamais honte d'avouer son étonnement, son bonheur de découvrir une œuvre qui l'enchante et le ravit. Certes, de nombreuses fois, tombant d'ailleurs dans l'ornière peu profonde d'un prosélytisme somme toute fort discret, l'auteur réaffirme — mais qui en aurait douté ? — ses indéracinables convictions monarchistes, comme lorsqu'il nous parle du contre-révolutionnaire Babel de Caillois. Mais jamais, même s'il s'agit assez souvent de regretter, à l'exception évidemment révérée du maître Maurras, que l'auteur et l’œuvre étudiés n'aillent pas aussi loin que lui et n'avouent franchement que leur souci de l'ordre et d'un principe logocratique dans les lettres ne rejoigne pas, à moins qu'il ne le fonde, celui qui légitimerait une politique réellement mystique et non plus tartufe, laïcardement innocente, mais jamais, donc, cette critique ne fait l'impasse du texte, de sa réalité chaude et profonde, n'emmaillote celle-ci dans le paletot rapiécé d'une pesante et imbécile critique partisane. De toute façon, l'écriture de Boutang, comme celle de Barbey, de Hello ou de Maistre, comme celle de Bloy ou de Bernanos, de Kraus ou même, comme celle de Steiner, n'a nul besoin de glacer son édifice analytique avec le sucre amer de la pièce rapportée, puisqu'elle-même scrute dans le langage les prodromes de la décadence du monde et des institutions qui régissent sa destinée de vieillard intarissable de paroles : arc-boutée sur les contreforts effrités, elle devient une tentative inspirée de rédemption de l'écriture. Qu'importe donc si l'homme de conviction, dans ces pages où il ne se prive pas de condamner durement l'errance politique du grand Bernanos tout en admirant à juste titre son pouvoir de voyant (Malheureux Bernanos... Le chemin de la fidélité qui est le même que celui de l'honneur... p. 237), commettant au passage une vilenie inutile et de surcroît bêtement insinuante (Car enfin c'est Bernanos qui a failli avoir les funérailles nationales... p. 333), qu'importe si son plaisir est souvent frustré, puisqu'il reste la tâche redoutable et immense qu'il faut accomplir, en homme lige de la royale littérature : commenter les œuvres, toutes les œuvres, et pas seulement celles naguère savourées par les papilles néo-classiques du maître Maurras (qui y trouvèrent, plus que le génie intrinsèque de ces ouvrages, celui, remarquablement condimenté, qu'elles-mêmes y apportèrent), cela seul compte, à l'évidente condition que les auteurs lus et commentés aient du talent, voire, ayant quelque chose de nouveau à dire dans le brouhaha du siècle, comme Faulkner ou T. S. Eliot, du génie. Ainsi le Très-Haut de Blanchot, qui probablement n'a jamais rendu la politesse à Boutang, est-il très justement analysé comme l'acmé du romanesque devenu cauchemar. Les conversations boutangiennes, ou plutôt, les véritables disputes qu'il a eues avec l'auteur de Réelles présences, sa thèse, Ontologie du secret ou bien le vaste champ des traductions offertes par son Art poétique, m'avaient depuis longtemps averti que ce maître de l'enseignement était également, tout comme son ami anglais ou Borges, un maître de lecture, capable de rendre aux œuvres commentées la politesse d'une réelle présence, d'une courtoisie (notions cardinales dans l'œuvre critique de George Steiner) qui font d'un commentaire plus qu'un appendice caudal disgracieux et mutant : qu'on en juge, Blanchot, Faulkner, Maurras, Aymé, Giono ou Marcel, Supervielle ou Mann, Pascal ou Montaigne, Rousseau et Michelet, Baudelaire ou Bernanos... Je pourrais allonger cette liste; elle ne manquera pas, d'elle-même, de s'agrandir, puisque le deuxième volume de ces Abeilles, également préparé par les soins de Stéphane Giocanti (aidé de Georges Laffly et de Frédéric Rouvillois) qu'il faut ici remercier pour son impeccable et sobre préface, mais gronder de ne pas nous l'avoir donnée plus longue, est prévu courant 2000 [Nda : ce deuxième volume ne parut en fait qu'en 2003]. Dans presque tous les cas, la lecture de Boutang est magistrale, et révèle en somme ce que l'œuvre étudiée dit en bégayant, dans les ténèbres, comme au travers d'un miroir à l'eau troublée que le critique est seul capable de lire. J'emploie à dessein des métaphores scripturaires, car le souci de notre auteur dans ces pages lumineuses est, je l'ai dit, de rehausser l'étiage stagnant du flux de paroles, de seconder amoureusement la vision de l'écrivain par la limpide sérénité d'une vraie compréhension : À quoi servent les critiques ?, se demande ainsi Boutang, avant de répondre, dans une étude consacrée à Oublieuse mémoire de Supervielle : Ce ne peut être qu'à maintenir le sens et la fonction religieuse du langage (p. 346).Ah ! Dois-je parler ici de ma petite personne et ajouter mon inutile sobriquet aux noms prestigieux que je viens d'évoquer ? A dire vrai, je n'avais presque rien lu de l'œuvre de l'auteur de l'Apocalypse du désir, qui demeurait dans mon esprit auréolée d'une réputation (bien évidemment inepte dans sa publicité, et toute proche de n'intéresser que ceux qui ne l'avaient jamais lue) emmaillotée dans le prestige d'un solide hermétisme qui devait, comme il se doit inévitablement, me séduire, et tomber, dès que je compris que cette difficulté était, non pas une étape ou une partie de la difficile progression, mais comme l'enveloppe même de cette dernière, sa lumière voilée. Qui a lu, une fois seulement, une œuvre de Boutang, reconnaît sans doute immédiatement ce que Julien Gracq appelait la patte du griffon, la signature inimitable, propre à quelques auteurs – quelques auteurs, pas plus – raidis par la discipline du style. Mais cela importe peu, tout compte fait. Ce qui demeure dans la prose de Pierre Boutang, plus que le style dans lequel s'amalgame (comme dans un alliage entre deux métaux réfractaires mais inéluctablement liés) la concision érémitique des classiques avec la déprédation furieuse trouvée chez Bloy ou Lautréamont, c'est la question posée au langage et, plus encore que cette question, qui pourrait nous faire confondre Boutang avec un esthète mallarméen duquel tout le sépare, ce qui demeure et trouvera sa place éminente dans les années qui viennent, lorsque l'os blanc de la déconstruction structuro-psychanalysante aura été jeté dans la flache de l'oubli puant qui tentera de sucer sa moelle maladive, c'est la veille, et la garde jalouse que monte le soudard Boutang auprès du trésor inépuisable, comme un Gygès famélique hurlant de désespoir après que son secret luxuriant a été rendu invisible par un mauvais démiurge, ou comme un Oedipe attaché à son Sphinx qui le presse de découvrir son arcane ultime, ou comme un séide enfin qui serait fanatiquement pressé contre sa vestale innocente. Les puristes hurleront de me voir transformer l'érudit impeccable en reître, en barbare tudesque ? Je dis à ces prudents : et alors ? Ne sont-ce pas ces mêmes barbares qui, voici plusieurs siècles, en convertissant leurs forces inépuisables mais désordonnées, en les plaçant sous la seule bannière capable de guider leurs cavalcades sur les plaines incendiées, celle du christianisme, ont édifié les immenses bibliothèques que les esthètes parcourent à présent dans un silence impressionné ? Et puis, il y a chez Boutang une force, que l'on réduirait en la qualifiant seulement, comme Steiner le fait, de physique, dont chaque muscle de fauve bande l'épine dorsale de la plus courte de ses phrases : si les lions de Borges tout bardés des signes mystérieux d'une écriture divine, si le furet, cet animal métaphysique dont Boutang a fait le personnage d'une fable, ce prodigieux prédateur qui chasse, pourvu qu'il ait été quelque peu apprivoisé, pour le compte d'un maître qui aura grand soin d'en attiser la fulgurante vivacité – mais ce maître, à son tour, n'est pas le dernier de la chaîne : la proie que lui rapporte son furet, il ne peut se l'approprier définitivement, puisqu'il doit la remettre à plus puissant que lui, la sacrifiant au Dieu ainsi honoré qui lui donnera de nouvelles proies à poursuivre –, si donc le furet, le lion, et l'espèce de griffon qu'est Boutang sont couverts de signes comme les livres apocalyptiques de sceaux, c'est bien que nulle accalmie ne tempère leur bouillonnement et qu'aucune lénitive prudence n'attache leur marche au piquet où les chèvres continuent de brouter leur mouchoir d'herbe sale. C'est bien aussi que son verbe, il est allé le chercher, le capturer puis le domestiquer (domestication sauvage, comme celle, toujours dangereusement aléatoire, du lynx), dans les ruines encore fumantes de Babel la Haute, de Ninive la blanche qui faisait enrager le prophète Nahum, au milieu des bêtes horribles de la nuit, et que, une fois lavé, purifié, rédimé – car il faut quereller les mots qui font couler le sang après avoir permis l'imposture, comme nous le rappelle l'auteur à la page 464 –, c'est ce même verbe qui va lui servir à bâtir, plus que l'arche nouvelle chère à Maurras, la tour immense, cette fois inversée comme la fosse d'Abellio, au fond de laquelle les prodigieuses forces inconnues n'auront de cesse de creuser jusqu'à ce qu'elles aient trouvé, comme à la sortie d'un enfer bouché par le Satan congelé de Dante, la montagne lumineuse où tout murmure continue de résonner à l'infini, où toute vision devient à son tour signe d'un espace dégagé, où toute impatience trouve enfin sa réponse.Pierre Boutang, Les abeilles de Delphes (Éditions des Syrtes, préface de Stéphane Giocanti, 1999).Je rappelle quelques autres ouvrages, encore disponibles pour la plupart, à condition toutefois de manifester quelque opiniâtreté dans ses recherches...
Qu'y a-t-il de plus pur et délié que l'écriture de ces nombreux articles parus jadis dans Aspects de la France et réunis en 1952 par les soins de La Table Ronde, de moins tourmenté et violent, de plus éloigné de la prose stochastique d'un Hadjadj [Nda : Et les violents s'en emparent, L'âge d'homme/Les provinciales, 1999] et du verbe irascible d'un Soulié [Les châteaux de glace de Dominique de Roux, L'âge d'homme/Les provinciales, 1999] ? Pourtant, pour les pieuses galantes qui me liraient, dois-je rappeler quelle espèce d'infréquentable fut Pierre Boutang, qui écrivit d'aussi furieux pamphlets que Sartre est-il un possédé ? en 1947 ou La République de Joinovici l'année suivante ? Les lions ont de ces haltes, purs émerveillements d'une force concentrée dans la chair musculeuse de l'esprit qui, contrairement à ce que pensent les imbéciles, ces freluquets zoologistes qui s'imaginent que la lionne seule chasse pour son mâle paresseux, est la violence prodigue qui réellement capture la proie, autrement invisible, indestructible comme le vif-argent, inexistante et insapide. Boutang, dans ces articles de critique, ne voyage pas comme il le fait dans son odysséenne Ontologie, toujours proche d'être envoûtée par le chant maléfique des sirènes du non-être, bien près d'être capturée par la trame circéenne du secret ou, s'il le fait effectivement, c'est en nous ouvrant la halte protectrice de nombreux refuges sur la route limpide qu'il parcourt en poète, c'est-à-dire en homme qui n'a jamais honte d'avouer son étonnement, son bonheur de découvrir une œuvre qui l'enchante et le ravit. Certes, de nombreuses fois, tombant d'ailleurs dans l'ornière peu profonde d'un prosélytisme somme toute fort discret, l'auteur réaffirme — mais qui en aurait douté ? — ses indéracinables convictions monarchistes, comme lorsqu'il nous parle du contre-révolutionnaire Babel de Caillois. Mais jamais, même s'il s'agit assez souvent de regretter, à l'exception évidemment révérée du maître Maurras, que l'auteur et l’œuvre étudiés n'aillent pas aussi loin que lui et n'avouent franchement que leur souci de l'ordre et d'un principe logocratique dans les lettres ne rejoigne pas, à moins qu'il ne le fonde, celui qui légitimerait une politique réellement mystique et non plus tartufe, laïcardement innocente, mais jamais, donc, cette critique ne fait l'impasse du texte, de sa réalité chaude et profonde, n'emmaillote celle-ci dans le paletot rapiécé d'une pesante et imbécile critique partisane. De toute façon, l'écriture de Boutang, comme celle de Barbey, de Hello ou de Maistre, comme celle de Bloy ou de Bernanos, de Kraus ou même, comme celle de Steiner, n'a nul besoin de glacer son édifice analytique avec le sucre amer de la pièce rapportée, puisqu'elle-même scrute dans le langage les prodromes de la décadence du monde et des institutions qui régissent sa destinée de vieillard intarissable de paroles : arc-boutée sur les contreforts effrités, elle devient une tentative inspirée de rédemption de l'écriture. Qu'importe donc si l'homme de conviction, dans ces pages où il ne se prive pas de condamner durement l'errance politique du grand Bernanos tout en admirant à juste titre son pouvoir de voyant (Malheureux Bernanos... Le chemin de la fidélité qui est le même que celui de l'honneur... p. 237), commettant au passage une vilenie inutile et de surcroît bêtement insinuante (Car enfin c'est Bernanos qui a failli avoir les funérailles nationales... p. 333), qu'importe si son plaisir est souvent frustré, puisqu'il reste la tâche redoutable et immense qu'il faut accomplir, en homme lige de la royale littérature : commenter les œuvres, toutes les œuvres, et pas seulement celles naguère savourées par les papilles néo-classiques du maître Maurras (qui y trouvèrent, plus que le génie intrinsèque de ces ouvrages, celui, remarquablement condimenté, qu'elles-mêmes y apportèrent), cela seul compte, à l'évidente condition que les auteurs lus et commentés aient du talent, voire, ayant quelque chose de nouveau à dire dans le brouhaha du siècle, comme Faulkner ou T. S. Eliot, du génie. Ainsi le Très-Haut de Blanchot, qui probablement n'a jamais rendu la politesse à Boutang, est-il très justement analysé comme l'acmé du romanesque devenu cauchemar. Les conversations boutangiennes, ou plutôt, les véritables disputes qu'il a eues avec l'auteur de Réelles présences, sa thèse, Ontologie du secret ou bien le vaste champ des traductions offertes par son Art poétique, m'avaient depuis longtemps averti que ce maître de l'enseignement était également, tout comme son ami anglais ou Borges, un maître de lecture, capable de rendre aux œuvres commentées la politesse d'une réelle présence, d'une courtoisie (notions cardinales dans l'œuvre critique de George Steiner) qui font d'un commentaire plus qu'un appendice caudal disgracieux et mutant : qu'on en juge, Blanchot, Faulkner, Maurras, Aymé, Giono ou Marcel, Supervielle ou Mann, Pascal ou Montaigne, Rousseau et Michelet, Baudelaire ou Bernanos... Je pourrais allonger cette liste; elle ne manquera pas, d'elle-même, de s'agrandir, puisque le deuxième volume de ces Abeilles, également préparé par les soins de Stéphane Giocanti (aidé de Georges Laffly et de Frédéric Rouvillois) qu'il faut ici remercier pour son impeccable et sobre préface, mais gronder de ne pas nous l'avoir donnée plus longue, est prévu courant 2000 [Nda : ce deuxième volume ne parut en fait qu'en 2003]. Dans presque tous les cas, la lecture de Boutang est magistrale, et révèle en somme ce que l'œuvre étudiée dit en bégayant, dans les ténèbres, comme au travers d'un miroir à l'eau troublée que le critique est seul capable de lire. J'emploie à dessein des métaphores scripturaires, car le souci de notre auteur dans ces pages lumineuses est, je l'ai dit, de rehausser l'étiage stagnant du flux de paroles, de seconder amoureusement la vision de l'écrivain par la limpide sérénité d'une vraie compréhension : À quoi servent les critiques ?, se demande ainsi Boutang, avant de répondre, dans une étude consacrée à Oublieuse mémoire de Supervielle : Ce ne peut être qu'à maintenir le sens et la fonction religieuse du langage (p. 346).Ah ! Dois-je parler ici de ma petite personne et ajouter mon inutile sobriquet aux noms prestigieux que je viens d'évoquer ? A dire vrai, je n'avais presque rien lu de l'œuvre de l'auteur de l'Apocalypse du désir, qui demeurait dans mon esprit auréolée d'une réputation (bien évidemment inepte dans sa publicité, et toute proche de n'intéresser que ceux qui ne l'avaient jamais lue) emmaillotée dans le prestige d'un solide hermétisme qui devait, comme il se doit inévitablement, me séduire, et tomber, dès que je compris que cette difficulté était, non pas une étape ou une partie de la difficile progression, mais comme l'enveloppe même de cette dernière, sa lumière voilée. Qui a lu, une fois seulement, une œuvre de Boutang, reconnaît sans doute immédiatement ce que Julien Gracq appelait la patte du griffon, la signature inimitable, propre à quelques auteurs – quelques auteurs, pas plus – raidis par la discipline du style. Mais cela importe peu, tout compte fait. Ce qui demeure dans la prose de Pierre Boutang, plus que le style dans lequel s'amalgame (comme dans un alliage entre deux métaux réfractaires mais inéluctablement liés) la concision érémitique des classiques avec la déprédation furieuse trouvée chez Bloy ou Lautréamont, c'est la question posée au langage et, plus encore que cette question, qui pourrait nous faire confondre Boutang avec un esthète mallarméen duquel tout le sépare, ce qui demeure et trouvera sa place éminente dans les années qui viennent, lorsque l'os blanc de la déconstruction structuro-psychanalysante aura été jeté dans la flache de l'oubli puant qui tentera de sucer sa moelle maladive, c'est la veille, et la garde jalouse que monte le soudard Boutang auprès du trésor inépuisable, comme un Gygès famélique hurlant de désespoir après que son secret luxuriant a été rendu invisible par un mauvais démiurge, ou comme un Oedipe attaché à son Sphinx qui le presse de découvrir son arcane ultime, ou comme un séide enfin qui serait fanatiquement pressé contre sa vestale innocente. Les puristes hurleront de me voir transformer l'érudit impeccable en reître, en barbare tudesque ? Je dis à ces prudents : et alors ? Ne sont-ce pas ces mêmes barbares qui, voici plusieurs siècles, en convertissant leurs forces inépuisables mais désordonnées, en les plaçant sous la seule bannière capable de guider leurs cavalcades sur les plaines incendiées, celle du christianisme, ont édifié les immenses bibliothèques que les esthètes parcourent à présent dans un silence impressionné ? Et puis, il y a chez Boutang une force, que l'on réduirait en la qualifiant seulement, comme Steiner le fait, de physique, dont chaque muscle de fauve bande l'épine dorsale de la plus courte de ses phrases : si les lions de Borges tout bardés des signes mystérieux d'une écriture divine, si le furet, cet animal métaphysique dont Boutang a fait le personnage d'une fable, ce prodigieux prédateur qui chasse, pourvu qu'il ait été quelque peu apprivoisé, pour le compte d'un maître qui aura grand soin d'en attiser la fulgurante vivacité – mais ce maître, à son tour, n'est pas le dernier de la chaîne : la proie que lui rapporte son furet, il ne peut se l'approprier définitivement, puisqu'il doit la remettre à plus puissant que lui, la sacrifiant au Dieu ainsi honoré qui lui donnera de nouvelles proies à poursuivre –, si donc le furet, le lion, et l'espèce de griffon qu'est Boutang sont couverts de signes comme les livres apocalyptiques de sceaux, c'est bien que nulle accalmie ne tempère leur bouillonnement et qu'aucune lénitive prudence n'attache leur marche au piquet où les chèvres continuent de brouter leur mouchoir d'herbe sale. C'est bien aussi que son verbe, il est allé le chercher, le capturer puis le domestiquer (domestication sauvage, comme celle, toujours dangereusement aléatoire, du lynx), dans les ruines encore fumantes de Babel la Haute, de Ninive la blanche qui faisait enrager le prophète Nahum, au milieu des bêtes horribles de la nuit, et que, une fois lavé, purifié, rédimé – car il faut quereller les mots qui font couler le sang après avoir permis l'imposture, comme nous le rappelle l'auteur à la page 464 –, c'est ce même verbe qui va lui servir à bâtir, plus que l'arche nouvelle chère à Maurras, la tour immense, cette fois inversée comme la fosse d'Abellio, au fond de laquelle les prodigieuses forces inconnues n'auront de cesse de creuser jusqu'à ce qu'elles aient trouvé, comme à la sortie d'un enfer bouché par le Satan congelé de Dante, la montagne lumineuse où tout murmure continue de résonner à l'infini, où toute vision devient à son tour signe d'un espace dégagé, où toute impatience trouve enfin sa réponse.Pierre Boutang, Les abeilles de Delphes (Éditions des Syrtes, préface de Stéphane Giocanti, 1999).Je rappelle quelques autres ouvrages, encore disponibles pour la plupart, à condition toutefois de manifester quelque opiniâtreté dans ses recherches... La Maison un dimanche (La Table ronde, 1947). J'ai écrit sur ce roman un article, reproduit dans la Zone, ici.Quand le furet s'endort (La Table ronde, 1949).Le Secret de René Dorlinde (Fasquelle, 1957).Le Purgatoire (Sagittaire, 1976). Ces quatre romans ont été réédités en 1991 par les éditions La Différence.Le colossal Maurras, la destinée et l'œuvre (Plon, 1984) a été réédité par La Différence (1993). Karin Pozzi et la quête de l'immortalité (1991) et William Blake, manichéen et visionnaire (1990) ont également paru chez cet éditeur mais sont épuisés, tout comme Sartre est-il un possédé ? (La Table ronde, 1947), La Terreur en question (Fasquelle, 1958) ou bien Reprendre le pouvoir (Sagittaire, 1978).
La Maison un dimanche (La Table ronde, 1947). J'ai écrit sur ce roman un article, reproduit dans la Zone, ici.Quand le furet s'endort (La Table ronde, 1949).Le Secret de René Dorlinde (Fasquelle, 1957).Le Purgatoire (Sagittaire, 1976). Ces quatre romans ont été réédités en 1991 par les éditions La Différence.Le colossal Maurras, la destinée et l'œuvre (Plon, 1984) a été réédité par La Différence (1993). Karin Pozzi et la quête de l'immortalité (1991) et William Blake, manichéen et visionnaire (1990) ont également paru chez cet éditeur mais sont épuisés, tout comme Sartre est-il un possédé ? (La Table ronde, 1947), La Terreur en question (Fasquelle, 1958) ou bien Reprendre le pouvoir (Sagittaire, 1978).  En revanche, l'Art poétique (La Table ronde, 1988) et l'Apocalypse du désir (Grasset, 1979) sont encore disponibles, de même que le fascinant Ontologie du secret (PUF, 1988), le précieux petit volume Le Temps (Hatier, 1993) et La Fontaine. Les fables ou la langue des dieux (Hachette, 1995). L'une des façons les plus commodes de pénétrer dans le labyrinthe boutangien reste encore de lire les Dialogues entre George Steiner et Pierre Boutang (Jean-Claude Lattès, 1994) et, bien sûr, le Dossier H consacré à Boutang, sous l'égide de Antoine Joseph Assaf.
En revanche, l'Art poétique (La Table ronde, 1988) et l'Apocalypse du désir (Grasset, 1979) sont encore disponibles, de même que le fascinant Ontologie du secret (PUF, 1988), le précieux petit volume Le Temps (Hatier, 1993) et La Fontaine. Les fables ou la langue des dieux (Hachette, 1995). L'une des façons les plus commodes de pénétrer dans le labyrinthe boutangien reste encore de lire les Dialogues entre George Steiner et Pierre Boutang (Jean-Claude Lattès, 1994) et, bien sûr, le Dossier H consacré à Boutang, sous l'égide de Antoine Joseph Assaf.
02/01/2006 | Lien permanent
Le Visage humain de Max Picard

 Max Picard dans la Zone.
Max Picard dans la Zone. Les premières phrases de ce livre paru en 1929 sous son titre original de Das Menschengesicht et en France, plus de trente années plus tard, en 1962, dans une traduction de J.-J. Anstett (1), frappent par leur absence radicale de facilité qui, aujourd'hui, serait tout simplement inimaginable, alors que tout est fait pour mettre à la portée du dernier des imbéciles le moindre livre. Max Picard nous donne une énigme en une seule phrase, qui aura l'avantage de hérisser le poil de certains de ses lecteurs, de les décourager immédiatement, même, d'aller tout simplement plus loin. Comme tout grand auteur, Max Picard possède un pouvoir d'attraction, de sidération, son texte parvient, parfois, à retenir la respiration du lecteur qui, suivant sa complexion, détestera de telles façons de faire, affirmant que ce genre de procédé court-circuite ni plus ni moins l'intelligence, ou bien se laissera volontairement prendre au piège, croyant d'ailleurs reconnaître la marque du chasseur absolu, qui jamais ne rate sa cible lorsqu'il s'agit de convaincre, frapper, séduire, ravir, au sens premier du terme, Sören Kierkegaard bien sûr : «Le visage vient de ce que recouvre un voile et va dans ce que couvre un voile; il se fait connaître sur ce chemin d'un voile à un autre voile, mais c'est seulement comme se fait connaître quelqu'un qui est en route : en passant et incomplètement» (p. 11).
Les premières phrases de ce livre paru en 1929 sous son titre original de Das Menschengesicht et en France, plus de trente années plus tard, en 1962, dans une traduction de J.-J. Anstett (1), frappent par leur absence radicale de facilité qui, aujourd'hui, serait tout simplement inimaginable, alors que tout est fait pour mettre à la portée du dernier des imbéciles le moindre livre. Max Picard nous donne une énigme en une seule phrase, qui aura l'avantage de hérisser le poil de certains de ses lecteurs, de les décourager immédiatement, même, d'aller tout simplement plus loin. Comme tout grand auteur, Max Picard possède un pouvoir d'attraction, de sidération, son texte parvient, parfois, à retenir la respiration du lecteur qui, suivant sa complexion, détestera de telles façons de faire, affirmant que ce genre de procédé court-circuite ni plus ni moins l'intelligence, ou bien se laissera volontairement prendre au piège, croyant d'ailleurs reconnaître la marque du chasseur absolu, qui jamais ne rate sa cible lorsqu'il s'agit de convaincre, frapper, séduire, ravir, au sens premier du terme, Sören Kierkegaard bien sûr : «Le visage vient de ce que recouvre un voile et va dans ce que couvre un voile; il se fait connaître sur ce chemin d'un voile à un autre voile, mais c'est seulement comme se fait connaître quelqu'un qui est en route : en passant et incomplètement» (p. 11). John M. Œsterreicher, dans un ouvrage heureusement court qui n'est qu'une paraphrase pas même inspirée et beaucoup trop apologétique (2), cite le propos d'un critique du nom de Johannes Mumbauer qui, évoquant le livre de Max Picard, par une image frappante, bien évidemment contestable, valant toutefois mieux que quelques pesantes thèses, rend inutile le livre de notre commentateur paresseux : «Depuis Dante, il y a l'enfer; depuis Bernanos, il y a Satan; depuis Picard, eh ! bien, – il y a le visage de l'homme».
Interprétant littéralement l'identité entre l'homme et Dieu dont le premier a été créé à l'image du second, Max Picard nous propose des analyses remarquables, parfois quelque peu trop mécaniquement appliquées à différents exemples présentés en illustrations, sur le visage, comme celle-ci, qui ferait bondir comme il se doit tout zélateur scientiste, voire toute bonnement placidement soumis à la sévère discipline de la méthode expérimentale : «Si le visage s'était constitué peu à peu, au cours d'une évolution, il serait mélangé à tout ce qui lui serait arrivé au cours de cette évolution; il serait peu net, mou comme une méduse; il serait comme le prolongement de quelque chose; il ne serait pas comme sans passé, pur commencement. Ce qui protège le visage, c'est que son apparition ressemble à l'acte par lequel le Créateur le créa» (p. 26). Peu importe l'absence de rigueur scientifique, évidente, d'une telle observation, laquelle n'intéresse pas notre auteur. Son plan de compréhension et de lecture est symbolique, c'est-à-dire essentiel; son herméneutique, comme celle de Léon Bloy, se veut transcendantale. Dans un passage saisissant, Max Picard affirme, comme à son habitude, la prééminence du visage humain, de l'homme, dans la création, qui à vrai dire tourne autour de ce dernier, hominisation et humanisation, pour reprendre une distinction chère à Teilhard de Chardin, allant de pair, bien que l'hominisation ne puisse directement découler que du geste créateur de Dieu, ex abrupto en somme, et certainement pas d'une série astronomique d'essais et de hasards inouïs : «La nature non rédimée ose s'avancer jusque dans le sein maternel : l'embryon humain ressemble, dans le sein maternel tantôt à un amphibie, tantôt à un poisson et beaucoup de naturalistes pensent que l'embryon doit parcourir ces formes afin de pouvoir atteindre la forme humaine et que l'embryon humain est dépendant de ces formes. Mais c'est l'inverse : ce sont ces formes qui sont dépendantes de la forme humaine; elles se pressent vers la forme humaine, tout se presse vers l'homme, vers le médiateur, vers le rédempteur et la forme embryonnaire ouverte est moins protégée contre l'attaque des formes étrangères que la forme close de l'adulte» (p. 117). C'est là affirmer, de façon péremptoire, que l'homme, comme pour Teilhard d'ailleurs bien que je sois forcé de ne point m'étendre sur ce point, et les différences caractérisant visiblement ces deux conceptions de la philogénèse, est axe et flèche de l'évolution, mais encore cible. Ailleurs, Max Picard n'a-t-il pas montré que l'animal ne pouvait pas, par essence, prétendre se transformer en homme ? : «Les mouvements de l'animal longent une sorte de limite et, si l'animal avance toujours plus loin, il semble que quelque chose d'entièrement autre doit être atteint. Il semble que l'animal doive alors commencer à parler : tout mouvement de l'animal est comme une course vers la parole jamais atteinte» (p. 80).
 L'acte divin modelant le visage de l'intérieur, tout comme l'âme et l'esprit lui impriment sa forme et son aura, le «visage qui est à l'image de Dieu est métamorphose de l'abîme, le visage qui est séparé de Dieu par la chute n'est que prolongement de l'abîme» (p. 40). De belles analyses concernent le visage des hommes qui sont habités par le mal, ou bien de ceux qui, bons, ont toutefois commis de mauvais actes, analyses que nous pourrions d'ailleurs rapprocher du concept d'hermétisme démoniaque tel que Kierkegaard l'a exposé : «Là où l'aspect mauvais correspond à un être mauvais, le visage est comme épuisé par le mal, comme usé; tout ce qui y apparaît doit être fourni pour le mal; plus il y apparaît de choses, plus il faut en fournir et plus le visage devient mauvais; le visage n'a plus rien en perspective devant soi, il n'a plus rien à attendre que le mal, et, cependant tut, entièrement tout le mal s'y est déjà produit; ce visage est petit, étroit, sans espoir. Mais un visage mauvais qui appartient à un être bon a quelque chose d'une attente; il attend que le bien de l'être intérieur occupe aussi le visage où est actuellement le mal. Ce visage porte son regard au-delà de soi, au-delà du mal; il a quelque chose de l'avenir; il est ouvert : c'est un grand visage» (p. 46, l'auteur souligne).
L'acte divin modelant le visage de l'intérieur, tout comme l'âme et l'esprit lui impriment sa forme et son aura, le «visage qui est à l'image de Dieu est métamorphose de l'abîme, le visage qui est séparé de Dieu par la chute n'est que prolongement de l'abîme» (p. 40). De belles analyses concernent le visage des hommes qui sont habités par le mal, ou bien de ceux qui, bons, ont toutefois commis de mauvais actes, analyses que nous pourrions d'ailleurs rapprocher du concept d'hermétisme démoniaque tel que Kierkegaard l'a exposé : «Là où l'aspect mauvais correspond à un être mauvais, le visage est comme épuisé par le mal, comme usé; tout ce qui y apparaît doit être fourni pour le mal; plus il y apparaît de choses, plus il faut en fournir et plus le visage devient mauvais; le visage n'a plus rien en perspective devant soi, il n'a plus rien à attendre que le mal, et, cependant tut, entièrement tout le mal s'y est déjà produit; ce visage est petit, étroit, sans espoir. Mais un visage mauvais qui appartient à un être bon a quelque chose d'une attente; il attend que le bien de l'être intérieur occupe aussi le visage où est actuellement le mal. Ce visage porte son regard au-delà de soi, au-delà du mal; il a quelque chose de l'avenir; il est ouvert : c'est un grand visage» (p. 46, l'auteur souligne).L'intériorité est le mystère que le visage expose sans le corrompre, dans sa bonté ou sa laideur et, plus il y a d'intériorité, «plus grande est sa puissance pour déterminer ce qu'elle veut envoyer de soi dans l'aspect extérieur, dans le visage» (p. 51). Pour Max Picard, cette intériorité ne peut signifier qu'une seule chose : l'accueil de Dieu. Il n'est donc pas étonnant, à cette aune, que le visage de l'homme sans Dieu, qui fuit Dieu, n'ait aucune consistance : «Dans l'homme qui n'est pas à l'image de Dieu, en qui il n'y a pas de délimitation, passé, présent et avenir forment un seul pêle-mêle et c'est pourquoi tout ce qui se passe en lui a le même air et c'est en vain qu'il tente de donner par une contorsion une forme autre à ce qui est toujours la même chose» (pp. 69-70). L'homme sans Dieu, en premier lieu, est un homme qui s'ennuie.
J'aurais aimé lire de telles analyses plus tôt, qui m'auraient permis de proposer une explication à l'étrange image par laquelle le roman le plus ténébreux de Georges Bernanos, se termine et, pourrions-nous dire, se fige. C'est ainsi que le romancier parle du visage de l'ancien professeur de langues qui vient de mourir : «Cette masse prend peu à peu, d'ailleurs, la couleur de l'argile, semble durcir à l'air, au point que la clarté de la lampe se refuse à en épouser les contours. Seul, le nez qu'allonge démesurément le creux des orbites, l'affaissement des muscles de la face, reste vivant d'une vie désormais sans cause et sans but, ainsi qu'une petite bête malfaisante» (3). Cette minéralisation du visage du satanique le plus accompli de Bernanos s'explique, bien évidemment, par la thématique de l'hermétisme démoniaque, comme je l'ai indiqué, mais les lignes suivantes de Max Picard précisent de quoi il en retourne : «Le danger pour un visage humain est de devenir seulement image, image pour soi, mémorial. Un tel visage se fige. Un visage doit se mettre en marche vers un autre; ainsi seulement il répond au fait qu'il est image de Dieu en un lieu déterminé, ici, sur la terre, parmi les hommes; c'est par là seulement qu'un visage se réalise. Même un visage mauvais n'est pas aussi inhumain qu'un visage entièrement livré à ses seules ressources, qui n'est que mémorial en ciment. Un visage mauvais a, du moins, fait le mouvement de se détourner des hommes; il est certes convulsé parce que, ébauché pour aller vers l'homme, il a été tiré brutalement en arrière par le mal, arraché à ce mouvement; mais, bien qu'il soit ainsi convulsé, il n'a jamais l'inhumanité du visage qui est image pour être seulement plasticité formelle» (pp. 71-2).
Il est étonnant de constater que, suivant immédiatement ses lignes, Max Picard évoque la sexualité, dont nous savons quelle place elle occupe dans le dernier roman de Georges Bernanos : «Un homme dont le visage est pris ainsi dans la seule plasticité formelle est facilement la proie de la sexualité. La sexualité lui semble quelque chose d'apparenté, car la sexualité, comme la seule plasticité formelle, n'exige pas de personnalité, mais seulement de l'universalité, du générique» (p. 72).
Une page plus loin, nous trouvons d'ailleurs une image que nous pourrions à bon droit prétendre typiquement bernanosienne : «Chez l'homme qui ne sait même plus que l'homme est à l'image de Dieu, le mal devient démesuré; l'image de Dieu fait défaut qui peut mettre en ordre le mal. Un visage peut être tellement occupé par le mal qu'il ne subsiste plus rien de lui, du visage. De même que, sous les tropiques, un essaim de sauterelles occupe un arbre, le dévore entièrement et quitte ensuite le lieu où il a tout dévoré de sorte que là où il y avait autrefois un arbre, ce sont maintenant les sauterelles qui sont dans la forme de l'arbre, remplissant les formes de l'arbre dévoré, de même là, le mal remplit les formes du visage : il n'y a plus que le mal» (p. 73).
Enfin, nous pourrions aussi rappeler ce que Max Picard écrit à propos de la parole de celui qui a perdu, ou plutôt qui refuse sa ressemblance avec Dieu. Il est à ce titre très intéressant de noter que cette analyse rapproche visage et parole : «Là où le visage a perdu sa ressemblance avec Dieu, là se perd aussi la limite entre le visage et la parole; le visage devient vague, la parole aussi ensuite; la parole devient une simple rumeur, une rumeur qui se traîne. Elle s'efforce d'être au moins appel, moyen de se faire comprendre; elle n'est plus n création nouvelle ni acte créateur de choses nouvelles» (p. 81).
Le visage humain trahit notre origine, et il n'est que parfaitement logique qu'il s'agisse, en tout premier lieu, de le faire disparaître, pour faire advenir un type d'homme qui, enfin, une fois pour toute, soit débarrassé de ce si encombrant fardeau. Il est ainsi parfaitement possible «que se constitue un nouveau type d'homme de ce genre», devenu «entièrement la proie de la matière», «épais, informe, inhumain» : «Cette transformation se fait d'une manière violente et frappante; peut-être le regard d'un homme qui est encore à l'image de Dieu doit-il être attiré sur ce nouvel homme de la matière afin que ce regard au moins tombe sur lui, afin que cet homme qui n'est pas à l'image de Dieu se constitue au moins sous le regard de l'homme qui est à l'image de Dieu; même la matière qui se rebelle contre la ressemblance avec Dieu a la nostalgie de cette ressemblance» (p. 125).
Je ne suis pas certain que Max Picard ne fasse, dans ces lignes, preuve d'un optimisme évident, à moins qu'il ne s'agisse de la vertu très chrétienne d'espérance que, si nous suivions John M. Œsterreicher, serait donc à l’œuvre avant même la conversion au catholicisme de l'auteur. L'exemple, certes littéraire, de Ouine suffit à nous enseigner que l'homme médiocre tel que le peignait Ernest Hello a dépassé le bien et le mal, et se situe dans une espèce de miraculeux point de Lagrange qui le fait sa vie entière se tenir à égale distance de ces deux pôles ou plutôt, qui annule l'existence même de ces derniers. Trop d'optimisme disais-je, comme dans ces lignes : «Et, de même que les blessures d'un homme assassiné s'ouvrent à l'approche de son meurtrier, de même les abîmes de son visage s'ouvrent devant un homme qui ne s'est pas décidé pour Dieu, quand il le regarde dans un miroir» (pp. 159-60).
Avant de conclure notre propos qui n'a pour modeste ambition que celle de tenter de faire découvrir ce penseur pour le moins original qu'est Max Picard, évoquons des passages qui nous ont fait songé, respectivement, à Walter Benjamin et à Carlo Michelstaedter : «L'obscurité de la tristesse qui est en chaque parole prononcée vient de ce qu'elle participe à l'obscurité de toutes les paroles dans le péché. Mais c'est un honneur pour la parole que de vouloir conserver, dans sa tristesse, le souvenir de la chute dans le péché» (pp. 137-8) et puis, admirable rappel de la persuasion, même si je doute que Max Picard ait su quoi que ce soit du jeune prodige que nous avions évoqué ici : «Un homme qui serait en état de ne laisser passer aucun instant de sa vie sans décision serait tellement présent qu'il ne pourrait mourir; il faudrait qu'il fût enlevé à sa présence par les êtres célestes eux-mêmes comme fut enlevé Laotse, qui disparut sur le bord du désert» (p. 162).
Nous conclurons par une longue citation extraite des dernières pages du livre de Max Picard, qui évoque superbement la tension entre l'intériorité et l'extériorité que le corps humain a été capable de supporter lorsque Dieu s'est incarné par lui, grâce au Christ : «Lorsqu'il eut pris la forme de l'homme, Christ fut cloué sur la croix en forme d'homme, c'est pourquoi la forme de l'homme st frappée pour toujours, frappée pour son terme; elle est mise hors la loi. L'homme aurait dû, à partir de ce moment, cesser d'avoir l'aspect de l'homme. C'est une entreprise osée que d'avoir l'aspect d'un homme quand Dieu avait tenté en vain d'avoir l'aspect d'un homme. Il est inconcevable que l'homme porte la forme de l'homme quand Dieu est mort en elle. Dans les tableaux de Grünewald, il arrive réellement que les formes de l'homme se cabrent; elles se mettent presque en pièces, car elles ne supportent pas d'être encore chez l'homme alors qu'elles furent présentes à la mort de Christ. Elles ne veulent plus tenir à l'homme, elles sont sur le point de l'abandonner. Cet événement fut si immense que toute l'histoire de l'homme n'est, après cet événement, qu'une tentative pour combler le vide laissé maintenant dans l'espace et le temps là où, jadis, fut Dieu, fut Christ. L'histoire, qui a commencé avec le péché originel, devient maintenant seulement véritablement histoire» (pp. 163-4). C'est donc, nous dit Max Picard, par le Christ, «par cette nouvelle création en Christ de la forme humaine que cette forme est assurée pour toujours» (p. 164), cette incarnation, par laquelle Dieu, extérieurement du moins, sous la forme d'un visage d'homme, s'est fait serviteur en Christ, signifiant de facto qu'il est «entièrement indifférent qu'un homme puisse être connu ou non à son aspect extérieur» (p. 169), un saint et même un Dieu pouvant se cacher dans une enveloppe humaine qui, par l'incarnation, s'est ainsi élevée à sa dignité la plus haute, à dire vrai proprement inouïe, comme si un tel événement avait changé non seulement le futur mais aussi le passé : «Cette déchirure fut si immense qu'elle n'apparut pas d'abord là où le Christ fit éclater le monde, en l'an I : bien des siècles avant, les Grecs pressentirent déjà d'avance ce tremblement qui s'amassait, refluant à partir de cette déchirure vers les siècles antérieurs. Il y avait une tristesse sans nom, au sens propre du mot, dans le monde grec à cause de ce tremblement venant de loin et cependant tout proche. Une angoisse traversait ce monde et aussi une désespérance. Plus ce monde approchait de l'épiphanie de Christ, plus grandissait l'angoisse, car ce tremblement devenait toujours plus sensible» (p. 171).
strong>Notes
(1) Max Picard, Le Visage humain (Éditions Buchet/Chastel, 1962).
(2) John M. Œsterreicher, Max Picard. Les visages de l'Amour (Éditions Ad Solem, 2005), p. 17. Me paraît insupportable, et pour tout dire d'une déconcertante facilité, cette volonté de faire de l'auteur un penseur chrétien qui, en somme, s'ignorait en tant quel tel, alors même qu'il ne s'était pas encore converti au christianisme. Nous pouvons ainsi lire que : «La fuite devant Dieu est un livre catholique, bien que Picard, en l'écrivant, ne s'en soit guère douté» (p. 41). En outre, ce livre comporte plusieurs fautes (cf. pp. 8, 46, 50, 71 ou 75) qu'une relecture plus appliquée aurait pu éliminer.
(3) Georges Bernanos, Monsieur Ouine in Œuvres romanesques. Dialogues des carmélites (préface par Gaëtan Picon, textes et variantes établis par Albert Béguin, notes par Michel Estève, Gallimard, coll. La Pléiade, 1974), p. 1562.
13/05/2015 | Lien permanent
La Belle France de Georges Darien

 Mâles lectures.
Mâles lectures. Langages viciés.
Langages viciés.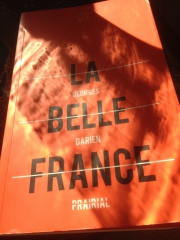 Acheter La Belle France sur le site de l'éditeur, Prairial.
Acheter La Belle France sur le site de l'éditeur, Prairial.Il faut commencer par saluer les toutes jeunes éditions Prairial qui, plutôt que de nous donner à lire puis jeter, à jeter avant même que de lire, tel ouvrage d'inculte écrivant présenté comme une révélation ou un chef-d’œuvre, révélation et chef-d’œuvre qui seront engloutis, d'ici quelques heures ou même minutes, par une autre révélation et un autre chef-d’œuvre, a cru utile, et a eu évidemment raison de le croire, de rendre de nouveau disponible un texte tout bonnement extraordinaire. Liberté extraordinaire, effrayante même à l'ère de la servitude volontaire qui caractérise notre époque et, en germe, celle de l'écrivain : Georges Darien ne plie l'échine devant aucun maître, et cette seule raison suffit à expliquer son oubli; violence extraordinaire, mais violence réelle, non surjouée, découlant logiquement de la liberté totale dont j'ai parlé et qui, si la première raison donnée n'était que quantité négligeable, expliquerait à elle seule l'oubli dans lequel ce contempteur implacable de ce qu'il a appelé, dans un autre livre, les pharisiens, est tombé; écriture extraordinaire, qui pourtant sert une thèse mais qui, par sa violence même, s'échappe du piège facile de la violence dirigée contre une cible trop aisément identifiable. Georges Darien n'a aucune cible, puisqu'il tire sur toutes (sauf peut-être sur les femmes), son écriture étant de toute façon une arme dont le canon est toujours chaud. Par cette plénitude, cet orgasme perpétuel de l'ire, il accède à une contrée mystérieuse, que seuls arpentent un tout petit nombre de marcheurs intrépides, qui n'ont strictement plus rien à perdre et, parce que totalement libres, ne peuvent plus faire rien d'autre que ce que le destin leur commande de faire : tuer, écrire, c'est selon, mais c'est au fond la même chose. Nous tenons un écrivain de sacré ramage et de lignage inconnu, et il n'est pas très étonnant qu'il soit tombé dans l'oubli disais-je, au vu de la complexion monstrueuse que j'ai mentionnée, bien assez forte, aujourd'hui, pour faire de vous un paria plus durablement embastillé qu'un démon dans l'Enfer de Dante. Ce qui frappe avant tout, c'est que Georges Darien, à la différence de tant d'exécrateurs pressés de se ranger des bagnoles et, en quelque sorte, de clamer leur amour à la Presse ou à la Coterie, ne peut être récupéré : imaginez un seul instant Georges Darien finir sur le giron d'une Élisabeth Lévy, comme Philippe Muray, le furibard réduit à quelque slogan mono-neuronal pour réactionnaire élevé au lait de caïman bio !
 C'est en 1901 que paraît, chez Stock après avoir été refusé partout ailleurs, ce texte qu'il serait tout bonnement inimaginable de pouvoir publier aujourd'hui, ou alors très largement caviardé comme le fit Jean-François Revel dans son édition du livre, et cela pour deux bonnes raisons qui n'en sont peut-être qu'une seule : La Belle France (1) est un texte aussi remarquablement écrit qu'il est d'une violence inouïe. Je m'amuse à imaginer quelle tête feraient les eunuques oints de moraline de La Croix s'ils devaient rendre compte d'un tel ouvrage, qu'ils s'empresseraient de châtrer en affirmant que la violence, fût-elle verbale, ne résout rien et que, même pour servir les pauvres, le Pauvre de tous les pauvres, pour introduire sa cause en somme auprès de sa Très Magnanime Éminence et le Toujours Prudent Si Saint Public qu'il s'agit de ne jamais froisser, mieux vaut se ranger aux habituelles laïcardes vertus républicaines d'un honnête et tempéré concordat du propos et du style ! Bref, renoncer. Bref, lâcher Darien, qui fut lâché de toutes parts parce que sa colère ne pouvait être assoupie par les lénifiantes hosties de la presse catholique ou même républicaine.
C'est en 1901 que paraît, chez Stock après avoir été refusé partout ailleurs, ce texte qu'il serait tout bonnement inimaginable de pouvoir publier aujourd'hui, ou alors très largement caviardé comme le fit Jean-François Revel dans son édition du livre, et cela pour deux bonnes raisons qui n'en sont peut-être qu'une seule : La Belle France (1) est un texte aussi remarquablement écrit qu'il est d'une violence inouïe. Je m'amuse à imaginer quelle tête feraient les eunuques oints de moraline de La Croix s'ils devaient rendre compte d'un tel ouvrage, qu'ils s'empresseraient de châtrer en affirmant que la violence, fût-elle verbale, ne résout rien et que, même pour servir les pauvres, le Pauvre de tous les pauvres, pour introduire sa cause en somme auprès de sa Très Magnanime Éminence et le Toujours Prudent Si Saint Public qu'il s'agit de ne jamais froisser, mieux vaut se ranger aux habituelles laïcardes vertus républicaines d'un honnête et tempéré concordat du propos et du style ! Bref, renoncer. Bref, lâcher Darien, qui fut lâché de toutes parts parce que sa colère ne pouvait être assoupie par les lénifiantes hosties de la presse catholique ou même républicaine.Il est une autre raison qui eût empêché Georges Darien de trouver de nos jours un éditeur et, si par chance il eût pu en dénicher un point trop châtré, de voir son livre passer sous les fourches caudines de la réclame journalistique : dans La Belle France, il n'a aucun ami, pas même les pauvres, coupables selon lui de s'habituer non seulement à leur pauvreté, mais de finir par l'aimer. Je cite in extenso un passage remarquable, et d'abord parce que l'auteur évoque son propre cas, ce qui est somme toute assez rare dans ce texte qui n'est qu'un immense projectile dirigé sur une multitude de cibles (les nationalistes, les socialistes, les curés, leurs parasites séculiers, les dirigeants politiques, et même nombre d'écrivains comme Molière !) qui n'en font finalement qu'une seule, le mensonge : «J'ai voulu écrire un livre sur la misère française, un livre dans lequel j'aurais fait voir quelle somme d'énergie immonde il faut, pour vivre, aux êtres qui se sont résolus à se conduire en lâches. J'ai commencé ce livre il y a longtemps; je l'ai abandonné; je l'ai repris dix fois, cent fois; et je ne le ferai sans doute jamais, tellement l'horreur me glace en l'écrivant, tellement je suis envahi par le dégoût ! Dernièrement, encore, j'ai essayé. Il me semblait entendre un grand cri venir de France, terrible comme un hurlement de supplicié, déchirant comme un sanglot d'enfant. Mais, vite, j'ai reconnu que ce n'était point un cri; c'était un ricanement – un ricanement qui se terminait en prière. J'ai jeté la plume... Je n'aime pas les pauvres. Leur existence, qu'ils acceptent, qu'ils chérissent, me déplaît; leur résignation me dégoûte», continue Darien, qui poursuit en affirmant que cette résignation le dégoûte à tel point que c'est, croit-il, «l'antipathie, la répugnance, qu'ils [lui] inspirent, qui [l]'a fait révolutionnaire. Je voudrais voir l'abolition, continue-t-il, de la souffrance humaine afin de n'être plus obligé de contempler le repoussant spectacle qu'elle présente. Je ferais beaucoup pour cela. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à sacrifier ma peau; mais je sacrifierais sans hésitation celle d'un grand nombre de mes contemporains. Qu'on ne se récrie pas. La férocité est beaucoup plus rare que le dévouement» (p. 125).
Ces lignes d'une méchanceté et d'une drôlerie irrésistibles sont bien évidemment loin d’être un cas isolé, puisque d’innombrables férocités surgissent en rang serré sous la plume de l'auteur de Biribi, notamment celles qu'il prête à Léon Bloy (2). Même si je songe aussi à Georges Bernanos, je ne puis que constater que Darien récuse par avance dirait-on toute opposition entre misère et pauvreté, sur laquelle Bernanos brodera plus d'une fois, comme nous le savons : «On remarquera que je n'établis aucune différence entre la pauvreté et la misère. Les deux termes sont synonymes, exactement. La distinction qu'on a voulu créer entre eux, bien qu'elle soit commode pour les souteneurs du présent état de choses, n'existe pas. Dès qu'on manque du nécessaire, on est pauvre; et dès qu'on est pauvre, on est misérable. Je ne crois pas que vivoter soit vivre; c'est agoniser. Je ne reconnais pas de degrés dans le dénuement. Je pense que tout être qui raisonne autrement que moi à ce sujet est un infâme menteur qui mérite la mort» (p. 122). Gageons que Bernanos, s'il a lu ces lignes, a dû par avance sourire de s'exposer aux imprécations d'un mort aussi intraitable que Darien (lequel quitta cette terre en 1921, cinq années avant que l'écrivain ne publie son premier roman, Sous le soleil de Satan), lorsqu'il écrivit sa Grande Peur des bien-pensants, qui veille à séparer la pauvreté de la misère qui est, affirme le grand romancier, une pauvreté devenue folle.
Comme tous les grands textes, La Belle France est essentiellement prophétique. Non pas qu'il annonce l'avenir, ce qu'il fait aussi cependant, mais parce qu'il commence, d'abord, par montrer quelle est la nature réelle du sol qui se trouve sous nos pieds : il n'y a là qu'une apparence de stabilité, car tout est friable, tout particulièrement la terre de France, qui d'ailleurs n'a pas de sol, puisqu'une baudruche (un mauvais rêve, dira Bernanos) ne saurait avoir quelque consistance que ce soit, sinon celle que veulent à tout prix lui donner les gonfleurs de baudruches. La France est un pays de vaincus c'est entendu. Mieux : elle est essentiellement le pays où les vaincus passent pour des victorieux : «Si vous voulez avoir droit au respect de tous, en France, commencez par vous faire battre» (p. 16). C'est ainsi que le «glorieux vaincu, voyez-vous, le seul, le vrai», est celui qui est «fier d'être vaincu», car «on lui dit qu'il a raison d'être fier», puisque «vaincu il est, vaincu il veut être, et vaincu il restera» (p. 17).
Le régime de l'imposture, nous le savons au moins depuis la lecture du deuxième grand roman de Georges Bernanos, est d'autant plus strict que les apparences extérieures sont impeccablement conservées. Un prêtre peut perdre la foi sans que le plus petit frémissement ne trahisse son tourment intérieur, scellé aux yeux de tous. Un peuple de vaincus comme l'est celui de la France doit donc veiller avec un soin jaloux à montrer qu'il ne l'est pas, et même à témoigner, aux yeux du reste du monde, qu'il est un peuple victorieux, plus victorieux qu'une armée de myrmidons gonflés aux hormones patriotiques : «Des monuments commémoratifs ! La France en est couverte; le sol gémit sous le poids de ces édifices d'ostentation et de mensonge. Jamais un peuple n'avait demandé à la pierre ou au bronze de lui fournir tant de preuves palpables de sa dégradation, tant de témoignages de son abaissement» (pp. 19-20), écrit ainsi Darien, qui complète sa sentence par ces mots et une date, fameuse, clouant le paon français sur la glace déformante de sa ridicule prétention : «Il est triste de voir une nation chercher à se mentir à elle-même; à duper, par l'exposé de convictions factices, ses sentiments réels; à se repaître d'illusions et d'impostures. Pas une fois, depuis 1870, la France n'a agi en nation sûre d'elle-même, consciente de sa valeur et de sa force. La noble blessée dont parlait Thiers est devenue une infirme sans noblesse. Et ce qu'il y a de plus entier chez l'infirme, c'est l'orgueil creux, la vanité» (p. 22). S'il semble donc clair pour l'écrivain que «la défaite trempe le caractère d'une nation; ou le brise» (p. 28), nous ne pouvons douter que la France soit un pays de pleutres gouvernés par des imbéciles, ribambelle d'enfants humiliés interchangeables contre lesquels Darien ne semble jamais avoir de mots assez durs, lui qui pourtant en regorge, d'une violence contrôlée infiniment plus convaincante et surtout puissante que les logorrhées du Céline pamphlétaire : «Le sens moral, qui est le sens de l'action, leur manque. Ils ne savent plus ce que c'est qu'un acte; ils en sont aux agissements. Et l'on dirait que la seule chose entière qui reste en eux, c'est cette rage interne, cachée dans les plus noirs replis de l'amour-propre, qui soulève en secret l'être ignorant, pusillanime et pervers contre tout ce qui vaut mieux que lui» (ibid.).
Finis Galliae, expression qu'emploie Darien (cf. p. 39), ou encore la France brisée, pourrait assez bien convenir comme sous-titre de son ouvrage, dont l'objet, nous apprend-il, est de montrer que les causes qui selon Helvétius produisaient en 1771 la décadence de la France sont «encore en existence» (p. 38). Je ne suis pas certain que Darien reprenne à son compte les raisons avancées par Helvétius, tout bonnement parce que le premier ne manque pas d'explications (le patriotisme, défini comme «l'hystérique désir d'une revanche impossible», p. 44, la Réaction englobant l'Armée et l’Église, «la pieuvre militaire et le vampire catholique», p. 64, etc.) venant au secours de son terrible constat, dont il a pris l'exacte mesure et qu'il a décidé de peindre dans une fresque immense, qui ne pourra que dessiller les yeux des badauds et qui, bien sûr, comptons sur les journalistes, sera précipitamment recouverte d'un voile pudique. Qu'importe la lâcheté des lâches puisque, quoi qu'il en soit, le mot d'ordre reste le même : il ne faut point fuir devant l'imposture, mais la crever.
Et, pour la crever, il faut être un écrivain, car lui seul, s'il n'est évidemment point un bonimenteur, saura dégonfler l'enflure des mots, et leur redonner le sens qu'ils n'ont perdu qu'à cause d'une manipulation de prestidigitateur. Pamphlet au carré voire au cube, pamphlet des pamphlets pour le coup, La Belle France est une critique radicale contre ce que j'ai appelé les langages viciés, et que Darien résume par une image remarquable, parlant de ces êtres «dont l'âme est un larynx» (p. 62) : «Mais, s'ils ne donnent pas l'exemple du patriotisme, ils le prêchent. De quelque parti qu'ils se réclament, leurs sermons et leurs homélies ne varient guère. C'est toujours le même couplet sur le merveilleux relèvement de la France, et le même refrain sur la revanche nécessaire que l'avenir tient en réserve; toujours les mêmes déclamations farcies de sous-entendus d'allure menaçante et de lieux communs hors d'usage; toujours les mêmes invitations à l'union, à la concorde, à l'oubli des querelles et des dissensions» (p. 48).
Il faudrait citer intégralement des dizaines de passages de ce livre prodigieux, qui annonce bien des colères, et peut-être même des haines littéraires futures, bien que l'objet n'en soit pas forcément le même, mais il n'en reste pas moins que La Belle France vaut d'abord pour le constat imparable et magistral posé sur un pays spectral : «Les yeux fixés sur un mirage qui sans cesse se recule, disparaît, et ne reparaît que pour s'évanouir encore, [la France] semble vivre dans une atmosphère étouffante et viciée qui enlève jusqu'à la possibilité même des compréhensions nettes et jusqu'au désir de l'énergie. On dirait que sur cette nation, la pénétrant par tous ses pores, plane l'odeur suffocante et putride de la défaite, pareille à un cadavre mal enfoui que la terre rejette, boursouflé et pourri, et dont les miasmes pestilentiels viennent empoisonner les vivants» (p. 52).
Toujours, la France se caractérise selon Georges Darien par son rêve de grandeur, que la réalité, sordide, dément à chaque seconde. Il suffit pourtant d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, mais comment se fait-il que Darien hurle dans le désert ? C'est que personne ne veut voir la réalité, bien sûr, si confortable pour tous les Assis qui font leur beurre et reluquent en prime les fesses grasses de la fermière, que Darien traite plaisamment de «pourfendeurs ataxiques», composant une «cohue de janissaires gâteux» (p. 61) ! : «Il aurait fallu faire un effort; il aurait fallu ne pas avoir peur. Et au lieu de se laisser confronter par la réalité de sa Défaite, elle a préféré rester face à face avec les fantômes vermoulus de ses Victoires mortes et le spectre imposteur de sa Victoire future» (pp. 57-8). La place de la France est donc inexistante, son passé étant faux, de même que son avenir, une nation ne pouvant vivre dans le seul présent de l'immanence radicale, privée de racines et de canopée.
Que faudrait-il donc, pour se débarrasser de cette «coalition d'assassins et de matassins, de faux-bonshommes et de fausses-couches» (p. 65), que faudrait-il faire pour envoyer dans son trou le «fougueux Jules Lemaître» qui, «dès qu'on allume les becs de gaz, baisse sa visière de combat sur ses paupières qui battent la chamade», ou pour évacuer le «bouillant Coppée» qui, «lorsque sa sœur a versé dans la camomille matutinale trois gouttes de la liqueur des braves, met des éperons à ses pantoufles» (p. 67) ? Il faudrait ne pas craindre d'utiliser charitablement ce que Georges Darien appelle le «Rasoir national» (p. 354), la Révolution bien sûr, à condition de s'entendre, nous le verrons, sur ce terme, «panier de son» dans lequel la France molle, liquéfiée, la France simulacre, dupliquée «laissera couler ses dernières baves» (p. 65) bien davantage que sa tête, qu'elle a perdue depuis des lustres. La Révolution, selon Darien, est «la seule attaque possible à la France», alors que «la défense nationale n'est qu'une farce ridicule» (p. 181), car elle permettra de faire advenir, face à «la France des Nationalistes, c'est-à-dire la France de Rome», «la France des Protestants, des Intellectuels et des Cosmopolites» (p. 268), bien que nous ne pensions pas qu'en employant le terme «Intellectuels», Georges Darien ait pu un instant imaginer ce qu'il adviendrait de cette caste de mandarins à tête hydropique. Ce n'est pas tant son don de prescience qui a des limites : c'est plutôt l'abaissement de notre époque qui n'en a point. Il est assez étonnant, du reste, de constater de quelle liberté intellectuelle jouissait Darien qui, de nos jours, passerait pour un furieux anarchiste : drôle d'anarchiste, qui peut affirmer que le plus féroce des patriotes est aussi le plus ouvert aux autres peuples ! Drôle d'anarchiste que celui qui voue aux gémonies l'Armée, accusée non point de se battre mais de conserver comme une mère son nourrisson la paix sociale (cf. p. 181), autrement dit l'exploitation des pauvres par les riches, avec la bénédiction de l’Église !
Quoi qu'il en soit, il est après tout logique, sinon normal, qu'un pays qui se paie de mots, qui «se contente de chimères et ne demande pas autre chose» (p. 194) crève par la maladie qui affecte ces derniers : «Des mots, des mots, des phrases sonores, des déclamations pompeuses et vides» (p. 69), et il est normal, mais aussi logique, que le Français, «à cheval sur les principes, à genoux devant les traditions, et à plat ventre devant ceux que n'effrayent ni ses moulinets ni ses fanfaronnades» (p. 75), n'ait plus aucune envie d'aucune sorte, si ce n'est celle d'adhérer avec le plus de ferveur possible au mensonge généralisé, tout comme la France, qui est «toujours belle, comme autrefois, au grand soleil de messidor», a pourtant «cessé d'être grosse» : «Le
06/01/2017 | Lien permanent

























































