Rechercher : francis moury george romero
Révolution 2 : Révolution et contre-révolution romaines, par Francis Moury

 Rappel
RappelRévolution 1 : Révolution et contre-révolution nationales-socialistes, ici.
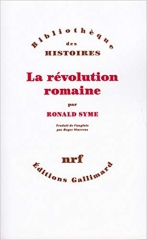 Note de lecture sur Ronald Syme, La Révolution romaine (1939-1951, traduction, 1967, par Roger Stuveras, nouvelle édition Gallimard, coll. NRF-Bibliothèque des histoires, novembre 2016, 670 pages environ). Acheter ce livre sur Amazon.
Note de lecture sur Ronald Syme, La Révolution romaine (1939-1951, traduction, 1967, par Roger Stuveras, nouvelle édition Gallimard, coll. NRF-Bibliothèque des histoires, novembre 2016, 670 pages environ). Acheter ce livre sur Amazon.«καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει»
Pour se justifier, ils changèrent la valeur habituelle des mots par rapport aux actes qu'ils qualifient.
Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, III, 82.
«Vetus ac jam pridem insita mortalibus potentiae cupido cum imperii magnitudine adolevit erupitque.».
L'antique soif de puissance, depuis longtemps innée au cœur des mortels, a grandi et fait explosion avec l'expansion de notre empire.
Tacite / Publius Cornélius Tacitus, Histoires, II, 38.
«C'est un ordre des Dieux qui jamais ne se rompt,
De nous vendre un peu cher les grands biens qu'ils nous font.».
Pierre Corneille, Cinna (1639-1643), II, 1, 559-560.
«Ce n'est pas la fortune qui domine le monde. On peut le demander aux Romains, qui eurent une suite continuelle de prospérités quand ils se gouvernèrent sur un certain plan et une suite non interrompue de revers lorsqu'ils se conduisirent sur un autre. Il y a des causes générales, soit morales, soit physiques qui agissent dans chaque monarchie, l'élèvent, la maintiennent, ou la précipitent; tous les accidents sont soumis à ces causes; et, si le hasard d'une bataille, c'est-à-dire une cause particulière, a ruiné un État, il y avait une cause générale qui faisait que cet État devait périr par une seule bataille : en un mot, l'allure principale entraîne avec elle tous les accidents particuliers.»
Charles-Louis de la Brède, baron de Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains (1734), §XVIII.
«À Rome, malgré toutes les pseudo-révolutions, la grande crise, profonde et radicale, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de la masse, fut toujours évitée».
Jacob Burckhardt, Considérations sur l'histoire du monde (1868 + cours et articles posthumes édités en 1905), version française de S. Stelling-Michaud, § IV (éditions PUF 1938, pp. 161-163).
«Restait le choix des moyens à employer. Ici encore les faits, ces créateurs tout puissants d'histoire, répondaient avec une clarté aveuglante. Au cours du dernier siècle de la République, patrie et régime se sont révélés choses inconciliables. En pareil cas, hésiter serait un crime. Une seule solution : le pouvoir personnel, devenu une nécessité pour le monde romain. Mais aussi – seconde leçon des réalités – impossibilité de la formule monarchique telle que César l'avait concue.et sur laquelle, pour le moment du moins, l'expérience venait de prononcer une sentence sans appel».
Léon Homo, Nouvelle histoire romaine, III L'Apogée, § 1 Auguste le fondateur (éditions Librairie Arthème Fayard, 1941 retirage 1958, p. 294).
Peut-on poser aux historiens grecs et romains antiques des questions qu'ils ne se sont pas posées ? Des questions concernant plus particulièrement la période-charnière allant des années 60 avant Jésus-Christ à 15 après Jésus-Christ ? Période-charnière car en 61 avant Jésus-Christ, Caius Julius Caesar, Cnaeus Pompeius Magnus et Marcus Licinius Crassus forment le premier triumvirat. En 14 après Jésus-Christ, l'empereur Auguste meurt et il est divinisé : l'empereur Tibère lui succède. Les contemporains ont commenté les conditions de cette chute de la République romaine et de la naissance de l'Empire romain. Nous savons, autant par ce qu'ils nous en ont raconté que par la manière dont ils nous l'ont raconté, qu'ils croyaient à la liberté mais ne croyaient pas au progrès, encore moins à la démocratie qui était pour eux le pire des régimes et l'antithèse même de l'idée de République. L'histoire de la civilisation était, à leurs yeux, soit l'histoire d'une décadence, soit celle de cycles de constructions puis de destructions vouées à se reproduire sans raison ou sous la seule raison d'un destin obscur, d'une nécessité de fer (1).
Octavius, futur Auguste (petit-fils de Julia, une des sœurs de César), lorsqu'il prit illégalement le pouvoir par les armes (une armée privée payée par sa fortune personnelle et celle de ses associés et partisans) pour venger décidément la mort de César (15 mars 44 avant Jésus-Christ), instaura sans réflexion théorique préalable, simplement à partir de la situation contemporaine révolutionnaire qu'il analysa correctement, l'ordre nouveau du Principat qui devait déboucher sur l'empire romain et sur la puissance mondiale inégalée de la dynastie julio-claudienne. Auguste devint donc auteur d'une révolution qui renversa définitivement la République romaine puis auteur d'une contre-révolution consciente dont Virgile, Horace, Tibulle, Properce, Ovide, Tite-Live furent les témoins voire les contributeurs à divers degrés; Ovide le fut jusqu'en 8 avant Jésus-Christ, date de son ordre exil reçu d'Auguste, exil qui fut maintenu par Tibère. Les effets sociologiques de cette contre-révolution furent une restauration morale, une extension du nationalisme (romain puis italien puis impérial : Syme montre que le changement d'échelle ne fut pas géographique mais politique), une renaissance religieuse, certes déjà amorcée, concernant cette dernière, au temps de la République dès l'époque de Cicéron (2). Elle fut appuyée par des groupes sociaux et des individus aux intérêts momentanément convergents mais ses effets durèrent bien au-delà d'eux : l'idéal politique antique hellénistique puis l'idéal médiéval occidental s'inspirent de l'empire augustéen; certains aspects de notre histoire moderne et contemporaine lui empruntent également certains traits.
C'est ce résultat inédit d'une contingence absolue et que rien ne laissait prévoir (Auguste, d'apparence fragile, vécut bien plus longtemps qu'on aurait pu s'y attendre alors qu'aucun de ses enfants ne devint empereur tandis que l'attitude des «nobiles» à son égard était imprévisible et demeura fluctuante : il y eut les ralliés, les neutres et les hostiles au sein d'une même famille ou parfois au sein d'une même vie individuelle) que peint Ronald Syme dans cet ouvrage monumental désormais classique paru en 1939, en édition revue et corrigée par l'auteur en 1951, puis en traduction française en 1967 et enfin dans cette nouvelle édition 2016. Il y a une certaine ironie historique dans ces dates : l'histoire adresse de ces clins d'oeil aux historiens. Une édition originale parue au début de la Seconde guerre mondiale, une traduction française parue au début des événements de 1968. Cette réédition 2016 (dont je donne ici la chronique – que le lecteur patient veuille bien me pardonner le délai écoulé entre la parution et la chronique - avec trois ans de retard, en cette fin d'été 2019) sera lue par une génération peut-être plus désabusée et moins naïve que ne le furent certaines générations du siècle passé.
Sir Ronald Syme (1903-1989) peut être considéré comme le Tacite anglais, en tout cas comme le plus grand historien anglais de l'antiquité romaine depuis Edward Gibbon (3). Tout comme Gibbon, Syme est pessimiste et il brosse, tout comme Tacite, l'inéluctable chute des nobles familles romaines, chute corollaire de celle de la République romaine remplacée par le Principat d'Auguste, principat lui-même progressivement transformé en règne impérial dynastique. C'est que ses modèles historiographiques le sont aussi : ils n'ont pas la naïveté démocratique de nos historiens français de la seconde moitié du vingtième siècle. Syme a pour maîtres grecs Thucydide et Dion Cassius, pour maîtres romains Salluste, Asinius Pollion, Suétone et Tacite. Les remarques de Syme sur leur style me semblent confirmer qu'il partage leur vision du monde, outre le fait qu'il les cite également pour critiquer, avec une précision et une sévérité inégalées, les autres sources grecques et romaines, à commencer par Velleius Paterculus (l'historien officiel de Tibère) mais aussi les sources littéraires augustéennes classiques telles que Virgile, Horace et Tite-Live. Il s'appuie pour cela non seulement sur une connaissance magistrale des lettres grecques et latines mais encore sur celle de la Prosopographia Imperii Romani (première édition à Berlin en 1897-1898) ainsi que sur celle des généalogies des familles nobles qui furent, depuis les Rois romains les plus anciens jusqu'à la République puis à l'Empire, le constant arrière-plan actif de l'histoire romaine antique.
Syme rejette la tradition historienne démocratique moderne qui considère la théorie politique cicéronienne comme la source théorique de l'action politique de César Auguste («Octavius» puis «Caesar Augustus» puis «Divus Julius Augustus») :
«Les savants, attentifs à scruter l'histoire des idées et des institutions, ont prétendu qu'environ quinze ans après sa mort revivait beaucoup plus que le souvenir et l'éloquence de Cicéron; toute sa conception de l'État romain triomphait après sa mort, en prenant forme et consistance dans la République nouvelle de César Auguste.
Ce serait une consolation si c'était vrai» (p. 303).
Les pages suivantes démontrent avec une sombre ironie, alternativement tendue et tragique, d'une sobriété ramassée héritée directement de Tacite, en quoi César Auguste n'adopta précisément pas la théorie cicéronienne du principat, en dépit d'une rencontre sémantique de surface. Syme traque les choses derrière les mots : il ne se paye jamais de mots. Le spinoziste Charles Appuhn pouvait encore s'y laisser prendre dans son édition-traduction du De Republica de Cicéron (4) en remarquant que ce dernier usait du terme princeps civitatis, repris par Auguste quelques années plus tard. Cicéron (bon connaisseur de l'histoire et des lettres grecques) se souvenait de Périclès mais il n'imaginait pas encore ce que serait la réalité du règne impérial d'Auguste qu'il crut bon de soutenir contre Antonius qui avait pourtant la légalité de son côté. Ce défaut de prévision devait abaisser son cou sous le couteau des assassins, quelques années plus tard (le 7 décembre 43 avant Jésus-Christ).
Vers 1960, la myopie française est toujours de mise. Claude Nicolet et Alain Michel connaissent certes, en 1961, l'existence du livre de Syme et ils savent que l'augmentation des connaissances en histoire politique, amène le professeur d'Oxford à une révision du rôle politique de Cicéron tout comme à une révision de sa position historique mais ils maintiennent pourtant in extremis la thèse traditionnelle française (dont ils fournissent une bibliographie détaillée de 1920 à 1960) de la préparation théorique du principat d'Auguste par les thèses politiques de Cicéron (5). Il faut dire que, à droite, au centre comme à gauche, l'université française demeurait fascinée par le déterminisme du dix-huitième siècle. Louis Althusser (6) et Raymond Aron (7) en créditaient presque simultanément Montesquieu, celui des Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains autant que celui de L'Esprit des lois mais la conception des lois de Montesquieu ne pouvait pourtant guère permettre de comprendre celle de Cicéron : pour celui-ci, les lois sont des commandements divins intangibles fondés sur la nature des choses; pour celui-là, elles sont des rapports observables entre des variables contingentes.
Toutes ces illusions françaises sont balayées d'un revers de main autant par Tacite que par Syme lecteur de Tacite qui s'avère capable de replacer l'œuvre de Tacite lui-même dans l'histoire politique et psychologique de l'empire postérieur à celui d'Auguste. La mort, la folie, la décadence ont accompagné ouvertement ou secrètement le Principat d'Auguste et ceux de ses successeurs julio-claudiens mais il n'y avait pas de fatalité structurelle ni de loi structurelle à l'œuvre dans cette histoire : la fortune, le destin, la contingence, ont joué leur rôle. Cette structure politico-juridique du Principat s'est maintenue pendant des siècles parce qu'elle apportait à la société romaine la paix et l'ordre (Pax et Princeps, voir Syme, §XXXIII) après des dizaines d'années de combats et de guerres civiles dévastatrices pour l'Occident, le Proche-Orient et l'Afrique mais dévastatrices d'abord pour Rome et pour l'Italie puisque des populations entières de villes importantes furent décimées dans des conditions de cruauté aujourd'hui inimaginables. Elle naquit et se maintint avec l'accord (parfois partiel... c'est toute la science historique de Syme de déterminer précisément ce degré de partialité à l'aide des sources) parfois suicidaire des familles nobles les plus puissantes du temps des anciens rois et de l'ancienne république (ceux auxquels était réservé par défaut le consulat), avec le concours moins suicidaire des chevaliers et des «hommes nouveaux». Les fonctions conservaient les mêmes noms : il y avait toujours des consuls, des tribuns, des préteurs, des fonctionnaires de rang varié mais les «hommes nouveaux» du régime montèrent avec lui puis disparurent sans laisser de postérité politique ni dynastique, surtout lorsqu'ils effleuraient les plus hautes couches de la société, celles dont la fréquentation était la plus dangereuse. À mesure qu'on se rapprochait physiquement et professionnellement des cercles du pouvoir, on risquait automatiquement davantage sa vie et ses biens : procès, accusations de trahison, jalousie, meurtres, exécutions, relégation décimèrent régulièrement les premiers cercles. Le pouvoir personnel dynastique des grandes familles romaines fut progressivement neutralisé par le pouvoir impérial : des individualités d'élite, il ne demeura bientôt plus qu'un souvenir fasciné.
Pourquoi le Principat naquit-il, pourquoi disparut-il ? Répondre à ces questions, c'est souvent en France choisir une philosophie de l'histoire voire même une attitude politique. Pas en Angleterre : la réponse de Gibbon à la seconde question est, par exemple, bien connue. Il pensait que le régime impérial romain disparut à cause du christianisme, facteur de rénovation politique. Cette réponse tranchée n'a rien d'évident : les empereurs devenus chrétiens, tout demeurait possible : saint Augustin n'était pas si catégorique concernant une incompatibilité structurelle entre politique romaine et religion. Les historiens romains antiques païens ne l'étaient pas non plus : Syme restitue leur ancien point de vue. Il s'attache d'abord aux historiens-témoins actifs et plaideurs pro-domo de la génération républicaine qui connut les guerres civiles : Salluste, Cicéron, César. Il se tourne ensuite vers les lettres latines du Principat d'Auguste (propagande de Tite-Live et Virgile) puis de Tibère (histoire de Vellieus Paterculus) et vers l'histoire antique postérieure. Les faits non rapportés, les noms oubliés, les compliments adressés ou non par un Horace parlent ainsi autant, grâce à Syme, que les faits rapportés et les noms cités par les autres. Ce qui amène Syme à reconstituer la réalité des rapports de force au prix d'un travail précis, restituant aussi archéologiquement l'histoire secrète (oubliée ou cachée par la propagande impériale) des familles et des alliances au moyen des inscriptions et des monuments. L'histoire antique, en tant que science visant la vérité, redevient bientôt grecque (Plutarque, Dion Cassius) – éloignés de Rome, ils peuvent s'exprimer plus librement - avant qu'elle ne redevienne plus tard romaine bien après le Principat d'Auguste, sous des empereurs plus libéraux : Suétone et Tacite sont alors libres d'écrire la vérité sur les guerres civiles républicaine et sur l'histoire de l'empire julio-claudien.
Parlant des époques dont ils ont choisi de parler, ces historiens romains (sans oublier les témoins actifs tels que Sénèque le philosophe stoïcien qui fut conseiller politique de Caligula puis de Néron mais rapporte à l'occasion des anecdotes du temps d'Auguste) parlent inévitablement d'eux. En examinant leurs textes Syme répond, par le biais de l'analyse littéraire et politique des œuvres de Salluste, de Cicéron, de César, de Virgile, de Tite-Live, d'Horace, de Sénèque, de Suétone et de Tacite, à la question philosophique initiale, celle du rapport de l'historien à l'histoire : poser des questions qu'elle ne s'est pas posée à une époque semble possible puisque, de facto, chaque époque procéda ainsi. Il y a une transcendance de chaque époque, une objectivité de chaque époque mais cette transcendance et cette objectivité font sens parce qu'elles nous font signe par-dessus, par-delà leurs propres limites temporelles. Ce qui leur permet de dialoguer, par l'intermédiaire de leurs historiens. On retrouve alors, tout naturellement, cette autre grande question que posait si précisément et si clairement Henri Gouhier : peut-on poser non seulement à une histoire mais encore à une philosophie (y compris à une philosophie de l'histoire) les questions qu'elle ne s'est pas posées ? (8)
Chaque époque comporte certes des écrivains qu'aucun régime n'explique et que l'historien ne peut circonscrire tant leur individualité est puissante : telles paraissent les puissantes personnalités de Salluste, de Lucrèce («[...] un solitaire dont la personnalité pose une énigme [...]», écrit Syme page 241), d'Asinius Pollion, de Tacite. Le cas de Tacite est celui d'un fonctionnaire impérial consciencieux qui demeure fasciné par la noblesse républicaine antique. L'histoire que Tacite écrit (notamment sa dernière œuvre, les Annales), veut établir et comprendre les causes de sa disparition : les pages que lui consacrent Syme comptent parmi les plus riches du livre. Syme insiste par ailleurs sur le fait que la fidélité familiale et les liens d'amitiés et de clientèle l'emportent régulièrement sur les liens administratifs ou militaires qu'ils contrebalancent voire subvertissent parfois. La politique d'Auguste fut non moins ambivalente à cet égard que celle de ses prédécesseurs et celle de ses successeurs. Au lecteur de Syme comme à celui de Tacite, Corneille apparaît donc, rétrospectivement, comme ayant bien restitué l'esprit politique et psychologique des Ro
17/12/2019 | Lien permanent
Actualité et inactualité du Disciple de Paul Bourget, par Francis Moury

«Il y a si peu de personnes à qui Dieu se fasse paraître par ces coups extraordinaires, qu'on doit bien profiter de ces occasions, puisqu'il ne sort du secret de la nature qui le couvre que pour exciter notre foi à le servir avec d'autant plus d'ardeur que nous le connaissons avec plus de certitude».
Pascal, extrait d'une Lettre à mademoiselle de Roannez (fin octobre 1656), in Pensées et Opuscules (Éditions Hachette, introduction, notice et notes par Léon Brunschvicg, tirage revu par Geneviève [Rodis]-Lewis & Didier Anzieu, 1978), p. 214.
«Plusieurs critiques m'ont fait l'honneur de réfuter la méthode employée dans les morceaux qu'on va lire. C'est cette méthode que je voudrais expliquer et justifier ici. La voici en quelques mots : si l'on décompose un personnage, une littérature, un siècle, une civilisation, bref, un groupe naturel quelconque d'événements humains, on trouvera que toutes ses parties dépendent les unes des autres comme les organes d'une plante ou d'un animal».
Hippolyte Taine, Essais de critique et d'histoire (Éditions Hachette 1858, treizième tirage 1920), Préface de la première édition, p. III.
«La Science d'aujourd'hui, la sincère, la modeste, reconnaît qu'au terme de son analyse s'étend le domaine de l'Inconnaissable. Le vieux Littré, qui fut un saint, a magnifiquement parlé de cet océan de mystère qui bat notre rivage, que nous voyons devant nous, réel, et pour lequel nous n'avons ni barque ni voile. A ceux qui te diront que derrière cet océan il y a le vide, l'abîme du noir et de la mort, aie le courage de répondre : «Vous ne le savez pas...» Et puisque tu sais, puisque tu éprouves qu'une âme est en toi, travaille à ce que cette âme ne meure pas en toi avant toi-même. ― Je te le jure, mon enfant, la France a besoin que tu penses cela, et puisse ce livre t'aider à le penser».
Paul Bourget, Le Disciple (Éditions Alphonse Lemerre 1890), Préface, p. XI.
«Depuis cinquante ou soixante ans, on a pour elle un culte. Elle est une idole. Lisez Auguste Comte, Littré, Taine et Renan. Ils la montrent expliquant ce que la religion chrétienne n'avait pu expliquer et, par conséquent, supplantant la religion chrétienne et se substituant à elle».
Ferdinand Brunetière, L'Évolution du concept de science (1899), repris in Discours de combat – dernière série (Éditions Perrin, 1907), p. 246.
Lorsque Paul Bourget, le 5 juin 1889, mit un point final à la Préface de son roman Le Disciple, il prévoyait certainement que le sujet qu'il traitait allait se trouver, en raison de sa puissance structurelle, au cœur d'une controverse morale, politique et philosophique qui aura traversé tout le vingtième siècle et qui se poursuit encore aujourd'hui : celle concernant la responsabilité des intellectuels.
De quoi s'agissait-il dans le roman ?
Le modeste lycéen clermontois Robert Greslou, qui redouble sa terminale afin de pouvoir préparer le concours de l'Ecole Normale d'instituteurs, est un disciple du philosophe Adrien Sixte. Greslou décide, en toute connaissance de cause et en s'appuyant sur des extraits connus par coeur des trois traités signés par Sixte (Psychologie de Dieu, Anatomie de la volonté, Théorie des passions), de prendre pour sujet d'une expérience psychologique la belle Charlotte de Jussat, du jeune frère de laquelle il est devenu, pour quelques mois, précepteur dans un château isolé du Puy-de-Dôme. Il provoque, autant par bravade sociale que par défi intellectuel, artificiellement et sciemment, son amour. Son jeu d'abord froid et entièrement simulé débouche sur une passion authentique qui provoque le suicide de Charlotte et le procès pour meurtre de Robert. Meurtre qu'il n'a certes pas commis mais suicide dont il est indubitablement la cause motrice, ayant causé le déshonneur d'une vierge, ayant renoncé à la parole qu'il lui avait donnée d'accomplir en sa compagnie un double suicide qui eût permis à Charlotte d'échapper aux dramatiques conséquences sociales et familiales de leur amour interdit. La question centrale du roman n'est pas tant celle de la culpabilité judiciaire de Greslou (question éclaircie par la conclusion du chapitre IV, constituant la dernière section du journal de Greslou transmis par sa mère à Sixte avant que son procès n'ait lieu) que celle de savoir si Adrien Sixte est, au fond, responsable de la conduite non seulement immorale mais criminelle de son disciple ?
La réponse de Bourget est finalement affirmative mais il a l'intelligence de la faire prononcer intérieurement par Sixte lui-même à la toute dernière page du livre, après bien des péripéties psychologiques et judiciaires et dans des circonstances si tragiques que le souvenir de Pascal (Sixte cite une de ses pensées) ne dépareille nullement l'atmosphère de conversion authentique, dramatique, qui saisit autant ce curieux anti-héros (1) que le lecteur. C'est que le fictif Sixte vient intellectuellement de loin, même de très loin : les maîtres avoués de cet «abstracteur de quintessence» (Rabelais, cité avec humour par Bourget page 8) sont Lucrèce, Spinoza, Emmanuel Kant, Stuart Mill, Taine, Théodule Ribot. L'auteur divise cependant plus précisément les maîtres de Sixte en trois catégories qui permettent de mieux situer son livre dans l'histoire de la philosophie.
D'abord Sixte est kantien mais un kantien mutilé, amputé : «Avec l'école critique issue de Kant, l'auteur de ces trois traités [Sixte] admet que l'esprit est impuissant à connaître des causes et des substances, et qu'il doit seulement coordonner des phénomènes» (p. 19).
Il faut noter ici que Sixte procède à une ablation importante du kantisme puisqu'il résume sommairement la Critique de la Raison pure en faisant totalement abstraction des deux critiques postérieures, à savoir la Critique de la Raison pratique et la Critique du Jugement que le néo-kantisme allemand exploitera dans un sens positiviste et parfois positiviste spiritualiste. Certains post-kantiens idéalistes, notamment F.W.J. von Schelling et G.W.F. Hegel, en avaient déjà tiré quelques conclusions allant dans le même sens. Il est vrai que Bourget lui-même s'était rendu coupable d'une semblable réduction dans une séance à l'Académie du 30 novembre 1906. Il y avait dit :
«Le bien et le mal ont imposé leur évidence à ce philosophe sincère [Taine] comme jadis à ce Kant dont le nihilisme radical s'est transformé en un dogmatisme absolu, rien qu'à constater le mystère de cette réalité indiscutable : la conscience se soumettant à la loi» (2).
Bourget est moins excusable que son héros Greslou car en 1906, les deux dernières critiques kantiennes sont lues à l'université française. Jules Lachelier dans Du Fondement de l'induction (1871) puis Émile Boutroux dans ses célèbres cours de la Sorbonne de 1896-1897 sur La Philosophie de Kant (3) les mettent réellement en lumière dans ce cadre universitaire (cadre auquel Greslou n'a jamais accédé et auquel il était alors infiniment plus difficile d'accéder qu'aujourd'hui) avec précisément pour but de ne pas réduire Kant à une partielle analyse desséchante et desséchée des conditions de la connaissance. La non moins célèbre thèse de Victor Delbos sur La Philosophie pratique de Kant (1905) parachevait ce tableau bien plus complet et compréhensif du kantisme. À rebours de ce que pensait Bourget, on pouvait donc utiliser Kant contre un désuet scientisme athée hérité du dix-huitième siècle, pour un moderne positivisme spiritualiste qui fut précisément celui de Ravaisson, de Lachelier, de Boutroux, de Bergson. Positivisme spiritualiste dont ils sont les héritiers métaphysiques par un fil rouge courant d'Aristote à Maine de Biran, via Descartes. Delbos y ajoute la connaissance théologique affinée du protestantisme du dix-huitième siècle qui seul éclaire réellement la morale de Kant et sa pensée politique et juridique (4). Cela dit, il serait aussi peu opportun de critiquer Bourget pour sa lecture erronée de Kant que de critiquer Taine pour sa lecture partielle et erronée de Hegel : il faut bien savoir qu'on ne les lisait, à cette époque, souvent pas autrement et qu'il en existait encore d'autres lectures parfois moins fautives mais parfois tout autant, n'en retenant qu'un aspect au détriment du restant. L'histoire de la philosophie ne nous les restitue dans leur intégralité et dans leur vérité qu'au vingtième siècle, pour des raisons d'abord matérielles. Les éditions critiques de Kant et de Hegel existent en Allemagne mais ne sont pas traduites en France dans leur intégralité : le dix-neuvième siècle français n'a donc, germanistes mis à part, qu'une connaissance assez fragmentaire de leurs œuvres.
Ensuite, Adrien Sixte est un disciple de Taine, de Spencer et de Théodule Ribot (p. 19) dans la mesure où il considère que l'esprit est passible d'une étude scientifique qui le décompose en éléments naturels, tout comme un composé chimique peut être décomposé en ses éléments constitutifs. Ce vague scientisme qui les unit et les relie, lui semble aboutir à la philosophie contemporaine de Spencer mais, à la différence de Herbert Spencer — et cette différence est fondamentale — Sixte ne considère pas l'Inconnaissable comme une réalité (ce qui permettrait métaphysiquement une réconciliation de la science avec la religion puisque l'Inconnaissable étant réel, de cette réalité une autre réalité, pour sa part connaissable, peut procéder : par exemple notre esprit, par exemple notre âme elle-même si le concept d'âme est psychologiquement sauvegardé donc théologiquement sauvegardé aussi) mais comme la dernière des illusions que la science doit combattre (p. 20) : on mesure ici directement en quoi Henri Bergson pourra, plus tard, se revendiquer des Premiers Principes d'Herbert Spencer puisque la doctrine spencérienne de l'Inconnaissable peut introduire naturellement au positivisme spiritualiste dont Bergson est, comme on le sait, l'héritier direct. On se souvient que les Essais sur les données immédiates de la conscience, la thèse de doctorat du jeune Bergson, était dédiée à Jules Lachelier, donc par ricochet, aux pères spirituels de Lachelier que furent les autres fondateurs du positivisme spiritualiste, à savoir Émile Boutroux et Félix Ravaisson. Ce dernier auquel Bergson, en tant que membre de l'Institut, rendit un vibrant hommage par sa notice nécrologique (5).
Enfin, Sixte est un disciple du déterminisme évolutionniste de Darwin (p. 20) : «appliquant la loi de l'évolution à tous les faits qui constituent le coeur humain, il a prétendu montrer que nos plus raffinées sensations, nos délicatesses morales les plus subtiles, comme nos plus honteuses déchéances, sont l'aboutissement dernier, la métamorphose suprême d'instincts très simples, transformation eux-mêmes des propriétés de la cellule primitive; en sorte que l'univers moral reproduit exactement l'univers physique et que le premier n'est que la conscience douloureuse ou extatique du second» (p. 21).
D'où il déduit plusieurs conséquences sévères : à commencer par celle, majeure, de l'inexistence de la liberté.
«Tout acte n'est qu'une addition : dire qu'il est libre, c'est dire qu'il y a dans un total plus qu'il n'y a dans les éléments additionnés. Cela est aussi absurde en psychologie qu'en arithmétique. [...] Si nous connaissions vraiment la position relative de tous les phénomènes qui constituent l'univers actuel, — nous pourrions, dès à présent, calculer avec une certitude égale à celle des astronomes, le jour, l'heure, la minute où l'Angleterre, par exemple, évacuera les Indes, où l'Europe aura brûlé son dernier morceau de houille, où tel criminel, encore à naître, assassinera son père, où tel poème, encore à concevoir, sera composé. L'avenir tient dans le présent comme toutes les propriétés du triangle tiennent dans sa définition» (pages 21-22).
Sans parler de la non-validité des concepts moraux de bien et de mal, de la non-pertinence du concept de crime, simple réalisation d'un désir que la société ne reconnaît pas (ou ne reconnaît plus ou ne reconnaît pas encore : pages 48 à 52). Ce dernier aspect de la pensée de Sixte n'est pas particulièrement moderne : c'est un vieux thème de la pensée philosophique sceptique grecque antique, diffusé et sans cesse repris par l'histoire des lettres et par celle de la philosophie, y compris chez des écrivains relevant des deux genres : Montaigne et Pascal par exemple (cf. Pascal, Pensée n°294 : «Vérité au deçà des Pyrénées, erreur au-delà»).
Reste que le tableau d'ensemble de cette pensée correspond exactement à ce qu'un esprit cultivé pouvait trouver de désespérant dans la philosophie contemporaine de 1850-1890, à rebours des synthèses romantiques de 1800-1850. La réaction d'esprits tels que Bourget, Brunetière, Renan visait à rétablir un équilibre qu'ils jugeaient rompus par les excès de la pensée se dévorant elle-même et minant ouvertement les fondements de l'ordre social et religieux.
À partir du chapitre IV, les conséquences des théories de Sixte et leur influence presque démoniaque sur l'esprit fragile de Greslou sont détaillées par Greslou lui-même. Il décrit par le menu son entreprise intellectuelle de séduction menée d'une part pour subvertir la hiérarchie sociale à laquelle il est, de facto, soumis au château dont il est précepteur, d'autre part pour prouver son pouvoir sur la créature adorable mais naïve qu'est Charlotte de Jussat. Il y a, assurément, quelque chose de stendhalien et, par certains aspects métapsychologiques (6), aussi de balzacien, dans ce jeune héros qui évoque autant le balzacien Louis Lambert que le stendhalien Julien Sorel (7). Par ricochet, il y a aussi chez lui quelque chose de pré-nietzschéen : Friedrich Nietzsche n'est certes pas encore traduit ni beaucoup lu en France vers 1890 mais son admiration de jeunesse pour les moralistes français classiques (François de La Rochefoucauld, Nicolas de Chamfort, Antoine de Rivarol sans oublier le cardinal de Retz et le duc Louis de Rouvroy de Saint-Simon) coïncide avec son admiration pour Stendhal. De fait, Greslou s'analyse, se dissèque et livre à son maître un récit en forme de journal intime autant balzacien que stendhalien, commenté philosophiquement et psychologiquement. À partir du moment où Greslou tombe véritablement amoureux de Charlotte, toute sa perception des choses se modifie, à mesure qu'il traverse ce qu'il nomme ses «trois crises» successives : sa décision de faire tomber Charlotte amoureuse de lui d'une manière technique, sa constatation que Charlotte l'aime réellement et, enfin, sa jalousie et sa lâcheté qui enclenchent le drame, doublement criminel. Bourget a-t-il emprunté la volonté manifestée par Charlotte d'un double suicide amoureux à la lecture de certains classiques de la littérature japonaise ? On pourrait se poser la question car c'est d'abord du Japon que vient cette pratique : voir par exemple le célèbre film de la Nouvelle vague japonaise Double suicide à Amijima [Shinju : ten no Amijima, 1969] de Masahiro Shinoda, soigneusement adapté d'une pièce de théâtre (1721) de Monzaemon Chikamatsu.
Sixte pleure finalement face au cadavre de Robert. C'est alors qu'il se remémore la formule de Pascal (provenant de la Pensée n°553 titrée Le Mystère de Jésus) dont Léon Brunschvicg écrivait en note de son édition classique qu'elle «défiait tout commentaire». En 1890, on savait d'ailleurs, sans avoir besoin de le mentionner en note comme Brunschvicg le fait, que cette formule pascalienne «Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais [déjà] trouvé», était adaptée d'une sentence antérieure de saint Bernard, De Deo eligendo (publié in Patrologie de Migne, tome CL). Le sens de ce souvenir est, dans la perspective philosophique des années 1890, le suivant : l'intellectuel égaré doit reconnaître son orgueil d'une part, doit accepter de s'abaisser au niveau commun de la foi d'autre part pour être sauvé (8).
Tout cela peut sembler avoir vieilli mais remplaçons, par exemple, la doctrine de Sixte dans Le Disciple par la doctrine marxiste-léniniste et / ou par la doctrine structuraliste (il arrive en effet qu'elles soient alliées chez certains penseurs de la période 1950-1970) qui subvertirent en profondeur l'université française et ses grandes écoles (y compris et surtout l'École Normale Supérieure, durant la période Louis Althusser) de 1930 à 1990 : on mesure l'inaltérable vérité du roman de Bourget. Dans le cas de Althusser, la continuité théorique est d'ailleurs directe puisqu'il avait constitué en 1967 à Normale Sup un Groupe Spinoza, l'un des maîtres revendiqués d'Adrien Sixte ! Bourget avait, au demeurant, parfaitement saisi le fil rouge doctrinal qui pouvait historiquement comme logiquement (9) faire dériver les thèses mécanistes de Sixte (fils d'un horloger, fasciné par les rouages que lui montre son père, ce qui pourrait avoir favorisé son déterminisme) d'une lecture médiocre ou incomplète de Spinoza, tout comme d'une lecture médiocre et incomplète de Kant. Il n'est pas jusqu'à la passion de Sixte pour le grand psychologue français Théodule Ribot qui ne puisse, mutatis mutandis, être prolongée par les tentatives modernes et parfois contemporaines de réduire la pensée à un mécanisme biologique (Henri Piéron en 1923) ou l'être humain à une pure structure, à une machine désirante fondamentalement irresponsable (Deleuze et Guattari en 1972) ou l'histoire de la philosophie elle-même à sa simple section matérialiste et eudémoniste (Michel Onfray en 2004 (10)).
Est-ce à dire que Bourget aurait dépeint, sans que cela soit son objet premier, le mécanisme non seulement de ce qu'on pourrait nommer la foi intellectuelle (en dépit du fait que ces deux termes paraissent antinomiques) mais encore celui de l'embrigadement et de la dépersonnalisation idéologique, donc du fanatisme politique ou religieux et pas seulement intellectuel, mécanisme qui sera si flagrant durant le vingtième siècle ? Peut-être ne faudrait-il pas aller jusqu'à cette interprétation : elle a quelque chose de trop rétroactif. Et puis Lucrèce (De natura rerum, III, 958) aurait ici le dernier mot : le fanatisme (qu'il soit politique ou religieux) est comme le reste, une éternelle répétition : «...eadem sunt omnia semper...».
Il y a pourtant, assurément, quelque chose de dostoïevskien (au premier chef du Dostoïevski auteur de Les Possédés / Les Démons) dans la personnalité du jeune Greslou telle que Bourget l'a décrite. À mesure que Greslou rédige en prison son journal intime —qui occupe tout le chapitre IV soigneusement enchâssé entre deux parties rédigées au contraire en style objectif, chapitres I à III + chapitres V et VI : construction sophistiquée — afin que son maître spirituel (on peut lui conférer ce titre : dans le contexte du roman, il est loin d'être usurpé) puisse établir la nature exacte des faits et celle de sa responsabilité — il note, à plusieurs reprises, un fait pour le coup authentiquement et très r
25/04/2020 | Lien permanent
Heidegger ex cathedra, 5 : Occident, première partie, par Francis Moury

 Heidegger ex cathedra, 1 : religion.
Heidegger ex cathedra, 1 : religion. Heidegger ex cathedra, 2 : philosophie antique.
Heidegger ex cathedra, 2 : philosophie antique.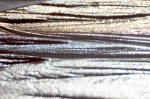 Heidegger ex cathedra, 3 : philosophie moderne et contemporaine.
Heidegger ex cathedra, 3 : philosophie moderne et contemporaine. Heidegger ex cathedra, 4 : l'écrit sur le mal.
Heidegger ex cathedra, 4 : l'écrit sur le mal. Notes de lecture sur : Martin Heidegger, Le Commencement de la philosophie occidentale : interprétation d'Anaximandre et de Parménide (1932, traduction de Guillaume Badoual et François Fédier, éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque de philosophie, coll. Œuvres de Martin Heidegger, 2017).
Notes de lecture sur : Martin Heidegger, Le Commencement de la philosophie occidentale : interprétation d'Anaximandre et de Parménide (1932, traduction de Guillaume Badoual et François Fédier, éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque de philosophie, coll. Œuvres de Martin Heidegger, 2017).«Le non-être était conçu ontologiquement par les Éléates de façon que ce qu'on énonçait sur lui ne valait que dans la contradiction, de façon qu'il n'y a que l'être qui existe. [...] La philosophie moderne n'a guère fait de progrès dans la conception du non-être, et cela malgré qu'on se flatte d'être chrétien.»
Søren Kierkegaard, Le Concept de l'angoisse (1844), chapitre III, note 2 (traduction de Knud Ferlov et J.-J. Gateau, éditions Gallimard-NRF, 1935, reprise dans la coll. Idées, 1969), p. 176.
«Combien, au contraire, ceux qui n'ont pas le sentiment qu'ils sont les citoyens de ce temps ont le droit d'être pleins d'espérances. S'ils étaient de ce temps, ils contribueraient à sa destruction et périraient avec lui, tandis qu'au contraire ils veulent éveiller le temps à une vie nouvelle, pour se perpétuer dans cette vie même.»
Friedrich Nietzsche, Considérations inactuelles – deuxième série (1874-1876) : Schopenhauer éducateur, Richard Wagner à Bayreuth (traduction d’Henri Albert, éditions Mercure de France, 1922), p. 9.
Voici la traduction, en cette fin d'année 2017, du tome 35 de l'édition allemande des œuvres complètes de Martin Heidegger, paru là-bas en décembre 2011. Dans le tableau synoptique publié par l'éditeur allemand V. Klostermann, ce tome 35 se situe dans la seconde partie (leçons universitaires période 1919-1944), section des leçons prononcées à l'Université de Fribourg-en-Brisgau de 1928 à 1944. Sur les 102 volumes de l'édition allemande Klostermann, plus de la moitié est à présent disponible en français. Reste que l'ordre dans lequel l'éditeur allemand a réparti ces 102 volumes demeure discutable : les leçons dispensées à Fribourg-en-Brisgau de 1919 à 1923 sont placées à la suite de celles professées à Marbourg en 1923-1928 et de celles professées à nouveau à Fribourg-en-Brisgau en 1928-1944, ce qui est évidemment, d'un point de vue chronologique, totalement absurde. Je rappelle la division en quatre sections de l'édition intégrale allemande :
I - écrits publiés du vivant de Heidegger (tomes 1 à 16),
II - leçons universitaires 1919-1944 (tomes 17 à 63),
III - textes inédits et conférences (tomes 64 à 80),
IV - archives, notes de séminaires, correspondance (tome 82 à 102). Ni cette division ni cet ordre ne sont adoptés dans la collection NRF dont les tomes ne sont d'ailleurs pas numérotés, ce qui a l'avantage de permettre d'adopter un ordre de rangement strictement chronologique.
Venons-en à présent à ce tome 35 qui rassemble trois séries de leçons prononcées en 1932 à l'université de Fribourg-en-Brisgau.
Il édite un cours de 1932 divisé de la manière suivante : d'abord un cours sur une sentence d'Anaximandre (pp. 13-45), ensuite des considérations intermédiaires sur le rapport philosophique à l'être (pp. 55-134), enfin un cours sur le poème de Parménide (pp. 137-244). À cet ensemble de trois cours, s'ajoutent les utiles annexes habituelles (pp. 245-322) : notes personnelles préparatoires, plans, schémas. Le tome 35 ne fait pas double emploi avec le tome 78 (La Parole d'Anaximandre) car Heidegger concéda par la suite (par exemple dans la section consacrée à Anaximandre de ses Chemins qui ne mènent nulle part) que son interprétation de 1932 avait pu être «l'occasion d'une méprise». Il ne fait pas non plus double emploi avec le tome 54 (Parménide) qui reproduisait une leçon de 1942-1943 entièrement consacrée à Parménide, encore moins avec les cours dispensés sur Parménide à Fribourg en 1915-1916 et à Marbourg en 1922. Car ce cours de 1932 sur Parménide serait, selon l'éditeur allemand, le seul dans lequel Heidegger étudie philologiquement autant que philosophiquement l'intégralité du poème de Parménide. Inutile de dire que cette édition 2017 du texte grec et de sa traduction commentée par Heidegger, marque une date : on pourra dorénavant comparer les similitudes et les différences entre cette édition-traduction et celle de Jean Beaufret éditée en 1955 dans la collection Épiméthée aux P.U.F. Sans oublier de noter que la page de garde de ce cours sur Parménide s'ouvre par une citation intéressante (pour sa philosophie du temps, d'ailleurs proche de celle de Kierkegaard puisque le véritable révélateur de l'être comme du temps est l'angoisse chez Heidegger comme chez Kierkegaard, ce dernier dénonçant avec un siècle d’avance sur Henri Bergson la spatialisation du temps) du poème La Migration de Hölderlin qui annonce l'interprétation de l'être comme essentiellement présent. En marge de cette page de garde, Heidegger, autocritique, avait écrit : «L'interprétation est insuffisante, même si nombre d'aspects sont saisis de manière essentielle». On mesure ainsi son degré d'exigence.
Sur le plan de l'histoire de la philosophie, ces interprétations des Présocratiques par Heidegger s'inscrivaient dans la lignée des interprétations antérieures des Présocratiques par G.W.F. Hegel (cf. p. 131 note 1 le définitif : «Hegel, soit ! mais en allant plus loin ?» et p. 134) et Friedrich Nietzsche (cf. p. 69 et p. 235 mais cette dernière contient une critique de l'interprétation nietzschéenne de Parménide alors que certaines de ses autres interprétations des Présocratiques sont qualifiées par Heidegger de «parfois lumineuses»). Sur le plan de la philologie, Heidegger suit mais rectifie aussi, parfois heureusement (par exemple p. 193), les leçons de l'édition Diels des Fragments des Présocratiques : ainsi (p. 148 alinéa 20) il fournit une excellente raison, à la fois philologique et philosophique, de corriger l'ordre de certains vers interpolés par Diels dans les fragments 4 et 5 du Poème de Parménide, interpolation, précise-t-il, absente des éditions antérieures à celle de Diels et correction, précise-t-il aussi, adoptée par Karl Reinhardt dès 1916 dans son étude sur Parménide et l'histoire de la philosophie grecque. Sur le plan de l'interprétation, elles se placent aussi, dans la seconde partie intermédiaire, chapitre 9, alinéa C, sous le patronage revendiqué de Nietzsche, non seulement celui de La Naissance de la tragédie et de La Naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque (1), mais aussi Nietzsche comme emblème «unique» (p. 69) du destin allemand. Sur le pur plan de l'histoire de la philosophie, Heidegger précise lui-même que la tradition doxographique antique assure que Parménide fut un élève d'Anaximandre : il y aurait donc une cohérence non seulement philosophique mais historique à regrouper ensemble leur étude. Le premier présocratique Thalès de Milet n'ayant laissé aucun écrit, Heidegger s'attache à montrer que les écrits d'Anaximandre et de Parménide initient le commencement de la philosophie en posant tous les deux, l'un brièvement, l'autre d'une manière bien plus ample, la question de l'être. Les réduire à des cosmographes et à des physiologues est, selon lui, une grave erreur d'histoire de la philosophie. Parménide et Héraclite ne s'opposent pas (p. 134) : ils sont dans «l'accord le plus parfait». C'est, restitué d'une manière un peu énigmatique, le résumé de la philosophie de l'histoire de la philosophie de G.W.F. Hegel : Heidegger est, en dépit du verbiage phénoménologique sous lequel il exprime souvent son intuition centrale, bien davantage disciple de G.W.F. Hegel et de Friedrich Nietzsche que de Edmund Husserl.
La page 13 du premier cours indique clairement sous quels auspices révolutionnaires Heidegger ouvre ce cours de 1932: «La tâche qui nous est impartie : une rupture par laquelle nous cesserions de «faire de la philosophie» ? [...] Si les Grecs avaient su quelque chose de cet avenir occidental, jamais un commencement de la philosophie n'aurait eu lieu. Romanité, judaïsme et christianisme ont complètement altéré et falsifié la philosophie dans son commencement – la philosophie grecque. [...] Nous cherchons à nous enquérir du commencement de la philosophie occidentale. Ce que nous y trouvons est peu de chose. Et ce peu est fragmentaire.»
Au sujet de sa remarque sur l'altération de la philosophie occidentale, il la confirme (aux pp.112 à 114) au chapitre 14 des considérations intermédiaires, intitulé Pour délimiter la signification d'exister et d'existence par rapport à l'usage que Kierkegaard et Jaspers font de ces termes. On peut pratiquement considérer ces pages comme une réponse, presque cent ans plus tard, à Kierkegaard qui écrivait en 1844: «[...] c'est là la profondeur du Γνῶθι σεαυτόν, qu'on a assez longtemps entendu à l'allemande à propos de la pure conscience du moi, ce mirage de l'idéalisme. Il serait grand temps de chercher à la comprendre à la grecque et cette fois de chercher à l'entendre comme l'eussent fait les Grecs s'ils avaient eu des notions chrétiennes. [...] Veut-on maintenant comparer cette conception, qu'on l'appelle chrétienne ou ce qu'on voudra, avec celle de l'hellénisme, on y verra, je crois, plus de profit que de perte» (2).
Voici le lien vers ces fragments grecs anciens d'Anaximandre tel qu'ils sont reproduits par Simplicius (en haut de la p. 11 de l'édition Diels (puis Diels revues par Kranz) des fragments des Présocratiques, reproduite ici).
Heidegger connaissait les traductions antérieures proposées par Friedrich Nietzsche, Erwin Rohde, Werner Jaeger mais il ne cite expressément (p. 15) que celle de Nietzsche. Le lecteur français pourra lire la traduction à peu près contemporaine (1938) du même fragment par Émile Bréhier afin d'avoir un sérieux point de référence historique, puis celles de Jean Voilquin (1941 traduction seule) et de Marcel Conche (1991 texte et traduction). Nietzsche traduisait ainsi ce fragment, selon Heidegger: «D'où les choses prennent naissance, c'est là aussi qu'elles doivent aller à leur ruine, selon la nécessité; car elles doivent expier et être jugées pour leurs injustices, selon l'ordre du temps». Heidegger présuppose connus les thèmes présocratiques de la cosmologie et aussi les thèmes principaux de la philosophie d'Anaximandre, le premier penseur grec avant Socrate dont on connaisse des fragments originaux, restitués par les doxographes. L'infini ou l'illimité (3) est, pour Anaximandre, le principe de toutes choses, elles-mêmes réglées selon une justice obscure mais certaine, épousant un rythme mystérieux mais inexorable. Or, on sait que selon Nietzsche, la tragédie grecque comme la tragédie wagnérienne tendent à épouser le rythme symphonique. Ce rythme dialectique harmonique qui fait infiniment alterner vagues positives et négatives, apparitions et disparitions, constructions et destructions, accords et désaccords, n'est autre, en réalité, que le rythme même de la métaphysique idéaliste allemande, portée à son paroxysme par G.W.F. Hegel et illustrée musicalement au plus haut point par Anton Bruckner, le plus grand disciple de Richard Wagner. C'est ce rythme essentiellement allemand dans sa conception que Heidegger voudrait retrouver, mot à mot, racine de mot par racine de mot, dans ce fascinant fragment d'Anaximandre. Ce travail – ici autant philologique que philosophique, autant poétique que phénoménologique – est éclairé par les notes préparatoires rassemblées en annexe (pp. 247-285) que j'invite à lire sans hésiter car elles ne font nullement double-emploi avec le texte rédigé qu'elles éclairent, en profondeur, régulièrement. Il faut noter que Heidegger utilise d'une manière qu'il estime révolutionnaire les acquis philologiques de ses prédécesseurs allemands. Il s'inscrit dans le mouvement qui fut celui des leçons d'histoire de la philosophie de G.W.F. Hegel d'une double manière : il hérite de son ambition philosophique et prétend la dépasser sur son propre terrain.
Notes
(1) Je préfère de beaucoup le titre La Naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque, adopté par Geneviève Bianquis en 1938, au titre La Philosophie à l'époque tragique des Grecs car celui-ci n'établit pas immédiatement la proximité thématique, pourtant évidente, que celui-là prenait soin de confirmer entre philosophie grecque et tragédie grecque. La parole d'Anaximandre telle qu'elle est ici analysée pour la première fois par Heidegger manifeste précisément la parenté poétique entre l'aube de la philosophie et celle de la tragédie: cette parenté est, évidemment, d'abord et avant tout hégélienne puisque Nietzsche comme Heidegger furent des lecteurs de G.W.F. Hegel, par la médiation de qui ils reçurent tous deux l'héritage grec dans sa totalité.
(2) Cf. Søren Kierkegaard, Le Concept de l'angoisse (1844), chapitre II, alinéa 2 , remarque B, op. cit., supra, pp. 84-85.
(3) Heidegger précise, dans ses notes préparatoires (pp. 269-270) au cours de 1932 sur Anaximandre, que l'illimité n'est pas à prendre au sens physique ni cosmologique mais au sens de «temps»: l'essence de l'être, pour Anaximandre, ce serait donc le temps et son rythme d'apparition et de disparition modulant l'existence. Inutile de préciser que cette interprétation est totalement marginale en 1932: on reconnaît que le fragment en question a un aspect poétique et mystérieux mais personne ne songe à l'interpréter d'une manière qui ne soit pas cosmologique. Il arrive qu'on le juge suspect au point de le qualifier d'interpolé ou d'apocryphe (John Burnet, notamment). En 1953, Paul Ricœur savait qu'Heidegger avait étudié et interprété ce fragment d'Anaximandre: il y fait allusion dans son cours professé à Strasbourg sur Être, essence et substance chez Platon et Aristote (in section Platon, troisième partie, chapitre 1 note 2, p. 67 de l'édition dactylographiée originale), mais sans préciser l'orientation de cette interprétation, encore moins son contenu. Encore en 1957, lorsque B. Wisniewski publie dans le tome 70 de la Revue des études grecques son article Sur la signification de l'Apeiron chez Anaximandre, l'interprétation de Heidegger est ignorée ou passée sous silence.
13/04/2018 | Lien permanent
Heidegger ex cathedra, 5 : Occident, seconde partie, par Francis Moury

 Heidegger ex cathedra, 5 : Occident, première partie.
Heidegger ex cathedra, 5 : Occident, première partie. Notes de lecture sur : Martin Heidegger, Le Commencement de la philosophie occidentale : interprétation d'Anaximandre et de Parménide (1932, traduction de Guillaume Badoual et François Fédier, éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque de philosophie, coll. Œuvres de Martin Heidegger, 2017).
Notes de lecture sur : Martin Heidegger, Le Commencement de la philosophie occidentale : interprétation d'Anaximandre et de Parménide (1932, traduction de Guillaume Badoual et François Fédier, éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque de philosophie, coll. Œuvres de Martin Heidegger, 2017).La reprise de la question grecque n'est possible, aux yeux de Heidegger, que parce que G.W.F. Hegel d'une part, Friedrich Nietzsche d'autre part, l'ont eux-mêmes posée. La science positive de l'histoire est matériellement utilisée mais intellectuellement méprisée par Heidegger qui distingue une histoire-destin (celle dans laquelle s'inscrit la question de l'être) et une histoire-historienne (celle de l'université positive allemande qui ignore la question de l'être car elle méconnaît la portée réelle de l'œuvre de Nietzsche, la portée réelle de l'œuvre de G.W.F. Hegel et la portée réelle de toute l'histoire de la philosophie depuis les Présocratiques). L'histoire de la pensée grecque n'intéresse Heidegger que dans la mesure où elle peut s'insérer dans l'histoire-destin de la philosophie allemande. Les études d'histoire de la philosophie de Heidegger se veulent non seulement scientifiques mais encore régénératrices : «Der Anfang verbirgt sich im Beginn (L'origine se cache sous le commencement)» écrit d'ailleurs Heidegger dans Qu'appelle-t-on penser ? (M. H., Was heisst Denken ? (édition Max Niemeyer, Tubingen 1954 puis 1961, p. 98). Il ne s'agit donc pas ici du commencement historique contingent de la philosophie occidentale mais de son origine elle-même et, en même temps et dans le même mouvement, de sa destination. C'est par «origine» qu'il aurait fallu traduire «Anfang» plutôt que par «commencement». L'introduction du traducteur et la quatrième de couverture, assurent toutes deux que l'interprétation de la philosophie présocratique est abordée ici pour la première fois selon le thème du commencement, que cette interprétation constitue un «autre commencement», un «second foyer», après le premier commencement qu'avait été Être et temps (1927). Pourtant, Badoual et Fédier savent pertinemment que le tout premier cours de Heidegger à Fribourg en 1915 était déjà consacré à Parménide : Badoual le remémore d'ailleurs avec raison dès la première page de sa propre introduction. Toute sa vie, Heidegger a enseigné et médité les Présocratiques sous cet angle : un commencement que nous devons reprendre pour notre compte et qui demeure indépassable et indépassé. Être et temps est, en réalité, un rameau, tout comme les études sur la poésie de Hölderlin en furent un autre, de cette méditation initiée dès sa thèse sur Duns Scot et surtout dès sa lecture de la thèse de Franz Brentano sur Aristote (1). Pour le dire plus simplement, il n'y a pas à introduire artificiellement (bien des tentatives ont été faites en ce sens en France au siècle dernier) de scission dans la philosophie de Heidegger : il convient au contraire de situer ses textes dans la perspective de l'unité métaphysique de sa pensée ou, ce qui exprime peut-être encore mieux la vérité, dans le souvenir de l'effort d'unification qui a élaboré sa pensée et qui s'avère toujours plus serré à mesure qu'on la découvre.
Une unique mais très savoureuse allusion (marquée du sceau d'une noire ironie qui devait au moins provoquer les sourires entendus des auditeurs sinon leurs rires chaleureux) à la situation économique et sociale de l'Allemagne de 1932, intervient brusquement à l'alinéa 11 des considérations intermédiaires (pp. 81-82) et mérite d'être citée in extenso: «Quelque chose nous tourmente-t-il, ou tout au moins quelque chose provoque-t-il notre inquiétude, quand nous posons la question : qu'est-ce que l'étant ? Pas du tout, car c'est une question qui nous laisse indifférent, une question sans intérêt, à supposer qu'une question dont l'enjeu n'est ni de mettre en ordre les finances de l'État ni de trouver du travail aux six millions de chômeurs soit bien [,] tout compte fait [,] une question [?]».
Les lecteurs français de 2018 qui ont traversé, comme nous l'avons fait, ce que les historiens du futur nommeront les «quarante honteuses» (1975-2015) par opposition aux «trente glorieuses» (1945-1975) apprécieront en connaisseurs. Je laisse, sur le plan économique et social, l'heureux bénéfice du doute à la décade actuelle 2015-2025 puisqu'elle n'est pas achevée.
Revenons à ces considérations intermédiaires, presque socratiques d'esprit, sur la manière d'accoucher de la question de l'être et ensuite de se tenir dignement en sa présence: elles sont à lire, me semble-t-il, en fonction aussi des thèses de Heinrich Rickert sur la science de la culture et en fonction aussi des thèses de Max Scheler, le phénoménologue des valeurs. Rickert est parti du néokantisme pour aboutir à un réalisme des valeurs, Scheler est parti de la phénoménologie de Husserl pour aboutir à un réalisme des valeurs : Heidegger pose la question de l'être et de la valeur d'une manière aussi réaliste, pas au sens du réalisme platonicien des essences mais au sens du réalisme opposé à l'idéalisme subjectif kantien, dois-je préciser.
La pensée de Parménide est une œuvre dont la «grandeur est grosse de frayeurs» (p. 244). Saisissante conclusion qui manifeste bien en quoi Heidegger se veut lui-même sur un autre chemin que le pur chemin philologique d'un Diels ou d'un Diels-Kranz. Ce qui ne signifie pas qu'il ignore ou néglige ce dernier : il l'a parfaitement fréquenté au point d'être capable de rectifier certaines de ses erreurs ou bien encore au point d'être capable de proposer de rationnelles et suggestives interpolations de fragments doxographiques. Il n'est cependant pas lui-même à l'abri de curieux raccourcis ou de curieux «errements» pour reprendre une expression qui plaît à ses traducteurs : p. 239, on apprend ainsi que le corps serait représenté comme le «mal» dans la représentation catholique (ou plus largement «chrétienne», ce qui ne veut rien dire puisque les théologies catholiques, orthodoxes et protestantes sont très différentes). Plus suggestive est l'idée parménidienne, transmise sinon revue par Théophraste, selon laquelle les morts percevraient le froid et le silence mais ici, ce n'est plus vers saint Augustin ou saint Thomas qu'il faut se tourner, c'est vers Franz Cumont, ce grand contemporain de Heidegger.
Cette traduction suit les règles de sérieux scientifique qui caractérise cette collection des œuvres de Martin Heidegger. Une note de la p. 236 corrige même heureusement une erreur de l'édition allemande. Certaines notes du traducteur (p. 153, p. 161) sont très utiles pour préciser le sens de tel mot allemand. Quelques coquilles relevées: p. 154, ligne 2, il faut lire: «comme quand un tribunal reçoit un témoignage» et non pas le fautif «comment quand»; p. 169, ligne 10, il faut rajouter mentalement un «de» après «qui distingue l'homme qui sait [de] la parentèle de ceux qui ne savent pas». La traduction est élégante et précise sauf certains néologismes toujours regrettables. La traduction de «dasein» par «être-le-là» (sic) aurait fait la joie du Molière des Précieuses ridicules : il vaudrait mieux laisser «dasein» en allemand plutôt que traduire ainsi mais peu importe, au fond, puisque mentalement on peut toujours remplacer cela. C'est ici le fameux débat sur les traductions françaises de Heidegger qui resurgit : tout a été dit et écrit à ce sujet, sur papier comme sur internet, depuis presque cinquante ans. Je préfère largement «réalité humaine», inventé par Henri Corbin, à ça. Certains professeurs de philosophie défendent ce laid et grotesque «être-le-là». On dit (dicunt, narrant, tradunt... on le dit mais... est-ce vrai ?) que Heidegger lui-même aurait proposé «être-le-là» pour traduire l'allemand «dasein». Si même c'était confirmé, ce n'est pas une raison pour accepter cette traduction qui ne correspond nullement au génie de notre langue. Depuis 1927, on a proposé (je cite de mémoire Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, Henri Corbin mais bien d'autres manquent à mon appel) plusieurs traductions plus simples ou plus élégantes («existence humaine», «présence humaine», «réalité humaine», etc.) de ce terme technique heideggerien. Sans doute son Être et temps est-il, tout du long, un commentaire du sens exact de ce terme mais alors... autant avouer qu'il demeure intraduisible et autant le conserver en allemand ? Possible et même réel puisque bien des articles français sur Heidegger l'ont fait durant tout le vingtième siècle et leurs lecteurs n'en mouraient pas.
Avenance utilisé par François Fédier il y a quelques années, me semblait inspiré et beau. Dis-cord me semble intéressant car il y a une dimension musicologique certaine (autant que cinématographique) dans les descriptions phénoménologiques de Heidegger mais quel avantage réellement philosophique le lecteur aura-t-il à lire «in-certain», «in-déterminé» et même «in-quiétude» au lieu de incertain, indéterminé, inquiétude ? Ces coquetteries sont enfantines. Heureusement, ces néologismes sont assez parcimonieusement employés et la lecture n'en souffre que peu sur l'ensemble, bien trop important pour qu'on s'arrête à des détails : l'arbre ne doit pas cacher la forêt surtout lorsqu'il s'agit de la Forêt noire ! Il faut néanmoins encore mentionner un archaïsant mais un peu agaçant «Introduction en la métaphysique» au lieu du classique Introduction à la métaphysique (1935) tel que ce titre fut traduit en 1958 et un assez vulgaire «Qu'est-ce qui s'appelle penser ?» alors qu'on est habitué au titre, plus bref et plus élégant et, pour cette raison, devenu classique chez nous, Qu'appelle-t-on penser ? (1951-1952) tel qu'il fut traduit en 1959, tous deux utilisés en page 7 de l'introduction par le traducteur.
Je regrette aussi les absences d'un index des noms cités et d'un index des passages grecs cités. Un tel cours méritait d'être muni de deux instruments si utiles.
On reparlera des traductions et des appendices lorsque l'œuvre intégrale sera accessible en français une fois pour toutes. La lumière définitive sur la traduction, dans le cas de Heidegger, ne jaillira vraiment qu'une fois disponible la traduction de l'œuvre entière. Il sera alors temps de tout revoir méthodiquement en écartant les aberrations universellement dénoncées, en conservant les heureuses correspondances, en fixant une fois pour toutes le vocabulaire, en rajoutant méthodiquement les index des noms cités et des passages grecs, latins, allemands cités, en vue d'une seconde édition revue et corrigée de l'ensemble. Seconde édition qu'il faudrait, dans un tel cas, bilingue juxtaposée. Un autre moyen de mettre tout le monde d'accord serait de proposer une traduction latine, une sorte de «Vulgate» heideggerienne, reposant sur un glossaire raisonné, préalablement accepté par la communauté scientifique occidentale. Ce souhait vient, me dira-t-on, cent ans trop tard mais peut-être vient-il, tout au contraire, cent ans trop tôt ?
Note
(1) Heidegger écrit (pp.112-113) : «Existence du phoque, de la terre, du soleil, de la rose, de l'être humain, existence de Dieu ; il faut ici avoir présent à l'esprit que la tradition, la scolastique médiévale comme la philosophie des Temps nouveaux (Leibniz par exemple) ne conçoit pas qu'un chien existe au même sens que Dieu. Existentia n'est pas univoce mais analogice. L'être saisi comme la détermination la plus universelle de l'étant n'a absolument pas le caractère d'universalité qui appartient au genre le plus haut. Cela, Aristote l'avait déjà vu. En vérité, même à ce jour, nous n'avons pas fait un pas au-delà de ce qu'il avait vu : la problématique, dans ce qu'elle a de propre, n'en est pas conçue. Nous n'utilisons pas le terme dans ce sens large, pour signifier le fait d'être appartenant à tout existant quelconque, mais pas non plus dans la signification étroite établie par Kierkegaard». La «signification étroite» dénoncée par Heidegger, ainsi que le précise le paragraphe suivant, est rien moins que celle du rapport personnel de l'individu à la transcendance, donc in fine à Dieu. L'expression n'a sans doute pas de rapport direct avec le titre du roman-récit d'André Gide, La Porte étroite (1909) mais rétrospectivement, il faut bien avouer que la coïncidence est stimulante, d'autant plus que cette année-là, Heidegger était pour sa part novice à la Compagnie de Jésus. Quel nouveau Charles Andler ou quel nouveau Henri Gouhier sera un jour en mesure (ce jour ne viendra évidemment pas avant l'édition et la traduction intégrale unifiée et révisée des œuvres de Heidegger) en mesure, dis-je, de nous écrire un volume décent sur la jeunesse de Heidegger ?
14/04/2018 | Lien permanent
Révolution et contre-révolution nationales-socialistes, par Francis Moury

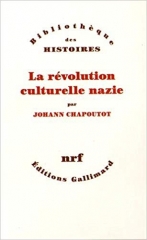 Notes de lecture sur Johann Chapoutot, La Révolution culturelle nazie (éditions Gallimard, coll. NRF-Bibliothèque des histoires, 2017). Acheter ce livre sur Amazon.
Notes de lecture sur Johann Chapoutot, La Révolution culturelle nazie (éditions Gallimard, coll. NRF-Bibliothèque des histoires, 2017). Acheter ce livre sur Amazon.«La Guerre, comme un géant de fer, s’avança parmi ces alanguis et, s’enfuyant aux accents de sa voix terrible dont retentissaient les montagnes, ils cherchaient la protection de leur mère, en qui ils avaient cessé de croire. Mais, avec la foi, leur revint cette vérité : la prospérité ne peut naître que de la force, le combat fait rayonner la divinité, comme la mort fait rayonner la vie ! Oui, Ludwig, voici venue une époque fatale […] nous percevons clairement, de nouveau, la voix de la puissance éternelle.»
E.T.A Hoffmann, Kreisleriana, Le Poète et le compositeur (1815), préface d’André Schaeffner, traduction d’Albert Béguin (éditions Gallimard, N.R.F. 1949, pp. 250-251).
Ce recueil, rassemblant des études publiées ces dix dernières années et d'autres inédites, forme la dernière partie du triptyque de Johann Chapoutot, professeur germaniste d'histoire à la Sorbonne (Paris-IV), à savoir Le Nazisme et l'antiquité (PUF, 2008), La Loi du sang : penser et agir en nazi (Gallimard NRF, 2014), La Révolution culturelle nazie (Gallimard NRF, 2017). C'est à la page 274 que l'hypothèque un peu gênante de la connotation maoïste du titre – inévitable pour un lecteur français se remémorant les années 1960 à 1970, période où l'expression «révolution culturelle» était synonyme de «maoïsme» – est levée. L'auteur précise que la révolution, pour les nazis, n'avait nullement le sens que lui donnaient les révolutionnaires français de 1789 ni celui que lui donnèrent les révolutionnaires communistes marxistes de 1848 ou les maoïstes de 1930. Il s'agissait non pas d'une révolution abolissant le passé pour ouvrir sur un avenir artificiel car conventionnel (si on préfère, résultant artificiellement d'une convention humaine), mais tout au contraire d'un retour aux origines naturelles, donc d'une révolution au sens philologique premier du terme. En quoi cette révolution nazie originale a-t-elle pu s'insérer dans le courant d'idées contre-révolutionnaires classiques anglaises et françaises du dix-neuvième siècle et comment ses intellectuels et ses cadres l'ont-elle définie ?
C'est bien tout l'intérêt de ce troisième volume de vouloir répondre en priorité à cette question, au carrefour de l'histoire générale et de l'histoire de la philosophie. Ce sont surtout, à vrai dire, ses deux premières parties qui comportent des articles relevant expressément de la seconde discipline, notamment La Dénaturation de la pensée nordique : du racisme platonicien à l'universalisme stoïcien (initialement parue en 2008 sous le titre plus généraliste : Régénération et dégénérescence : la philosophie grecque reçue et relue par les Nazis) et À l'école de Kant ? Kant, philosophe «nordique» (initialement parue sous le titre encore plus savoureux de L'Impératif catégorique kantien sous le IIIe Reich), mais, en réalité, une grande partie du livre en relève dans la mesure où il complète très utilement des études classiques antérieures qui, en raison de leur date, ne couvraient évidemment pas la période considérée et qui ne pouvaient pas non plus, pour cette même raison, tirer certaines conclusions rétrospectivement clairement contenues dans plusieurs de leurs prémisses ou bien dont ce n'était pas l'objet premier non plus. C'est ainsi que les lecteurs philosophes de Lucien Lévy-Bruhl (1), Charles Andler (2 et 3), Émile Boutroux (4), Victor Basch (5), Jean-Édouard Spenlé (6), Émile Bréhier (7) ou, plus récemment André Glucksmann (8), profiteront d'une intéressante mise à jour en lisant ce livre. Même chose d'ailleurs pour les lecteurs historiens ou étudiants en sciences politiques qui estimaient un peu légère la section consacrée aux idées nazies dans la commode étude de Claude David, Hitler et le nazisme (PUF, 1967) ou dans la plus ample anthologie de Jean Imbert, Henri Morel et René-Jean Dupuy, La Pensée politique des origines à nos jours (PUF, coll. Thémis, section Textes et documents, 1969) et qui souhaitaient un accès à des documents plus récents. Depuis 1945, au demeurant, les études historiques mondiales ont accumulé une quantité remarquable de recherches sur les origines de la pensée et de la doctrine nationale-socialiste. Cette nouvelle synthèse permet d'avoir accès aux travaux allemands, anglais et français les plus sérieux et les plus récents, scrupuleusement cités en notes. Ce n'est pas un de ses moindres mérites.
Sur le pur plan de l'histoire de la philosophie, certains noms classiques sont cités et c'est en priorité à eux que le lecteur philosophe s'intéressera le plus : Platon, les Stoïciens et Kant, au premier chef. (9)
Concernant l'interprétation de Platon par l'histoire nazie de la philosophie, il faut bien convenir, à s'en tenir aux citations ici traduites et examinées, qu'elle semble très pauvre (elle sacrifie l'étude de la métaphysique des Idées au profit des idées morales, sociales et politiques de Platon), mais qu'elle n'est ni absurde en soi ni, surtout, inédite. Lorsque Mgr. Auguste Diès (1875-1958) préfaçait en 1932 l'édition-traduction par Émile Chambry de La République (10) de Platon (dans la Collection des Universités de France, éditée sous les auspices de l'association Guillaume Budé, aux éditions des Belles lettres), il débutait sa préface ainsi : «Platon n'est venu à la philosophie que par la politique et pour la politique.» C'est exactement le point de vue des historiens allemands de Platon que Johann Chapoutot rattache ici au nazisme. Cette même affirmation de Diès introduira sa préface, mot pour mot, à la réédition de la traduction seule de Chambry lorsque cette dernière paraîtra dans la belle collection des Grandes œuvres de l'antiquité classique traduites en français, chez le même éditeur, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Globalement, Platon exalterait aux yeux des historiens nazis les valeurs de Sparte et de sa rigoureuse sélection raciale et militaire. Son propos témoignerait d'un génie nordique pas encore altéré en Grèce classique par les guerres civiles puis par la période hellénistique et romaine. Le stoïcisme serait au contraire le système incarnant précisément le point de vue universaliste triomphateur durant la période hellénistique, séparant définitivement l'individu de sa communauté biologique et primitive pour le livrer à l'impératif désincarné et abstrait d'un moralisme individualiste. Lisons à présent la page 30 de l'article d'Auguste Diès consacré en 1936 à la désormais classique monographie de Léon Robin sur Platon (11). Diès y complimente Robin d'avoir écrit un solide chapitre sur la morale et la politique de Platon. Il ajoute : «[...] dois-je signaler le paragraphe où Robin montre que la raison est, pour Platon, la loi de la Cité universelle, et nous laisse entrevoir le magnifique développement que cette idée prendra dans la morale cosmologique et universaliste des Stoïciens ? Mais j'aurais l'air, en choisissant ainsi, de réserver mon adhésion sur le reste».
On le voit, Diès et Robin soutiennent la thèse opposée à celle de la philosophie nazie de l'histoire de la philosophie : Platon annoncerait, par son rationalisme, le stoïcisme lui-même. Elle n'est pourtant pas plus vraie que l'autre. En réalité, Platon ne peut pas davantage être réduit à un théoricien raciste spartiate qu'à un rationaliste universaliste pré-stoïcien. Le Platon réel est bien plus complexe : la lecture de la monographie de Robin (plus tard celle de François Chatelet, très bonne aussi mais qu'il ne faut lire qu'après celle de Robin, afin d'honorer l'ordre chronologique et historique de l'histoire de la philosophie, le seul restituant la vie réelle de la pensée) en donne d'ailleurs un fidèle portrait qui ne peut évidemment pas être réduit à une ou deux formules sans être par là-même trahi. Ce qui est certain, c'est que Platon fut un penseur politique absolument totalitaire mais un penseur politique qui considérait la politique comme un art inférieur à celui de la métaphysique, uniquement chargé d'adapter ses résultats au monde sublunaire sensible et contingent. Platon, contrairement à ce qu'écrivait Diès, n'est donc venu à la politique que par et pour la philosophie, pour tenter de réaliser (avec une mémorable constance) sur Terre le modèle métaphysique qu'il apercevait dans le ciel des idées et dans le ciel cosmique et astronomique. Raison pour laquelle les lois de la république platonicienne sont inapplicables à moins de considérables ajustements dont Platon était parfaitement conscient. Sur le problème posé par La République, Le Politique et, surtout, par Les Lois, je renvoie à mon propre article paru ici même il y a dix ans sur Le Dernier travail de Platon (12) qui examinait les tenants et aboutissants historiques et philosophiques de la réédition augmentée de la thèse belge de Marcel Piérart, Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la constitution des «Lois» (Les Belles lettres, 2008).
Ce premier chapitre consacré à la philosophie antique est aussi intéressant, au second degré, pour l'historien de l'histoire de la philosophie, car deux noms importants y sont cités : celui de Werner Jaeger et celui de Max Pohlenz.
Il était impossible d'étudier en France le système d'Aristote, durant la seconde moitié du vingtième siècle, sans constamment lire le nom de Jaeger, auteur d'une thèse célèbre sur l'évolution génétique du système d'Aristote marqué par un passage progressif du platonisme à l'anti-platonisme. En 1953, lorsque Paul Ricœur professa son célèbre cours de Strasbourg sur Être, essence et substance chez Platon et Aristote, il précisa qu'il prenait «pour fil conducteur l'interprétation de Werner Jaeger» (13). Dix ans plus tard, précisément dès 1962, Pierre Aubenque faisait justice de cette thèse de Jaeger en détails : elle développait en effet d'une manière excessivement systématique ce qui relevait initialement du simple bon sens et ses résultats n'étaient pas particulièrement probants. On connaît beaucoup moins chez nous les idées de Jaeger sur Platon et la citation de l'article de Jaeger fournie par Chapoutot (traduite d'un article paru dans la revue nazie Volk im Werden (Peuple en devenir, I, 3, 1933, extrait traduit de la p. 46) vaut donc d'être reproduite : «Le Platon de notre génération est un créateur d'États, un législateur. Ce n'est plus le systématicien néo-kantien et l'honorable scholarque philosophique que nos prédécesseurs avaient vu en lui». Chapoutot précise que, dans le même article, Jaeger attaque vigoureusement le dix-huitième siècle et son humanisme individualiste. Intéressante précision mais, en réalité, la charge de Jaeger est directement conduite, je pense, contre la célèbre étude du kantien Paul Natorp (1854-1924), Platons Ideenlehre (Leipzig, 1903, puis seconde édition en 1921). Cette attaque est cohérente avec l'anti-kantisme profond du nazisme : il n'était pas question pour le nazisme de laisser récupérer Platon par le kantisme, y compris le néo-kantisme de l'École de Marbourg à laquelle appartenait Natorp. Mais il faut bien mesurer que pour un historien moderne de Platon, la lecture kantienne de Platon effectuée par Natorp était déjà douteuse par elle-même, indépendamment de tout contexte politique.
Encore vers 1965, il était non moins impossible de préparer l'agrégation si le stoïcisme antique était au programme sans lire la mention bibliographique du célèbre ouvrage de Max Pohlenz, Die Stoa, Geschichte einer geistigen Bewegung (, Leipzig, 1942, puis Gottingen 1946-1949 et éditions sans cesse revues et augmentées par la suite). Jean Brun, dans son cours d'agrégation Le Stoïcisme : direction et instruments de travail, professé vers 1965 (sa mention bibliographique la plus récente date de 1963 et concerne d'ailleurs précisément la seconde édition de sa propre étude Le Stoïcisme, PUF, 1963) et dactylographié par le C.N.T.E., situe ainsi l'œuvre de Pohlenz : «étude érudite en deux volumes mais qui ne remplacent cependant pas les ouvrages français cités ci-dessus», à savoir les études classiques d'ensemble de Ravaisson, Brochard, Rodier, Bréhier, Goldschmidt. Étude cependant bien évidemment lue et citée par le moindre article français traitant du sujet depuis 1950. Parmi les thèses intéressantes de Pohlenz, on trouve l'idée d'une déviation intellectualiste chez Chrysippe (280-210 avant J.-C.) qui aurait, au sein du courant général de l'ancien stoïcisme, rompu avec le naturalisme originel de Zénon de Cittium (336-264 avant J.-C.) et de Cléanthe (331-232 avant J.-C.). Chapoutot cite à la page 47 la remarque de Pohlenz selon laquelle «Nous rencontrons dans la doctrine stoïcienne bien des traits qui nous rappellent que ses fondateurs n'étaient pas des Grecs». Vers 1965, Jean Brun confirme qu'ils ne sont pas des Athéniens, qu'ils viennent d'Asie mineure, ajoutant : «comme d'ailleurs la plupart des pré-socratiques». On soulignait, ajoute Brun, leur accent étranger voire leur grec entaché de barbarismes. Armand Jagu, dans Zénon de Cittium, son rôle dans l'établissement de la morale stoïcienne (éditions Vrin 1946, p. 49 et sq.) s'est posé la question de savoir si on pouvait trouver dans leur doctrine des influences sémites ou orientales. Dans l'état actuel des textes, il ne reste, semble-t-il, guère de place que pour des hypothèses, mais la question est parfaitement légitime et mérite encore aujourd'hui d'être posée. Sur le rapport de Platon et des stoïciens, j'en profite pour signaler que l'étude de Jagu, Épictète et Platon – Essai sur les relations du Stoïcisme et du Platonisme à propos de la morale des Entretiens (éditions Vrin, 1945) demeure encore aujourd'hui l'étude française la plus suggestive. Rapportée à l'ensemble des citations traduites par Chapoutot, celle de Pohlenz est donc assurément dans l'air du temps nazi mais elle n'est pas philologiquement ni historiquement inexacte par elle-même. Il est, de même, parfaitement exact de prétendre que le cosmopolitisme des Stoïciens est une idée neuve à une époque où la pensée grecque distingue encore essentiellement Grecs et barbares d'une part, hommes libres et esclaves d'autre part.
Sur la récupération nazie de Kant, l'article de Chapoutot vaut d'être lu, en dépit du fait que le cheminement fondamental qui mène de Kant aux postkantiens (Fichte, Schelling, G.W.F. Hegel) et qui, de la sorte, détermine toute l'histoire de la pensée allemande moderne et contemporaine, soit pratiquement passé sous silence. L'auteur qui écrit d'abord un livre d'histoire et non pas un livre d'histoire de la philosophie mais qui en sonde régulièrement certains éléments, part de l'étonnement d'Hannah Arendt lorsque, journaliste au procès d'Eichmann à Jérusalem en 1961, elle l'entendit citer une «définition approximative mais correcte» (p. 111) de l'impératif catégorique kantien au président du tribunal israélien. Eichmann : «Je voulais dire, à propos de Kant, que le principe de ma volonté doit toujours être tel qu'il puisse devenir le principe de lois générales». En quoi le penseur par excellence de l'Aufklärung (les Lumières allemandes du dix-huitième siècle) pouvait-il avoir inspiré Eichmann ? Chapoutot explique, au troisième paragraphe de sa page 117, que «lois générales» traduit mal ce qui doit s'entendre comme «lois universelles» de la raison. Une remarque est nécessaire à ce sujet : la première définition de l'impératif catégorique (in Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785) est : «Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle» (14). Il est exact que «loi générale» ne saurait, ainsi que le fait justement remarquer Chapoutot, traduire correctement «loi universelle». Mais Kant fournit une seconde définition, une page plus loin, qui stipule : «Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature». Pour un nazi lisant pour la première fois ce traité, la seconde définition est très facilement compréhensible puisque le nazisme est d'abord et avant tout une philosophie de la nature, une «bio-logie» au sens le plus philologique du terme. Il suffit, d'un point de vue raciste, de rajouter mentalement «nature allemande» ou de remplacer «nature» par «sang allemand» (dont les exigences sont traduites directement par Adolf Hitler et par les théoriciens racistes SS, exigences connues par cœur par Eichmann) pour ne pas être trop dépaysé en terre kantienne. D'autant moins que les notes 111 et 112 de la page 137 de la traduction de Victor Delbos expliquant en quoi les lois universelles sont l'élément formel de la nature et en quoi cette seconde définition précise la première sans la modifier, peuvent sembler tout de même un peu embarrassées puisque Delbos est alors contraint, pour faire comprendre la modification, de la mettre en parallèle avec le schématisme de la raison pure. À celui qui, en revanche, comme Eichmann, est électromécanicien de formation et qui n'a aucune culture philosophique mais qui a pourtant fait l'effort de lire la Critique de la raison pratique (1788, notamment la première partie, chapitre 2 où cette définition est présentée, selon Delbos, «un peu différemment» [sic]) sans avoir en revanche aucune idée de la Critique de la raison pure (1781, puis seconde édition en 1787) ni de la Critique de la faculté de juger, (1790), les choses peuvent paraître plus simples qu'à Victor Delbos, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des lettres de l'Université de Paris, auteur en 1903 d'une thèse de doctorat sur la philosophie pratique de Kant qui fait d'ailleurs, encore aujourd'hui et à juste titre, autorité.
Sur le reste, excellente mise en perspective des relations entre contre-révolution anglaise et française d'une part et révolution nationale-socialiste d'autre part. Les penseurs nazis (notamment le philosophe catholique Carl Schmitt dont la pensée se situait alors au carrefour original de la théologie marcioniste (15) et de la philosophie du droit : il est naturellement cité à plusieurs reprises) reprennent à leur compte une partie mais pas la totalité de l'héritage contre-révolutionnaire. Ce n'est ainsi pas Dieu (du moins pas le Dieu des Juifs ni le Dieu catholique, auxquels ils ne croient pas) ni sa religion qui constituent, comme pour Burke, Joseph de Maistre ou Louis de Bonald, le support organique permettant de renverser l'individualisme pseudo-rationaliste et anti-social enfanté par la révolution française mais la «science» raciste de la fi
04/09/2018 | Lien permanent
Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, par Francis Moury

 Première partie.
Première partie. Deuxième partie.
Deuxième partie.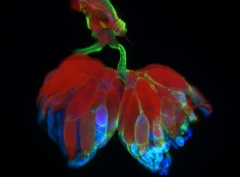 Troisième partie.
Troisième partie. Quatrième partie.
Quatrième partie. Cinquième et dernière partie.
Cinquième et dernière partie.28/08/2020 | Lien permanent
Jésus – une étude d'histoire christologique, par Francis Moury
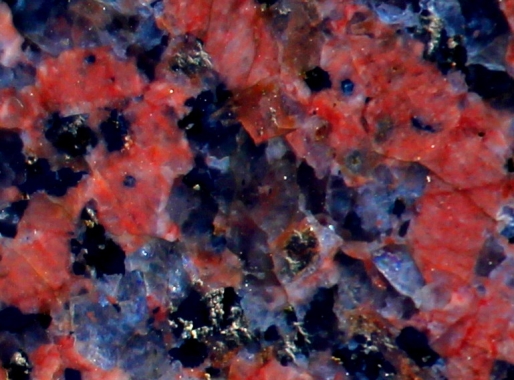
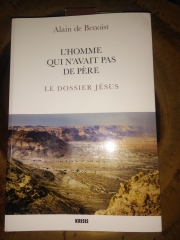 Notes de lecture sur : Alain de Benoist, L'Homme qui n'avait pas de père. Le dossier Jésus (éditions Krisis, 2021, 970 pages). Acheter ce livre sur Amazon.
Notes de lecture sur : Alain de Benoist, L'Homme qui n'avait pas de père. Le dossier Jésus (éditions Krisis, 2021, 970 pages). Acheter ce livre sur Amazon.«On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace; c'était l'hiver [et] Jésus se promenait dans le Temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent donc et lui dirent : "Jusques à quand tiendrez-vous notre esprit en suspens ? Si vous êtes le Christ, dites-le nous franchement." Jésus leur répondit : "Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas : [cependant] les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage. Mais vous ne croyez point, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et jamais elles ne périront et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et nul ne peut les ravir de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un"».
Évangile selon saint Jean X, 23-25 (traduction Augustin Crampon 1923, légèrement revue).
«Comme il enseignait dans le temple, "les princes des prêtres et les docteurs de la loi et les sénateurs du peuple s'assemblèrent et lui firent cette demande : en quelle puissance faites-vous ces choses ?" (Évangile selon saint Luc, XX, 1-2) [...] Et néanmoins Jésus ne leur donne sur ce sujet aucune instruction. "Je ne vous dirai pas non plus en quelle puissance j'agis." (ibid., XX, 8) Mais il se contente de les confondre devant le peuple, de mauvaise foi et d'hypocrisie, comme l'on va voir. [...] Ils avaient donc deux témoignages : celui de sa parole et, ce qui était encore plus fort, celui de ses miracles. S'ils consultaient après cela, un mauvais esprit les poussait. La vérité éternelle, qu'ils consultent mal, n'a rien à leur répondre et n'a plus qu'à les confondre devant tout le peuple. Ainsi nous arrivera-t-il, quand nous la consulterons contre notre propre conscience sur des choses déjà résolues : nous ne cherchons qu'à tromper le monde ou à nous tromper nous-mêmes.»
Jacques-Bénigne Bossuet, Méditations sur l'Évangile (écrites vers 1687, publiées posthume en 1731, éditions Desclée et Cie., Paris 1903, pages 213-215).
«Seuls les uniques, ceux qui par rapport à leur "temps" sont dans l'abri du retrait, sont capables un jour d'appeler le Dieu et de persévérer dans l'attente de ce qui vient le plus éminemment. Et c'est alors chaque fois le lointain et l'inaccessibilité qui dictent la manière dont naît pour le grand nombre une sorte de possession et de familiarité tangible, et le ton où le caractère de ces uniques s'accorde pour sauver une histoire-destinée déployant pleinement son essence.»
Martin Heidegger, Réflexions XII-XV/-Cahier noirs 1939-1941 (traduction Guillaume Badoual, éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque de philosophie, 2021, p. 161).
Cette considérable mise au point des études historiques consacrées à la vie du Christ, depuis les récits des évangiles antiques aux recherches archéologiques et philologiques les plus récentes, est le fruit de dizaines d'années de travail. Elle s'ouvre par deux citations antiques (une d'Aristote et une de Tertullien) qui s'équilibrent bien; elle est dédiée à Louis Rougier, Jean-Marie Paupert et Simon Claude Mimouni.
Disons un mot de ces trois dédicataires.
Louis Rougier (1889-1982) avait débuté par la philosophie des sciences avant de devenir un historien des religions mais aussi un penseur de l'histoire et de la politique : son œuvre est assez variée. Son étude sur Celse ou le conflit de la civilisation antique et du christianisme primitif (éditions du Siècle, 1925) avait eu les honneurs d'une recension (bienveillante) par Joseph Bidez et d'une autre (plus sévère car signalant des emprunts effectués parfois sans guillemets au travail antérieur de Causse) par Eugène de Faye. Plus tard et parmi bien d'autres études publiées, Louis Rougier fut aussi l'auteur de La Religion astrale des Pythagoriciens (éditions PUF, collection Mythes et religions, dirigée par Paul-Louis Couchoud, 1959). Or, il faut savoir que Paul-Louis Couchoud fut l'un des représentants français de la «thèse mythiste» qui faisait de Jésus un mythe humanisé, «avatar d'un Dieu sauveur adoré bien des siècles avant Tibère» (page 85).
Jean-Marie Paupert (1927-2010) avait été dominicain au Saulchoir et fut un proche du père Marie-Dominique Chenu (1895-1990), l'historien bien connu de la théologie médiévale. Paupert renonce à la vie religieuse puis étudie à la Sorbonne avant de partager son temps entre la direction d'une collection religieuse chez l'éditeur Arthème Fayard et la publicité de la firme pétrolière Total. Il oscilla entre catholicisme réformateur et traditionaliste.
Simon Claude Mimouni (né en 1949), ancien élève de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, fut notamment professeur à l'École Pratique des Hautes Études, section des sciences religieuses où il enseigna de 1995 à 2017 les origines du christianisme et l'histoire des premières communautés chrétiennes, en particulier dans leur rapport au judaïsme depuis le second siècle avant notre ère jusqu'au second siècle après notre ère.
Alain de Benoist a, pour sa part, déjà publié plusieurs livres ayant trait aux questions religieuses : Avec ou sans Dieu (1970), Comment peut-on être païen ? (1981), Fêter Noël. Légendes et traditions (1982), Les traditions d'Europe (1982), L'Éclipse du sacré (1986), Jésus sous l'œil critique des historiens (2001), Jésus et ses frères (2006), La Puissance et la foi (2021). Son nouveau Dossier Jésus, divisé en six parties, comptant au total environ un millier de pages, est une somme d'une belle richesse historique autant que religieuse, mais aussi philosophique concernant certains chapitres. Les philosophes le liront donc aussi avec intérêt, eux qui n'ont — ainsi que le rappelait très bien Emilio Brito en 1980 — «jamais cessé d'interpréter le Christ» (1). Entendons : l'interpréter à partir de sa réalité religieuse comme de sa réalité historique. Toute la question étant, évidemment, de savoir ce que recouvre ce «comme» et de quelle nature peut bien être cette médiation entre histoire et religion.
Concernant le premier terme (l'histoire), il faut naturellement commencer par le commencement : la réalité historique de Jésus en son temps (éditions Arthème Fayard, 1945, revue et corrigée, 1947) — selon le beau titre donné par Daniel-Rops (Henri Petiot, 1901-1965) au second volume de son Histoire sainte — et la méthode applicable à cette réalité. C'est l'objet de la première partie (La Recherche, pages 11 à 122) du livre d'Alain de Benoist.
Alain de Benoist n'en doute pas et l'écrit : Jésus a certainement existé. La question, après deux mille ans et l'établissement consacré d'une religion mondiale, pourrait sembler oiseuse sinon spéculative mais ce serait une erreur de perspective car elle fut constamment brûlante depuis le dix-huitième siècle. Alain de Benoist résume très soigneusement son évolution : une «première quête» (qu'on peut commodément dater 1474 à 1901 ou 1774 à 1901 selon qu'on opte comme terminus a quo pour les recherches historiques de H. S. Reimarus publiées en Allemagne par Lessing à partir de 1774 ou bien pour la Vita Christi du chartreux Ludolphe de Saxe en 1474), une seconde période «sans quête» (qu'on peut dater 1906 à 1953 et qui est caractérisée par un certain découragement relativement à la possibilité d'une restitution historique de Jésus), une troisième période nommée «nouvelle quête» (qu'on peut dater 1953 à la fin des années 1970). Tout n'y est certes pas mentionné (car il y faudrait non seulement des volumes mais encore des bibliothèques entières) : je ne crois pas qu'y figure, par exemple, la savoureuse démonstration du logicien anglais Richard Whately, Historic Doubts about Napoleon Buonaparte (2), dans lequel Whately montrait, en 1819, que les mêmes arguments attaquant la vérité du christianisme pouvaient nous faire douter de l'existence de Napoléon, alors même que ce dernier était encore vivant. Ses étapes principales — les Vies du Christ (par exemple celle de G.W.F. Hegel, de David Strauss, d'Ernest Renan), leur influence et les critiques qu'elles occasionnèrent, initiant notamment en guise de contre-offensive la naissance de l'historiographie catholique moderne sous les auspices de Fulcran Vigouroux (3), puis Marie-Joseph Lagrange (4) le fondateur en 1890 de l'École biblique de Jérusalem — sont mentionnées, parfois étudiées plus en détails. J'y ajouterais volontiers, concernant la première moitié du vingtième siècle les noms de Jean Michel Alfred Vacant, Eugène Mangenot, Émile Amann, Réginald Garrigou-Lagrange (5) en raison de leur contribution au collectif Dictionnaire de théologie catholique qui demeure un monument des études historiques et théologiques françaises. À ses côtés, il faut bien avouer que l'unique volume, pourtant si remarquable – en dépit du fait qu'il accordait trop peu de place à la philosophie médiévale : pour le reste, il demeure admirable — d'André Lalande (1867-1964) et des membres et correspondants de la Société Française de philosophie, j'ai nommé le vénérable Vocabulaire technique et critique de la philosophie (1902-1923 puis éditions revues et légèrement augmentées jusqu'en 1993 au moins) fait très pâle figure quantitative alors que sa matière est pourtant plus étendue chronologiquement puisque l'histoire de la philosophie occidentale depuis les Grecs à nos jours couvre 2500 ans environ.
L'histoire de la position du Vatican et les successives encycliques sur l'étude historique des évangiles sont utilement mentionnées et analysées. C'est l'encyclique Divino afflante spiritu (1943) du pape Pie XII «qui a permis aux exégètes catholiques de s'affranchir en partie des condamnations antimodernistes des papes du siècle précédent. Elle sera suivie, pendant le concile de Vatican II, d'une Instruction sur l'historicité des Évangiles publiée (le] 23 avril 1964 par la Commission biblique pontificale qui déclarait accepter la méthode de l'exégèse historico-critique et a abouti, notamment, à l'abandon de la notion (pourtant augustinienne et fondamentale] d'inerrance : littéralement parlant, tout ne serait donc pas nécessairement vrai dans la Bible. Mais cette libéralisation ne s'appliqua encore que très partiellement à l'étude des évangiles. L'abbé Jean Steinmann l'a appris à ses dépens lorsqu'il fut interdit de publication à cause de quelques lignes de sa Vie de Jésus, parue en 1962» (p. 53).
Citons, à ce sujet, le passage de la «constitution dogmatique» du pape Paul VI, intitulée Dei verbum (1965) qui ne fait d'ailleurs, je pense, que reprendre en partie ce qu'écrivaient déjà les Pères grecs et romains de l'Église : «Il n'est pas contraire à la vérité d'un récit que les évangélistes rapportent les actes et les paroles de Jésus de façons diverses et qu'ils expriment ses déclarations de manières variées. C'est d'une façon différente, en effet, que la vérité est proposée dans des textes diversement historiques ou prophétiques ou poétiques ou relevant d'autres genres d'expression» (p. 54).
Un chapitre est consacré aux critères retenus par les historiens pour valider l'authenticité de telle ou telle section des évangiles. Le «critère d'embarras» ou le «critère de discordance» s'applique, par exemple, à un fait ou une parole se révélant comme une source d'embarras historique ou théologique, notamment pour les premières communautés chrétiennes. Ces paroles ou ces faits auraient donc des chances d'être historiquement réels en raison même des contradictions soulevées dont une pure propagande aurait au contraire soigneusement fait l'économie : par exemple le baptême du Christ par saint Jean Baptiste rapporté par saint Marc et par saint Luc relève d'un tel critère car ce baptême était effectué par Jean en vue du pardon des péchés. Or Jésus, étant considéré par les Évangiles comme le Fils de Dieu, n'a évidemment pas besoin de se faire pardonner ses péchés; ce qui explique que saint Matthieu fasse dire à saint Jean Baptiste : «C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi !» (cité p. 29). Le «critère de cohérence» est inverse car les historiens qui l'adoptent tiennent le raisonnement suivant : «[...] une parole ou un acte de Jésus a plus de chance d'être authentique s'il est cohérent avec l'ensemble du récit ou avec d'autres actes et paroles dont on a établi l'authenticité» (page 30). Plusieurs dizaines d'autres critères sont présentés, illustrés et, in fine, critiqués car leur luxuriance logique ne laisse pas de porter, finalement, presque à faux : ils se concurrencent et, à l'occasion, s'annulent réciproquement. C'est le cas des deux critères cités supra : le critère d'embarras est l'inverse du critère de cohérence. Qui choisit l'un, devrait logiquement renoncer à l'autre.
Lire cette étonnante liste de critères élaborés, pour l'essentiel, durant le dix-neuvième et le vingtième siècles, revient un peu, sur le plan philosophique, non pas tant à revivre intellectuellement les circonstances conceptuelles de la naissance du cercle de Vienne que celles, un peu plus anciennes, dans lesquelles Victor Brochard (1848-1907) avait soutenu – sous l'influence de la philosophie néocriticiste de Charles Renouvier (1815-1903) et sous celle de la philosophie trans-rationaliste probabiliste d'Antoine-Augustin Cournot (1801-1877) – sa thèse de doctorat De l'erreur (1879). On se souvient de la question que Brochard posait : «On peut se demander ce que l'erreur est en elle-même, comment elle est possible en des intelligences dont la fonction essentielle semble être de connaître la vérité, comment elle apparaît sous tant de formes diverses, tantôt partielle et comme dissimulée entre plusieurs vérités, tantôt générale et faussant, par la place qu'elle occupe, les vérités mêmes qui l'entourent; presque toujours si étroitement unie à la vérité qu'elle peut à peine en être détachée par la plus minutieuse attention, et mêlée de vérité plus souvent encore qu'elle n'est mêlée à la vérité.»
La position du problème contenait (selon la future formule de Henri Bergson dans la première partie de La Pensée et le mouvant, (éditions PUF, collection BPC, 1934-1938, dernière réédition revue du vivant de Bergson) une présupposition de sa solution : la vérité n'était qu'une hypothèse confirmée, l'erreur qu'une hypothèse réfutée. Mais surtout – et c'était au fond le plus important ! – Brochard concluait (6) : «Non seulement le scepticisme est désarmé mais, on l'a vu plus haut, il reste, au-delà de la vérité démontrée, un vaste champ pour la croyance; à côté de la certitude scientifique, il y a place pour une certitude d'une autre nature; la métaphysique et la religion sont légitimes comme la science, quoique à des titres différents. Les constructions métaphysiques ou religieuses, en tant qu'elles sont pensées par chacun de nous, procèdent de la même activité spontanée et créatrice de l'esprit, qui découvre aussi en les reconstruisant les vérités de la science. Si l'esprit peut découvrir la vérité dans un cas, pourquoi ne le pourrait-il pas dans l'autre ? De quel droit limiterait-on sa puissance ?»
Faudrait-il alors, pour échapper au point de vue étroitement critériologique, privilégier un Jésus purement mythique aux dépends du Jésus historique ? Ce serait trahir l'essence même du christianisme, celle de l'incarnation divine non pas en un in illo tempore mythique – temps qui est, par exemple, encore en partie le temps indoeuropéen du Zoroastre historique, fondateur du mazdéisme (7) – mais en une période et un lieu précis de l'histoire humaine. Alain de Benoist a raison de citer Henri-Irénée Marrou («À la différence d'autres religions qui offrent à leurs fidèles un credo de propositions intemporelles, le christianisme se présente comme une religion essentiellement historique [...] La foi chrétienne exige que les événements de la vie de Jésus aient été bien réels, soient des événements historiques situés dans l'espace et le temps.») (8) et non moins raison de citer Henri-Charles Puech («[...] le christianisme est une religion historique au double sens du terme [...] il naît à un moment précis de l'histoire, et sa fondation comme sa foi reposent sur une personne – celle de Jésus – dont, en dépit des efforts des mythologues [...] l'historicité ne fait point de doute, mais encore et surtout [...] il donne au temps une valeur concrète et attache à son développement [...] une valeur sotériologique») (9) à ce sujet : on ne saurait mieux poser le problème ni le résumer plus clairement. Peut-être, d'ailleurs, le lecteur — surtout le lecteur catholique, bien sûr, mais l'hypothèse concerne aussi les autres – reviendra-t-il sagement, après un détour par cette savoureuse section critériologique (relevant tout à la fois de la logique, de l'épistémologie et de la philosophie des sciences puisqu'elle pose la question de savoir comment valider logiquement l'authenticité d'un fait rapporté ou bien celle d'une proposition concernant un fait) à la méthodologie hellénistique de saint Augustin qui, déjà bien conscient des différences et des divergences entre les évangiles, avait cru possible seize siècles plus tôt d'en venir à bout par son ample et souvent lumineux De Consensu evangelistarum (10) ?
Cette première partie se poursuit par une étude critique de trois thèses jadis célèbres, aujourd'hui abandonnées : d'abord la thèse de Jésus Essénien (à la formule de Renan, écrite en 1894 et citée page 61 : «Le christianisme est un essénisme qui a largement réussi», s'opposent les sages remarques d'Adolf von Harnack, écrites en 1900 et citées page 66 : «Les Esséniens accordaient la plus extrême importance à la pureté légale et se tenaient strictement à l'écart, non seulement des impurs mais de ceux qui étaient moins stricts [...] Chez Jésus, nous trouvons l'exact contraire de cette manière de vivre : il va à la rencontre des pécheurs et mange avec eux. Cette différence fondamentale suffit à garantir qu'il était très éloigné des Esséniens»), ensuite la thèse de Jésus Zélote (certains passages des évangiles rapprochent Jésus de cette secte religieuse et nationaliste mais d'autres l'en écartent fondamentalement), enfin la thèse de Jésus Aryen (notamment introduite par le philosophe allemand Ernst Haeckel (ou Häckel, 1834-1919) et par Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), avant d'être reprise et popularisée par l'exégèse
16/11/2021 | Lien permanent
Nécessité ou contingence de l'histoire de la philosophie ? par Francis Moury

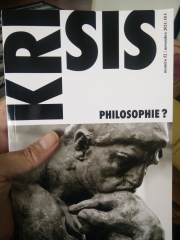 Version intégrale, revue et corrigée le 31 janvier 2022, d'un article initialement paru novembre 2021 dans la revue Krisis n°52 (spécial «Philosophie ?», pp. 9-26).
Version intégrale, revue et corrigée le 31 janvier 2022, d'un article initialement paru novembre 2021 dans la revue Krisis n°52 (spécial «Philosophie ?», pp. 9-26). «L'injustice la plus courante que l'on commet à l'égard de la pensée spéculative consiste à la rendre unilatérale, c'est-à-dire à ne relever qu'une des propositions dont elle se compose. [...] Toute philosophie est essentiellement idéalisme, ou a celui-ci comme principe; la question est seulement de savoir comment ce principe est effectivement réalisé. La philosophie est tout aussi idéaliste que la religion; la religion ne reconnaît pas non plus la finitude comme un être véritable, ultime, absolu, un être non-posé, éternel et incréé. [...] Les principes des philosophies antiques, ou même plus récentes, comme l'eau, la matière ou les atomes, sont des pensées, de l'universel, de l'idéal, et non des choses que l'on peut rencontrer immédiatement dans leur singularité sensible — même l'eau dont parle Thalès; car, bien que cette eau soit également l'eau empirique, elle constitue en fait l'en-soi ou l'essence des autres choses; celles-ci ne sont pas indépendantes et fondées en elles-mêmes, mais sont posées à partir d'un autre, l'eau, c'est-à-dire qu'elles sont idéelles.»
G.W.F. Hegel (1770-1831), La Science de la logique (1812-1816) (éditions Aubier, tome 1, traduction S. Jankélévitch, 1947-1949), pp. 83 et 158.
I — La philosophie et son passé : de la naissance de la philosophie à l'histoire de la philosophie
La philosophie de l'histoire de la philosophie constitue un fil rouge de son étude. Certains philosophes ont, en effet, consacré une partie de leur œuvre à établir, ordonner, juger cette histoire. Ce fil rouge n'est ni univoque ni unidimensionnel car il court entre des penseurs très distincts, de Aristote à G.W.F. Hegel et Auguste Comte, de Hegel à Nietzsche et Martin Heidegger. C'est ce fil rouge, instaurant une étrange dialectique entre nécessité et contingence dans l'histoire de la philosophie de l'histoire de la philosophie, que je voudrais ici mettre en lumière.
D'abord se pose le problème de l'origine de la philosophie occidentale. Il est irrésolu car les documents (notamment ceux concernant la haute antiquité) manquent par comparaison avec ceux que nous possédons sur les périodes helléniques, hellénistiques et romaines. On considère généralement, surtout depuis le dix-neuvième siècle (Friedrich Nietzsche et son ami Erwin Rohde, parmi d'autres, avaient ouvert cette voie dès les années 1870-1880) que les origines de la pensée grecque sont religieuses, mythiques, relevant de la mentalité archaïque ou primitive (1). Simplement, par commodité, on laisse la philosophie orientale (Asie occidentale en remontant au troisième millénaire avant Jésus-Christ, Égypte, Mésopotamie, Iran, Inde, Chine) et la philosophie byzantine (dont la première période est inséparable de l'histoire du christianisme) aux spécialistes, en particulier à ceux de l'histoire des religions (ce qui permet d'établir des connexions attestées : influence établie des mystères de Mithra et des religions solaires sur le néoplatonisme de Plotin qui avait, vers 244 après J.C., accompagné l'expédition de l'empereur Gordien en Perse). On fait, surtout depuis le dix-neuvième siècle, débuter cette histoire de la philosophie en Grèce au sixième siècle avant Jésus-Christ, par les cosmologues et physiologues de l'école milésienne (Thalès, Anaximandre, Anaximène).
 Reste que cette chronologie axiologique, aujourd'hui établie, ne fut absolument pas celle d'une partie non-négligeable des anciens historiens : saint Augustin, La Cité de Dieu (VIII, §9) et Clément d'Alexandrie (Stromates, I, 28) considéraient que les Grecs n'avaient pas inventé la philosophie. Au contraire, leur période et la période romaine postérieure constituent, à leurs yeux, une décadence achevée par les sceptiques grecs (qui nient la possibilité d'une pensée objective) et les néoplatoniciens hellénistiques (qui ramènent la philosophie à la religion païenne) par rapport à une période plus archaïque mais plus pure illustrée par Moïse, les Égyptiens, les Babyloniens, les Chaldéens, les Indiens et, d'une manière générale, les barbares pré-helléniques, sans oublier les Germains. Son origine est, de toute manière, divine : de là, l'intérêt de saint Augustin dès sa jeunesse pour la philosophie mais aussi pour l'astrologie et la divination (saint Augustin fut un lecteur attentif du traité de Cicéron sur la divination) demeuré intact après sa conversion; de là aussi, les curieuses hypothèses mi-historiques mi-théologiques de Clément d'Alexandrie considérant que la philosophie (la science du bien par lui-même qu'il ne faut surtout pas confondre avec les arts subalternes que sont la géométrie, la musique, l'astronomie reposant sur des postulats, des approximations et des apparences) pouvait être le résultat d'un vol effectué par des anges inférieurs ou, plus prosaïquement, par un plagiat matériel du Pentateuque.
Reste que cette chronologie axiologique, aujourd'hui établie, ne fut absolument pas celle d'une partie non-négligeable des anciens historiens : saint Augustin, La Cité de Dieu (VIII, §9) et Clément d'Alexandrie (Stromates, I, 28) considéraient que les Grecs n'avaient pas inventé la philosophie. Au contraire, leur période et la période romaine postérieure constituent, à leurs yeux, une décadence achevée par les sceptiques grecs (qui nient la possibilité d'une pensée objective) et les néoplatoniciens hellénistiques (qui ramènent la philosophie à la religion païenne) par rapport à une période plus archaïque mais plus pure illustrée par Moïse, les Égyptiens, les Babyloniens, les Chaldéens, les Indiens et, d'une manière générale, les barbares pré-helléniques, sans oublier les Germains. Son origine est, de toute manière, divine : de là, l'intérêt de saint Augustin dès sa jeunesse pour la philosophie mais aussi pour l'astrologie et la divination (saint Augustin fut un lecteur attentif du traité de Cicéron sur la divination) demeuré intact après sa conversion; de là aussi, les curieuses hypothèses mi-historiques mi-théologiques de Clément d'Alexandrie considérant que la philosophie (la science du bien par lui-même qu'il ne faut surtout pas confondre avec les arts subalternes que sont la géométrie, la musique, l'astronomie reposant sur des postulats, des approximations et des apparences) pouvait être le résultat d'un vol effectué par des anges inférieurs ou, plus prosaïquement, par un plagiat matériel du Pentateuque. Cette conception de l'origine de la philosophie effectue assez régulièrement, dans l'histoire de la philosophie, un retour en force. Schopenhauer en offre, au dix-neuvième siècle, un bel exemple : «C'est du mythe de la transmigration des âmes qu'il s'agit. [...] jamais mythe ne s'est approché, jamais mythe ne s'approchera plus près de la vérité accessible à une petite élite, de la vérité philosophique, que n'a faite cette antique doctrine du plus vieux et du plus noble des peuples : antique et toujours vivante, car, si dégénérée qu'elle soit en bien des détails, elle domine toujours les croyances populaires, elle exerce toujours sur la vie une action marquée, aujourd'hui comme il y a plusieurs milliers d'années. C'est le nec plus ultra de la puissance d'expansion du mythe : déjà Pythagore et Platon l'écoutaient émerveillés, ils l'empruntaient aux Hindous, aux Égyptiens peut-être; ils le vénéraient, ils se l'appropriaient, et enfin – dans quelle mesure ? nous l'ignorons – ils y croyaient.» (2)
Schopenhauer avait été initié aux textes sacrés indiens par l'orientaliste Maier dès les années 1810 mais il retrouve à cette occasion cette vieille idée à laquelle il confère ici des accents presque gnostiques. Que la philosophie soit la fille des religions primitives ou d'une sagesse révélée à une élite restreinte a pour conséquence de la priver de son autonomie illusoire : elle ne serait, au mieux que la nouvelle expression d'un ancien savoir, au pire que la manifestation de l'oubli de ce savoir.
Ensuite, vient le problème des frontières de la philosophie avec la religion, l'art, la politique et l'histoire. On ne peut plus le poser a priori ni dogmatiquement : il ne peut être résolu qu'historiquement, donc penseur par penseur, individu par individu, nation par nation, civilisation par civilisation, soigneusement restitués dans leur temps et leur complexité. Le présocratique Héraclite, dans ses Fragments si denses, s'intéresse autant à la nature qu'à la théologie, aux sciences naturelles qu'à la morale et à la politique, et sa vision tragique de l'univers englobe tous ces domaines : il est peut-être bien l'exemple du premier philosophe authentiquement multidisciplinaire en Occident. Ses contemporains et ses prédécesseurs le furent à des degrés divers que seules la variété et la rareté des sources nous empêchent d'unifier d'une manière aussi visible : nous savons par les témoignages, les réfutations, les doxographies antiques que les Pythagoriciens étaient, par exemple, au premier chef une confrérie mystique dont le but principal était sotériologique mais qu'ils avaient aussi une ambition politique avérée et une ambition scientifique.
Plus près de nous et exemple plus familier car incarnant désormais symboliquement la figure de l'intellectuel, qui est le véritable Socrate ? Celui si souvent mis en scène par Platon dans ses dialogues de jeunesse ? Peut-être mais dans quelle mesure Socrate est-il transformé en platonicien et dans quelle mesure Platon reste-t-il fidèle à l'enseignement socratique original ? Celui dont Aristote rapporte plus tardivement certaines thèses éparses dans sa Physique, dans sa Métaphysique, dans ses Problèmes aristotéliciens ou pseudo-aristotéliciens, selon les manuscrits conservés ? Celui du dramaturge Aristophane qui, pour mieux le ridiculiser, le montre dans sa pièce de théâtre Les Nuées descendant d'une nacelle face à un disciple étonné à qui il assure d'une manière sophistique que sa proximité avec les nuages lui permet de mieux saisir la vérité et qui, à l'occasion, lui place dans la bouche une formule d'Anaxagore ? Celui du général historien mémorialiste Xénophon qui vante son courage militaire et relate sa savoureuse rencontre avec la belle courtisane Théodote dans ses Mémorables ? On en discute sans relâche depuis le dix-neuvième siècle autant sur le plan littéraire et historique (Taine considérait vers 1855 Platon autant comme un historien que comme un philosophe : cette thèse sera, cinquante plus tard, reprises par John Burnet qui en tirera les ultimes conséquences dans une célèbre hypothèse d'histoire de la philosophie) que sur le plan purement philosophique, au point qu'on oscille véritablement, concernant la figure de Socrate comme concernant sa doctrine, entre histoire et légende.
La méthode de Gustave Lanson en histoire de la littérature s'applique, certes, parfaitement à l'histoire de la philosophie dans un cas tel que celui de Socrate, application favorisée par la variété des sources et le fait qu'elles relèvent de genres et de disciplines diverses : histoire générale et genres littéraires, comédie, dialogue littéraire, dialogue philosophique. Mais elle ne lève pas une indécision fondamentale à son sujet. Socrate est un personnage connu par ce qu'en disent des témoins divers qui fragmentent son portrait à mesure qu'ils livrent leurs témoignages, le dissolvant et le recomposant en figures si variées qu'il quitte progressivement le plan de l'histoire pour glisser vers celui du mythe.
 Un problème corollaire du précédent est celui de savoir s'il peut exister une philosophie nationale ? Lorsque Maurice Blondel publie, au lendemain de la Première guerre mondiale, le livre posthume de son ami défunt Victor Delbos (rassemblant certaines leçons prononcées à la Sorbonne, d'autres intégralement rédigées, d'autres enfin dont il ne restait que des notes) sur La Philosophie française (éditions Plon, 1919), on peut, dans l'introduction puis son premier chapitre, lire les lignes suivantes :
Un problème corollaire du précédent est celui de savoir s'il peut exister une philosophie nationale ? Lorsque Maurice Blondel publie, au lendemain de la Première guerre mondiale, le livre posthume de son ami défunt Victor Delbos (rassemblant certaines leçons prononcées à la Sorbonne, d'autres intégralement rédigées, d'autres enfin dont il ne restait que des notes) sur La Philosophie française (éditions Plon, 1919), on peut, dans l'introduction puis son premier chapitre, lire les lignes suivantes : «En étudiant les éléments originaux de la philosophie française, je voudrais montrer en quoi la France s'est révélée dans ses façons de penser autant que dans ses doctrines, indépendamment de l'influence anglaise ou allemande. [...] Nous sentons bien que nos armes sont engagées pour la défense non seulement de notre sol, mais encore des meilleurs fruits spirituels qu'ont fait pousser du sol français les âmes françaises.»
Victor Delbos souhaitait, durant la Première guerre mondiale, «faire l'union sacrée de nos philosophes» mais soixante-dix ans plus tard, Henri Gouhier se demande s'il ne vaudrait décidément pas mieux parler, sinon d'une philosophie d'expression française (Leibniz, Jean-Jacques Rousseau, Joseph de Maistre écrivent en français mais ne se considèrent pas français au sens où Delbos pouvait l'entendre vers 1914) au moins d'une tradition française en philosophie ?
«Problème difficile qui exclut les réponses faciles», ajoute Gouhier. Après tout, les évolutions sont proches, depuis la renaissance, entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Russie, la Suisse, le Danemark : mêmes oscillations entre sentiment de continuité ou volonté de rupture, même évolution sociologique entre le philosophe fonctionnaire professeur et celui en marge (volontairement ou non) de l'université, même rapport obsédant à l'histoire, aux sciences, à la politique et à la religion, même culture commune gréco-latine puis chrétienne (avec ses importantes nuances catholique, protestante ou orthodoxe) d'autre part (3).
Enfin vient le problème majeur de savoir si l'histoire de la philosophie est commandée par une loi nécessaire de développement ou si elle est contingente ? C'est sans doute lui qui permet à la philosophie de se réapproprier véritablement son histoire en la réfléchissant comme telle.
Envisagée d'abord comme une histoire des sectes païennes par certains pères de l'Église, comme une histoire des sectes philosophiques par certains sceptiques (cela dès la période hellénistique puis romaine) ou comme un musée des errements de l'esprit humain (c'était souvent la position des penseurs français du dix-huitième siècle), elle aboutit, au début du dix-neuvième siècle, au syncrétisme et à l'éclectisme d'un Victor Cousin qui tend à remplacer l'histoire de la philosophie par la classification psychologique des systèmes de philosophie. Cousin suit de près les études allemandes d'histoire de la philosophie au point que G.W.F. Hegel (avec qui Cousin correspondait en français car Hegel écrivait parfaitement notre langue) s'amusait de ses «courses philosophiques» effectuées en Allemagne. Hegel qui, durant le premier tiers du dix-neuvième siècle, élabore le système philosophique le plus ample jamais formé, comprenant en tant que section à part entière l'histoire de la philosophie elle-même la plus ample jamais rédigée par un grand philosophe dans l'histoire de l'Occident. N'anticipons pas et procédons chronologiquement : Aristote est le père authentique de l'histoire de la philosophie.
II — Aristote père contingent de l'histoire de la philosophie
Le premier historien de la philosophie en tant que tel est Aristote. Contrairement à ce qu'assurait Bernard Bourgeois en 1968, ce n'est donc pas tout à fait chez Fichte (4) que la philosophie devient pour la première fois objet de la philosophie. Elle était déjà envisagée comme discipline autonome par Platon et Aristote mais c'est le second qui en fournit la première histoire systématique (5). Si Hérodote est le père de l'histoire, alors Aristote peut être considéré comme le père de l'histoire de la philosophie et cela, à deux titres : il vise l'exhaustivité en rassemblant systématiquement ses prédécesseurs, du moins ceux qu'il juge dignes de l'être; il confère à cette histoire un sens dans la mesure où chacun d'eux aurait émis une parcelle de la vérité que lui seul, néanmoins, possède.
 Ces deux exigences structurelles caractérisent ses héritiers modernes : G.W.F. Hegel et Auguste Comte sur le versant de la nécessité, Nietzsche et Heidegger sur le versant de la contingence. Hegel et Comte visent en effet, comme Aristote, l'encyclopédie totale du savoir scientifique de leur temps et, comme lui, ils écrivent une histoire de la philosophie qui couronne un édifice systématique, lui donnant un sens que sa rédaction parachève soigneusement dans le détail. Nietzsche et Heidegger n'ont pas d'ambition encyclopédique (ce qui les différencie fondamentalement de Hegel et de Comte) sauf concernant l'histoire de la philosophie qu'ils prétendent à leur tour interpréter d'une manière totale tout en acceptant (à la différence aussi de Hegel et de Comte) son aspect historique contingent. La plupart des philosophes et des historiens de la philosophie ne pourront guère que se situer dans un des deux camps : celui de la nécessité ou de la contingence de l'histoire de la philosophie. Aristote a peut-être le mérite d'avoir concilié d'avance ces deux positions : il est encyclopédiste, vise la totalité mais fait toute sa place à la contingence (l'aporie) au sein même de ses recherches systématiques.
Ces deux exigences structurelles caractérisent ses héritiers modernes : G.W.F. Hegel et Auguste Comte sur le versant de la nécessité, Nietzsche et Heidegger sur le versant de la contingence. Hegel et Comte visent en effet, comme Aristote, l'encyclopédie totale du savoir scientifique de leur temps et, comme lui, ils écrivent une histoire de la philosophie qui couronne un édifice systématique, lui donnant un sens que sa rédaction parachève soigneusement dans le détail. Nietzsche et Heidegger n'ont pas d'ambition encyclopédique (ce qui les différencie fondamentalement de Hegel et de Comte) sauf concernant l'histoire de la philosophie qu'ils prétendent à leur tour interpréter d'une manière totale tout en acceptant (à la différence aussi de Hegel et de Comte) son aspect historique contingent. La plupart des philosophes et des historiens de la philosophie ne pourront guère que se situer dans un des deux camps : celui de la nécessité ou de la contingence de l'histoire de la philosophie. Aristote a peut-être le mérite d'avoir concilié d'avance ces deux positions : il est encyclopédiste, vise la totalité mais fait toute sa place à la contingence (l'aporie) au sein même de ses recherches systématiques. Est-ce à dire que l'histoire de la philosophie fut inconnue des prédécesseurs d'Aristote ? Nullement mais ils ne lui conféraient pas un sens unifié ni ne la traitaient avec une exigence conceptuelle homogène. Au pire, on collectionnait matériellement les sentences et opinions illustres en recueils dont les matériaux sont parfois d'une remarquable richesse. Au mieux, c'est Platon qui émet des remarques d'histoire de la philosophie, éparses dans ses dialogues, mais sans en écrire une séparée ni séparable sur le plan littéraire du restant de son œuvre. Il y avait une ironie socratique que Platon et Xénophon ont rendue justement célèbre. Il y a une ironie platonicienne plus subtile que l'ironie socratique : lorsque Platon écrit un dialogue intitulé Parménide, le lecteur d'aujourd'hui croit, d'après son titre, qu'il va bénéficier des lumières historiques qu'une relative proximité chronologique entre Platon et Parménide le met en droit d'attendre. Ce n'est pourtant pas du tout le cas : il n'y a, en effet, guère de rapport historique entre les hypothèses et contre-hypothèses du dialogue platonicien intitulé Parménide et le poème original du véritable et vénérable Parménide d'Élée. Platon introduit même un décalage supplémentaire puisque Zénon d'Élée, le disciple bien réel de Parménide, est lui aussi mis en scène. Il utilise, au début du dialogue, sa véritable méthode de discussion (la réduction par l'absurde des arguments de l'adversaire) en permettant ainsi à Socrate d'introduire le problème purement platonicien du rapport entre les idées (ou formes) et les êtres particuliers sensibles. Problème soumis à plusieurs hypothèses sophistiquées par le Parménide fictif du dialogue qui prend le relais de son disciple Zénon. Pire : la sixième hypothèse énoncée (qui suppose la négation de l'un pour aboutir inévitablement à soutenir l'être du non-être) constitue, ainsi que l'a écrit en son temps Auguste Diès, la réponse du Parménide de Platon à la solennelle interdiction prononcée par le Parménide historique, à savoir le fameux : «Non ! Tu ne contraindras point les non-êtres à être».
Quant au Socrate de Platon, il est, depuis le dix-neuvième siècle, sujet à discussion historique particulièrement serrée (6). Ce jeu platonicien de miroirs est bien éloigné des exigences de l'histoire de la philosophie contemporaine mais il est aussi bien éloigné des exigences historiques ultérieures d'Aristote, disciple de l'Académie platonicienne mais qui rompt avec elle pour fonder sa propre école, le Lycée.
La sagesse (σοφία / sophia, en grec ancien) est définie par Aristote dans la Métaphysique (livre A, 1-2) comme la science recherchée des premiers principes et des premières cau
04/03/2022 | Lien permanent
Les SAS de Gérard de Villiers : un regard français sur le monde (SAS 1965-2013), par Francis Moury

 «[...] Cependant le philosophe ne méprise pas le mythe. [...] Encore faut-il avouer que cette aventure, dans laquelle nous nous trouvons bel et bien engagés, comporte de multiples périls, encore plus pour qui la tente du côté du mythe que pour qui la tente du côté des doctrines. [...] Pourtant, au point de civilisation où nous en sommes, et maintenant qu’à travers l’Europe les musées et les livres ont lâché tous les symboles de toutes les sagesses, tous les signes de toutes les magies, blanches ou noires, nous ne pouvons plus éviter la tâche de mettre de l’ordre dans nos richesses, d’apprendre à utiliser nos puissances et à enchaîner nos périls [...]».
«[...] Cependant le philosophe ne méprise pas le mythe. [...] Encore faut-il avouer que cette aventure, dans laquelle nous nous trouvons bel et bien engagés, comporte de multiples périls, encore plus pour qui la tente du côté du mythe que pour qui la tente du côté des doctrines. [...] Pourtant, au point de civilisation où nous en sommes, et maintenant qu’à travers l’Europe les musées et les livres ont lâché tous les symboles de toutes les sagesses, tous les signes de toutes les magies, blanches ou noires, nous ne pouvons plus éviter la tâche de mettre de l’ordre dans nos richesses, d’apprendre à utiliser nos puissances et à enchaîner nos périls [...]».Clémence Ramnoux, Mythe et métaphysique, in Revue de Métaphysique et de Morale (Éditions Armand Colin, 55e année, N°4 octobre-décembre 1950), pp. 408-431.
«John Turner se rapprocha de la glace du lavabo et inspecta soigneusement son visage. Il avait horreur d’être mal rasé. Le miroir lui renvoya l’image d’un homme aux traits réguliers mais sévères, les sourcils noirs fournis soulignaient des yeux gris verts qui semblaient inexpressifs. Le nez était important, au-dessus d’une grande bouche bien dessinée mais qui souriait rarement. John Turner était bel homme, mais son attitude distante et froide, due en grande partie à la timidité, accentuait son allure un peu gauche. Il semblait mal à l’aide dans son grand corps, et ne livrait rien de ses pensées».
Gérard de Villiers, SAS n°146 Le Sabre de Bin Laden (Éditions Gérard de Villiers / Malko Productions, 2002), p. 9.
Note liminaire du 1er novembre 2013.
La mort de Gérard de Villiers, survenue alors qu’il venait de publier, à la fois comme auteur et comme éditeur, son SAS n°200 (désormais dernier volume de la série, on le signale pour ceux qui veulent posséder la collection complète) rend d’actualité la réédition de notre texte initialement publié en 2005 sur le défunt site Internet Jeune France de Raphaël Dargent.
Notre ambition était simplement de faire le point sur quarante années de SAS, donc sur la période 1965-2005. La période 2005-2013 ne m’a pas fourni l’occasion de modifier mon point de vue : de Villiers est un auteur inégal mais, en ce qu’il a de bon, remarquable. Certes, de 2005 à 2013, les coquilles se font parfois plus quantitativement présentes au point que l’auteur lui-même doit s’en excuser dans une note liminaire d’un des deux volumes de SAS n°178-179 La Bataille des S-300. Les facilités demeurent : en 2006 dans SAS n°162 Que la bête meure – ne pas confondre avec le titre homonyme du film de Claude Chabrol de 1967 –, le milliardaire vénézuélien anti-Chavez dirige une agence recrutant des Miss, prétexte sociologique certes plausible à d’inévitables rencontres érotiques ! Ou bien encore tel personnage est nommé «James Whale», ce qui prouve que Villiers était cinéphile et connaissait l’histoire du cinéma fantastique américain classique : James Whale est en effet le nom du cinéaste qui a filmé Frankenstein (1931) puis La Fiancée de Frankenstein (1935). Ce qui a toujours intéressé de Villiers n’est pas la construction ni l’inspiration, c’est la réalité. D’où sa belle formule de l’écrivain «éponge» du réel sur laquelle la presse glose bêtement aujourd’hui. De fait, que tel personnage se nomme James Whale ne change rien à l’affaire : on trouve régulièrement dans chaque SAS de remarquables passages capables de résumer d’une manière incisive l’histoire d’une nation (par exemple la lutte anticommuniste – lutte interne contre le Pathet Lao et lutte externe des émigrés laotiens de 1968 à 2008 – au Laos dans SAS n°172 Retour à Shangri-La) ou d’un individu parfois emblématique mais demeurant concret, auquel on croit immédiatement (le transfuge nord-coréen dans SAS n°168-169 Le Défecteur de Pyongyang). Sans oublier les qualités de l’ouverture, en général stupéfiante de vérisme : par exemple la démentielle description du transfert physique de l’argent de la banque centrale de Bagdad au début du SAS n°163-164 Le Trésor de Saddam, en 2006 ou bien encore la manière dont on désosse un ancien pétrolier au Balouchistan dans SAS n°160 Aurore noire. Sans oublier l’ouverture presque néo-réaliste, d’une brutalité sordide mais vériste, du SAS n°190 Ciudad Juarez. Ce sont ces passages, ces moments souvent très forts par leur lucidité et leur puissance, qui permettent de considérer sans remord Gérard de Villiers pour ce qu’il fut effectivement : un passeur oscillant avec une précision méticuleuse, un sens du suspense non moins méticuleux, entre journalisme et lettres, politique et histoire, sociologie et géographie. Il fut, pour ma génération, à la fois notre Jean Hougron (car, de tous les continents, c’était probablement l’Asie que Villiers préférait) et notre Jean Lartéguy.
Gérard de Villiers est peut-être l’écrivain français le plus populaire en France et dans le monde aujourd’hui. Les chiffres de la série des SAS – Gérard de Villiers a publié d’autres œuvres, et même tout récemment ses mémoires, mais ce sont uniquement les SAS qui nous intéressent ici – parlent d’eux-mêmes : de 1965 (date du premier SAS) à septembre 2005, il a publié 159 SAS, tirés à 200 000 exemplaires chacun, soit en tout à peu près 150 millions de volumes publiés sans compter les traductions innombrables (un ami bibliophile, connaissant notre péché mignon, nous a récemment ramené un exemplaire de l’édition turque du SAS n°27 Safari à La Paz) et les éditions pirates.
Quarante ans d’histoire du monde, quarante ans d’évolution géopolitique sont rassemblés dans ces 159 volumes, publiés au rythme de quatre volumes par an. Balzac avait écrit une Comédie humaine, Gérard de Villiers raconte l’histoire du monde. Il arrive que les deux se recoupent puisque les hommes sont les acteurs de l’une comme de l’autre. SAS ou une vérité de l’histoire, voire une histoire de la vérité au sens le plus hégélien du terme ?
En apparence Gérard de Villiers ne semble guère s’intéresser à la France : son altesse sérénissime (SAS renvoie à ce titre mais était aussi un clin d’œil à sa compagnie aérienne scandinave favorite) le Prince Malko Linge est autrichien et voyage en mission pour la CIA partout dans le monde. Sauf en France où il ne séjourne qu’en transit à l’aéroport ou le temps de faire quelques courses à Paris. Gérard de Villiers avoue d’ailleurs que s’il avait écrit en anglais ses aventures, il eût probablement vendu bien davantage encore de volumes : le fait que Malko Linge soit un espion international s’y prêtait admirablement. Mais de fait, les SAS sont écrits en français. Et la vision du monde qu’ils expriment est bien celle d’un Français sur le monde actuel. SAS est un Autrichien qui pense en français et voit le monde comme un Français peut le voir. Première raison pour laquelle, de toute évidence, les lecteurs français l’apprécient.
Formé à Sciences-po puis par le journalisme, Gérard de Villiers s’est, au fil des rares entretiens parus de 1965 à nos jours (si l’on excepte, encore une fois, ses récents mémoires beaucoup plus amples et réflexifs), défini à la fois comme un journaliste et comme un romancier (1). C’est la première originalité qui caractérise son style : avant de publier un nouveau SAS, Gérard de Villiers part systématiquement enquêter dans le pays où son action aura lieu et il y vit suffisamment de temps pour capter l’esprit du lieu comme l’esprit du temps. Comme tout romancier aussi, il lit et se tient au courant. Il a des amis journalistes, des amis fonctionnaires et a connu personnellement quelques espions et aventuriers dont SAS Malko Linge est un condensé au physique mais également au moral. Comme tout journaliste Villiers dit la vérité lorsqu’il la voit : les noms des rues, la géographie d’une région, les types d’armes légères (ou lourdes) employées, l’architecture, les mœurs, les religions, la situation économique et sociale sont reproduits d’une manière exacte dans chaque SAS. Pas seulement reproduits, mais aussi soigneusement sélectionnés en fonction de leur poids, de leur signification intrinsèque en regard du récit spécifique qui va nous être contés et qui met à chaque fois en jeu l’idée d’un cancer local menaçant la santé du monde libre par sa soudaine virulence.
La toute première question que se pose le lecteur d’un SAS est : «Comment peut-on être SAS ?» et à cette première question, Gérard de Villiers a toujours soin de répondre. Il rappelle les motivations de son héros : elles sont d’abord économiques puisqu’il est rétribué pour ses missions et qu’il a, comme tout homme, besoin d’argent. Mais Linge étant un honnête homme bien éduqué et d’une lignée respectable, l’aspect éthique et politique de son travail ne lui est pas indifférent. Il arrive même que cet aspect contredise le précédent, le mette lui-même en danger, le pousse éventuellement à exécuter un des fonctionnaires (SAS n°60 Terreur à San Salvador) de l’organisation qui le commandite. Autrement dit, Linge est un héros répugnant à employer n’importe quel moyen pour arriver aux fins qui lui sont assignées. Il est systématiquement conscient des horreurs qu’il doit commettre pour éviter de plus grandes horreurs. Il mesure en outre à chaque passage dans un lieu les injustices sociales parfois terrifiantes qui ont créé le terreau favorable à la naissance du terrorisme qu’on lui demande de combattre. Ce terrorisme fut longtemps celui du communisme rouge international soutenu par l’URSS et la Chine maoïste. Pas exclusivement cependant : SAS a combattu des néo-nazis rescapés de la seconde guerre mondiale ou inspirés par elle, des complots africains, des escadrons de la mort paramilitaires comme leurs cibles paramilitaires de gauche, des narcotrafiquants, le terrorisme palestinien, israélien, l’islamisme fondamentaliste djihadiste et bien d’autres formes avérées prises par l’esprit de l’histoire. Ouvrir un SAS, c’est se trouver dans la situation de Hegel ouvrant son journal du matin. Un nouvel aspect véritable du monde va nous être donné : nous le savons d’avance. Nous savons aussi que nous allons découvrir un contenu véridique, violent parce que véridique, véridique parce que source de morts et de violence réellement advenues.
SAS n°59 Carnage à Abu Dhabi et SAS n°61 Le complot du Caire – écrits tous deux vers 1980 – traitaient déjà du djihadisme puisqu’ils s’inspiraient de faits réels au cœur desquels le lecteur informé savait le repérer comme cause motrice. Telle une abeille, Gérard de Villiers puise le nectar acide de l’histoire du monde au jour le jour et la relate. Il en livre parfois une version exacte à 80 % mais ignorée du grand public. Il modifie ou intervertit parfois aussi les données de telle équation mais le lecteur informé peut en rétablir les termes exacts (SAS n° 140 Enquête sur un génocide) ou, du moins, croit y être arrivé. D’une manière générale, depuis quarante ans, le lecteur français a le très net sentiment, lorsqu’il lit un SAS, qu’il passe de l’autre côté du miroir et qu’il a entre les mains une version non censurée des faits que lui livrent parcimonieusement les médias, un peu moins parcimonieusement les enquêtes journalistiques publiées sous forme d’articles dans les quotidiens sérieux ou sous forme de livre plus ample.
À cela plusieurs causes : la vérité des mentalités est d’abord la première. Certains personnages sont caricaturaux mais contiennent une part fondamentale de vérité. D’autres ne sont nullement caricaturaux et sont absolument véridiques. Simplement, la violence de leur pensée, de leurs actions, de leur langage est difficilement recevable par la critique littéraire française «bon chic bon genre» qui n’admet pas qu’on dépeigne des psychopathes ou des criminels d’une manière aussi directe. On ne le pardonne pas à Gérard de Villiers alors que c’est une de ses grandes qualités : il dit là le vrai. Les mêmes ne lui pardonnent pas davantage le vérisme sexuel : la pornographie et l’érotisme sont parties intégrantes des SAS car parties intégrantes de la vie des personnages qui sont parfois tout bonnement des personnes dont le nom a simplement été changé. La pornographie et l’érotisme seraient selon eux des figures de style populaires et vulgaires alors que ce sont précisément des éléments de la vérité de l’histoire lui permettant de progresser : leur part d’irrationalité existe et Gérard de Villiers le sait. Il les met en œuvre et le lecteur sincère s’y retrouve correctement. Certes, la maîtresse de Linge, la fameuse Alexandra, nous a pour notre part toujours, il faut bien l’avouer, laissé de marbre, mais bien des personnages féminins nous ont paru marqués au coin de la vérité documentaire la plus pure, la plus brûlante et la plus véridique. Les figures marginales de la sexualité sont représentées assez régulièrement par de Villiers : Linge pose sur elles un regard assez distant et compassé, mais il en tient compte en homme de terrain, sans les juger en moraliste. Il les croise, encore une fois, parce qu’elles existent.
Lire un SAS produit un double effet constant et identique : la satisfaction provoquée par une nouvelle connaissance, augmentée, du monde dans lequel nous vivons mais aussi la peur. La description de l’envers du miroir fait peur. Sans doute parce que nous devinons qu’une partie absolument exacte de la vision proposée est authentique ou parce que nous le constatons si nous connaissons bien la situation et avons visité, au même moment et à la même époque, le pays en question. Et aussi parce que l’autre partie, celle dont nous sommes incapables de savoir si elle est inspirée de faits réels ou non, apparaît si réelle qu’elle nous impressionne autant que la précédente. Dès lors qu’importent certaines coquilles, certaines rapidités coupables d’écriture qu’on peut repérer au hasard de certains volumes. Balzac lui-même orthographiait bien de diverses manières le même mot : l’essentiel n’est pas là. Qu’importe aussi certaines facilités de structure qui d’ailleurs, compte tenu de la nécessité dramaturgique du récit, n’en sont finalement pas car elles reproduisent tout bonnement ce qui se passerait effectivement dans tel ou tel cas de figure relativement (totalement, parfois) fondé. Le fond (la vérité dite en partie, en partie cachée) comme la forme (la manière de montrer la vérité, de la faire ressentir au lecteur) sont l’essentiel aux yeux de Villiers. Il n’y a pratiquement pas d’erreur concernant les descriptions d’armes légères : il sait ce qu’est un fusil d’assaut «M14» américain, «FN F.A.L» belge, «G3» ouest-allemand. Il sait aussi qu’un pistolet semi-automatique allemand Walther P38 est chambré en calibre 9mm Parabellum et pas en calibre 38 Spécial, encore moins, comme nous avions pu le lire une fois dans le journal Le Monde il y a bien longtemps, en calibre «P38 spécial» qui n’existe pour sa part absolument pas ! Il connaît l’univers physique, industriel, technologique qu’il décrit. Et il connaît l’univers moral, intellectuel, politique qu’il décrit. La fiction met en branle tout cela juste assez pour que la projection soit vivante aux normes de la fiction. Mais c’est bien d’abord la charge virulente extrême de la réalité qui demeure impressionnante dans tout bon SAS qui se respecte. Le rapport réalité-fiction est inversé par rapport aux proportions habituelles du genre : telle est la source féconde de l’originalité et de la valeur de cette série remarquable.
En tant que lecteur, nous avions cru possible à une époque, vers 1990 si nos souvenirs sont bons, de définir un âge d’or de la série. Nous pensions que les 40 premiers SAS parus pouvaient le constituer. Mais nous avons revu depuis ce jugement. Comme toute série, celle-ci connaît des hauts et des bas et régulièrement tel ou tel nouveau SAS nous surprennent. Il faut bien prendre la mesure de ce phénomène : on pouvait concevoir qu’il soit facile de surprendre un Français de 1965 n’ayant jamais voyagé, ne lisant pas Le Monde, Le Figaro ni Libération quotidiennement. Celui de 1980 était un peu plus au courant de l’histoire du monde, nolens volens. Eh bien, celui de 2005 – y compris l’intellectuel – peut toujours être surpris, en dépit des innombrables moyens de diffusion de l’information à sa disposition. C’est qu’en effet, cette politique-fiction repose sur un style propre, une vision du monde spécifique, acérée, lucide, à nulle autre pareille dans le genre «espionnage». Nous nous souvenons qu’un architecte cambodgien nous avait avoué son étonnement devant la richesse d’information (sur tous les plans) de la situation décrite en son temps et en son lieu par SAS n°35 Roulette cambodgienne. Et que, lorsque nous avions lié connaissance avec un jeune appelé laotien lors de notre service militaire au 110e RI, il nous avait confirmé les détails géographiques que nous lui citions, de mémoire de fervent lecteur, d’après SAS n°28 L’Héroïne de Vientiane. Autre souvenir : un jeune homme dont le père avait été en poste à Bagdad nous vantait la précision des descriptions de SAS n°14 Les Pendus de Bagdad.
Souvent, le meilleur passage des meilleurs SAS est le premier chapitre, qui plante le décor et met en branle l’action qui va déterminer au chapitre suivant le recours à Linge. Gérard de Villiers utilise pour cela deux procédés éminemment cinématographiques : soit il part d’un plan d’ensemble pour ensuite isoler un détail; soit il part d’un détail pour élargir celui-ci en «zoom-arrière» et le planter dans sa proche universalité. L’efficacité de l’écriture, sans que le héros soit encore intervenu, est alors en général maximale. On n’oublie pas, une fois qu’on les a lues, les ouvertures des SAS n°20 Mission à Saigon, SAS n°17 Amok à Bali, SAS n° 22 Les parias de Ceylan, SAS n° 32 Murder Inc. Las Vegas et tant d’autres comme celles, admirables du point de vue de la dynamique et du rythme, de SAS n° 53 Croisade à Managua, SAS n°98 Croisade en Birmanie ou encore celles de SAS n° 97 Cauchemar en Colombie et SAS n°102 La Solution rouge.
Les chapitres suivants agissent comme révélateurs au sens photograph
08/11/2013 | Lien permanent
Aux origines du gaullisme : note sur le personnalisme d'Emmanuel Mounier, par Francis Moury

 Cet article de Francis Moury a paru dans une version quelque peu écourtée et amputée de sa bibliographie sommaire dans la revue de Raphaël Dargent, Libres – La Revue de la pensée française n°4, spécial Vrais et/ou faux gaullistes (éditions François-Xavier de Guibert, novembre 2006, pp. 169-171), sous le titre Emmanuel Mounier, philosophe français 1905-1950. Je remercie une nouvelle fois Raphaël Dargent de m'avoir autorisé à reproduire un article ayant paru dans sa revue.
Cet article de Francis Moury a paru dans une version quelque peu écourtée et amputée de sa bibliographie sommaire dans la revue de Raphaël Dargent, Libres – La Revue de la pensée française n°4, spécial Vrais et/ou faux gaullistes (éditions François-Xavier de Guibert, novembre 2006, pp. 169-171), sous le titre Emmanuel Mounier, philosophe français 1905-1950. Je remercie une nouvelle fois Raphaël Dargent de m'avoir autorisé à reproduire un article ayant paru dans sa revue.Dernière précision : il va de soi que ce texte peut être légitimement lu comme un complément à l'entretien, précédemment paru dans la Zone, entre Jean Charbonnel et Raphaël Dargent sur la question du chiraquisme.
«Quand nous disons que la personne est en quelque manière un absolu, nous ne disons pas qu’elle est l’Absolu; encore moins proclamons-nous, avec les Droits de l’homme, l’absolu de l’individu juridique.»
Emmanuel Mounier, Révolution personnaliste et communautaire, Aubier, 1935, p. 65.
«On ne saurait se dissimuler le caractère global de la réaction existentialiste. Chrétienne ou athée, elle marque un retour du religieux dans un monde qui a tenté de se constituer dans le pur manifeste. […] Le rationalisme occidental garde un message vivant à entretenir dans le monde : l’existentialisme, s’il échappe à ce baroquisme de l’indigence spirituelle où certains semblent le pousser, s’il redécouvre sans jeu de mots la plénitude de l’existence, peut en renouveler le visage et l’esprit devant les continents qui déjà s’avancent vers nous avec leurs richesses énormes, et leur dédain.»
Emmanuel Mounier, Introduction aux existentialismes, Denoël, 1947, pp. 154-156.
«L’idée de liberté et l’idée de personne sont au centre de la philosophie française. […] Nous pourrons dire que si la philosophie de Lachelier, de Boutroux, de Renouvier et de Hamelin, de Bergson s’achève par l’idée de la personne, la philosophie de Descartes s’ouvre par elle.»
Jean Wahl, Tableau de la philosophie française, Gallimard, coll. Idées, 1962, pp. 141-142.
Il semble que la revue Esprit qu’il fonda en 1932 ait survécu à la pensée strictement philosophique d’Emmanuel Mounier. Il convient donc de revenir à la source pour rétablir une perspective correcte.
Son premier livre, corédigé mais déjà personnel, consacré à La pensée de Charles Péguy (1931) annonçait en germe son développement. Mais ni Révolution personnaliste et communautaire (1935) ni De la propriété capitaliste à la propriété humaine (1936) ne furent considérés comme dignes d’être seulement mentionnés dans les manuels scolaires de philosophie des années 1940 qui étaient en général au courant de la dernière évolution de la pensée française : pas un mot sur Mounier chez les pourtant très complets et honnêtes Paul Foulquié (1938) ou Armand Cuvillier (1942) ! Si Mounier n’est naturellement pas cité dans la première édition (1932) de la monumentale Histoire de la philosophie d’Émile Bréhier (1876-1952), il ne sera pas intégré pour autant dans les éditions suivantes parues du vivant de Bréhier qui néglige totalement Mounier dans son ultime ouvrage : Les thèmes actuels de la philosophie (1951). Même chose pour Jean Wahl qui ne lui consacre pas une ligne dans l’édition originale de son Tableau de la philosophie française (1946) ni dans sa réédition de 1962 alors que certains développements faisaient attendre qu’on citât son nom. Mounier n’est tout simplement pas considéré par l’Université française de son temps comme un philosophe digne d’être cité. C’est l’Anthologie philosophique de Léon-Louis Grateloup (1974) qui va lui rendre les honneurs scolaires au chapitre intitulé La personne (correspondant au nouveau programme des classes terminales) et comprenant deux extraits et une introduction critique. En revanche, le manuel clairement orienté «pensée 68» d’André Le Gall, Textes nouveaux pour une philosophie nouvelle (1973) ne lui consacre pas une seule page alors que Deleuze, Foucault et consorts s’en voient consacrer des dizaines ! Du point de vue universitaire, c’est Jean Lacroix qui lui consacre enfin quelques belles et claires pages dans les années 1960-1970. Le décalage chronologique de la reconnaissance de Mounier «penseur» par rapport au Mounier «intellectuel politique» est donc patent et rétrospectivement étrange.
C’est que politiquement Mounier est un peu trop équilibré et que philosophiquement il n’est pas original : on ne lui pardonne le premier trait ni à gauche ni à droite; on le méprise cordialement dans les cercles universitaires en raison du second.
Fils de paysans grenoblois, agrégé de philosophie, Emmanuel Mounier fut d’abord l’ami du thomiste Jacques Maritain qui publiera son premier livre de 1931 dans la collection Le Roseau d’or qu’il dirigeait chez Plon. Mounier refuse l’individualisme libéral autant que le collectivisme fasciste comme communiste : c’est d’abord un rationaliste catholique. Esprit est interdit en 1941 après avoir désavoué le statut imposé aux Juifs par le Régime de Vichy, sous couvert d’un article consacré à… Péguy. On refuse à Mounier l’accès à l’École des cadres d’Uriage; on l’exclut du mouvement culturel Jeune France qu’il animait; enfin ses contacts avec le directeur du journal Combat lui valent d’être emprisonné en 1942. Il est acquitté mais se rallie décidément à la Résistance et passe dans la clandestinité. L’après-guerre sera naturellement pour lui comme pour Esprit une période de gloire mondaine et d’influence politique. Il œuvre en faveur de la réconciliation avec l’Allemagne. Il est d’abord compagnon de route des communistes mais s’en détache dès novembre 1949. Dès lors, il se «recentre», comme on dit, même si sa revue connaît, pour sa part, une toute autre évolution.
Mounier déclarait que l’événement «était son maître intérieur». Il n’a pas abdiqué pour autant son ambition philosophique. Pendant sa période résistante, il s’intéressait à la psychologie et à la caractérologie mais les travaux plus assidus de Le Senne dans la même direction éclipsèrent évidemment les siens. Après 1945, Mounier écrit, en partie peut-être à l’usage de son prestigieux «transfuge» Maurice Merleau-Ponty passé, comme on sait, d’Esprit aux Temps Modernes dirigés par Jean-Paul Sartre, une Introduction aux existentialismes (1947) et un volume de la collection Que-sais-je ? sur Le personnalisme (1949) dans lesquels il se revendique haut et fort héritier de Kierkegaard et Gabriel Marcel bien davantage que de Hegel, Husserl ou Heidegger, à la différence de Sartre. Dans ces deux ouvrages, il affirme clairement et distinctement que son personnalisme est métaphysiquement issu d’un existentialisme chrétien dont il s’attache à préciser les origines et l’évolution.
Il faut absolument tenter de se procurer l’édition originale de son Introduction aux existentialismes car la page 11 est illustrée d’un magnifique «Arbre des existentialismes» probablement dessiné par Mounier lui-même et dont les racines remontent à Socrate, aux stoïciens, à saint Augustin et saint Bernard. L’amorce du tronc est constituée par Pascal et Maine de Biran puis le tronc lui-même par Kierkegaard. Le sommet du tronc est la phénoménologie husserlienne. La branche gauche est Sartre précédé par Heidegger et Nietzsche; la branche droite est celle du personnalisme de Mounier, située entre celles de Karl Jaspers et de Gabriel Marcel. Entre ces deux branches extrêmes, et en faisant courir son regard de droite à gauche, on constate que Mounier a réparti harmonieusement ses autres sources spirituelles : Vladimir Soloviev, Léon Chestov, Nicolas Berdiaev, Martin Buber, Karl Barth, Max Scheler, Herrad von Landsberg, Henri Bergson, Maurice Blondel, Lucien Laberthonnière. Trois ans avant sa mort, Mounier s’était donc soigneusement situé dans l’histoire de la philosophie française comme dans l’histoire de la philosophie occidentale. Pourtant c’est paradoxalement de la philosophie pratique de Kant qu’un interprète comme Grateloup fera dériver son intuition métaphysique fondatrice, en particulier de la seconde maxime de l’impératif catégorique qui exige que l’on traite les personnes comme des fins. Et Grateloup de citer à juste titre un illustre intermédiaire entre Kant et Mounier, nous voulons parler de Charles Renouvier, fondateur du criticisme et condisciple à Polytechnique du génial philosophe Jules Lequier. Dans les années 1950, Lucien Sève tenta de tirer le personnalisme dans le sens du marxisme : tentative absurde, typique du climat de cette époque.
Parmi les hommes politiques qui furent ses contemporains, c’est en fait Charles de Gaulle qui l’a lu le plus attentivement. L’idée gaullienne de la participation est directement inspirée du texte mounien de 1936. En outre, le parcours individuel comme politique et spirituel de Mounier ressemblait au sien : il pouvait sembler au Général de Gaulle qu’ils avaient été nourris tous deux aux mêmes sources, avaient traversé les mêmes épreuves, en avaient tiré les mêmes leçons.
Bibliographie
1) Œuvres d’Emmanuel Mounier (sauf indication contraire, la ville d'édition est toujours Paris)
- La pensée de Charles Péguy, éd. Plon, coll. Le Roseau d’or, 1931.
- Révolution personnaliste et communautaire, éd. Aubier, 1935.
- De la propriété capitaliste à la propriété humaine, éd. Desclée de Brouwer, coll. Questions disputées, 1936.
- Manifeste au service du Personnalisme, éd. Montaigne, 1936.
- L’Affrontement chrétien, éd. La Baconnière, Neuchâtel 1944-1945.
- Montalembert – Morceaux choisis, éd. Luf, Fribourg, 1945.
- Liberté sous condition, éd. du Seuil, 1946.
- Traité du caractère, éd. du Seuil, 1946.
- Qu’est-ce que le personnalisme ?, éd. du Seuil, 1947.
- Introduction aux existentialismes, éd. Denoël, 1947 (rééd. 1960)
- La petite peur du XXe siècle, éd. La Baconnière, Neuchâtel 1948.
- Le personnalisme, éd. P.U.F., coll. Que-sais-je ? n°395, 1949.
- Feu la chrétienté, 1950.
- Œuvres, éd. du Seuil, Paris 1961-1963 divisées en 4 volumes.
2) Études sur sa pensée
Son meilleur exégète universitaire demeure Jean Lacroix qui le rencontre dès 1928 et avec qui il fonde Esprit :
- Jean Lacroix, Vocation personnelle et tradition nationale, éd. Bloud & Gay, coll. La Nouvelle journée, 1942 : le nom de Mounier n’y est, sauf erreur, pas mentionné mais le chapitre final de conclusion, après des études très suggestives sur Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Auguste Comte et Charles Renouvier, s’intitule tout de même Personne et personnalisme.
- Jean Lacroix, Personne et amour, éd. du Livre Français, coll. Construire, 1942 puis réédition revue et augmentée aux éd. du Seuil, 1955.
- Jean Lacroix, Marxisme, existentialisme, personnalisme – Présence de l’éternité dans le temps, 7e éd. P.U.F., coll. B.P.C., 1949.
- Jean Lacroix, Le personnalisme comme anti-idéologie, éd. P.U.F., coll. SUP n°105, 1972.
On peut également consulter :
- le numéro spécial de la revue Esprit en hommage à Mounier, 1950, contenant des textes d’H.-I. Marrou, F. Goguel, P. Fraisse, P. Ricoeur, P.-A. Touchard, etc.
- le volume collectif Mounier et sa génération – Lettres, carnets et inédits 1956.
- J. Calbrette, Mounier le mauvais esprit, 1957.
Version revue, corrigée et augmentée le lundi 15 janvier 2007.
20/01/2007 | Lien permanent



























































