Rechercher : francis moury george romero
Solaris d’Andreï Tarkovski, par Francis Moury

 Andreï Tarkovski dans la Zone.
Andreï Tarkovski dans la Zone.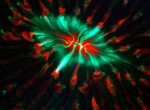 Solaris de Stanislas Lem et le Dieu incompréhensible.
Solaris de Stanislas Lem et le Dieu incompréhensible.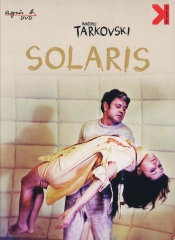 Acheter Solaris de Tarkovski sur Amazon.
Acheter Solaris de Tarkovski sur Amazon.Argument du scénario
Sur une station orbitale qui étudie la planète Solaris depuis des années, des phénomènes étranges se produisent au point que les responsables terrestres soviétiques du projet envoient le psychologue Kelvin enquêter sur place. Il découvre que son ami Gibarian (un des trois derniers occupants de la station) s’est suicidé et que les deux autres savants rescapés ont peur. Kelvin ne tarde pas à émettre l'hypothèse que Solaris est un gigantesque organisme vivant qui réagirait au psychisme humain en matérialisant ses désirs comme ses peurs.
 Solaris (URSS, 1972) d’Andreï Tarkovski fut récompensé par le Grand Prix Spécial du Jury du Festival de Cannes de 1972 et par celui du Centre International Évangélique du Film. Il fut exporté par la suite dans des dizaines de pays, comme une réponse soviétique au 2001 : l’odyssée de l’espace (USA, 1968) de Stanley Kubrick. Tarkovski dénia la valeur de ce rapprochement mais certains éléments ne laissent pas d’y faire néanmoins penser : le témoignage terrestre du cosmonaute qui a vu un enfant monstrueux devant un aréopage de scientifiques rappelle un peu la réunion internationale entre savants à laquelle on annonce la découverte d’un monolithe; l’idée même de l’enfant monstrueux correspond peut-être au bébé surhomme de la fin du film de Kubrick. C’est pourtant avec un titre plus ancien (et bien supérieur à celui de Kubrick qui demeure certes riche mais qui est, hélas, structurellement déséquilibré et intellectuellement insatisfaisant) que Solaris entretient des similitudes étroites : nous voulons parler du génial Planète interdite [Forbidden Planet] (USA, 1956) de Fred McLeod Wilcox. En 1956, une planète autrefois occupée par une race supérieure qui a réussi à matérialiser son propre inconscient et ses pulsions monstrueuses afin de les expulser au dehors sous une forme physique; en 1972, une planète elle-même vivante qui matérialise momentanément les désirs des hommes qui s’en approchent. C’est le fait que la planète soit elle-même vivante qui constitue la «différence spécifique» du film de Tarkovski. Il faut noter que l'idée d'une planète vivante avait été déjà illustrée d'une manière brève et percutante par une nouvelle du recueil de contes de science-fiction de Jacques Sternberg, Univers zéro (éditions André Gérard, coll. Bibliothèque Marabout, série science-fiction, Verviers, Belgique 1969).
Solaris (URSS, 1972) d’Andreï Tarkovski fut récompensé par le Grand Prix Spécial du Jury du Festival de Cannes de 1972 et par celui du Centre International Évangélique du Film. Il fut exporté par la suite dans des dizaines de pays, comme une réponse soviétique au 2001 : l’odyssée de l’espace (USA, 1968) de Stanley Kubrick. Tarkovski dénia la valeur de ce rapprochement mais certains éléments ne laissent pas d’y faire néanmoins penser : le témoignage terrestre du cosmonaute qui a vu un enfant monstrueux devant un aréopage de scientifiques rappelle un peu la réunion internationale entre savants à laquelle on annonce la découverte d’un monolithe; l’idée même de l’enfant monstrueux correspond peut-être au bébé surhomme de la fin du film de Kubrick. C’est pourtant avec un titre plus ancien (et bien supérieur à celui de Kubrick qui demeure certes riche mais qui est, hélas, structurellement déséquilibré et intellectuellement insatisfaisant) que Solaris entretient des similitudes étroites : nous voulons parler du génial Planète interdite [Forbidden Planet] (USA, 1956) de Fred McLeod Wilcox. En 1956, une planète autrefois occupée par une race supérieure qui a réussi à matérialiser son propre inconscient et ses pulsions monstrueuses afin de les expulser au dehors sous une forme physique; en 1972, une planète elle-même vivante qui matérialise momentanément les désirs des hommes qui s’en approchent. C’est le fait que la planète soit elle-même vivante qui constitue la «différence spécifique» du film de Tarkovski. Il faut noter que l'idée d'une planète vivante avait été déjà illustrée d'une manière brève et percutante par une nouvelle du recueil de contes de science-fiction de Jacques Sternberg, Univers zéro (éditions André Gérard, coll. Bibliothèque Marabout, série science-fiction, Verviers, Belgique 1969).Il faut cependant savoir que Tarkovski n’était pas intéressé par l’aspect «science-fiction» du roman de Stanislas Lem mais par son aspect moral et par l’histoire d’amour qu’il mettait en jeu, vision que Tarkovski n’a de cesse d’opposer à une vision scientifique et matérialiste de la réalité. On sait qu’il eût voulu tourner, à la limite, cette histoire sur la Terre. Évidemment tout eût été différent et nous n’aurions pas vu le même film. Cela dit, il faut aussi se méfier des déclarations a posteriori d’un cinéaste sur le film qu’il aurait voulu faire : ce qui compte c’est d’abord bel et bien le résultat filmé. Et de ce point de vue, il est évident qu’il y a une thématique intellectuelle commune aux trois films signés respectivement par McLeod Wilcox, Kubrick et Tarkovski : à savoir celle du «Connais-toi toi-même et tu connaîtras le reste de l’univers» de Socrate, formule philosophique qui est technologiquement médiatisée de la même manière. L’homme, dans les trois titres, obtient des révélations sur sa nature et ses virtualités prodigieuses en se confrontant avec l’altérité absolue : une planète interdite en 1956, un monolithe dispensateur d'intelligence en 1968, un océan intelligent et vivant chez Tarkovski.
Tarkovski n’a, de toute évidence, pas bénéficié du colossal budget de ses deux concurrents américains : Solaris est pauvre en maquettes comme en effets spéciaux. Les seuls éléments visuels ressortant vraiment de la science-fiction sont le décor du vaisseau, sa fusée fragmentaire, les plans de la planète elle-même. Le reste est terrestre. Solaris est épuré, relativement dénudé de toute séduction facile et spectaculaire : les plans de la planète sont répétitifs et volontairement «simples», bien qu’ils soient majestueux et d’une profonde beauté. Le décor intérieur de la station est, de même, minimaliste en comparaison de ce que les films américains de 1956 et 1968 nous montraient. Tarkovski filme une fable philosophique d’une manière réaliste, ni plus ni moins : on dirait presque d'une manière «réaliste soviétique» au sens sadoulien, mais ce serait une aberration du point de vue historique. C’est pourtant le terme qui nous vient spontanément à l’esprit.
Tarkovski débute son récit par une vision de la Terre différente de celle de 2001 : l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, et sans lien non plus avec les rapports sociologiques conventionnels de Planète interdite de Fred McLeod Wilcox. Le cheminement n’y est pas le même parce que, par-delà tout ce dispositif de science-fiction, l’homme est enraciné à sa situation humaine et l’altérité mystérieuse de Solaris ne concourt qu’à confirmer cette situation en la démultipliant dans le temps et l’espace. Solaris est la planète non pas d’un futur surhomme (possibilité ultime représentée par le bébé mutant aperçu à la fin de 2001 : l'Odyssée de l'espace) ou d’un homme accompli (ayant surmonté victorieusement le complexe d'Œdipe, contrairement au père maudit joué par Walter Pidgeon dans Planète interdite), mais la planète où l’homme se confirme comme inachevé essentiellement, comme essentiellement contingent et fini. Un détour lointain pour en revenir là... sans gain spécifique lié au déplacement : c’est toute l’ironie du traitement par Tarkovski de cette «grosse machine». C’est aussi toute sa poésie nue et évidente : la science-fiction est un moyen externe qui n’intéresse pas Tarkovski. Le héros revient à sa «datcha» qui est montrée en un très beau plan comme incorporée dans ce miroir actif qu’est, en somme, Solaris.
L’amour humain est, assurément, le thème central du film et son personnage principal est une femme, alors que la femme n’avait qu’une place parfaitement subalterne dans l’économie narrative de 2001 : l'Odyssée de l'espace, et que c’était bien davantage le rapport œdipien père-fille qui était l'objet de Planète interdite.
Solaris est, en somme, un curieux huis-clos déplacé qui, s’il s’était passé sur la Terre dans une maison isolée, aurait été considéré comme un film fantastique et non plus comme un film de science-fiction. C’est qu’au fond Solaris est à cheval entre les deux genres : esthétiquement impur même si filmographiquement cohérent avec la thématique générale de son réalisateur. Thématique qui est celle, métaphysique, de l’existentialisme chrétien tel qu’il s’est exprimé dans l’histoire de la philosophie depuis Kierkegaard jusqu'à Gabriel Marcel. Raison pour laquelle le film fut plébiscité, comme le signalait en 1999 sa vedette Natalia Bondartchouck, par les églises chrétiennes catholiques, protestantes et orthodoxes. Car Solaris fut d’abord reçu, en 1972, comme une preuve de la vitalité d’une spiritualité orthodoxe inquiète et contemplative en pleine période soviétique officiellement athée et «scientifique». Avec raison. Notons que la projection de Solaris à la Seconde Convention française du Cinéma Fantastique qui s’était tenue du 8 au 15 avril 1973 au cinéma Le Palace (rue Bergère, à Paris) constitua, passée sa première partie, une cruelle déception pour les inconditionnels du genre. L’importance des dialogues philosophiques de la seconde partie rendait le film trop statique à leurs goûts. Et cela se conçoit aisément : Solaris est une fable philosophico-théâtrale de 160 minutes simplement travestie en adaptation d’un roman de science-fiction. Sa mayonnaise ne prend pas, sur le plan de la science-fiction, parce que Tarkovski n’a pas jugé utile qu’elle prenne. Solaris est, avec le recul, devenu un étrange objet cinéphilique davantage qu’un film majeur du maître. Sa lourdeur démonstrative est, cependant, à plusieurs reprises, victorieusement annulée par le sens cinématographique visuel le plus pur de Tarkovski.
Nota Bene
Ce texte est une version revue et corrigée de ma critique parue le 14 juillet 2005 sur Stalker - Dissection du cadavre de la littérature. Cette critique était elle-même issue de la refonte de la section critique de mon test global du DVD zone 2 PAL édité en France par MK2 il y a dix ans. J'ai supprimé la fiche technique succincte du film (on en trouve de bien plus précises actuellement sur Internet) et j'ai, notamment, précisé davantage par rapport à la première version un certain nombre de points sur lesquels, selon moi, Solaris s'éloigne ou se rapproche de 2001 : l’Odyssée de l'espace et de Planète interdite.
18/06/2016 | Lien permanent
La nuit du chasseur de Charles Laughton, par Francis Moury

 Durant la grande dépression économique des années 1930, dans l'état de Virginie aux États-Unis, Harry Powell assassine des veuves. Convaincu d'œuvrer pour Dieu en nettoyant la Terre de la perversité féminine, il se fait passer pour un pasteur protestant dont il a le langage et les connaissances bibliques. Incarcéré pour vol dans la même cellule que Ben Harper condamné à mort pour vol avec meurtre, il parvient à recueillir de sa bouche une partie du secret concernant son butin. Libéré, Powell épouse la veuve de Harper afin de se rapprocher de l'argent. Mais les deux enfants Harper finissent par lui être hostiles et la veuve découvre sa véritable nature. Powell la tue à son tour. Les deux enfants Harper fuient à travers toute la Virginie. Powell, obstinément attaché à ses proies, les retrouve sous la protection d'une veuve charitable, dirigeant un foyer pour les enfants victimes de la crise, abandonnés ou orphelins...CritiqueLa Nuit du chasseur (The Night of the Hunter, États-Unis, 1955) de Charles Laughton – repris par Carlotta Films en copie neuve à Paris à partir du 13 avril 2011 – est un de ces films inclassables, initialement maudits puis devenu classiques, passibles d'appartenance à plusieurs genres à la fois. Film fantastique au premier chef, film noir policier aussi, sans aucun doute... et bien d'autres genres encore (aventure, insolite, comédie dramatique, drame psychologique) au fil des séquences. Cela tient à son fond comme à sa forme.Laughton, grand acteur «oscarisé» dès les années 1930, avait incarné plusieurs personnages de l'âge d'or américain 1931-1945 du cinéma fantastique : The Old Dark House [Une soirée étrange / La Maison grise] (1932) de James Whale, Island of Lost Souls [L'île du docteur Moreau] (1932) d'Erle C. Kenton, The Hunchback of Notre Dame [Quasimodo] (1939) de William Dieterle et, plus tard, The Strange Door [Le Château de la terreur / Emmuré vivant] (1951) de Joseph Pevney. Il eut aussi l'occasion de s'illustrer dans le film noir policier : The Paradine Case [Le Procès Paradine] (1947) d'Alfred Hitchcock, Witness For the Prosecution [Témoin à charge] (1957) de Billy Wilder, Advise and Consent [Tempête à Washington] (1962) d'Otto Preminger. Ce furent ses meilleurs rôles, sans oublier son interprétation du sadique capitaine de la première grande version hollywoodienne des Révoltés du Bounty, opposé à Clark Gable.
Durant la grande dépression économique des années 1930, dans l'état de Virginie aux États-Unis, Harry Powell assassine des veuves. Convaincu d'œuvrer pour Dieu en nettoyant la Terre de la perversité féminine, il se fait passer pour un pasteur protestant dont il a le langage et les connaissances bibliques. Incarcéré pour vol dans la même cellule que Ben Harper condamné à mort pour vol avec meurtre, il parvient à recueillir de sa bouche une partie du secret concernant son butin. Libéré, Powell épouse la veuve de Harper afin de se rapprocher de l'argent. Mais les deux enfants Harper finissent par lui être hostiles et la veuve découvre sa véritable nature. Powell la tue à son tour. Les deux enfants Harper fuient à travers toute la Virginie. Powell, obstinément attaché à ses proies, les retrouve sous la protection d'une veuve charitable, dirigeant un foyer pour les enfants victimes de la crise, abandonnés ou orphelins...CritiqueLa Nuit du chasseur (The Night of the Hunter, États-Unis, 1955) de Charles Laughton – repris par Carlotta Films en copie neuve à Paris à partir du 13 avril 2011 – est un de ces films inclassables, initialement maudits puis devenu classiques, passibles d'appartenance à plusieurs genres à la fois. Film fantastique au premier chef, film noir policier aussi, sans aucun doute... et bien d'autres genres encore (aventure, insolite, comédie dramatique, drame psychologique) au fil des séquences. Cela tient à son fond comme à sa forme.Laughton, grand acteur «oscarisé» dès les années 1930, avait incarné plusieurs personnages de l'âge d'or américain 1931-1945 du cinéma fantastique : The Old Dark House [Une soirée étrange / La Maison grise] (1932) de James Whale, Island of Lost Souls [L'île du docteur Moreau] (1932) d'Erle C. Kenton, The Hunchback of Notre Dame [Quasimodo] (1939) de William Dieterle et, plus tard, The Strange Door [Le Château de la terreur / Emmuré vivant] (1951) de Joseph Pevney. Il eut aussi l'occasion de s'illustrer dans le film noir policier : The Paradine Case [Le Procès Paradine] (1947) d'Alfred Hitchcock, Witness For the Prosecution [Témoin à charge] (1957) de Billy Wilder, Advise and Consent [Tempête à Washington] (1962) d'Otto Preminger. Ce furent ses meilleurs rôles, sans oublier son interprétation du sadique capitaine de la première grande version hollywoodienne des Révoltés du Bounty, opposé à Clark Gable. Que La Nuit du chasseur, son œuvre unique en tant que cinéaste, relève de ces deux genres thématiques n'est donc pas surprenant. La surprise provient plutôt des excès du scénario : la critique du puritanisme américain protestant y est quasiment psychanalytique, à la manière dont l'était déjà sans le savoir ce classique de Nathaniel Hawthorne, La Lettre écarlate. Le névrosé criminel, incarné d'une manière parfois expressionniste par Robert Mitchum, est inoubliable pour plusieurs raisons, la première étant sans doute, aux yeux d'un spectateur américain, son incarnation d'une tendance lourde dont on trouve des échos systématiques dans le cinéma hollywoodien indépendant comme dans celui des «majors» : Cape Fear [Les Nerfs à vif] (1992) de Martin Scorsese, par exemple, où le personnage dément joué par Robert de Niro appartient à la même famille «spirituelle» que le personnage d'Harry Powell joué par Mitchum, l'uniforme usurpé en moins mais une violence graphique démesurée en plus. Cette première raison fut probablement déterminante concernant l'échec financier dont Laughton ne se releva pas puisque, blessé par cet échec, il ne revint ensuite plus jamais à la mise en scène. C'était d'ailleurs inutile car il n'aurait probablement jamais pu nous donner un tel film une seconde fois.Shelley Winters qui joue l'autre névrosée du scénario – acceptant d'être assassinée plutôt que de renoncer à son illusion morbide – était alors élève des cours d'art dramatique que donnait Laughton. Quelques années avant ou après, son physique et son âge ne lui auraient pas permis d'interpréter le rôle comme elle le fit. On peut remarquer, à son propos, que Laughton et son scénariste font mourir la star féminine (une star au physique neutre, une anti-star, en réalité, dans le contexte de l'époque) avant la fin de la première moitié du film, cinq ans avant que l'ensemble de la critique internationale ne crédite Alfred Hitchcock d'une telle innovation concernant Janet Leigh dans Psychose (1960). Dans l'histoire du cinéma, on peut en général trouver des précédents : il suffit de les chercher mais surtout de vouloir les chercher. Inversement, on pourrait aussi penser que Robert Mitchum est l'anti-Joel McCrea dans Stars In My Crown (1950) de Jacques Tourneur : Mitchum est un pasteur qui provoque l'agressivité au lieu de la combattre, un névropathe criminel capable de s'en prendre à des enfants alors que le personnage de McCrea est, durant tout le film, remémoré comme l'idéal du père protecteur par le narrateur devenu adulte, en voix off. Peut-être trouverait-on aussi dans la filmographie de Lillian Gish, l'ancienne star du cinéma muet ici étonnante de vivacité et d'intelligence maternelle, un précédent à de tels rôles angéliques ? Sur le plan de l'histoire du cinéma, La Nuit du chasseur a donc autant reçu qu'on lui a emprunté, et c'est bien naturel. Sur le plan esthétique, en revanche, son originalité est patente. Le film emploie une syntaxe et une morphologie qui passent toutes deux constamment du classicisme narratif (l'arrivée de Harper chez lui et son arrestation) au baroque (la fuite cosmologique nocturne des enfants le long de la rivière, observée par des animaux variés, filmés en premier plan tandis que les enfants sont très loin en profondeur de champ) voire à l'expressionnisme (les plans durant lesquels Mitchum se prépare à tuer Shelley Winters). Certains plans inspirés ressortent de L'Écran démoniaque tel que Lotte H. Eisner l'avait défini (1), mais un écran démoniaque également traversé par une esthétique anglo-saxone de l'efficacité : en témoigne par exemple le «strip-tease» au cour duquel la violence dangereuse de Mitchum est, pour la première fois, réellement visualisée en temps réel grâce à l'idée géniale, symbolique de la démence meurtrière du personnage, du couteau à cran d'arrêt perçant sa propre poche, faute de pouvoir éventrer la fille.
Que La Nuit du chasseur, son œuvre unique en tant que cinéaste, relève de ces deux genres thématiques n'est donc pas surprenant. La surprise provient plutôt des excès du scénario : la critique du puritanisme américain protestant y est quasiment psychanalytique, à la manière dont l'était déjà sans le savoir ce classique de Nathaniel Hawthorne, La Lettre écarlate. Le névrosé criminel, incarné d'une manière parfois expressionniste par Robert Mitchum, est inoubliable pour plusieurs raisons, la première étant sans doute, aux yeux d'un spectateur américain, son incarnation d'une tendance lourde dont on trouve des échos systématiques dans le cinéma hollywoodien indépendant comme dans celui des «majors» : Cape Fear [Les Nerfs à vif] (1992) de Martin Scorsese, par exemple, où le personnage dément joué par Robert de Niro appartient à la même famille «spirituelle» que le personnage d'Harry Powell joué par Mitchum, l'uniforme usurpé en moins mais une violence graphique démesurée en plus. Cette première raison fut probablement déterminante concernant l'échec financier dont Laughton ne se releva pas puisque, blessé par cet échec, il ne revint ensuite plus jamais à la mise en scène. C'était d'ailleurs inutile car il n'aurait probablement jamais pu nous donner un tel film une seconde fois.Shelley Winters qui joue l'autre névrosée du scénario – acceptant d'être assassinée plutôt que de renoncer à son illusion morbide – était alors élève des cours d'art dramatique que donnait Laughton. Quelques années avant ou après, son physique et son âge ne lui auraient pas permis d'interpréter le rôle comme elle le fit. On peut remarquer, à son propos, que Laughton et son scénariste font mourir la star féminine (une star au physique neutre, une anti-star, en réalité, dans le contexte de l'époque) avant la fin de la première moitié du film, cinq ans avant que l'ensemble de la critique internationale ne crédite Alfred Hitchcock d'une telle innovation concernant Janet Leigh dans Psychose (1960). Dans l'histoire du cinéma, on peut en général trouver des précédents : il suffit de les chercher mais surtout de vouloir les chercher. Inversement, on pourrait aussi penser que Robert Mitchum est l'anti-Joel McCrea dans Stars In My Crown (1950) de Jacques Tourneur : Mitchum est un pasteur qui provoque l'agressivité au lieu de la combattre, un névropathe criminel capable de s'en prendre à des enfants alors que le personnage de McCrea est, durant tout le film, remémoré comme l'idéal du père protecteur par le narrateur devenu adulte, en voix off. Peut-être trouverait-on aussi dans la filmographie de Lillian Gish, l'ancienne star du cinéma muet ici étonnante de vivacité et d'intelligence maternelle, un précédent à de tels rôles angéliques ? Sur le plan de l'histoire du cinéma, La Nuit du chasseur a donc autant reçu qu'on lui a emprunté, et c'est bien naturel. Sur le plan esthétique, en revanche, son originalité est patente. Le film emploie une syntaxe et une morphologie qui passent toutes deux constamment du classicisme narratif (l'arrivée de Harper chez lui et son arrestation) au baroque (la fuite cosmologique nocturne des enfants le long de la rivière, observée par des animaux variés, filmés en premier plan tandis que les enfants sont très loin en profondeur de champ) voire à l'expressionnisme (les plans durant lesquels Mitchum se prépare à tuer Shelley Winters). Certains plans inspirés ressortent de L'Écran démoniaque tel que Lotte H. Eisner l'avait défini (1), mais un écran démoniaque également traversé par une esthétique anglo-saxone de l'efficacité : en témoigne par exemple le «strip-tease» au cour duquel la violence dangereuse de Mitchum est, pour la première fois, réellement visualisée en temps réel grâce à l'idée géniale, symbolique de la démence meurtrière du personnage, du couteau à cran d'arrêt perçant sa propre poche, faute de pouvoir éventrer la fille. Le film hésite constamment, de toutes manières, entre plusieurs lignes directrices, prenant plaisir à brouiller les pistes : il est en apparence inclassable pour cette raison. Quel rapport entre un tueur en série cynique, fasciné par la théologie biblique du mal (qu'il met en scène d'une manière enfantine et théâtrale) et une honorable vieille dame dirigeant une fondation charitable, elle aussi férue de citations bibliques ? Une étrange symétrie qui renforce le malaise. Quel rapport entre un vieux couples d'épiciers qui servirait d'arrière-plan dramaturgique fugitif cinq secondes maximum dans n'importe quel western de John Ford et une foule de lyncheurs sortis tout droit d'un autre western signé aussi John Ford, William Wellman ou Fritz Lang ? Une étrange appartenance (dont la base névrotique, frigidité et impuissance, est explicitée par les dialogues) qui renforce aussi le malaise. Même la famille basique hollywoodienne est étrangement recomposée : le père est un criminel qui finit sur l'échafaud, la mère est une masochiste qui sera assassinée par son bourreau, les enfants deviennent receleurs par respect d'un serment fait au père ! Une lecture psychanalytique pourrait aller encore plus loin (2). Tout le film est placé sous l'ombre de la parabole des faux prophètes qu'on reconnaîtra à leurs fruits dévoyés : il en est une très cruelle illustration qui fut trop excessive pour le grand public américain de l'époque. Seule une production indépendante pouvait courir le risque de porter à l'écran pareil sujet traité d'une telle manière et seul un distributeur américain tel que United Artists (spécialisé dans la distribution des films indépendants entre 1950 et 1960 avant de devenir une quasi-«major» dans les années 1970-1980) pouvait le distribuer là-bas.Envisagé comme un simple film noir policier, La Nuit du chasseur tient déjà très bien sur ses jambes et son suspense n'est que très rarement pris en défaut, presque chaque plan faisant progresser inexorablement l'action. Mais, à mesure que le temps passe, c'est décidément bien comme film fantastique que La Nuit du chasseur prend sa véritable dimension, celle du vertige du cauchemar, celle du prestige du rêve. Cauchemar et rêve sur les rapports entre religion et névrose, entre paternité et idéal de la paternité, entre maternité et idéal de maternité, entre Eros et Thanatos, et aussi sur les rapports entre les trois âges de la vie. Le film est visible par tout public en raison de cette universalité riche des thèmes, le beau adoucissant constamment le laid, le tendre ou le comique rendant acceptables le cruel qui pourrait devenir exagéré. La Nuit du chasseur témoigne peut-être aussi du drame d'un film venant trop tôt ou trop tard : il paraissait excessif par sa noirceur, il paraît aujourd'hui trop doux par son humanisme éclairé et sa religion vécue de l'intérieur, sa forme parabolique revendiquée. Il n'est jamais tout à fait à sa place et toujours un peu décalé par rapport à ce qu'on en attend. Raison pour laquelle on peut le visionner tout au long de sa vie et y trouver, à chaque vision, l'occasion d'y découvrir de nouveaux aspects. Laughton, ce Socrate si laid en apparence mais si intelligent au dedans, a accouché d'une créature esthétique magnifique et troublante, scintillant toujours du plus vif éclat au cœur des nuits de sa projection.Notes*Captures d'écran réalisées par Francis Moury.(1) Se reporter pour cela à l'édition définitive illustrée et reliée Éric Losfeld, revue par Lotte H. Eisner en 1965.(2) Cf. Dr. Karl Abraham, Psychanalyse et culture (traduction française par Ilse Barande et Elisabeth Grin, Éditions Payot, collection P.B.P., 1969) et notamment son essai de psychanalyse appliquée intitulé La Croisée des trois chemins dans la légende d'Œdipe, § II de l'article Deux contributions à l'étude des symboles, pp. 203-205. Ce petit volume reprend les principaux essais de psychanalyse appliquée qui se trouvaient dans Karl Abraham, Œuvres complètes, tomes I & II (mêmes traductrices, Éditions Payot, collection B.S.P., section Science de l'homme, dirigée par G. Mendel, 1965 et 1966). La représentation infantile du coït avec la mère comme une terrifiante tentative d'assassinat de la mère par le père et le fantasme filial rêvant de sauver de la mort la mère, en attaquant le père, en le tuant et en prenant sa place auprès de la mère, est quasiment illustré dans La Nuit du chasseur, au prix des effets habituels du récit : déplacement, modification, symbolisme. C'est le second père (Mitchum) qui opère le meurtre de la mère mais si le fils n'en est pas témoin, il l'apprend assurément à la fin du film. Le parallélisme entre sa terreur durant l'arrestation de son premier père, et celle éprouvée durant l'arrestation de son second «faux», «mauvais» père, peut s'expliquer par l'aspect de viol subi dans les deux cas : le père privé de sa virilité, symboliquement violé et redevenu féminin par sa mise à terre et son braquage par les revolvers des policiers, le fils se retrouve investi de la puissance paternelle, ce qui le terrifie et qu'il ne peut supporter consciemment bien qu'étant enfant, il l'ait souhaité inconsciemment. À noter que les deux pères sont impuissants à des titres divers : le premier père joué par Peter Graves est capable de procréer mais devient incapable de subvenir aux besoins de sa famille; le second père de substitution joué par Mitchum est un névrosé qui refuse tout rapport sexuel avec les femmes mais les pénètre symboliquement avec son couteau à cran d'arrêt. Sa «première» mère tuée par son «second» père, le fils se retrouve durant le dernier tiers du film, le seul mâle environné de filles-sœurs et grandes sœurs et d'une mère... qui est aussi un père tant elle est virile et déterminée : Lillian Gish.
Le film hésite constamment, de toutes manières, entre plusieurs lignes directrices, prenant plaisir à brouiller les pistes : il est en apparence inclassable pour cette raison. Quel rapport entre un tueur en série cynique, fasciné par la théologie biblique du mal (qu'il met en scène d'une manière enfantine et théâtrale) et une honorable vieille dame dirigeant une fondation charitable, elle aussi férue de citations bibliques ? Une étrange symétrie qui renforce le malaise. Quel rapport entre un vieux couples d'épiciers qui servirait d'arrière-plan dramaturgique fugitif cinq secondes maximum dans n'importe quel western de John Ford et une foule de lyncheurs sortis tout droit d'un autre western signé aussi John Ford, William Wellman ou Fritz Lang ? Une étrange appartenance (dont la base névrotique, frigidité et impuissance, est explicitée par les dialogues) qui renforce aussi le malaise. Même la famille basique hollywoodienne est étrangement recomposée : le père est un criminel qui finit sur l'échafaud, la mère est une masochiste qui sera assassinée par son bourreau, les enfants deviennent receleurs par respect d'un serment fait au père ! Une lecture psychanalytique pourrait aller encore plus loin (2). Tout le film est placé sous l'ombre de la parabole des faux prophètes qu'on reconnaîtra à leurs fruits dévoyés : il en est une très cruelle illustration qui fut trop excessive pour le grand public américain de l'époque. Seule une production indépendante pouvait courir le risque de porter à l'écran pareil sujet traité d'une telle manière et seul un distributeur américain tel que United Artists (spécialisé dans la distribution des films indépendants entre 1950 et 1960 avant de devenir une quasi-«major» dans les années 1970-1980) pouvait le distribuer là-bas.Envisagé comme un simple film noir policier, La Nuit du chasseur tient déjà très bien sur ses jambes et son suspense n'est que très rarement pris en défaut, presque chaque plan faisant progresser inexorablement l'action. Mais, à mesure que le temps passe, c'est décidément bien comme film fantastique que La Nuit du chasseur prend sa véritable dimension, celle du vertige du cauchemar, celle du prestige du rêve. Cauchemar et rêve sur les rapports entre religion et névrose, entre paternité et idéal de la paternité, entre maternité et idéal de maternité, entre Eros et Thanatos, et aussi sur les rapports entre les trois âges de la vie. Le film est visible par tout public en raison de cette universalité riche des thèmes, le beau adoucissant constamment le laid, le tendre ou le comique rendant acceptables le cruel qui pourrait devenir exagéré. La Nuit du chasseur témoigne peut-être aussi du drame d'un film venant trop tôt ou trop tard : il paraissait excessif par sa noirceur, il paraît aujourd'hui trop doux par son humanisme éclairé et sa religion vécue de l'intérieur, sa forme parabolique revendiquée. Il n'est jamais tout à fait à sa place et toujours un peu décalé par rapport à ce qu'on en attend. Raison pour laquelle on peut le visionner tout au long de sa vie et y trouver, à chaque vision, l'occasion d'y découvrir de nouveaux aspects. Laughton, ce Socrate si laid en apparence mais si intelligent au dedans, a accouché d'une créature esthétique magnifique et troublante, scintillant toujours du plus vif éclat au cœur des nuits de sa projection.Notes*Captures d'écran réalisées par Francis Moury.(1) Se reporter pour cela à l'édition définitive illustrée et reliée Éric Losfeld, revue par Lotte H. Eisner en 1965.(2) Cf. Dr. Karl Abraham, Psychanalyse et culture (traduction française par Ilse Barande et Elisabeth Grin, Éditions Payot, collection P.B.P., 1969) et notamment son essai de psychanalyse appliquée intitulé La Croisée des trois chemins dans la légende d'Œdipe, § II de l'article Deux contributions à l'étude des symboles, pp. 203-205. Ce petit volume reprend les principaux essais de psychanalyse appliquée qui se trouvaient dans Karl Abraham, Œuvres complètes, tomes I & II (mêmes traductrices, Éditions Payot, collection B.S.P., section Science de l'homme, dirigée par G. Mendel, 1965 et 1966). La représentation infantile du coït avec la mère comme une terrifiante tentative d'assassinat de la mère par le père et le fantasme filial rêvant de sauver de la mort la mère, en attaquant le père, en le tuant et en prenant sa place auprès de la mère, est quasiment illustré dans La Nuit du chasseur, au prix des effets habituels du récit : déplacement, modification, symbolisme. C'est le second père (Mitchum) qui opère le meurtre de la mère mais si le fils n'en est pas témoin, il l'apprend assurément à la fin du film. Le parallélisme entre sa terreur durant l'arrestation de son premier père, et celle éprouvée durant l'arrestation de son second «faux», «mauvais» père, peut s'expliquer par l'aspect de viol subi dans les deux cas : le père privé de sa virilité, symboliquement violé et redevenu féminin par sa mise à terre et son braquage par les revolvers des policiers, le fils se retrouve investi de la puissance paternelle, ce qui le terrifie et qu'il ne peut supporter consciemment bien qu'étant enfant, il l'ait souhaité inconsciemment. À noter que les deux pères sont impuissants à des titres divers : le premier père joué par Peter Graves est capable de procréer mais devient incapable de subvenir aux besoins de sa famille; le second père de substitution joué par Mitchum est un névrosé qui refuse tout rapport sexuel avec les femmes mais les pénètre symboliquement avec son couteau à cran d'arrêt. Sa «première» mère tuée par son «second» père, le fils se retrouve durant le dernier tiers du film, le seul mâle environné de filles-sœurs et grandes sœurs et d'une mère... qui est aussi un père tant elle est virile et déterminée : Lillian Gish.
05/04/2011 | Lien permanent
Le réalisme critique de Schlick, par Francis Moury
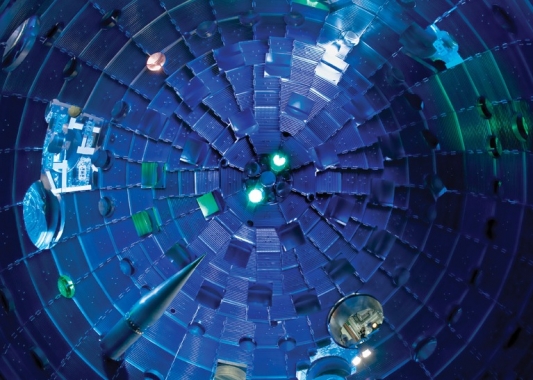
 À propos de Moritz Schlick, Théorie générale de la connaissance (traduction de la 2e édition allemande de 1925, présentation, index rerum, index nominum et notes par Christian Bonnet, un volume de 551 pages, Éditions Gallimard-NRF, coll. Bibliothèque de philosophie, 2009).
À propos de Moritz Schlick, Théorie générale de la connaissance (traduction de la 2e édition allemande de 1925, présentation, index rerum, index nominum et notes par Christian Bonnet, un volume de 551 pages, Éditions Gallimard-NRF, coll. Bibliothèque de philosophie, 2009). «Il y a, il est vrai, une difficulté dans cet opérationalisme, difficulté qui est celle même du «positivisme logique» : pour que les concepts aient un sens dans l’application, il faut les confronter à l’expérience immédiate; à cette condition, comme dit Schlick, on pourra transformer les propositions logiques (Sätze) en énoncés sur les choses (Aussage); mais cela est impossible, puisque selon la même doctrine, l’expérience immédiate est par nature incommunicable, donc invérifiable et sans signification. Aussi le physicalisme n’a-t-il pu devenir cohérent qu’en affirmant qu’il n’y avait pas d’expérience immédiate; il n’y a rien de tel dans l’opposition reconnue d’abord par le cercle de Vienne entre connaissance (Erkenntnis) et impression (Erlebnis). Mais comment se résout alors le problème posé ?»
Émile Bréhier, Histoire de la philosophie, Tome II, La Philosophie moderne, fascicule 4, § XVI La Philosophie après 1930, section 3, Les Tendances subjectivistes et leurs critiques (5e édition revue et bibliographie mise à jour par L. Jerphagnon et P.-M. Schuhl, P.U.F. 1932-1968), p. 1019.
«La balle est à courte distance du trou. À un pouce près, je mesure de l’œil cette distance. Je prends soigneusement la ligne. Un piètre joueur de billard réussirait le coup avec une queue. La balle part. Elle dépasse le trou de dix pouces, de quinze… Je rougis, ma main tremble, le cri d’un geai qui passe raille ma maladresse. Mon caddy, qui s’apprêtait à remettre le drapeau, réprime mal un ricanement. J’ai une envie folle de lui envoyer une paire de gifles. Je me contiens et reprends ma ligne. La balle saute littéralement au-dessus du trou. Je renonce.»
Jean Ray, Influence, in Les Contes noirs du golf (Éditions Gérard & Cie, Bibliothèque Marabout, série fantastique n°208, Verviers, 1964), pp. 46-47.
Un fascinant «cas limite» ! Telle avait été notre impression lorsque nous avions lu, vers 1978, le bref et énigmatique paragraphe consacré à Schlick par Bréhier. Son nom n’était pourtant pas cité dans le monumental Index général des noms cités dans ses tomes I et II, couvrant les pages 1023 à 1059 de notre édition de 1968. Nous l’avions rajouté en marge, au stylo, à sa place alphabétique correcte, afin d’être certain de le retrouver rapidement en cas de besoin. Bréhier brossait le portrait d’un Schlick hésitant entre la tendance au concret et la tendance subjectiviste. Laquelle des deux l’emportait finalement ? On se le demandait autant que Bréhier. Ce beau volume Gallimard-NRF de la Bibliothèque de philosophie fondée par Jean-Paul Sartre et Maurice Merleau-Ponty, nous fournit, presque trente ans plus tard, l’occasion de revenir sur cette question.
Nous connaissions bien sûr, étant jeune homme, l’existence du «cercle de Vienne» (inutile de mettre une majuscule au «c» de « cercle» bien que ce soit la mode aujourd’hui : Bonnet en met une mais Bréhier n’en mettait pas et nous préférons la simplicité de Bréhier) et sa qualité de «fondateur» de ce mouvement. Nous avions une vague idée de son rôle dans l’histoire de la philosophie de la logique, comme dans celle de la philosophie des sciences et de la connaissance. Nous devons pourtant avouer que le nom même de Schlick ne nous était pas familier. Par la suite, Maurice Clavelin nous l’avait cité dans ses cours de licence et de maîtrise sur la philosophie de la physique et des mathématiques, mais assez brièvement, nous laissant à nouveau un peu sur notre faim. Notre problème personnel était, dans ces années 1980-1985, de bien comprendre en quoi le positivisme logique du cercle de Vienne pouvait se réclamer du positivisme originel, à savoir celui constitué par Auguste Comte (1). Or, aucun livre de Schlick n’avait été traduit en France dans les années 1980-1985 pour nous aider à approfondir ce lien qui nous intéressait. On disposait de quelques éléments traduits et de quelques études françaises sur la logique mathématique et sur le positivisme logique, mais de Schlick, nihil. Les positivistes comtiens francophones négligeaient assez, pour leur part, l’héritage positiviste logique viennois : ils le considéraient bien davantage comme un avatar phonétique du kantisme et de la critique des sciences que comme un héritier stricto sensu du positivisme. On pouvait en revanche parler des «positivistes spiritualistes» (Félix Ravaisson, Jules Lachelier, Émile Boutroux) avec beaucoup plus de justesse historique. De fait, l’idée même de théorie de la connaissance découle plus directement – bien qu’elle en soit littéralement absente – de la position initiale adoptée par Emmanuel Kant que de celle adoptée par Comte : celle d’une critique de la métaphysique. La différence étant, comme on sait, que Kant ne renonce nullement à l’idée d’une métaphysique (au point que Heidegger a pu écrire en 1929 un livre sur Kant et le problème de la métaphysique) alors que Comte la remplace franchement, dans sa dernière période, par une nouvelle religion qui coiffe organiquement l’ensemble des sciences, à savoir sa très intéressante et curieuse «religion de l’Humanité». Seulement Schlick, convaincu autant que Comte (dont il admire la critique de l’idée de psychologie comme science) de l’inanité de la métaphysique, a une tendance métaphysique : il a lu les Grecs, Descartes, Schopenhauer et Nietzsche. Il est physicien mais s’est d’abord intéressé à l’esthétique et à la morale. Comme Descartes et Spinoza, il a étudié l’optique. Il soutient sa thèse de physique, en 1904 sous la direction de Max Planck, sur La Réfraction de la lumière dans un milieu non homogène. Mais il avoue dans ses Fragments autobiographiques (cités par Bonnet dans l’introduction) qu’il n’est venu à la physique que pour la philosophie. Après s’être tourné vers Épicure, il publie dès 1910 un premier article épistémologique et logique important sur La nature de la vérité selon la logique moderne. Il ne faut donc pas commettre, à propos de Schlick, l’erreur qu’avait commise A. Diès en 1948 à propos de Platon : croire qu’ils ne sont venus à la philosophie que pour en sortir, l’utilisant comme un simple moyen en vue d’une fin qui serait dans le cas de Platon la politique, dans le cas de Schlick la science. Schlick vise au contraire et très classiquement la fondation de toute science possible par l’établissement de prolégomènes métaphysiques qui lui sont, architectoniquement parlant, d’essence supérieure, de même que Platon vise la fondation de toute cité juste à partir de son imitation d’un parfait modèle métaphysiquement fondé.
La première édition de la Théorie générale de la connaissance date de 1918 (rédigée à Rostock sur les bords de la mer Baltique entre 1913 et 1916, parue à Berlin en 1918) et sa seconde édition date de 1925. Il aura donc fallu attendre presque 85 ans – presque un siècle, en somme ! – pour en avoir une traduction française fiable, bien présentée, et dotée d’un appareil critique éclairant. Ce n’est pourtant pas, selon Schlick lui-même, ces deux éditions qui devaient témoigner pour la postérité de sa pensée au stade de sa maturité : il voulait en donner une troisième édition car il en était arrivé à considérer cette théorie comme «primitive et immature» (lettre de Schlick à Albert Einstein du 14 juillet 1927, citée par Bonnet dans son introduction, p. 23) mais son assassinat le 22 juin 1936 sur les marches de l’Université de Vienne par un de ses étudiants ne lui en laissa pas le loisir.
La Théorie générale de la connaissance est divisée en trois parties : La Nature de la connaissance, Problèmes de la pensée, Problèmes de la réalité. Qu’on n’espère pas les comprendre sans avoir auparavant lu Platon, Aristote, certains penseurs médiévaux, certains penseurs modernes et certains penseurs contemporains de Schlick qui critique, par exemple, très vigoureusement Henri Bergson. Il faut en outre savoir que Schlick occupait à Vienne la chaire auparavant tenue par Ernst Mach. Pourtant le novice peut parfaitement s’y risquer tant la pensée est claire et limpide, et tant la traduction maintient dans notre langue cette clarté et cette limpidité. Schlick est en effet l’exemple d’un penseur synthétisant les problématiques de ses prédécesseurs sans les dissoudre ni les annihiler, sans les travestir ni les modifier pour les besoins de sa cause. Plus précisément, Schlick est à la recherche du moyen-terme, un moyen-terme qui soit le plus sûr et le plus commode à la fois, permettant de valider à la fois l’expérience et la connaissance, la nature et l’esprit. Il refuse de tenir pour l’une ou l’autre exclusivement : il veut tenir les deux ensemble dans un même mouvement. Il aboutit, dans la Théorie générale de la connaissance, à un réalisme critique proche du monisme, éclairé par une «méthode des coïncidences» permettant de faire coïncider deux singularités, séparées d’habitude. Schlick veut réconcilier le monde physique et le monde psychique. Les problèmes de l’intuition pure, de la connaissance animale du monde ou de celle de l’homme primitif par rapport à l’homme moderne, de la vérification des inductions, de la causalité en physique, l’amènent à débattre tout naturellement de la question de l’inconscient psychologique, de l’univocité du signe, de la coordination équivoque ou univoque des signes et des concepts, de l’axiomatique de Hilbert. La validité ontologique du monde – qu’il souhaite fonder – repose d’abord sur de tels travaux techniques et logiques.
Schlick admira Wittgenstein. Un peu trop, selon ses propres amis qui lui reprochaient de s’effacer en sa faveur alors que, assez souvent, certaines des idées de Wittgenstein avaient d’abord été énoncées par Schlick lui-même ! Schlick fut, par ailleurs, accusé de psychologisme par les logiciens, de conceptualisme par les intuitionnistes, de relativisme et de scepticisme par les réalistes, de nihilisme… par les nazis autrichiens. La manière dont on résume son système sous les termes de «réalisme critique» est à la fois juste et savoureuse car éminemment dialectique. On sait que le criticisme kantien s’oppose au réalisme aristotélicien qu’il ne faut surtout pas confondre, pour sa part, avec le réalisme abstrait du platonisme, celui des essences. Mais dans le cas de Schlick, il y a une certaine ambivalence relativement au sens du mot «réalisme» et une certaine ambivalence relativement au sens de l’adjectif «critique». La définition est donc très bien choisie, à condition de développer toute sa richesse possible. Ce n’est pas ici le lieu d’en débattre en détails, mais donnons tout de même quelques indications succinctes. Pour Aristote comme pour Schlick, le concret est bien la chose même d’abord : ce rouge que je perçois, et pas d’abord l’idée du rouge. Mais l’idée de rouge n’est pas rien non plus. Tout le problème repose sur la signification des termes constituant un tel jugement de fait («je perçois une couleur rouge») tel que la logique d’Aristote nous l’a théoriquement transmis. L’idée ou la pensée sont, pour Schlick, des réalités tangibles dont la valeur de réalité ne remet pas en cause la pesanteur et le sens du monde des objets, et l’inverse est tout aussi vrai. Schlick qui veut tenir la balance égale entre réalisme et idéalisme, considère donc l’intuition comme une réalité, différente de la connaissance et qui ne peut s’y substituer mais possédant sa valeur cognitive propre, même s’il s’agit d’une forme inférieure de connaissance. Lisant de telles indications, le lecteur non prévenu pourrait penser que la ratiocination est décidément une constante de l’histoire de la philosophie, dans la mesure où, de Platon à Husserl et à son contemporain Schlick, on peut dire qu’on n’a jamais terminé la discussion du Théétète sur la perception ! Mais il faut bien comprendre – on ne le peut que par l’étude de son histoire – que ce n’est pas la même discussion qui se répète, en dépit de l’usage de certains termes identiques : c’est la même et c’est une autre à la fois.
Il y a, en outre, quelque chose d’inédit, de discrètement pathétique, voire d’inévitablement tragique qui affleure du fond de cette suite de raisonnements sereinement techniques et rationnellement distribués dans ce traité d’une admirable rigueur. Tandis que Schlick critique (à tort selon nous mais d’une manière passionnante) le rôle de la mémoire dans le système cognitif élaboré par Descartes, et qu’il critique le sens même de la critique humienne de la causalité, son univers est progressivement, objectivement, investi par la mort et la violence. Ce pur produit raffiné et cultivé de l’empire austro-hongrois – entre deux articles de philosophie de la connaissance, il publie en 1930 des Questions d’éthique – au sens où Laurent Schang l’entendait (2) est universitaire pendant la Première guerre mondiale, et finit assassiné à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Certes ce fut le destin de tous les penseurs européens de l’entre-deux guerres mondiales. Mais Schlick fut assassiné par un de ses propres étudiants («antisémite déclaré» Bonnet dixit) qui le rendait « responsable de ses déboires». On aimerait en savoir plus car la formulation de la note, assez laconique, ouvre sur l’infini du possible. On savait déjà, depuis qu’on avait visionné et critiqué le téléfilm Wittgenstein (Grande-Bretagne et Japon, 1993) écrit et réalisé par Derek Jarman, que la vie privée des positivistes logiques pouvait réserver des surprises. On devient franchement curieux dans le cas de Schlick. Ironie plus noire encore, la propre philosophie de Schlick est tenue, nous y avons déjà fait allusion supra, par les journaux nazis autrichiens pour la première responsable de son assassinat, en raison du «nihilisme» qu’elle aurait véhiculé. Schlick plus nietzschéen que Nietzsche selon ses thuriféraires au premier degré ? Le «réalisme critique» de Schlick se tient, on le voit, doublement sur le fil du rasoir : en histoire de la philosophie, il est l’héritier direct du rasoir d’Ockham (3), et en histoire générale, il fut contemporain de la montée du nazisme.
Souhaitons pouvoir un jour disposer des œuvres complètes chronologiques de Schlick traduites en français, et pouvoir découvrir ainsi ses œuvres esthétiques et morales qui ne doivent pas être d’un moindre intérêt, en tout cas qui n’étaient pas d’un moindre intérêt à ses propres yeux. Car décidément, on ne peut pas se contenter de définir Schlick par sa seule qualité de fondateur du «cercle de Vienne» : ce livre et l’introduction de Bonnet nous en donnent confirmation. Et ils nous confirment aussi que Bréhier avait eu raison d’hésiter lorsqu’il s’agissait de définir Schlick du point de vue de l’histoire de la philosophie. Le positivisme logique de Schlick n’est en effet, à présent qu’il nous est mieux connu qu’à l’époque de Bréhier, ni univoque, ni unilatéralement définissable. Sa richesse, qui reste encore à découvrir dans sa totalité, l’en préserve.
Notes
(1) Carnap estimait, selon Karl Popper, que la plupart des philosophes des sciences partagent l’idée comtienne selon laquelle la physique est le paradigme des sciences. Mais cette conception n’est valable que dans le cas où la question de la chose n’a plus de raison d’être, dans le cas où le réalisme et le positivisme se confondraient, et où leur opposition métaphysique disparaîtrait. L’universel n’est de nature logique ni chez Aristote ni chez Comte, pas davantage de nature cosmologique : les niveaux de réalité sont soigneusement distingués chez l’un comme chez l’autre. Les liens possibles entre les individus raisonnables sont de nature morale et politique, poétique aussi. Il semble donc que, compte tenu de ces différences, Schlick ait été nettement plus comtien que Carnap.
(2) Laurent Schang, Otto de Habsbourg, celui qui a dit «nein», in Cancer ! - Gueules d’amour (Éditions Mille et une Nuits, 2003), pp. 97-133.
(3) Pierre Alféri, Guillaume d’Ockham le singulier (Éditions de Minuit, coll. Philosophie, 1989), a étudié les relations étroites entre la pensée d’Ockham et les thèses de Schlick et de Wittgenstein. Voir sa page 260, par exemple, en dépit du fait qu’il demeure une distance certaine entre l’empirisme et le nominalisme d’Ockham d’une part, le positivisme logique du cercle de Vienne d’autre part. Sans oublier les différences non moins certaines existant entre les membres du cercle.
19/11/2010 | Lien permanent
Heidegger ex cathedra, 1 : religion, par Francis Moury

«Nous appelons «rationnel» dans l’idée du divin ce qui peut être clairement saisi par notre entendement et passer dans le domaine des concepts qui nous sont familiers et qui sont susceptibles de définitions. Nous affirmons d’autre part qu’au-dessous de ce domaine de pure clarté se trouve une obscure profondeur qui se dérobe, non pas à notre sentiment, mais à nos concepts et que pour cette raison nous appelons «irrationnel».»
Rudolf Otto, Le Sacré (1917, traduction de A. Jundt revue par l’auteur sur la 18e édition allemande, Bibliothèque scientifique Payot, 1949, réédition Petite Bibliothèque Payot, 1969), p. 93.
 Heidegger ex cathedra, comme professeur d’histoire de la philosophie et comme philosophe de l’histoire occidentale de la philosophie, nous est progressivement révélé par la traduction de ses œuvres complètes chez Gallimard. Je souhaite examiner, dans une série d’articles, certains volumes consacrés à la religion, aux philosophies anciennes, modernes et contemporaines.
Heidegger ex cathedra, comme professeur d’histoire de la philosophie et comme philosophe de l’histoire occidentale de la philosophie, nous est progressivement révélé par la traduction de ses œuvres complètes chez Gallimard. Je souhaite examiner, dans une série d’articles, certains volumes consacrés à la religion, aux philosophies anciennes, modernes et contemporaines.C’est la traduction française du tome 60 de l’édition allemande des Œuvres complètes d’Heidegger (tome paru en 1995 puis réédité en 2011) qui m’en fournit la première occasion : première, à la fois par ordre chronologique et par ordre des matières, les deux ordres étant ici parfaitement confondus. Il s’agit, en effet, de la réunion de trois cours professés (ou, concernant le premier d’entre eux, préparé) par le jeune professeur Heidegger, augmentés des notes de ses étudiants et auditeurs de l’Université de Fribourg-en-Brisgau : «Les Fondements philosophiques de la mystique médiévale» (hiver 1919-1920), «Introduction à la phénoménologie de la religion» (hiver 1920-1921), «Augustin et le néoplatonisme» (été 1921).
Les deux postfaces rédigées en 1995 (aussi traduites par Jean Greisch) par les éditeurs allemands, donnent la mesure du travail que représente la publication de ces œuvres complètes : déchiffrement de sténographie, de manuscrits, collations et comparaisons de notes, recours à la famille de Heidegger pour déchiffrer son écriture manuelle parfois minuscule, recomposition des tables des matières à partir d’éléments disparates. Surtout, leur progression éditoriale allemande et leur arrivée en traduction française à la NRF, permettent de mesurer de mieux en mieux l’ambition hégélienne de Heidegger : ni plus ni moins qu’une histoire phénoménologique de la philosophie occidentale rendant compte de l’ensemble des écoles anciennes, modernes et contemporaines. Tout comme Hegel dans sa propre histoire de la philosophie, Heidegger a voulu comprendre la totalité des penseurs qui l’ont précédé. Tout comme Hegel, cette histoire de la philosophie a été pour lui l’occasion d’un dialogue approfondi avec l’histoire, la culture, la religion, l’économie, les mœurs, la psychologie, la sociologie, les sciences positives qui constituaient le monde phénoménal ambiant des penseurs qu’il étudie. Commentaire attentif, précis à la virgule près, qui est un moyen constant d’approfondissement de ses propres thèses, ici préludes à celles développées bientôt dans Être et temps, dans ses Questions, dans ses Correspondances (avec Jaspers, Arendt et tant d’autres) et dialogues (avec Jean Beaufret et tant d’autres) puis ses grands séminaires. L’ensemble est majoritairement traduit chez Gallimard mais il subsiste encore un décalage d’une dizaine de volumes entre les œuvres disponibles en Allemagne et celles disponibles chez nous. Chaque nouveau volume traduit le comble heureusement.
Le lecteur français ne peut s’empêcher d’éprouver un étrange sentiment en lisant, à la page 150 des annexes, à l’occasion d’une remarque méthodologique sur l’Épître aux Galates de saint Paul, cette savoureuse parenthèse : «…exigence positive d’une nouvelle position du problème qui m’anime authentiquement moi-même !… le concept de théologie reste entièrement en suspens. Celui dont nous avons hérité peut bien avoir une valeur indicative : mais le dévoilement des connexions phénoménologiques […] nous fournira des critères authentiques pour la destruction de la théologie chrétienne et de la philosophie occidentale».
Alors que le théologien Rudolf Otto venait de publier son célèbre livre sur Le Sacré, les remarques d’Heidegger écrites en vue de sa recension (ici traduites pp. 376-7) manifestent une réserve à la fois sur le fond et sur la forme : Otto est dans la bonne direction puisqu’il aboutit à un fait brut, pur, «constitutif» au sens le plus phénoménologique possible, à savoir celui du «numineux», phénomène au sens strict manifesté par les éléments du «tremendum» et du «fascinans», ceux qui constituent le cœur même de la terreur sacrée dans les mythologies et les religions les plus archaïques, les plus primitives, donc les plus primordiales du point de vue historique positif d’une science possible de la religion, d’une science phénoménologique de la religion telle que la poursuivront des esprits aussi différents que Roger Caillois ou Sigmund Freud, Mircea Eliade ou Lévy-Bruhl. Mais Otto a, selon Heidegger, le tort de considérer l’irrationnel comme une limite du rationnel; or le sacré ne doit pas être le résultat de l’équation [numineux – éthique = religion] car la constitution originaire du sacré n’a pas de rapport immédiat ni théorique avec… ce qui n’est pas lui. Heidegger, bien sûr, retrouve une intuition familière au lecteur de Kierkegaard : le sacré a bien davantage à voir avec le silence de la violence qu’avec la parole du prédicateur. Il est du côté du sacrifice, pas du côté du «théorétique» ou de la connaissance. Cet aspect irrationnel du sacré était déjà celui qui fondait le système de Duns Scot, selon Étienne Gilson, Scot à qui Heidegger avait consacré, comme on le sait, sa thèse de doctorat d’ailleurs traduite depuis longtemps chez Gallimard-NRF.
La position de Heidegger en 1919-1921 est en situation dans l’histoire de la philosophie allemande. On a longtemps considéré comme primordiale la relation de maître à disciple entre Husserl et Heidegger. Elle lui a, sans aucun doute, fourni un instrument, un vocabulaire mais les intuitions réalistes de Heidegger sont les héritières d’un passé plus lointain : de Luther à Nietzsche en passant par G.W.F. Hegel et Kierkegaard. Durant sa jeunesse, Heidegger est nourri par les influences théoriques les plus variées : le relativisme (Simmel), le néokantisme (Natorp, Windelband), les théoriciens de la culture (Troeltsch, Spengler), les contributions positives allemandes aux sciences positives (histoire générale, histoire des religions, psychologie, psychanalyse, sociologie, anthropologie, philologie). Husserl lui fournit cet instrument séduisant qu’est la réduction phénoménologique mais Heidegger en fait finalement tout autre chose que ce que Husserl attendait. L’ambition de Husserl était profondément cartésienne alors que l’ambition de Heidegger s’avère profondément hégélienne. Il faut d’ailleurs noter que Heidegger a, plus tard, modifié le titre original de son cours sur le cahier manuscrit : de «Phénoménologie de la conscience religieuse», il a rayé le mot «conscience» (mentionné dans une lettre du 1er mai 1919 à Elisabeth Blochmann) pour le remplacer par «vie». Ce déplacement me semble signer la fin de l’influence husserlienne ; il rattache plutôt Heidegger, malgré qu’il en ait eu, à des philosophes tels que Spengler ou Scheler en dépit des critiques qu’il leur prodigua expressément.
D’un point de vue scientifique étroit (point de vue qui était peut-être celui des «personnes non qualifiées» ayant interrompu en novembre 1920 la première partie méthodologique de l’Introduction, curieux mélange tout germanique de lourdeur et de subtilité, précédant les commentaires un peu plus concrets des Épitres aux Galates puis des Épitres aux Thessaloniciens) il ne faut pas rechercher ici une introduction à saint Paul ou à saint Augustin ni à aucun autre des théologiens cités, commentés ou simplement mentionnés (1). Le commentaire de Heidegger suppose de telles histoires positives et scientifiques lues et connues. Il suppose que le lecteur est déjà familier de la chronologie des œuvres de saint Augustin, qu’il sait à quoi correspond dans ses Confessions le livre X qu’il étudie, qu’il connaît les Retractationes écrites vers la fin de la vie d’Augustin. Ce qui intéresse Heidegger est d’étudier la frontière entre sens et langage, monde et conscience, de cerner la naissance d’une forme originale s’associant à une matière originale, donc la naissance d’un être inédit, au sein de l’histoire culturelle occidentale. La moindre phrase, attentivement scrutée, étudiée – toutes les citations grecques et latines sont soigneusement traduites en français mais Heidegger et ses étudiants les lisaient dans leur texte original – est matière à une recherche de cette réalité concrète inédite : «ce» que fut la religion de saint Paul, «ce» que fut la religion de saint Augustin du point de vue purement phénoménologique.
Sur le plan matériel, cette édition est impeccable : le glossaire final du vocabulaire technique et critique de Heidegger, établi par J. Greisch, rendra bien des services au lecteur français. Sa simple présence pourrait recommander ce volume 60 de l’édition allemande pour servir d’introduction à cette collection NRF (pas numérotée en volumes, pour sa part) des Œuvres de Martin Heidegger. Une coquille, je crois, à la page 231 : la citation de saint Augustin «prospera in adversis desidero» (Confessions, X, 28, 39) est curieusement traduite par «dans la prospérité, je désire l’adversité». C’est, à mon avis, une coquille matérielle par interversion. Il faut évidemment lire : «dans l’adversité, je désire la prospérité». D’ailleurs, au bas de la même page, la formule symétrique «adversa in prosperis timeo» est parfaitement traduite par «dans la prospérité, je crains l’adversité».
Note
(1) Celui qui désirerait un éclairage historique et littéraire précis sur saint Paul, le trouvera dans Aimé Puech, Histoire de la littérature grecque chrétienne, et celui qui en désirerait un sur saint Augustin le trouvera dans Pierre de Labriolle, Histoire de la littérature latine chrétienne.
26/10/2014 | Lien permanent
L'éclat des penseurs japonais, par Francis Moury

«Pendant qu’un philosophe assure
Que toujours par leurs sens les hommes sont dupés,
Un autre philosophe jure
Qu’ils ne nous ont jamais trompés.
Tous les deux ont raison [...]»
Jean de La Fontaine, Fables, livre VII, § XVIII, Un Animal dans la lune [1678] (29e éd. Hachette, avec notices et notes par M. E. Thirion, 1926, p. 228).
«Ce dont on ne peut parler, il faut le taire»
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus [1918] (éd. Gallimard, coll. Idées, trad. de Pierre Klossowski, introduction de Bertrand Russel, notes d’Aimé Patri, 1961-1972, p. 177).
«[...] Dans la pensée européenne, il y a, je crois, deux choses : le rationalisme et l’individualisme. Et ni l’une ni l’autre ne conviennent au tempérament japonais. [...]»
Yasuzo Masumura (1924-1986) extrait d’un Entretien accordé aux Cahiers du Cinéma N° 224, octobre 1970.
«[...] Éh bien, mon cher ami Gilbert, les Évangiles ne nous donnent aucun renseignement sur la vie de Jésus entre douze et trente ans. Et pour cause ! Le Christ, suivant la «route de Bouddha», se serait rendu une première fois en Asie durant cette période, afin d’y étudier la théologie… en Inde puis au nord du Japon, terre du chamanisme aïnou [...] après un long voyage et de multiples aventures Jésus-Christ a regagné le Japon, pays des études mystiques et chamaniques de sa jeunesse… Il a voyagé jusqu’au charmant petit village de Heraï, dans la préfecture d’Aomori… Nous y avons tourné plusieurs séquences… Jésus de Nazareth s’est donc éteint là, à Héraï, plusieurs fois grand-père… ayant atteint grâce au yoga et à la gymnastique ésotérique chinoise, à un régime alimentaire japonais typiquement pauvre en graisses, l’âge vénérable de cent six ans…[...].»
Romain Slocombe, La Crucifixion en jaune, tome 4 : Regrets d’hiver (éd. Fayard, coll. Noir, 2006, p. 121).
Voici un très intéressant dialogue mené par Yann Kassile avec vingt-deux penseurs japonais. Kassile a séjourné à Tokyo, à Kyoto, à Osaka et à Nagoya pour réaliser ces entretiens qui ont été, en outre, filmés. C’est un livre important qui ouvre le dialogue franco-japonais du XXIe siècle sous les meilleurs auspices par sa richesse et sa variété.
Remarques matérielles
 Première remarque : on ne saisit pas très bien pourquoi c’est Yann Kassile qui est mentionné sur la couverture comme auteur du livre alors que c’est un certain Jean D’Istria qui signe tous les entretiens. Éh bien, observez le titre de la collection dans laquelle paraît le livre : l’adjectif «imaginaire» y figure. Kassile aurait choisi de se nommer Jean D’Istria tout du long pour instaurer une sorte de distance fictionnelle, certes loisible sinon nécessaire. Bien sûr, les interlocuteurs japonais sont pour leur part – et encore heureux ! – identifiés réellement.
Première remarque : on ne saisit pas très bien pourquoi c’est Yann Kassile qui est mentionné sur la couverture comme auteur du livre alors que c’est un certain Jean D’Istria qui signe tous les entretiens. Éh bien, observez le titre de la collection dans laquelle paraît le livre : l’adjectif «imaginaire» y figure. Kassile aurait choisi de se nommer Jean D’Istria tout du long pour instaurer une sorte de distance fictionnelle, certes loisible sinon nécessaire. Bien sûr, les interlocuteurs japonais sont pour leur part – et encore heureux ! – identifiés réellement.Chaque entretien est illustré de plusieurs photographies du penseur japonais avec à l’arrière-plan un fragment du contexte spatial où il s’est déroulé. La ville et la date sont mentionnées mais on regrette que la date soit exclusivement celle du calendrier japonais. Il aurait fallu mentionner aussi la date occidentale puisque ce livre est destiné à des lecteurs francophones occidentaux par principe ! Le nom japonais de chaque interlocuteur est également écrit en japonais, ce qui, en revanche, est très bien. Des notes maigres mais nécessaires rassemblent sur les deux dernières pages quelques informations sur les auteurs japonais cités par les interlocuteurs de Kassile.
L’usage japonais de l’inversion «NOM-prénom» est transcrit en français : c’est la mode mais nous dénonçons ce procédé pour une raison simple : on ne le faisait pas au siècle dernier, qui n’est pas si loin, dans les ouvrages traitant du Japon. Si on commence à le faire, ce sera le désordre dans l’esprit des jeunes lecteurs qui seront vite confronté à des ouvrages français du XXe siècle sur le Japon respectant l’usage français et à d’autres du XXIe siècle ne le respectant pas. Dans le cas d’une célébrité telle que le cinéaste Kenji Mizoguchi, le nommer à la japonaise Mizoguchi Kenji ne va pas changer la face du monde : le lecteur quelque peu cultivé ne sera jamais induit en erreur. Mais dans le cas de ces penseurs contemporains, célèbres là-bas pour certains d’entre eux mais, de toute évidence, peu connus chez nous en dehors d’une élite restreinte et japonisante – ce livre et notre modeste compte rendu vont d’ailleurs les populariser, nous l’espérons – c’est absurde. Il eût donc fallu persister à écrire «Takaaki Yoshimoto» à la française et non pas « Yoshimoto Takaaki».
Pour le reste, le papier est beau, les caractères lisibles et agréables : seule la couverture est décevante car trop fonctionnelle. On aurait pu trouver mieux et plus joli, d’un point de vue esthétique, que cette sorte de «dossier d’identité judiciaro-philosophique».
Peut-être eût-il fallu reproduire les vingt-quatre questions initiales posées par Kassile lors des premiers entretiens, puis les huit questions seulement utilisées lors des derniers ? Bien sûr, certaines sont reproduites plusieurs fois dans le cours de certains dialogues mais ces répétitions auraient tout de même été utiles. Cela aurait constitué un aide-mémoire pratique qui aurait pu servir de «plate-forme intellectuelle» de référence au lecteur français. Ce dernier découvre ici les questions en même temps que l’interlocuteur japonais : cette façon de faire a son charme aussi, cela dit, car il y a du suspense. Il augmente à mesure que l’ouvrage progresse : on se demande : «Celui-ci va-t-il répondre à telle question ?» et «Comment va-t-il y répondre ?».
Enfin sur la question de la traduction, un aspect matériel du livre non moins essentiel : on a strictement respecté les tentatives (réussies ou maladroites, partielles ou totales) d’expression française, et strictement respecté aussi les quelques impropriétés ou approches sémiologiques voulant exprimer une idée imprécise parfois. C’est très bien. Cela préserve la vie brute et dramatique de chaque dialogue.
Remarques intellectuelles
Concernant les questions posées par Kassile, il faut bien convenir qu’elles sont souvent naïves et tout aussi souvent tendancieuses mais ce n’est pas grave. Leur rôle est fonctionnel : amorcer le dialogue et de fait, elles l’amorcent souvent d’excellente façon.
Il arrive qu’on s’en tienne pratiquement à la première question ou, en tout cas, qu’on n’arrive pas au stade de la quatrième ou de la cinquième. La meilleure question est celle concernant le rationalisme : c’est elle qui donne lieu aux réponses les plus intéressantes. L’attitude de Kassile est parfois un peu agressive et a probablement gêné certains de ses interlocuteurs. Nous pensons notamment à ses reproches lorsqu’ils lui avouent ne pas partager ses illusions sur le progrès de l’humanité ou l’universalité du rationalisme, sur l’idée aussi que l’individu pourrait se définir d’une manière auto-suffisante, comme une sorte d’être infini «per se». On ne voit pas en quoi l’individu serait «auto-référent». On ne voit pas non plus en quoi il importe de préciser qu’Aristote estimait que l’activité philosophique était la plus élevée du monde puisque tous les philosophes grecs le pensaient, y compris le maître d’Aristote et que tous les philosophes postérieurs l’ont aussi pensé ! Une telle remarque incidente se veut culturelle : elle est vaine.
On loue le soin de Kassile d’avoir rapporté les conditions de chaque entretien. C’est une nécessité : il aurait fallu pousser plus loin les descriptions parfois. Il est vrai que ce devait être un film. Si Kassile a un montage visible, il faut au moins faire éditer cela en DVD : on lui suggèrerait volontiers quelques pistes d’éditions. Voir et entendre un penseur répondre en v.o.s.t.f. à des questions en v.f.s.t.j. est un spectacle qui se vendrait à une élite mais il se vendrait assurément : cela renforcerait sans doute encore la portée du livre et on pourrait même les vendre ensemble, à notre humble avis.
Concernant les interlocuteurs (une seule jeune femme parmi eux), une remarque statistique : la majorité (seize) habite à Tokyo. Les autres se décomposent comme suit : quatre de Kyoto, un d’Osaka et un de Nagoya. Cela ne rend absolument pas compte de l’importance de l’École contemporaine de Kyoto, soulignée par un certain nombre d’interlocuteurs de Tokyo.
Une autre remarque statistique concernant les professions dont le compte excède naturellement le nombre des personnes puisqu’une personne peut cumuler plusieurs qualités : on compte seize philosophes, six écrivains ou professeurs de littérature ou d’histoire de la littérature dont deux poètes, deux psychologues (un psychiatre et un psychanalyste). On peut encore superposer à cela un ou deux professeurs de philosophie qui sont également anthropologues, sociologues. Bref, cela signifie, et c’est un compliment que nous faisons à Kassile, que tous les aspects de la pensée sont bien représentés. Il ne manque éventuellement que des juristes ou des politiques s’intéressant à la philosophie de leur activité mais leur absence est compensée par celle des philosophes qui s’intéressent à celles-ci.
Commençons la recension.
Le mot «Dialogue» est désigné par la lettre «D».
Son numéro correspond à son ordre chronologique dans le volume.
Recension critique
D1 – Hidetaka Ishida et Chihiro Minato (Tokyo)
D2 – Osamu Nishitani et Kuniichi Uno (Tokyo)
Les deux premiers dialogues avec ces deux groupes de penseurs – philosophes, parfois historiens de la littérature française – sont d’excellentes introductions aux similitudes culturelles et aux premières différences que l’on rencontre. Il faut commencer par ce commencement naturel qui fut aussi celui de Kassile dans le temps de la découverte de cette altérité. Ce qu’est l’histoire de la réception de l’Occident durant Meiji, ce qu’est le Bouddhisme, ce qu’est la culture normale d’un intellectuel japonais de bonne facture, on le trouve dans ces deux dialogues. Par la suite, on retrouve individuellement chacun d’eux et nous y reviendrons à ce moment-là dans le cours de cette recension.
D3 – Schinichi Nakazawa (Tokyo)
Il est le premier interlocuteur «sérieux» de Kassile, en ce sens qu’il est le premier qui lui résiste d’emblée franchement et ne le caresse pas dans le sens du poil structuralo-socialiste – même si Nakazawa cite Spinoza avec à propos – et ne cite pas trop les habituels Lacan ni Deleuze ni Lévi-Strauss. Il est aussi, par son expérience biographique, un exemple intéressant d’aventurier de la pensée puisqu’il a été au Tibet rechercher une initiation religieuse dans sa jeunesse.
D4 – Rika Kayama (Tokyo)
La psychiatre lacanienne Rika Kayama (Tokyo) qui suit, est très intéressante et franche : elle sape de l’intérieur sa propre discipline en posant que la réalité n’est pas unique ni stable donc pas compréhensible, in fine. Cette attitude réjouira tout freudien de stricte obédience, comme nous. Elle décontenance Kassile qui pensait qu’un psychologue ne pouvait être qu’un scientiste éhonté. Elle est un exemple pratique de «l’étrangeté» japonaise qui est la conséquence d’un certain pragmatisme. Il n’est pas étonnant que le pragmatisme et l’irrationalisme puissent s’allier : les sociétés de recherche psychique anglo-saxonnes en étaient un bel exemple européen au XIXe siècle. Bergson qui fut un de leurs correspondants et même, un temps, président de l’une d’elles, ne s’y trompait pas. Freud lui-même savait qu’il faut faire sa part à l’irrationnel. Ce secret antique est le partage des grandes âmes : les présocratiques, Platon et Aristote (le mythe chez l’un, l’individu chez l’autre), Descartes (les passions de l’âme, l’infinité de Dieu en nous qui n’est pas rationnelle mais expérimentable grâce à la volonté), Maine de Biran, Hegel (sa pensée religieuse), Schopenhauer et Nietzsche, Freud. La boucle existe aussi au Japon : elle est bien plus passionnante à relever que de s’occuper des passeurs du XVIIIe siècle !
D5 – Takaaki Yoshimoto (Tokyo)
Le cinquième dialogue – demi-dialogue en fait, et raté en dépit de ce que Kassile s’évertue à raccommoder par la suite, est le premier qui fascine franchement : nous voulons parler de sa rencontre avec Takaaki Yoshimoto (Tokyo). Sur lui, les questions de Kassile ne mordent pas d’un pouce l’altérité culturelle, et lui parler, c’est une expérience qui pourrait s’assimiler à parler – par delà le temps et l’espace, par delà-le mur du sommeil et du rêve – à quelqu’un comme Héraclite (cité justement par Kassile au début de son volume, et avec une belle intuition, profonde cette fois-ci) ou bien Hölderlin. Yoshimoto n’est pas rationaliste mais il est très intelligent. Il fait à Kassile le pire reproche que l’on puisse faire à quelqu’un qui se pique de penser : Kassile parle de mots ne correspondant pas à une réalité. Kassile parle du chaos en citant Deleuze mais ne SAIT pas ce qu’est le chaos parce qu’il ne l’a pas expérimenté. Son expérience «préliminaire à» et «déclenchant»… la philosophie, sa première question (Sur quoi m’appuyer ?) n’est nullement chaotique : elle découle d’une interprétation idéaliste du cartésianisme qui n’est, comme le lui fera très justement remarquer par la suite un autre interlocuteur (Yasuo Kobayashi de Tokyo, pp. 74-76) nullement le cartésianisme véritable. Kassile se justifie en expliquant qu’il est faux qu’on doive associer une image au mot «chaos» pour le penser correctement, et qu’il est inutile d’associer de même une représentation précise à l’idée de non-être pour penser cette idée réellement. Cette justification est hélas inacceptable : Héraclite en son fragment 124 (in Abel Jeannière, La Pensée d’Héraclite d’Éphèse et la vision présocratique du monde, avec la traduction intégrale des Fragments, éd. Aubier Montaigne, coll. Philosophie de l’esprit fondée par Louis Lavelle et René Le Senne, Paris 1959, p. 114) compare «le plus bel ordre du monde (cosmos)» à un «tas d’ordures rassemblées au hasard». Le Poème de Parménide (tel que Jean Beaufret l’a traduit, notamment in IV et VIII) assimile de son côté le non-être à la nuit, l’être au feu mais assure que cette séparation est humaine, non véridique en soi. Aucune idée, de toute manière, qui puisse se tenir abstraitement : l’être est une sphère, et même le non-être doit être considéré comme une présence. Les remarques d’A. Dies et de Heidegger sur la possibilité de replacer le fragment IV dans le corps du fragment VIII de Parménide sont un signe de plus de cette vérité. Yoshimoto s’est intéressé à Hegel, en profondeur, comme tout penseur japonais authentique, parce que Hegel a affronté directement cette dialectique terrible qui ne supporte pas l’absence de contenu trop longtemps. C’est le sens de la citation – qu’elle soit ou non tronquée par la traductrice – de Yoshimoto qui impressionne tant Kassile : elle traduit bien une pensée typiquement hégélienne, et du meilleur Hegel, du plus génial Hegel.
D6 – Yasuo Kobayashi (Tokyo)
Remarquable d’un bout à l’autre. À la p. 70, Kassile pose l’équivalence «athéisme = rationalisme», «religion = irrationalisme». Il n’a jamais lu saint Thomas ? Il ne sait donc pas qu’une des disciplines les plus remarquables, une des sections les plus riches de l’histoire de la philosophie est la philosophie des religions ? Une telle équivalence n’a cessé d’être déniée par l’Église catholique, en tout cas, à travers ses plus illustres théologiens. À la page 72 Kassile se revendique d’une lignée dont Descartes et Spinoza seraient les deux maîtres : l’idée d’une telle lignée prouve qu’on n’a rien compris à l’un ni à l’autre. La lecture courante d’Istrienne des deux philosophes est d’ailleurs souvent insuffisante dans son principe comme dans son résultat. On le renvoie aux interprétations de Delbos, de Gilson, de Gouhier, de Laporte et d’Alquié sur Descartes, de Delbos, Macherey et Alquié sur Spinoza (à notre récent article sur le spinozisme eudémoniste de Misrahi, pendant que nous y sommes, paru d’ailleurs ici) afin qu’il mesure ce qui les sépare et qui rend impossible leur rassemblement en une lignée commune, vocabulaire et problématique à part. Lachièze-Rey a étudié cela : inutile d’y revenir ici et maintenant. Kobayashi interprète Descartes correctement p. 74-76, bien mieux que Kassile. Nous le félicitons. Page 77, Kobayashi est cousin des Stoïciens. Page 82, Kobayashi juge 40 ans de spinozisme d’une manière exacte et aboutit – à propos du cri d’une femme – à la conclusion des meilleurs commentateurs, de Roland Caillois notamment : l’idée de valeur n’a plus de sens dans le système spinoziste.
D7 – Kuniichi Uno (Tokyo)
Page 88, Uno est naïf : il estime que ni Descartes ni Kant n’ont pensé la transgression de la raison. C’est faux : ils n’ont cessé de penser cette transgression et de la montrer en acte. Croire que Bataille, Benjamin ou Artaud l’ont pensée les premiers est illusoire et inexacte. Les connaissances d’Uno en histoire de la philosophie sont médiocres mais il a pourtant un esprit profondément philosophique : c’est l’essentiel. Il parle du travail infini de la liberté et pense que c’est ce brave Michel Foucault qui aurait le premier inventé une telle expression. Foucault l’a peut-être employée quelque part mais une telle expression provient directement de l’œuvre de Hegel, elle est purement hégélienne : telle est sa source. Le fait que Uno s’intéresse à cette expression et la trouve belle est très sympathique. Nous avons souligné bien des idées de Uno aux p. 94-95 et p. 97 qui témoignent d’une réflexion intelligente sur la pensée occidentale, et d’une recherche japonaise originale.
D8 – Kazushige Shingu (Kyoto)
Ce psychanalyste (mais de quelle obédience : strictement freudien ?) et psychiatre est le premier, curieusement, à poser le problème de l’irrationnel sous un angle mathématique qui est brillant. Il s’intéresse aussi au pouvoir «performatif» des énoncés bien qu’il ne cite pas le penseur anglais J.L. Austin. Shingu pense volontiers la contingence et l’incomplétude humaine
27/11/2006 | Lien permanent
Le pragmatisme de John Dewey, par Francis Moury

Acheter l'ouvrage sur Amazon.
«Ce que la Nature fait et ce que l'homme ne peut pas faire, ou ce qu'il ne fait qu'instinctivement, par une expansion de la vie qui est en lui, c'est ce qui résiste à l'analyse ou que l'analyse détruit».
Antoine-Augustin Cournot, Traité de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire (1861) (Hachette, 1922), p. 372.
John Dewey (1859-1952) fut un des pragmatistes américains disciples de William James. Il avait donné en 1930 pour titre à son autobiographie intellectuelle From Absolutism to Experimentalism. Et la postface (presque une centaine de pages) de nous expliquer que l'absolutisme en question était initialement celui de G.W.F. Hegel. Il faut, malheureusement, assez vite déchanter concernant ce point précis. Dewey a beau avoir enseigné l'histoire de la philosophie, y compris celle du système de Hegel, à ses étudiants de l'université de Chicago puis de Columbia, la conception qu'il s'en fait n'a pas grand-chose à voir avec celle de Hegel lui-même. Il faut dire que Dewey y avait été en partie initié par l'intermédiaire des auteurs d'un curieux Journal of Speculative Philosophy qui prétendait lire Hegel d'une manière «non métaphysique» (sic, selon la postface, page 269) : on se demande ce que pouvait bien être une telle lecture ! Dewey remarque savoureusement que les contemporains anglais et américains ont tendance à considérer inexactement Hegel comme un néo-kantien. Cela donne la mesure de leur connaissance en matière d'hégélianisme. En fait, Hegel est – ce que ne précise nullement Dewey – non pas un néo-kantien mais un post-kantien. Dans l'histoire de la philosophie, nous savons que ces deux termes recouvrent deux périodes différentes et des penseurs différents. (1)
L'histoire de la philosophie selon Dewey est simplifiée à un point tel qu'on pourrait la résumer aisément comme étant un combat progressivement de plus en plus clair entre point de vue empiriste et point de vue rationaliste, entre démocratie et conservatisme. Ce que veut Dewey, c'est saisir l'opportunité offerte par le darwinisme et l'évolutionnisme (2) pour, non seulement les réconcilier mais encore pour dévier le point de vue de ce combat qui a, selon lui, fait son temps, donc pour oublier cette dichotomie et repartir à zéro, pour combattre le fixisme du concept, le réintégrer dans le mouvant opératoire de l'action et faire de l'intelligence un simple moment d'une action – et réciproquement puisque la pensée est aussi une action – en vue de... de quoi ? Non pas en vue d'une finalité idéale extra mondaine telle que celles posées par la pensée grecque (la finalité idéale de l'action lui demeurant externe) mais en vue d'un accroissement d'expériences, de vie, de possibilités, d'opportunités de réussites pratiques pédagogiques ou scientifiques, esthétiques ou sociales demi-mondaines. Pour Dewey, l'idéalisme souffre du même travers que la théologie : couper le monde en deux au lieu d'en rechercher l'unité immanente.
William James, le fondateur du pragmatisme comme mouvement philosophique, était un esprit susceptible de nourrir divers courants chez ses disciples. Dewey en représente un aspect assez curieux et assez fluctuant mais intéressant. Si on veut savoir ce que fut le pragmatisme original de James, il faut, encore aujourd'hui, relire l'article contemporain que lui consacra Henri Bergson, recueilli dans La Pensée et le mouvant. Article célèbre, historiquement précieux mais qui n'est pourtant pas cité une seule fois par une postface et des traducteurs pourtant peu avares en références et citations. Bergson et James s'intéressaient beaucoup aux problèmes parapsychiques et aux Variétés de l'expérience religieuse. Dewey ne semble pas intéressé par cet aspect de la réalité si on s'en tient aux articles ici rassemblés : le problème de la perception l'intéresse techniquement bien davantage que celui de l'expérience mystique. Le nœud de son argumentation consiste à dériver les aspects cognitifs des aspects pratiques et d'intégrer ceux-ci dans ceux-là : l'exemple du bruit sec du volet se fermant et provoquant la peur avant que cette peur disparaisse une fois la cause du bruit identifiée, mérite d'être lu. On y saisit exactement ce qu'est le degré zéro du pragmatisme et quelle est sa filiation avec l'empirisme d'un Hobbes ou d'un Locke. Le réalisme médiéval (au sens gnoséologique du terme dans l'histoire de la philosophie) intéressait aussi Dewey : il y fait une allusion en note, discrète mais excitante.
On ne peut pas s'empêcher, lorsqu'on lit certaines remarques de Dewey sur l'histoire de la philosophie ou ses navrantes et très laborieuses argumentations contre l'idéalisme du grand Francis Herbert Bradley (1846-1924), de songer à ce passage si savoureux du film Accident (G.-B., 1967) de Joseph Losey durant lequel des professeurs de philosophie d'Oxford discutent dans leur club d'une information selon laquelle 5% des étudiants américains font l'amour pendant les cours sur Aristote, ce qui déclenche cette remarque froidement émise par l'un d'eux : «J'ignorais qu'il y avait des cours sur Aristote dans les universités américaines». Le succès de rire est garanti dans un cinéma parisien mais lire Dewey, c'est réellement se mettre en situation d'appréhender le degré de connaissance qu'il avait d'Aristote vers 1900 : il semble, il faut bien le dire à la lecture de ces essais, proche lui aussi de zéro. Hegel de son côté n'est cité en tout et pour tout qu'une seule fois par Dewey, occasion de rappeler la célèbre formule «Tout le réel est rationnel et tout le rationnel est réel»... et de s'en réclamer avec précaution... et pour cause, car la filiation est vraiment assez indirecte ! Il y a, en revanche, des remarques suggestives à méditer. Par exemple cette idée qu'on a tort de séparer l'antiquité du Moyen Âge alors qu'en réalité ces deux périodes fonctionnent de la même manière sur le plan gnoséologique. Dewey pousse même un cran plus loin le raisonnement en assurant qu'au fond le véritable Moyen Âge est la période moderne, donc la période qui va de la Renaissance à Kant voire même aux néo-kantiens.
Ce qui est passionnant n'est finalement pas tant la pensée de Dewey que l'aperçu qu'il donne des débats, pour leur part bien autrement serrés et riches, entre ses contemporains idéalistes, rationalistes, empiristes, positivistes, spiritualistes, pragmatistes. C'est cette période 1850 à 1900 qui est passionnante et c'est bien parce que Dewey lui appartient qu'il est intéressant. Il ne faudrait pas me pousser beaucoup, au surplus, pour me faire écrire que ce qui m'a le plus réellement passionné dans ce livre, ce sont les fragments de Bradley ici cités et discutés par Dewey. La tentative de simplification de l'histoire de la philosophie que Dewey prétend pratiquer, comme philosophe et comme pédagogue, au bénéfice politique de l'individualisme démocratique protestant capitaliste (car telle est bien, selon lui, la quadruple Signification contemporaine du problème de la connaissance telle qu'il l'énonce dans la dernière conférence du recueil) en niant la valeur des diverses écoles occidentales de pensée, intéresse donc davantage par ce qu'il nous fait connaître d'elles que par ce qu'il prétend mettre à leur place. C'est ce qui fait le charme et la valeur historique de certains de ses textes tels que la Conversation sur la Nature et le bien (dans lequel les participants à ce dialogue fictif mis en scène sur une plage, représentent les diverses philosophies contemporaines) ou que le Petit catéchisme sur la vérité (un dialogue très dix-huitième siècle entre un professeur pragmatique et son élève réticent puis convaincu).
Les thèses de psychologie de Dewey (dans ses conférences consacrées à l'expérience du point de vue psychologique, donc à la conscience) n'ont, en revanche, ni l'importance historique de celles d'un Brentano (qui annonce la phénoménologie de Husserl) ni de celles d'un Freud (qui fait passer la psychologie des profondeurs au stade de la métapsychologie) : elles oscillent plus modestement entre celles de l'opérationalisme de C. S. Peirce (1839-1914) et celles du positivisme logique des années 1930. Quant à ses thèses sociologiques, elles sont, compte tenu de l'époque, relativement neutres : Dewey enregistre strictement que la morale doit toujours conserver une finalité normative mais qu'elle ne peut dorénavant se passer de la science des mœurs. Émile Durkheim et Lucien Lévy-Bruhl ne disent rien d'autre au même moment. Le pragmatisme de Dewey de cette époque annonce, parfois, presque le rationalisme opératoire d'un Léon Brunschvicg dans L'Expérience humaine et la causalité physique (1922) qui considère lui aussi que l'opposition de l'idéalisme et du réalisme est dépassée mais qui n'en tirera évidemment pas tout à fait les mêmes conclusions.
Que la philosophie devienne une sorte d'organisatrice méthodologique des sciences humaines, une régulatrice des rapports entre la théorie et la pratique, était un des aspects philosophiques de ce début de vingtième siècle, symbolisé par un penseur tel que Wundt. C'est par cet aspect de sa pensée, désireuse de recomposer l'unité perdue, en redonnant à la philosophie un rôle premier et unificateur, que Dewey se souvient sans doute avec le plus de sincérité de ses lectures hégéliennes de jeunesse, y compris celles concernant l'histoire hégélienne de la philosophie qu'il ne restitue évidemment pas telles quelles mais dont il conserve un certain style et certaines traces. Plus curieux, Dewey semble ignorer totalement Auguste Comte qui était correspondant de John Stuart Mill auquel Dewey se réfère, sans surprise, plusieurs fois. Sans surprise, dis-je, parce que c'est au moins autant de l'empirisme classique (celui de Hobbes par exemple) que de l'idéalisme absolu hégélien que relève, in fine, le pragmatisme de John Dewey.
Cette traduction est matériellement munie de tous les outils universitaires nécessaires à la compréhension du texte : index des noms, avertissement sur la traduction (avec références au Vocabulaire technique et critique de Lalande, gage de sérieux), sans oublier une postface d'environ 90 pages. Cette dernière apporte de nombreuses informations de première main (notamment sur les éditions américaines de Dewey) mais glose ou paraphrase souvent laborieusement les thèses de Dewey sans arriver – comment le pourrait-elle si l'original lui-même n'y arrive pas ? – à les rehausser à un niveau métaphysiquement acceptable... et pour cause puisque Dewey pense que la métaphysique – au sens grec comme au sens kantien – est dépassée. Quelques coquilles relevées mais très peu : par exemple, un redoutable «Apperception» page 222, écrit avec un glorieux A majuscule mais avec deux p au lieu d'un seul.
Une dernière remarque : Dewey avait cru bon, en 1910, d'intervertir l'ordre de présentation et l'ordre chronologique de rédaction de ces articles et conférences. L'article sur Darwin, écrit en dernier, ouvre le livre en le plaçant, par son titre même, sous son patronage intellectuel. Il faut en tenir compte car on est à cheval, de ce point de vue, entre les Early Works (1882-1898) et les Middle Works (1899-1924) de ses œuvres complètes qui comprennent une troisième partie, les Later Works (1925-1953). Je me demande, à présent que je viens d'achever ce volume, s'il ne vaudrait pas mieux le lire en commençant par la dernière conférence puis en remontant jusqu'à la première, en suivant ainsi l'ordre de rédaction chronologique ? Il me semble en effet que la pensée de Dewey apparaît, rétrospectivement, plus clairement à mesure qu'on ressaisit son évolution naturelle.
Notes
(1) Cf. Victor Delbos (1862-1916), De Kant aux postkantiens (édition posthume préfacée par Maurice Blondel, Aubier Montaigne, 1940).
(2) Dewey veut assimiler la révolution évolutionniste du darwinisme à la révolution copernicienne du kantisme qu'il juge dépassée (le Kant de Dewey, tel qu'il apparaît dans ce recueil, est lui aussi très simplifié : la distinction entre l'esthétique transcendantale et l'analytique transcendantale est pratiquement ignorée, la question des jugements synthétiques a priori n'est pas posée, etc.) : le darwinisme devient, à ses yeux, un paradigme ou une direction de travail transposable ailleurs, destinée à casser le fixisme supposé des positions conceptuelles irréductibles classiques de l'histoire de la philosophie. Cependant, il faut savoir qu'être darwinien n'est, durant la période considérée, pas aussi innocent qu'une telle position philosophique éthérée peut le laisser croire. Je renvoie à la thèse dactylographiée de Mondher Sfar, Karl Marx. Psychanalyse et idéaux indo-germaniques, soutenue à Paris-I en mai 1983 qui prouvait que Marx avait, sa vie durant, recherché la caution scientifique de Darwin (au point qu'il lui proposa même de lui dédier le second livre du Capital), caution que Darwin refusa non moins fermement de lui accorder. Friedrich Nietzsche (une seule fois cité, en compagnie d’Amiel, par Dewey, à la page 72) ne s'y était, pour sa part, pas trompé : Nietzsche fut, comme on sait, au moins autant un critique qu'un disciple de Darwin.
25/12/2017 | Lien permanent
La Psychologie métaphysique de Franz Brentano, par Francis Moury

«J'affirme que, lorsqu'un objet est représenté, chaque partie de l'objet est implicitement représentée. Je vous rappelle ici la doctrine de notre logique, selon laquelle le jugement positif juge d'après le contenu total. Si je reconnais, par exemple, un moineau, alors je reconnais aussi un oiseau car l'oiseau est une partie logique du moineau, et un bec car c'est une partie physique du moineau. Ces parties ne sont jugées qu'implicitement, car elles sont représentées implicitement.»
Franz Brentano, extrait d'une lettre adressé à Oskar Kraus le 20 septembre 1909 (op. cit., page 93, note 1).
On ne pouvait, au milieu du siècle dernier en France et si on n'était pas germaniste, guère juger de l’œuvre du philosophe catholique Franz Brentano (1838-1917) que par les études de Lucie Gilson (1) qui en traduisait des extraits et par les brèves notices, sur sa vie et son œuvre, disponibles dans les histoires de la philosophie. Entre 1955 et 2010, à la faveur du développement des études phénoménologiques, trois éléments essentiels à sa mise en perspective historique, semblaient se dégager clairement. On savait qu'il avait soutenu en 1862 sa thèse sur Aristote, que cette thèse avait été lue avec passion par Martin Heidegger en 1907 au point qu'elle avait déterminé sa vocation philosophique (2). On savait aussi que Sigmund Freud, alors étudiant en médecine et en philosophie, avait suivi les cours de Brentano de 1874 à 1876. Que Freud avait été impressionné par la profondeur de son maître de telle sorte qu'il envisagea sérieusement de soutenir une thèse de philosophie sous sa direction. Réciproquement, Brentano l'estimait au point qu'il avait recommandé son étudiant Freud comme traducteur du penseur anglais John Stuart Mill à l'éditeur Theodor Gomperz (3). On savait enfin qu’Edmund Husserl avait été élève puis critique de Brentano, un peu comme Heidegger devait être élève puis critique de Husserl. De fait, pendant une bonne partie du vingtième siècle, les seuls contacts à peu près directs entre les étudiants français et Brentano, furent les citations de Brentano par Husserl, en général suivies des jugements et discussions de Husserl concernant son maître, disponibles en traduction française. Ce point de vue husserlien sur Brentano est l'origine du malentendu et de l'ignorance quasi totale de la philosophie de Brentano dont les maîtres sont Aristote, saint Thomas d'Aquin, Descartes et qui considérait comme des charlatans les idéalistes post-kantiens notamment Schelling et Hegel dont la pensée est, selon Brentano, «dénuée de tout caractère scientifique» (sic, in op. cit., page 70). Raison pour laquelle Brentano se voit qualifier de l'épithète «réaliste» dans les notices synthétiques. Brentano est réaliste au sens où Aristote l'était, au sens aussi où le réalisme thomiste domine chez lui largement toute critique de la connaissance d'inspiration anti-thomiste ou néo-kantienne, au sens enfin où le rationalisme de Descartes fut un rationalisme catholique, réaliste lui aussi et qui devait beaucoup à la pensée médiévale. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Brentano accola dans son panthéon personnel ces trois penseurs. Ce n'est pas non plus un hasard si Étienne Gilson, dont on ne dira jamais assez qu'il fut peut-être le plus grand maître de la Sorbonne du vingtième siècle, consacra une partie de sa vie à les étudier tous les trois.
On considère comme établi d'une part que Husserl emprunta à Brentano le concept d'intentionnalité, concept que Brentano lui-même avait emprunté à Aristote et à la philosophie du moyen âge et que, d'autre part, la définition du psychologique selon Brentano ne donnait pas satisfaction à Husserl (4). Souvenons-nous surtout de la formule de Husserl concernant les leçons universitaires de Brentano qui avaient le mérite d'être «tout particulièrement stimulantes en ce qu'elles signalent les problèmes au fur et à mesure de leur déroulement» (5). Un tel compliment, à double tranchant, n'épuise évidemment pas la question de savoir aujourd'hui ce que Brentano pensa vraiment, ce qui lui permit d'être admiré par des esprits aussi profonds et subtils mais néanmoins aussi divers que Freud, Husserl et Heidegger. La parution en traduction française de cette Psychologie descriptive est l'occasion de faire le point non seulement sur la pensée de Brentano mais sur ce qu'elle signifie aujourd'hui pour nous.
Commençons par le commencement qui détermine vraiment en profondeur l'ensemble de l'œuvre de Brentano : Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, sa thèse soutenue en 1862 sur Aristote. La traduction correcte de son titre est : De la signification multiple de l'être chez Aristote. Et non pas «de l'étant» comme on peut le lire ici ou là, ce qui revient à mettre la charrue heideggerienne avant, si j'ose dire, le bœuf brentanien. Commencer par Aristote pour comprendre ce qu'a voulu dire Brentano dans ses leçons de psychologie – leçons touchant aussi constamment à la logique, à l'éthique et à l'esthétique («quadrivium» lui-même hérité directement de la tradition antique puis médiévale) – est d'ailleurs nécessaire à un double titre. Non seulement historiquement (du point de vue de l'histoire de la philosophie) mais philologiquement (du point de vue de l'étude de cette traduction paraissant cent trente ans après l'original) dans la mesure où l'index nominum de la Psychologie descriptive permet un compte statistique sans équivoque : Aristote est le philosophe le plus souvent cité par Brentano durant ses leçons. (6) Le problème principal de Brentano est ici de distinguer ce qui relève de la psychologie et ce qui relève de la logique : c'était déjà le problème du De Anima et de l'Organon d'Aristote. Selon Brentano, Aristote serait parti de la décision de distinguer les sens multiples de l'être : cette décision aurait été la condition d'élaboration de son système. On peut, avec Pierre Aubenque cent ans plus tard (7), se demander si Brentano n'a pas inversé là non seulement l'ordre psychologique mais l'ordre structural de la problématique aristotélicienne qui aboutit à cette question bien davantage qu'elle n'en surgit. D'autre part, l'Aristote de Brentano est plutôt celui de saint Thomas d'Aquin, ce qui se conçoit puisque Brentano fut formé par la théologie catholique. Par exemple, Brentano tranche (dans son étude de 1872 sur La Psychologie d'Aristote, encore inédite chez nous en traduction) le problème de savoir si le Dieu d'Aristote connaît le monde, dans le sens thomiste : Dieu, en se connaissant, connaîtrait toutes choses. Brentano affirme que le rapport de l'être aux significations de l'être serait un rapport analogique, alors qu'Aristote ne l'a jamais affirmé. Enfin Brentano, sur des points essentiels, systématise Aristote : il considère ainsi, encore suivant certaines remarques de saint Thomas d'Aquin à propos de la Physique, du De Anima et de la Métaphysique d'Aristote, que la liste des dix catégories est achevée et complète. La conception ontologique aristotélicienne de la vérité, privilégiée par Martin Heidegger qui s'appuie sur certains textes précis de la Métaphysique d'Aristote, s'opposerait ainsi en partie ou en totalité à la conception logique aristotélicienne de la vérité privilégiée par Brentano, celle de l'être comme copule dans la proposition. C'est tout l'intérêt de l'étude serrée des textes grecs aristotéliciens que de constater qu'elles coexistaient, fût-ce aporétiquement (8). Ce genre de problèmes, certes techniques et difficiles et que je ne puis ici que signaler sommairement, constituent pourtant le soubassement métaphysique constant de ces leçons de psychologie, qui sont assez souvent aussi des leçons de psychologie et de métaphysique, à l'occasion de telle ou telle remarque, classification, division pédagogique.
Bref nous le voyons bien : envisager Brentano uniquement comme précurseur de Husserl, comme on le faisait autrefois, est une erreur de perspective. C'est au contraire comme disciple d'Aristote qu'il faut l'envisager, ainsi que le fit Heidegger, favorisé par la chronologie de l'histoire de la philosophie qui lui évitait naturellement de commettre l'erreur rétrospective des lecteurs de Husserl. La Psychologie descriptive de Brentano est, en réalité, une sorte de reprise, nourrie de certaines expériences psychophysique récentes, pour tenter d'actualiser la psychologie aristotélicienne en la poussant dans le sens d'une psychologie pure d'une part (la «psychognosie») et dans le sens d'une psychologie appliquée, d'une psychophysique génétique d'autre part. Ce qui a pu séduire Husserl comme Freud, à cette époque, dans l'enseignement psychologique de Brentano, c'est la perspective intentionnelle (du côté de Husserl), la place accordée aux processus inconscients (du côté de Freud) et l'aspect aporétique authentique, constant, de son enseignement. La modernité de Brentano en psychologie tient, en effet, aussi au fait qu'elle alliait toutes les autres tendances (du matérialisme au spiritualisme en passant par la psychophysique) en conférant à chacune sa place comme instrument exploitable au sein d'une recherche pure à visée autant psychologique que métaphysique. (9) Sa place dans l'histoire de la philosophie est celle d'un reprise de la position aristotélicienne originelle, celle du De Anima, de l'Organon, de la Métaphysique et du restant du corpus aristotélicien envisagé comme recherche aporétique actualisable hic et nunc, à l'état de la science positive et de la philosophie allemande de la fin du dix-neuvième siècle, par-delà le kantisme, le post-kantisme idéaliste et le néokantisme. De ce point de vue, on mesure en quoi, par ce retour conscient à Aristote, donc à une situation pré-kantienne sinon pré-cartésienne, Brentano s'inscrit dans l'héritage leibnizien : Leibniz est d'ailleurs un des autres penseurs classiques les plus cités par Brentano dans l'index nominum.
Compte tenu de ces éléments, je suggère donc, afin que la position de Brentano dans l'histoire de la philosophie apparaisse plus clairement au lecteur français, qu'on traduise enfin l'ensemble de ses études d'histoire de la philosophie antique sur la métaphysique, la vision du monde et la psychologie d'Aristote. On mesurera mieux, ainsi, en quoi le réalisme psychologique de Brentano est, toutes choses égales d'ailleurs, autant un annonciateur de la phénoménologie et de la psychanalyse qu'un cousin allemand du positivisme spiritualiste français de Félix Ravaisson, Jules Lachelier, Émile Boutroux et Henri Bergson (10).
Notes
(1) Lucie Gilson, La Psychologie descriptive selon Franz Brentano (Éditions Vrin, 1955) et Lucie Gilson, Méthode et métaphysique selon Franz Brentano (Éditions Vrin, 1955).
(2) Martin Heidegger, préface à W. Richardson, Heidegger, Through Phenomenology to Thought (Éditions Martinus Nijhoff, La Haye 1963), page X.
(3) Sigmund Freud, Lettres de jeunesse (cf. lettres des 13 et 15 mars 1875), traduction C. Heim, éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque de l'inconscient 1990. Gomperz, membre de l'Académie royale de Vienne, correspondant de l'Institut de France, ici envisagé comme simple éditeur allemand des œuvres traduites de J.S. Mill, est davantage connu chez nous comme savant auteur d'une monumentale histoire de la philosophie antique, Les Penseurs de la Grèce (traduction d’A. Reymond, Éditions Payot et Alcan, nouvelle édition revue en trois volumes, 1908-1910).
(4) Edmund Husserl, Recherches logiques (1900-1901) (traduction de H. Elie, A. L. Kelkel et R. Schérer, Éditions P.U.F., collection Épiméthée 1961, tome II, 2), page 166.
(5) Edmund Husserl, Souvenirs de Franz Brentano, cités in O. Kraus, Franz Brentano (Munich, Beck, 1919), page 157.
(6) Les deux autres noms autant, voire davantage, cités que celui d'Aristote sont, dans cet index nominum, ceux des éditeurs-annotateurs allemands de Brentano, mais ils sont cités par le traducteur-présentateur, pas par l'auteur. Pour donner une idée de l'ampleur statistique et philosophique aristotélicienne, il suffit de constater que Platon n'est cité, pour sa part, qu'une seule fois.
(7) Pierre Aubenque, Le Problème de l'être chez Aristote (Éditions P.U.F., collection B.P.C. 1962, cinquième tirage 1983), p. 12 et, d'une manière générale, concernant les divers points évoqués dans ce paragraphe, la quinzaine de références à Brentano dans cette thèse soutenue sous la direction de Maurice de Gandillac mais qui bénéficia aussi des conseils de Pierre-Maxime Schuhl, de A. Forest et, sur le plan philologique, de ceux du maître helléniste Paul Mazon.
(8) Une remarque incidente : la version PDF dite «1.0» des éditions Les Échos du Maquis, en ligne sur internet depuis 2014, reproduisant la seconde édition de la traduction de 1953 par J. Tricot de la Métaphysique d'Aristote est utilisable à condition de conserver à l'esprit qu'elle est incomplètement reproduite donc lacunaire par rapport à l'édition originale : les accents et les esprits des mots grecs antiques cités par Tricot n'ont pas été conservés; la bibliographie établie par Tricot n'a pas été reproduite au prétexte qu'elle serait «devenue trop incomplète avec le passage des années» (sic); un certain nombre de notes de Tricot ont disparu ou alors sont mutilées selon un critère pseudo-utilitaire : «Parmi les très nombreuses notes que contient la grande édition de [J.] Tricot, nous avons conservé uniquement, en tout ou en partie, celles qui fournissaient des indications essentiellement informatives». Occasion de répéter que nous ne disposons toujours pas d'une édition critique du texte grec avec traduction en regard et apparat critique dans la Collection des Universités de France publiée sous les auspices de l'Association Guillaume Budé. Quand cette lacune ahurissante sera-t-elle enfin comblée ?
(9) On peut se rendre compte de ce qu'étaient les études psychologiques à la fin du dix-neuvième siècle en lisant cette page savoureuse écrite par le Dr. Sandor Ferenczi en 1913, cité in S. Ferenczi, Thalassa, psychanalyse des origines de la vie sexuelle (traduction J. Dupont et S. Samama, édition Payot établie, présentée et annotée par N. Abraham, collection P.B.P. 1962), page 7 : «Depuis longtemps, l'évolution des sciences psychologiques et neurologiques était en stagnation, lorsque la méthode psychanalytique de Freud vint leur insuffler une vie nouvelle. Avec une remarquable patience, à ne pas imiter, les anatomistes du cerveau faisaient coupes et colorations sur des milliers d'échantillons, sans apporter aucun fait nouveau de quelque intérêt. Avec un zèle digne d'une cause meilleure, les psychologues expérimentalistes mesuraient les temps de réaction au millième de seconde près, sans la moindre idée du parti à tirer de cette accumulation de données. Dans leur fanatisme, des philosophes de la nature, soi-disant matérialistes, refusaient de prendre connaissance des faits dits psychiques et se contentaient de nier purement et simplement l'existence de l'âme, comme sans fondement biologique pour l'heure. De leur côté, les spéculateurs de la métaphysique fermaient les yeux à l'évidente primauté qui revient aux instincts dans les processus vitaux et croyaient aborder par le biais de la logique le domaine de l'âme si agité de passions. Pendant le même temps, l'activité mentale des neurologues cliniciens se limitaient à la localisation géométrique, annuellement, de quelques tumeurs cérébrales et à la prescription de bromures. La psychiatrie, enfin, s'épuisait à décrire des groupes de symptômes et à soumettre ceux-ci à des exercices de variations et de combinaisons [...].»
(10) Je renvoie ici le lecteur à mon article sur Le positivisme spiritualiste d'Aristote.
02/12/2017 | Lien permanent
Les Apocalypses de Ray Bradbury, par Francis Moury

Notes de lecture sur Ray Bradbury, L'Homme illustré [The Illustrated Man] (1951), traduction C. Andronikof, éditions Denoël, collection Présence du futur, 1954.
Ce recueil classique de nouvelles de science-fiction peut trouver place dans une anthologie eschatologique car quatre nouvelles ont la fin du monde pour sujet.
1) The Highway [La grand-route] (pages 55 à 59) constitue un traitement minimaliste de l'apocalypse atomique. Cette nouvelle est intéressante pour cette raison stylistique mais s'avère, somme toute, assez décevante. Un paysan mexicain voisin d'une route frontalière avec l'Amérique, est surpris par le nombre considérable et inhabituel de voitures qui remontent en direction du Nord. Il alimente en eau le radiateur de la dernière, retardataire, conduite par un adolescent et ramenant de très jeunes filles en larmes. «Vous ne savez pas ?» [...] répondit l'autre en se retournant et en agrippant le volant. Il se pencha. «C'est arrivé.» [...]» (page 58). Quoi donc ? «La fin du monde»... mais le paysan mexicain en question ne comprend pas la sens de la notion ou du concept de monde. Il saisit bien que quelque chose d'anormal se passe, il en est angoissé et c'est au lecteur de prendre sur lui-même le fardeau de la terrible information, le héros en étant mentalement incapable. Il y a quelque chose de faulknérien dans ce quasi-monologue d'un univers mental débile mais cette décalcomanie faulknérienne n'est pas assez sincère pour emporter l'adhésion. On reste sur sa faim.
2) The Last Night of the World [titre très mal traduit par La Nuit dernière alors qu'il aurait fallu bien évidemment le traduire par La Dernière nuit] (pages 123 à 127) est lui aussi minimaliste mais plus intéressant car plus original. Le 19 octobre 1969, un homme avoue à son épouse avoir rêvé que le monde allait finir durant la nuit suivante. Tous ses collègues de bureau ont fait le même rêve. Son épouse lui confirme que les femmes de son quartier ont également rêvé le même avertissement. Le doute n'étant plus permis, la résignation individuelle comme collective l'emporte sur la peur. Les informations du soir de la télévision et de la radio n'annoncent pas la nouvelle : tout le monde la connaît et sa redondance semble inutile. Sans rien avouer à leurs deux petites filles, les deux époux agissent comme chaque jour puis se couchent en se souhaitant mutuellement bonne nuit, sachant qu'aux alentours de minuit, tout le monde mourra. La curiosité ici provient de deux éléments : le rêve prophétique collectif et le traitement mi-psychologique, mi-sociologique d'une résignation qui n'est à proprement parler ni religieuse ni athée mais purement rationnelle et morale. Ici l'Apocalypse est annoncée, en route mais pas encore survenue en dépit du fait que Bradbury annihile d'avance, semble-t-il, tout suspense possible relativement à sa définitive réalité. Par-delà la banalité des propos parfois très platement moralistes échangés par le couple protagoniste, un terrible poids pèse du début à la fin sur la nouvelle.
3) The Exiles [Les Bannis] (pages 128 à 143) traite d'une apocalypse beaucoup plus originale, à savoir l'apocalypse littéraire. Cette nouvelle annonce son roman de politique-fiction Fahrenheit 451 (publié en 1953 puis traduit en 1955 chez le même Denoël et adapté au cinéma par François Truffaut en 1966) mais elle est beaucoup moins connue que ce dernier.
Elle se rattache assurément autant à la politique-fiction qu'à la science-fiction par son cadre : en 2120, des cosmonautes terriens, en route vers Mars dans une fusée, sont assaillis par d'étranges cauchemars qui finissent par tuer certains d'entre eux. La cause s'en trouve sur Mars car les fantômes des grands auteurs de la littérature fantastique anglaise et américaine, y survivent tels des bannis : ils y ont trouvé refuge alors que la Terre brûle leurs livres depuis cent ans, dominée par un régime pseudo-rationaliste détruisant purement et simplement ce qu'il considère irrationnel. Les corps et les âmes de William Shakespeare, d'Edgar Allan Poe, d'Ambrose Bierce, d'Algernon Blackwood, d'Arthur Machen, et d'autres écrivains y sont encore animés d'une vie, certes chétive mais pourtant capable d'influencer, à distance et par magie, les cauchemars des pionniers humains. Cauchemars mortels destinés à faire échouer cette colonisation car, de fait, si ces pionniers ignorent certes tout des succubes, des vampires, et des démons, les cauchemars dans lesquels ces créatures interviennent, les tuent bel et bien. Tel est, en tout cas, le dernier moyen de défense restant à la disposition de ces pathétiques mais dangereux fantômes.
La page 131 fournit une spectaculaire et curieusement hétéroclite énumération des auteurs en question (d'ailleurs lacunaire puisque des écrivains protagonistes de la nouvelle n'y sont pas nommés et inversement) qui vaut la peine d'être recopiée :
«Selon la loi, il est interdit à quiconque de posséder de tels livres. Ceux que vous voyez là sont les derniers exemplaires, conservés à des fins historiques dans les caves plombées du Musée. Smith se pencha pour lire les titres poussiéreux : Contes de Mystère et d'Imagination, par Edgar Allan Poe, Dracula par Bram Stoker, Frankenstein par Mary Shelley, Le Tour de Vis (1) par Henry James, La Légende du Val Dormant, par Washington Irving, La Fille de Rappacini, par Nathaniel Hawthorne, L'Incident du pont de Owl Creek, par Ambrose Bierce, Alice au Pays des Merveilles par Lewis Carroll, Les Saules, par Algernon Blackwood, Le Magicien d'Oz, par Frank Baum, L'Ombre étrange sur Innsmouth (2), par H. P. Lovecraft. Et d'autres livres encore par Walter de la Mare, Wakefield, Harvey, Wells, Asquith Huxley tous des auteurs interdits. Tous brûlés la même année que furent interdits le carnaval et Noël.»
Le capitaine de la fusée, une fois sur Mars, brûle ces volumes afin d'en finir avec les vestiges de l'ancien monde, entraînant simultanément – sans en avoir conscience – la destruction ou la fuite sur une autre planète (fuite évoquée par Algernon Blackwood comme une ultime possibilité de survie mais énergiquement refusée par Edgar Poe qui tente un dernier combat tandis que Charles Dickens refuse de les aider !) des fantômes de ses auteurs. Lesquels fantômes auront assisté auparavant à la «mort» de deux autres fantômes : celle d'Ambrose Bierce et celle du Père Noël, ombres à peine corporelles, bientôt auto-carbonisées ou dissoutes après, sans doute, qu'une dernière âme enfantine terrestre ait cessé de croire au Père Noël, après aussi que le dernier volume physique terrestre de Bierce ait été détruit ou bien que son dernier lecteur l'ait oublié. Les trois sorcières du Macbeth de Shakespeare ouvraient Les Bannis d'une manière spectaculaire en envoûtant les cosmonautes : elles aussi auront, une dernière fois mais en vain, composé leurs filtres, désormais inopérants. L'équipage survivant constate que la planète Mars est, apparemment, un désert inhospitalier. À peine l'un d'eux perçoit-il d'étranges cris, émis à mesure que chaque ouvrage achève de brûler, sans pouvoir établir entre ces deux faits la moindre relation inductive de cause à effet. Cette parabole oscille entre poésie, fantastique, horreur et épouvante, science-fiction, politique-fiction mais elle constitue surtout un curieux exemple d'eschatologie littéraire et esthétique : un peu comme si la littérature de science-fiction tentait de signer l'arrêt de mort de la littérature fantastique alors que celle-ci vampirise celle-là une fois de plus, à la fois sur le plan du contenu comme sur le plan formel.
Sur le plan de la simple histoire littéraire, il faut noter la comique récrimination de Dickens qui se plaint d'être catalogué par ses confrères comme écrivain fantastique : à peine a-t-il signé quelques contes de fantômes, comme tout bon écrivain anglais normalement constitué doit pouvoir un jour en écrire ! Il faut aussi noter que Shakespeare constitue l'auteur ayant créé le plus de créatures de fiction vivant elles aussi encore d'une vie fantomatique sur Mars mais lui-même n'apparaît pas. Bien sûr, le thème de l'interdiction de la lecture sur la Terre sera à nouveau traité dans le roman de politique-fiction de 1953 mais il est ici annoncé par cette très curieuse histoire au carrefour du fantastique et de la science-fiction.
4) L'Heure H [Zero Hour] (pages 229 à 240) narre une apocalypse discrète, au sens mathématique pur de la «quantité discrète» en jouant sur les unités de temps, de lieu et d'action. Des extra-terrestres investissent le psychisme des enfants (3) puis leurs jeux, en apparence innocents, afin d'envahir le monde à l'insu de leurs parents qui se retrouvent acculés et terrorisés lorsque l'invasion se produit, comprenant trop tard que leurs enfants, à présent totalement asservis aux envahisseurs, vont les guider jusqu'à eux pour les tuer. La vivacité de l'intrigue est dynamique car elle est constituée de multiples indices isolés les uns des autres que seul le lecteur rassemble intellectuellement tandis qu'ils échappent aux protagonistes adultes. Le passage du soupçon à la terreur panique de la conclusion, achevant brutalement d'éclairer l'ensemble, fait penser à la construction d'une nouvelle de terreur dans le genre de celles de Robert Bloch ou Richard Matheson. Il n'y a là rien d'étonnant car il existe chez Bradbury non seulement une veine de science-fiction mais encore une veine sombre de pure terreur : elle explique que les noms de Bloch, Bradbury et Matheson se croisent régulièrement non seulement dans les anthologies littéraires de nouvelles de science-fiction mais aussi, à l'occasion, dans des anthologies littéraires vouées à l'horreur et à l'épouvante.
Notes
1) Henry James, Le Tour d'écrou [The Turn of the Screw] (1898), traduit par M. Le Corbeiller (Bibliothèque fantastique Marabout, éditions Gérard & Cie, Verviers 1972) et nouvelle traduction in Henry James, Nouvelles complètes, tome IV (1898-1910) (éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade-NRF n°571, 2011).
2) H. P. Lovecraft, Le Cauchemar d'Innsmouth [The Shadow over Innsmouth] (1936), traduit par Jacques Papy in H. P. Lovecraft, La Couleur tombée du ciel éditions Denöel, 1954, pages 91 à 162 du retirage de 1973. NB : ce recueil porte le titre de la première des quatre nouvelles dont il est composé.
3) Bradbury a aussi imaginé des extra-terrestres investissant le psychisme humain dans une histoire adaptée au cinéma : It Came From Outer Space [Le Météore de la nuit] (États-Unis, 1953) réalisé par Jack Arnold.
03/08/2018 | Lien permanent
Baptiste Rappin contre le Golem, par Francis Moury
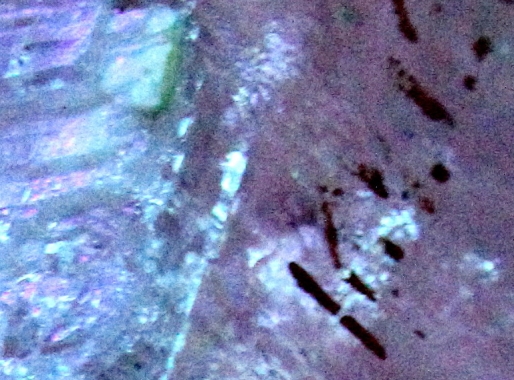
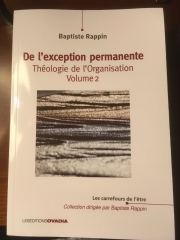 Baptiste Rappin, Au fondement du management – Théologie de l'organisation, volume 1 (Éditions Ovadia, collection Chemins de pensée, 2014).
Baptiste Rappin, Au fondement du management – Théologie de l'organisation, volume 1 (Éditions Ovadia, collection Chemins de pensée, 2014).De l'exception permanente – Théologie de l'organisation, volume 2 (Éditions Ovadia, collection Carrefours de l'être, 2018).
Acheter les ouvrages de Baptiste Rappin sur Amazon.
 Baptiste Rappin dans la Zone.
Baptiste Rappin dans la Zone.«Car il est indubitable que le temps de cette vie n'est qu'un instant, que l'état de la mort est éternel, de quelque nature qu'il puisse être, et qu'ainsi toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes selon l'état de cette éternité, qu'il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement qu'en la réglant par la vue de ce point qui doit être notre dernier objet.»
Pascal, Pensées et opuscules, pensée n°195 (circa 1655 à 1662) de l'édition Léon Brunschvicg (Éditions Hachette, collection Classiques Hachette 1897, revue et augmentée par Didier Anzieu et Geneviève Rodis-Lewis, circa 1951, nouveau tirage en 1978), p. 424.
«La force des choses nous conduit peut-être à des résultats auxquels nous n'avons point pensé.»
Louis Antoine de Saint-Just (2 février 1794)
«En premier lieu, pour rendre positive la science politique, il faut y introduire, comme dans les autres sciences, la prépondérance de l'observation sur l'imagination. En second lieu, pour que cette condition fondamentale puisse être remplie, il faut concevoir, d'une part, l'organisation sociale comme intimement liée avec l'état de la civilisation et déterminée par lui; d'autre part, il faut considérer la marche de la civilisation comme assujettie à une loi invariable fondée sur la nature des choses.»
Auguste Comte, Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société (1822) in Opuscules de philosophie sociale (Édition Ernest Leroux 1883), p. 111.
«L'existence de l'homme ― marquée par l'atome. Cette qualification désigne aujourd'hui quelque chose qui peut-être, à l'heure présente, n'est accessible à partir de la «pensée» qu'à un petit nombre d'homme. Pourtant le nom d'ère atomique donné à notre époque atteint probablement ce qui est.»
Martin Heidegger, Le Principe de raison (1957, traduction d'André Préau, Éditions Gallimard, 1962), pp. 92-3.
«La conscience de la possible annihilation du monde rend, seule, nécessaire un ordre universel et – principe fondamental, elle doit suffire. L'arrière-pensée de cette idée de derrière, il faut la voir se préciser dans une sagesse politique qui s'affirme depuis le Leviathan de Hobbes jusqu'à «L'Esprit du monde» de Hegel. Freud, arrivant à New York, confiait à Jung : «ils ne savent pas que nous leur apportons la peste» – les cadeaux intellectuels sont toujours subtilement empoisonnés.»
André Glucksmann, Le Discours de la guerre (Éditions de l'Herne, 1967 puis édition revue et augmentée U.G.E., collection 10/18 en 1974), p. 28.
«Ils veulent créer un système de contrôle global directement neuro-implanté dans chaque être humain. Je pense même qu'ils préparent une sorte de programme-monde d'autocontrôle généralisé, un monde parfaitement stable, sur tous les plans, une écologie homéostatique intégrale, planétaire et individualisée.»
Maurice Dantec, Satellite Sisters (Éditions Ring, 2012, p. 29, cité en exergue par Baptiste Rappin, op. cit. supra, volume 1), p. 231.
Ces deux premiers volumes (1) contiennent l'interprétation de fond, historique et philosophique, de la cybernétique du penseur américain Norbert Wiener, considérée comme le père théorique du «management» en tant que philosophie de l'information et de l'organisation. Ils contiennent aussi des pages très intéressantes sur Frédéric W. Taylor, le père du Taylorisme qui était, pour sa part, inspiré par des sectes protestantes mais dont les thèses peuvent relever rétrospectivement, par une ruse typique de l'histoire, du même mouvement. Le «management», issu à la fois de la pensée de Wiener et de celle de Taylor, désigne cette très curieuse sophistique moderne et contemporaine située au carrefour de la science économique, de la science politique et de la philosophie. Il ne faut pas la confondre avec la science de l'administration. On peut déjà en apercevoir poindre des aspects, et davantage qu'en filigrane, chez un penseur français du dix-neuvième siècle tel que Claude-Henri de Saint-Simon dont le jeune Auguste Comte avait été, comme on sait, secrétaire et disciple avant leur rupture.
Cette sophistique, au sens grec classique du terme, tenterait rien moins que de s'approprier l'ensemble des leviers de commande de la société : organisationnels, stratégiques, politiques, épistémologiques. La démonstration est excitante car elle se fonde sur l'histoire des religions, sur l'histoire de la philosophie, sur l'histoire générale et politique (selon ses quatre sections académiques : ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) autant que sur l'histoire théorique individuelle de cette science elle-même de l'organisation dont Calliclès n'avait jamais rêvé dans ses rêves dominateurs les plus avérés, tels du moins que le dialogue platonicien du Gorgias nous les rapporte. Calliclès ne songeait certes pas encore à neutraliser la politique par l'information conçue comme exception permanente exigeant de celui qui la pense une réorganisation continuelle, un mouvement en forme de boucle rétroactive modifiant sans cesse l'homme désormais pris dans les filets d'un dynamisme qu'il a lui-même engendré.
De l'histoire des religions, elle souligne les possibles racines théologiques catholiques de la pensée de Wiener ; la métaphysique médiévale nominaliste de Jean Duns Scot est convoquée dans le volume 2 et l'étude classique d'Étienne Gilson sur Duns Scot a évidemment droit à sa référence en note. Elle en souligne aussi les racines dans la pensée mystique juive du seizième siècle et dans le mythe juif du Golem, symbole de la technologie pan-organisationnelle, mythe repris par Wiener dans le titre d'un de ses propres livres (2). Ce sont, aux yeux du lecteur s'intéressant à l'histoire de la philosophie et à l'histoire des religions, les parties inévitablement les plus riches de ces deux volumes mais Wiener est par lui-même non moins passionnant et ils constituent donc, en somme, la meilleure introduction générale à sa pensée.
Le lecteur peu familier avec les théories sociologiques de l'organisation, y seront du même coup initié : Baptiste Rappin les met en relation, lorsqu'il le juge opportun, avec des penseurs classiques antiques, médiévaux, modernes et contemporains, notamment avec Platon, saint Augustin, saint Thomas, Machiavel, Thomas Hobbes, Claude-Henri de Saint Simon, Max Weber, Carl Schmitt, Martin Heidegger. Elle s'appuie sur les connaissances approfondies de Rappin qui a lu attentivement et d'une manière constamment critique, les hallucinantes publications théoriques de cette pseudo-science de l'organisation éditorialement florissante de 1945 à nos jours, des deux côtés de l'Atlantique et un peu aussi au Japon. Il fait bénéficier le lecteur, par de nombreuses citations et de nombreuses notes, d'une bibliographie de première main couvrant les auteurs américains fondateurs et leurs passeurs français. L'ouvrage analyse rigoureusement les origines, le développement, la situation théorique et pratique contemporaine de la cybernétique comme science de l'organisation. On apprend beaucoup de choses en lisant dans l'ordre volume 1 puis volume 2 qui ne répètent pas mais dialoguent, le second volume reprenant en les approfondissant certaines hypothèses ou certains résultats dégagés dans le premier volume. Le point de vue critique qui permet de les penser est souvent – ce qui ne gâte rien, au contraire ! – celui du Martin Heidegger penseur de la technique et critique visionnaire de la cybernétique, à qui Baptiste Rappin avait, notre lecteur s'en souvient sans doute, consacré une belle étude en 2015 dont j'avais rendu compte ici même (3).
Certains débats contemporains sont convoqués : la question de la sécularisation en philosophie de l'histoire, celle de la souveraineté et du sacerdoce en philosophie politique et en théologie, celle du langage en logique et en poésie, celle du messianisme et du katechon dont Baptiste Rappin avait réservé, il y a quelques mois, la primeur de la découverte aux lecteurs de Stalker-dissection du cadavre de la littérature (4). Sur le plan de la stricte histoire de la philosophie, Baptiste Rappin réinterprète cette histoire de l'antiquité à nos jours, ainsi que l'histoire des sciences et l'histoire de la philosophie des sciences, en pointant les moments charnières annonçant tel ou tel aspect de la cybernétique de Wiener. Les interprétations d'ensemble sont condamnées, en raison de l'ampleur de leur visée, à être discutées sur des points de détail : «le diable est dans les détails» comme dit le proverbe. Je ne suis ainsi pas sûr que Pierre Lévy – un des auteurs cités les plus intéressants par sa clairvoyance, ici aux pages 161 et 162 du volume 2 – ait eu raison en 1985 de considérer le Ludwig Wittgenstein du Tractatus logico-philosophicus comme source historique de la cybernétique de Wiener; cela pour la simple et bonne raison que Wittgenstein n'a eu de cesse, sa vie durant, de renier les positions de jeunesse publiées dans ce livre, y compris leurs formulations (5) mais en 1985 Lévy pouvait encore l'ignorer. Je ne suis pas davantage convaincu par les pensées et recherches citées d'André Neher, de Pierre Legendre et de Giorgio Agamben qui me semblent filandreuses et peu rigoureuses. D'une manière générale, ce qui concerne la pensée médiévale (et les thèses afférentes d'un Pierre Musso) me semble aussi trop rapide pour être réellement convaincant. Autre boucle de rétroaction s'appliquant à l'histoire de l'histoire de la philosophie, Baptiste Rappin étant un heideggérien émérite, j'ai parfois l'impression qu'il consent à l'interprétation heideggerienne de Descartes qui m'apparaît jusqu'à présent (car peut-être serai-je détrompé par la traduction future d'une de ses études d'histoire de la philosophie qui nous manque encore dans la belle collection Gallimard NRF des Œuvres de Martin Heidegger) assez partiale : elle néglige la pensée religieuse de Descartes. Là encore, le diable est dans les détails et même, ici en l’occurrence Dieu lui-même. Je ne crois pas du tout non plus, par exemple, que Descartes manifeste une rupture avec l'esprit médiéval : Étienne Gilson a d'ailleurs suffisamment prouvé le contraire (6). Gilson a également prouvé historiquement que sur plusieurs plans essentiels, il n'y a pas davantage de rupture nette entre l'antiquité et le moyen âge qu'il n'y en a entre ce dernier et la période moderne. Sans oublier la fascinante thèse meyersonienne de la continuité épistémologique qui les traverserait de part en part (7).
Sur le plan méthodologique, puisque l'on parle de pensée médiévale, je remarque que deux techniques très en vogue à cette époque, à savoir l'étymologie et l'analogie, sont assez régulièrement employées par Baptiste Rappin : les résultats de la première me semblent souvent plus dignes d'intérêt que ceux de la seconde dont j'ai tendance à me méfier. Je ne puis pourtant m'empêcher, pendant que j'écris ces lignes, d'en établir une entre la pensée de Wiener et celle des encyclopédistes du douzième siècle, telle qu’Étienne Gilson analysait (8) celui-ci concernant les rapports que ses encyclopédistes et ses théologiens établissaient entre microcosme et macrocosme. On sait, en effet, que la thèse ontologique majeure de Wiener est d'opposer la dissolution entropique (la mort) à la construction organisationnelle (la vie, résultat d'une exception permanente). Thèse ontologique parce que Wiener l'applique, en mathématicien logicien et en philosophe autant qu'en sociologue, à tous les niveaux de la réalité, non seulement à la société humaine mais encore à l'univers. Cette intuition métaphysique dont Wiener n'est évidemment pas l'inventeur mais un simple adaptateur (presque au sens électrique contemporain du terme, sinon au sens thermodynamique original auquel Baptiste Rappin le rattache à bon droit), vient de loin. Baptiste Rappin a bien sûr raison de remonter jusqu'à Empédocle mais on peut même remonter un peu plus haut : à Parménide (identité, unité, permanence, être) et à Héraclite (altérité, multiplicité, changement, devenir). Et on peut ensuite redescendre chronologiquement un peu plus bas : les dialogues métaphysiques les plus ardus de Platon (Parménide, Le Sophiste, Philèbe) s'intéressent en profondeur au rapport qui peut unir les deux thèses de Parménide et d'Héraclite. Depuis Platon, les études classiques d'histoire de la philosophie de G.W.F. Hegel, de Friedrich Nietzsche et de Martin Heidegger les ont aussi étudiés, ces rapports. L'homme nouveau de Wiener devient, quoi qu'il en soit de cette filiation et d'une certaine manière – c'est tout l'avantage du livre de Baptiste Rappin d'étudier les tenants et les aboutissants de cette manière, de cette métamorphose, chez Wiener comme chez ses précurseurs et comme chez ses disciples – comme le microcosme de cette thèse macrocosmique, par elle-même, on le voit bien, éminemment dialectique.
Ce qui nous amène à une question qui me semble inévitable: Norbert Wiener avait-il lu G.W.F. Hegel ? Et si oui, précisément quels ouvrages de Hegel ? J'aimerais le savoir. Norbert Wiener n'est d'ailleurs pas le seul, au vingtième siècle, à être inspiré par l'opposition d’Éros et de Thanatos : sur les plans ontogénétiques et phylogénétiques, la psychanalyse freudienne classique remet à l'honneur cette dualité sur les plans de la psychologique mais aussi de la métapsychologie. Autres questions non moins intéressantes : Norbert Wiener avait-lu Freud ? Et si oui, précisément quels ouvrages de Freud ? J'aimerais aussi le savoir. Parlant ici de Freud et de Wiener, je ne puis m'empêcher de signaler le fait que mon cher parrain le docteur Francis Pasche (9) avait d'ailleurs préfacé, durant la période de sa présidence de la Société psychanalytique de Paris, la traduction du célèbre livre américain de David Bakan, Freud et la tradition mystique juive (Éditions Payot, Bibliothèque scientifique, coll. Sciences de l'homme, avec postface d'Albert Memmi, 1964) dans lequel les études de G. Scholem (citées à juste titre par Baptiste Rappin relativement à l'influence mystique juive sur Wiener) sont abondamment discutées.
Sur le plan matériel, le volume 1 et le volume 2 sont esthétiquement dépareillés pour plusieurs raisons.
Ils ont été édités par le même éditeur mais dans deux collections distinctes. La table des matières du volume 1 est placée, à l'anglo-saxonne, en tête du livre alors que celle du volume 2 est placée, à la française, à sa fin. La fin du volume 1 ne comporte ni index des noms cités ni index des thèmes alors que celle du volume 2 en est munie. Le volume 2 est, en outre, esthétiquement infiniment plus mignon que le volume 1 non seulement à cause de la belle photographie catadioptrique de notre ami Juan Asensio qui illustre sa couverture mais encore à cause de la qualité et de l'épaisseur de son papier, de sa mise en page et de ses belles polices de caractères. Souhaitons que la parution future du volume 3 soit l'occasion de leur unification matérielle et esthétique au sein de la collection Carrefours de l'être des éditions Ovadia.
L'index des noms cités du volume 2 est utile mais cependant très lacunaire : certaines occurrences n'y figurent pas (Descartes est bien mentionné à la page 139 mais il faudrait aussi rajouter ses mentions aux pages 271, 426 et 456) et certains noms cités en sont absents (Henri Bergson devrait être mentionné à la page 245). On pourrait donc le compléter de plusieurs dizaines de mentions lors d'une réédition. Le Golem ne figure, alors qu'il est étudié à plusieurs reprises dans les deux volumes (notamment volume 1 pages 139 et suivantes, volume 2 pages 508 et suivantes), ni dans l'index des noms cités ni dans celui des thèmes : il eût fallu l'insérer, au moins, dans l'un des deux.
Signalons aussi de démoniaques (et hélas pas si exceptionnelles) coquilles : absence de numéros au bas de certaines pages (les pages 515 et 516 du volume 2), interversions de lettres («l'artillerie qui tonné [qui tonnait]» in volume 1, page 220 ou bien encore un mémorable «Innovent III» [Innocent III] » in volume 2 page 511) voire de mots («la nouvelle de Wiener insultée [intitulée] Un savant réapparaît» in volume 2 page 506), lacunes de mots qu'on doit mentalement combler («la disparition progressive [de] la notion de bien commun» in volume 2 page 512).
Le style est parfois original et savoureux : au lieu de l'attendu [Poursuivons] ou d'un pléonastique mais classique [Poursuivons plus avant], Baptiste Rappin écrit assez souvent un rabelaisien et, en tout cas, bien vigoureux «Poursuivons plus outre» ! Au lieu des simples verbes [distinguer] ou [séparer], on lit volume 2 page 536 une formule qui les remplace d'une manière inutilement longue : «il [Max Weber] en vient à assurer le départ entre [c'est moi qui souligne] plusieurs formes de domination». Pourquoi une formule si compliquée alors qu'un verbe tout simple suffisait ?
Un mot encore sur les notes bibliographiques de bas de page : elles citent, en général, l'édition la plus récente mais négligent de remémorer au lecteur, ne serait-ce qu'entre parenthèses, la date de l'édition originale. Le livre de Carl Schmitt, Terre et mer, un point de vue sur l'histoire du monde, est cité in volume 2 page page 545 muni de la référence : éditions Pierre Guillaume de Roux, 2017, avec une introduction par Alain de Benoist et une postface par Julien Freund (1921-1993). Il me semble qu'il eût fallu mentionner entre parenthèses, par exemple juste après son titre, la date de l'édition originale allemande (1942) et celle de sa première traduction française (éditions du Labyrinthe 1985) afin que le lecteur ait une idée exacte de la vie du livre.
Vous me répondrez, non sans raison, que la mention de l'édition la plus récente suffit, que ce genre d'informations est trop lourd pour une note de référence et qu'il aurait davantage sa place dans une bibliographie. C
18/08/2018 | Lien permanent
Frankenstein de James Whale, par Francis Moury

1- Frankenstein (1931) de James Whale.
2- La fiancée de Frankenstein (1935) du même.
3- Le fils de Frankenstein(1939) de Rowland V. Lee.
4- Le spectre de Frankenstein(1942) de Erle C. Kenton.
5- Frankenstein rencontre le Loup-garou (1943) de Roy William Neill.
6- La maison de Frankenstein(1944) de Erle C. Kenton.
7- Deux nigauds contre Frankenstein (1948) de Charles T. Barton.
Did I request thee, Maker, from my clay
To mould me man ? Did I solicit thee,
From darkness to promote me ?
John Milton (1608-1674), Lost Paradise / Le Paradis perdu (1667), livre X, vers 743-745.
Résumé du scénario
 Dans la région germanique de Goldstat, vers la fin du dix-neuvième ou le début du vingtième siècle. Le docteur Henrich Frankenstein veut créer un être humain vivant à partir de fragments de cadavres secrètement déterrés. Méprisant les avertissements de son ancien professeur d'université et négligeant les inquiétudes de sa fiancée, il leur insuffle la vie grâce à un procédé électro-biologique, à la faveur d’une grandiose nuit d’orage. La créature a un esprit enfantin et, par accident, le cerveau d'un criminel : sa puissance physique est redoutable et son aspect effrayant. Elle ne tarde pas à constater la méchanceté des hommes qui raniment ses propres instincts meurtriers. Elle s’échappe du laboratoire, bientôt pourchassée en raison de ses crimes tantôt accidentels tantôt volontaires, semant la terreur. Quitte à périr de la haine des hommes, la créature veut périr en même temps que l’homme bien particulier qui l’a créée. Qui des deux sortira vivant de la confrontation finale ?
Dans la région germanique de Goldstat, vers la fin du dix-neuvième ou le début du vingtième siècle. Le docteur Henrich Frankenstein veut créer un être humain vivant à partir de fragments de cadavres secrètement déterrés. Méprisant les avertissements de son ancien professeur d'université et négligeant les inquiétudes de sa fiancée, il leur insuffle la vie grâce à un procédé électro-biologique, à la faveur d’une grandiose nuit d’orage. La créature a un esprit enfantin et, par accident, le cerveau d'un criminel : sa puissance physique est redoutable et son aspect effrayant. Elle ne tarde pas à constater la méchanceté des hommes qui raniment ses propres instincts meurtriers. Elle s’échappe du laboratoire, bientôt pourchassée en raison de ses crimes tantôt accidentels tantôt volontaires, semant la terreur. Quitte à périr de la haine des hommes, la créature veut périr en même temps que l’homme bien particulier qui l’a créée. Qui des deux sortira vivant de la confrontation finale ?Critique
Produit par Carl Laemmle Jr. pour la Universal Pictures dans la foulée du succès du Dracula (États-Unis, 1931) de Tod Browning avec Bela Lugosi, Frankenstein (États-Unis, 1931) de James Whale inaugure donc le cycle produit et distribué aux États-Unis par la Universal inspiré du roman de Mary W. Shelley (1797-1851), Frankenstein ou le Prométhée moderne (1818). Le poète romantique Percy B. Shelley lui avait offert, le 06 juin 1815, un exemplaire du Paradis perdu (1667) de Milton à qui elle devait emprunter les lignes citées supra pour les mettre en exergue de la page de titre de la première édition de 1818. Frankenstein, dans le roman de Mary Shelley, se compare à l'archange maudit qui aspira à l'omnipotence, tout comme lui dorénavant enchaîné à un éternel enfer. La créature de Frankenstein lit aussi ce poème et compare son propre sort tantôt à celui du Adam, tantôt à celui du Satan, tels que décrits par Milton.
Depuis sa publication en 1818 suivie de nombreuses rééditions, ce roman fantastique avait été adapté plusieurs fois au théâtre (dès les années 1825) et même au cinéma bien avant 1931 puisque la firme Edison avait déjà distribué un film muet (de court métrage) sur le sujet en 1910. Bien des modifications avaient été effectuées par les adaptations théâtrales, parmi lesquelles citons au moins celles-ci : le prénom de Frankenstein n'est plus Victor; on lui adjoint un récupérateur de cadavres (souvenir des très réels criminels écossais Burke et Hare dont les forfaits eurent lieu en 1828 : ils tuaient des innocents dont ils revendaient ensuite les cadavres au docteur Knox, célèbre anatomiste); la créature ne parle plus alors qu'elle était éduquée et maniait parfaitement le langage dans le roman. Frankenstein ne disposait ni d'un moulin ni d'une tour de guet dans le roman de Mary Shelley : ses moyens étaient plutôt ceux d'un simple étudiant en médecine vivant isolé. Et la naissance de la créature n'avait rien de technologique ni de spectaculaire, contrairement à ce qu'on voit dans le film de Whale. Dans les anciennes pièces de théâtre, il arrivait même qu'elle naquît d'une marmite remplie de produits chimiques. Il y eut en outre, au sein de l'équipe de production Universal, une intéressante discussion sur la nécessité d'angliciser totalement l'intrigue en supprimant les noms à consonance germanique : le résultat fut un compromis assez étrange, ni franchement localisé ni franchement daté. En revanche, certains éléments de la vieille tradition théâtrale furent préservés par le film de Whale : par exemple, le générique d'ouverture ne mentionne pas le nom de l'acteur Boris Karloff comme interprète du monstre : un simple point d'interrogation figure à sa place.
On sait que le cinéaste français Robert Florey, amateur de fantastique et récemment arrivé à Hollywood, avait d’abord été pressenti comme réalisateur par Richard Schayer, le conseiller littéraire du producteur Carl Laemmle Jr. Et que Florey tourna bel et bien, dans les décors du film de Browning de 1931, deux bobines d’essais avec Bela Lugosi dans le rôle du monstre, maquillé par Jack Pierce mais que l’acteur refusa d’aller plus loin, gêné par le maquillage d’une part, le peu de dialogues accordé à son personnage, d’autre part. Et on sait que James Whale reprit le projet en songeant cette fois-ci à Boris Karloff (de son véritable nom William Henry Pratt) comme interprète du monstre. La pièce de théâtre de Peggy Webling et son adaptation par le scénario de John L. Balderston (aussi l’auteur du scénario de Dracula de 1931 et du scénario de La Momie (États-Unis, 1933) de Karl Freund) et Robert Florey (non crédité au générique) aboutit donc à un film certes considérablement différent du roman initial mais néanmoins tout à fait remarquable par sa puissance dramatique et sa beauté plastique.
La version James Whale de 1931 est bel et bien la version matricielle de toute la filmographie moderne du thème, par rapport à laquelle chaque nouvelle tentative est amenée à se définir en l’imitant ou en en prenant le contre-pied. La mise en scène parvient à dynamiser de l’intérieur, par sa violence visuelle récurrente et sa pureté absolue, atteignant sans effort jusqu’à l’ampleur la plus majestueuse et la plus originale, le matériel écrit à sa disposition. Même si Whale a évidemment été influencé par la séquence correspondante du Metropolis (Allemagne, 1926) de Fritz Lang, il faut admirer sa séquence de naissance du monstre comme un morceau de bravoure technique et dramatique. Le plan célèbre dans lequel, durant la chasse finale au monstre, créateur et créature s’affrontent un instant du regard, avec une inquiétude commune, est un autre exemple de cette économie dramatique, au symbolisme nullement plaqué. Whale avait le sens de la beauté et de la tragédie car il avait connu la mort et la peur de près pendant la Première guerre mondiale. C’était un esthète raffiné, au goût sûr, et dont le génie visionnaire authentique s'approfondira encore dans le film suivant de 1935. L’interprétation bouleversante de Karloff, le maquillage créé par Jack Pierce, la direction de la photographie d’Arthur Edeson influencé par l’expressionnisme allemand, la beauté des décors de Charles D. Hall ― ils reprenaient notamment certains éléments de décor du film fantastique The Cat and the Canary [La Volonté du mort] (États-Unis, 1927) de Paul Leni et du film de guerre All Quiet on the Western Front [À l'Ouest rien de nouveau] (États-Unis, 1930) de Lewis Milestone d'après le roman de Erich Maria Remarque ― installent définitivement le mythe et les deux personnages (créateur et créature) dans l’histoire du cinéma mondial. Colin Clive est honorable dans le rôle du baron qu’il campe d’une manière fiévreuse et romantique, assez nerveuse et originale : on l’a souvent critiqué à tort en France. L’acteur Dwight Frye confère à son personnage de bossu sadique et récupérateur de cadavres, une virulence d’une modernité et d’une violence assez étonnante tandis que Edward van Sloan incarne une vivante antithèse du baron avec une relative finesse. Les autres rôles sont conventionnels et sans grand intérêt.
À noter que la présentation pré-générique d’époque est celle de la version américaine y compris lorsqu’on regarde la version française alors que dans les copies françaises, Jean-Pierre Bouyxou (dans son remarquable petit livre Frankenstein, (éditions Serdoc, collection Premier Plan, Paris 1969, page 16) assure qu’il s’agissait d’un acteur français, Paul Reboux, substitué à l’acteur américain Edward Van Sloan. Preuve s’il en était que la version française proposée par Universal sur son édition numérique n’est pas d’époque.
À noter aussi qu’on ne cesse, depuis des dizaines d’années, d’écrire et de répéter qu’il n’y pas de musique dans ce Frankenstein. Mais, ainsi que le remarque très justement le commentateur américain de l'édition collector Universal, les génériques de début et de fin en comportent bel et bien une, et la séquence de la fête des villageois est aussi illustrée musicalement, même si c’est une partition censée être réelle et non pas surajoutée à l’action afin de la commenter. Cependant aucun compositeur n’est crédité au générique pour ces deux morceaux distincts.
À noter enfin que l'édition vidéo numérique Universal de ce classique de 1931 est munie d'un considérable dossier documentaire dans lequel interviennent des historiens (Ivan Butler) et des cinéastes historiens (Don F. Glut), sans oublier un remarquable commentaire audio de Rudy Belhmer, riche et précis, signalant ce qui est original par rapport au roman initial de Mary Shelley et même par rapport aux adaptations théâtrales et cinématographiques antérieures à 1931. Il ne s’agit pas d’un commentaire à finalité esthétique mais d’abord d'un commentaire d'histoire du cinéma, typiquement anglo-saxon, constamment nourri par les déclarations des membres de l'équipe de production et de tournage, donc par des documents de première main. Sa vocation est d'offrir des informations et des dates, des faits exacts et contrôlés.
Source technique
Coffret Frankenstein : the Legacy Collection (édition Universal, Paris, 2004).
30/07/2021 | Lien permanent



























































