« Ils veulent défaire la France : dialogue à trois voix | Page d'accueil | Journal d'une lecture, 1 : Le Tunnel de William H. Gass »
06/06/2007
Apologia pro Vita Kurtzii, 6 : Exterminate all the brutes !

Photographie (détail) de Juan Asensio.
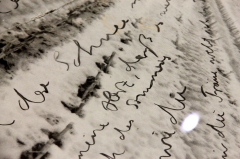 Apologia pro vita Kurtzii.
Apologia pro vita Kurtzii.«It was very simple, and at the end of that moving appeal to every altruistic sentiment it blazed at you, luminous and terrifying, like a flash of lightning in a serene sky : ‘Exterminate all the brutes !’.»
«J’ai étudié cette phrase pendant plusieurs années. J’ai réuni une quantité de documentation que je n’ai jamais eu le temps de dépouiller. J’aimerais disparaître dans ce désert où personne ne peut me joindre, où j’ai tout le temps possible. Disparaître et revenir seulement quand j’aurais compris ce que je sais déjà.»
Sven Lindqvist, Exterminez toutes ces brutes ! (Éditions Les Arènes, 2007).
«Et lorsque ce qui avait été commis au cœur des ténèbres se répéta au cœur de l’Europe, personne ne le reconnut. Personne ne voulut reconnaître ce que chacun savait.»
Ibid.
Cœur des ténèbres est une sorte de monstre. Il n’est pourtant pas le seul exemple de son espèce car d’autres œuvres nous permettraient de lire, d’une façon à peine métaphorique, la crise dans laquelle l’Occident se trouve plongé.
Cette crise est une crise du langage, familière à Georges Bernanos lorsqu’il affirme en 1926 à Frédéric Lefèvre : «On nous avait tout pris. Oui ! quiconque tenait une plume à ce moment-là s’est trouvé dans l’obligation de reconquérir sa propre langue, de la rejeter à la forge. Les mots les plus sûrs étaient pipés. Les plus grands étaient vides, claquaient dans la main».
Conrad, avant Bernanos, fit l’expérience douloureuse de cette universelle tricherie.
«La phrase «Exterminez toutes ces brutes !» n’est pas plus éloignée du cœur de l’humanisme que Buchenwald de la Goethehaus à Weimar. Cette idée a été presque complètement refoulée – même par les Allemands qui ont été faits les uniques boucs émissaires des théories de l’extermination, lesquelles, en réalité, appartiennent à toute l’Europe.»
Je ne puis m’étendre sur l’infinie complexité des raisons de cette crise, que George Steiner, reprenant les remarquables intuitions d’un Fritz Mauthner (encore bien ignoré dans notre pays, cet auteur développe dans son œuvre principale (Contribution à une critique du langage qui n’a pas été traduite en français alors qu’elle a paru en… 1903) un scepticisme radical à l’égard de ce qu’il nomme la «superstition des mots», ajoutant que ces derniers ne «donnent pas d’intuition réelle et ne sont pas réels»), que Steiner donc rattache à la grande cassure épistémologique propre au début du siècle passé, et que, plus largement, nous pourrions étendre à la Modernité, comprise comme une période où vacille l’autorité de la tradition logocentrique (1), où la parole perd de sa transparence, devient le vecteur idoine d’un mensonge généralisé.
Qu’il nous suffise de dire que les mots ne se nourrissent plus que d’autres mots depuis que Dieu est devenu un fantôme, le Revenant suprême qui ne cesse de hanter les corridors vides de notre monde mais ne parle plus, ne daigne plus nous soulever d’une seule parole. Qu'il nous suffise de dire que les mots, ne se nourrissant plus que d'autres mots (dans un sens aussi dramatique que le pensait le jeune Hofmannsthal, avant même le mutisme de Lord Chandos), deviennent ainsi les vecteurs du langage souillé, de tous les mensonges. Le langage putanisé devient le faux silence (le mutisme donc) qui est gros de toutes les trahisons : le bavardage.
Et les livres ne répondent finalement qu'aux livres, à d'autres livres desquels ils sont nés, dans une chaîne presque infinie, plus qu'ils n'évoquent, sans y parvenir autrement que laborieusement et de toute façon incomplètement, le réel.
Et les livres eux-mêmes, en bavardant, s'enferment dans le mutisme des idiots : en bavant, en bégayant, en se vidant de leur merde.
D’autres œuvres disais-je ? Oui car, contrairement aux ogres des contes, nos monstres littéraires ne sont pas des créatures solitaires. Mieux, ils entretiennent entre eux des ressemblances souvent remarquables, comme s’ils étaient les fils d’un même père dégénéré, Cœur des ténèbres. Ainsi, l’une des œuvres les plus directement inspirée par la nouvelle de Joseph Conrad est sans nul doute Le Transport de A. H. de George Steiner. Dans ce roman qui fit scandale il y a quelques années, Hitler n’est qu’une voix, dont l’étrange et perfide mélopée contamine les pages, comme les mots de l’aventurier Kurtz contaminent celles de l’œuvre de Conrad, comme les mots du vagabond Marius Ratti contaminent les cervelles d’un petit village tyrolien où Broch fait éclore la parole vide de son pitoyable tentateur, comme les mots de Monsieur Ouine sapent lentement les esprits des habitants de Fenouille et les fondations mêmes d’une paroisse qui se meurt.
Mais Kurtz n’est rien, rien d’autre qu’une ombre, un homme dont la caboche remplie d’un peu de bourre fomente dans l’obscurité impénétrable de la jungle des plans grandioses d’éducation et de rédemption des âmes sauvages dont nous ne saurons rien, si ce n’est qu’ils préconisent, alors que l’aventurier, comme un missionnaire démoniaque, est parvenu au bout de la nuit, l’extermination de toutes les «brutes». Mais Marius Ratti n’est rien, rien de plus qu’un vagabond suspect, un prophète raté réclamant des paysans qu’ils délaissent l’utilisation des machines et retournent à l’exploitation de la mine abandonnée, afin que les puissances de la terre, celles-là même que Hitler, selon Steiner, saura diaboliquement évoquer dans ses discours chthoniens, retrouvent leur antique grandeur, détruite par le christianisme. Mais Ouine enfin, au moment de mourir, n’est plus rien, lui qui n'a jamais été grand chose de plus qu'une coquille vide, le vieillard bredouillant des paroles incohérentes et insensées, tandis qu’il semble avalé par un gouffre sans fond – sa propre âme, nous dit Bernanos – dont les forces de marée délitent le monde des vivants.
Ces romans sont autant d’astres vides dont le centre de gravité, le foyer obscur, le cœur vorace est le conte de Joseph Conrad, ce dernier se souvenant bien évidemment de l'exemple de Macbeth. Toutes ces œuvres sont des trous noirs, qui paraissent aspirer le langage et dévorer ce qui les entoure. Les contempler, c’est comprendre que leur puits est sans fond. Les observer de loin, c’est admettre que nous ne saurons jamais rien du mal qui mine notre âge si, comme l’ont fait les romanciers que nous avons nommés, nous ne tentons à notre tour de nous y enfoncer.
Sven Lindqvist ne s'est point enfoncé dans ce puits de ténèbres mais il s'est perdu au plus profond du désert là où, selon Ernest Hello, l'âme parle à Dieu dans un dialogue dont le plus petit grain ne sera jamais perdu. Dieu ou... le démon ? Selon Marlow, la forêt tropicale a pris possession de l'âme vide de Kurtz. Le démon de midi, hantant les contrées chaudes, a peut-être soufflé à Lindqvist quelques-unes de ses intuitions, notamment celle qui lui fait dire que la Shoah, aussi irréductible qu'on le voudra dans son caractère d'atrocité absolue, comme élue à rebours, n'en a pas moins été longuement mûrie par et surtout dans l'Europe éclairée (2).
Ainsi, c'est volontairement perdu sur la terre la plus aride (qu'il retrouvera en Australie avec Terra Nullius, également édité par Les Arènes) que Lindqvist a entrevu la moiteur infernale dans laquelle se sont corrompues les âmes de peu de poids de Kurtz et de ses séides, personnages reprenant, selon les dires de l'auteur, les débats concernant la colonisation (3) qui ont agité la société anglais de la fin du 19e siècle. En voulant se perdre dans le désert, Lindqvist s'est retrouvé au milieu des cadavres humains déambulant comme les fantômes noirs du roman de Conrad : pas encore morts et pourtant déjà morts.
En fait, comme Marlow dont il a reproduit le dangereux voyage, Lindqvist nous a rapporté du plus profond du désert, de sa propre âme donc, un savoir dont il soupçonnait la présence, comme Marlow sait, intimement, que presque rien ne le sépare de Kurtz, comme Macbeth sait qu'il ne pourra pas résister à la tentation et qu'il est déjà le meurtrier de son roi annoncé par les trois sorcières, comme nous savons que bien peu de choses nous séparent d'un de ces criminels errants décrits par Cormac McCarthy.
Notes
(1) «L’ordre du cosmos s’est effondré, émietté dans des chaînes associatives et des points de vue non communicants. Le langage des signes se met à parler pour lui-même […]; il ne s’appuie plus sur un Logos subsistant», Gilles Deleuze, Proust et les signes (P.U.F., coll. Perspectives critiques, 1964), p. 137.
(2) Point sans doute le plus contestable du livre de Lindqvist, qui bien évidemment ne se préoccupe pas de la dimension métaphysique de la Shoah. L'auteur écrit ainsi : «[...] l’Holocauste fut unique – en Europe. Mais l’histoire de l’expansion occidentale dans d’autres parties du monde montre maints exemples d’exterminations totales de peuples entiers» puis «[…] le pas entre massacre et génocide ne fut pas franchi avant que la tradition antisémite ne rencontre la tradition du génocide qui avait surgi durant l’expansion européenne en Amérique, en Australie, en Afrique et en Asie.», op. cit., p. 210.
(3) «Lorsque Conrad rédigea Cœur des ténèbres, il ne fut pas seulement influencé par le débat sur le Congo, par le retour de Kitchener et d’autres événements de l’époque. Il fut également influencé par un monde littéraire, un monde de mots, où Kipling était le rival et l’antipode, mais aussi par d’autres écrivains qui signifiaient davantage pour lui : Henry James, Stephen Crane, Ford Madox Ford et, surtout, H.G. Wells et R.B. Cunninghame Graham.», p. 99. Et encore : «Je ne prétends pas que Joseph Conrad a entendu le discours de lord Salisbury. Il n’en avait pas besoin. Ce qu’il avait lu de Dilke [l’article de Dilke, intitulé Civilization in Africa, paru dans la revue Cosmopolis, juillet 1896, est une esquisse de la nouvelle de Conrad], dans La Guerre des mondes de Wells et dans Higginson’s Dream de Graham lui avait suffi. Tout comme ses contemporains, Conrad ne pouvait pas éviter d’entendre parler des génocides incessants qui marquèrent tout son siècle. C’est nous qui l’avons refoulé. Nous refusons de nous souvenir. Nous voulons que le génocide ait commencé et fini avec le nazisme. C’est plus réconfortant ainsi», op. cit., p. 186.































































 Imprimer
Imprimer