« Le Feu follet et Récit secret de Pierre Drieu la Rochelle | Page d'accueil | La dimension infinie du secret dans Lord Jim : Joseph Conrad à la lumière de Pierre Boutang, par Gregory Mion »
19/10/2017
L'Agonie du christianisme de Miguel de Unamuno
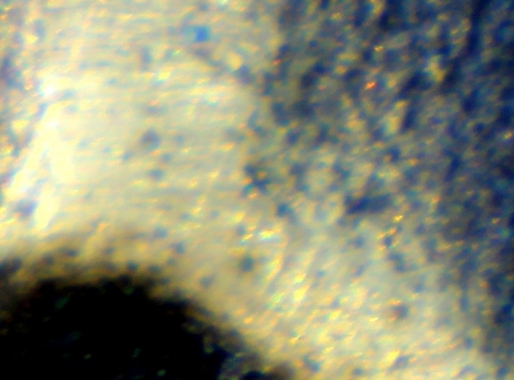
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Deux Caïn, peut-être même trois : Demian, Abel Sanchez et Le Vent noir.
Deux Caïn, peut-être même trois : Demian, Abel Sanchez et Le Vent noir. Acheter L'Agonie du christianisme sur Amazon.
Acheter L'Agonie du christianisme sur Amazon.Impeccablement traduit par Antonio Werli (1) pour les Éditions RN qui décidément méritent toute notre attention, L'Agonie du Christianisme est un de ces ouvrages paradoxaux et biscornus, disparates, point uniques si on songe à le rattacher à d'autres textes existentiels comme ceux de Kierkegaard ou de Chestov (2), que chérissent les bonnes plumes espagnoles comme José Bergamín ou Manuel Arroyo-Stephens. Le traducteur évoque dans sa Préface les circonstances tourmentées durant lesquelles Unamuno publie en 1930 son texte écrit en 1924 dans «un style lui-même en lutte» (p. 7), texte «extrêmement personnel et intime, où vibrent les inquiétudes diffuses d'une époque entière» (p. 8, toute la préface est en italiques) que nous pouvons à bon droit considérer comme une agonie au sens premier, grec, du terme, que rappelle le grand écrivain lorsqu'il déclare que l'agonie est d'abord lutte : «Celui qui vit en luttant, en luttant contre la vie même, agonise», et poursuit de la sorte : «Ce que je m'apprête à exposer ici, lecteur, c'est mon agonie, ma lutte pour le christianisme, l'agonie du christianisme en moi, sa mort et sa résurrection à chaque instant de ma vie intime» (p. 23). Finalement, ce texte rappelle Le sentiment tragique de la vie datant de 1913, dans lequel Unamuno écrivait : «Tant que je n'arriverai pas à perdre la tête, ou mieux encore que la tête, le cœur, je ne me démettrai pas de la vie, j'en serai destitué» (3).
C'est parce que son texte est une agonie, une lutte, un doute, qu'on y retrouve «le pouls de la fièvre» avec lequel il l'a rédigé (p. 15, ce Prologue à l'édition espagnole est lui aussi tout entier en italiques), avec lequel aussi «les sceptiques, les agoniques, les polémiques» (p. 16) dans les rangs desquels il se fait fort d'avoir trouvé sa place écrivent leurs textes tout tendus vers le culte du Christ agonisant, car, à leurs yeux, il semble qu'il n'y ait pas de «plus grande consolation que la désolation, comme il n'y a pas d'espérance plus créatrice que celle des désespérés» (p. 35), ces deux caractéristiques étant celles du «style agonique», «non pas dialectique, mais agonique, car on n'y dialogue pas, mais on y lutte, on y discute» (p. 39). Que l'écriture, si bien sûr elle engage l'être tout entier, soit une lutte, nous n'avons pas besoin du christianisme pour le savoir. Que l'écriture soit une agonie, nous avons besoin du christianisme non pas pour le savoir, mais pour insuffler à cette agonie qui derechef est une lutte une trouée, un but non point heureux mais d'exigence, un souffle de vie et d'espérance et, de la sorte, ne point nous livrer totalement aux puissances délétères qui travaillent son corps lourd comme un Béhémoth.
Avec de tels ferments, on se doute que la «foi véritablement vive, celle qui vit de doutes et non celle qui les dépasse» (p. 66) est une agonie au sens défini par l'auteur, soit quasiment une sorte de suicide : «On dit que lorsque le scorpion se retrouve entouré par les flammes et menacé de périr par le feu, il s'enfonce son propre dard venimeux dans la tête", agonie et suicide selon Unamuno étant des paradoxes puisque «le triomphe de l'agonie, c'est la mort, et cette mort, c'est peut-être la vie éternelle» (p. 67). Ce suicide est, d'abord, bien évidemment, social; c'est même un suicide à la société que la chrétienté requiert, «une complète solitude» car, «en réalité, l'idéal de la chrétienté, c'est un chartreux qui laisse père, mère et frères pour le Christ, et qui renonce à former une famille, à être mari et à être père» (pp. 70-1) et qui renonce sans doute aussi, Unamuno oublie de le dire, à l'écriture. Bien sûr, il est conscient du paradoxe qu'il énonce, qui aboutirait, en somme, au suicide social du christianisme, à la disparition du christianisme social, car «le christianisme pur, le christianisme évangélique, s'applique à chercher la vie éternelle en dehors de l'histoire», et il ne pourra que disparaître en tant qu'entité sociale et non point comme chrétien agonistique confronté, comme Pascal, «au silence de l'univers». Peu importe au demeurant, nous dit Unamuno qui étrille les «jésuites, ces fils dégénérés d'Ignace de Loyola» et celles et ceux qui osent dire que «Jésus fut un grand démocrate, un grand révolutionnaire ou un grand républicain !», puisque «la passion du Christ se poursuit» comme l'a si bien montré Pascal, et parce que «c'est une passion, et une grande, que d'avoir à souffrir que les uns veulent [faire du Christ] un radical-socialiste et les autres un bloc-nationaliste, que les uns veulent en faire un franc-maçon et les autres un jésuite», alors que le Christ, «pour l'ensemble des prêtres, des scribes et des pharisiens du judaïsme [fut] un juif antipatriote» (p. 71).
Cette impossibilité du christianisme social est encore illustrée par ce passage qui choquera les petits apôtres de l'insertion de l’Église dans le monde : «Résoudre le problème économico-social, celui de la pauvreté et de la richesse, celui de la répartition des biens de la terre, n'est pas une mission chrétienne; et cela, même ce qui rachète le pauvre de sa pauvreté devrait racheter le riche de sa richesse, de même que ce qui rachète l'esclave devait racheter le tyran, et qu'il fallait en finir avec la peine de mort pour sauver le bourreau, et non le condamné. Pourtant, ce n'est pas une mission chrétienne. Le Christ appelle de la même manière les pauvres et les riches, les esclaves et les tyrans, les condamnés et les bourreaux. Face à la fin prochaine du monde, face à la mort, que signifient pauvreté et richesse, esclavage et tyrannie, être exécuté ou exécuter une sentence de mort ?» (p. 72).
Pourtant, si «la chrétienté ne peut vivre sans civilisation ni culture» (p. 73), il nous faut constater que le christianisme social ne pouvait, tôt ou tard, à partir du moment où l'idée de progrès allait connaître l'essor foudroyant que nous savons, que laisser sa propre traînée de poudre dans les esprits et les cœurs, paradoxe duquel Unamuno s'accommode du reste fort bien, lui qui sait parfaitement que le christianisme mourra avec la civilisation occidentale et que «la lutte du chrétien, son agonie, n'est ni de paix, ni de guerre mondaines» (p. 76), mais d'une intimité autrement plus secrète, propre à favoriser et nourrir «l'individualisme radical» qu'est le christianisme (p. 79). Il est d'ailleurs frappant de constater qu'Unamuno condamne dans un même élan non seulement le christianisme qui aurait trop maille à partir avec la société mais aussi l'islam car, dès que «le mahométisme désertique» décide de «prendre part à l'histoire, de se faire civil et politique", il «se christianise, il devient chrétien», ce qui signifie donc qu'il «devient agonique» (pp. 82-3), et meurt ainsi de ne point mourir, comme le saint de la nuit obscure.
Non, le christianisme est solitaire, pascalien ou kierkegaardien, c'est-à-dire polémiste, contradictoire, ne cherchant pas «une synthèse entre la thèse et l'antithèse», ne cherchant pas une dialectique, «mais une polémique» (p. 91). Ainsi, «le solitaire, le vrai solitaire que fut Pascal, l'homme qui voulut croire que Jésus avait versé telle goutte de sang pour lui, Blaise Pascal ne pouvait s'entendre avec ces soldats que sont les jésuites détestés, qui «tentent d'arrêter et d'éviter l'agonie du christianisme» en le tuant, en lui administrant «l'opium mortifère de leurs exercices spirituels et de leur éducation» (p. 97), alors même qu'Unamuno sent dans son âme l'agonie de sa patrie qui a remué «l'agonie du christianisme», l'une et l'autre étant indissociablement liés, de même que christianisme et Europe, qui n'est autre chose que «la civilisation que nous appelons chrétienne», agonisent toutes deux, puisque «les deux agonies n'en sont qu'une, le christianisme tuant la civilisation occidentale, «en même temps que la seconde tue le premier» et «ainsi vivent-ils, en se tuant» (p. 111), puisque nulle synthèse ne saurait être de mise dans cette lutte qui est agonie et essence même du christianisme et fine pointe du chrétien véritable qui ne peut qu'être un solitaire et, à sa façon, un bretteur, et qu'il ne faut se désespérer que d'une seule chose, par quoi Unamuno conclut son essai brûlant et baroque, provocateur et agonique, non point de ne pas être des saints mais de devoir comprendre que, comme le Christ en Croix, nous devons lutter seuls, quoi que disent les jésuites qui, en fin de compte, sont des optimistes, c'est-à-dire des imbéciles : «Notre Christ, notre Christ ! Pourquoi nous as-tu abandonnés ?» (p. 117).
Notes
(1) Qui semble avoir fait sien le précepte d'Unamuno déclarant, dans une lettre du 28 juin 1927 à Warner Fite, que son critère, en règle générale, «est que la traduction doit tendre à conserver le plus possible le style de l'original et non la langue» (p. 10, l'auteur souligne).
(2) Unamuno avoue avoir lu La nuit de Gethsémani, l'essai que Chestov a consacré à Pascal (cf. p. 56).
(3) Publié chez Gallimard, coll. Folio essais, 1997, p. 147.































































 Imprimer
Imprimer