« La Fiancée de Frankenstein de James Whale, par Francis Moury | Page d'accueil | L'Arme la plus meurtrière ou Francesca Gee, pas vraiment ivre du vin tiré »
05/10/2021
L'innommable actuel de Roberto Calasso

Photographie (détail) de Juan Asensio.
Roberto Calasso dans la Zone.
 La ruine de Kasch.
La ruine de Kasch. La Folie Baudelaire.
La Folie Baudelaire.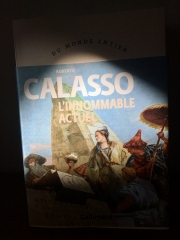 Depuis ma lecture, en 2005, de La ruine de Kasch puis, en 2012, de La Folie Baudelaire, j'ai toujours été gêné par les textes de Roberto Calasso, trouvant systématiquement qu'ils en disaient beaucoup et, dans le même mouvement, bien peu, à la différence de ceux d'un W. G. Sebald, où chaque phrase, dûment pesée, ne fait qu'accroître le sentiment, bien vite étouffant, que le Mal rôde cherchant qui dévorer, même si jamais rien de précis ne nous est dit, même si tout est suggéré et, habituel paradoxe chez ce grand écrivain, bien qu'une débauche de détails et de précisions ne puisse que concourir à accentuer l'effet de réel cher aux universitaires, effet de réel lui-même plus que suspect puisqu'il n'est pas rare que Sebald s'amuse à inventer de fausses précisions, ou donne la photo d'un personnage pour un autre et, ainsi, nous rappelle, amusé voire ironique, qu'un texte jamais ne peut vraiment toucher la réalité.
Depuis ma lecture, en 2005, de La ruine de Kasch puis, en 2012, de La Folie Baudelaire, j'ai toujours été gêné par les textes de Roberto Calasso, trouvant systématiquement qu'ils en disaient beaucoup et, dans le même mouvement, bien peu, à la différence de ceux d'un W. G. Sebald, où chaque phrase, dûment pesée, ne fait qu'accroître le sentiment, bien vite étouffant, que le Mal rôde cherchant qui dévorer, même si jamais rien de précis ne nous est dit, même si tout est suggéré et, habituel paradoxe chez ce grand écrivain, bien qu'une débauche de détails et de précisions ne puisse que concourir à accentuer l'effet de réel cher aux universitaires, effet de réel lui-même plus que suspect puisqu'il n'est pas rare que Sebald s'amuse à inventer de fausses précisions, ou donne la photo d'un personnage pour un autre et, ainsi, nous rappelle, amusé voire ironique, qu'un texte jamais ne peut vraiment toucher la réalité.Il n'y a aucun humour, ou alors je n'y suis décidément pas sensible, dans les textes de Roberto Calasso comme cet Innommable actuel (1), parfaitement traduit par Jean-Paul Manganaro et, c'est de plus en plus rare pour que je le souligne, expurgé de toute trace de faute, un texte qui se glisse à la suite de La ruine de Kasch puisque ce fort volume contient l'expression l'innommable actuel, précédée d'un blanc que l'auteur aura donc mis quelques années à combler.
Ce livre est composé de trois textes assez disparates, mais que quelques lignes du premier («Durant les années 1933 à 1945, le monde s'est livré à une tentative d'anéantissement, en partie réussie», p. 11) rattachent donc vaguement au deuxième, qui n'est qu'une suite, méticuleusement datée, d'anecdotes, de passages de textes et d'observations de différents auteurs (dont Jünger, Benjamin, Céline, Beckett ou encore Malaparte) s'étendant entre les deux bornes temporelles que nous avons indiquées. Le troisième texte, très bref, évoque un rêve de Baudelaire, qu'il a retranscrit «sur un feuillet isolé, sans date, aujourd'hui à la bibliothèque Jacques-Doucet» (p. 171), peignant l'écroulement dramatique d'une tour, que Roberto Calasso a vite fait de dédoubler à la dernière ligne de son livre, façon de nous montrer, sans doute, que les trois textes obéissent à une logique interne elle-même composée de deux brins entrelacés, l'un que nous pourrions dire être la fuite de Dieu (la fuite devant Dieu, selon Max Picard ?), l'autre l'horreur qui en découle, horreur de masse et horreur insignifiante, banale, quotidienne, aboutissant aux attentats des Tours jumelles.
Dans l'esprit de Roberto Calasso, il ne fait pas de doute que le lien entre les deux premiers textes est si évident qu'il peut se contenter, pour les rapprocher et les relier, d'une cheville ajointant «l'âge de l'inconsistance» (p. 12) qui est le nôtre à l'âge de l'innommable qui fut donc celui précédant et accompagnant la surrection du nazisme, comme si, en fait, les formes, qu'elles soient de la beauté ou de l'horreur, ne s'éteignaient pas mais muaient, «se charg[aient] et se vid[aient] de significations selon les occasions», alors qu'un «mince fil les relie toujours à leurs débuts» (p. 18). En fait, c'est tout bonnement que «l'horreur n'était pas seulement une forme de société», à cette époque, «mais la société elle-même, en ce qu'elle se reconnaissait enfin autosuffisante, souveraine et dévoratrice sous n'importe quelle forme» (p. 103).
La thèse de Roberto Calasso (je doute qu'il eût approuvé un vocabulaire aussi sommaire voire grossier) est assez simple en fin de compte : notre époque, devenue tout entière séculière, devenue, même, et «sans qu'il ait été besoin de le proclamer», «l'ultime cadre de référence pour n'importe quelle signification, comme si sa forme correspondait à la physiologie de n'importe quelle communauté et que la signification ne devait être recherchée qu'à l'intérieur de la société elle-même» (p. 23), n'en finit pas moins de conserver, secrètement, des traces, y compris grossières ou complètement déformées, du sacré, n'en éprouve pas moins «le frisson du numineux» qui, contrairement à ce qu'écrit l'auteur, n'est pas seulement accepté «dans le milieu académique» (p. 24), mais peut parfaitement être revitalisé, réamorcé, comme un mécanisme de bombe qui sera prête à exploser, par l'Islam, dernière force souterraine encore capable de s'opposer au déferlement du nihilisme contemporain, nivelant tout, abrasant tout, faisant table rase de tout ce qui ne concourt pas à l'auto-glorification du vide.
Pourtant, explicitement, Roberto Calasso évoque l'Islam, puis, comme gêné parce qu'il serait allé trop loin, l'évacue subitement au bout de quelques pages, comme si, plus que d'éprouver de la gêne, il avait en fait peur, peur d'écrire noir sur blanc cette évidence : l'Islam politique, celui qui n'hésite pas à commettre des attentats pour parvenir à ses fins ou, du moins, faire vaciller la République infidèle haïe, toute forme de gouvernement occidental à vrai dire et même : toute forme de gouvernement qui ne serait pas directement enté sur les principes de l'Islam, ne peut d'aucune façon accepter la laïcisation accélérée voire consommée des sociétés occidentales modernes, qui ne croient en rien d'autre qu'en elles-mêmes (cf. p. 26), les conflits, y compris les plus apparemment violents, au sein de ces sociétés avancées ou plutôt, décomposées, n'ayant plus «pour objet quelque chose qui serait en dehors et au-delà, mais la société elle-même» (p. 27).
Wittgenstein, avançant à sa façon lui aussi prudemment, a affirmé, à propos du Rameau d'or de Frazer que l'homme est, presque, un animal cérémoniel, mais à quelle cérémonie participera, dans ce cas, celui qui (comme Roberto Calasso ? (2)) «n'appartient à aucune confession mais se refuse en même temps à accepter la religion» ou, plus précisément note l'auteur, la «superstition» (p. 32) de la société ? L'auteur ne nous donner pas de réponse claire, franche, ni ne s'attarde, à vrai dire, sur ce cas qui pourrait être le sien, ce qui expliquerait que, de livre en livre, il se soit attaché à relever la trace la plus anodine, la plus minuscule, d'un sacré évanoui, enfoui au-delà de l'horizon, comme l'a fait la mystérieuse et impalpable aura fuyant les désastres, ainsi que l'ange peint par Klee, selon tels dires célèbres de Walter Benjamin.
Ce n'est donc peut-être pas seulement dans le seul langage de la politique que persistent «les épaves de la légitimité» ou celles de la sacralité (c'est tout un, en fait), «comme dans certaines familles on continue à raconter les anecdotes qui ont trait à quelque noble ancêtre» (p. 37), comme si, à vrai dire, la société séculière dans laquelle nous vivons avait «une peur terrible de ce qui a été sa plus grande découverte : l'allégement, la libération des obligations rituelles et confessionnelles» (p. 47) rythmant on le sait la vie quotidienne de tout bon musulman. Cela signifie selon Calasso que «la sécularisation est en premier lieu relâchement des contraintes» et, «dans certains cas, effacement des contraintes elles-mêmes», la seule contrainte qui demeure, quoi qu'il arrive, résidant dans «le paiement des impôts», aucun rite n'étant plus obligatoire, «pas même le vote». Dès lors, «la situation qui en résulte pourrait susciter un subtil sentiment d'euphorie» puisque, «devant tout u chacun, s'étend, très vaste, le territoire du disponible» (pp. 44-5), mais, visiblement, ce n'est pas le cas, et c'est dans ce constat plus ou moins désabusé que la plus grande partie de la littérature dite décadente s'est engouffrée, jusqu'à son dernier surgeon, contrefait, à peine reconnaissable tant il manque des ressources langagières de ses aînés, Huysmans, Lorrain ou Rollinat, Michel Houellebecq.
Les procédures ont remplacé les rituels nous assure Calasso, lesquelles, au contraire du «rituel vers la conscience parfaite qui correspond, pour les chrétiens, à l'instant de la transsubstantiation», «tendent au contraire à l'automatisme global": «plus les procédures se multiplient et plus le règne des automates s'étend» (p. 46).
Dès lors, «abandonné à lui-même, le monde séculier n'offre aucune certitude, juste des probabilités» (p. 48), alors que l'absence de tout repère sacré, ritualisé, ne peut plonger le sécularisme que dans la négativité par laquelle il se définit, «en ce qu'il ignore et exclut de celui ce qu'est le divin, le sacré, les dieux ou le dieu unique», n'aboutissant, dans le meilleur des cas, qu'à un sécularisme humaniste (p. 51) appliquant «des préceptes hérités du christianisme, assouplis et édulcorés» (p. 49).
Donnons, de ce sécularisme humaniste évoqué par Calasso, un nom plus banal : laïcité, une notion qui implique «toutes les nuances possibles, de la tiédeur à la bigoterie agressive, que l'on rencontre dans les religions antérieures» (p. 52), et affirmons avec l'auteur cette évidence : «Deux mille ans après Jésus-Christ, le sécularisme enveloppe la planète. Il en est ainsi non parce qu'il a vaincu les religions, mais parce que, de toutes les religions, c'est la première qui ne s'adresse pas à des entités extérieures mais à elle-même, en tant que vision juste et ultime des choses telles qu'elles sont et qu'elles doivent être» (p. 53).
Roberto Calasso insiste : si les rituels ont été abolis ou bien, plus certainement, ont été subtilement modifiés, il ne peut s'agir chaque fois que «d'affirmations tautologiques, qui confirment l'existant, comme certains rites archaïques confirmaient la révérence envers la divinité» (p. 61) réduite à n'être plus que la société démocratique elle-même, qui ne saurait avoir d'autre idole qu'elle-même.
Que nous reste-t-il à accomplir dans un monde uniformément plat qui, même, lorsqu'il explore le vide de l'espace, tend à tout réduire à une surface aisément exploitable par les calculs ? Ce qui résiste aux calculs justement (3), même si le butin paraît maigre et ne peut qu'être celui rapporté par quelques chasseurs triés sur le volet, dont Calasso lui-même comme il se doit : «remonter dans le temps, parfois vers des entités reculées, uniquement accessibles à travers des mots survivants. Il peut même arriver de se retrouver dans une caravane védique. Et à cette époque, il n'y avait pas de touristes» (p. 63), soit s'évader dans un cabinet de lectures ou, d'ici peu, ce qui ressemblera le plus à ce dernier, quelque ultime refuge souterrain construit par un milliardaire qui, sans avoir lu plus qu'une poignée d'ouvrages, aura tenu à remplir les rayonnages de sa miraculeuse (unique ?) bibliothèque d'exemplaires rarissimes, à moins que l'avenir ne se résolve à accomplir la sombre prédiction que Gottfried Benn a consignée dans son Ptoléméen : «Le siècle prochain ne devrait admettre que deux types de constitutions, deux formes de réaction : ceux qui agissent et visent haut et ceux qui se taisent en attendant la métamorphose» ou, pour le dire autrement, «criminels et moines», car «il n'y aura rien d'autre» (cité par l'auteur, p. 70).
Ce propos, que l'on trouvera, au choix, louche ou franchement exagéré, ne vaut-il quand même pas mieux que l'espèce de bizarre prière, prière toute profane donc, qui clôt le premier texte, Roberto Calasso invoquant «le temple-tombe» qu'est l'Europe, sa capacité de souplesse «qui n'est pas nécessairement liée à la stabilité et à la solennité» (p. 95), comme ces trois statues acéphales, monument des Néréides venant de Xanthos en Lycie, aujourd'hui conservées au British Museum, auxquelles l'auteur confère une signification secrète ? Une fois de plus, Roberto Calasso m'aura laissé sur ma faim, mais je crains qu'il ne puisse désormais plus répondre à mes interrogations.
Notes
(1) Roberto Calasso, L'innommable actuel (L'innominabile attuale, 2017, traduction de l'italien par Jean-Paul Manganaro, Gallimard, coll. Du monde entier, 2019).
(2) Quelques pages plus loin, nous pensons de nouveau reconnaître l'auteur qui se pose cette question : «qu'arrive-t-il si quelqu'un qui n'est pas enclin à professer une quelconque religion reconnaît ces deux mots [divin et sacré] et en a une expérience, tout aussi intense que celle d'un fidèle ?» (p. 56). Il passera sans doute, s'il est un intellectuel honnête comme Robert Calasso m'a l'air de l'être, l'essentiel de sa vie de penseur à essayer de retrouver la clé du festin ancien, où il retrouvera peut-être l'appétit, selon les mots du génial Rimbaud.
(3) «Quiconque pense en dehors de l'enclos logico-mathématique sait que les catégories théologiques sont toujours vivantes et à l’œuvre» (p. 93).





























































 Imprimer
Imprimer