« Les Enfants des morts de Heinrich Böll, par Gregory Mion | Page d'accueil | Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers, par Gregory Mion »
12/07/2020
Gilles de Drieu la Rochelle
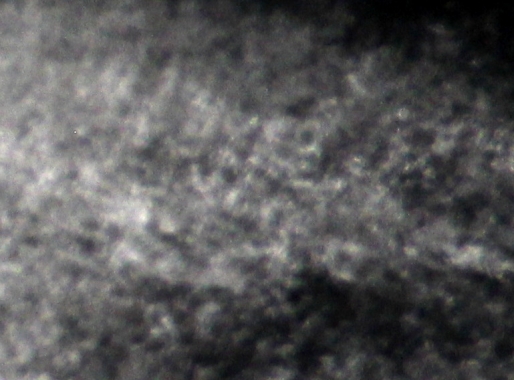
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Ce sont peut-être les premières pages de L’Homme à cheval, prolongation sud-américaine des aventures espagnoles de Gilles (non sans parenté avec les aventures du Marquis de Bolibar de Leo Perutz), qui nous permettent le mieux de saisir quel est l’aiguillon qui n’aura cessé de tourmenter notre héros et, bien sûr, celui qui l’a créé : non pas les femmes (Myriam, Alice, Dora, Antoinette, Pauline, Berthe, etc.) malgré leur nombre, qu’un séducteur conséquent, après tout, saurait ramener à de banales proportions mondaines, et dont il s’agira de toute façon, plus vite que ne le pensent les sots à tégument vertueux, de réussir à se déprendre, non pas encore les saillies contre les Juifs, finalement assez discrètes dans ce texte et qui n'en font cependant pas moins pleurnicher un universitaire, un certain Jacques Lecarme, mais l’action ou plutôt, le monde entier des choses englobant et guidant cette dernière, ainsi que la pensée, monde et pensée ramenés dans un geste, dans une geste aussi, qui en signifient à la fois la beauté, la grandeur et la fulgurance.
Ce sont peut-être les premières pages de L’Homme à cheval, prolongation sud-américaine des aventures espagnoles de Gilles (non sans parenté avec les aventures du Marquis de Bolibar de Leo Perutz), qui nous permettent le mieux de saisir quel est l’aiguillon qui n’aura cessé de tourmenter notre héros et, bien sûr, celui qui l’a créé : non pas les femmes (Myriam, Alice, Dora, Antoinette, Pauline, Berthe, etc.) malgré leur nombre, qu’un séducteur conséquent, après tout, saurait ramener à de banales proportions mondaines, et dont il s’agira de toute façon, plus vite que ne le pensent les sots à tégument vertueux, de réussir à se déprendre, non pas encore les saillies contre les Juifs, finalement assez discrètes dans ce texte et qui n'en font cependant pas moins pleurnicher un universitaire, un certain Jacques Lecarme, mais l’action ou plutôt, le monde entier des choses englobant et guidant cette dernière, ainsi que la pensée, monde et pensée ramenés dans un geste, dans une geste aussi, qui en signifient à la fois la beauté, la grandeur et la fulgurance. Lorsque le narrateur, Felipe, à la fois guitariste doué et théologien rusé, affirme des cavaliers d’Agreda chargeant le village duquel il faut chasser le potentat local, qu’ils connaissent «un de ces rares moments où il est donné à l’homme d’être lui-même en se jetant tout à fait hors de lui», et vivent, l’instant d’une courbe balistique inscrivant au ciel la grandeur des humains, un de ces «moments où les hommes sont vraiment des amis et fondus dans un amour qui passe hautainement les amours» (1), nous croyons voir ramassée, en quelques mots à la fois précis et elliptiques, dessinant un orbe infiniment large au sein duquel se déploieront une multitude de faits et gestes, d’aventures aussi, la pensée solitaire, monotone, à vrai dire unique, répétitive, lascive et lassante, de Gilles, crucifié par l’évidence selon laquelle «vivre, c’est d’abord se compromettre» (2), autrement dit : se sacrifier.
Cette unique pensée, corps et âme de Gilles qualifié d’«affreux décadent» (p. 124) trompant son ennui dans une «époque de civilisation saturée» (p. 114), est le lien le plus solide et comme l’armature vertébrée du roman foisonnant dans lequel Drieu a figuré son désespoir ardent de vivre dans une époque bourgeoise, basse, ignoble, médiocre, morne comme un séducteur en chasse, singeant la grandeur passée jusqu'à se croire elle-même grande, la démocratie ayant «posé à jamais son derrière dans les Gobelins» (p. 115), le «monde démocratique» ou encore «ce pauvre meublé démocratique» (p. 435) n’étant qu’un «monde d’usurpation» (p. 114) : encore une fois, «aucune pensée, aucun sentiment n’a de réalité que s’il est éprouvé par le risque de la mort» (p. 125), et nous pourrions même prétendre que ce beau risque à courir devenu devise («tranche toujours», p. 155) est la seule façon, pour l’hermétique Gilles claquemuré dans une solitude qu’avec orgueil il considère comme «une source rare où il avait bu le dédain de tout ce qui n’était pas son enchantement mystérieux» (p. 63), enfermé dans le «personnage qu’il s’était peu à peu formé de lui-même en dehors de lui par l’effet d’une demi-sincérité, d’une demi-hypocrisie, de la distraction, de l’humour» (p. 140) et qu’il voit se réfléchir dans les yeux de ses conquêtes, de sortir de la cage dorée, sorte de «crispation hystérique de tout son être» (p. 201) qu’il a construite patiemment autour de son secret qui n'en est même pas vraiment un, ou alors qui est le secret puéril des hommes jouant à en posséder un.
Puisqu’il «faut mettre de la profondeur dans chaque minute, chaque seconde», sans quoi «tout est raté pour l’éternité» (p. 174), mais aussi parvenir à s’échapper de sa propre «disponibilité» (p. 241) constamment contemplée dans le regard des adoratrices plus ou moins conséquentes, la femme, sur laquelle des centaines de lignes admirables et cruelles de Drieu seraient à citer pour leur édification et aussi celle de leurs amants, n’est encore qu’un pâle et très imparfait moyen, un véhicule dirait le sage bouddhiste, bien incapable d’arracher Gilles à tant d’années de «laisser-aller, de fuite désespérée, où il n’avait pas tant recherché le plaisir que la figuration facile, enivrée et blasphématoire de l’amour, ne demandant aux femmes que les premiers accords d’une grande musique aussitôt amortie» (p. 284), alors que, face aux «nostalgies anciennes» (p. 298) qui de nouveau se déchaînent dans une époque qui n'avait pas, à tout le moins, complètement perdu le sens de l'aventure, face à l’impérieuse nécessité de «rouvrir les sources» (p. 299) et alors même que notre personnage «songe sans cesse à la valeur d’or, à la valeur primitive, avant toute altération» (p. 302), il faut trouver une porte de sortie, sans doute étroite comme celle de Gide, du moins honorable : l'action pour elle-même sans doute, mais finement ourlée d'une dentelle de dialectique. Gilles, Drieu ne cesse de nous le répéter, n’est qu’un raté, un gandin qui n’a jamais rien été et ne sera jamais rien, rien d'autre qu'un homme de peu de poids «plein d’orgueil secret sous une fausse modestie, plein d’ambition impuissante sous des airs d’indifférence et de nonchalance» (p. 321), car, comme «âme mystique destituée de la grâce» et condamnée, donc, à ne broder que sur une «aridité sans nom» (p. 379), il lui faut à tout prix trouver la clé, non sans avoir plus d’une fois songé au suicide que nous pourrions à bon droit considérer comme le chef-d’œuvre de l’hermétisme, seul à même d’accomplir, dans un illusoire triomphe dont rien ne percera, l’œuvre au noir que poursuit plus ou moins consciemment et volontairement l’homme revenu de tout, dégoûté de tout et d'abord de sa propre insupportable nonchalance, et ainsi de consacrer le paradoxal triomphe de «sa mythologie secrète» (p. 394), tout en en rejetant la froide tentation qu'il s'agira, dans le meilleur des cas, de transformer en rage de vivre, en mort héroïque et pourtant anonyme, vite oubliée comme des milliers d'autres dans un monde qui n'accorde pourtant plus d'importance qu'au seul règne de la quantité. De toute façon, cette tentation elle-même, comme d’autres, l’érotisme n’étant que l’une des plus visibles floraisons de cette racine très profondément enfouie, est très crument analysée, puisque le suicide, l’idée du suicide, ne peut être que la réaction des «être faibles, mais obsédés par l’idée de la force» (p. 404), alors même que la mort, aux yeux de Gilles qui a connu l’expérience du Front, n’est rien de plus vraiment tentateur que «l’illusion du néant» qui ne lui paraît même plus, comme autrefois, «impensable et misérable» (p. 394).
 C’est en tout cas à une longue dérive de Gilles que nous assistons, notre falot allant de femme en femme, «obsédé par l’idée que n’ayant jamais assez donné aux femmes», à celle-ci au moins, n’importe laquelle, «il donnerait autant qu’il pourrait» (p. 382) sans bien sûr tenir sa belle mais évasive promesse, jouant, même, un temps, la comédie de l’intrigue politique (dans la partie de loin la plus laborieuse du roman), fréquentant tel cercle de pseudo-artistes moquant les prétentions du raout à excommunications définitives d'André Breton, «petit monde de bourgeois intellectuels, tremblotant et flageolant» (p. 465) dirigé par un certain Caël qui «a supprimé la syntaxe, la logique, le discours» et qui a «inventé la parole frénétique, l’extase laïque, l’inspiration athée», alors que, dans «les réunions de sa secte» appelée pompeusement et trompeusement Révolte, «les adeptes entrent en transe et éructent des mots sans suite, qui sont enregistrés par des sténos, imprimés ensuite et considérés comme évangile» (p. 250), autant d’imposteurs qui, sous les yeux de Gilles, ont remué «un tison fascinant, celui de l’action» et lui ont fait croire «qu’ils s’étaient arrachés à la foule inerte qui comble ce temps»; mais Caël est en fin de compte «plus lâche qu’un boursier», et l'esprit de ses séides rien d’autre qu’un «inénarrable carambolage de riens», toutes ces marionnettes agitées par le prurit de l’action violente qui jamais n’aboutit ne pensant rien, ne sachant rien, ne voulant rien, ne pouvant rien, si ce n’est, tragiquement, fomenter un vague complot pour aboutir à un banal fait divers aussitôt oublié par la presse, tant de petites histoires ne pouvant se terminer que «dans l’atrocité la plus piteuse : celle d’un fils qui tue son père parce qu’il n’y a pas dans leur sang assez de vie pour deux» (p. 427), toutes ces ombres d'un théâtre que ne hante plus aucun Shakespeare ne pouvant jamais que «simuler la puissance et cette simulation» leur suffisant (p. 469), alors que Gilles, dégoûté par «cette infâme singerie de la puissance» (p. 470), «obscur par débilité» et se plaisant avec ivresse, du coup, «à l’obscurité de leur pensée» (p. 340), cherche à retrouver «un peu de verdeur, un souvenir du temps où toutes choses se créaient et non pas se fabriquaient» (p. 280), n'a qu'une hâte constamment procrastinée: se retremper et puiser de larges lampées à l’antique vin de vigueur conservée dans une amphore introuvable, mais aussi pouvoir contempler une beauté qui, de nos jours, ne se trouve plus que «dans les statues, pas dans la vie des humains» (p. 366). Certes, Gilles aura adoré les femmes, étant parfaitement capable de frémir, et jusqu'aux larmes, devant les premiers signes de flanchement d'une courbe féminine naguère plus pure qu'un tracé de maître au fusain, mais jamais au point d'accepter de mêler, humblement, ce délabrement devenu source profuse d'innombrables lamentations élégiaques au propre engourdissement et délabrement de son corps.
C’est en tout cas à une longue dérive de Gilles que nous assistons, notre falot allant de femme en femme, «obsédé par l’idée que n’ayant jamais assez donné aux femmes», à celle-ci au moins, n’importe laquelle, «il donnerait autant qu’il pourrait» (p. 382) sans bien sûr tenir sa belle mais évasive promesse, jouant, même, un temps, la comédie de l’intrigue politique (dans la partie de loin la plus laborieuse du roman), fréquentant tel cercle de pseudo-artistes moquant les prétentions du raout à excommunications définitives d'André Breton, «petit monde de bourgeois intellectuels, tremblotant et flageolant» (p. 465) dirigé par un certain Caël qui «a supprimé la syntaxe, la logique, le discours» et qui a «inventé la parole frénétique, l’extase laïque, l’inspiration athée», alors que, dans «les réunions de sa secte» appelée pompeusement et trompeusement Révolte, «les adeptes entrent en transe et éructent des mots sans suite, qui sont enregistrés par des sténos, imprimés ensuite et considérés comme évangile» (p. 250), autant d’imposteurs qui, sous les yeux de Gilles, ont remué «un tison fascinant, celui de l’action» et lui ont fait croire «qu’ils s’étaient arrachés à la foule inerte qui comble ce temps»; mais Caël est en fin de compte «plus lâche qu’un boursier», et l'esprit de ses séides rien d’autre qu’un «inénarrable carambolage de riens», toutes ces marionnettes agitées par le prurit de l’action violente qui jamais n’aboutit ne pensant rien, ne sachant rien, ne voulant rien, ne pouvant rien, si ce n’est, tragiquement, fomenter un vague complot pour aboutir à un banal fait divers aussitôt oublié par la presse, tant de petites histoires ne pouvant se terminer que «dans l’atrocité la plus piteuse : celle d’un fils qui tue son père parce qu’il n’y a pas dans leur sang assez de vie pour deux» (p. 427), toutes ces ombres d'un théâtre que ne hante plus aucun Shakespeare ne pouvant jamais que «simuler la puissance et cette simulation» leur suffisant (p. 469), alors que Gilles, dégoûté par «cette infâme singerie de la puissance» (p. 470), «obscur par débilité» et se plaisant avec ivresse, du coup, «à l’obscurité de leur pensée» (p. 340), cherche à retrouver «un peu de verdeur, un souvenir du temps où toutes choses se créaient et non pas se fabriquaient» (p. 280), n'a qu'une hâte constamment procrastinée: se retremper et puiser de larges lampées à l’antique vin de vigueur conservée dans une amphore introuvable, mais aussi pouvoir contempler une beauté qui, de nos jours, ne se trouve plus que «dans les statues, pas dans la vie des humains» (p. 366). Certes, Gilles aura adoré les femmes, étant parfaitement capable de frémir, et jusqu'aux larmes, devant les premiers signes de flanchement d'une courbe féminine naguère plus pure qu'un tracé de maître au fusain, mais jamais au point d'accepter de mêler, humblement, ce délabrement devenu source profuse d'innombrables lamentations élégiaques au propre engourdissement et délabrement de son corps.Comment agir dans un monde où «les dieux sont morts», qui est tout entier envahi par la «vieillesse spirituelle» emportée et importée d’Europe, sorte de mirage s’évaporant dans une brume de chaleur, «abominable et caduc mythe moderne fait de rationalisme, de mécanisme et de mercantilisme» ne pouvant que tenter de convoquer «le fantôme imbécile du bonheur, faute de dieux» (p. 385) alors que, tous, nous sombrons dans une «affreuse impuissance», comme ce peuple nord-américain qui, «ayant pris contact avec les pays d’ancienneté, recherche l’authentique et tombe à côté avec une sûreté irrémédiable» (p. 324) ? Comment agir dans un monde où la quête charnelle, elle aussi, comme une «morne routine sans force et sans invention» (p. 288), tourne à vide, puisque «l’érotisme ressasse bientôt» (p. 323) ? Et, surtout, comment retrouver le sens d’une action ou même d’une parole qui engage celui qui la dit ou l’écrit alors que, autrefois, «une parole c’était un coup d’épée ou la guillotine, à donner ou à recevoir» (p. 313) ?
Tout appelle Gilles, les femmes bien sûr ou, plutôt, à travers leurs masques plus ou moins séduisants, «une rafale venue de sa vie où il y avait une supplication et un ordre» (p. 299), dernier vestige, peut-être, d’un temps plein ayant érigé des «cathédrales, des châteaux et des palais qui sont les derniers points d’appui de la grâce, car les pierres ont mieux résisté que les âmes» (p. 296), élan qu’il a cru trouver dans l’expérience de la guerre, où il a expérimenté dans une tranchée en train d’être bombardée, «cette tombe que les dieux piétinent avec rage, cherchant à étouffer dans la gorge des hommes le dernier cri du défi et du courage», par fulgurances, «la nature agonique des choses» (p. 240). Il faut agir, en se débarrassant de l’influence, maigre heureusement, du groupe de Caël composé de lâches et d’impuissants, «incapables de risquer quoi que ce soit» (p. 486) puisqu’ils ne sont rien de plus que des «petits intellectuels débiles, remplis de la jactance la plus imperceptible», comme autant d’ultimes «gouttes de sperme arrachées» à des «vieillards avares qui refermaient, sur leurs agonies rentières» les rares portes encore battantes de mots vagues remplaçant le tranchant des actes. Il faut agir comme autrefois, lorsque «les hommes pensaient parce que penser, pour eux, c’était un geste réel», parce que penser, pour eux, «c’était finalement donner ou recevoir un coup d’épée» (p. 487), les dernières pages de la deuxième partie, en s’acheminant vers la troisième intitulée L’Apocalypse, se colorant d’une teinte rouge de plus en plus violente, puisque «ce n’était donc pas seulement l’hiver de la nature que Gilles voyait», mais «un autre hiver et une autre mort, plus durables, portant la menace, peut-être, de l’irrémédiable», «l’hiver de la Société et de l’Histoire», «l’hiver d’un peuple» (p. 489), puisque «jamais plus la sève ne repassera dans ce peuple de France aux artères desséchées» (p. 490). Dans une formule vulgaire qui trahit bien, au fond, la colère de Drieu, c’est donc «la source même de la vie qui est atteinte» : «plus de foutre, ou il va au bidet» (p. 493). Il faut agir en repoussant la dernière tentation où se fiche l’esthétisme, autrement dit la perte de toute force, l’écriture, de laquelle Gilles se sera plus d’une fois approché et éloigné, conscient qu’il est de son manque de génie, préférant adresser «une prière lumineuse» en méditant en silence, même s’il finira par fonder un brûlot éphémère, en regardant les hommes autour de lui et en se taisant, puisque, mieux que «les bavardages du talent», le silence est «un plus sûr accompagnement aux rares voix de ceux qui ont le droit de parler» : «Il écouterait, il regarderait les hommes. Il était leur témoin le plus actuel et le plus inactuel, le plus présent et le plus absent. Il les regardait vivre avec un œil aigu dans leurs moindres frémissements de jadis et de demain, et soudain il prenait du champ et ne les apercevait plus que comme une grande masse unique, comme un grand être seul dans l’univers qui traversait les saisons, grandissait, vieillissait, mourait, renaissait pour revivre un peu moins jeune» (p. 111). Felipe, l'étrange guitariste théologien de L'Homme à cheval, eût pu faire siens ces propos.
Il faut agir contre ce «temps des nains» (p. 552), mais en lâchant, sur le monde surpris par toute action décisive, un geste venu de loin, retrempé dans le silence du désert, qui seul sera capable de façonner ou plutôt refaçonner une société sur le modèle de celles qui firent la Grèce, l’Europe du Moyen Âge, par le biais d’une «restriction des besoins pour l’élite, équilibre des forces matérielles d’une part, corporelles et spirituelles de l’autre. Ascétisme du religieux, mais aussi de l’athlète et du guerrier» (p. 503), et l’action pure pour seul guide, bien davantage que «cette traditionnelle diatribe que poursuivent depuis plus d’un siècle en France, dans une haute et apparente stérilité, les fervents de l’Anti-Moderne, depuis de Maistre jusqu’à Péguy» (p. 520) voire Léon Bloy, Paul Claudel et Georges Bernanos, également nommés (cf. p. 545), même si, à l’occasion, un rapprochement tactique peut être opéré avec les marxistes qui, comme Gilles, veulent détruire la société actuelle en constituant «une force de combat, libre de toutes les vieilles doctrines, un corps franc» (pp. 521-2). Détruire la société capitaliste «pour restaurer la notion d’aristocratie» (p. 522), tel est le vœu de Gilles : «Qu’est-ce qui le séduisait dans le communisme ? Écartées la ridicule prétention et l’odieuse hypocrisie de la doctrine, il voyait par moments dans le mouvement communiste une chance qui n’était plus attendue de rétablir l’aristocratie dans le monde sur la base indiscutable de la plus extrême et définitive déception populaire» (p. 525). Tactique risquée voire désespérée («Que la France soit balayée par la destruction. C’était vivre que de hâter la décision de la mort», p. 568), sans doute ou, plus certainement encore, vouée à l’échec, alors que se profile la tentation fasciste, seule à même de rompre «le silence oraculaire des hommes d’action» et aussi de se débarrasser des Juifs, l’antisémitisme de Drieu, somme toute assez discret dans Gilles, s’expliquant assez aisément si l’on songe que le Juif est à ses yeux le pur produit de la Modernité, autrement dit, de la «camelote»(3), et que les mots du Juif se retrouvent toujours «dans la salive des décadences» (p. 553) : «Oui, je le vois d’ici ton parti, s’emballa-t-il soudain, ce serait notre parti à tous, un parti qui serait national sans être nationaliste, qui romprait avec tous les préjugés et les routines de la droite sur ce chapitre, et un parti qui serait social sans être socialiste, qui reformerait hardiment mais sans suivre l’ornière d’aucune doctrine» (p. 537).
En attendant le fascisme dont Gilles n’aura enregistré que les premiers soubresauts, parcourant les vieux flancs de la France, une vieille haridelle pouilleuse qui fut autrefois une nation ayant bâti durant plusieurs générations d'humbles des églises qu’elle était désormais bien incapable de refaire, toute l’aventure de la vie étant dans ce fait atroce : notre peuple a vieilli, aux yeux de Gilles (cf. p. 561), qui raille un pays considéré comme «une vaste académie, une assemblée de vieillards débiles et pervers où les mots n’étaient entendus que comme des mots» (p. 574), la folle embardée politique du Duce et de Hitler électrisant et cabrant les reins de l’Europe comme d’ultimes décharges de vigueur.
En attendant ce monde qui ne sera pas (seulement) celui de l’invention romanesque, il faut, pour le personnage de Drieu, tenter le coup de force, et essayer de produire l’étincelle qui fera exploser la vieille baraque déglinguée de la Démocratie, provoquer ou essayer de provoquer «le ménage détonnant de toutes les ardeurs de France» (p. 597), précipiter, au sens chimique du terme qui évoque une belle cristallisation, riche de ses irrégularités, les dernières forces du pays : ce sera le rôle et l'occasion, ratés, du 6 février 1934, que Gilles traverse comme il a traversé la Première Guerre, rêvant, les yeux grands ouverts, à une alliance, fût-elle éphémère, de toutes les forces, une fois de plus sous la poigne d’un homme providentiel, vecteur idéal d’un «élan vital, qui fait que chaque sursaut converge vers tout autre sursaut» (p. 601), homme inattendu par essence, apocalyptique dans sa geste, qu’il semble désormais impossible d’imaginer ailleurs que dans les romans : «Si un homme se lève et jette tout son destin dans la balance, il fera ce qu’il voudra. Il ramassera dans le même filet l’Action française et les communistes, les Jeunesses patriotes et les Croix-de-Feu, et bien d’autres» (p. 598), puisque les barrières seront alors «à jamais rompues entre la droite et la gauche, et des flots de vie se précipiteront en tout sens» (p. 599), alors que les Parisiens, eux, réussiront peut-être à lever un geste véritablement viril «vers les traces de la vieille énergie encore visibles dans le ciel, à la frise de ces palais, pour quelques prophètes torturés comme lui» (p. 592), Gilles, prophète sans foi, ce qui est surmontable, mais surtout sans dieux, ce qui l’est moins. Gilles, qui est peut-être un fanatique dans le sens où il tente de «ramener dans cet univers les forces qui en semblaient bannies : le fatal, le décisif, l’irrémédiable», croyant en outre «à des possibilités que son pessimisme tenait pour parfaitement exclues» (p. 594), Gilles encore «éperdument enraciné dans son inertie», dont les multiples conquêtes féminines, toutes tôt ou tard délaissées, pourraient constituer la pathétique illustration vivante de quelques «mythes de l’immobilité» (p. 602), doit accompagner, alors, Pauline qui se meurt d’un cancer, la fulgurante consomption de la dernière femme, sinon la femme aimée de Gilles, n’étant que le chiffre et le symbole de l’inéluctable dévolution de la France, où «pas la moindre explosion n’est possible» (p. 604) et qui ne propose qu’une unique carrière, celle de la lâcheté : «Fuir, encore fuir, toujours fuir», alors qu’il faudrait «faire autre chose que fuir», «se battre» (p. 649) par exemple.
Las, les derniers soubresauts de l’énergie française, la vie aventureuse dans l’Espagne déchirée par la guerre civile, ne permettront pas à Gilles de connaître, de nouveau, les rares sensations qu’il a connues en se battant au Front, au milieu «d’hommes entièrement ramassés sur une partie d’eux-mêmes, à la fois tendus et conscients», le sacrifice pouvant se savourer en commun «à quelque chose qui, à mesure que le risque se prolonge, s’avère de plus en plus intime au cœur de chacun , tout en étant sensible à tous» (p. 670). Tout au plus pourra-t-il se croire le héraut d’un ordre secret, «militaire et religieux» et qui poursuit «envers et contre tout, la conciliation de l’Église et du fascisme et leur double triomphe sur l’Europe» (pp. 674-5).
Drieu se trompera, mais cette illusion, nous ne pouvons qu’en juger longtemps après les événements et encore, extérieurement, sans être vraiment capables d’apporter de solides arguments qui attaqueraient la substance de son pari démesuré, par essence démesuré : Gilles, se définissant lui-même comme «un de ces humbles qui aident l’action et la pensée à recommencer toujours leurs épousailles compromises» (p. 680), est l’homme qui vit une idée autour de laquelle il a longtemps erré, la caressant vaguement avant de la reconnaître puis de tendre tous ses muscles pour en faire plus qu’une idée, en épouser «avec une curiosité meurtrie, mais toujours voluptueuse, les détours et les plis tels que les faisait la résistance de la matière humaine où elle essayait de s’imprimer» (p. 676), ce qui est sans doute l’une des plus magnifiques et profondes définitions de l’Histoire sous la plume d’un homme que l’on dit, pudiquement ou avec une prétention de mauvais aloi, la prétention du prudent, commentateur, journaliste ou universitaire, dans tous les cas petit pion, s’être trompé, et lourdement, comme est belle cette autre phrase, sur l’Histoire et sa vague qu’il faut être capable de saisir pour en être soulevé : «Il se serrait sans cesse sur l’immense et sourde palpitation qui allait, enfantant des événements» (p. 677), jusqu’à finir en train de tirer au fusil derrière une meurtrière derrière laquelle tomberont ses ennemis d’un jour, derrière laquelle, peut-être, il finira sa vie de météore, retrouvant, avant de rendre son dernier souffle, les sensations impossibles qu’il a éprouvées au Front, redevant «follement lui-même comme un homme ivre qui s’arrête entre deux verres et qui jouit une seconde de la suspension», approchant, qui sait, Dieu, d’un dernier «geste violent de son corps, ce geste dément le projetant, le heurtant contre une mort sauvage» (p. 686).
Dans sa belle Préface à Gilles, d’une humilité accablante qui frise la haine et le mépris de soi, Drieu affirme que son propre roman a pu paraître «insuffisant parce qu’il traite de la terrible insuffisance française, et qu’il en traite honnêtement, sans chercher de faux-fuyants ni d’alibis» puisque, pour «montrer l’insuffisance, l’artiste doit se réduire à être insuffisant» (p. 16), terrifiant aveu et condamnation de sa propre stérilité qui eût, davantage qu’à Drieu qui jamais ne se dupa sur son propre cas et dépiauta cruellement son personnage, Gilles, convenu à un Michel Houellebecq, écrivain sans verbe décrivant un monde sans verbe ni colonne vertébrale, ou bien un monde agité par les courants contradictoires, erratiques, d’un langage devenu liquide, comme une colonne vertébrale qui aurait fondu par quelque opération de magie noire. C’est à la fois peu et beaucoup dire, mais nous savons en tout cas qu’en décrivant l’insuffisance de la France, de ce qu’est devenue, sous ses propres yeux, la race française, Drieu nous a donné un roman d’une très belle ampleur et d’une puissance foisonnante, irrésistible, que nous pourrions considérer comme une longue parabole au mille reflets et chatoiements, dépassant de très loin le seul cas, pourtant exemplaire, de Gilles, pour approcher du silence de la prière, «soupir imperceptible de l’éternel au sein de l’être» (p. 112), atteindre la transparence d’une icône, «l’âme de son enfance» peut-être, qui a «prodigué ce verbe infini qui jaillit de l’homme devant les éléments purs» (p. 143), icône derrière laquelle surprendre les traits d’un visage qui est à la fois de la terre et plus que de la terre, et seul capable de ré-insuffler la vie et le sens de la beauté se dressant contre l’«irrémédiable décadence» (p. 152), guetter aussi le miracle, comme l’indique ce passage admirable, seule mention directe de la figure du Christ (4) : «Gilles avait souvent songé aux miracles; il n’y avait jamais rien trouvé que de naturel. Par exemple, la primevère de Champagne, c’était le printemps et c’était un miracle. La nature est si puissante qu’elle offre aux saints et à Dieu des possibilités exorbitantes sur elle-même. Gilles avait souvent imaginé le Christ arrivant dans une bourgade galiléenne d’une longue randonné de vingt kilomètres en pleins champs et saturé, ivre de forces, d’effluves, imposant les mains. La puissance divine, la grâce lui apparaissaient comme un rebondissement des forces naturelles par-dessus elles-mêmes» (p. 541), Gilles lui-même paraissant avoir été tenté, une seule fois, par la possibilité d’esquisser un geste dont la simplicité absolue l’élève à une transcendance elle-même dépouillée de tous ses oripeaux, comme le montrent tant de scènes dans La Route de Cormac McCarthy : «Il se rappela encore un trait que lui avait conté un ami : c’était la nuit, et il avait dans les bras un camarade qui agonisait. Il ne savait quoi faire et il ne pouvait supporter ce mot qui grelottait dans sa cervelle : «Je ne peux rien faire.» Il avait pris un peu de terre et avait imité un geste qui l’avait frappé dans son enfance. Il s’était dit : «Ce doit être ça, l’Extrême-Onction.»» (p. 543). C’est donc admettre que quelque chose soulève nos actes à une dimension supérieure, pourvu que nous tentions de nous attacher à leur signification profonde, réelle, invisible, comme les gestes en apparence totalement anodins des «cléricaux de province» sont eux-mêmes élevés par «les figures des vitraux, quelque chose qui, bon gré mal gré, les doublait» (p. 549) en leur accordant une signification non point sottement secrète à la manière franc-maçonne mais transcendante, soumise à tous les regards, sujette à toutes les railleries, toujours présente mais de plus en plus difficile à voir, faute de regards sachant surprendre les derniers signes de la grâce, l’or des jours perdus, l’antique puissance, «l’ancienne courbe créatrice, petite tige fanée» (p. 561), pas seulement «le raisonnement mais l’élan de la foi; pas seulement le ciel mais la terre; pas seulement la ville mais la campagne; pas seulement l’âme mais le corps», enfin tout car «la France avait eu le sens du tout, elle l’avait perdu» (p. 560) et c’est bien de cette perte de substance, de cette béance ontologique que Gilles, trop cruellement lucide pour l’ignorer, souffre.
 C’est ainsi que Gilles, lui aussi revenu des femmes, chemine d’une certaine façon aux côtés de l’homme à cheval, Jaime Torrijos. Il en conte la geste sanglante et merveilleuse, au moyen de la musique, assemblant les chapitres de son histoire comme autant de «chants qui avaient lancé et soutenu toute [leur] action et qui la soutiendraient encore par la suite» (pp. 193-4), musique que Felipe joue sur sa guitare. Bien sûr, nous avons vite fait de deviner que Felipe et Jaime ne font qu’un, le rêve de l’un s’attachant à l’autre, le guitariste étant lié au maître de la Bolivie «par des liens beaucoup plus étroits et particuliers que ceux» qu’il avait imaginés (p. 146), une dialectique subtile entre l’action et la pensée se nouant entre ces deux vecteurs d’une même force : ainsi Felipe se déclare habile aux «idées ou à l’action seulement dans ces moments de l’action qui sont si intenses que celle-ci s’épure et devient aussi prompte et simple que la pensée» (p. 163). Il dispose aussi de «couteaux de la pensée» (p. 20) qu’il a fort aiguisée par ses méditations théologiques (5), mais il s’agit finalement toujours de nouer le même nœud : rendre l’action pensante, façonner la pensée pour la rendre aussi dangereuse qu’une dague. Cette dialectique tend ses deux bornes entre le début et la fin du roman, les différentes péripéties mouvementant le récit pouvant en fin de compte n’être considérées que comme un fil d’acier, qu’un simple pincement fera vibrer comme une corde de guitare. Écoutons Felipe se réciter l’antienne de l’action point dépourvue de finalité, de la pensée lestée de force agissante, dans leur éternelle sarabande l’une autour de l’autre : «Et moi, retrouvais-je dans ce que disait Jaime ce que je lui avais parfois murmuré ? La pensée devenue action, trempée de sang, forgée comme une arme d’acier est étrangère au penseur. Mais comme est peu sage cet étonnement des hommes de pensée devant la rapidité d’assimilation des hommes d’action, car les hommes d’action ne sont importants que lorsqu’ils sont suffisamment hommes de pensée, et les hommes de pensée ne valent qu’à cause de l’embryon d’homme d’action qu’ils portent en eux» (p. 198). L’action, pour quoi faire ? Reconstruire le défunt empire inca sur un sacrifice propitiatoire censé faire de nouveau pulser le vieux cœur endormi ? Ce sera l’occasion d’un beau jeu de mots plus que d’une action véritable, fût-elle romanesque, fût-elle par avance synonyme d’échec ce qui, finalement, est la même chose, tout grand roman racontant l’histoire d’un échec, la parole, sauf peut-être aux abords du Paradis, avec Dante, étant bien incapable de fixer la pure lumière, d’en dessiner les linéaments qui ne se détachent jamais mieux que sur un fond d’obscurité, où pourra être figurée la folle destinée humaine : «Ce sont les impérieux, ce sont les impériaux» (p. 234) qui, finalement, dirigent le monde, alors que Jaime et, surtout, Felipe, sont des êtres pensants, comme le concède sans peine ce dernier qui avoue, à l’action, un autre but qui la dépasse, la connaissance évidemment : «D’abord, j’avais été porté contre cet homme par l’action, la joyeuse action, ensuite s’était figée la méconnaissance, résidu triste de cette action, enfin, j’atteignais à une sorte de connaissance et d’amour qui d’abord était délivrance» (p. 225), métamorphose ultime qui aura été rendue possible parce que, un instant, la pure action a donné forme à la pure pensée : «Qu’étais-je, moi ? Un joueur de guitare, un pâle étudiant en théologie; et soudain tu t’es dressé devant moi, tu étais la forme. La forme. Moi qui étais amant de la beauté, je me suis rué vers cette forme, qui était la beauté vivante. Soudain, la musique, la théologie étaient une seule figure qui marchait dans le monde» (p. 236), car les idées les plus hautes de l’humanité « se trempent dans le sang versé par les héros» (p. 239) et qu’il nous faut, décidément, parier sur la possibilité «de grands hommes et de grandes actions pour que nous retrouvions le sens des grandes choses» (pp. 238-9) et, même, le temps des «grandes actions, des actions impériales» (p. 231).
C’est ainsi que Gilles, lui aussi revenu des femmes, chemine d’une certaine façon aux côtés de l’homme à cheval, Jaime Torrijos. Il en conte la geste sanglante et merveilleuse, au moyen de la musique, assemblant les chapitres de son histoire comme autant de «chants qui avaient lancé et soutenu toute [leur] action et qui la soutiendraient encore par la suite» (pp. 193-4), musique que Felipe joue sur sa guitare. Bien sûr, nous avons vite fait de deviner que Felipe et Jaime ne font qu’un, le rêve de l’un s’attachant à l’autre, le guitariste étant lié au maître de la Bolivie «par des liens beaucoup plus étroits et particuliers que ceux» qu’il avait imaginés (p. 146), une dialectique subtile entre l’action et la pensée se nouant entre ces deux vecteurs d’une même force : ainsi Felipe se déclare habile aux «idées ou à l’action seulement dans ces moments de l’action qui sont si intenses que celle-ci s’épure et devient aussi prompte et simple que la pensée» (p. 163). Il dispose aussi de «couteaux de la pensée» (p. 20) qu’il a fort aiguisée par ses méditations théologiques (5), mais il s’agit finalement toujours de nouer le même nœud : rendre l’action pensante, façonner la pensée pour la rendre aussi dangereuse qu’une dague. Cette dialectique tend ses deux bornes entre le début et la fin du roman, les différentes péripéties mouvementant le récit pouvant en fin de compte n’être considérées que comme un fil d’acier, qu’un simple pincement fera vibrer comme une corde de guitare. Écoutons Felipe se réciter l’antienne de l’action point dépourvue de finalité, de la pensée lestée de force agissante, dans leur éternelle sarabande l’une autour de l’autre : «Et moi, retrouvais-je dans ce que disait Jaime ce que je lui avais parfois murmuré ? La pensée devenue action, trempée de sang, forgée comme une arme d’acier est étrangère au penseur. Mais comme est peu sage cet étonnement des hommes de pensée devant la rapidité d’assimilation des hommes d’action, car les hommes d’action ne sont importants que lorsqu’ils sont suffisamment hommes de pensée, et les hommes de pensée ne valent qu’à cause de l’embryon d’homme d’action qu’ils portent en eux» (p. 198). L’action, pour quoi faire ? Reconstruire le défunt empire inca sur un sacrifice propitiatoire censé faire de nouveau pulser le vieux cœur endormi ? Ce sera l’occasion d’un beau jeu de mots plus que d’une action véritable, fût-elle romanesque, fût-elle par avance synonyme d’échec ce qui, finalement, est la même chose, tout grand roman racontant l’histoire d’un échec, la parole, sauf peut-être aux abords du Paradis, avec Dante, étant bien incapable de fixer la pure lumière, d’en dessiner les linéaments qui ne se détachent jamais mieux que sur un fond d’obscurité, où pourra être figurée la folle destinée humaine : «Ce sont les impérieux, ce sont les impériaux» (p. 234) qui, finalement, dirigent le monde, alors que Jaime et, surtout, Felipe, sont des êtres pensants, comme le concède sans peine ce dernier qui avoue, à l’action, un autre but qui la dépasse, la connaissance évidemment : «D’abord, j’avais été porté contre cet homme par l’action, la joyeuse action, ensuite s’était figée la méconnaissance, résidu triste de cette action, enfin, j’atteignais à une sorte de connaissance et d’amour qui d’abord était délivrance» (p. 225), métamorphose ultime qui aura été rendue possible parce que, un instant, la pure action a donné forme à la pure pensée : «Qu’étais-je, moi ? Un joueur de guitare, un pâle étudiant en théologie; et soudain tu t’es dressé devant moi, tu étais la forme. La forme. Moi qui étais amant de la beauté, je me suis rué vers cette forme, qui était la beauté vivante. Soudain, la musique, la théologie étaient une seule figure qui marchait dans le monde» (p. 236), car les idées les plus hautes de l’humanité « se trempent dans le sang versé par les héros» (p. 239) et qu’il nous faut, décidément, parier sur la possibilité «de grands hommes et de grandes actions pour que nous retrouvions le sens des grandes choses» (pp. 238-9) et, même, le temps des «grandes actions, des actions impériales» (p. 231).Se sacrifier, en somme, comme tous les grands hommes se sont sacrifiés d’une façon ou d’une autre, à l’action échevelée ou à l’idée, car il eût fallu, pour Felipe, mieux se servir de son ami Jaime, et s’élever près de lui alors que le guitariste n’est «habile qu’aux idées ou à l’action seulement dans ces moments de l’action qui sont si intenses que celle-ci s’épure et devient aussi prompte et simple que la pensée» (p. 163). Pourtant, Felipe, après tout capable de ressentir, dans certains gestes, une influence invisible, capable, comme sa musique, de s’étendre aux coins les plus secrets du monde (cf. p. 167), capable même d’éprouver le vertige du créateur devant sa création, «toute cette matière humaine, épaisse et fuyante comme du poisson» (p. 191), est en fin de compte aussi impuissant que Gilles qui lui, au moins, se sacrifiera à ce qui le dépasse, alors que Jaime et son fidèle guitariste auront échoué à instaurer le règne, un temps éclipsé par les conquérants espagnols, de la race indienne, tel nouvel empire inca aussi difficile à atteindre que la ville de Carcassonne pour Lord Dunsany (6).
Si «l’homme ne naît que pour mourir et [s’]il n’est jamais si vivant que lorsqu’il meurt», si «sa vie n’a de sens que s’il donne sa vie au lieu d’attendre qu’elle lui soit reprise» (pp. 242-3), alors Jaime Torrijos et l’étudiant en théologie Felipe ont échoué, car le premier n’a pas existé et le second, sans doute, n’est rien de plus qu’un farceur, «non pas Sud-Américain mais Espagnol d’Espagne, réfugié politique» dont le récit fantaisiste, «qui renferme de monstrueuses inexactitudes», aura été écrit «par quelqu’un qui n’a jamais mis les pieds en Bolivie, qui tout au plus en a rêvé» car l’action n’est que l’ombre d’un rêve, comme l’est aussi la littérature.
Notes
(1) Pierre Drieu la Rochelle, L’Homme à cheval (1943, Le Livre de Poche, 1965), p. 52. Toutes les citations de ce texte renvoient à cette édition.
(2) Pierre Drieu la Rochelle, Gilles (1939, Gallimard, coll. Folio, 1992), p. 113.
 (3) Une «belle juive aux seins blancs, à la mâchoire dévorante», qualifiée d’«Esther du Parti», est censée se satisfaire, ainsi, «d’une grandeur de camelote» (p. 562). Jacques Lecarme, dans une longue étude point dénuée de qualités bien que truffée de fautes, intitulée Drieu la Rochelle ou le bal des maudits (PUF, coll. Perspectives critiques, 2001), semble ne pas comprendre grand-chose à Gilles, un roman qu’il prétend pourtant admirer, en nous fatiguant à prendre un milliard de précautions quand il aborde l’antisémitisme de l’auteur, du reste assez peu présent dans ce roman, les Juifs n’étant finalement détestés qu’en tant que plus parfaits représentants d’une modernité que l’écrivain exècre. Je ne puis vraiment plus supporter les petites fadaises, chattemites et prudences universitaires, que l’on dirait être celles d’une pucelle rougissant à la vue d'un champignon de forme phallique, que Jacques Lecarme étale sur plusieurs pages, affirmant à l’occasion de parfaites âneries, notamment sur le Rebatet pamphlétaire sur la tête duquel le couperet du petit pion tombe avec la précipitation du trouillard flanqué d’une subite déveine intestinale : «aucun talent littéraire, rien que le bagout ordinaire d’un «gros bras» de Je suis partout, et la rhétorique monotone de la délation, dans Les Décombres» (en note 2 de bas de page 191 de son ouvrage). Nous avons finalement beaucoup de chances que Jacques Lecarme, soucieux, écrit-il, de ne point susciter des vocations racistes (cf. p. 183) affirme de Gilles qu’il s’agit d’un roman «qui a l’avantage d’affronter les risques du politique et la corne du taureau» ! (p. 251).
(3) Une «belle juive aux seins blancs, à la mâchoire dévorante», qualifiée d’«Esther du Parti», est censée se satisfaire, ainsi, «d’une grandeur de camelote» (p. 562). Jacques Lecarme, dans une longue étude point dénuée de qualités bien que truffée de fautes, intitulée Drieu la Rochelle ou le bal des maudits (PUF, coll. Perspectives critiques, 2001), semble ne pas comprendre grand-chose à Gilles, un roman qu’il prétend pourtant admirer, en nous fatiguant à prendre un milliard de précautions quand il aborde l’antisémitisme de l’auteur, du reste assez peu présent dans ce roman, les Juifs n’étant finalement détestés qu’en tant que plus parfaits représentants d’une modernité que l’écrivain exècre. Je ne puis vraiment plus supporter les petites fadaises, chattemites et prudences universitaires, que l’on dirait être celles d’une pucelle rougissant à la vue d'un champignon de forme phallique, que Jacques Lecarme étale sur plusieurs pages, affirmant à l’occasion de parfaites âneries, notamment sur le Rebatet pamphlétaire sur la tête duquel le couperet du petit pion tombe avec la précipitation du trouillard flanqué d’une subite déveine intestinale : «aucun talent littéraire, rien que le bagout ordinaire d’un «gros bras» de Je suis partout, et la rhétorique monotone de la délation, dans Les Décombres» (en note 2 de bas de page 191 de son ouvrage). Nous avons finalement beaucoup de chances que Jacques Lecarme, soucieux, écrit-il, de ne point susciter des vocations racistes (cf. p. 183) affirme de Gilles qu’il s’agit d’un roman «qui a l’avantage d’affronter les risques du politique et la corne du taureau» ! (p. 251).(4) Carentan, toutefois, évoquera le christianisme à la suite de la songerie de Gilles sur le Christ (cf. pp. 542-3).
(5) «Ô théologiens, vous ignorez que vous êtes aussi des poètes et que vous hantez les mêmes sommets éternels où par les belles nuits le haut vers lyrique vient accomplir vos balbutiements essentiels !» (p. 41). Presque à la fin de ce magnifique roman, Felipe parlera du christianisme comme d’un «grand poème métaphysique» (p. 247) galvaudé par les prêtres catholiques qui «ne savent plus ce que veulent dire chute, incarnation, rédemption, saint sacrifice, Saint-Esprit» (p. 246).
(6) Curieuse méditation de celle de Drieu, que l’on a souvent présenté comme obsédé par les questions de races : «Le sang espagnol n’est déjà presque plus rien en Amérique du Sud. Il sera noyé. La race indienne renaîtra du coup terrible qu’elle a reçu, elle s’adaptera, elle assimilera la vie de ses anciens vainqueurs. Elle sortira de sa paresse, qui est celle d’un malade, d’un convalescent. Du Mexique à la Bolivie il en sera ainsi. Je ne suis qu’un précurseur, mais j’aurai beaucoup de successeurs» (p. 204).



























































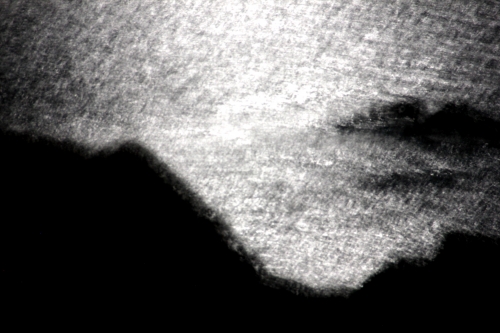

 Imprimer
Imprimer