« 2005-09 | Page d'accueil
| 2005-11 »
31/10/2005
V'Ger

Lien permanent | Tags : critique cinématographique, science-fiction, star trek, v'ger, voyager 1 |  |
|  Imprimer
Imprimer
29/10/2005
Dans la gorge de l'ombre, par Lucien Suel

A propos du livre de Juan Asensio, La littérature à contre-nuit.
Lucien Suel, Notes de lecture, mars - septembre 2005.
Avant toute chose, j’aimerais dire les circonstances qui m’ont amené à rédiger ces notes à propos de l’ouvrage de Juan Asensio. Depuis plus de trente ans, mes influences littéraires majeures forment un ensemble additionnant Léon Bloy et Jack Kerouac, Georges Bernanos et William Burroughs, Philip K. Dick et Kurt Schwitters, Joris-Karl Huysmans et Raymond Chandler, mélange qui peut paraître hétéroclite mais que j’assume avec plaisir.
Mon isolement relatif au fond d’une campagne française me laissait imaginer qu’à la vérité, peu de gens partageaient avec moi ce cocktail capiteux. Ces dernières années, au moins deux événements m’ont heureusement détrompé. Ce fut d’abord la découverte de l’œuvre en construction de Maurice G. Dantec à partir des Racines du mal, jusqu’à Villa Vortex, en passant par son Journal métaphysique et polémique, une œuvre qui brasse également un flot d’influences diverses pour en faire une pâte singulièrement nourrissante. Je me souviens de mon heureux étonnement en voyant Maurice G. Dantec découvrir Léon Bloy dans Le théâtre des opérations, premier volume de son journal, découverte se métamorphosant pour l’auteur, en véritable engouement, voire fascination, dans le deuxième volume, Le laboratoire de catastrophe générale, jusqu’à ce que le Vieil Imprécateur devienne pour finir un des personnages de son roman Villa Vortex. Un ami qui rédige aujourd’hui sur Internet les Chroniques de l’inutile avait attiré mon attention sur un compte rendu de Villa Vortex rédigé par Juan Asensio. Et là intervient le second événement, la rencontre sur Internet d’une communauté de lecteurs et d’auteurs partageant influences et admirations similaires aux miennes. Le blog littéraire de Juan Asensio, avec ses articles et ses liens, me fait vivre une nouvelle expérience, m’ouvre d’autres portes. Depuis plus d’un an maintenant, j’ai appris à lire sur un écran, mais je suis toujours heureux de tourner les pages de papier et de humer l’intérieur des livres.
Me voici donc occupé à rédiger ces lignes sur un livre qui parle d’autres livres, à écrire noir sur blanc sur noir sur blanc.
A contre-jour, l’ombre est devant, la lumière est derrière. A contre-nuit, l’objet est éclairé, c’est la nuit qui est derrière. Le dévoilement se fait sur un fond de noirceur, sur le fond du mal. Lisant La littérature à contre-nuit, je réagis, j’approuve, je me questionne mais aussi je m’approprie les phrases de Juan Asensio. J’ai lu ce livre entre mars et septembre. Cela peut sembler une longue période, mais c’est que je pratique deux formes de lectures, comme en électricité, la lecture en parallèle (1) et la lecture en série (2). J’ajoute que comme tout bon livre, La littérature à contre-nuit m’a donné des envies de lecture, de relire Joseph Conrad et William Faulkner et de connaître l’œuvre d’Ernesto Sabato.
Le projet est de travailler à dissiper la nuit, détruire la nuit, me souffle en parallèle Michel Ciry. J’ai appris dans ma jeunesse que parfois, la nuit se manifeste en plein jour, à trois heures de l’après-midi. Juan Asensio, lecteur au service des lecteurs, pour parodier le slogan des Électriciens de France, dirige l’éclairage sur quelques auteurs, Joseph de Maistre, Joseph Conrad, Paul Gadenne, Ernesto Sabato, Georg Trakl, Georges Bernanos et Ernest Hello. Ce n’est bien sûr pas un nouveau brelan d’excommuniés, je sais compter, mais il ne m’étonne pas de trouver là des maîtres et des disciples devenus à leur tour maîtres, mais souvent ignorés par une majorité de lecteurs. Ernest Hello figurait déjà dans le Brelan d’excommuniés de Léon Bloy. Il est intéressant de se souvenir que dans l’édition Pauvert de Belluaires et porchers, le brelan était devenu une paire, Barbey d’Aurevilly et Paul Verlaine, le malheureux Ernest Hello étant excommunié une fois de plus... Merci donc à Juan Asensio de lui redonner un peu de lumière, de vraie lumière, pas cette mauvaise lumière de la télévision qui est le véhicule nouveau du démoniaque (3), agent du contrôle nova (4), propagatrice des mots-virus (5). Le langage s’attaque à la parole. Il faut répondre à l’assaut, ne rien céder, c’est l’obstination qui sauve, l’obstination, un autre nom pour l’espérance. Ernest Hello encore, en 1872 : «La Parole est un acte. C’est pourquoi j’essaye de parler.»
Depuis mes premières lectures de William Burroughs, notamment Junkie et Les Lettres du yage, je fréquente plus volontiers les évidences du béhaviourisme que les écoulements de la psychanalyse. Je regarde aussi l’infini dans le microcosme, en étant attentif au ver de terre, au pouillot véloce, à l’éclat de silex noir et blanc. Les plus petites choses méritent la contemplation. C’est la nature qui me donne la parole. Ceux qui me connaissent un peu savent que j’écris dans et sur le jardin, grave dans la terre, sur la terre. Le jardin de mon enfance, de mon innocence était celui d’Éden. Le monde actuel est l’ennemi de l’enfant et du pauvre. La période est courte pour gambader dans le jardin d’Éden. La perte de l’innocence intervient de plus en plus tôt. On appelle cela précocité. A force de vivre dans un présent figé comme le rictus des bonimenteurs médiatiques, on finit par oublier l’existence de l’entropie. Comment lutter contre quelque chose dont on ignore, volontairement ou non, l’existence ? Je sais que le monde est un langage, une parole. Je préfère croire que tout est signe de tout. Ce n’est pas encore la Pentecôte, mais de vrais nuages s’éclairent de rouge à l’ouest. En clignant des yeux, je peux voir la Nouvelle Jérusalem descendre du ciel entre les pales des éoliennes. Mouchette flotte à la surface de l’étang, les yeux ouverts, levés vers la même vision, autre chose qu’un flux de méga-octets transitant dans l’espace entre deux boîtes de plastique métallisé.
Je flotte dans le vide assourdissant de la cacophonie. L’oracle des ondes crachouille. Il est ce qu’il prononce, le plus souvent, un flot de vomissures. Satan parle, la bouche d’ombre vagit. Il y a identité entre être et parole, entre faux-semblant et langage. Le langage est infecté à l’origine. Le virus est l’autre nom du péché originel. Écoute, petit homme : le barbare est devenu médiocre, le sauvage est devenu terne. Oui, Satan radote ; c’est le non-langage, l’épidémification, le nihilisme, la nullité revendiquée ou non, celle que Pierre Jourde fustige dans La littérature sans estomac (6) avec le renfort de René Girard concernant l’écriture blanche (7).
Pour Joseph de Maistre, ce n’est pas seulement le langage qui est malade, mais l’homme entier qui n’est qu’une maladie. William Burroughs déclare que son pays était déjà vieux et malade avant même l’arrivée des Indiens. L’esprit du mal est à l’oeuvre, pétrifiant les consciences incapables de tendre vers un ailleurs et un autre, figées dans le froid l’ennui le vide. L’ennui, une autre joie dépourvue de grâce, est l’autre nom du désespoir, une préfiguration terrestre de l’enfer. Le sacré a été retourné comme un gant. Juan Asensio affirme : «Sans Dieu, l’homme n’est rien de plus qu’un bavard qui s’ennuie». La langue est détruite par le mensonge de la propagande. Là où Jacques Ellul voit le règne de l’image toute-puissante humiliant la parole, Juan Asensio juge que la dégénérescence du langage est à l’œuvre intrinsèquement. Il y reviendra avec le personnage de Bernanos, Monsieur Ouine, personnification du mal abouti.
La liste sans fin des noms des jeunes gens abattus par dizaines de milliers entre 1914 et 1918, gravés sur les pierres de la Porte de Menin à Ypres est un des premiers poèmes de la douleur et du désespoir du siècle dernier. Impossible de visiter ce lieu, d’effleurer tous ces noms sans être saisi par l’horreur. Georges Bernanos et Paul Celan, entre autres, sont les témoins à charge de ce crime et de ceux qui suivirent. La parole désespérée débouche sur le silence définitif.
Je pense à Barbey d’Aurevilly disant qu’après A rebours, Huysmans n’avait le choix qu’entre le revolver et le pied de la croix. Aujourd’hui, cent ans après, il n’aurait plus le choix (8). D’ailleurs, Georges Bataille, aussi bien que Pierre Klossowski, tous deux un moment tentés par le sacerdoce, n’ont pas succombé à la tentation. Ne parlons pas de Maurice Sachs ou d’Ernest de Gengenbach. En revanche, voici ce que Hugo Ball, l’un des fondateurs de Dada, initiateur du Cabaret Voltaire à Zürich en 1916, déclarait à Hambourg, dans un discours prononcé le 1er juillet 1920 : «Tirons la leçon de notre défaite. Nous avons vécu sous le règne de Satan. Nous pouvons croire à nouveau que le démon existe. Nous l’avons vu à l’œuvre. Faisons maintenant de l’Allemagne un pays de Dieu. Il nous suffit de prendre le contre-pied de tout ce que nous avons vu à l’œuvre autour de nous. Voilà ma conception de la reconstruction.» Les conseils de Hugo Ball (9), aussi bien que ceux de Georges Bernanos dans Les Enfants humiliés, sont restés lettre morte (10). «L’Illumination, c’est fini. Ce que nous vivons maintenant, c’est la Dés-Illumination» (11). Et Juan Asensio me présente L’ange des ténèbres de Ernesto Sabato. Je le sens plus proche de moi que le sinistre Cthulhu de Lovecraft. L’ange se penche vers moi, regarde la page. J’ai perdu la grâce de l’enfance mais je veux bien essayer d’écrire un Jugement Dernier, voire une Apocalypse romancée pour mes enfants et petits-enfants. Je peux mixer L’Obsolescence de l’homme de Günther Anders avec des fragments de la trilogie Matrix. Le désespoir est rivé à la «possibilité» de la grâce, la possibilité d’une île. Le battement du sang dans mes artères me rappelle d’où je viens, ma provenance lointaine et sacrée. Il s’agit de réintroduire le mystère dans la littérature. Je me souviens de ce que Claude Louis-Combet disait, concernant le rejet catégorique de la religion par André Breton, comment les surréalistes avaient ignoré tout un pan du merveilleux, du sacré. Nous avons réduit le monde en pièces (12). Aujourd’hui, la parole souffle sur notre poussière (13) et l’évidence de la beauté se tient dans la simplicité. Le bleu-Trakl que j’utilisai dans mes précédents livres (14) est devenu un bloc de noirceur obstruant la gorge du poète. Même avec les yeux crevés, le chant reste un croassement.
Monsieur Ouine, Madame Ebola, le mal, l’horreur, un duo, une litanie pour notre temps. Monsieur Ouine, le personnage de Georges Bernanos est ici analysé, disséqué magistralement par Juan Asensio. L’écriture de Monsieur Ouine fut le combat de Bernanos avec l’Ange, le second du programme, après celui de Donissan et du maquignon dans Sous le soleil de Satan. Dieu est mort, il n’y a même plus la possibilité d’une seconde d’innocence absolue. Monsieur Ouine, c’est le mal. Monsieur Ouine, c’est le froid éternel de l’enfer. Monsieur Ouine, c’est l’ennui. Monsieur Ouine, c’est le néant (15). Mais Juan Asensio ajoute que c’est un néant trompeur. En effet, «l’homme n’est pas la victime résignée mais la bête volontaire, le partenaire de Satan». D’un point de vue littéraire, c’est le mal qui provoque le brouhaha et la confusion dans l’écriture. Seuls, ceux qui respectent la tradition peuvent s’autoriser les audaces les plus inouïes. Juan Asensio a raison de pointer l’insignifiance des productions des nains littéraires du nouveau roman en regard du roman de Bernanos. Monsieur Ouine exprime toute la civilisation depuis la Renaissance (ce terme est-il vraiment approprié ?). Dans la crise du langage, le sens des mots s’est inversé (16). Au commencement était le Verbe [...] et le Verbe était Dieu, s’il n’y a plus de Dieu il n’y a plus de Verbe.
La littérature à contre-nuit se termine par un long développement sur Ernest Hello et l’urgence de la parole. Ernest Hello ! Bonjour l’espérance ! Je vois le jeune Georges Bernanos, dans son collège d’Aire-sur-la-Lys, lisant avec un grand sérieux les phrases de L’Homme. Oui, la beauté est dans la simplicité. Ernest Hello et Arthur Rimbaud meurent la même année et Juan Asensio nous invite à un détour par le désert, par le silence du désert que l’adolescent de Charleville a cherché. Mais on ne part pas, le désert se multiplie par lui-même et l’Éden est perdu. Le silence est le verbe du désert. C’est l’or qui s’oppose au silence, l’or qui glapit en lettres lumineuses au sommet des tours, sur les affiches de la propagande publicitaire, sur tous les écrans de la virtualité, l’or qui est le sang du pauvre. Les pierres ne seront pas transformées en pain mais les mots, eux, sont du pain ou du poison. La lumière est la splendeur du monde visible. La parole est la splendeur du monde invisible. Il reste à reprendre l’offensive pour dégager les mots profanés, les arracher à l’homme médiocre, l’homo festivus d’aujourd’hui en apesanteur dans un présent indifférencié, un néant d’où naît l’ennui d’où naît le désespoir. Il reste à graver, à marteler une écriture noire, à se frayer un chemin vers la rédemption par la langue.
La Tiremande, septembre 2005.
1) Mes lectures en parallèle durant la même période : La parole humiliée (Jacques Ellul), Détruire la nuit (Michel Ciry), Choke, Berceuse (Chuck Palahniuk), La littérature sans estomac (Pierre Jourde).
2) Mes lectures en série de la même période : Sunset Limited (James Lee Burke), Entretiens avec Raymond Abellio (Marie-Thérèse de Brosses), La poésie en string (Jean-Marc Baillieu), Un drôle de pèlerin (Elmore Leonard), Celle qui pleure (Léon Bloy), L’oiseau de paradis (James Purdy), Takfir sentinelle (Lakhdar Belaïd), La solitude du manager, Meurtre au comité central (Manuel Vasquez Montalban), Le jeu du chien-loup, Une proie en hiver, La proie de l’instant (John Sanford), Le silence inutile (Lambert Schlechter), L’homme qui souriait (Henning Mankell), De Marquette à Vera-Cruz (Jim Harrison), La source chaude (Thomas Mc Guane), Gone, baby gone, Un dernier verre avant la guerre (Dennis Lehane), Déviances mortelles (Chris Mooney), L’enfant du silence (Abigaïl Padgett), Ce que je crois (Jean Delumeau), Rimes de joie (Théodore Hanon), Sarinagara (Philippe Forest), Ça sent le brûlé (John Lutz), Revanche, Une balle dans la tête (Dan Simmons), Brûlé (Leonard Chang), Chant pour Jenny (Staffan Wasterlund), Rites de mort (Alicia Gimenez Bartlett), L’homme chauve-souris (Joe Nesbo), Chroniques, volume I, (Bob Dylan), Mea culpa (Louis-Ferdinand Céline), Tchadiennes (Daniel Boulanger), Deuil interdit (Michael Connelly), Meurtre à la sauce cajun (Robert Crais), L’insurrection de Cronstadt et la destinée de la révolution russe (Ante Ciliga), Les neiges bleues (Piotr Bednarski), La simple vérité (David Baldacchi), Le bonhomme de neige (Jorg Faüser), Tokyo (Mo Hayder), Le papou d’Amsterdam (Jan Van de Wetering).
3) Dans La part du diable (Gallimard, 1946), Denis de Rougemont a donné un bel exemple de la ruse ultime de l’ennemi, celle qui consiste à faire douter de son existence.
4) 24 octobre 2004, Bordeaux, 1H30 du matin. En rentrant à l’hôtel, je jette un œil au mur de la caverne de Platon. Je tombe dans le «toc chaud» de Thierry Ardisson, un aréopage pérorant d’humoristes auto-proclamés, arrogants et sûrs de connaître la vérité ultime sur le destin et la manière de vivre de l’humanité. Le meneur de jeu au masque de cire, espace de statue funéraire au regard vicieux, donne la parole à Philippe Val, le rédacteur en chef inamovible d’un organe libéralo-conformiste. Je suis édifié par le visage dur, lisse et glacé de ce moraliste à rebours qui énumère les lieux communs les plus convenus. Tous ces gens se congratulent. Ils sont les nouveaux maîtres à penser. J’éteins le poste et les rejette dans leur nuit.
5) Voir William Burroughs, Entretiens avec Daniel Odier (Belfond), 1969.
6) La littérature après avoir perdu l’âme et le souffle a maintenant perdu l’estomac.
7) «Comme l’avait bien vu René Girard, l’écriture blanche n’est que du romantisme dégradé : L’esthétique du silence est un dernier mythe romantique. [...] Dix ans ne passeront pas avant qu’on reconnaisse dans l’écriture blanche et son degré zéro des avatars de plus en plus abstraits, de plus en plus éphémères et chétifs des nobles oiseaux romantiques. Ils ne veulent pas la solitude, mais qu’on les regarde en proie à la solitude. Ils ne choisissent le silence que comme marque d’honorabilité littéraire, l’insignifiance n’est chez eux qu’une ruse de l’impuissance, qui l’utilise comme apparence d’un sens mystérieux», Pierre Jourde, La littérature sans estomac (Presses Pocket, coll. Agora), pp. 195 et 196. Un peu plus loin, p. 333, Pierre Jourde parle de l’idiotie revendiquée de Valère Novarina, comme perspective d’un dépassement du couple affirmation-négation. Pour lui, «l’étrange réalisme de Novarina est le miroir du réel : son théâtre représente le monde à l’envers». Après tout, en ce siècle, cela est peut-être proche de l’affirmation de saint Paul dans la Première épître aux Corinthiens, souvent citée par Léon Bloy : «Nous voyons maintenant, à travers un miroir, en énigme. Mais alors, nous verrons face à face».
8) «Parfois, dit et renifle Denny, c’est comme si je voulais être battu et puni. C’est pas un problème s’il n’y a plus de Dieu, mais je veux quand même continuer à respecter quelque chose. Je ne veux pas être le centre de mon propre univers», in Choke de Chuck Palahniuk (Gallimard, Folio Policier n° 370), p. 106.
9) Voir aussi Hugo Ball, La fuite hors du temps, Journal 1913-1921 (Editions du Rocher), 1993.
10) Sauf peut-être pour Maurice G. Dantec qui se coltine tout cela dans Cosmos Incorporated (Albin-Michel).
11) Choke, de Chuck Palahniuk (Gallimard, coll. Folio Policier n° 370), p. 136.
12) Choke, p. 153.
13) Titre de l’essai que Juan Asensio a consacré à l’œuvre de George Steiner (L’Harmattan).
14) Sombre ducasse (épuisé), Canal Mémoire, Marais du Livre Éditions.
15) «Monsieur Ouine est partout ! Monsieur Ouine est partout ! Monsieur Ouine se porte bien ! Il est le ressuscité des ordinateurs, les robots qui ne disent plus rien d'autre que oui non oui non oui non oui oui non non, qui marchent aux pas des lois : un deux un deux un deux un droite gauche droite gauche ! Logiciel, ça s'allume et ça s'éteint.» L. S., in Canal Mémoire.
16) Voir l’ouvrage de Arnaud Aaron-Upinsky, La tête coupée (Éditions Le Bec, 1998) et aussi, de Dimitri Panine, Théorie des densités (Éditions Présence), 1990.
25/10/2005
Monsieur Ouine de Georges Bernanos

23/10/2005
Manhunter

22/10/2005
Ecce Nunc
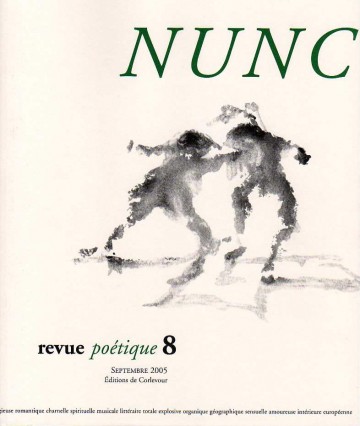
Qu'est-ce qu'une revue ? J'éviterai peut-être toute banalité en affirmant qu'il s'agit, d'abord, d'une vision et, accessoirement (même si je sais, oui, le poids, la glu, la dévoration des milliards de petites lamproies quotidiennes), des moyens offerts à cette vision de se concrétiser, de se montrer. Ainsi, a contrario, il est tout de même facile d'affirmer ce qu'une revue n'est pas ou ne doit pas être : une collection d'articles, bien souvent de seconde main, commercialement assemblés, pour le contentement du plus grand nombre, contentement frelaté qui se paie, et cher je vous prie. De ce postulat, la revue véritable tire sa singularité : elle est aussi, elle est d'abord un bel objet, une rareté, mieux, une singularité. Si la vision est unique et rare, de même la revue qui, en aucun cas, ne saurait être bibelot de fête foraine, que quelques passants décident de s'offrir, moyennant tout de même rétribution sonnante et trébuchante, attirés par la voix suraiguë de la poissonnière. J'accepte de payer un bel objet le prix qu'il a coûté, j'accepte en tout cas de le payer au prix fixé, et cela sans broncher puisque de toute façon l'âme infusant les pages n'est point monnayable mais je refuse d'acheter une simple coquille vide, reproduite à des milliers d'exemplaires, d'où l'âme ne subsiste même pas à l'état de trace.
Il est ainsi tout simplement inadmissible que la revue que Joseph Vebret dirige, Le Journal de la culture, laquelle n'offre, la plupart du temps, que des pièces rapportées que de toute façon leurs auteurs finiront tôt ou tard par mettre en ligne, coûte près de 20 euros. Payer une somme tout de même élevée pour lire, entre autres perles de vulgarité contente d'elle-même (caractéristique de la vulgarité qui toujours s'auto-contemple), les élucubrations spongieuses d'un Montalte sur tel nanar absolument incompris de la critique, voilà qui est du plus haut comique...
Reste que quelles que soient, je l'ai dit, les inévitables compromissions (évidemment, d'abord, commerciales mais il y en a d'autres...), la grandeur d'une revue est de tenter de reconquérir le statut de l'objet encore auréolé de son prestige que Walter Benjamin s'efforça, sa vie durant, de retrouver dans certaines œuvres d'art, dans la furtivité essentielle des passages parisiens, d'une poésie de l'éphémère magnifiée par Baudelaire ou dans l'assemblage savant, secret, des collectionneurs, des bibliothèques aussi, puisque toute bibliothèque est la trace remarquable d'une bizarrerie de l'humeur et de l'âme de son propriétaire, en clair : une monstruosité.
 Je connais trois magnifiques revues : Conférence (dirigée par Christophe Carraud) qui, je l'ai écrit dans la Zone, m'a beaucoup déçu par l'indigence de certains de ses textes d'auteurs contemporains. Lorsque l'on évoque Pétrarque, saint Augustin, Günther Anders ou Maria Zambrano, on n'ouvre point, par lamentable copinage, ses belles pages à de petits auteurs de textes rimailleurs et indigents. Il y avait aussi (déjà le passé avant, peut-être, sa renaissance, ailleurs que chez A contrario) la monstrueuse et fascinante Sœur de l'Ange de Matthieu Baumier. Il y a enfin Contrelittérature créée par Alain Santacreu, à l'actualité riche puisqu'un livre vient de paraître (aux éditions du Rocher) qui regroupe différentes contributions consacrées à l'essence contrelittéraire des arts. A présent, voici Nunc, magnifique revue (présentée par un site très laid que l'on espère simplement informatif), que dirigent Réginald Gaillard et Franck Damour avec lesquels j'ai échangé quelques mots, samedi soir sur le stand convivial de Contrelittérature, au Salon de la revue littéraire. J'ai évoqué avec Réginald, en quelques trop brèves phrases hélas, les efforts fournis par sa poignée d'amis (comme toujours, une revue est d'abord, pardonnez-moi la comparaison disgrâcieuse, un oignon : au fil du temps, les pelures superficielles disparaissent pour découvrir le noyau véritable, qui lui-même sera stable ou instable, se désintégrera ou pas...), tel auteur d'importance présent au dernier numéro, le huitième, Jean-Louis Chrétien auquel il y a maintenant bien longtemps j'avais proposé de participer à ma propre revue, Dialectique, et qui refusa cette participation pour d'indignes raisons (disons-le : ridiculement et prétendument politiques, notre penseur éminent s'imaginant sans doute tomber dans quelque piège tendu par l'horrible infréquentable que je suis et reste...).
Je connais trois magnifiques revues : Conférence (dirigée par Christophe Carraud) qui, je l'ai écrit dans la Zone, m'a beaucoup déçu par l'indigence de certains de ses textes d'auteurs contemporains. Lorsque l'on évoque Pétrarque, saint Augustin, Günther Anders ou Maria Zambrano, on n'ouvre point, par lamentable copinage, ses belles pages à de petits auteurs de textes rimailleurs et indigents. Il y avait aussi (déjà le passé avant, peut-être, sa renaissance, ailleurs que chez A contrario) la monstrueuse et fascinante Sœur de l'Ange de Matthieu Baumier. Il y a enfin Contrelittérature créée par Alain Santacreu, à l'actualité riche puisqu'un livre vient de paraître (aux éditions du Rocher) qui regroupe différentes contributions consacrées à l'essence contrelittéraire des arts. A présent, voici Nunc, magnifique revue (présentée par un site très laid que l'on espère simplement informatif), que dirigent Réginald Gaillard et Franck Damour avec lesquels j'ai échangé quelques mots, samedi soir sur le stand convivial de Contrelittérature, au Salon de la revue littéraire. J'ai évoqué avec Réginald, en quelques trop brèves phrases hélas, les efforts fournis par sa poignée d'amis (comme toujours, une revue est d'abord, pardonnez-moi la comparaison disgrâcieuse, un oignon : au fil du temps, les pelures superficielles disparaissent pour découvrir le noyau véritable, qui lui-même sera stable ou instable, se désintégrera ou pas...), tel auteur d'importance présent au dernier numéro, le huitième, Jean-Louis Chrétien auquel il y a maintenant bien longtemps j'avais proposé de participer à ma propre revue, Dialectique, et qui refusa cette participation pour d'indignes raisons (disons-le : ridiculement et prétendument politiques, notre penseur éminent s'imaginant sans doute tomber dans quelque piège tendu par l'horrible infréquentable que je suis et reste...).Les lecteurs habitués de Jean-Louis Chrétien ne découvriront, dans les pages qui lui sont consacrées (dans la rubrique intitulée Shekhina), rien qu'ils n'aient su de longue date après avoir lu le crépusculaire Lueur du secret (L'Herne, 1985) par lequel je découvris l'auteur, L'inoubliable et l'inespéré (Desclée de Brouwer, 2000) dont la lecture m'aida (avec d'autres, Gadenne, Kierkegaard) à surmonter telle épreuve ou encore, ouvrage remarquable, L'arche de la parole (PUF, 1998). En revanche, celles et ceux qui ne savent rien de Chrétien trouveront de quoi nourrir de belles interrogations grâce aux différentes études regroupées dans ce même dossier (au demeurant parfaitement pensé) dont la plus intéressante me semble être celle de Catherine Pickstock intitulée La poétique cosmique de Jean-Louis Chrétien.
 Je termine enfin par l'article qui eût pu être intitulé Archéologie sacrée du signe, en fait un passionnant entretien mené par Nunc au sujet du livre d'Irène Rosier-Catach intitulé La parole efficace. Signe, rituel, sacré (Seuil, 2004).
Je termine enfin par l'article qui eût pu être intitulé Archéologie sacrée du signe, en fait un passionnant entretien mené par Nunc au sujet du livre d'Irène Rosier-Catach intitulé La parole efficace. Signe, rituel, sacré (Seuil, 2004).L'existence, toujours fragile rappelons-le, d'une revue telle que Nunc est l'un des rares témoignages écrits de la survivance, dans notre merveilleux pays oublieux de tout et d'abord d'une tradition de culture, de savoir et de poésie qui se forgea souvent dans de précieuses et éphémères revues, d'une pensée qui ose et, osant, n'a pas besoin de la criaillerie publicitaire.
19/10/2005
Asensio tient le couteau, ou contre Jorge Semprún

17/10/2005
Anus mundi virtuel

Longues heures, le regard perdu, douloureux, sirotant un verre de rouge plus qu'épais, à lire, à tenter de lire ce que la Toile offre de criardes nullités jetées au vide virtuel, sitôt avalées, sitôt digérées puis expulsées : phocomèles paroles de putes esseulées allumant l'écran à défaut d'un mâle qui calmerait leurs ardeurs et parviendrait même, rêvons un peu, à les empêcher d'écrire, discrètes forfanteries accumulées pour nuls yeux experts de jésuite, pituitifs orgasmes qu'alimentent de pieuses connasses ouvertes comme des outres que la première idée imbécile remplira jusqu'à menacer de crever, verroteries d'argumentations plus versicolores que la dague d'un mamelouk qui ne s'enfoncera jamais dans le secret humide et poisseux d'une chair.
Abandonne toute espérance, lecteur, puisque te voici emprisonné dans l'enfer de ce qui n'est pas. Oui, comme il est vrai que «La post-humanité blogue en crevant» et que, pour quelques réussites que je ne manque jamais de saluer (comme les textes, désormais familiers à mes lecteurs je l'espère, de Dominique Autié et de Juan Pedro Quiñonero), tout le reste est une vaste comédie, une farce abjecte gainée par et dans les mailles du Réseau, comme une dinde géante qui aurait oublié son essence (de) volatil(e) et nous rejouerait, la poésie insurpassable en moins, la pantomime grotesque de l'albatros que moquent les matelots. Et que fait, même, l'un des plus doués, Olivier Noël, qui dans sa réponse rusée et torve au texte de Dominique Autié et au mien, ne décide ni ne tranche mais crucifie la Zone au pied d'une aporie évidente, je veux dire, que je ne songe pas un instant à contester ? Ainsi : «Domaine infra-verbal pour Juan Asensio, univers de la furtivité pour Dominique Autié, la Toile, ce schizo-monde infernal peuplé de simulacres, ne saurait en effet relayer la moindre parole solitaire sinon pour la broyer sans état d’âme et à son insu. La Zone elle-même, qui se voudrait pourtant telle, a surtout réussi – les anticorps de la Matrice sont désormais trop puissants – à traîner dans son sillage son cortège de commentaires dégénérés, cellules métastatiques dont la prolifération exponentielle menace de submerger le monde sensible qui les a vu naître, comme si l’Univers, après s’être étendu, s’auto-dévorait jusqu’à n’être plus qu’un non-point de densité infinie – anus mundi sans la moindre dimension. La Zone, plus que tout autre territoire du blogomphalos, contribue ainsi, malgré la foi inébranlable qui anime son créateur – mais pour combien de temps encore ? –, à l’irréversible entropie qui frappe non seulement le média lui-même, mais encore ses utilisateurs. Autant vociférer dans un désert éternel en effet : du cyberespace ne saurait naître qu’une déhiscence de la Technique, gris acier, à laquelle l’homme, cet animal pathétique, ne serait plus indispensable». Consumatus est avais-je envie d'ajouter, ne me dissimulant pas la portée blasphématoire de ce propos appliqué au règne du multiple, du pluriel indifférencié, du grouillant qui caractérise, depuis la nuit des temps, la surrection du démoniaque (1).
L'ironie seule peut-être, et le ton du pastiche nietzschéen empêchent qu'à leur tour, ces quelques lignes d'Olivier procrastinant une réponse réelle à notre débat ne sombrent dans le vortex tourbillonnant et, leur auteur lui-même l'affirme, dans l'anus mundi qui, nous pouvons le craindre, ne débouche comme une espèce monstrueuse de trou blanc sur un univers surplié au nôtre, inscrit dans son recès le plus secret, comme son avers. Mais peut-être qu'alors ces habitants de l'outre-monde sont les seuls capables de transformer la boue en or, de sauver, en somme, ces phrases ironiques et cruelles (d'abord pour son propre travail) d'un homme, comme il a dû lui-même l'écrire quelque part, moins hanté par le rêve sot d'une surhumanité que par celui d'un âge d'or non point retrouvé (cette chimère de tous les mystiques ratés mâchonnant leur bâton de réglisse ésotérique) mais conquis de haute lutte.
(1) : je suis en train de lire, dans Trois fureurs (Gallimard, 1988, pp. 72-126), la longue étude que Jean Starobinski a consacré au cas, canonique si on veut, du possédé de Gérasa rapporté par l'évangéliste Marc (V, 1-20).
15/10/2005
De Roux le provocateur, Hallier l'imposteur

13/10/2005
Actualité ou inactualité de Max Scheler, par Francis Moury

Lien permanent | Tags : philosophie, max scheler, francis moury |  |
|  Imprimer
Imprimer
08/10/2005
La chair est triste, hélas... : sur Alina Reyes

Je m'accuse, publiquement, d'avoir déshonoré la Zone en acceptant d'y publier, et ce par deux fois, des textes ridicules, ampoulés, mêlant sans force ni talent méditations bibliques loufoques et érotisme ludique, d'Alina Reyes. Car il n'aura fallu qu'une poignée d'échanges directs, violents, sans la moindre concession de ma part à quelque sotte proclamation de bonheur de midinette et de vie d'artiste, pour que se révèle, sous l'apparence douce et timide, le visage véritable de notre romancière polygraphique et, elle n'aime pas le mot qui la cantonne comme une professionnelle de la chair, pornographique. Et dire que, par souvenir lointain de certaine émotion coupable, à la lecture, dès sa parution, du fameux Boucher, j'avais décidé de ne point dire à cette dame charmante ce que je pensais, réellement, de ses petites dégoulinades traduites, se fait-elle une fierté de nous le rappeler, en trente-huit langues dont le moldavo-tchétchène, histoire que les fous de Dieu, combattants d'une juste cause et goûtant tout de même la vie placide du bivouac guerrier, n'ignorent plus rien de la double pénétration, fût-elle repoussée je vous prie, héroïquement, pendant six nuits et en guise de cerise acidulée de la septième et dernière, par quelque bourgeoise parisienne en mal d'aventures, rejouant le drame plat d'une Création sans naissance mais avec éruption de douloureuses hémorroïdes...
Alina, donneuse de leçons (de choses bien sûr) sous vos airs de n'y point toucher, leçons applicables aux autres mais que vous vous gardez bien, n'est-ce pas, d'infuser dans vos propres textes, dès fois que leur bavardage serait, immédiatement, réduit en poussière, voilà bien le masque de cette écrivaine de monomaniaque penchant qui ne parvient pas, nous dit-elle, à faire publier son manuscrit de réflexions personnelles, on se demande bien pourquoi. Peut-être, chère madame, parce que nul tenancier de gargote ne se risquerait à servir une telle soupe où les ingrédients sont jetés, pêle-mêle, par une cuisinière peu regardante. J'ai il y a quelques mois, ici même, servi deux gamelles de semblable potage, depuis vidées dans l'évier (pardonne-moi, LKL, d'avoir ainsi supprimé tes dessins), m'étant avisé, en les goûtant du bout des lèvres, qu'ils étaient, si je renifle leurs grumeaux théologiques, de très peu de farine et, considérant cette fois leur écriture, de bien maigre substance, quelques croûtons à peine, flottant comme des bouchons sur une tambouille saumâtre. Peut-être encore, chère madame, ne parvenez-vous point à faire lever cette pâte parce que vous avez laissé votre petit-œuvre érotique se nicher, comme un ténia foreur, dans les surplis les plus secrets de carnes mille et mille fois retournées sans veiller à donner à cette écriture quelque repos, quelque solidité, quelque densité : un peu d'air, oui, un peu d'air pour le long ver des profondeurs les plus sales de notre pauvre corps.
Artiste (elle me l'a répété suffisamment, la bouche fière : je suis une artiste, et ne manque jamais une seule occasion de le répéter à ses benoîts lecteurs...) ou plutôt artisane, puisque chacun de ses romans, gage de qualité et de sincérité prétendument rustiques, est le fruit d'une parturiente douloureuse, de quelques mauvais livres inoffensifs qui n'auront pas même provoqué, sur l'océan immense qu'est la seule littérature érotique, plus que l'infime frémissement d'une patte d'éphémère, Alina se veut ouverte, béante même mais... Attention cher ami, ne vous méprenez pas, ne vous jetez pas dans cette béance trompeuse, l'ouverture, comme tout ce qui n'existe qu'en simulacre, a un prix, la largesse a tout de même un empan, celui-là même qui vous permet de mesurer votre souveraine tolérance au fait de vivre dans un quartier à la mode qui, probablement, a vue directe, depuis le balcon mais ce n'est déjà pas si mal, sur la misère habituelle, tragiquement habituelle des rues de Paris. Cette misère heureuse du prétendu artiste qui, sans être vécue (car alors, banal tout de même : point d'écriture), vous permet toutefois d'écrire des livres qu'aucun clochard, fût-il ancien lecteur et amateur frustré des enfantillages amoureux, n'aura même l'idée de consulter pour y humer l'air éditorial du temps. Alors, rien de plus me direz-vous que ce boudoir de nonchalance bohème dans lequel l'acéré et pâle Laclos eût tremblé de rage de se laisser emprisonné, rien de plus que cette imposture placide qui aurait provoqué, chez le dangereux spartiate de la luxure qu'était Bataille, une grimace de mépris ? Non, rien de plus mais après tout me dira la belle, qu'importe la taille de la lucarne cerclée d'or consensuel, si l'on peut y contempler, niellée de paillettes, la crasse sereinement mise à distance, l'exacerber même par l'écriture de romans qui jetteront une deuxième fois les pauvres dans la rue et les confineront dans les latrines de leur propre misère sexuelle, comme disent les journalistes ? Vous n'écrivez donc point, Alinartiste, vous répétez la même chansonnette à quatre notes facilement apprise par une petite fille rêveuse et, distraitement, vous promenant dans la rue enjouée (puisque décidément le monde crasseux, sous votre regartiste, semble se parer des ors d'un éternel champ élyséen), sifflez l'air qui ne hantera plus de quelques secondes, je vous l'assure, l'attention labile du plus amène poivrot.
J'appelle cette insouciance une trahison (l'horrible mot doit buter devant vos lèvres délicatement parfumées), j'appelle cette mascarade angotienne trahir les pauvres, et je vous assure que je n'ai point eu le besoin de consulter mon petit Bernanos pour vous l'écrire. Si au moins on devinait, dans vos livres, des gouffres autres que corporels. Non, pas une Mouchette dans vos romans pour se jeter sur quelque amant méprisable, qui lui aura néanmoins appris le goût de cendre de la corruption, rien que d'évasives belles de jour qui se donnent des frissons en croisant le regard niais de Gilles de Rais bourgeois, tranquillement vicelards, lisant Libération à la terrasse du Rostand. Dans vos bluettes, la moindre Laure, sainte de l'abîme, que dis-je, la plus sotte Lolita nourrie de lait aurait rang, dans le pandémonium femelle dont vous êtes le Satan d'opérette, de Lilith carnassière. J'appelle cela, maladie jumelle de la précédente qui tavèle vos pages d'une légère mais persistante pruine rance, de la mauvaise foi, fièvre parisienne bénigne connue de longue date (certains médecins, le thermomètre entre les dents, vont même jusqu'à parler de mal français), typique somme toute, c'est là votre rhume des foins contracté depuis un certain mois de mai éthéré comme du pollen, de la gauchiste rentrée que vous êtes, comme celle consistant à ne pas publier ma dernière réponse à votre odieux, votre stupide texte stambouliote puis, ensuite, sans m'aviser de rien et alors même que nous échangions quelques messages clairs, à écrire, publiquement, que je vous avais insultée. Insultée Alina ? Maintenez-vous, sans rire, que je vous ai insultée ? Je ne vois rien, moi qui suis pourtant expert en recyclage d'ordures, rien que votre fierté d'artiste (décidément, j'aurais préféré plus d'intermittence dans le pauvre spectacle...) blessée et votre inanité intellectuelle, vous-même, encore une fois, me l'écrivez.
Êtes-vous donc assez piètre lectrice pour confondre votre cas avec celui de ces chiennes occidentalisées à outrance, millionnaires salopes que Paris Match, chantant récemment les vertus incomparables d'une adhésion de la Turquie à l'Europe à bout de course, a choisies comme bayadères représentatives d'une société, nous dit-on, laïquement islamiste ou, c'est équivalent, sauvagement modérée ? Est-ce cela ? Voyons, je vous ai tout juste dit ce que je pensais de vos procédés de contournement, d'échappatoires grotesques, de non-réponses méprisantes plus que légères, que vous vous amusiez encore à jouer la chattemite, à votre âge tout de même, bien capable d'exacerber la patience d'un bonze castré. Je vous ai simplement rappelé que votre optimisme béat, votre comique appropriation, à fins exclusives de tolérance et d'ouverture (pigeon à deux têtes plus rare qu'un Phénix que vous êtes, sans doute depuis votre balcon, la seule à avoir pu observer) des vertus d'accueil, l'éternelle rengaine viciée et fausse de la France balayée par tous les vents, seraient aussi, un jour prochain, le couteau qui, manié par la main experte du boucher, se retournerait contre votre jolie petite gorge rose.
Voilà ce que vous ne pouvez entendre, chère Alina, voilà ce que l'onctueuse vertu de tolérance que vous pommadez, d'une main légère, sur le dos de vos amis journalistes et de vos nombreux et délicats lecteurs, voilà ce que votre artistique irresponsabilité ne peut supporter plus de quelques secondes, et encore, vous fermez les yeux, vous êtes bien incapable de fixer l'insoutenable éclat d'une indigence, d'une inconsistance dont vous refusez de considérer qu'elles sont, tout simplement, vos propres rejetons, petits monstres ricanants et nains difformes enfantés par une écriture plus fade que blanche, vidée, avilie d'avoir été contrainte de tant se prostituer pour, finalement, répéter cette pauvre vérité, que tous les clichés du monde ne parviendront pas à voiler : la chair, y compris celle, boucanée à outrance et qui se complaît sur l'étal de vos petites histoires saucissonnables à volonté, est affreusement triste que l'esprit ne nourrit point.


























































