« Une génération perdue de Maurizio Serra | Page d'accueil | La chanson d’amour de Judas Iscariote de Juan Asensio, par Guillaume Sire »
04/10/2016
Quelques pistes bloyennes de recherche sur Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos
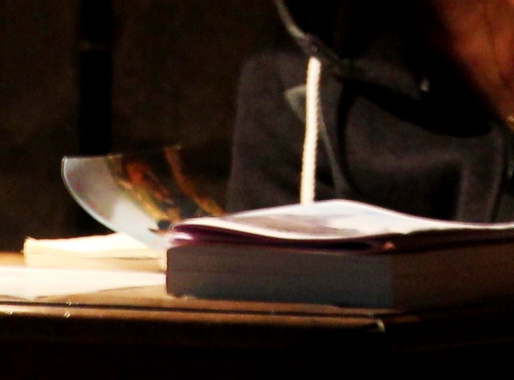
 Georges Bernanos dans la Zone.
Georges Bernanos dans la Zone. Léon Bloy dans la Zone.
Léon Bloy dans la Zone.«Un bagage énorme, pour un voyage qu'on ne fait jamais.»
Armel Guerne.
Exorde en forme de coup de pied au large séant universitaire, qui a reçu déjà beaucoup de coups de pied, mais qui n'en réclame pas moins de nouveaux
 Des années de recherches intenses n'ont visiblement pas permis à l'élite universitaire française, paraît-il spécialiste des textes de Georges Bernanos, d'apporter, au cours de plusieurs centaines de pages de banalités pieusement imprimées sur le réputé papier Bible de la collection de la Pléiade les quelques indices, modestes mais pas moins intéressants il me semble, d'une compénétration entre le premier roman de Georges Bernanos paru en 1926 et un ouvrage aujourd'hui bien oublié de Léon Bloy sur le génial explorateur qui découvrit l'Amérique, Christophe Colomb. J'expose, ci-dessous, ces indices, en m'autorisant quelques digressions vers un autre des textes de Léon Bloy, beaucoup plus connu que le précédent, Le Désespéré. La note qui suit ne prétend bien évidemment pas remplacer un travail, universitaire si l'on y tient à tout prix, de belle ampleur, qui s'attellerait à démontrer que Georges Bernanos, comme d'ailleurs tout écrivain qui se respecte, était beaucoup de choses, et évidemment un romancier de génie, mais aussi un très grand lecteur ou, à tout le moins, un lecteur profond, qui a finalement assez peu évoqué l'influence que d'autres écrivains ont pu exercer sur lui mais qui, n'en doutons pas, a non seulement beaucoup lu mais a été profondément influencé par ses lectures. Léon Bloy fut, pour celui que Roger Nimier appela à juste titre le Grand d'Espagne, une influence profonde, séminale, le prodigieux coup de vent que le Mendiant ingrat insuffla à la langue française faisant lever, comme une pâte, les images qui dansaient dans la cervelle du jeune gamin turbulent puis de l'homme au front, sans compter, bien évidemment, celui de l'homme qui deviendrait, au sens le plus noble de ce terme, un écrivain de génie comme je l'ai dit.
Des années de recherches intenses n'ont visiblement pas permis à l'élite universitaire française, paraît-il spécialiste des textes de Georges Bernanos, d'apporter, au cours de plusieurs centaines de pages de banalités pieusement imprimées sur le réputé papier Bible de la collection de la Pléiade les quelques indices, modestes mais pas moins intéressants il me semble, d'une compénétration entre le premier roman de Georges Bernanos paru en 1926 et un ouvrage aujourd'hui bien oublié de Léon Bloy sur le génial explorateur qui découvrit l'Amérique, Christophe Colomb. J'expose, ci-dessous, ces indices, en m'autorisant quelques digressions vers un autre des textes de Léon Bloy, beaucoup plus connu que le précédent, Le Désespéré. La note qui suit ne prétend bien évidemment pas remplacer un travail, universitaire si l'on y tient à tout prix, de belle ampleur, qui s'attellerait à démontrer que Georges Bernanos, comme d'ailleurs tout écrivain qui se respecte, était beaucoup de choses, et évidemment un romancier de génie, mais aussi un très grand lecteur ou, à tout le moins, un lecteur profond, qui a finalement assez peu évoqué l'influence que d'autres écrivains ont pu exercer sur lui mais qui, n'en doutons pas, a non seulement beaucoup lu mais a été profondément influencé par ses lectures. Léon Bloy fut, pour celui que Roger Nimier appela à juste titre le Grand d'Espagne, une influence profonde, séminale, le prodigieux coup de vent que le Mendiant ingrat insuffla à la langue française faisant lever, comme une pâte, les images qui dansaient dans la cervelle du jeune gamin turbulent puis de l'homme au front, sans compter, bien évidemment, celui de l'homme qui deviendrait, au sens le plus noble de ce terme, un écrivain de génie comme je l'ai dit. Un simple coup d’œil sur les index des noms de ses trois volumes de correspondance (chez Plon, qui s'en fout d'ailleurs) nous renseigne suffisamment sur ce point, puisque Georges Bernanos y évoque Barbey d'Aurevilly (I, pp. 188 et 212, III, p. 163), Ernest Hello (I, p. 79, II, p. 589), mais aussi Joris-Karl Huysmans (I, pp. 174 et 424, II, p. 302), Rimbaud (I, pp. 175, 351, 470 et 480, III, p. 408) ou encore Dostoïevski (I, p. 258, III, p. 167), Rebatet (II, p. 703), Brasillach (II, p. 649) et tant d'autres (comme Psichari, Du Bos, Mauriac, Claudel, Gide, Jouhandeau, etc.). Il n'en est que plus intéressant de constater que le seul texte réellement ample écrit par Bernanos sur un écrivain qu'il a admiré est, comme il se doit, consacré à Léon Bloy (voir Dans l'amitié de Léon Bloy et, dans la Correspondance, tome I, pp. 212, 415 et 537; II, pp. 20, 116, 167, etc.; III, pp. 112, 116, 119, etc.), qu'il découvrit dans les tranchées boueuses et puantes de la Grande Guerre. Il est encore plus frappant de voir que ce texte a été écrit bien après que le jeune soldat ait découvert le formidable imprécateur, en juillet 1946, et que Bernanos s'adresse à son «vieux Bloy» qu'il prend le soin de séparer des «gens de lettres» en affirmant de lui qu'il a exercé «tant d'années, de taudis en taudis, de propriétaire en propriétaire, le Sacrement de Littérature» et qu'il a annoncé «notre monde», à la stupéfaction des «auditeurs subjugués» qui finissent par le distinguer au travers des voiles du temps, mais surtout grâce à Bloy justement, grâce à l'écriture du Vieux Pèlerin, «à travers les images et les symboles de ce style d'une opulence byzantine, comme on voit entre les puissants piliers de l'Arc de Triomphe descendre un soleil rouge». La suite de ce texte inspiré fait de Léon Bloy un écrivain non seulement génial, même s'il ne sait parfois pas ce qu'il dit et qu'importe, car «l'Ange qui parle à son âme le sait pour lui...», mais un prophète, une dimension à laquelle, si mes souvenirs sont bons, Kafka avait lui aussi été sensible : «Plus d'un demi-siècle d'avance, lorsque le petit Hitler était un enfant innocent, il a l'air d'avoir épelé en rêve le nom des nouveaux dieux, erré dans les Dachau et les Buchenwald, ou dans d'autres camps d'agonie que nous ne connaissons pas encore, que nous ne connaîtrons jamais, là-bas, aux frontières de l'Asie, aux bords de la Mer Glaciale; il a respiré l'odeur des fours crématoires, senti coller à sa peau la grasse suie humaine, il a vu crouler les villes sous la lune et le ciel de Dieu, le ciel innocent, ouvert d'outre en outre par l'éclat aveuglant de la bombe atomique, mais de ces visions, le moment venu de les révéler, il ne lui reste que l'horreur, et la certitude que cette horreur ne ment pas. N'importe ! son témoignage n'est pas celui d'un homme qui prévoit, mais d'un d'homme qui voit, qui est seul à voir ce qu'il voit, les yeux fixés sur ce point de l'histoire, l'index tendu, parmi la foule horrible des badauds» (in Essais et écrits de combat, t. 2, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1995, pp. 1231-2). Bernanos a reconnu en Bloy l'un des siens, comme, sans doute, Ernst Jünger, a reconnu en Bernanos l'un des siens, à savoir un homme possédant le don de force.

Acheter Sous le soleil de Satan sur Amazon.
Depuis que j'ai découvert Georges Bernanos, non point dans quelque tranchée infestée de rats, mais bien sagement assis sur le siège assez peu confortable, dans mon souvenir, d'une salle de cinéma lyonnaise projetant l'adaptation que Maurice Pialat réalisa de son premier roman, j'ai toujours pensé qu'il était honteusement relégué au rang d'un écrivain quelque peu grossier ou plutôt mal dégrossi, un provincial en quelque sorte, une espèce de Donissan à l'intelligence lourde, lente comme la mastication d'une vache, un homme un peu brusque, non seulement colérique mais bien trop souvent injuste avec ses contemporains, et qui surtout aurait oublié de lire non seulement ces derniers mais ceux qui l'ont précédé. J'ai ainsi insisté sur quelques rapprochements possibles entre son premier roman, Sous le soleil de Satan donc, et Moravagine de Blaise Cendrars, un texte fascinant qui, étrangement, a lui aussi paru en 1926. Pure coïncidence bien sûr, mais il y a plus que cette date commune de parution : il y a des parentés, des affinités aussi naturelles que souterraines, subtiles, invisibles du coup et par définition aux bigleux bientôt nonagénaires qui professent doctement sur les mystères de la littérature et, plus modestement, corrigent des copies sans beaucoup de grâce ni même d'application. J'avais déjà évoqué, dans une longue note fouillée, les rapprochements qui me semblaient pouvoir être fondés entre ce même Sous le soleil de Satan et le texte le plus connu d'Arthur Machen, Le Grand Dieu Pan, que Bernanos a peut-être lu dans la traduction qu'en donna Paul-Jean Toulet, ce même Toulet bien oublié hélas que cite le romancier dans son premier roman, sans que notre si érudite caste de mandarins universitaires, qu'il faudrait pour l'occasion traiter d'eunuques sans un atome de curiosité et d'originalité, n'émette plus que de pieuses banalités à propos de cette citation étrange. Je prétends en dire plus, et cela sans même que le lecteur passionné de Bernanos mais ne pouvant pas forcément investir quelque 130 euros dans deux tomes décevants, bavards, logorrhéiques et creux, n'ait besoin de dépenser un centime d'euro, hormis bien sûr s'il tient à encourager le travail d'exploration que je mène depuis désormais plus de 11 années en m'enfonçant toujours davantage dans la Zone ! Je serai probablement jugé, d'ici quelques années, sur cette folle prétention, mais j'affirme sans ciller que le double volume des romans de Georges Bernanos paru dans la Pléiade, décidé voici de nombreuses années, alors même que Max Milner et Jean-Loup Bernanos étaient de ce monde, est bien sûr ridiculement daté dans nombre de ses commentaires, mais était d'ores et déjà obsolète, à tout le moins ne présentait aucune vue nouvelle le jour même de sa parution.
Georges Bernanos lecteur de Léon Bloy : l'abbé Donissan, christophore des ténèbres
«Souviens-toi de la guerre, c'est-à-dire que je combats contre lui […], que je combattrai contre lui sur la croix. Là Léviathan sera pris à l'hameçon, c'est-à-dire il sera vaincu par la divinité cachée sous la chair de l'humanité.»
Le Marteau des Sorcières [1486] (Jérôme Millon, coll. Atopia, 1990), p. 409.
Nous avons longuement évoqué la figure de Christophe Colomb telle que Léon Bloy l'a peinte dans deux de ses ouvrages, Le Révélateur du Globe paru en 1884 et Christophe Colomb devant les taureaux, publié six ans plus tard.
Il m'a toujours paru curieux que la critique universitaire n'ait pipé mot sur une mention assez étrange qui, dans le premier roman de Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan, a passé presque totalement inaperçue. C'est bien simple, la dernière édition des romans de Georges Bernanos, prétentieux monument de gloses le plus souvent insignifiantes et complaisamment satisfaites qui jamais n'oublie de citer les travaux appartenant au sérail trois fois saint de l'Université, ne nous apprend absolument rien sur ce passage et cette mystérieuse mention, que voici, évoquant la jeune Mouchette, qualifiée de «petite fille ambitieuse» qui s'est «lassée d'attendre on ne sait quoi, qui ne vient jamais» : «C'est de là qu'elle est partie, et elle est allée plus loin qu'aux Indes... Heureusement pour Christophe Colomb, la Terre est ronde; la caravelle légendaire, à peine eut-elle engagé son étrave, était déjà sur la route du retour...». Je donne la suite du texte qui, elle, ne pourra qu'éveiller les soupçons de tout lecteur de Léon Bloy, mais pas de nos remarquables universitaires qui, eux, n'ont rien vu ! : «Mais une autre route peut être tentée, droite, inflexible, qui s'écarte toujours, et dont nul ne revient». J'ai cité le texte dans l'édition, fort valable à mes yeux, des romans de Georges Bernanos donnée par Michel Estève et Albert Béguin laquelle, à dire vrai, ne nous en apprend pas davantage que l'autre, la plus récente et inutile, sur cette occurrence, et cela en dépit même du fait que l'un des premiers, Michel Estève a pointé ce que Bernanos devait à son illustre prédécesseur (1).
Le plus commode serait bien sûr de parler d'une image, d'une métaphore qu'il ne faudrait tout de même pas s'aventurer à explorer durant des lustres, puisque, après tout, elle s'insérerait parfaitement dans le réseau des autres images poétiques qui tisse le roman. Nous savons que Georges Bernanos a lu Léon Bloy avec lequel il a même correspondu selon ses dires, et auquel il a consacré un texte magnifique, intitulé Dans l'amitié de Léon Bloy. Renseignements pris auprès d'Yves Bernanos, celui-ci m'a assuré que, selon son père Jean-Loup Bernanos, son grand-père avait lu tous les ouvrages du Mendiant ingrat durant sa convalescence en 1918 à Vernon, donc les deux textes que ce dernier a écrits sur le grand navigateur très-chrétien, et qu'il ne serait donc pas absolument incohérent que ces textes aient influencé l'auteur durant la période de l'immédiate après-guerre.
Toutes les fois qu'il le peut, Bernanos identifie l'abbé Donissan au Christ, mais un Christ qui serait à quelques solides années-lumière de toute sotte fadaise post-Vatican II, un Christ non point de gloire ou de sucre glace, un Christ non point clignotant sur un étal de Lourdes, mais un Christ de déréliction, considéré, selon une très ancienne patrologie qui nous vient de Grégoire de Nysse par l'intermédiaire de Rufin, comme l'hameçon du Démon. C'est en effet Donissan qui rejoue le drame inimaginable, auquel il donne sa véritable portée face à son confrère de Luzarnes : «Prenez bien garde, Sabiroux, que le monde n'est pas une mécanique bien montée. Entre Satan et Lui, Dieu nous jette, comme son dernier rempart. C'est à travers nous que depuis des siècles et des siècles la même haine cherche à l'atteindre, c'est dans la pauvre chair humaine que l'ineffable meurtre est consommé» (p. 256). Georges Bernanos ose même affirmer que Dieu s'est livré «pour un temps» à Satan, car «c'est en nous qu'Il est saisi, dévoré. C'est de nous qu'Il est arraché» (p. 257).
Donissan est aussi comparé à un soldat «qui ne calcule plus les chances et va droit devant» (p. 137, la guerre étant directement évoquée à la page 272), un prêtre dont chaque échec «ne peut plus que bander le ressort d'une volonté désormais infléchissable» (p. 138), un monstre en quelque sorte aux yeux de l’Église même, comme Bernanos n'aura de cesse de le rappeler par la voix de Menou-Segrais (cf. pp. 122, 133), puisque Donissan se livrera «à l'homme pécheur, son maître, qui ne le lâchera plus vivant» (p. 140), puisqu'il n'a de cesse de le suivre, puis de le précéder au plus profond de l'Enfer, luttant de force (cf. p. 147) avec Satan, devenu donc un véritable scandale, une pierre d'achoppement, un diviseur en somme (cf. p. 158), une espèce de diable, au sens étymologique du terme pour les imbéciles qui l'entourent, qu'ils soient prêtres (comme le curé de Luzarnes) ou académiciens. Oui, Donissan est haï d'une haine féroce, comme le lui apprendra Menou-Segrais : «Vous n'êtes point né pour plaire, car vous savez ce que le monde hait le mieux, d'une haine perspicace, savante : le sens et le goût de la force. Ils ne vous lâcheront pas de sitôt...» (p. 222). Certes, Donissan n'est pas né pour plaire, ni même pour vaincre son Ennemi, qui est probablement rentré dans son âme et y a pris la place de la joie et même de Dieu. Il est alors étonnant de remarquer qu'il n'y a guère de différence, du moins en profondeur, entre le désespoir du prêtre et celui du personnage (car c'en est un, recréé par l'auteur) de Drumont, tel que Bernanos le voit : «L'homme de la Croix n'est pas là pour vaincre, mais pour témoigner jusqu'à la mort de la ruse féroce, de la puissance injuste et vile, de l'arrêt inique dont il appelle à Dieu» (p. 276) : Bernanos parle bien évidemment du Démon, mais, tout autant, il pourrait parler de l'Argent, contre lequel, en somme, Drumont s'est sacrifié aux yeux de l'écrivain, comme si son sacrifice pouvait, une seule seconde, ralentir l'horrible mouvement des mâchoires d'acier se refermant sur le Pauvre.
Toutes les fois qu'il le peut, Léon Bloy identifie Christophe Colomb au Christ, comme l'est du reste Donissan nous venons de le voir qui, d'une certaine manière, devient une espèce d'hameçon où va mordre le Démon, parce qu'il n'a pas craint de se donner à celui qui fut le plus puissant et redoutable des Anges. J'évoquerai maintenant Léon Bloy, les travaux sérieux, dont celui de Michel Estève, ayant suffisamment montré que Bernanos faisait rejouer au curé de Lumbres la geste christique. Ainsi : «La mystérieuse effigie qu'on rencontrait à chaque pas, dans les basiliques des vieux siècles, avait enfin reçu son application. La légende si célèbre du martyr syrien serait donc quelque chose comme un vieux testament que l'histoire évangélique de Colomb devait accomplir» (p. 340). C'est dans Christophe Colomb devant les taureaux que Léon Bloy n'hésite pas à citer ce qu'il a écrit dans Le Révélateur du Globe, affirmant, à propos du comte Roselly de Lorgues, que «cet écrivain a été pour Christophe Colomb précisément ce que fut le Samaritain de l’Évangile pour le personnage mystérieux tombé dans les mains des voleurs, dépouillé par eux et laissé pour mort sur la symbolique voie qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Le prêtre et le lévite avaient passé à côté de ce moribond sans le secourir. Mais le troisième voyageur, l'homme de la race détestée par les Pharisiens, aussitôt qu'il l'aperçoit, tremble de pitié. Il s'approche de l'abandonné, panse les plaies que lui ont faites les spoliateurs, le fait asseoir sur sa monture d'historien, le conduit à l'auberge d'un éditeur et prend soin de lui comme d'un frère» (pp. 335-6). Nous pourrions multiplier les exemples où l'écrivain rapproche le grand navigateur du Christ, dont le rôle est toujours de porter le Fils de l'Homme «aux nations privées d'espérance» (p. 328) et qui, même, est directement identifié à ce dernier puisque lui aussi, «descendit aux enfers pour délivrer la moitié du genre humain» (p. 327), de la même façon que nous pourrions multiplier les exemples des occurrences où l'abbé Donissan est indirectement ou pas rapproché du Christ, mais point n'est besoin je crois d'être un grand ponte de l'Alma Mater pour comprendre d'où ce tropisme, qui aimante pour ainsi dire tout le ministère de Donissan, provient.
Georges Bernanos lecteur de Léon Bloy : portrait de Satan et peinture de l'univers du Mal
Je me permets de reproduire longuement un passage de la note que j'avais consacrée au Révélateur du Globe de Léon Bloy (2), où nous retrouvons notre bernanosienne préférée : «Il y a quelques années, si l'incompétence prétentieuse de Monique Gosselin-Noat ne m'avait dégoûté de poursuivre un sujet de thèse qui, deux années à peine avant que je ne commence à m'y atteler, avait été épuisé par une thèse publiée en deux forts volumes, j'aurais pu travailler au sujet que je lui avais proposé et qu'elle avait refusé, prétextant que c'était viser au-dessus de mes forces et que, petit étudiant lyonnais monté à la capitale pour la voir durant 1 heure 27, je n'avais qu'à accepter le sujet qu'elle avait eu l'heur de me confier et non celui dont je rêvais : le diable dans la littérature française de Charles Baudelaire à Georges Bernanos, cet intitulé prenant la suite du travail que Max Milner avait consacré, en prenant pour borne le grand poète et, en amont bien sûr, Jacques Cazotte ! J'aurais alors pu y évoquer la figure de Satan chez Bloy, singulièrement dans Le Révélateur du Globe, comme nous allons à présent le voir.
Il est assez étonnant que cette figure surgisse dans les toutes premières pages du livre, où Bloy écrit : «La notion du Diable est, de toutes les choses modernes, celle qui manque le plus de profondeur, à force d'être devenue littéraire. À coup sûr, le Démon de la plupart des poètes n'épouvanterait pas même des enfants. Je ne connais qu'un seul Satan poétique qui soit vraiment terrible. C'est celui de Baudelaire, parce qu'il est SACRILÈGE. Tous les autres, y compris celui de Dante, laissent nos âmes bien tranquilles [...]. Mais le vrai Satan qu'on ne connaît plus, le Satan de la Théologie et des Saints Mystiques, – l'Antagoniste de la Femme et le Tentateur de Jésus-Christ, – celui-là est si monstrueux que, s'il était permis à cet Esclave de se montrer tel qu'il est – dans la nudité surnaturelle du Non-Amour, – la race humaine et l'animalité tout entière ne pousserait qu'un cri et tomberait morte...» (p. 36, l'auteur souligne). Georges Bernanos, découvrant Léon Bloy dans les tranchées de la Grande Guerre, se souvint peut-être de cette étonnante description qui avait pour but, en somme, d'arracher Satan aux bondieuseries et de lui donner ou plutôt redonner sa véritable dimension théologique : l'horreur faite ange, et plus grand des anges, une horreur surnaturelle, une singularité théologique, le Mal personnifié, unifié par une volonté dont nous ne pouvons même pas imaginer la cruauté et la fixité !
La description se poursuit, et je ne vais pas hésiter à citer de longs passages de ce portrait du Démon tel que Léon Bloy le peint : «La plus grande force de Satan, écrit-il ainsi, c'est l'Irrévocable [...]. Dieu garde pour lui sa Providence, sa Justice, sa Miséricorde et, par-dessus tout, le Droit de grâce qui est comme le sceau où son omnipotente Souveraineté est empreinte. Il garde aussi l'irrévocable de la Joie et il laisse à Satan l'irrévocable du Désespoir» (pp. 36-7, l'auteur souligne). Léon Bloy affirme que le diable, contrairement à une idée commune qui le prétend débordant de vitalité, est au contraire un être appauvri, asséché, congelé comme l'avait figuré Dante, trônant au plus profond de l'Enfer, mais cette existence au rabais suffit encore à provoquer la stupéfaction de l'humanité et, plus que cela nous l'avons vu, sa sidération et sa mort. Les lecteurs férus de lettres auront vite fait de prétendre que Léon Bloy, une fois de plus, a recours à l'une de ses figures de style favorites, qui n'est autre que l'hyperbole et Georges Bernanos, encore lui, ne manquera pas de céder à la tentation de l'utiliser dans son premier roman, Sous le soleil de Satan, avant que ses romans ultérieurs ne fassent disparaître le diable en tant que personnage réel de ses histoires, et cela jusqu'à la plus parfaite intériorisation de Satan, qui est aussi l'acmé de sa malfaisance, comme nous le voyons dans le dernier roman de l'auteur, Monsieur Ouine.
Léon Bloy poursuit de manière trop visiblement apologétique, donc assez peu intéressante finalement, en écrivant que «Lorsque le Démon séduit et surmonte notre liberté, il en obtient des enfants terribles de notre race et de sa race, immortels comme leur père et leur mère. Cette progéniture enfante et pullule à son tour, indéfiniment, sans qu'aucun moyen naturel nous soit donné d'arrêter cette horrible et incalculable multiplication des témoins de notre déshonneur. C'est là l'empire illimité de Satan» (p. 37, l'auteur souligne). Les lignes qui suivent sont plus intéressantes et même impressionnantes à mon sens, qui livrent la puissance de Satan dans la nudité de sa faiblesse : il n'est que le Singe de Dieu, selon une très vieille acception patristique mais, pourtant, il se glisse dans le moindre interstice entre Dieu et ses élus. De telles lignes épouvanteraient aujourd'hui le plus réactionnaire de nos prélats, qui depuis belle lurette ont rangé Satan au magasin des accessoires avec lesquels les libres esprits se sont, un temps seulement, amusés, mais elles ont l'avantage à nos yeux d'annoncer la formidable stature théologique du Démon que figurera Georges Bernanos dans ses plus grands romans : «Il ceint la terre de ses deux bras immenses comme d'une écharpe de deuil et de mort, comme le mare Tenebrosum de la cosmographie des anciens. Rien ne se dérobe à son étreinte, rien... excepté la liberté crucifiée avec Jésus-Christ. Hors de ce calvaire, il est maître de tout et on peut l'étiqueter du nom de toutes les influences néfastes de la vie. Il est entre toutes les lèvres et toutes les coupes; il est assis à tous les festins et nous y rassasie d'horreurs au milieu des triomphes; il est couché dans le fond le plus obscur du lit nuptial; il ronge et souille tous les sentiments, toutes les espérances, toutes les blancheurs, toutes les virginités et toutes les gloires ! [...] Quand nous ne parlons pas à Dieu ou pour Dieu, c'est au Diable que nous parlons et il nous écoute... dans un formidable silence. Il empoisonne les fleuves de la vie et les sources de la mort, il creuse des précipices au milieu de tous nos chemins, il arme contre nous la nature entière [...]. Enfin Satan est assis sur le haut de la terre, les pieds sur les cinq parties du monde et rien d'humain ne s'accomplit sans qu'il intervienne, sans qu'il soit intervenu et sans qu'il doive intervenir. Il n'y a pas à s'étonner de cette énorme puissance et la raison catholique ne s'en étonne pas. Satan n'a que ce que Dieu lui donne et Dieu lui donne tout... à la réserve de la liberté de l'homme» (pp. 37-8).
La suite du portrait de l'Adversaire est beaucoup moins intéressante, puisqu'elle se contente d'en faire l'ennemi de l’Église : «Actuellement dénuée de tout secours humain, elle [l’Église] lutte avec des tribulations infinies contre la plus formidable tempête que le ténébreux génie du mal ait jamais soulevée contre elle en aucun temps de l'histoire» (p. 77). Une exception toutefois, comme si Léon Bloy, s'avisant de la stature qu'il a donnée à Satan, ne pouvait décidément se contenter d'en faire le banal tentateur des premières communiantes et des curés démocrates. Il est ainsi assez étonnant qu'il précise, de nouveau, un certain nombre de traits sataniques, de la façon qui suit : «Le Diable a des façons d'agir qui lui sont particulières et qui ne permettent pas de méconnaître entièrement son influence dans les choses humaines, quand l'incrustable [sic. Ne conviendrait-il pas plutôt de lire l'inscrutable ?] sagesse du Dieu de Job les abandonne, pour un temps, à son administration. D'abord, en sa qualité d'esprit, il est infatigable. Rien ne le décourage, rien ne le rebute. Antagoniste perpétuellement armé du Père tout-puissant et contradicteur merveilleusement exact de tous ses conseils, il oppose sans relâche à la Miséricorde infinie qui récompense un simple verre d'eau, l'irréprochable sollicitude d'une haine qui s'efforce de déshonorer jusqu'à nos larmes» (p. 172). Léon Bloy poursuit son portrait à charge en disant de Satan qu'il «est l'Immonde et, comme tel, [qu']il choisit toujours ce qui lui ressemble, c'est-à-dire l'ordure la plus alambiquée et l'infection la plus savante» et qu'il est «surtout un avocat. Tous les mystiques qui en ont parlé nous le montrent plaidant contre nous devant Dieu» (p. 173). Les autres rares mentions intéressantes de Satan se bornent à le présenter, assez traditionnellement, comme le Singe de Dieu («Quand on est croyant, même à la façon du Diable qui ne peut s'empêcher de l'être dans son enfer, quoi qu'il en frémisse de rage», p. 151) et comme le Monarque des Amériques auquel Christophe Colomb ravira des millions d'âmes.»
Je n'ai sans doute pas besoin de rappeler les nombreuses similitudes que la peinture du Mal proposée par Bernanos entretient avec celle de Léon Bloy, que je viens d'évoquer. Le lecteur intéressé par cette question pourra se reporter à la longue étude que je fis paraître dans les Archives Bernanos en 2009, et dont voici les deux premières pages. D'emblée, affirmons que les caractères sataniques que sont le désespoir mais aussi l'irrévocabilité (l'un et l'autre pouvant du reste être confondus) ont joué à bloc, pour ainsi dire, contre Mouchette, dont le destin, Bernanos n'a pas manqué de le signifier plusieurs fois (3), était tracé par avance.
Il y a plus bien sûr car, fidèle à Léon Bloy, Georges Bernanos, dans son premier roman, n'a de cesse de rappeler que nous ne pouvons en aucun cas confondre la réalité de Satan avec quelque belle image romantique, donc édulcorée. Le Démon selon Bernanos est le Premier des Anges, le plus puissant, mais déchu, auquel il fait dire : «Vous ignorez tout de nous, petits dieux pleins de suffisance. Notre rage est si patiente ! Notre fermeté si lucide !» (p. 183). Tout au long de son crépusculaire premier roman, Georges Bernanos n'hésitera jamais à nous avertir que nous nous faisons du Mal une idée totalement édulcorée, et c'est Léon Bloy qui, bien évidemment, lui aura ouvert la voie, qui lui-même écrivait : «Le mal est plus universel et paraît plus grand, à cette heure, qu'il ne fut jamais, parce que, jamais encore, la civilisation n'avait pendu si près de terre, les âmes n'avaient été si avilies, ni le bras des maîtres si débile. Il va devenir plus grand encore. La République des Vaincus n'a pas mis bas toute sa ventrée de malédiction» (p. 234). Citons par exemple ce fameux passage de Sous le soleil de Satan, dont la colère et la puissance frappent : «O vous, qui ne connûtes jamais du monde que des sons sans substance, cœurs sensibles, bouches lyriques où l'âpre vérité fondrait comme une praline – petits cœurs, petites bouches – ceci n'est point pour vous. Vos diableries sont à la mesure de vos nerfs fragiles, de vos précieuses cervelles, et le Satan de votre étrange rituaire n'est que votre propre image déformée, car le dévot de l'univers charnel est à soi-même Satan. Le monstre vous regarde en riant, mais il n'a pas mis sur vous sa serre. Il n'est pas dans vos livres radoteurs, et non plus dans vos blasphèmes ni vos ridicules malédictions. Il n'est pas dans vos regards avides, dans vos mains perfides, dans vos oreilles pleines de vent. C'est en vain que vous le cherchez dans la chair plus secrète que votre misérable désir traverse sans s'assouvir, et la bouche que vous mordez ne rend qu'un sang fade et pâli... Mais il est cependant... Il est dans l'oraison du Solitaire, dans son jeûne et sa pénitence, au creux de la plus profonde extase, et dans le silence du cœur... Il empoisonne l'eau lustrale, il brûle dans la cire consacrée, respire dans l'haleine des vierges, déchire avec la haire et la discipline, corrompt toute voie. On l'a vu mentir sur les lèvres entrouvertes pour dispenser la parole de vérité, poursuivre le juste, au milieu du tonnerre et des éclairs du ravissement béatifique, jusque dans les bras même de Dieu...» (p. 154). Oui, ni Bloy ni Bernanos, donc, ne sont de ceux «qui prêtent naïvement au bourreau familier, présent à chacune de nos pensées, nous couvant de sa haine, bien qu'avec patience et sagacité, le port et le style épiques...» (p. 173), une phrase qui eût pu être écrite à la virgule près par Léon Bloy.
Georges Bernanos, dépeignant Satan, Donissan mais aussi l'état de damnation dans laquelle il semble vouloir s'enfermer volontairement, dépasse à notre sens Léon Bloy, en retrouvant la catégorie kierkegaardienne de l'hermétisme démoniaque. Nous ne revenons pas sur ce qui est à nos yeux un grand sujet d'étude, partiellement évoqué à propos de Monsieur Ouine, et nous contentons de relever quelques exemples de cette thématique dans le premier roman de Bernanos. Ainsi le romancier dit de son prêtre tourmenté qu'il a commis, «délibérément, avec une entière bonne foi, comme une chose simple et commune, une sorte de suicide moral dont la cruauté raisonnée, raffinée, secrète, donne le frisson» (p. 159). Mouchette, elle aussi, qui, une fois son crime commis, se taira, mentira, et ne parlera, presque dans un rêve, qu'à Donissan (cf. p. 201), sombrera dans l'hermétisme démoniaque, comme Bernanos l'écrit sans ambiguïté, avant de se suicider : «Où l'enfer trouve sa meilleure aubaine, ce n'est pas dans le troupeau des agités qui étonnent le monde de forfaits retentissants. Les plus grands saints ne sont pas toujours les saints à miracles, car le contemplatif vit et meurt le plus souvent ignoré. Or l'enfer aussi à ses cloîtres. La voilà donc sous nos yeux, cette mystique ingénue, petite servante de Satan, sainte Brigitte du néant. Un meurtre excepté, rien ne marquera ses pas sur la terre. Sa vie est un secret entre elle et son maître, ou plutôt le seul secret de son maître. Il ne l'a pas cherchée parmi les puissants, leurs noces ont été consommées dans le néant», Bernanos ajoutant, quelques lignes plus bas, à propos de Satan que, si loin «qu'il pousse la ressemblance de Dieu, aucune joie ne saurait procéder de lui, mais, bien supérieure aux voluptés qui n'émeuvent que les entrailles, son chef-d’œuvre est une paix muette, solitaire, glacée, comparable à la délectation du néant» (p. 213).
Donissan lui aussi pourrait être analysé par le biais de cette même catégorie de l'hermétisme démoniaque, car nous savons que son don de vision est trouble, car nous savons qu'il a voulu chasser toute joie de son cœur, car nous savons que, folie parmi les folies, mais la plus incommensurablement grave, il a offert son propre salut, comme il finira par l'avouer au doyen de Campagne, Menou-Segrais (cf. p. 227) pour tirer de l'Enfer les pécheurs. Le doyen de Campagne ne pense-t-il pas que son cher protégé, l'abbé Donissan, porte dans sa «vie intérieure un secret, mieux gardé par [son] ignorance et [sa] bonne foi que par n'importe quelle duplicité» (p. 227) ? Notre prêtre insatiable veut, lui, je l'ai dit, s'enfoncer dans les noires profondeurs : «Ce n'est plus ce cloître qu'il désire, mais quelque chose de plus secret que la solitude, l'évanouissement d'une chute éternelle, dans les ténèbres refermées» (p. 237) car, en effet, Donissan n'est pas loin de «cette minute où Satan pèse de tout son poids, où s'appliquent au même point, d'une seule pesée, toutes les puissances d'en bas» (p. 238). Donissan, Bernanos insiste plusieurs fois sur ce trait de caractère, n'a pas pour habitude de s'ouvrir aux autres car «cet homme étrange, où tant d'autres se déposèrent comme un fardeau, eut le génie de la consolation et ne fut jamais consolé» (p. 242), lui dont la vie a été «consommée dans la solitude et le silence, à jamais scellée» (p. 250), autant de phrases qui me font immédiatement penser, hormis bien sûr aux exemples de l'ancien professeur de langues, Ouine et à celui de Cénabre, au stupéfiant dialogue inventé par Arthur Machen dans une de ses plus noires et somptueuses nouvelles, Le Peuple blanc.
Le Démon, enfin, parce qu'il jouit du plus haut degré de conscience, est aussi, comme chez Kierkegaard, celui qui sera le plus hermétiquement refermé sur sa rage, ainsi que Bernanos le fait dire à Donissan, qui par cette dure parole arrache à la pauvre Mouchette ce qu'elle croyait être à elle, un meurtre, des mensonges, un vice, qui tous auront d'autres pères et mères, ses propres ancêtres que Donissan verra comme dans une espèce de grandiose récapitulation du Mal (cf. p. 205), mais qui tous n'auront néanmoins qu'un seul Père : «Qu'avez-vous donc trouvé dans le péché qui valût tant de peine et de tracas ? Si la recherche et la possession du mal comportent quelque horrible joie, soyez bien sûre qu'un autre l'exprima pour lui seul, et la but jusqu'à la lie» (p. 200).
Georges Bernanos lecteur du Désespéré de Léon Bloy : la veine polémique, et plus encore
La veine polémique, pour le dire schématiquement, est présente dans le moindre texte de Léon Bloy, mais c'est peut-être dans Le Désespéré qu'elle atteint l'un de ses sommets (4). C'est peu dire que nous retrouvons dans le premier roman de Georges Bernanos bien des traits qui se fichaient sur d'innombrables cibles dans le célèbre texte de Léon Bloy, notamment ceux qui concernent la bêtise des prélats et des prêtres, incapables par exemple de reconnaître quel mystère, celui de la sainteté bien sûr, cèle le cœur du si maladroit et grossier abbé Donissan. Ainsi, si Bloy peut écrire qu'«En général, le Clergé français n'aime pas les saints ni les apôtres. Il ne vénère que ceux qui sont morts depuis longtemps et en poussière» (p. 101), Bernanos, lui, fera dire à Menou-Segrais, le seul ayant eu «le pressentiment de ce magnifique destin» (p. 158) de Donissan, qu'«Ils ne reconnaissent jamais rien», et qu'«Ils n'ont pas su reconnaître le plus précieux des dons de l'Esprit», car c'est «Dieu qui nous nomme», poursuit le directeur spirituel de celui qui deviendra le curé de Lumbres, rappel évident de Bloy, précisant que le «nom que nous portons n'est qu'un nom d'emprunt» (p. 133, l'auteur souligne). Je puis me tromper, mais je n'ai jamais vu qu'un rapprochement ait été opéré entre l'abbé Menou-Segrais, qui ne cesse de se lamenter de la stupidité et de la trouille de ses confrères, qui déclare avoir «vu poursuivre l'homme supérieur comme une proie» et avoir «vu émietter les grandes âmes» (p. 122), Menou-Segrais encore qui, très bloyennement, affirme que «le nom que nous portons n'est qu'un nom d'emprunt» et celui qu'évoque Léon Bloy dans son roman, affirmant ainsi que «L'abbé T... était mort à la peine, peu après la rencontre du Périgourdin. Écarté soigneusement de toutes les chaires où ses rares facultés de prédicateur apostolique eussent pu servir à quelque chose, navré du cloaque de bêtise où il voyait le monde catholique s'engouffrer, abattu par le chagrin au pied de l'autel, il avait à peine eu le temps d'ensemencer ce vivipare dont la monstrueuse fécondité immédiate eût peut-être suffi pour le faire expirer d'effroi» (p. 101).
Bien d'autres rapprochements pourraient être opérés, qui non seulement ressortiraient de la veine polémique que nous avons indiquée mais, plus subtilement, ne pourraient qu'intéresser les lecteurs du premier roman de Georges Bernanos, car ils ne peuvent qu'évoquer tel trait de caractère de Donissan, thaumaturge dont le seul miracle a été tourné en ridicule par Satan (Bloy : «Cette frêle créature devait normalement expirer bientôt sur le cœur du malheureux homme qui ne pouvait pas être le thaumaturge qu'il aurait fallu pour l'empêcher de mourir», p. 119), ou bien, et là encore Georges Bernanos saura s'en souvenir, parce que les propos de Marchenoir grondent contre les esthètes, comme l'illustre Antoine Saint-Marin qui manquera défaillir en voyant, sur l'un des murs de la cellule de Donissan, une très épaisse tâche de sang, preuve des mortifications que s'infligera le pauvre prêtre : «Être saint ! cria Marchenoir, comme en délire, qui peut l'espérer ?... Job, dont on célèbre la patience, a maudit le ventre de sa mère, il y a quatre mille ans, et il faut des centaines de millions de désespérés et d'exterminés pour faire la bonne mesure des souffrances que l'enfantement d'un unique élu coûte à la vieille humanité !...» (p. 140, l'auteur souligne).
Souvenons-nous que Donissan, présenté comme un rustre par Menou-Segrais qui a toutefois compris, seul parmi ses distingués confrères, quel drame inouï se jouait au plus profond de l'âme de son balourd protégé, a toujours été un cancre mais que, une fois que Menou-Segrais l'aura mis sur la voie qui sera jusqu'au bout la sienne, la grâce contournera subtilement ses carences intellectuelles, et lui donnera même une espèce de don de parole, non point d'art oratoire ni même d'éloquence inspirée, car c'est pitié d'écouter Donissan en chaire, mais de verbe secouant les pauvres badauds jusqu'aux entrailles (cf. p. 138) : Léon Bloy, ainsi, écrit de Marchenoir que «Cette faculté [oratoire], tout à fait supérieure en lui, avait eu le développement tardif de ses autres facultés. Longtemps il avait eu la bouche cousue et la langue épaisse. Sa timidité naturelle, une compressive éducation, puis l'étouffoir de toutes les misères de sa jeunesse avaient exceptionnellement prolongé pour lui le balbutiement de l'enfance. Il avait fallu la décisive rencontre de Leverdier et la nouvelle existence qui s'ensuivit, pour lui dénouer à la fois le cœur, l'esprit et la langue» (p. 144).
Souvenons-nous que Donissan, comme Marchenoir, n'est point fait pour le clergé régulier, comme ne manquera pas de le lui répéter Menou-Segrais, mais pour le combat de rue si je puis dire, et même pour la guerre, puisque «chaque détour de sa route sera marqué d'un flot de sang» (p. 147), il est fait pour la rencontre avec Satan après s'être perdu sur un chemin qu'il connaissait pourtant : «Mon père, dit-il un jour, croyez-vous, en conscience, que la vie religieuse régulière me soit décidément et absolument interdite ?» (p. 145) demande ainsi Marchenoir, la réponse du prêtre ne faisant aucun doute, comme celle de Menou-Segrais ne fera aucun doute (cf. p. 127).
Mouchette, pour laquelle Bernanos aura tant de mots justes et tendres, et qu'il ne manquera pas de retrouver une dernière fois, quelques années après avoir raconté sa tragique destinée dans son premier roman, semble aussi avoir été préfigurée dans le roman de Léon Bloy, en la personne de la femme, d'abord putain, aimée par Marchenoir : «La pauvre fille, il la voyait vierge, tout enfant, sortant du ventre de sa mère. On la salissait, on la dépravait, on la pourrissait devant lui. Cette âme en herbe, cette fille verte, comme ils disent dans la pudique Angleterre, était bafouée par un vent de pestilence, piétinée par d'immondes brutes, contaminée avant sa fleur» (p. 154). Pareillement, plusieurs commentateurs ont insisté sur la nécessité, pour Donissan, de rencontrer Mouchette, après avoir d'ailleurs rencontré le Démon, les deux destinées étant invisiblement liées, comme l'est celle de Marchenoir à la pécheresse : «Un inexplicable lien de destinée, contre lequel il se fût vainement raidi, le faisait époux de cette chair qui s'était débitée comme une denrée et, par conséquent, solidaire de la même balance, dans la parfaite ignominie des mêmes comptoirs...» (p. 155).
Bien des passages du Désespéré (5) résonnent encore dans le premier roman de Georges Bernanos, même s'il ne s'agit que de critiques adressées au clergé devenu très laïquement humaniste, aux écrivains naturalistes, «détrousseurs de documents humains» (p. 249), à ces fins esprits qui firent «du problème de l'être un divertissement d'honnêtes gens» (p. 255) et qui ne savent rien de Satan, puisqu'ils «ont lu trop de livres, et n'ont pas assez confessé» (p. 257), à tel «illustre vieillard», Saint-Marin, qui «exerce depuis un demi-siècle, la magistrature de l'ironie» (p. 280) et qui comme nul autre «n'a défloré plus d'idées, gâché plus de mots vénérables, offert aux goujats plus riche proie" (p. 281), ou bien encore à une élite littéraire et intellectuelle qui n'a pas su parler aux enfants humiliés, à «la jeunesse décimée, qui vit Péguy couché dans les chaumes, à la face de Dieu [qui] s'éloigne avec dégoût du divan où la supercritique polit ses ongles. Elle laisse à Narcisse le soin de raffiner encore sur sa délicate impuissance. Mais elle hait déjà, de toutes les forces de son génie, les plus robustes et les mieux venus du troupeau qui briguent la succession du mauvais maître, distillent en grimaçant leurs petits livres compliqués, grincent au nez des plus grands, et n'ont d'autre espoir en ce monde que de pousser leur crotte aigre et difficile au bord de toutes les sources spirituelles où les malheureux vont boire» (pp. 297-8).
Après avoir lu un tel roman dont nous évoquerons bientôt la dimension apocalyptique, assez peu commentée à nos yeux, après avoir noté quelques troublantes parentés entre ce dernier et deux textes majeurs de Léon Bloy, nous pouvons affirmer que ce n'est pas seulement le témoignage du saint, fût-il de papier comme Donissan, qui «est comme arraché par le fer» (p. 308, l'auteur souligne), mais celui de ce prodigieux écrivain qu'est Georges Bernanos qui, je ne cesse de le répéter, est devant nous, même si la majeure partie des travaux universitaires qui lui sont consacrés, aujourd'hui, referment sur lui, pieusement, une chape de gloses le plus souvent aussi prétentieuses qu'inutiles.
Notes
(1) Voir par exemple : «Les deux écrivains insèrent la Passion du Christ au cœur même de leur création littéraire, mais plus que Bloy Bernanos soulignera la réalité mystérieuse de la Résurrection. Et si les deux hommes attendent avec une impatience passionnée d'aborder au rivage du royaume de Dieu, on peut semble-t-il écrire que Bernanos est davantage un homme du Christ, Bloy un homme de l'Esprit saint», in Michel Estève, Bernanos. Un triple itinéraire (Minard, 1987), p. 82. Le texte cité se trouve aux pages 69 et 70 de Sous le soleil de Satan (Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1974). Sans autre précision, les pages entre parenthèses renvoient toujours à cette édition, la seule qui trouve grâce à mes yeux.
(2) Léon Bloy, Œuvres, tome 1, contenant Le Révélateur du Globe, Christophe Colomb devant les taureaux et Lettre encyclique, Introduction, p. 16 (édition établie par Joseph Bollery et Jacques Petit, Mercure de France, 1964).
(3) «Sa déception fut si forte, son mépris si prompt et décisif qu'en vérité les événements qui vont suivre étaient déjà comme écrits en elle", in op. cit., p. 83.
(4) Léon Bloy, Le Désespéré (dans l'excellente édition, comme toujours, donnée par Pierre Glaudes pour la collection GF, Flammarion, 2010). Dans cette partie consacrée au Désespéré, les pages entre parenthèses renvoient à notre édition.
(5) Citons ce passage, entre mille autres, qui concerne Louis Veuillot, qui semble anticiper les très dures critiques que Georges Bernanos portera contre Charles Maurras : «Louis Veuillot, repartit aussitôt Marchenoir, est arrivé au bon moment. La France, alors, n'avait pas troqué les ailes de l'Empire contre les nageoires de la République et le métier d'homme n'était pas encore devenu tout à fait impossible. Si le personnage avait eu autant de grandeur que de force, le christianisme éclatait peut-être partout, car il y eut une heure d'anxiété suprême où l'âme errante du siècle pouvait aussi bien tomber sur Dieu que «sur elle-même». tel fut le pouvoir abandonné à ce condottière dont la vanité goujate et médiocre eût avili jusqu'au martyre. Aucun laïque n'a jamais eu et n'aura, sans doute, jamais, ses ressources et son immense crédit catholique, qui ont été jusqu'au dernier épuisement de la libéralité des fidèles» (p. 286).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, georges bernanos, sous le soleil de satan, léon bloy, le désespéré, christophe colomb devant les taureaux, paul-jean toulet, le grand dieu pan, monique gosselin-noat, ernst jünger, le cœur aventureux, blaise cendrars, moravagine, arthur machen, le peuple blanc |  |
|  Imprimer
Imprimer


























































