« Orpaillages, ou les tribulations héroïcomiques d'un manuscrit de critiques littéraires en France, phare universel de la littérature parisienne | Page d'accueil | Défense et illustration de la novlangue française de Jaime Semprun »
29/03/2017
Le Cannibale de John Hawkes

Photographie (détail) de Juan Asensio.
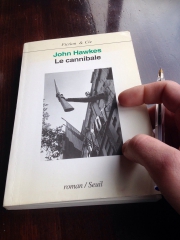 Acheter Le Cannibale sur Amazon.
Acheter Le Cannibale sur Amazon.Paru en 1949, The Cannibal de John Hawkes (1) étonne par sa structure très fortement elliptique, le passage d'une scène à l'autre étant quasiment bien souvent inexistant, et sa noirceur que nous pourrions dire trakléenne, puisqu'elle est hantée par le lent mais inéluctable pourrissement du monde, pas seulement celui de l'Allemagne (précisément : Spitzen-sur-le-Dein), qui est le théâtre dévasté que parcourent nos personnages en charpie, allant dans l'obscurité à leurs noirs desseins, Stella Snow et sa sœur, Jutta, le fils de celle-ci, poursuivi par le duc, mais aussi le narrateur, Zizendorf, conspirateur du nouveau Reich et amant de Jutta, Balamir le fou ou même Leevey, le motard américain qui sera tué par Zizendorf et deux hommes de main, cet assassinat devant signer le premier jour du renouveau politique de l'Allemagne défaite.
Il faut au moins relire ce livre avant de pouvoir en donner un peu plus que des impressions fugitives mais néanmoins justes, évoquées plus haut, lecture et relecture que Pierre-Yves Pétillon a dû visiblement faire si j'en juge par les quelques lignes puissantes et suggestives qu'il a consacrées à ce noir roman dans sa remarquable somme sur la littérature nord-américaine.
Rappelant qu'un passage de cet étrange roman de John Hawkes n'est qu'un écho du sermon sur la Nativité écrit par Lancelot Andrewes que reprendra T. S. Eliot dans sa Journée des Mages (2), Pierre-Yves Pétillon cite plusieurs fois le grand poète, mais aussi Malcolm Lowry, car Le Cannibale présenterait selon lui, comme Sous le volcan «une vision à la fois panoramique et hallucinée de l'Histoire» (3), mais l'excellent connaisseur de la littérature nord-américaine qu'est Pétillon ne cite point en revanche d'autres textes auxquels le roman de Hawkes me semble plus directement s'apparenter même si, peut-être, l'écrivain ne les a point lus (Pétillon, lui, semble avoir tout lu !), à savoir Monsieur Ouine de Georges Bernanos et Connaissance de la douleur de Carlo Emilio Gadda. Dans ces trois romans, le Mal, difficilement identifiable (l'ancien professeur de lettres est-il un meurtrier, le duc est-il un véritable cannibale, etc. ?) est partout, fait gonfler la substance du monde comme une éponge gorgée de fiel qu'il suffirait de presser pour, en recueillant le liquide puant, tenter d'en identifier la nature exacte. La nuit, la tombée de la nuit souvent, y sont également omniprésentes, la lumière chiche étant paradoxalement compensée par la crudité de certaines images, quasiment gravées à contre-nuit dans le roman de Hawkes, où une «vache morte dans un champ [est] comme un morceau de marbre» (p. 21).
Très visuelles, les images crépusculaires du Cannibale, le plus souvent sordides, font songer à un film de Béla Tarr, Damnation pourquoi pas, à moins qu'il ne nous faille plus directement puiser dans les visions cauchemardesques rapportées par plusieurs témoins sillonnant l'Allemagne vaincue au sortir de la Seconde Guerre mondiale, recueillies dans un ouvrage dirigé par Hans Magnus Enzensberger et intitulé, significativement, L'Europe en ruines. Témoignages oculaires, 1944-1948 (Actes Sud/Solin, 1995). Voici de quelle sombre manière le décor est planté dans le texte de Hawkes : «Librairies et pharmacies avaient été détruites, et le vent feuilletait brutalement les pages des livres ouverts tandis que, s'échappant des flancs crevés de boîtes de papier décorées, une poudre légère à bon marché volait par les rues comme une neige fine» (p. 15). Voici encore dans quelle veine expressionniste s'exprime assez souvent l'écrivain : «La ville, sans murs ni barricades, quoique toujours lieu de campement millénaire, était aussi ratatinée dans sa structure, aussi décomposée qu'une langue de bœuf noire de fourmis» (p. 19).
 D'ailleurs, nous retrouvons la langue pour une tout autre affaire, qui elle aussi signe la ruine de l'Allemagne et, plus largement, de l'Occident tout entier, dont l'histoire profonde, par le biais d'un passé aussi lointain que paradoxalement vivace (cf. p. 59) et qui plus d'une fois refait surface (cf. p. 140), est assez souvent rappelée : c'est ainsi qu'à de nombreuses reprises l'auteur affirme que les moyens de communication, et d'abord l'imprimerie, sont détruits (cf. pp. 20, 21, 22), mais aussi, plus largement, que le langage lui-même est devenu caduc, puisqu'il est incapable de raconter ce qui a eu lieu durant la guerre (cf. p. 26), certaines chansons des temps heureux étant devenues «inchantables» (p. 28), tous étant devenus taciturnes, «le cri de la tribu s'étant éteint depuis longtemps sur leur langue roulante» (p. 27), alors même que les mots «ne voulaient pas venir» (p. 28).
D'ailleurs, nous retrouvons la langue pour une tout autre affaire, qui elle aussi signe la ruine de l'Allemagne et, plus largement, de l'Occident tout entier, dont l'histoire profonde, par le biais d'un passé aussi lointain que paradoxalement vivace (cf. p. 59) et qui plus d'une fois refait surface (cf. p. 140), est assez souvent rappelée : c'est ainsi qu'à de nombreuses reprises l'auteur affirme que les moyens de communication, et d'abord l'imprimerie, sont détruits (cf. pp. 20, 21, 22), mais aussi, plus largement, que le langage lui-même est devenu caduc, puisqu'il est incapable de raconter ce qui a eu lieu durant la guerre (cf. p. 26), certaines chansons des temps heureux étant devenues «inchantables» (p. 28), tous étant devenus taciturnes, «le cri de la tribu s'étant éteint depuis longtemps sur leur langue roulante» (p. 27), alors même que les mots «ne voulaient pas venir» (p. 28).Le langage n'est plus de mise, hormis peut-être celui, arme de propagande («le hangar était quasiment prêt pour la composition et l'impression de la parole», p. 218), par lequel le rédacteur Zizendorf, factieux qui jamais ne prétendra avoir les mains propres (cf. p. 216), désireux de fomenter le coup de force contre l'envahisseur nord-américain et de réimposer la puissance de l'Allemagne éternelle, prétend reconstruire, par la violence, ce qui a été détruit (cf. p. 220) et, pas plus que le langage, la raison n'est présente, puisque nous suivons le personnage Balamir, fou échappé d'un asile à l'abandon, alors même que l'«Allemagne entière» tournait autour de lui, lui, le fou qui «avait les pieds dans les bottes d'un prince», et «sentait battre contre sa hanche l'épée du temps, des éléments et de la force» (p. 31).
Une fois que le langage est en partie disloqué, le paysage dévasté étant rempli de pans de murs où, «tracés à la craie, des fragments de communiqués des armées alliées alors en pleine mêlée et assez inquiètes» (p. 44) finissent de se dissoudre, alors même qu'il n'y a plus rien à dire, «quand personne ne pouvait comprendre qu'avait été balayé le grand idéal révéré" (p. 47), le Mal peut surgir et s'en donner à cœur joie, apparaissant même sous les traits habituels d'un Méphistophélès qui, «tapi dans une sacristie, cerclait de rouge ce dix-huitième jour du mois» (p. 64) ou bien sous ceux d'un «terrible petit démon à qui sa douleur atroce recroquevillait les petites mains aux paumes tournées vers l'extérieur» (p. 114), ou encore sous ceux de «l'ange noir» (cf. p. 147) ayant des «cornes terribles, atroces, de petits moignons déformés qui sortaient de son front ridé», «la flûte qu'il tenait dans ses mains rougeoyantes» étant «celle du péché» (p. 154). C'est une "pestilence universelle» (p. 68) qui ravage l'Europe, les Suisses dévalant «leurs montagnes en glissant sur le derrière, les Anglais secoués par les vagues de la Manche, et le reste des nations» (pp. 67-8) suivant le mouvement, initié par le meurtre de l'archiduc héritier de l'Empire austro-hongrois, François-Ferdinand, par l'assassin Gavrilo Princip qui est directement évoqué en tant que personnage d'une scène hallucinatoire (cf. p. 126) : «Lorsque les gens, le peuple de Bosnie, d'Autriche et la monarchie de Habsbourg s'aperçurent de ce qui s'était passé, ils provoquèrent au-dessus du cadavre de Ferdinand un ébranlement impersonnel, silencieux et qui fit tache d'huile» (pp. 75-6).
Cet ébranlement, que l'auteur fait remonter loin puisqu'il évoque la date de 1870 (cf. pp. 88-9), est celui du fanatisme, soit «la longue chaîne de virus qui tient un homme ancré à sa nation» (p. 121), incarné par Zizendorf mais aussi, semble insinuer le romancier, par tout Allemand digne de ce nom : «L'esprit qui a été conquis reste non seulement au repos mais dans l'attente, profondément marquée par les rides de la privation, par les doigts qui refusent tout labeur, de l'unique chose qui le soulèvera, l'agrandira, le libérera» (p. 81).
Il n'est donc absolument pas étonnant que dans cet univers cassé (4) de l'immédiat après-guerre Seconde Guerre mondiale, où «Krupp, un barbare, sans doute, est davantage la cheville ouvrière de l'Histoire qu'un père qui jadis parlait d'honneur» (p. 74), où les digues de la Raison cèdent devant la puissance d'un «mouvement de masse plus vaste qu'une nation» (p. 120), où l'Allemagne semble incapable de se défaire de ses démons qui paraissent avoir complètement cristallisé la nation (cf. p. 39), le cannibalisme puisse exister, d'abord mentionné de façon anecdotique (cf. pp. 97-8), puis incarné dans la longue traque, qui se poursuit durant tout le roman, du jeune garçon par le mystérieux Duc, qui tuera sa proie et la dévorera, sans que nous sachions vraiment s'il s'agit d'un enfant ou bien d'un renard (cf. pp. 38, 52, etc.), ou même si c'est l'esprit du Duc qui ne parvient même plus à faire la distinction entre un animal et un petit homme : «Le duc remit la lame au fourreau et s'en fit une canne dont il accrocha la poignée à son bras. Il rassembla les organes et les morceaux déchiquetés dans la petite veste noire du renard dont il noua ensemble les manches et les coins, utilisa sa canne comme un bâton et remonta lourdement la côte, ses longues jambes de Habsbourg se démenant avec entrain. Il laissa derrière lui une flaque de déchets, comme un chat qui aurait attrapé une corneille égarée dans les champs» (p. 229).
Ce meurtre a valeur de symbole, comme l'est l'embuscade que trois conjurés (présentés comme des «sentinelles», p. 180) dressent à un motard nord-américain, laquelle semble annoncer un avenir plus noir encore que ne l'est le présent de la dévastation dans lequel fomentent et tuent nos meurtriers, obéissant à la maxime selon laquelle on ne peut «demander à nul homme d'abandonner sa civilisation, c'est-à-dire sa nation» (pp. 167-8) : «Des champs jonchés de débris et des branches qui les ombrageaient, de la librairie municipale en cendres, non expurgée, des radeaux pneumatiques crevés qui obstruaient le canal, aux bouches pendantes, aux couleurs de l'ennemi, aux mines non explosées, aux fonctionnaires ivrognes et à la vérole, planait un désespoir sans nom, non admis, non reconnu, qui persistait par-delà la prostituée enchaînée et les bulletins d'information ennemis, par-delà les maisons cadavéreuses et les avant-postes américains, à nous donner des forces, à nous sentinelles menaçantes, et à alimenter les bavardages des historiens nonchalants» (p. 167).
La nonchalance, plus encore que la faiblesse, est un luxe impitoyable, face à une insurrection qui doit être «victorieuse, inspirée, impitoyable» (p. 186), puisque le coup d'envoi a été donné (le meurtre de l'Américain), le «nouveau plan de campagne» commençant à se dérouler comme prévu qui «couvrait, en gros et en détail, le pays jusqu'à ses frontières, avec la victoire pour but» (p. 213), victoire qui selon toute apparence n'est qu'un leurre, comme semblent l'indiquer les toutes premières lignes du roman, sorte d'exergue dont le narrateur n'est pas précisé (mais on se doute qu'il s'agit de Zizendorf), lequel évoque telle ville d'Allemagne «qui par un grand effort est parvenue à se hausser au-dessus des malheurs qui se sont abattus sur les communautés vaincues du continent» (p. 9, le passage est en italique), notation bien mystérieuse qui semble affirmer que la ville dirigée par Zizendorf est devenue une espèce d'îlot totalitariste survivant au milieu du chaos, un laboratoire qu'il convient de garder secret, comme si une main de fer pouvait seule garantir que la corruption, comme tant de ces «gros titres d'autrefois, simples mots de métal brisé» (p. 210) qui jonchent le sol, ne pénètre pas dans le camp des derniers résistants, fous ou braves, braves et fous, derniers rêveurs fanatisés ayant conduit le monde à sa presque totale destruction.
Notes
(1) John Hawkes, Le Cannibale (Seuil, 1992). Sans autre précision, les pages indiquées entre parenthèses renvoient à notre édition.
(2) «A cold coming we had of it, / Just the worst time of the year / For a journey, and such a long journey : / The ways deep and the weather sharp, / The very dead of winter». Par deux fois John Hawkes évoque indirectement ces vers, aux pages 199 et 210.
(3) Pierre-Yves Pétillon, Histoire de la littérature américain. 1939-1989 (Fayard, 2003), p. 117.
(4) Monde cassé dont la description sordide est encore accentuée par la relative pureté du deuxième chapitre, évoquant des faits qui remontent à 1914. Relative car, une fois de plus, John Hawkes, en encadrant ce chapitre de deux autres qui évoquent des faits datés de 1945, semble vouloir signifier que la chaîne du Mal ne peut être cassée.






























































 Imprimer
Imprimer