Rechercher : Proust
Dreuse de Louis Jeanne

 À propos de Louis Jeanne, Dreuse (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2012).
À propos de Louis Jeanne, Dreuse (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2012).Qu'est-ce donc que Dreuse, le premier roman de Louis Jeanne ?
À cette question, Michel Marmin répond, dans un entretien avec Rémi Soulié (paru dans le numéro 144 de la revue Éléments), en affirmant qu'il s'agit d'un «admirable premier roman» «où, par delà les décombres de la cité et la déchéance de ceux qui la peuplent, le réenchantement de la langue est consubstantiel au retour du mythe».
Cette langue ainsi réenchantée, il est vrai que la quatrième de couverture dudit roman nous la présente comme étant faulknérienne puisqu'il suffit sans doute, dans l'esprit de celui qui l'a rédigée, de dépasser l'empan d'une phrase composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément, pour mériter ce qualificatif glorieux et intimidant.
Je serai beaucoup moins élogieux que Michel Marmin (avec quelques autres, tout pressés de saluer un livre meilleur que bien d'autres qui ont paru durant cette rentrée dite littéraire, pas nécessairement bon pour autant) qui, sans doute, a oublié de vraiment lire ce premier roman pour ce qu'il est, non pas un roman après tout plaisant à lire, dont certaines pages sont belles qui le nierait, et même intéressant mais la mort de tout roman, c'est-à-dire : une œuvre à thèse.
Celle de Louis Jeanne est simple, précise, nette, aussi simple et précise que ses phrases sont longues et, souvent, peu nettes, en tous les cas jamais vraiment faulknériennes, en cette qualité qui paraît les avoir rendues primitives, instinctives, toutes préoccupées d'avancer et de dire et non d'expliquer ou plutôt, d'expliciter, d'illustrer : la France (un certain art de vivre, une certaine façon de se tenir dans et par la langue, une certaine façon de bien vivre, cuisiner, parler, se vêtir, prendre sa douche, faire l'amour, se moucher, etc.) n'existe plus ailleurs que dans tel coin reculé de sa campagne la moins exposée aux ravages d'une époque honnie.
Il se pourrait, à dire vrai, qu'une autre thèse, plus discrète, moins directement appuyée, infuse les pages du texte de Louis Jeanne : Hadrien Dreuse seul maintient la pureté de la langue, qui parle peu et, surtout, qui publie des textes qui jamais ne paraîtront. Nous savons l'époque obsédée par la figure mystérieuse de Bartleby le scribe, plus pathétique et digne de commisération, par exemple lorsqu'elle est exposée en des centaines de lettres déchirantes, par un Vincent La Soudière, que sujette à un culte qui pourrait s'apparenter à celui de l'impuissance.
Lisant ce roman, j'ai songé à plusieurs images susceptibles de le décrire : tout d'abord, s'impose, avec Dreuse, le personnage principal, quelque lointain descendant du Durtal de Huysmans, l'inquiétude métaphysique en moins, la curiosité insatiable aussi, un Durtal qui se serait égaré, plutôt que dans le logis bienfaisant du sonneur de cloches Carhaix de Là-bas, dans la maison d'En rade, au milieu de paysans qui, contrairement à la vision cauchemardesque développée par Huysmans, représenteraient le dernier reste d'humanité digne d'éloge.
D'autres influences, beaucoup moins littéraires, peuvent être suggérées, puisque de nombreuses pages contre la laideur des banlieues (cf. p. 153), la mode immonde des graffitis (cf. p. 155), celle des baladeurs et des téléphones portables, l'atrocité infernale que constitue un déplacement en métro dans une grande ville (Paris, bien sûr), la faillite de l'enseignement tel qu'il est dispensé dans des établissements qui ne méritent plus le nom d'école, etc., ne peuvent que nous faire songer à un Richard Millet éructant contre la décadence de sa chère patrie, blanche et chrétienne, ou à un Renaud Camus pestant, en laborieuses circonlocutions bien incapables de nous cacher la trouille et la haine qui constituent les tripes transparentes de ce tout petit monsieur, contre ce qu'il nomme le Grand Remplacement ou encore enfin, et c'est peut-être la référence la plus littéraire de notre sainte trinité de gardiens de la pureté française, à Alain Finkielkraut analysant la déconfiture morale, intellectuelle et même spirituelle de notre cher pays, naguère phare de l'humanité, devenu à présent son cloaque.
C'est beaucoup mais, hélas, très peu, d'un point de vue strictement littéraire, pour un premier roman, et un premier roman, je le disais, qui n'en est pas vraiment un puisque la moindre de ses phrases (il s'agit là d'un euphémisme, les phrases de Jeanne s'étendant souvent sur des pages entières; son faulknérisme, je suppose...) nous martèle l'antienne convenue que tout est fichu mon bon monsieur : «[ces récits venus tout droit du XIXe siècle] et dans lesquels ils étaient plusieurs, pauvres bougres, à se mirer la nostalgie, non pas regrettant une époque qui n'était pas non plus radieuse, mais regrettant celle dans laquelle ils étaient plongés comme des survivants, ce qui leur faisait presque dire que la justice sociale n'avait été qu'un attrape-nigaud avec lequel on avait brisé les foules pour mieux les supplicier, invoquant la crise pour rendre tolérables des privations qui ne l'étaient pas, tolérables, aimant ce temps parce que se sentant ficelés dans le leur, prêts, sans l'ombre d'un doute, à être définitivement sacrifiés comme des mémoires trouées, bientôt jetés aux oubliettes de l'Histoire et irrémédiablement, sans que l'époque, la leur, en eût aucun remords, charriés qu'ils seraient bientôt, avait fini par lâcher encore Le Bret, comme des alluvions insignifiantes, tous mués bientôt, sitôt sous terre, en déchets organiques et informes de l'Histoire» (1).
De fait, si certaines pages sont assez belles, surtout celles où Louis Jeanne oublie de stigmatiser les transports en commun (cf. pp. 159-60) et l'incurie de l'École (cf. pp. 169 ou 256) pour s'élever à la déploration du temps passé et perdu (2), si certaines pages, comme celles qui décrivent la rencontre entre Dreuse et son éditrice qu'il aimera durant une seule nuit ou bien celles qui décrivent la stature réelle de Dreuse (3), écrivain dont les textes ont été refusés par cette éditrice qu'il aimera (4), bref, si certaines pages sont belles lorsque Louis Jeanne se contente d'écrire, ce qu'il sait à l'évidence faire, force est de constater que la grande majorité d'entre elles est poussive, ridicule, involontairement comiques, comme d'un Proust ou d'un Claude Simon décrivant en de longues périodes un battement de cil amibien (5), comme celles qui commencent à la page 87 et qui évoquent un Des Esseintes (toujours Dreuse) qui serait à l'aise dans la bucolique maison champêtre de Kerpantric où il ferait son miel du temps qui passe méticuleusement, comme les toutes dernières, d'un grotesque fini (6) et qui signent, à mon sens, la facile capitulation devant la modernité, par le recours au mythe et amalgament, à la mode bretonne si reconnaissable depuis Tristan et Yseult, Barbey et Gracq, comme celles (pp. 105-6) encore qui nous peignent par le menu, c'est le cas de le dire, la recette d'un délicieux lapin bien évidemment préparé à l'ancienne, cette expression nous paraissant constituer le sésame ouvre-toi de la pensée et de l'écriture de Louis Jeanne, telles que celles évoquant les ablutions matinales du personnage principal (cf. pp. 138-9) et, je l'ai dit, toutes celles enfin qui n'en finissent pas de pester contre les laideurs et les promiscuités de la vie moderne, comme si Renaud Camus, enfin, avait acquis un certain souffle littéraire en décollant son nez de son nombril et nous livrait le roman faulknérien du Gers, dernier refuge de la culture et de l'humanisme (voire de l'humanité), face aux hordes déchaînées de la Laideur et de la Nocence universelles.
Notes
(1) Louis Jeanne, Dreuse (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2012), pp. 38-9.
(2) «Repoussant le journal, il avait soudain ressenti la rouillure du monde, l'égarement de l'époque, et celle-ci, l'époque, reconduite en lui depuis de nombreuses années avec cette fissure s'accroissant, et ressentant cela bien que n'étant pas, à proprement parler, un passéiste ou un nostalgique invétéré, juste un homme flottant sur des mémoires trouées, cet homme-là, le maire, n'ayant pu comprendre cela qui l'occupait, ce frêle équilibre de la superposition de deux paysages, de deux temps se supportant, quand l'image qui vous a porté et poussé à être ce que vous êtes en grande part s'incline déjà dans les traits mêlés de l'autre, la plus contemporaine, chaque ligne s'évaporant peu à peu, déjà s'effaçant, comme dans les fondus enchaînés du cinéma, cette mort programmée depuis trop longtemps n'ayant rien à voir avec le regret d'une période bénie et disparue, vraiment, côtoyant juste l'effroi de la perdition radicale, en passe de devenir, lui, une victime collatérale d'une histoire sans fond, sans déterminant historique fort, sans événement fondateur, et lui, bien que demeuré en dehors de la vanité, touchant pour prix de cette humilité, construite sur l'évidence du temps, le nom d'une mémoire bientôt épuisée» (pp. 79-80).
(3) «[...] seul le tenant encore son salut particulier, ce qui ne le faisait pas déchoir à ses yeux, sa façon de vivre étant devenue à elle seule une manière de langue morte, un détour prolongé dans la mémoire, dans une lisière persistante, échappant à la grande nuit totale et lumineuse du spectacle» (p. 233).
(4) Pour Dreuse, le texte est «devenu absent parce que plus nécessaire à dire ce qu'il vivait, son retrait, ses émotions, la langue uniquement vouée à la lecture, l'écriture enserrée en lui comme un mystère inavouable, comme on conserve en soi, profondément, la mémoire d'un paysage que l'on sait ne plus devoir traverser» (p. 218).
(5) À force de trop en faire, la structuration implicite de notre langue a vite fait de reprendre le dessus sur le lyrisme, témoin cette drôle de phrase, point incorrecte d'un point de vue grammatical mais assez laide et tortue, marquant un pénible bégaiement : «[...] il ne regrettait pas Kerpantric, devenue terre d'adoption dans laquelle s'était mêlée son autre terre, celle de ses origines, qui le verrait, dans quelques jours, faire halte du côté de ces tombes qui étaient aussi sa vie, la mort étant le second cœur de son existence, cette part de mémoire assimilée qui faisait de lui cet homme terriblement présent au monde, contrairement à ce que sa vie aurait pu laisser croire, les basses évidences étant devenues la fosse commune des idées reçues et qui, avec la bien-pensance, cette morale des bons sentiments fluctuants, étaient devenues les deux cancers les plus purulents de ce bas-monde, devenu bas par manque de clarté et excès d'artifices et de gesticulations» (pp. 163-4).
(6) Dreuse se laisse mourir de froid après avoir fait l'amour à une femme mystérieuse qui aura écrit (et publié, à titre posthume, puisqu'elle se laisse mourir avec son amant) un texte salué par la critique et que par son propre métier (celui de lecteur), Dreuse aura qualifié de remarquable dans une note adressée à son éditrice, celle-là même qui a refusé tous les textes que lui a envoyés Dreuse et avec lequel elle aura pourtant couché, qu'elle finira même par aimer follement et à qui, mais un peu tard, elle reconnaîtra la qualité d'écrivain, vous me suivez ? À ce propos, Claire Vajou Le Tallec (pour le n°27, remarquable au demeurant, de la revue Nunc, juin 2012, p. 157), affirme qu'il n'y a «Rien de passéiste pourtant chez Louis Jeanne, qui possède l’oreille absolue et des moyens littéraires extrêmement sophistiqués, mais qui n’en fait pas une manière, une virtuosité d’apparat». Si un tel livre n'est point passéiste, je me demande bien quel texte, dans ce cas, pourrait être taxé de passéiste aux yeux de Claire Vajou Le Tallec qui me semble également n'avoir point insisté sur cette dimension d'apparat, la prose de Louis Jeanne n'étant, pour l'heure, qu'un moyen d'enrober ses idées.
20/09/2012 | Lien permanent
Céline ou l’indignité du génie, par Thierry Guinhut

07/02/2011 | Lien permanent | Commentaires (16)
Entretien avec Serge Rivron, 2

Rappel
Le texte dont je rêve est là, cher Juan, et il existera forcément, parce qu'il existe depuis la nuit des temps. Il ressemble à ceux qu'ont écrits Ésope, Virgile, Le Tasse, Rabelais, Villon, Dante, Racine, Baudelaire, tant d'autres… Moins ou plus fort, ça dépend toujours du lecteur, de celui qui au final fait «l'écart». Ce n'est pas forcément moi qui l'écrirai. Mais soyez gentil, revenons à nos moutons! La Chair, qui a le mérite d'exister… JA
La Chair ? Mais nous ne l’avons jamais quitté, voyons, ce beau roman ! Un point tout de même : non, trois fois non, il n’y a pas eu que des grotesques ayant désiré écrire le livre total, Le Livre. Je vous rappelle quelques noms tout de même : Canetti, Musil, Broch, Faulkner, Joyce, Melville, Dos Passos, Borges, etc. Un autre point et, promis, nous revenons à notre licorne noire : si la Terre n’est pas totalement explorée (nous sommes même très loin du compte), que faites-vous donc des mondes qui nous entourent ? La conquête de la Lune est pour demain, celle de Mars pour après-demain. Ensuite, qui sait ? Vous ne lisez pas assez de romans de science-fiction et ne paraissez pas être au fait, quoi qu’il en soit, des progrès fulgurants de la conquête spatiale, cher Serge…
Bien, puisque vous êtes pressé de revenir à votre roman (il faut bien, tout de même, que nous empruntions quelques sentiers qui bifurquent, non ?), alors même que nous avons, dans la Zone, tout notre temps, voici une question abrupte : votre livre existe me dites-vous ? Bien sûr, mais vous savez que l’existence d’un livre, hélas, dépend certes du nombre (et de la qualité, mais tout de même de plus en plus du nombre) de ses lecteurs mais aussi, là aussi de plus en plus, de la puissance commerciale de son éditeur. Avez-vous proposé votre Chair à d’autres éditeurs que celui qui a eu finalement le courage, puisqu’il en faut, de publier un tel livre dont le sujet serait… la sainteté ? Celle de Marie je suppose ou bien celle, torturée, inversée, de son fils Michel ?
SR
Que de remarques ! Que de questions ! D'abord, je ne conteste pas que la quête du «Livre Total» – tout de même très «vingtièmiste», vous me le concèderez – n'ait été poursuivie par des écrivains majeurs, et ceux que vous citez en sont évidemment de très bons spécimens (vous auriez pu ajouter Proust). Je tentais simplement d'exprimer ceci qu'au fond le rêve du prochain livre comme «Grand Œuvre», à la fois naïf, un peu bêta, et abruptement prétentieux, outre qu'il me paraît (voyez, je reste prudent maintenant) concomitant à l'histoire d'un siècle, le 20e, particulièrement brutal et nombriliste, ne sert en aucune manière de moteur à mon désir d'écrire. Que le «Grand Œuvre» est toujours derrière nous, et que nos créations prochaines en seraient plutôt une conséquence, un approfondissement. Quant aux «mondes qui nous entourent»… Vous avez parfaitement raison de souligner mon inconnaissance en matière de science-fiction, je n'ai aimé que très peu de romans du genre à part ceux de Van Vogt, certains Philip K. Dick, et Dune, de Frank Herbert. Les livres de science-fiction me font en général bâiller d'ennui dès la sixième page, au moment où les cybers commencent à se révolter parce que ceux de la dernière génération ont senti qu'à l'autre bout de l'espace intersidéral une étrange planète violette était en train de surgir d'un trou noir entièrement peuplée d'une civilisation de droïdes revanchards ayant la capacité de se reproduire par scissiparité. Comme j'avais essayé de l'expliquer il y a quelques années dans les colonnes de votre excellente Zone, je crois l'humain irrémédiablement voué à la Terre, et «les mondes qui l'entourent» ne m'intéressent que dans cette exacte mesure. C'est en ceci que la sainteté me paraît une «entrée» essentielle, qui fait du Ciel l'horizon tellurique de l'humain, qui nous force à approfondir notre relation à la boue qui nous fonde et ne la transmute (peut-être) qu'autant que nous sommes d'ici, et pas des ectoplasmes doués de pouvoirs surnaturels.
Apparemment, cependant, notre époque qui affiche la supériorité absolue de la matière tout en s'ébaubissant paradoxalement de para-normal et d'énergie transcendantale, vieille lune, éternel éther mystique, frisson gratuit des fins de feu de camp, apparemment notre époque ne croit plus une demi-seconde à la possibilité de la sainteté, alors même qu'elle lui doit les deux derniers millénaires de son histoire, et son règne absolu sur toute la planète, quand Memphis, Athènes, Rome et toutes les autres civilisations jusqu'à la nôtre n'avaient pu, à leur apogée, conquérir que des morceaux de territoires continentaux. Cela soulève mon étonnement, et c'est effectivement le sujet principal de La Chair – non pas la sainteté, mais l'exploration des conséquences dans la chair et pour la chair de l'incapacité absolue dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui d'accepter la possibilité de la sainteté. En ce sens, Marie et Michel sont tous deux des figures non pas inversées, mais renversées, de la sainteté. La force qui les habite et les conduit est sans cesse empêchée, contrainte, par celle, incroyablement plus puissante, des constructions que notre époque de grégarité a élaborées pour parer son impuissance à admettre l'impensable qui l'a fait souveraine.
Bon, je ne sais pas si c'est ce qui passe, quand on lit ce bouquin. C'est en tous cas une de ses clés, a posteriori. Un livre ne sera toujours qu'une reconstruction, même et peut-être surtout pour celui qui l'écrit. Je ne suis pas certain, par exemple, que mon éditeur (mes éditeurs, devrais-je dire, parce qu'en plus de Jean-Patrick Péju, le directeur de la collection Les sœurs océanes, qui a le premier accepté ce livre, il a été bien porté par Michèle Narvaez et Jean-Pierre Huguet) ait le sentiment d'avoir édité un livre sur la sainteté. Je suis certain, en revanche, qu'il a été l'un des premiers éditeurs auxquels je me suis adressé à le lire – et sa capacité de lecteur, pour répondre à une de vos nombreuses questions antécédentes, m'intéresse davantage que sa puissance commerciale, hélas fort limitée !
JA
Attendez un peu. Vous me dites que Marie et son fils Michel sont tous deux empêchés de devenir des saints par la force de «constructions que notre époque de grégarité a élaborées pour parer son impuissance à admettre l'impensable qui l'a fait souveraine». Je ne suis pas d’accord avec votre affirmation, et à double titre : d’abord parce que, à mes yeux, Marie est bel et bien une sainte, justement puisqu’elle ignore presque tout de sa condition et paraît s’être engagée dans la «petite voie» chère à Sainte Thérèse de Lisieux. Elle accepte ce que la vie lui réserve, elle accepte même le sacrifice de son propre fils comme s’il s’agissait d’une douce et douloureuse évidence. Ensuite parce que Michel, lui, n’est qu’un homme moderne. Entendons-nous : votre personnage est aussi complexe que vous le souhaitez, peut-être même est-il infiniment plus complexe que le Pernichon moyen hantant nos sociétés, mais il n’est pas un saint. Il est un «homme creux» pour évoquer T. S. Eliot, un «désespéré» selon Bloy, surtout un Des Esseintes ne parvenant guère à s’arracher à la contemplation esthétique. Il est, surtout, je vous cite, un «tricheur» («Qui n’est pas un Saint est un tricheur. Jusqu’à l’abaissement. Jusqu’à la vomissure», p. 23). Où est donc, je vous prie, notre Durtal qui délaissera le démonisme de pacotille pour le silence plénier des monastères ? Je ne l’ai pas trouvé. Je n’ai même pas vu en Michel d’indices nous permettant de supposer qu’il pourrait devenir (voyez comme je suis prudent à mon tour) un saint, même torturé comme Donissan, tant ce personnage me paraît parfaitement incapable de comprendre quelques toutes petites choses essentielles, y compris lorsque sa propre fille les lui assène d’une façon pour le moins… fulgurante ! Vous n’allez tout de même pas me répondre que Michel a été empêché de devenir un saint parce qu’il a trop aimé les femmes ? Et alors je vous prie ? Sainte Thérèse d’Avila a beaucoup aimé les hommes et voyez quelle a été sa carrière !…
Je vais vous le dire sans ambages, cher Serge : je crois que vous avez absolument tout fait, tout ce que le diable de romancier que vous êtes pouvait faire pour que Michel ne devienne pas un saint.
SR
La posture au monde de ce pauvre Michel est extrêmement complexe, je vous le concède aisément. D'abord, parce qu'il est une pure création de mots. Et à ce titre, comme tout personnage de fiction, son destin est tout entier dans la main du diable qui l'agite, un romancier. Ensuite parce que le diable en question, s'étant reconnu il y a longtemps chrétien, puis catholique, et de plus en plus apostolique et romain à chaque fois qu'il essaie un pas vers l'élucidation de sa réalité, l'a mis dans cette situation plutôt limite que, immergé dans une société (la nôtre) absolument imperméable à toute forme de religiosité et plus encore si elle est chrétienne, il serait cependant sommé, pour être mieux que la nullité qu'avec l'ensemble de ses contemporains il poursuit, s'étant reconnu le fils complètement improbable du père que sa mère lui attribue, ayant à peine ébauché ce chemin de sainteté, de se trouver exactement dans la posture du Christ lui-même écoutant Marie lui dire qu'elle avait été engrossée de lui par le frôlement des ailes d'un ange. Reconnaissez qu'il n'a pas la «petite voie» facile. Pourtant il avance, par le sexe, certes, mais par lui parvient à repousser, même si en creux, ces deux tentations majeures que sont l'envie et l'orgueil. Michel ne peut pas croire sa mère, parce que croire une histoire pareille aujourd'hui le livrerait instantanément à cette construction maîtresse de notre époque de grégarité, à savoir la psychiatrie.
Ceci dit, vous avez parfaitement le droit de ne voir en lui que le tricheur, puisqu'il est loin d'être un Saint. Quant à Marie, bien sûr, sa capacité de résignation, la durée miraculeuse de la gestation en elle de son fils, son obéissance à ses voix, sa modestie, dessinent assez franchement le portrait d'une Sainte. Vous omettez juste, en la voyant finalement traverser assez directement notre époque de grégarité, que le diable de romancier qui, elle aussi, l'a agitée a fermé son roman de telle manière qu'on puisse aussi parfaitement croire qu'elle est folle, ou qu'horrifiée de ce que le lecteur découvre à la fin du récit, sa pudibonderie hystérique (comme ils disent) l'ait conduite au double meurtre des enfants de Serge. Plusieurs lecteurs soutiennent cette hypothèse mordicus, et tentent de me prouver que c'est même l'évidence ! Je vous le dis, Juan, notre époque renverse les saints.
04/09/2008 | Lien permanent | Commentaires (2)
La revue Cancer ! est-elle immortelle ?

05/04/2004 | Lien permanent
La boulangère de Monceau et La carrière de Suzanne d’Éric Rohmer, par Francis Moury

11/01/2010 | Lien permanent
Apologia pro Vita Kurtzii, 6 : Exterminate all the brutes !

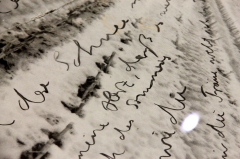 Apologia pro vita Kurtzii.
Apologia pro vita Kurtzii.«It was very simple, and at the end of that moving appeal to every altruistic sentiment it blazed at you, luminous and terrifying, like a flash of lightning in a serene sky : ‘Exterminate all the brutes !’.»
«J’ai étudié cette phrase pendant plusieurs années. J’ai réuni une quantité de documentation que je n’ai jamais eu le temps de dépouiller. J’aimerais disparaître dans ce désert où personne ne peut me joindre, où j’ai tout le temps possible. Disparaître et revenir seulement quand j’aurais compris ce que je sais déjà.»
Sven Lindqvist, Exterminez toutes ces brutes ! (Éditions Les Arènes, 2007).
«Et lorsque ce qui avait été commis au cœur des ténèbres se répéta au cœur de l’Europe, personne ne le reconnut. Personne ne voulut reconnaître ce que chacun savait.»
Ibid.
Cœur des ténèbres est une sorte de monstre. Il n’est pourtant pas le seul exemple de son espèce car d’autres œuvres nous permettraient de lire, d’une façon à peine métaphorique, la crise dans laquelle l’Occident se trouve plongé.
Cette crise est une crise du langage, familière à Georges Bernanos lorsqu’il affirme en 1926 à Frédéric Lefèvre : «On nous avait tout pris. Oui ! quiconque tenait une plume à ce moment-là s’est trouvé dans l’obligation de reconquérir sa propre langue, de la rejeter à la forge. Les mots les plus sûrs étaient pipés. Les plus grands étaient vides, claquaient dans la main».
Conrad, avant Bernanos, fit l’expérience douloureuse de cette universelle tricherie.
«La phrase «Exterminez toutes ces brutes !» n’est pas plus éloignée du cœur de l’humanisme que Buchenwald de la Goethehaus à Weimar. Cette idée a été presque complètement refoulée – même par les Allemands qui ont été faits les uniques boucs émissaires des théories de l’extermination, lesquelles, en réalité, appartiennent à toute l’Europe.»
Je ne puis m’étendre sur l’infinie complexité des raisons de cette crise, que George Steiner, reprenant les remarquables intuitions d’un Fritz Mauthner (encore bien ignoré dans notre pays, cet auteur développe dans son œuvre principale (Contribution à une critique du langage qui n’a pas été traduite en français alors qu’elle a paru en… 1903) un scepticisme radical à l’égard de ce qu’il nomme la «superstition des mots», ajoutant que ces derniers ne «donnent pas d’intuition réelle et ne sont pas réels»), que Steiner donc rattache à la grande cassure épistémologique propre au début du siècle passé, et que, plus largement, nous pourrions étendre à la Modernité, comprise comme une période où vacille l’autorité de la tradition logocentrique (1), où la parole perd de sa transparence, devient le vecteur idoine d’un mensonge généralisé.
Qu’il nous suffise de dire que les mots ne se nourrissent plus que d’autres mots depuis que Dieu est devenu un fantôme, le Revenant suprême qui ne cesse de hanter les corridors vides de notre monde mais ne parle plus, ne daigne plus nous soulever d’une seule parole. Qu'il nous suffise de dire que les mots, ne se nourrissant plus que d'autres mots (dans un sens aussi dramatique que le pensait le jeune Hofmannsthal, avant même le mutisme de Lord Chandos), deviennent ainsi les vecteurs du langage souillé, de tous les mensonges. Le langage putanisé devient le faux silence (le mutisme donc) qui est gros de toutes les trahisons : le bavardage.
Et les livres ne répondent finalement qu'aux livres, à d'autres livres desquels ils sont nés, dans une chaîne presque infinie, plus qu'ils n'évoquent, sans y parvenir autrement que laborieusement et de toute façon incomplètement, le réel.
Et les livres eux-mêmes, en bavardant, s'enferment dans le mutisme des idiots : en bavant, en bégayant, en se vidant de leur merde.
D’autres œuvres disais-je ? Oui car, contrairement aux ogres des contes, nos monstres littéraires ne sont pas des créatures solitaires. Mieux, ils entretiennent entre eux des ressemblances souvent remarquables, comme s’ils étaient les fils d’un même père dégénéré, Cœur des ténèbres. Ainsi, l’une des œuvres les plus directement inspirée par la nouvelle de Joseph Conrad est sans nul doute Le Transport de A. H. de George Steiner. Dans ce roman qui fit scandale il y a quelques années, Hitler n’est qu’une voix, dont l’étrange et perfide mélopée contamine les pages, comme les mots de l’aventurier Kurtz contaminent celles de l’œuvre de Conrad, comme les mots du vagabond Marius Ratti contaminent les cervelles d’un petit village tyrolien où Broch fait éclore la parole vide de son pitoyable tentateur, comme les mots de Monsieur Ouine sapent lentement les esprits des habitants de Fenouille et les fondations mêmes d’une paroisse qui se meurt.
Mais Kurtz n’est rien, rien d’autre qu’une ombre, un homme dont la caboche remplie d’un peu de bourre fomente dans l’obscurité impénétrable de la jungle des plans grandioses d’éducation et de rédemption des âmes sauvages dont nous ne saurons rien, si ce n’est qu’ils préconisent, alors que l’aventurier, comme un missionnaire démoniaque, est parvenu au bout de la nuit, l’extermination de toutes les «brutes». Mais Marius Ratti n’est rien, rien de plus qu’un vagabond suspect, un prophète raté réclamant des paysans qu’ils délaissent l’utilisation des machines et retournent à l’exploitation de la mine abandonnée, afin que les puissances de la terre, celles-là même que Hitler, selon Steiner, saura diaboliquement évoquer dans ses discours chthoniens, retrouvent leur antique grandeur, détruite par le christianisme. Mais Ouine enfin, au moment de mourir, n’est plus rien, lui qui n'a jamais été grand chose de plus qu'une coquille vide, le vieillard bredouillant des paroles incohérentes et insensées, tandis qu’il semble avalé par un gouffre sans fond – sa propre âme, nous dit Bernanos – dont les forces de marée délitent le monde des vivants.
Ces romans sont autant d’astres vides dont le centre de gravité, le foyer obscur, le cœur vorace est le conte de Joseph Conrad, ce dernier se souvenant bien évidemment de l'exemple de Macbeth. Toutes ces œuvres sont des trous noirs, qui paraissent aspirer le langage et dévorer ce qui les entoure. Les contempler, c’est comprendre que leur puits est sans fond. Les observer de loin, c’est admettre que nous ne saurons jamais rien du mal qui mine notre âge si, comme l’ont fait les romanciers que nous avons nommés, nous ne tentons à notre tour de nous y enfoncer.
Sven Lindqvist ne s'est point enfoncé dans ce puits de ténèbres mais il s'est perdu au plus profond du désert là où, selon Ernest Hello, l'âme parle à Dieu dans un dialogue dont le plus petit grain ne sera jamais perdu. Dieu ou... le démon ? Selon Marlow, la forêt tropicale a pris possession de l'âme vide de Kurtz. Le démon de midi, hantant les contrées chaudes, a peut-être soufflé à Lindqvist quelques-unes de ses intuitions, notamment celle qui lui fait dire que la Shoah, aussi irréductible qu'on le voudra dans son caractère d'atrocité absolue, comme élue à rebours, n'en a pas moins été longuement mûrie par et surtout dans l'Europe éclairée (2).
Ainsi, c'est volontairement perdu sur la terre la plus aride (qu'il retrouvera en Australie avec Terra Nullius, également édité par Les Arènes) que Lindqvist a entrevu la moiteur infernale dans laquelle se sont corrompues les âmes de peu de poids de Kurtz et de ses séides, personnages reprenant, selon les dires de l'auteur, les débats concernant la colonisation (3) qui ont agité la société anglais de la fin du 19e siècle. En voulant se perdre dans le désert, Lindqvist s'est retrouvé au milieu des cadavres humains déambulant comme les fantômes noirs du roman de Conrad : pas encore morts et pourtant déjà morts.
En fait, comme Marlow dont il a reproduit le dangereux voyage, Lindqvist nous a rapporté du plus profond du désert, de sa propre âme donc, un savoir dont il soupçonnait la présence, comme Marlow sait, intimement, que presque rien ne le sépare de Kurtz, comme Macbeth sait qu'il ne pourra pas résister à la tentation et qu'il est déjà le meurtrier de son roi annoncé par les trois sorcières, comme nous savons que bien peu de choses nous séparent d'un de ces criminels errants décrits par Cormac McCarthy.
Notes
(1) «L’ordre du cosmos s’est effondré, émietté dans des chaînes associatives et des points de vue non communicants. Le langage des signes se met à parler pour lui-même […]; il ne s’appuie plus sur un Logos subsistant», Gilles Deleuze, Proust et les signes (P.U.F., coll. Perspectives critiques, 1964), p. 137.
(2) Point sans doute le plus contestable du livre de Lindqvist, qui bien évidemment ne se préoccupe pas de la dimension métaphysique de la Shoah. L'auteur écrit ainsi : «[...] l’Holocauste fut unique – en Europe. Mais l’histoire de l’expansion occidentale dans d’autres parties du monde montre maints exemples d’exterminations totales de peuples entiers» puis «[…] le pas entre massacre et génocide ne fut pas franchi avant que la tradition antisémite ne rencontre la tradition du génocide qui avait surgi durant l’expansion européenne en Amérique, en Australie, en Afrique et en Asie.», op. cit., p. 210.
(3) «Lorsque Conrad rédigea Cœur des ténèbres, il ne fut pas seulement influencé par le débat sur le Congo, par le retour de Kitchener et d’autres événements de l’époque. Il fut également influencé par un monde littéraire, un monde de mots, où Kipling était le rival et l’antipode, mais aussi par d’autres écrivains qui signifiaient davantage pour lui : Henry James, Stephen Crane, Ford Madox Ford et, surtout, H.G. Wells et R.B. Cunninghame Graham.», p. 99. Et encore : «Je ne prétends pas que Joseph Conrad a entendu le discours de lord Salisbury. Il n’en avait pas besoin. Ce qu’il avait lu de Dilke [l’article de Dilke, intitulé Civilization in Africa, paru dans la revue Cosmopolis, juillet 1896, est une esquisse de la nouvelle de Conrad], dans La Guerre des mondes de Wells et dans Higginson’s Dream de Graham lui avait suffi. Tout comme ses contemporains, Conrad ne pouvait pas éviter d’entendre parler des génocides incessants qui marquèrent tout son siècle. C’est nous qui l’avons refoulé. Nous refusons de nous souvenir. Nous voulons que le génocide ait commencé et fini avec le nazisme. C’est plus réconfortant ainsi», op. cit., p. 186.
06/06/2007 | Lien permanent
Les visages pâles de Solange Bied-Charreton ou Martine s'essaie à l'écriture

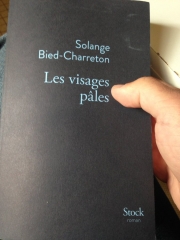 Mon article va finir mal, mais je crains qu'il ne commence assez difficilement. En effet, Les visages pâles m'a d'emblée fait penser aux Renards pâles de Yannick Haenel, et tout ce qui me fait penser à Yannick Haenel me donne la nausée, puis de franches envies vomitives. Avant même d'avoir ouvert ce laborieux roman qui rendrait ceux de Michel Houellebecq fins comme une phrase de Marcel Proust, roman dont je ne dirai rien car la presse réactive l'a amplement résumé et encensé, mon hypothétique plaisir de lecture s'envolait donc plus sûrement qu'une belle phrase devant la petite langue tirée de Christine Angot sur son clavier poisseux. Lire Solange Bied-Charreton est un exercice certes particulièrement pénible, à peine atténué par le petit plaisir que voici : en matière de critique littéraire, c'est-à-dire de jugement, la bonté est peut-être ce qui ressemble le plus au mystérieux péché de l'esprit. C'est parce que je suis encore bien trop plein de bonté que je n'ai pas évoqué Enjoy, premier roman de Solange Bied-Charreton, à peu près nul si ce n'est, ici ou là, un grumeau métaphorique s'extrayant malaisément d'une glu d'insignifiances, d'un plâtra de petites phrases que l'on dirait avoir été écrites, produites plutôt, par un logiciel que l'on n'aurait nourri que des textes paraissant sur Causeur ou L'Incorrect.
Mon article va finir mal, mais je crains qu'il ne commence assez difficilement. En effet, Les visages pâles m'a d'emblée fait penser aux Renards pâles de Yannick Haenel, et tout ce qui me fait penser à Yannick Haenel me donne la nausée, puis de franches envies vomitives. Avant même d'avoir ouvert ce laborieux roman qui rendrait ceux de Michel Houellebecq fins comme une phrase de Marcel Proust, roman dont je ne dirai rien car la presse réactive l'a amplement résumé et encensé, mon hypothétique plaisir de lecture s'envolait donc plus sûrement qu'une belle phrase devant la petite langue tirée de Christine Angot sur son clavier poisseux. Lire Solange Bied-Charreton est un exercice certes particulièrement pénible, à peine atténué par le petit plaisir que voici : en matière de critique littéraire, c'est-à-dire de jugement, la bonté est peut-être ce qui ressemble le plus au mystérieux péché de l'esprit. C'est parce que je suis encore bien trop plein de bonté que je n'ai pas évoqué Enjoy, premier roman de Solange Bied-Charreton, à peu près nul si ce n'est, ici ou là, un grumeau métaphorique s'extrayant malaisément d'une glu d'insignifiances, d'un plâtra de petites phrases que l'on dirait avoir été écrites, produites plutôt, par un logiciel que l'on n'aurait nourri que des textes paraissant sur Causeur ou L'Incorrect. Tout vieux briscard journalistique vous le dira : il ne faut jamais dire du mal d'un premier roman paraît-il, et l'inobservance de cette règle absolue du journalisme inculte peut valoir au critique envieux, ce raté notoire, une lourde peine d’excommunication. Depuis longtemps écarté du journalisme à fort tirage et petite pensée, j'ai donc critiqué tel premier roman, 111 d'Olivier Demangel par exemple, moins oubliable toutefois que les textes de Solange Bied-Charreton par l'originalité de son sujet. J'ai également qualifié de prétentieuse bouse le premier mais, hélas, sans doute pas le dernier, roman de Clémentine Haenel, et je serais bien évidemment tout disposé à en faire de même pour le second, voire le deuxième, hélas encore. C'est aussi parce que je suis trop plein de bonté, en dépit cette fois-ci de tout interdit tacite, que je n'ai pas évoqué Nous sommes jeunes et fiers, le deuxième roman, lui franchement mauvais, de Solange Bied-Charreton qui est quelque chose, je m'en avise en souriant, comme le pendant féminin, plus drôle cependant et quand même moins prétentieux que son altier modèle portant testicules en bakélite et lavallière en soie, du très dandy, vertical et même priapistique Romaric Sangars, cultivateur gothique de navets dont le troisième du genre, pourtant poussé au coin d'un jardin de curé, ne semble pas avoir bénéficié de quelque engrais certifié d'origine rigoureusement naturelle. D'ici peu, notre cultivateur de navets en herbe offrira en circuit court comme il se doit un cageot entier de ses dolentes cultures, dont quelques bécasses et pas mal d'ânes feront un usage résolument écologique en les transformant en engrais naturel, qui permettra d'enrichir la rapide poussée de nouvelles courges : hélas, les plantations de serre ne trompent jamais que les ignorants, et jamais une production de boudoir ne pourra être confondue avec une plante sauvage, soumise aux éléments, tirant d'eux sa force.
C'est cependant pour corriger cette coupable abondance de ridicule bonté suintant de la moindre de mes phrases comme les platitudes tombent d'un article d'Eugénie Bastié, laquelle (la bonté, pas la Bastié) me perdra assurément, que j'ai non seulement décidé de lire le troisième roman de Solange Bied-Charreton, Les visages pâles, ce qui n'est pas un mince exploit je vous prie de le croire, mais de l'évoquer sans tomber dans le tressage consanguin, sans fard et sans vergogne, de couronnes de laurier, ce qui tient non pas du prodige, mais de la plus élémentaire honnêteté intellectuelle et, sinon de la bonté, du moins de l'amour du travail bien fait. Avant de commencer ma séance de résipiscence publique, je me dois tout de même de ne point trop prendre mon lecteur pour un naïf, en précisant que Les visages pâles, roman non point pâle mais littéralement transparent (oui, pas même translucide), non point à peu près nul ou franchement mauvais mais franchement nul, a reçu l'accueil heureusement dithyrambique et bien sûr très largement mérité accordé aux livres des amis, selon la bonne vieille habitude des médias français, surtout ceux avec laquelle l'intéressée a l'habitude de travailler, qu'il s'agisse de Causeur, d'Éléments ou du Figaro. Une telle unanimité critique ferait presque passer Solange Bied-Charreton pour ce qu'elle n'est absolument pas : un écrivain digne de ce nom voire, tout bonnement, une romancière honnête à défaut d'être douée, comme l'est par exemple, avec une discrétion bienvenue par ces temps de surexposition, un Matthieu Jung qui a publié lui aussi chez Stock, et dans la même collection (La Bleue) que Martine, pardon, Solange.
C'est un problème de vue qui frappe tout d'abord le lecteur des Visages pâles : on relit telle ou telle phrase, pratiquement n'importe laquelle puisqu'elles sont toutes aussi mal fichues, et on se dit qu'on a mal lu. On relit la phrase en question, n'importe quelle autre puisqu'elles sont toutes capables de provoquer cette sidération de la vue, et on finit par se convaincre, ahuri, que Solange Bied-Charreton est moins une écrivassière rabat-joie, et même, une rabat-joie méticuleuse selon ses propres termes colligés par le cueilleur de truismes qu'est Devecchio, qu'une écrivante qui ne sait tout bonnement pas écrire, ni même respecter quelques règles élémentaires de concordance des temps. Sans doute est-ce le fait que l'intéressée soit née au début des années 80 qui lui a permis de bénéficier d'un enseignement de la grammaire et de la conjugaison aussi catastrophique que décomplexé, mais on se demande dans ce cas si la ou les personnes chargées de relire le manuscrit des Visages pâles (à moins, bien sûr, que l'éditeur Stock ne fasse point correctement son travail, hypothèse parfaitement envisageable quand on sait qu'il a osé publier du Christine Angot) souffrent du même déficit. Peut-être même faut-il parier que l'auteur et son ou ses relecteurs ne se sont même pas rendus compte que le livre qu'ils lisaient ou relisaient n'était tout simplement pas écrit en français, sinon celui d'un article pour Causeur je l'ai dit ou, bien pire, pour le Figaro Vox, Alexandre Devecchio, ce jeune prince du journalisme consanguin qui finira par prendre la place de l'insignifiant Étienne de Montety, qui possède, à défaut de cerveau, une langue (non certes pour écrire), réécrivant l'article et y ajoutant son lot de fautes.
On me dira que j'exagère, comme toujours, en me concédant toutefois que cette étrange tournure est bel et bien imprimée à la page 49 de notre roman : «La semaine précédente, l'enfant avait enchaîné les examens médicaux et psychologiques, et ils avaient enfin obtenu une explication rationnelle à propos de sur son comportement». Défaut de relecture assurément, qui en aucun cas ne doit me permettre d'affirmer que c'est tout le reste du roman qui présenterait les mêmes défauts, bien qu'il compte beaucoup de fautes (1). Pourtant, ce n'est pas tant cette faute évidente, imputable je le veux bien à une erreur d'inattention, qui me gêne, que des dizaines d'autres phrases qui, elles, j'en suis sûr, ont été conservées telles quelles. J'en donne un exemple, qui à vrai dire pourrait valoir pour tous les autres puisqu'il s'agit toujours du même patron étique : «Raoul avait conté à ses petits-enfants ce qui se trouvait derrière chaque fenêtre, combien d'hommes travaillaient, à quoi, à quel endroit, dans quel but. Ce qu'ils faisaient de leurs mains chaque jour» (p. 29). Deux phrases sont de la sorte artificiellement séparées par un point, la seconde étant du coup réduite à sa plus simple substance, comme le montre cet autre exemple : «Des rangements dégageaient ingénieusement l'espace. Autorisaient le vide» (p. 129). Parfois, le verbe est purement et simplement rayé de la deuxième voire de la troisième phrase suivant, toujours sur le même canevas, la première phrase qui les aura fait naître. Ainsi : «L'un des traits les plus édifiants de cette époque, c'était le défaut d'engagement, l'incertitude constante. Siècle d'êtres liquides, fébriles, titubants. Raison sans fondement. Revirements, fortune acquise mais perdue d'un cillement, d'un souffle» (p. 94).
Que voulez-vous, une seule phrase mal construite sur ce modèle, qui suffirait à faire passer la prose de Michel Houellebecq pour un modèle de nervosité stylistique, suffit à me faire jeter à la cheminée un livre (pardon Solange, mais c'est encore le meilleur moyen de spiritualiser ton texte que de le livrer aux flammes et aux courants chauds, donc ascendants, qu'elles provoquent), mais alors deux ou trois, à chaque page faiblarde, traînarde, poussive et soporifique de ce roman si long qui eût pourtant pu tenir en une ligne : Jules-Édouard est triste de ne pas savoir pourquoi il est triste et cela suffit à faire de lui un inadapté social et même un franc réactionnaire, voilà qui me donne des envies de bûchers géants, alimentés pourquoi pas par tout le petit bois débité menu par Solange, ses cousins, nombreux, et ses amis, pléthoriques voire journalistiques. Nous avons lu mille fois ces invertébrations d'écriture qui, par paresse ou plutôt, dans le cas qui nous occupe, par insuffisance, lorgnent systématiquement vers le camée sociologique et ont moins de profondeur qu'une platitude d'Eugénie Bastié et multiplier les exemples de cette indigence stylistique n'aurait d'autre but que de nous faire perdre un temps précieux que nous pourrions consacrer à de vrais écrivains.
J'ai avoué d'entrée de jeu un péché en affirmant qu'il ne m'avait jamais gêné de dire tout le mal que je pensais d'un premier roman, surtout s'il était mauvais. Je dois à présent confesser une seconde faute, plus grave encore que ne l'est la première : ce n'est pas au feu que j'ai jeté Les visages pâles de Solange Bied-Charreton, mais à la poubelle. Je crains même de ne pas m'être vraiment préoccupé de la couleur de son couvercle.
Note
(1) Solange Bied-Charreton, Les visages pâles (Stock, 2016). Voir ainsi, à la page 87 : «Cela ne servait à rien de présenter correctement, ou bien même d'utiliser d'expressions branchées». Page 66 : «L’œuvre en grand, étalé», etc. Ajoutons un assez comique : «La question immobilière avait pourtant glacé l'insistance» (p. 161) en lieu et place d'assistance bien sûr. Finalement, Solange Bied-Charreton écrit tellement mal que nous finissons assez vite par ne même plus voir les fautes et incorrections manifestes déparant sa non-prose, cette dernière étant tout entière une aberration de la langue française.
19/08/2019 | Lien permanent
Les Jours de silence de Phillip Lewis

 Acheter Les Jours de silence sur Amazon.
Acheter Les Jours de silence sur Amazon.Les Jours de silence de Phillip Lewis (1), dont le titre français ne rend pas franchement la sécheresse (tout de même hantée) de l'original (The Barrowfields) est un assez beau roman, de surcroît ambitieux et dont la presse anglo-saxonne a fait l'éloge à peu près unanime, non sans de bonnes raisons.
Certes, le motif de la disparition du père (2) est quelque peu fallacieusement entretenu par Phillip Lewis, afin sans doute d'exploiter l'atmosphère gothique de son roman et de garder dans une relative ambiguïté le sort d'Henry L. Aster, ou Henry Senior, puisque nous apprenons assez tardivement qu'en lieu et place du Wakefield d'Hawthorne, nous n'avons qu'un homme désespéré qui s'est pendu à un arbre (cf. p. 419). De la même manière, ce n'est qu'à la fin de son roman que nous apprenons le prénom de la petite sœur des deux enfants (qui se révélera être celui de sa grand-mère, Maddy), Henry Junior et Threnody (dite Bird), piétinée toute jeune par des chevaux.
Toutefois, cette éclipse du père, qui ne peut traduire in fine qu'une disparition de toute forme de repère, tant intellectuel que spirituel, mais aussi une douloureuse méditation sur le paradis perdu que même un ange ne saurait pouvoir reconquérir, permet à Phillip Lewis d'évoquer la quête du fils, dédoublée dans les personnages d'Henry Junior mais aussi de Story, belle jeune femme dont le narrateur tombera éperdument amoureux et qui elle aussi, à sa façon, n'en finit pas de chercher celui dont le sang coule dans ses veines, et qu'elle a pourtant sous ses propres yeux, puisque son père adoptif n'était autre que son père biologique.
Ces quelques facilités narratives seraient sans doute gênantes voire rédhibitoires dans un roman français, n'ayant donc l'ambition que de figurer sur la liste d'un prix dit littéraire, mais, ici, elles ne sont point gênantes, car l'ensemble se lit avec beaucoup de plaisir, même si nous savons que les écrivains nord-américains sont rompus à ces techniques d'écriture qui vous font tourner, encore et encore, page après page sans vraiment pouvoir vous empêcher de le faire, la grande majorité de ce qui est aujourd'hui publié et traduit en provenance des États-Unis.
Un autre point me semble plus embarrassant, car nous ne savons pas vraiment si le roman de Phillip Lewis veut nous montrer les ravages d'une vie toute entière vouée à la littérature, sur les brisées du géant Thomas Wolfe plusieurs fois cité, y compris en exergue, la stature complexe (3) d'un homme envahi par le langage, ne parvenant pas à (ou ne voulant même pas) publier (4) alors qu'il a tout lu (5), et qui semble en oublier de vivre parmi les siens jusqu'à les abandonner en se suicidant, la thématique, voisine sinon consécutive, d'enfants qui doivent donc se forger sans leur père, cette dimension se posant avec une acuité toute particulière pour le narrateur, Henry Junior, ou bien s'il s'agit d'une vaste méditation sur l'absurdité du temps qui passe («désespéré de ce qui était à tout jamais perdu», dit le fils, p. 399) et engloutit absolument tout, alors que la seule façon de tenter d'en ralentir le cours absurde, de freiner cette flèche qui décidément ne bouge que dans un sens, «vers l'avant» (p. 403) est d'écrire (cf. p. 65). Et pourtant, tout passe, car «le temps ne suffit que quand on a la volonté d'en faire quelque chose» (p. 408), alors que, manifestement, ni le père ni même le fils ne l'ont : «Au cours d'une conversation quelconque pouvait lui venir à l'esprit un parallèle avec Whitman, Coleridge ou Proust, qui lui semblait particulièrement approprié à une situation, mais qu'il ne formulait jamais. Cette pensée resterait en lui, mourrait en lui, et personne n'en entendrait jamais parler» (p. 67). Et pourtant, oui, tout passe, comme le révèle un extrait d'un des textes écrits par le père du narrateur, sauvés du feu o il a bien failli être lui-même consumé : «On se rend compte, toutefois, parce que cela doit arriver, de la finitude du souvenir. Il ne peut traverser qu'un nombre restreint de générations avant de se fondre dans l'indistinction» (p. 189) et, une page plus loin : «Nous ne sommes guère plus qu'une poignée de feuilles sur un arbre dans une forêt à flanc de colline. Nous goûterons notre bref moment de soleil, pour tomber avec tous les autres et laisser place à la verdoyante génération d'après».
Un lecteur passable, donc optimiste, me dirait que la force du premier roman de Phillip Lewis est justement de parvenir à entretisser savamment ces différents motifs jusqu'au point où l'histoire du fils répète celle du père jusqu'à se confondre l'une dans l'autre (6), où une discrète mise en abyme (cf. p. 170) tente de creuser une profondeur purement livresque, mais je n'en suis pas totalement convaincu, car il me semble que seule l'épaisseur d'une ligne sépare l'ambition du fourre-tout. De même, je ne suis pas plus convaincu par la peinture gothique des lieux, notamment de la maison où la famille dont nous suivons le destin a élu domicile, et qui me semble représenter une évidente facilité pour un roman qui n'en avait du reste nullement besoin pour éveiller ce sentiment d'inquiétude palpable dans Les Jours de silence, et cela dès les toutes premières lignes décrivant Old Buckram. Remarquons la justesse générale avec laquelle l'écrivain peint les paysages grandioses et inquiétants où vivent les personnages, ceux-ci semblant n'être qu'une émanation éphémère des premiers.
Ces réserves, d'ailleurs propres à tout exercice de lecture critique, n'altèrent en rien la qualité manifestement supérieure de ce premier roman dont certaines scènes (comme celle de l'apparition nocturne d'un troupeau de chevaux sauvages) sont superbement décrites, et qui frappe par le sentiment effrayé de la consomption de toute chose, alors même que le langage, objet de toutes les vénérations, ne peut rien faire, ou alors, seulement l'espace d'un battement de paupière, langage dont le rôle ambivalent est bellement évoqué : à la fois malédiction qui empêche un homme dévoré par les livres de vivre réellement, mais seul outil pourtant à même de nous faire comprendre que, sans la littérature, la vraie vie qui n'a que faire des livres ne serait rien de plus que la distraction absurde d'une brute.
Finalement, Les Jours de silence de Phillip Lewis est un roman qui illustre finement la si douloureuse philosophie de Carlo Michelstaedter ou celle du premier roman de Paul Gadenne, Siloé, mais c'est là une réflexion qui nous engagerait bien trop loin, sur les pistes pulvérulentes empruntées par les horribles travailleurs cherchant une vie rédimée, point séparée du mot qui la dit et la sauve, mais la condamne en même temps.
Notes
(1) Le titre français semble avoir été choisi d'après ce passage du roman : «La tristesse que je crus percevoir ce matin-là et lors des jours qui suivirent n'avait rien à voir, bien sûr, avec ce sentiment de chagrin isolé de tout le reste qui descend sur vous et pèse sur vos épaules tel un lourd manteau lors des nombreux jours de silence qui suivent un enterrement» (p. 107). Publiée chez Belfond, la traduction due à Anne-Laure Tissut n'est point exempte de reproches, qu'une lecture plus attentive eût levés. Quelques fautes banales sont à signaler (comme des mots qui manquent, cf. : «une tension vive et bien palpable survenait parfois entre lui et quiconque [était] doté d'un avis sur l'art, ou «j'étais prêt à accepter de partager [ce] liquide si précieux» (p. 422); remarquons encore des répétitions très rapprochées de mots, cf. p. 262 pour «Story» (surnom d'une des héroïnes), p. 291 pour «route», p. 312 pour «ville». J'ai aussi relevé quelques horreurs visuelles et auditives comme «de sur» (p. 109) ou «celle sur comment" (p. 178) qui nous font douter, si elle a eu lieu, de la qualité de la relecture du texte français. Enfin, j'ai noté cette laideur qu'est l'emploie si contemporain et si typiquement managérial du terme «résilience» (p. 208) ou encore de «juste» employé à toutes les sauces : «Elle pensait juste que c'était ce qu'il fallait faire» (p. 82), «Tu ne peux pas juste...» (p. 104), «c'est juste que je ne parvenais pas à me résoudre à le faire» (p. 155), ou encore (liste non exhaustive, hélas) : «Nous restâmes assis longtemps juste à regarder l'eau» (p. 227).
(2) Significativement, la traduction italienne du roman est La montagna del padre.
(3) Ainsi, à neuf ans, «cet enfant précoce était assez lucide pour soupçonner qu'il était né dans une caste de dignité inférieure à ce qu'il estimait mériter» et, un peu plus loin : «Avec le temps, il se fit donc marginal, et le resterait, comme tous les hommes et femmes illustres parmi leurs contemporains» (pp. 28-9).
(4) «Il écrirait une œuvre de fiction sans égale, qui tenterait de redéfinir la nature même du langage» (p. 42).
(5) Comme le montre la belle scène d'un duel littéraire entre le père et son beau-frère, petit universitaire prétentieux, ce qui du reste est un double pléonasme parfait.
(6) «Inconsciemment, j'avais hérité les tendances nocturnes de mon père» (p. 181) ou «Je voulais être tout ce qu'il avait été avant que la tristesse ne vienne» (p. 187). Une page plus loin, le père révèle à son fils qu'il l'a élevé pour qu'il soit écrivain : «Je pensais que tu le serais peut-être un jour. Tous ces livres que je t'ai lus. Toutes ces histoires» (p. 188). Il va de soi que nous pourrions estimer que c'est Phillip Lewis lui-même qui est ainsi devenu le fils écrivain rêvé et souhaité par son père. Comme son père encore, Henry Junior est toujours désireux de quitter un lieu où il a pourtant vécu de longues années, quitte à abandonner sa mère et sa sœur (cf. p. 281). Jamais plus clairement que dans ce passage le fils ne révèlera son intention : «Je pensai à lui, là, sous l'herbe mourante, lui que le temps implacable avait réduit au silence avant qu'il ait pu donner voix au chaos qui bouillonnait et rugissait en lui. J'imaginai brièvement que je pourrais être ses yeux et ses oreilles; que je pourrais voir et entendre à sa place en ce frais après-midi d'automne; respirer la fumée de feu de bois des premiers feux du soir; éprouver l'excitation solitaire de la tombée de la nuit dans notre ville hors du temps; goûter la chaleur mielleuse du scotch sur ma langue; connaître la vie et la joie éphémère de toutes choses vivantes, juste une minute, pour mon père. Lui permettre de voir et sentir de nouveau, à travers mes yeux et mon corps, le délicieux automne d'octobre à Old Buckram» (p. 424).
06/10/2018 | Lien permanent
Le deuil de la littérature de Baptiste Dericquebourg, par Baptiste Rappin

 Baptiste Rappin dans la Zone.
Baptiste Rappin dans la Zone.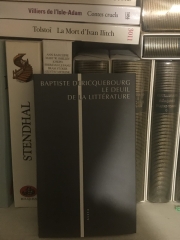 Étrange et percutant livre que ce premier essai que signe Baptiste Dericquebourg et qui lie le destin de la littérature à l’aventure des Gilets Jaunes et au projet du RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne), tant l’auteur tient qu’il n’existe de littérature que tendue vers l’action, comme si le Verbe devait appeler à l’acte et, plus encore, se faire acte, selon le modèle performatif que John Langshaw Austin rendit populaire. Une telle prise de position n’est d’ailleurs pas sans comporter de pesants paradoxes, car le lecteur taquin en vient à se demander si Baptiste Dericquebourg ne rejoint pas par ce chemin de traverse la cohorte des pseudo-théoriciens postmodernes que, pourtant, il ne laisse pas de tourner en ridicule – nombre de passages sont savoureux, certains jubilatoires ! – tout au long de son ouvrage.
Étrange et percutant livre que ce premier essai que signe Baptiste Dericquebourg et qui lie le destin de la littérature à l’aventure des Gilets Jaunes et au projet du RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne), tant l’auteur tient qu’il n’existe de littérature que tendue vers l’action, comme si le Verbe devait appeler à l’acte et, plus encore, se faire acte, selon le modèle performatif que John Langshaw Austin rendit populaire. Une telle prise de position n’est d’ailleurs pas sans comporter de pesants paradoxes, car le lecteur taquin en vient à se demander si Baptiste Dericquebourg ne rejoint pas par ce chemin de traverse la cohorte des pseudo-théoriciens postmodernes que, pourtant, il ne laisse pas de tourner en ridicule – nombre de passages sont savoureux, certains jubilatoires ! – tout au long de son ouvrage.Nous n’assistons pas, en ce moment, à la décomposition de l’Université : décomposée, elle l’est déjà, et depuis un bon moment; c’est donc à une autopsie en règle à laquelle se livre l’auteur, qui prend le détour du récit autobiographique pour d’autant mieux mettre en exergue les causes du décès. Et il en ressort que cette mort est tout sauf naturelle ! Lisons plutôt : «Ce sont les Facultés de Lettres et de Philosophie que j’attaque ici : le type d’enseignement qui y prévaut et leur activité de ‘recherche’ promeuvent une esthétique qui transforme les discours en choses; c’est en elles que s’opère la grande confusion entre la conservation de la lettre et la vie de l’esprit» (p. 16). Au fond, pour Baptiste Dericquebourg, tous les travers de l’Université mènent à la même impasse : qu’il s’agisse des normes de publication (des colloques aux articles des revues académiques), de l’exercice de la thèse (dont l’auteur donne la très juste définition : un exercice de docilité !), de l’hyperspécialisation qui conduit à l’insignifiance, des méthodes d’enseignement, des finalités visées (la culture in vitro de futurs collègues), tout concourt en effet à sevrer la littérature et la philosophie de leur référent, à savoir la réalité. Les enseignants-chercheurs s’adressent à de futurs enseignants-chercheurs, ils passent leur temps à commenter des textes en renvoyant à d’autres textes, reproduisant ainsi le schéma de la différance derridienne au sein duquel les signifiants, ne cessant de s’appeler les uns les autres, finissent par se suffire à eux-mêmes en procédant à l’ablation du monde. Et alors même que les universitaires, ces bien-pensants devant l’Éternel, clignent de l’œil en en appelant à la diversité, en promouvant l’altérité, la simple observation établit tout au contraire le profond éléatisme de cette caste; tout, chez eux, revient en effet invariablement sous la figure du Même : «Car à l’Université, la diversité des approches critiques aboutit toujours au même résultat : critique structuraliste ou génétique, voire franchement biographique, critique stylistique ou sociologisante, ça se termine toujours en colloque, en article ou en thèse» (pp. 29-30).
Et cet éternel retour du Même de compter parmi ses nombreux corollaires un relativisme radical dans la mesure même où les œuvres s’en trouvent vidées de toute signification et privées, par conséquent, de toute possibilité de transmission. Toujours il faut commenter la virgule d’un passage de Proust ou de Hegel, afin de paraître important sans surtout ne rien dire de décisif ; toujours il faut trouver un angle mort, passé inaperçu, ignoré jusqu’alors, qui justifie une inscription en thèse mais sert la reproduction d’un système plus que le monde des idées. C’est la raison pour laquelle Baptiste Dericquebourg affirme que «la neutralisation des enjeux théoriques s’accompagne d’un aplanissement des discours et des auteurs eux-mêmes» (p. 30).
Mais le Même, c’est aussi la promesse de l’inceste et de la dégénérescence, ainsi que notre jeune essayiste le remarque avec humour en retournant les thèses de Bourdieu contre ses zélés thuriféraires : «À cette logorrhée pseudo-scientifique [celle du Maître bien sûr], on opposera l’évidence suivante : les mouches dégénèrent dans un bocal hermétiquement fermé. En peu de temps, leur reproduction incestueuse donnera naissance à de petites mouches débiles, aveugles et sans ailes» (p. 54). Quelle lucide description de l’universitaire, lui qui, pris de psittacismes, répète les mêmes mots-clefs, ressasse les mêmes canevas conceptuels, rabâche les mêmes expressions théoriques que dans les années de l’après-guerre ! Il se croit dans le coup, se pense dans le vent, mais déploie mécaniquement la même stratégie à laquelle la horde des déconstructeurs nous a désormais habitués : l’analyse des discours et des pratiques qui, comme le note finement Baptiste Dericquebourg, constitue le pont entre les études de Lettres et de Philosophie et la sphère médiatique dont l’occupation centrale est le commentaire, puis le commentaire du commentaire, etc. Comme dirait Milou, agacé par le perroquet dans Les bijoux de la Castafiore, «moi, je ne supporte pas ces bêtes qui parlent !».
Il est surprenant de voir coexister cette lucidité sur la littérature et la philosophie avec une certaine naïveté car, à en croire l’auteur, ces départements de l’université seraient plus gravement touchés par la dégénérescence que les autres ; lisons ce surprenant développement : «Bien d’autres formations enseignent à écrire et à parler de façon efficace : la rhétorique et les ateliers d’écriture ‘littéraire’ sont mieux accueillis dans les instituts d’études politiques qu’en fac de Lettres; le marketing a recyclé la poésie, la communication le roman; la philosophie est pastichée dans les séminaires de développement personnel. Il n’y a plus qu’en de tels lieux, où les discours sont asservis et sans histoire (ou bien porteurs d’une histoire perpétuellement réécrite selon les impératifs de la bourgeoisie), que s’enseigne ce que n’offrent pas les facs de Philosophie et de Lettres. Mais derrière, il faut entrer sur le marché du travail et devenir salarié du privé» (page 21). À dire vrai, nous avons dû lire ce passage à plusieurs reprises, tant il nous surprit : c’est que nous ne nous attendions pas à ce que Le deuil de la littérature conduise Baptiste Dericquebourg à vanter les mérites des ateliers d’écriture de Sciences Po, des IUT et des IAE ! Faut-il privilégier un simulacre à l’autre ? De deux maux, il convient de choisir le moindre, nous rappelle la sagesse populaire : et c’est bien ce que fait l’auteur. De son point de vue, en effet, les ateliers d’écriture, le marketing et la communication ne sont pas autant condamnables que les pratiques des facs de Lettres car subsiste en eux une visée d’efficacité.
Nous voici parvenus au cœur de l’argumentation : l’idolâtrie des textes que cultive l’université, idolâtrie qui se manifeste le plus clairement dans l’actualité donnée à des textes qui n’ont pourtant plus de lecteurs, coupe les facs de Philosophie et de Lettres de l’expérience du monde à laquelle les mots devraient introduire. Cela signifie deux choses, étroitement liées : d’une part, la littérature doit se définir comme une rhétorique ; d’autre part, elle a pour vocation de déboucher sur une action, ou sur l’élaboration d’une action : «Le contraire d’une littérature parnassienne n’est pas une littérature engagée, dont les livres dispensent de pieuses leçons de morale ou de politique ; c’est un usage du langage dans des structures sociales où s’élabore l’action collective : en un mot, la rhétorique» (p. 71). Au fond, deux grands types de parole se partagent la pratique des mots, sans nécessairement entrer en conflit l’une avec l’autre : la parole vaine et stérile qui tourne en rond sur elle-même et s’enferme dans une éternité éthérée, la parole utile et féconde qui se trouve grosse d’un avenir. On peut encore le dire autrement : la mort de la littérature n’est pas un drame dans la mesure où les mots peuvent trouver de nouveaux supports d’expression.
Le lecteur de cette recension comprend alors pourquoi je la débutai en faisant référence au RIC : pour Baptiste Dericquebourg, le mouvement des Gilets Jaunes et la revendication référendaire qui l’accompagna témoignent «d’une demande de langage utile, utilisable» (pp. 90-1) et, en eux, se produit la résurrection de la figure du Citoyen qui se caractérise, justement, par l’usage de la parole. On pourrait objecter à l’auteur, avant d’en arriver en conclusion à des arguments autrement plus tranchants, que le RIC conduit au même résultat que les pratiques de la déconstruction auxquelles, étudiant, il devait docilement assister voire se livrer : dans les deux cas, l’objet même du texte ou de la parole s’efface derrière la méthode. Qu’il s’agisse d’une technique d’analyse de textes ou d’un dispositif de démocratie directe, le fond des discours se trouve dans les deux cas soumis à un protocole plutôt que discuté en lui-même. C’est bien le déploiement d’une méthode qui légitime la production écrite, et non pas le caractère désirable de cette production.
Ancien étudiant de philosophie et de sciences de gestion, aujourd’hui ‘enseignant-chercheur’ à l’Université, je partage en large partie les analyses de Baptiste Dericquebourg : force est de constater que les facultés de Lettres, de Philosophie et de Sciences Humaines et Sociales sont devenues de putrides vases clos où se reproduisent, incroyablement nombreux, les moucherons de la pensée. Il conviendrait néanmoins d’étendre le diagnostic à l’ensemble de l’Université, tant les autres départements ne se trouvent guère épargnés par les maux décrits par l’auteur. L’Université est morte, et ce n’est pas une mauvaise nouvelle, loin s’en faut ! Toutefois, je bute sur l’utilitarisme ambigu de l’auteur : n’est-il pas réducteur d’assimiler la littérature au besoin d’expression et d’action collective ? En faisant sien un tel postulat, Baptiste Dericquebourg rejoint les cibles qu’il s’est donné dans son essai : comme ces dernières, il procède à l’évacuation en bonne et due forme des questions métaphysiques et théologiques qui pourtant forment le sel des grandes œuvres. Le Mal, l’Origine, Dieu, le Verbe, la Création, le Logos, la Liberté, le Destin, ces catégories sont tout autant bannies de l’Université – au nom d’un geste d’émancipation vis-à-vis des traditions grecques et catholiques – qu’absentes des lèvres des Gilets Jaunes. Aussi nécessaire cela soit-il, les mots ne doivent-ils servir qu’à défendre un pouvoir d’achat ?
09/11/2020 | Lien permanent
La guerre littéraire de Didier Jacob n'a pas eu lieu

 Le problème de Didier Jacob, banal mais handicapant, tient en une seule phrase, certes longue mais tout de même pas infinie : la sympathie, surtout lorsqu'elle oublie ses racines étymologiques grecques, a autant de rapports avec la critique littéraire que Philippe Sollers en a avec la figure classique, délicieusement surannée, du grand écrivain, Amélie Nothomb avec autre chose, par exemple une romancière, qu'une habile faiseuse pour éternels adolescents complexés, François Meyronnis avec le premier (et dernier, c'est tout un) penseur du nihilisme, Pierre Assouline avec un critique littéraire digne de ce nom, Patrick Kéchichian avec un polémiste passable, François Rastier avec un éminent philologue, Laurent Gaudé avec quelque Virgile égaré dans les royaumes infernaux, ce qui n'est pas exactement la même chose que ces derniers tels qu'ils pourraient être reconstitués, à base d'une pâte en sucre candi, par la maison (sympathique, tout le monde le sait) Walt Disney.Quoi qu'il en soit, un homme qui se moque de nullités littéraires telles que Christine Angot, Florian Zeller, Mazarine Pingeot, Dominique de Villepin et Philippe Sollers (cherchez l'erreur) ne peut m'être totalement antipathique, même s'il ne critique pas vraiment, au sens propre du terme, leurs livres ou plutôt les produits qu'ils font passer pour tels. Rien de plus, sous la plume facile de Didier Jacob, que du pastiche approximatif, d'ailleurs agréable, de l'humour, rarement fin, le plus souvent potache, du ricanement, très souvent journalistique donc faussement humble, de petits propos qui ne sont que des clichés ayant pour unique visée de rassurer les lecteurs de gauche (2), bref : pas de quoi faire un livre, Didier Jacob, de vos notes de blog même si votre livre, à la différence du catalogue publicitaire récemment commis par votre vaniteux collègue (et sympathique ami ?) Pierre Assouline, est encore au moins, lui, un livre, alors que le sien ou plutôt le machin fait (au sens le moins noble de ce verbe) par votre collègue se prenant pour un Everest de la critique littéraire n'a jamais été une chose pareille, noble, merveilleuse, humble, une chose qui, même si la submergent des milliers d'autres livres, vils ou bons, est encore un livre, c'est-à-dire une singularité absolue, non pas l'indigeste compilation de bavardages le plus souvent aussi stupides qu'ils sont anonymes, ce qui n'excuse rien. Et Pierre Assouline qui, sans la moindre honte, ose évoquer, à propos de ce salmigondis indigeste, une preuve éclatante des transformations de la conversation à notre époque... Imparable bonimenteur !J'écrivais que la sympathie ne peut absolument pas être, seule, l'alliée naturelle du critique littéraire, à moins d'écrire avec la légèreté quelque peu naïvement lacrymale d'un Charle Du Bos. Didier Jacob, je crois que je ne choquerai personne en affirmant pareille évidence, n'est pas exactement, du moins quant à son talent de critique, facilement comparable à Charles Du Bos. Même quant à d'autres qualités. D'autres qualités. Et voici, l'air de rien (c'est le cas de le dire), j'ai fait du Didier Jacob comme Pierre Assouline fait du mauvais journalisme, sans même m'en rendre compte (3). Ma phrase ne veut rien dire, est monstrueuse, de sémantisme vide, sans verbe ? Et alors, je vous prie ? Et encore, les mots que j'ai très soigneusement choisis sont tout de même d'un langage soutenu, alors que ceux de Jacob paraissent avoir été mémorisés à la hâte par un pion facétieux qui aurait attentivement écouté les hauts échanges entre des gamins jouant une partie de foot... Et puis, si l'art, aussi subtil que souvent ennuyeux à force de paraître s'être admirablement coulé dans la prose (et l'esprit, et peut-être même l'âme !) de l'auteur que Du Bos commente sans fin, peut agacer puis lasser, quelle différence, de culture littéraire assurément, de sensibilité mais surtout de rythme ! Chez Du Bos, d'immenses phrases envahies, parfois littéralement contaminées par des incises entières en anglais, obéissant à leur façon au commandement étrange de Sainte-Beuve, lequel réclamait du critique qu'il sache naviguer autour puis dans un livre à la façon de voyageurs cultivés contemplant un ouvrage remarquable suspendu dans les hauteurs depuis plusieurs lieux qui en varieront les éclairages (4). Chez Didier Jacob, pas de longues phrases, ça non, pas de propositions savamment subordonnées ni même coordonnées, uniquement des membres de phrases séparées par un point et qui n'ont aucune allure et encore moins de sens : «Et puis il y a Bayrou. Bayrou, c'est autre chose» (p. 71) ou encore : «Sagan, adulée aujourd'hui. Aimée, adorée, admirée. La grande romancière française. Des rééditions, un film, une bio. Alors que bon. Les livres. Le pas tripette de ses bouquins» (p. 77). Didier Jacob ? Un Céline de salle de rédaction qui aurait fait ses classes sur les bancs des scénaristes du Miel et les abeilles...Donc, non, vous ne trouverez pas de ces horribles choses longues comme des boudins au couteau dans ma boutique mon cher monsieur, s'exclame notre sympathique vendeur d'andouilles, mais plutôt la phrase courte voire très courte érigée en andouillette AAAAA de la non-pensée journalistique et qui donne toujours, aux textes ainsi amorcés, une couleur vineuse, une haleine particulièrement chargée contrebalançant la toute première impression, plutôt... sympathique, comme si derrière quelque Rimbaud faraud de sous-préfecture se révélait, trop vite, le morveux qui ne sait pas se tenir et flanquera ses doigts dans son nez sale dès que le bon professeur de grammaire tournera le dos à la classe. En un mot : l'odeur d'une andouillette est bien celle de la merde et, quoi qu'on fasse pour donner le change, cette fragrance est réputée l'une des plus tenaces. Un boucher qui se respecte vous le dira d'ailleurs bien volontiers : le meilleur boudin au couteau (par opposition à l'industriel, déjà coupé, ndlr) de France, il faut bien tout de même, à un moment ou à un autre, décider où il commencera et donc, logiquement, où il finira pour le ranger dans le panier de la ménagère. Sans cela, sans cette coopération tacite entre le boudin et celui qui le vend, pas d'affaires ! Pareil pour les phrases de notre journaliste. Seconde règle absolue, donc, du cacographe maîtrisant ses piètres gammes : il faut absolument que les petits textes composant un volume que l'on souhaitera lui-même le plus mince possible soient introduits par une phrase-choc que nos Robespierre de la concision nomment une accroche, chargée de hameçonner le regard ou plutôt, je file ici ma métaphore, de flatter l'odorat. Exemples : «L'époque ne brille certes pas par son encéphalogramme» (p. 51) ou bien «Chez Villepin, la météo est toujours dégueulasse» (p. 58) ou encore «À la une de L'Express, il [BHL] est soucieux, sérieux, prêt à en découdre» (p. 159). La pompe, vite amorcée, ne vous versera qu'un filet d'eau saumâtre mais après tout, il est bien établi que les journalistes qui se mêlent d'écriture ne font pas la fine bouche n'est-ce pas ? Il est ainsi du plus haut comique que Didier Jacob stigmatise à juste titre la nullité absolue des phrases d'un Villepin en adoptant une écriture elle-même absolument plate. Ainsi, nous pourrions pasticher le pasticheur lorsqu'il se moque de Finkielkraut (cf. p. 141), écrivant : «Paradoxe de Jacob : il hait les mauvais écrivains, mais il calibre ses sorties pour en être l'ami, assénant des vérités sommaires (la dé-culturation) à longueur d'articles, au nom de cette «critiquette de la non-pensée» dont il s'est fait le théoricien. Il est ainsi en passe, se copiant-collant sans fin dans ses éternuements de clown ironisant, signant le bon-à-penser de critiques de plus en plus formatées pour obéir à l'impératif médiatique, d'en devenir le croisé en effet sympa, et donc sa première illustration». Vous me direz aussi que le commentateur s'adapte au texte qu'il fait mine de commenter ?J'en doute, un pasticheur de génie est le plus souvent un auteur de plein droit, qui dépasse même son modèle en bien des cas, comme Proust dans ses propres textes décalquant et moquant amoureusement la prose de certains des auteurs qu'il admirait, Chateaubriand ou Flaubert par exemple.Revenons à Sainte-Beuve, pour évoquer une phrase qui lui a été souvent reprochée, d'abord, la charge est restée célèbre, par Proust en personne : «il m’est difficile de la [l’œuvre] juger indépendamment de la connaissance de l’homme même; et je dirais volontiers : tel arbre, tel fruit. L’étude littéraire me mène ainsi tout naturellement à l’étude morale» (5).Si, partant du recueil de texte de Didier Jacob, je devais en venir à l'étude morale, il y a fort à parier que je déclarerai l'un et l'autre : sympathiques, donc nuls.Le grand lecteur que Didier Jacob est sans conteste, même si, nul n'est parfait, il avoue ne strictement rien connaître, par exemple, aux auteurs de science-fiction, ce grand lecteur donc, lisant mes propres lignes, ne pourra s'empêcher, sous son sourire perpétuellement ironique, de lever les yeux au plafond de sa salle de rédaction, s'exclamant : quoi, ce pauvre Asensio qui se targue de mieux savoir lire que mon très honorable et estimé ami Pierre Assouline, plus grand critique que tous ces Saint-Bœuf, Teigne, Renaud et Dubosse que je ne connais pas, n'a même pas remarqué que je n'étais absolument pas sympathique, que ce n'était là qu'une façade, une supercherie, une ruse facile que Florian Zeller en personne a éventée (oui, bon : au bout d'un bon millier de relectures, et alors ?) de mes notes ? Il n'a pas compris qu'en fait, j'étais méchant, horriblement méchant ? Que j'étais la méchanceté faite homme ? Critique ? La méchanceté elle-même, quoi ? La belle affaire que d'être méchant, horriblement méchant, avec des pitres tels que ceux que moque Didier Jacob ! Et puis, n'importe quel polémiste digne de ce nom vous le dira sans hésitation, cher Didier : la méchanceté est facile, c'est même la chose la plus facile qui soit pourvu que, cela va sans dire, l'on maîtrise quelque peu son écriture afin de la rendre aussi blessante qu'il le faut, que les imbéciles le méritent. La difficulté, l'horrible difficulté en lettres, ce n'est point le bête contraire de la méchanceté, la gentillesse (ou sa sirupeuse contrefaçon, bien illustrée par une Alina Reyes bientôt canonisable : une mièvre esthétisation érotique de la religion) mais plutôt ce que je nommerai, faute de meilleur terme, une bonté admirative à l'égard du livre décortiqué en quelques phrases ou pages, puisqu'il est décidément infiniment délicat d'évoquer un livre ou un auteur que l'on admire sans tomber dans le ridicule de l'éloge maladroit ou la froideur sans âme de la bluette universitaire. Et c'est là que le bât blesse. Qu'il blesse. Le bât, écrirait le faussement sympathique puisqu'en fait il est très méchant Didier Jacob. Lorsque notre journaliste évoque les auteurs qu'il admire dans le chapitre le plus court de son recueil (pp. 111-130), qu'il s'agisse de Virginia Woolf, Cormac McCarthy ou Pierre Michon critiqué par l'admirable (selon son ancien élève) Jean-Pierre Richard, nous assistons à un cérémonieux étalage de platitudes. Car, après tout, le fait que McCarthy parle, à tout le moins devant un public, aussi peu que Faulkner ne devrait pas empêcher un critique littéraire un peu sérieux d'évoquer, espérons-le intelligemment, ses livres n'est-ce pas ? Quoi d'étonnant, en outre, que l'un des plus grands écrivains vivants ait si peu de choses à dire ou révéler à un journaliste, s'il estime raisonnablement que ses romans s'enfonceront toujours plus profondément dans les strates du langage que quelques minutes ou heures accordées à qui, de toute façon, s'il sait, parfois, entendre, ne sait assurément jamais écouter : un journaliste ? Didier Jacob lui, paraît s'extasier, la main contre la poitrine, de ses très maigres découvertes : le maléfice de taciturnité dont semble affecté Cormac McCarthy, comme l'appelaient jadis les inquisiteurs, provoquera cependant la rédaction d'un article ne nous apprenant rien, commençant de toute façon mal, de la façon la plus convenue qui soit par une citation parfaitement inepte et ridiculement fière de sa bêtise de Jérôme Garcin (du Nouvel Obs bien sûr), se terminant par la scène banale de la rencontre improbable d'un grand écrivain, Cormac McCarthy, avec un habile faiseur d'historiettes pour gamins de classe de cinquième, Jean-Marie Le Clézio. En fin de compte, sans doute parce que le style de Jacob, fait de petites notations qu'aucune concaténation autre que purement rhétorique ne relie vraiment, se prête assez bien à l'écriture d'un texte sans réel sujet, le meilleur passage du livre de notre journaliste est celui où il évoque le voyage dans l'Allemagne nazie d'un écrivain aussi injustement oublié que Denis de Rougemont (cf. pp. 125-130) alors que, évoquant le journal de Virginia Woolf, Jacob devient aussi prodigieusement ennuyeux que son modèle pourtant admiré.Nous avons dépassé la moitié de notre recueil de textes électroniques (mais tout de même retravaillés en vue de leur publication, ne nous plaignons donc point trop, je vous prie). Pouvons-nous d'ores et déjà en juger la portée ? Didier Jacob a-t-il bien fait, dès son introduction, de nous avertir qu'il ne se prenait pas au sérieux, y compris et surtout en tant que critique littéraire ? Bien sûr puisque, redevenu sarcastique, vachard, méchant après ce court passage louangeur où il semble ne pas avoir été dans son élément, il étrille l'infâme Guillaume Durand, le pathétique et baveux Jean-François Kahn, l'insupportable BHL, le plus talentueux de nos clowns, Philippe Sollers et quelques autres dont l'avenir ne gardera nulle trace, utilisant ses armes habituelles que sont le pathos méprisable et bien-pensant digne d'un ponte du Monde diplomatique, les jeux de mots péniblement alignés par un potache pas même fort en thème, l'intention parodique tournant à vide, la méconnaissance, voire l'ignorance profonde (concernant Debord, Finkielkraut ou Muray) de l'auteur qu'il mitraille avec des balles à blanc, méconnaissance et ignorance transformées en sotte formule journalistique chargée d'exécuter le malheureux alors qu'elle ne fait que ridiculiser celui qui l'a utilisée, le sympathique et méchant Didier Jacob, critique littéraire pour rire, blogueur hebdomadaire, journaliste quoi qu'il en soit de son état.Notes(1) Pierre Assouline et Didier Jacob ont été les récents invités de Parlonsnet, le club de la presse d’Internet, interrogés par David Abiker pour France Info, Anaële Verzaux pour Bakchich.info (un site au-dessus de tout soupçon qui d'ailleurs, sous la plume de Simon Piel, ne pense que du bien du livre de Jacob) et enfin Élisabeth Lévy pour Causeur.fr. Quel peut être l'intérêt de ce genre d'émission ultra-convenue, où David Abiker du moins remplit honnêtement son rôle consistant à chronométrer les temps de parole respectifs, Anaële Verzaux pose des questions d'une inconcevable bêtise (ce ne sont donc pas de vraies questions, ni même des questions...) et Élisabeth Lévy nous gratifie d'interventions aussi sympathiques (décidément) que peu pertinentes ? Aucun bien sûr : cela s'appelle du journalisme, autre mot, paraît-il noble, pour désigner une horrible et infamante réalité, l'entreléchage.(2) Par exemple : «Je ne sais pas ce que les étudiants pensent du socle commun de conscience entre les différents établissements, mais le fait est que le coma du gars que les CRS ont piétiné place de la Nation a fait l'effet d'un tsunami émotionnel qui s'est ressenti, ma foi, au moins jusqu'au boul'Mich», p. 69. Les textes en fin d'ouvrage, regroupés dans un chapitre intitulé Un peu de sérieux, textes qui ne sont d'ailleurs absolument pas des critiques littéraires (ou ce qui passe pour un travail critique aux yeux de Jacob) mais des billets d'humeur se voulant je le suppose des cris de colère frémissants de courage, atteignent, eux, des sommets ou plutôt des abîmes de bien-pensance repue.(3) L'original porte, p. 55 : «Reprenons de zéro. De [François] Léotard, donc».(4) Sainte-Beuve écrit : «L’art qui médite, qui édifie, qui vit en lui-même et dans son œuvre, l’art peut se représenter aux yeux par quelque château antique et vénérable que baigne un fleuve, par un monastère sur la rive, par un rocher immobile et majestueux; mais, de chacun de ces rochers ou de ces châteaux, la vue, bien qu’immense, ne va pas à tous les autres points, et beaucoup de ces nobles monuments, de ces merveilleux paysages, s’ignorent en quelque sorte les uns les autres; or la critique, dont la loi est la mobilité et la succession, circule comme le fleuve à leur base, les entoure, les baigne, les réfléchit dans ses eaux, et transporte avec facilité, de l’un à l’autre, le voyageur qui les veut connaître. […] De plus, en poursuivant l’image, en supposant le fleuve détourné, brisé, fatigué à travers les canaux, les usines, saigné à droite et à gauche, comme le Rhin dans les sables et la vase hollandaise, on retrouve la critique telle exactement que la font les besoins de chaque jour, dans sa marche sans cesse coupée et reprise», Pour la critique (Gallimard, coll. Folio Essais, 1992, présentation par Annie Prassoloff et José-Luis Diaz), pp. 129-130. (5) Cité dans Jean-Thomas Nordmann, La Critique littéraire française au XIXe siècle (1800-1914) (Le Livre de poche, coll. Références, 2001), p. 246.
Le problème de Didier Jacob, banal mais handicapant, tient en une seule phrase, certes longue mais tout de même pas infinie : la sympathie, surtout lorsqu'elle oublie ses racines étymologiques grecques, a autant de rapports avec la critique littéraire que Philippe Sollers en a avec la figure classique, délicieusement surannée, du grand écrivain, Amélie Nothomb avec autre chose, par exemple une romancière, qu'une habile faiseuse pour éternels adolescents complexés, François Meyronnis avec le premier (et dernier, c'est tout un) penseur du nihilisme, Pierre Assouline avec un critique littéraire digne de ce nom, Patrick Kéchichian avec un polémiste passable, François Rastier avec un éminent philologue, Laurent Gaudé avec quelque Virgile égaré dans les royaumes infernaux, ce qui n'est pas exactement la même chose que ces derniers tels qu'ils pourraient être reconstitués, à base d'une pâte en sucre candi, par la maison (sympathique, tout le monde le sait) Walt Disney.Quoi qu'il en soit, un homme qui se moque de nullités littéraires telles que Christine Angot, Florian Zeller, Mazarine Pingeot, Dominique de Villepin et Philippe Sollers (cherchez l'erreur) ne peut m'être totalement antipathique, même s'il ne critique pas vraiment, au sens propre du terme, leurs livres ou plutôt les produits qu'ils font passer pour tels. Rien de plus, sous la plume facile de Didier Jacob, que du pastiche approximatif, d'ailleurs agréable, de l'humour, rarement fin, le plus souvent potache, du ricanement, très souvent journalistique donc faussement humble, de petits propos qui ne sont que des clichés ayant pour unique visée de rassurer les lecteurs de gauche (2), bref : pas de quoi faire un livre, Didier Jacob, de vos notes de blog même si votre livre, à la différence du catalogue publicitaire récemment commis par votre vaniteux collègue (et sympathique ami ?) Pierre Assouline, est encore au moins, lui, un livre, alors que le sien ou plutôt le machin fait (au sens le moins noble de ce verbe) par votre collègue se prenant pour un Everest de la critique littéraire n'a jamais été une chose pareille, noble, merveilleuse, humble, une chose qui, même si la submergent des milliers d'autres livres, vils ou bons, est encore un livre, c'est-à-dire une singularité absolue, non pas l'indigeste compilation de bavardages le plus souvent aussi stupides qu'ils sont anonymes, ce qui n'excuse rien. Et Pierre Assouline qui, sans la moindre honte, ose évoquer, à propos de ce salmigondis indigeste, une preuve éclatante des transformations de la conversation à notre époque... Imparable bonimenteur !J'écrivais que la sympathie ne peut absolument pas être, seule, l'alliée naturelle du critique littéraire, à moins d'écrire avec la légèreté quelque peu naïvement lacrymale d'un Charle Du Bos. Didier Jacob, je crois que je ne choquerai personne en affirmant pareille évidence, n'est pas exactement, du moins quant à son talent de critique, facilement comparable à Charles Du Bos. Même quant à d'autres qualités. D'autres qualités. Et voici, l'air de rien (c'est le cas de le dire), j'ai fait du Didier Jacob comme Pierre Assouline fait du mauvais journalisme, sans même m'en rendre compte (3). Ma phrase ne veut rien dire, est monstrueuse, de sémantisme vide, sans verbe ? Et alors, je vous prie ? Et encore, les mots que j'ai très soigneusement choisis sont tout de même d'un langage soutenu, alors que ceux de Jacob paraissent avoir été mémorisés à la hâte par un pion facétieux qui aurait attentivement écouté les hauts échanges entre des gamins jouant une partie de foot... Et puis, si l'art, aussi subtil que souvent ennuyeux à force de paraître s'être admirablement coulé dans la prose (et l'esprit, et peut-être même l'âme !) de l'auteur que Du Bos commente sans fin, peut agacer puis lasser, quelle différence, de culture littéraire assurément, de sensibilité mais surtout de rythme ! Chez Du Bos, d'immenses phrases envahies, parfois littéralement contaminées par des incises entières en anglais, obéissant à leur façon au commandement étrange de Sainte-Beuve, lequel réclamait du critique qu'il sache naviguer autour puis dans un livre à la façon de voyageurs cultivés contemplant un ouvrage remarquable suspendu dans les hauteurs depuis plusieurs lieux qui en varieront les éclairages (4). Chez Didier Jacob, pas de longues phrases, ça non, pas de propositions savamment subordonnées ni même coordonnées, uniquement des membres de phrases séparées par un point et qui n'ont aucune allure et encore moins de sens : «Et puis il y a Bayrou. Bayrou, c'est autre chose» (p. 71) ou encore : «Sagan, adulée aujourd'hui. Aimée, adorée, admirée. La grande romancière française. Des rééditions, un film, une bio. Alors que bon. Les livres. Le pas tripette de ses bouquins» (p. 77). Didier Jacob ? Un Céline de salle de rédaction qui aurait fait ses classes sur les bancs des scénaristes du Miel et les abeilles...Donc, non, vous ne trouverez pas de ces horribles choses longues comme des boudins au couteau dans ma boutique mon cher monsieur, s'exclame notre sympathique vendeur d'andouilles, mais plutôt la phrase courte voire très courte érigée en andouillette AAAAA de la non-pensée journalistique et qui donne toujours, aux textes ainsi amorcés, une couleur vineuse, une haleine particulièrement chargée contrebalançant la toute première impression, plutôt... sympathique, comme si derrière quelque Rimbaud faraud de sous-préfecture se révélait, trop vite, le morveux qui ne sait pas se tenir et flanquera ses doigts dans son nez sale dès que le bon professeur de grammaire tournera le dos à la classe. En un mot : l'odeur d'une andouillette est bien celle de la merde et, quoi qu'on fasse pour donner le change, cette fragrance est réputée l'une des plus tenaces. Un boucher qui se respecte vous le dira d'ailleurs bien volontiers : le meilleur boudin au couteau (par opposition à l'industriel, déjà coupé, ndlr) de France, il faut bien tout de même, à un moment ou à un autre, décider où il commencera et donc, logiquement, où il finira pour le ranger dans le panier de la ménagère. Sans cela, sans cette coopération tacite entre le boudin et celui qui le vend, pas d'affaires ! Pareil pour les phrases de notre journaliste. Seconde règle absolue, donc, du cacographe maîtrisant ses piètres gammes : il faut absolument que les petits textes composant un volume que l'on souhaitera lui-même le plus mince possible soient introduits par une phrase-choc que nos Robespierre de la concision nomment une accroche, chargée de hameçonner le regard ou plutôt, je file ici ma métaphore, de flatter l'odorat. Exemples : «L'époque ne brille certes pas par son encéphalogramme» (p. 51) ou bien «Chez Villepin, la météo est toujours dégueulasse» (p. 58) ou encore «À la une de L'Express, il [BHL] est soucieux, sérieux, prêt à en découdre» (p. 159). La pompe, vite amorcée, ne vous versera qu'un filet d'eau saumâtre mais après tout, il est bien établi que les journalistes qui se mêlent d'écriture ne font pas la fine bouche n'est-ce pas ? Il est ainsi du plus haut comique que Didier Jacob stigmatise à juste titre la nullité absolue des phrases d'un Villepin en adoptant une écriture elle-même absolument plate. Ainsi, nous pourrions pasticher le pasticheur lorsqu'il se moque de Finkielkraut (cf. p. 141), écrivant : «Paradoxe de Jacob : il hait les mauvais écrivains, mais il calibre ses sorties pour en être l'ami, assénant des vérités sommaires (la dé-culturation) à longueur d'articles, au nom de cette «critiquette de la non-pensée» dont il s'est fait le théoricien. Il est ainsi en passe, se copiant-collant sans fin dans ses éternuements de clown ironisant, signant le bon-à-penser de critiques de plus en plus formatées pour obéir à l'impératif médiatique, d'en devenir le croisé en effet sympa, et donc sa première illustration». Vous me direz aussi que le commentateur s'adapte au texte qu'il fait mine de commenter ?J'en doute, un pasticheur de génie est le plus souvent un auteur de plein droit, qui dépasse même son modèle en bien des cas, comme Proust dans ses propres textes décalquant et moquant amoureusement la prose de certains des auteurs qu'il admirait, Chateaubriand ou Flaubert par exemple.Revenons à Sainte-Beuve, pour évoquer une phrase qui lui a été souvent reprochée, d'abord, la charge est restée célèbre, par Proust en personne : «il m’est difficile de la [l’œuvre] juger indépendamment de la connaissance de l’homme même; et je dirais volontiers : tel arbre, tel fruit. L’étude littéraire me mène ainsi tout naturellement à l’étude morale» (5).Si, partant du recueil de texte de Didier Jacob, je devais en venir à l'étude morale, il y a fort à parier que je déclarerai l'un et l'autre : sympathiques, donc nuls.Le grand lecteur que Didier Jacob est sans conteste, même si, nul n'est parfait, il avoue ne strictement rien connaître, par exemple, aux auteurs de science-fiction, ce grand lecteur donc, lisant mes propres lignes, ne pourra s'empêcher, sous son sourire perpétuellement ironique, de lever les yeux au plafond de sa salle de rédaction, s'exclamant : quoi, ce pauvre Asensio qui se targue de mieux savoir lire que mon très honorable et estimé ami Pierre Assouline, plus grand critique que tous ces Saint-Bœuf, Teigne, Renaud et Dubosse que je ne connais pas, n'a même pas remarqué que je n'étais absolument pas sympathique, que ce n'était là qu'une façade, une supercherie, une ruse facile que Florian Zeller en personne a éventée (oui, bon : au bout d'un bon millier de relectures, et alors ?) de mes notes ? Il n'a pas compris qu'en fait, j'étais méchant, horriblement méchant ? Que j'étais la méchanceté faite homme ? Critique ? La méchanceté elle-même, quoi ? La belle affaire que d'être méchant, horriblement méchant, avec des pitres tels que ceux que moque Didier Jacob ! Et puis, n'importe quel polémiste digne de ce nom vous le dira sans hésitation, cher Didier : la méchanceté est facile, c'est même la chose la plus facile qui soit pourvu que, cela va sans dire, l'on maîtrise quelque peu son écriture afin de la rendre aussi blessante qu'il le faut, que les imbéciles le méritent. La difficulté, l'horrible difficulté en lettres, ce n'est point le bête contraire de la méchanceté, la gentillesse (ou sa sirupeuse contrefaçon, bien illustrée par une Alina Reyes bientôt canonisable : une mièvre esthétisation érotique de la religion) mais plutôt ce que je nommerai, faute de meilleur terme, une bonté admirative à l'égard du livre décortiqué en quelques phrases ou pages, puisqu'il est décidément infiniment délicat d'évoquer un livre ou un auteur que l'on admire sans tomber dans le ridicule de l'éloge maladroit ou la froideur sans âme de la bluette universitaire. Et c'est là que le bât blesse. Qu'il blesse. Le bât, écrirait le faussement sympathique puisqu'en fait il est très méchant Didier Jacob. Lorsque notre journaliste évoque les auteurs qu'il admire dans le chapitre le plus court de son recueil (pp. 111-130), qu'il s'agisse de Virginia Woolf, Cormac McCarthy ou Pierre Michon critiqué par l'admirable (selon son ancien élève) Jean-Pierre Richard, nous assistons à un cérémonieux étalage de platitudes. Car, après tout, le fait que McCarthy parle, à tout le moins devant un public, aussi peu que Faulkner ne devrait pas empêcher un critique littéraire un peu sérieux d'évoquer, espérons-le intelligemment, ses livres n'est-ce pas ? Quoi d'étonnant, en outre, que l'un des plus grands écrivains vivants ait si peu de choses à dire ou révéler à un journaliste, s'il estime raisonnablement que ses romans s'enfonceront toujours plus profondément dans les strates du langage que quelques minutes ou heures accordées à qui, de toute façon, s'il sait, parfois, entendre, ne sait assurément jamais écouter : un journaliste ? Didier Jacob lui, paraît s'extasier, la main contre la poitrine, de ses très maigres découvertes : le maléfice de taciturnité dont semble affecté Cormac McCarthy, comme l'appelaient jadis les inquisiteurs, provoquera cependant la rédaction d'un article ne nous apprenant rien, commençant de toute façon mal, de la façon la plus convenue qui soit par une citation parfaitement inepte et ridiculement fière de sa bêtise de Jérôme Garcin (du Nouvel Obs bien sûr), se terminant par la scène banale de la rencontre improbable d'un grand écrivain, Cormac McCarthy, avec un habile faiseur d'historiettes pour gamins de classe de cinquième, Jean-Marie Le Clézio. En fin de compte, sans doute parce que le style de Jacob, fait de petites notations qu'aucune concaténation autre que purement rhétorique ne relie vraiment, se prête assez bien à l'écriture d'un texte sans réel sujet, le meilleur passage du livre de notre journaliste est celui où il évoque le voyage dans l'Allemagne nazie d'un écrivain aussi injustement oublié que Denis de Rougemont (cf. pp. 125-130) alors que, évoquant le journal de Virginia Woolf, Jacob devient aussi prodigieusement ennuyeux que son modèle pourtant admiré.Nous avons dépassé la moitié de notre recueil de textes électroniques (mais tout de même retravaillés en vue de leur publication, ne nous plaignons donc point trop, je vous prie). Pouvons-nous d'ores et déjà en juger la portée ? Didier Jacob a-t-il bien fait, dès son introduction, de nous avertir qu'il ne se prenait pas au sérieux, y compris et surtout en tant que critique littéraire ? Bien sûr puisque, redevenu sarcastique, vachard, méchant après ce court passage louangeur où il semble ne pas avoir été dans son élément, il étrille l'infâme Guillaume Durand, le pathétique et baveux Jean-François Kahn, l'insupportable BHL, le plus talentueux de nos clowns, Philippe Sollers et quelques autres dont l'avenir ne gardera nulle trace, utilisant ses armes habituelles que sont le pathos méprisable et bien-pensant digne d'un ponte du Monde diplomatique, les jeux de mots péniblement alignés par un potache pas même fort en thème, l'intention parodique tournant à vide, la méconnaissance, voire l'ignorance profonde (concernant Debord, Finkielkraut ou Muray) de l'auteur qu'il mitraille avec des balles à blanc, méconnaissance et ignorance transformées en sotte formule journalistique chargée d'exécuter le malheureux alors qu'elle ne fait que ridiculiser celui qui l'a utilisée, le sympathique et méchant Didier Jacob, critique littéraire pour rire, blogueur hebdomadaire, journaliste quoi qu'il en soit de son état.Notes(1) Pierre Assouline et Didier Jacob ont été les récents invités de Parlonsnet, le club de la presse d’Internet, interrogés par David Abiker pour France Info, Anaële Verzaux pour Bakchich.info (un site au-dessus de tout soupçon qui d'ailleurs, sous la plume de Simon Piel, ne pense que du bien du livre de Jacob) et enfin Élisabeth Lévy pour Causeur.fr. Quel peut être l'intérêt de ce genre d'émission ultra-convenue, où David Abiker du moins remplit honnêtement son rôle consistant à chronométrer les temps de parole respectifs, Anaële Verzaux pose des questions d'une inconcevable bêtise (ce ne sont donc pas de vraies questions, ni même des questions...) et Élisabeth Lévy nous gratifie d'interventions aussi sympathiques (décidément) que peu pertinentes ? Aucun bien sûr : cela s'appelle du journalisme, autre mot, paraît-il noble, pour désigner une horrible et infamante réalité, l'entreléchage.(2) Par exemple : «Je ne sais pas ce que les étudiants pensent du socle commun de conscience entre les différents établissements, mais le fait est que le coma du gars que les CRS ont piétiné place de la Nation a fait l'effet d'un tsunami émotionnel qui s'est ressenti, ma foi, au moins jusqu'au boul'Mich», p. 69. Les textes en fin d'ouvrage, regroupés dans un chapitre intitulé Un peu de sérieux, textes qui ne sont d'ailleurs absolument pas des critiques littéraires (ou ce qui passe pour un travail critique aux yeux de Jacob) mais des billets d'humeur se voulant je le suppose des cris de colère frémissants de courage, atteignent, eux, des sommets ou plutôt des abîmes de bien-pensance repue.(3) L'original porte, p. 55 : «Reprenons de zéro. De [François] Léotard, donc».(4) Sainte-Beuve écrit : «L’art qui médite, qui édifie, qui vit en lui-même et dans son œuvre, l’art peut se représenter aux yeux par quelque château antique et vénérable que baigne un fleuve, par un monastère sur la rive, par un rocher immobile et majestueux; mais, de chacun de ces rochers ou de ces châteaux, la vue, bien qu’immense, ne va pas à tous les autres points, et beaucoup de ces nobles monuments, de ces merveilleux paysages, s’ignorent en quelque sorte les uns les autres; or la critique, dont la loi est la mobilité et la succession, circule comme le fleuve à leur base, les entoure, les baigne, les réfléchit dans ses eaux, et transporte avec facilité, de l’un à l’autre, le voyageur qui les veut connaître. […] De plus, en poursuivant l’image, en supposant le fleuve détourné, brisé, fatigué à travers les canaux, les usines, saigné à droite et à gauche, comme le Rhin dans les sables et la vase hollandaise, on retrouve la critique telle exactement que la font les besoins de chaque jour, dans sa marche sans cesse coupée et reprise», Pour la critique (Gallimard, coll. Folio Essais, 1992, présentation par Annie Prassoloff et José-Luis Diaz), pp. 129-130. (5) Cité dans Jean-Thomas Nordmann, La Critique littéraire française au XIXe siècle (1800-1914) (Le Livre de poche, coll. Références, 2001), p. 246.
08/11/2008 | Lien permanent




























































