Rechercher : alain soral
La horde des contresens, par Jean-Baptiste Morizot

Je terminerai en ajoutant que, comme bien des ouvrages qu'Olivier a évoqués sur son excellent blog (je ne le répéterai jamais assez), je n'ai toujours pas lu La Horde du Contrevent. Avant, donc, de livrer (mais rien n'est moins certain, devant la masse des livres qu'il me reste à lire, que je dois lire, que je dois relire...) mon propre texte sur ce roman (et puis, que dire, je vous le demande, après les analyses expertes d'Olivier ou même celles, pléthoriques et tirant quelques barriques d'honnête vin d'un seul grain de raisin, de Bruno Gaultier), il m'a paru assez équitable d'offrir à mes lecteurs un contrepoint aux vues exprimées par Olivier. Alain Damasio, que j'ai du reste informé de cette parution, m'a déclaré qu'un auteur conséquent se devait d'être secoué.
Dont acte.
Bien sûr, je suis tout disposé à publier l'éventuelle réponse de Damasio, s'il estimait qu'une utile confrontation pourrait avoir la Zone (tant de zones...) comme théâtre des opérations. D'ores et déjà, j'autorise les commentaires pour cette seule note.
Après avoir lu sur le site du Cafard cosmique, qui décidément porte bien son nom, l’entretien accordé récemment par Alain Damasio (1), je n’ai pu me défaire d’un sentiment d’infinie tristesse. Voilà un écrivain pourtant indiscutablement talentueux, qui combinait une vraie curiosité philosophique à des romans au style évident. Las ! Celui qu’on nous présentait comme la nouvelle gloire de la science-fiction française, et qui semblait si prometteur, s’avère n’être qu’un relais de plus aux ordres du militantisme rebelle à la mode. Tout au long de ses réponses, Damasio nous égrène en effet la litanie sans fin des pires lieux communs de l’extrême gauche branchée. Le vilain Sarkozy, les gentils Bové et Besancenot, les admirables jeunes militants engagés (maître-mot s’il en est), la défense d’une écologie anti-technique et bravache qui saccage des champs d’OGM… On ne nous fera grâce de rien, pas même d’une ridicule apologie du recours à la violence, sorte d’insipide resucée soixante-huitarde selon laquelle les CRS sont méchants, et que contre un gouvernement de vilains fascistes (le nôtre bien sûr…) on peut tout faire, et qu’Action Directe c’était super…
Jusque-là tout va bien, si je puis dire, mis à part l’infection d’un encéphale pourtant capable par la banalité la plus plate et insipide. Mais le fond de la nullité cognitive sera atteint lorsqu’il s’agira d’annexer une authentique philosophie pour justifier ces propos.
Osant en effet se réclamer de Deleuze, Damasio nous assène les contresens les plus habituels et les plus grossiers sur le multiple et la différence, qui se ramèneraient à tolérer tout et n’importe quoi, du moment qu’il s’agit d’associations et de groupuscules anarchistes. Il est vrai que l’extrême gauche est connue pour son ouverture d’esprit : elle laisse volontiers en paix les dealers et les incendiaires de banlieues et accueille à bras ouvert les écolos-terroristes, le Jihad butlérien cher à Herbert, ou encore défend avec des accents de vierges effarouchées la liberté de penser des islamistes radicaux. Je veux bien le croire. Le diable a le même genre de tolérance. Il doit beaucoup aimer les «politiques» français.
En somme, pas une ligne qui ne suinte la haine exsudée par le militant gauchiste de base et l’indigence intellectuelle de l’alter-mondialiste. On nous explique ainsi que Deleuze est le chantre des communautés «nomades», «libres» et «multiples», et qu’on en voit déjà comme un exemple chez les partis d’extrême gauche, notamment chez José Bové ! Comment un écrivain de science-fiction peut-il encenser José Bové, c’est-à-dire l’homme qui détruit des organismes génétiquement modifiés issus de la pointe de déterritorialisation de la science occidentale, José Bové, c’est-à-dire ce symbole de l’ignorance qui tremble devant les technologies biocybernétiques du siècle à venir et préfère détruire ce qu’il ne comprend pas plutôt que de s’adapter ? Voilà qui me dépasse. On ne peut que s’étonner qu’un écrivain de science-fiction soutienne un homme qui promeut une sorte de Jihad butlérien, cette guerre contre toute technologie qu’avait imaginée Herbert dans Dune. À l’en croire, les subtilités raffinées de la philosophie deleuzienne sont parfaitement incarnées par une jeunesse rebelle et engagée, pour qui cet arracheur de maïs fait figure d’éminence grise… On se demande avec consternation comment un homme qui pense sauver la planète grâce à des water-closets à la sciure de bois pourrait être le disciple caché de L’Anti-Œdipe.
À vrai dire, il n’en est évidemment rien, mais à le suggérer, mais à rapprocher sans cesse la pensée deleuzienne de la non-pensée alter-mondialiste, on risque de réussir à le faire croire à une génération qui ne demande qu’à acquiescer sans se donner le temps de lire et de méditer. Ainsi, l’on nous confisque l’un des derniers grands philosophes français. L’abrutissement généralisé qui gagne notre nation a ceci de remarquable qu’il s’en prend à tout, y compris à ce qu’il reste de pensée chez elle. À croire qu’il lui faut nécessairement avilir ce qui restait de puissant ou de beau dans notre pays.
Et certes, qu’on nous empêche de lire Bloy ou de Maistre n’a rien de très surprenant, et nous savons passer outre, mais qu’on nous enlève un grand penseur est plus problématique, parce qu’à force de le dénaturer, Deleuze finira par ne plus être lu par les personnes qui en ont ou en auront besoin.
Un exemple : en se servant de Mille Plateaux, on serait à même de comprendre le décodage de l’ADN et la transformation par ingénierie génétique qui en découle. C’est par Deleuze qu’on peut penser le lien entre décodage/déterritorialisation et reterritorialisation sur un autre pôle (dans le cas de la réécriture génomique). Le début de Mille Plateaux parle d’ailleurs explicitement d’un virus commun au chat et au babouin qui crée une sorte de déterritorialisation de l’un sur l’autre, avant d’évoquer les créatures hybrides issues des «amours abominables» chères à l’Antiquité et au Moyen Âge comme un exemple paradigmatique de la nouvelle pensée rhizomique. Or les organismes génétiquement modifiés posent effectivement à l’humanité un problème majeur; non par ce qu’ils sont (quelques allèles modifiés ne changent pas grand-chose à notre essence), mais par ce qu’ils initient. La refonte de notre propre ADN, voire son hybridation avec un ADN non-humain se profilent déjà à l’horizon, ainsi que toutes les illusions, les erreurs et les délires de grandeur qui peuvent s’y associer.
Grâce à Deleuze nous pourrons conceptualiser ces communications transversales qui vont brouiller nos arbres généalogiques ainsi que ces évolutions aparallèles entre notre nature et celles d’autres vivants. Mais si les têtes «pensantes» d’une gauche qui ne va pas tarder à se dégonfler sous la pression des changements à venir contaminent Deleuze, c’est un moyen crucial de comprendre ce qui nous arrive qui sera perdu. Si la lecture communiste-révolutionnaire de Deleuze n’est pas rapidement combattue et vaincue, sa philosophie disparaîtra en même temps que les idéologies rances qui l’ont absorbée.
Rappelons pourtant qu’en vrai philosophe, Deleuze, plaçait la conceptualisation au-dessus de l’obscurantisme médiatique et tapageur, donc la compréhension de la déterritorialisation génétique avant le saccage de matériel d’expérimentation scientifique. Signalons également à nos chantres de la différence que rien n’est moins deleuzien que cette façon de transformer la différance et la diversité en Idée platonicienne (sa version populaire disons), en gros concept matraqué comme un mantra ou un talisman. Car Deleuze n’a rien du gauchiste fanatique réclamant l’effacement d’Israël et la ruine des USA, pas plus qu’il n’est l’apôtre de la «diversité culturelle» ou des sacro-saintes multiplicités, comme je vais en esquisser la démonstration.
La multiplicité et ses prédicats
J’étudierai pour ce faire l’introduction de Mille Plateaux. Car même si le livre se donne comme fait de «plateaux» indépendants, il est à remarquer que cette introduction nommée Rhizome possède un caractère programmatique, méthodique et spéculatif qui la place bien au-dessus du reste du livre, non pas tant du point de vue du contenu que parce qu’elle en est en quelque sorte le code, la carte des territoires que le reste de l’ouvrage parcourra.
Or, dans cette introduction, la multiplicité n’est pas déifiée comme seule réalité qui ferait déchoir l’Un. La multiplicité est seulement définie comme le seul étant véritable. Elle est un Multiple qui cesse d’être confondu avec son attribution pour être substantivée (2). La multiplicité n’est plus rejetée au rang de simple apparence, comme chez nombre de philosophes antérieurs, mais du coup le terme «multiple» peut reprendre son vrai sens. Car si la multiplicité était cachée en certain cas sous un multiple mal conçu, il n’en reste pas moins que parfois le multiple peut encore être attribué (3). De même en est-il de l’Un quelques lignes plus bas : il cesse seulement d’être substantivé pour n’être plus qu’attribuable aux multiplicités.
Mais que l’Un et le Multiple ne soient pas des substantifs, c’est-à-dire des ens, ne signifie pas qu’ils ne sont rien. En effet, Deleuze n’a cessé, depuis la Logique du Sens, en passant par le chapitre 4 de Mille Plateaux, d’établir une logique des attributs empruntée aux stoïciens. Pour eux, le prédicat n’existe pas en effet, car seuls existent les corps, susceptibles d’actions et de passions. Les prédicats qui disent seulement quelque chose au sujet des corps subsistent plus qu’ils n’existent. Ces prédicats incorporels, les lekton ou dicibles, Deleuze va même leur donner une force réelle, une efficace considérable, puisqu’il va en faire des verbes performatifs.
Si la société est bien ce qui opère réellement sur les corps, si c’est bien la seule réalité qui emprisonne les personnes, produit les biens, conditionne et modifie les aliments, les habitations, etc., en revanche, c’est le langage, et dans le langage les prédicats incorporels, qui étiquettent les corps, les rangent dans telle ou telle catégorie qui détermine ce qui peut leur être infligé comme passion ou les actions dont ils sont capables. Le juge qui condamne un homme n’impose pas par lui-même des barrières à ses mouvements, mais la prédication de la culpabilité rend la personne susceptible d’être mise en cellule, entravée, surveillée. «En exprimant l’attribut non corporel, et du même coup en l’attribuant au corps, on ne représente pas, on ne réfère pas, on intervient en quelque sorte, et c’est un acte de langage» (4).
Nous sommes bien d’accord : le prédicat n’est pas rien. Certes, le rhizome est opposé à l’arbre, parce qu’il est pure multiplicité, ouverte telle la durée bergsonienne au reste du monde, alors que l’arbre divise l’ensemble de la réalité sans communication possible entre les espèces parce que chaque terme est clos sur soi. Mais lorsque l’Introduction de notre livre condamne et la division binaire qui arbrifie le rhizome et le multiple de la modernité qui se détermine par absorption de l’Un toujours présent en creux comme unité supérieure, de même que dans la division c’est toujours par le passage pivotal au travers de l’Un que les branches divergent, elle ne nie pas leur réalité. Seulement, le seul étant, le seul corps diraient les stoïciens, c’est la multiplicité. Cela n’empêche pas que les passions et les actions qu’elle reçoit permettent de lui attribuer l’unité et la multiplicité. Et non seulement rien ne l’empêche, mais tout le réclame, car de même que le corps sans organe ne cesse de se faire et de se défaire, la multiplicité ne cesse «d’unifier» et/ou de «multiplier».
Les deux dicibles Multiple et Un ne sont donc pas des catégories répudiées au nom de la sacro-sainte multiplicité immanente. Car, de même qu’on ne peut imaginer un corps qui n’a ni action ni passion, on ne peut imaginer dans les faits la multiplicité sans Un ou Multiple.
Parfois le Multiple est fait (5), parfois c’est l’Un. Mais en tout cas ces deux prédicats partagent sans reste les modes possibles de la multiplicité, de même que chez Duns Scot, l’étant se divise sans reste par les passions disjonctives que sont le fini et l’infini. Et sachant l’estime que Deleuze portait à la distinction selon les modes intrinsèques utilisées par Duns Scot, on imagine sans peine qu’il ait pu s’en inspirer.
Duns Scott, l’ontologie de l’Un et du Multiple
D’un point de vue noétique, Duns Scot voyait pour seule et première réalité l’étant, car quoi qu’on pense d’un être, quels que soient les doutes qu’on a sur ce qu’il est, fini ou infini, vérace ou faux, accidentel ou substantiel, on a toujours d’abord et avant toute détermination ultérieure, l’idée qu’il est. C’est d’abord à des étants qu’on a à faire. C’est en second lieu qu’on peut trouver les modalités de cet étant, modes non pas rajoutés du dehors comme la couleur à une étendue, mais modes intrinsèques qui disent son degré propre d’essence. Ainsi – exemple célèbre – une blancheur intense n’est pas un concept comme par accident de la blancheur, mais un mode d’être déterminé de la blancheur.
Serait-il faux de conclure que Deleuze a pu s’inspirer de cette manière de distinguer, alors qu’il la tient en si haute estime (6) ? L’étant est ce qui seul est, mais il peut être dit tel ou tel. La multiplicité est ce qui seul est, mais elle peut être dite une ou multiple. Ou plutôt, dans une prédication stoïcienne qui attribut des événements et non des qualités, elle peut recevoir le dicible UN (être unifiée) ou MULTIPLE (faite multiple (7)).
Ainsi, quand Deleuze repousse l’arbre et le faux multiple comme mauvaise image du monde, il ne nie pas des modes d’être qui de toute façon «existent» (subsistent en fait) bel et bien. Il récuse seulement une confusion entre le fait et le droit. C’est un fait que l’Un, l’Un-deux et le multiple avorteur de l’Un sont. Mais en droit, ils ne sont que des manières d’être (des idios poion comme disent les stoïciens) de la multiplicité, celle-ci étant la seule réalité existante quand l’Un et le Multiple sont des événements survenant aux multiplicités.
Dès lors, le réel, puisqu’il n’est que multiplicité, et que la multiplicité se laisse dire en tous ses modes intrinsèques par l’Un et le Multiple, le réel disais-je est tension entre l’Un et le Multiple. Tension que parfois il est vrai, Deleuze laisse dans l’ombre sans la préciser, puisque dans le Traité de nomadologie (8), la multiplicité pure est dite survenir entre les deux termes de la division de la souveraineté (Mitra et Varuna, le despote et le législateur). Comme si la multiplicité n’était pas un pôle, mais l’abolition de tout pôle, leur autre, alors qu’elle est manifestement ce qui se fait polariser, le seul étant qui n’est pas un troisième terme mais le seul terme qui parfois se manifeste dans sa vérité avant toute prédication, et semble alors s’opposer à tous les autres. C’est que le chapitre porte sur la machine de guerre, machine qui s’oppose au deux pôles de la souveraineté. Cette machine qu’est le guerrier laisse entrevoir le pur étant de droit et s’oppose aux deux pôles. Ce n’est donc que le vecteur de la manifestation du vrai étant qui s’oppose, pas la multiplicité en tant que telle.
On pourrait donc comprendre ce qu’il en est des analyses de Deleuze en reprenant celles d’un autre scotiste, le poète jésuite anglais G. M. Hopkins. Dans son dialogue De l’origine de la beauté, la beauté apparaît comme rapport de régularité et d’irrégularité, de diatonisme et de chromatisme, jonction de similitude et de dissimilitude qui s’embrassent sans jamais se confondre, puisque l’une a besoin de l’autre pour être, que l’une passe par l’autre pour se manifester. Ainsi la feuille du marronnier contient sept folioles symétriques dont six s’opposent parfaitement, et l’une fait au sommet la jonction. La feuille est alors symétrique mais son axe radial passe par un dernier terme impair, la foliole qui couronne la feuille. Ainsi la beauté est-elle rapport d’équilibre des masses qui se sert d’un déséquilibre.
Le monde de Deleuze se présente donc comme synthèse disjonctive qui tient sans confondre, mêle les règnes, met en rapport les rapports de similitude et les rapports de dissimilitude, bref un rapport de rapport qui est entre les termes et non internes aux termes, comme l’auteur l’écrit dans son livre sur Hume. Car Deleuze est anglais sur ce point, anglais de la façon dont Hans Urs von Balthasar dit d’Hopkins qu’il est anglais dans la Gloire et la Croix : proche de la nature, non pas de la nature comme universel ou tout global, mais des individus singuliers de la nature, des différences individuelles – bref, comme Duns Scot.
Si la feuille de marronnier n’avait que six folioles, sa symétrie serait parfaite, mais elle serait moins belle; la beauté tient donc compte de la dissymétrie tout en requérant la symétrie. Il y a des lois de similitude dit Hopkins, c’est-à-dire une régularité structurelle, comme par exemple l’isomorphie des différentes parties de même taille d’un cercle. Les lois, dans la similitude, induisent des symétries, des rapports d’égalité entre côtés, ou entre parties, ou entre éléments d’un ensemble (même si les feuilles d’une espèce d’arbre étaient sans aucune symétrie interne, elles se ressembleraient entre elles).
Laissons donc parler ce poète scotiste, et dans sa proximité avec Deleuze, sentons combien sont vaines et nulles les tentatives d’annexion de Deleuze par une gauche violente, vindicative et haineuse. Car laisser être la multiplicité, c’est laisser être la jonction de l’Un et du Multiple dans l
29/09/2007 | Lien permanent | Commentaires (10)
Marc-Édouard Nabe le si peu bloyen + Entretien avec Pierre Glaudes

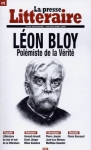 Il me faut être tout à fait juste. Après avoir très durement critiqué La Presse littéraire de Joseph Vebret pour son dramatique débraillé rédactionnel, je fais le constat à présent d'une nette amélioration de la qualité d'ensemble du tout dernier numéro de cette revue, désormais trimestrielle et réduite à un format plus agréable que le précédent.
Il me faut être tout à fait juste. Après avoir très durement critiqué La Presse littéraire de Joseph Vebret pour son dramatique débraillé rédactionnel, je fais le constat à présent d'une nette amélioration de la qualité d'ensemble du tout dernier numéro de cette revue, désormais trimestrielle et réduite à un format plus agréable que le précédent. Constat également valable pour son dossier, tout entier consacré à Léon Bloy, initiative suffisamment rare pour être saluée. Et puis... Nous voici tout de même à quelques salutaires années-lumière du lamentable Philippe Sollers, écrivant-tartuffe auquel a été consacré le précédent dossier de La Presse littéraire.
Une déception tout de même, due à Giovanni Dotoli, dont l'article, qui s'approche, je l'en loue, des normes universitaires habituelles à l'un de meilleurs connaisseurs de Bloy, Émile Van Balberghe, me semble toutefois trop vague, hésitant entre l'affirmation d'un Bloy poète et celle d'un Bloy visionnaire.
En fin de compte, je n'ai pas bien su que penser de sa thèse brouillonne. Il faut préférer, de Stéphane Beau, plutôt que ses ridicules et verbeux comptes rendus d'ouvrages (le comble du grotesque et de l'insignifiance critique me paraît atteint avec le papier de Beau sur American Vertigo de Bernard-Henri Lévy), l'article somme toute honnête qu'il a consacré aux relations complexes entre Bloy et Huysmans, même si ce travail souffre à l'évidence de ne point s'être inquiété du fait que, sur ce thème de l'amitié orageuse entre les deux célèbres écrivains, une bonne dizaine d'articles beaucoup plus fouillés que le sien existent, et depuis quelques années tout de même.
Comme toujours, les articles de Raphaël Juldé sont à son image monochrom(at)ique : lisses, honnêtes, agréables à lire, parfois même, apparemment lorsque leur auteur a délaissé, l'espace d'une inspiration vite condamnée, sa légendaire consommation de jus d'orange... assez verts si je puis dire et ils restent donc parfaitement insignifiants.
Jean-Jacques Nuel, évoquant dans un excellent petit texte la récente réédition du Pal par les éditions de L'Obsidiane, a fort raison de moquer la préface que Patrick Kéchichian, notre risible pamphlétaire ouaté, a donnée à ce beau volume rassemblant les cinq numéros de cette revue éphémère et d'une violence qui aujourd'hui ferait détaler tous les lapins du journalisme. Clôturant ce dossier qui certes ne m'a rien appris mais qui, de toute évidence, intéressera les lecteurs connaissant peu les livres du Mendiant ingrat, la courte étude aux accents fâcheusement métaphoriques d'Amadeo del Duca évoque l'intérêt que Léon Bloy porta aux écrits et à la figure du peu connu Jehan Rictus. Rappelons que c'est Bloy qui le tout premier a salué Les Chants de Maldoror...
Quoi d'autre ? Un bizarre article de Méryl Pinque qui, portant mention dans son sous-titre du diable, n'évoque pas une seule fois l'hôte inconvenant de toute entreprise littéraire (et bien sûr, plus largement : artistique, comme Gide l'écrivit à la suite de Blake) un tant soit peu sérieuse.
Il est vrai que Pinque, comme elle me l'a elle-même appris, ne croit pas au diable mais seulement à la part diabolique tapie en l'homme, nuance d'importance... Certes, si tout un chacun peut ignorer (ce qui est moins grave que de les mépriser) certains textes des plus hautes instances catholiques, qui, sur la redoutable question de l'existence du démon, sont pourtant dénués de la plus petite ambiguïté, j'aurais toutefois attendu, de la part de Pinque, un peu plus de profondeur et de discernement littéraires (Sade et Bataille : oui mais...) quant aux auteurs et à la façon même dont elle a évoqué ce sujet qui me passionne de longue date.
Délaissons à présent les meilleures plumes, c'est dire, de La Revue littéraire pour nous aventurer dans ses pénéplaines et ses basses fosses. Je remercie d'ailleurs chaleureusement Joseph Vebret qui pour une fois a joué son rôle de physionomiste (je préfère le terme peu hermétique de videur) à l'entrée de sa bien peu regardante auberge espagnole, puisque les plus nullissimes plumes qui déparaient, jusqu'à maintenant, La Presse littéraire ou bien La Revue du cinéma, j'ai nommé Adeline Bronner et Élizabeth Flory, ne sont pas ou peu présentes.
En attendant de relire et de corriger, comme elle sait si bien le faire, les tirages de la torcheculative Gazette des Lettres cavernicoles du Bazois-en-ânesse, Flory l'autofictive a tout de même lâché dans ce numéro de La Presse littéraire quelques lignes sans saveur ni tenue, passant, selon ses habitudes, de la dinde chypriote à la poule bressane.
Laissons nos deux très fines illettrées à leurs travaux de tricotage d'une critique plus ténue que la gaze et revenons à Bloy, démon coruscant des lettres françaises admiré par un Kafka, par un Borges, par un Barthes même, ce qui n'a tout de même pas suffi, malgré les objurgations que m'a adressées à ce sujet Sarah Vajda, à me le rendre intéressant (il est vrai que l'article du critique sur l'écrivain n'est tout de même pas exactement décoiffant), par un Nabe aussi... Justement, Zannini.
Voici un vieil entretien que je fis jadis paraître dans ma revue, Dialectique et qui, dans une version abrégée, fut repris par Bruno Deniel-Laurent pour le numéro hors-série de Cancer ! consacré à Léon Bloy. Interrogeant Pierre Glaudes, de loin le meilleur connaisseur de l’œuvre de Bloy en France, cet échange fut réalisé par Rémi Soulié et moi-même. Que Marc-Édouard Nabe, s'il me lit, s'inspire de ces lignes érudites, lui qui affirme (dans le premier numéro de La Vérité, novembre 2003) que les cancéristes n'ont rien compris au génie bloyen. C'est peut-être vrai, peu importe, aucun d'entre eux n'ayant prétendu être écrivain. Encore moins se réclament-ils à hue et à dia du rugissant polémiste. Nabe lui, ne cesse de le citer, multipliant depuis son Régal des vermines, sur l'auteur du Salut par les Juifs, les mots d'auteur dignes du plus louche éclat de quincaillerie orientale. En fait, ce que Nabe oublie, c'est que Bloy n'a gueulé et éreinté les imbéciles de toutes espèces, et Dieu sait qu’elles sont nombreuses, que dans l'unique espérance de hâter la Venue, en condamnant, en somme, les imbéciles à l’Enfer que l'on pourrait dès lors affirmer être comme l'éternité d'une venue qui jamais ne vient. Alain Zannini, lui, se complaît (il y patauge même) dans une colère de salon parisien et une outrance sexuelle qui, bien avant de détuméfier son monstrueux organe (est-ce si sûr ?), fatigue son lecteur le plus attentif et ne parvient guère à nous suggérer l'existence d'une autre vérité par-delà le miroir déformant de l'apôtre, vérité qui, dois-je vraiment le rappeler, était l’unique nourriture de Bloy.
L'Enfer de Nabe, c'est lui-même, le cachot le plus sûr ayant été inventé pour emmurer vivant le nain prolifique. L'Enfer de Bloy, c'est une réalité qui serait totalement essorée de Dieu. Est-elle seulement pensable pour celui qui crut dénicher l'éclair du divin jusque dans les glaviots les plus insipides du Bourgeois ? Ce que j'écrivais à propos du roman Alain Zannini dans ma Critique meurt jeune se vérifie donc à mesure que je lis Nabe/Zannini : l'homme est consumé par une haine maladive (qui n’est pas toujours drôle, à la différence des diatribes bloyennes) étouffant sa charité et l’écrivain, lui, qui est exactement le même, je le précise à tout hasard, que le personnage public (c'est bien leur stricte identité qui constitue la seule et unique croix de Nabe, apparemment de plus en plus lourde à porter pour le gringalet), s’est enlisé dans les dunes du désert irakien même s'il reste un redoutable chameau.
Un dernier mot enfin. S’il faut absolument les comparer, alors je n’hésite pas un instant avant d'affirmer que la sincérité totale, parfois pataude il est vrai, de l’écrivain Dantec est évidemment infiniment plus bloyenne ou bernanosienne que les pitreries réalisées devant le miroir de Zannini/Nabe et, si je dois avancer un sentiment sur l’homme que je connais et apprécie, Dantec me paraît un être d'infiniment plus de... poids que l'éthéré Zannini, petit maigrichon occupé de lui seul, écrivain raté, c'est lui qui le gueule sur tous les toits; on ne va tout de même pas, à présent qu'il daigne la retourner contre lui, chicaner sur la légendaire sincérité de Nabe n'est-ce pas ?
Il est certes vrai que l'envie provoque parfois, sans que l'on sache bien quelle responsabilité incombe à celui qui la déclenche et la subit, de telles cruelles ironies. Contemplant ainsi le triste spectacle que nous donne Nabe, je suis à peu près certain que le fantôme de Léon Bloy, peut-être pas encore fatigué de traîner tout près de son héritier auto-proclamé, doit partir d'un immense rire. Et il y a fort à parier, ultime facétie de l'Invisible qui en est un prodigue coutumier, que Nabe dont l'oreille absolue n'est apparemment pas qu'une légende inventée par ce musicien de l'ironie, est le premier à entendre ce long rire dévastateur.
Voici la première partie de notre entretien.
Rémi Soulié : Pierre Glaudes, vous êtes à la fois un universitaire «classique» par votre formation et atypique par votre manière certes très savante mais surtout très personnelle d'aborder les textes. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à Léon Bloy ?
Pierre Glaudes : Je suis venu à Léon Bloy par Huysmans, ce qui paraît un peu monstrueux pour les bloyens classiques ou les huysmansiens de «stricte obédience». J'avais d'ailleurs effectué un travail en deuxième cycle universitaire sur le pessimisme de Huysmans qui m'avait conduit à lire les ouvrages parus dans les années 1880-1887, période qui m'intéressait dans l’œuvre de Huysmans et, naturellement, j'avais été amené à lire Le Désespéré. De surcroît, Bloy m'a peut-être plus encore intéressé que Huysmans dans la mesure où il correspond assez bien à l'un des critères qui définissent pour moi ce qu'est un grand écrivain : une formidable résistance de l'écriture. Avant de pouvoir dire que l'on domine cette écriture, qu'on en comprend les enjeux et le fonctionnement, il faut beaucoup de temps et je ne suis pas sûr que l'on puisse même parvenir à des certitudes en cette matière – alors qu'elle paraît beaucoup plus accessible ou probable ou possible lorsque l'on considère des écrivains de second ou de troisième rayon.
R. S. : Qu'est-ce qui selon vous constitue la singularité radicale de Léon Bloy, d'un point de vue religieux, d'un point de vue politique et d'un point de vue stylistique ?
P. G. : Vous posez-là une bien vaste question. Il faut éviter de considérer Bloy comme un Décadent. Sa singularité ne se résorbe pas dans la littérature fin-de-siècle, pour une raison très simple : lui-même a toujours démenti la moindre affinité avec les groupes littéraires de son époque; sa situation dans l'espace littéraire, il l'a vécue comme une sorte de paradoxe ou de solution temporaire qui ne le dispensait pas de viser plus haut ou au-delà de la littérature, vers la sainteté. Il y a pour Bloy un au-delà de la littérature qui l'amène forcément à penser la littérature de la manière la plus paradoxale qui soit : elle n'est possible qu'à condition de se déposséder soi-même de toute parole pour laisser résonner en soi une autre parole. La littérature devient le lieu paradoxal d'émergence d'une autre parole, qui est évidemment quelque chose comme un écho du Verbe. La deuxième singularité qui détache Bloy des Décadents et même de ceux que l'on a coutume d'appeler les Symbolistes, c'est sa théorie de la figure, qui est enracinée dans une tradition médiévale évidemment chrétienne, laquelle conduit à ce qu'il a appelé lui-même le «symbolisme universel» : au nom de celui-ci, Bloy lit tout événement, toute histoire, à commencer par l'Histoire, comme une sorte de reformulation mystérieuse et symbolique du texte fondamental dans lequel toute l'Histoire se résorbe, le seul texte qui fut jamais, la Bible.
Juan Asensio : Dans l'introduction au Journal de Bloy, vous mentionnez le nom de George Steiner ; nous savons par quels mots douloureux se termine son ouvrage le plus célèbre, Réelles Présences : «Il est une journée bien particulière de l'histoire occidentale dont ni l'histoire, ni le mythe, ni les Écritures ne parlent. Il s'agit d'un samedi. Et ce samedi est devenu le plus long des jours. […] notre époque est celle du long samedi. Entre la souffrance, la solitude, l'inexprimable destruction d'une part et le rêve de libération, de renaissance de l'autre.» Jacques Vier pense que l’œuvre de Bloy se situe, elle, comme celle de Pascal, dans un perpétuel Vendredi : «Tout se passe, pour Léon Bloy, comme si les infidélités et les apostasies croissantes maintenaient le Golgotha, oserait-on dire, au préjudice de la Résurrection. Le monde auquel appartient Léon Bloy l'enclôt dans un Vendredi Saint permanent [...].» Que pensez-vous d'une telle affirmation ?
P. G. : Vous présentez deux points de vue, celui de George Steiner et celui de Jacques Vier, qui ne sont pas exactement les mêmes. Steiner parle d'un perpétuel Samedi, en référence au Samedi Saint, alors que Vier parle d'un perpétuel Vendredi Saint. De ces deux affirmations il me semble que la première convient le mieux à Bloy. Pour lui, le paradoxe central de l'Histoire n'est pas celui du Vendredi Saint ni du Dimanche de Pâques mais bien celui du Samedi, qui est le temps de l'attente. Ce paradoxe tient à ceci que la Rédemption est accomplie tout en restant malgré tout inaccomplie. Cette sorte de contradiction dans les termes est parfaitement déchirante. Pour expliquer cet inexplicable mystère, Bloy est conduit à penser l'Histoire de Dieu comme celle des atermoiements mystérieux de la Providence et à référer ces atermoiements à une inexplicable contradiction au cœur de la Trinité elle-même, contradiction qu'il pense en termes de conflit entre le Fils et l'Esprit – ce qui est sans doute la clé de sa réflexion théologique et qui le conduit à ce paracléto-luciférianisme que l'on a souvent remarqué. La contradiction est que l'Esprit, temporairement et mystérieusement, est travesti en son contraire, Bloy jouant sur la polysémie de Lucifer, à la fois ange du matin donc porteur de lumière, et ange du soir prince des ténèbres.
J. A. : Le problème de la représentation littéraire du Mal, nous le savons, fut la préoccupation constante de ces écrivains éminents que furent Maistre, Claude de Saint-Martin, Barbey, Blanc de Saint-Bonnet, Bloy ou Bernanos. N'est-ce pas, justement, cette radicale nouveauté de la tentative de représentation menée par ces auteurs qui, aujourd'hui, nous permet d'affirmer sans ambages leur étonnante modernité ? N'est-ce pas aussi le fait que, avec une remarquable continuité, ces écrivains ont tenté d'évoquer le mystère de la transcendance en empruntant la voie souterraine du démoniaque – comme le rappelle le célèbre proverbe portugais chéri par Claudel – qui confère à leur œuvre la portée soulignée par Pierre Boutang dans ses Abeilles de Delphes : «Le mal et la bassesse sont la seule transcendance qui puisse, à la rigueur, éveiller un monde assez oublieux des hiérarchies pour se faire raison de son ignominie et la résorber dans la nature».
P. G. : Je serai beaucoup plus bref pour répondre parce que je suis absolument d'accord avec vous, c'est d'ailleurs un point que j'aurais dû ajouter pour compléter ma réponse. En effet, cette réflexion théologique de Bloy a l'immense mérite de ne pas trop rapidement diluer la question du Mal dans une histoire du salut. Cette contradiction déchirante au cœur de la théologie bloyenne qui laisse en suspens, en proie à une aporie, la question de l'histoire du salut, a pour effet de faire venir au premier plan l'énigme du Mal, et c'est en ce sens qu'elle est profondément moderne.
J. A. : De la même façon, mais en somme inversée ou retournée, l'écriture bloyenne se propose de signifier la présence de Dieu, dans une voie d'approche que nous pourrions qualifier d'apophatique. Vous le dites mieux que moi, à propos des succulentes Histoires désobligeantes : «La Réalité divine, parce qu'elle excède les possibilités du langage, ne saurait être présente qu'en creux, si elle n'est approchée de biais. D'où les lacunes des Histoires désobligeantes, les blancs qu'aucune information ne vient combler, lorsque Dieu apparaît : une nappe de silence se répand sur les contes et communique au lecteur un sentiment d'étrangeté.» L'extrême ambiguïté de la démarche de Léon Bloy n'est-elle pas à rapprocher de celle qu'illustrent certains textes de mystiques (je songe, par exemple, à ceux d'Angèle de Foligno traduits par Ernest Hello), tentative d'ailleurs reprise par Bernanos dans Monsieur Ouine ?
P. G. : Oui, c'est bien une démarche apophatique que celle de Bloy. Le Dieu bloyen n'est pas essentiellement un deus absconditus tel que le conçoivent les tenants de la doctrine augustinienne, mais plutôt un deus ignotus, un Dieu qui s'est retiré et qui se tait. Dès lors, on ne peut Le connaître que par la voie négative, en effet. Dieu est en effet l'in-quelque chose; l'in-fini, l'in-commensurable, l'in-connaissable, l'in-nommable par certains côtés. Le Dieu bloyen est innommable. Si cette démarche s'enracine à l'évidence dans la mystique, elle n'en est peut-être pas moins en relation problématique, dans un siècle qui proclame la mort de Dieu ou qui est hanté par cette possibilité, avec l'a-théologie de Bataille ou de Klossowski.
R. S. : Gripari voyait en Léon Bloy un «Céline chrétien». Qu'en pensez-vous ?
P. G. : La form
27/05/2006 | Lien permanent
Quelques lectures du stalker - Gustave Thibon

12/06/2004 | Lien permanent
Maljournalisme, 1, par Jean-Pierre Tailleur

Carlo Michelstaedter, La Rhétorique et la Persuasion.
 Je remets en ligne, avec ce premier texte, le long témoignage de Jean-Pierre Tailleur, intitulé Maljournalisme à la française, publié par l'association culturelle de Vouillé, en Poitou-Charente. J’ai rencontré, il y a maintenant assez longtemps, Jean-Pierre Tailleur dans un bar huppé du Trocadéro où nous avons bavardé assez longuement. Il ne nous aura fallu pourtant que quelques minutes pour nous rendre compte que le mal que décrit le livre de Jean-Pierre est endémique et nullement cantonné aux médias, fûssent-ils aussi vérolés que la verge de Casanova.
Je remets en ligne, avec ce premier texte, le long témoignage de Jean-Pierre Tailleur, intitulé Maljournalisme à la française, publié par l'association culturelle de Vouillé, en Poitou-Charente. J’ai rencontré, il y a maintenant assez longtemps, Jean-Pierre Tailleur dans un bar huppé du Trocadéro où nous avons bavardé assez longuement. Il ne nous aura fallu pourtant que quelques minutes pour nous rendre compte que le mal que décrit le livre de Jean-Pierre est endémique et nullement cantonné aux médias, fûssent-ils aussi vérolés que la verge de Casanova. La même gangrène pourrit à l’évidence la littérature contemporaine, en tous les cas les tristes moignons de ces auteurs qui fréquentent davantage les salles de rédaction que le cloître intérieur du silence, sans l’expérience duquel, aussi douloureuse qu’on le souhaitera, une œuvre n’est rien de plus qu’une trace de bave sur une feuille sale (c’est le cas de le dire avec toute cette malpresse qui nous gouverne…).
Déjà d’habiles rumeurs et de judicieux indices, pour qui sait flairer les délicieux fumets de la décomposition, nous indiquent quel sera le degré de fermentation du cirque médiatico-littéraire prochain : les augures nous ont annoncé un excellent cru et, comble de l’originalité, les plus autorisés s’aventurent à conjecturer, selon l’affreux lieu commun, que la surprise pourrait bien venir de là où on ne l’attend point, peut-être même, allez savoir, la proclamation d’un puissant Veni foras provenant d’on ne sait quel puits de ténèbres, seul capable en tous les cas de faire se dresser le cadavre de la littérature française…
Je parlai d’une universelle pourriture, d’une mascarade et d’une chute médiatico-littéraire qui n’ont absolument rien à envier à leur cousine parlementaire… Quoi d’étonnant d’ailleurs puisque le langage est un, qu’il soit saint ou prostitué, vérolé sous la plume sale de Pierre Marcelle et de ses risibles clones pornographes, mangé par le prurit de la bêtise avec Sollers, Meyronnis et Haenel, royal et éminent sous celle de… De qui…? Je ne sais pas, je ne sais plus, ne me traversent l’esprit, immédiatement, que quelques noms d’hommes depuis longtemps réduits en poussière, comme si notre âge tout entier était décidément (à tout le moins le devenait de plus en plus) incapable à mes yeux de susciter une parole haute et claire ou bien comme s’il ne parvenait pas à s’oublier pour sonder l’Impénétrable, à se taire pour, selon le commandement de Heidegger habilement repris aux Pères de l’Église, écouter bruire le Verbe…
Autopsie d’un boycott médiatique et voyage dans l’édition
Un an, jour pour jour, après la sortie de Bévues de presse, mon essai sur le manque d'autocritique et de rigueur dans nos journaux – sur le maljournalisme en France –, notre pays a été saisi par un vent de remise en cause des médias. Il s'est déclenché avec la parution d’un témoignage de Daniel Carton sur les rapports incestueux entre journalistes et politiciens français, suivi de peu par un brûlot contre le conformisme au Centre de formation des journalistes de Paris (1).
Quelques semaines plus tard, le pamphlet-enquête de Pierre Péan et Philippe Cohen dont les meilleures pages étaient parues dans L’Express, La face cachée du Monde (2), transformait le vent en bourrasque. Ces quatre livres avaient en commun la critique médiatique mais le premier était autant boycotté que les autres médiatisés.
Bévues de presse montre comment, indépendamment de leur ligne éditoriale, les médias de notre démocratie ne remplissent pas suffisamment leur fonction citoyenne – ou civique, pour prendre un mot moins galvaudé. Il demande pour quelles raisons beaucoup de journaux américains et même espagnols exercent davantage un contre-pouvoir et sont souvent plus crédibles que les nôtres. En effet, contrairement à ce que laisse entendre la démonstration partiale du duo Péan-Cohen, la plupart des reproches faits au Monde concernent d’autres publications. Notamment celles qu’ils ménagent beaucoup dans leur essai, du Figaro à L’Express (pour cause…) et au Canard enchaîné.
À l’occasion de ce feu de paille polémique de février 2003, deux radios hispanophones et une suisse romande ont sollicité mes commentaires. La plupart des journalistes français susceptibles de parler de Bévues de presse – dans les rubriques livres, médias, société ou dans les émissions-débats – ont affiché le même désintérêt qu’un an auparavant. Pourquoi tant de bruit d’un côté et de silence de l’autre ? Probablement parce que le champ critique de mon essai ne se limite pas à une institution ou à un microcosme. Parce qu’il revient en détail sur la médiocrité de certains articles de journaux sans échappatoires et sans fausses excuses, et parce qu’on peut difficilement lui attribuer un parti-pris idéologique.
L’attitude de Daniel Mermet, sur France Inter, illustre cette forme de censure au sujet d’un livre au cœur des débats sur la démocratie. Ce commentateur souvent virulent des phénomènes de société a consacré au moins quatre heures d’émission à la critique des médias en février 2003, en effet. Il a cité à plusieurs reprises toutes sortes d’ouvrages sur le thème, mais en se gardant de mentionner celui qui est particulièrement consacré au manque d’ambition ou de professionnalisme dans notre journalisme (3). Cette façon de cacher l’existence de Bévues de presse, que le rebelle de France Inter n’a pas été le seul à pratiquer, d’ailleurs, me rappelait les photos soviétiques où l’on effaçait les visages que le régime totalitaire voulait rayer des mémoires. Il n’y a pas mort d’hommes mais la mécanique intellectuelle est la même et elle s’est remise en marche ailleurs. Le Nouvel Observateur fera de même fin 2003 à l’occasion d’un dossier d’une dizaine de pages sur la face cachée du journalisme, tout en se corrigeant peu après (4).
Le suivisme journalistique
Essai plus argumenté et pas moins polémique que ses cadets d’un an, Bévues de presse a fait seulement l’objet de rares critiques acerbes ou de quelques éloges, généralement succincts et confiés en privé. L’indifférence à laquelle il a eu droit publiquement illustre d’abord la faible curiosité des journalistes pour les travaux d’auteurs et d’éditeurs dont ils ne sont pas familiers ou qu’ils ne peuvent pas attacher à une famille de pensée. Elle traduit, aussi et surtout, leur réticence à réfléchir en profondeur, de façon dépassionnée et par l’analyse des contenus, sur les mauvaises pratiques de la presse écrite, celle qui est à la base de l’information civique. L’attention requise pour la lecture d’un texte plutôt dense, mon manque de notoriété ou bien nos maladresses d’éditeur et d’auteur expliquent peu ce relatif silence.
Dans les mois qui ont suivi la sortie de Bévues de presse, j’ai pourtant bénéficié d’un contexte extrêmement favorable. L’actualité mettait au grand jour la menace islamiste ou lepéniste, la gestion controversée de Vivendi ou la coupure entre la France d’en haut et d’en bas, des thèmes sur lesquels je m’attarde à travers leur (mauvais) traitement journalistique. La crise de la représentation citoyenne rendue visible le 21 avril 2002 tient aussi de l’incapacité de nos rédactions à briser l’indifférence devant certaines réalités sociales, en effet. Un problème de courroie de transmission qui dépasse largement le cas du Monde, d’une école de journalisme ou de la connivence des journalistes avec la classe politique. Mais l’autoflagellation dans les médias, suite à l’échec imprévu de Lionel Jospin, s’est limitée à la rengaine juste mais insuffisante et convenue des journalistes amplificateurs du sentiment d’insécurité.
On observe une réticence à se remettre vraiment en cause dans beaucoup d’autres professions mais la dissimulation des vrais problèmes y est plus difficile car par définition, elles ne contrôlent pas l’information. Nos intellectuels, nos médiacrates, ont du mal à s’interroger sur les déficits spécifiques de la presse française par manque de courage ou de clairvoyance. Pierre Bourdieu et ses adeptes, fers de lance de la critique des médias en France, ont eu raison de s’inquiéter de la spectacularisation, des conflits d’intérêt ou de la précarité dans le métier d’informer. Mais on entretient avec ce discours assez univoque une critique biaisée de notre culture journalistique, trop people, parisienne ou politiquement correcte.
Les attaques ciblées contre le magazine Voici ou contre le journalisme carpette et cumulard d’un Alain Duhamel sont nécessaires mais insuffisantes. Elles procèdent de considérations idéologiques, morales ou matérielles qui occultent certaines questions qui dérangent davantage la corporation des journalistes. De même, lorsque l’on considère que tel journal est mauvais uniquement parce qu’il est d’un bord opposé ou parce qu’il manque de moyens, on néglige la responsabilité individuelle et professionnelle de ses rédacteurs. Les fautes de quelques figures du journalisme sont parfois dénoncées à juste titre, comme la fameuse interview de Fidel Castro par Patrick Poivre d’Arvor ou bien, depuis peu, les scoops dopés d’Edwy Plenel. Mais ces critiques prennent une tournure si personnelle et démesurée que ces derniers ont beau jeu de crier au lynchage.
Pourquoi certains journaux français sont-ils pires que leurs équivalents étrangers à contexte néo-libéral égal ? (5). Pourquoi nos quotidiens régionaux couvrent-ils si mal la France profonde ? Les agissements aujourd’hui décriés du Monde sont rendus possibles dans un pays où les standards de qualité dans l’enquête ne sont pas assez définis et partagés. Un contexte que, jusqu’à aujourd’hui, Bévues de presse est le seul essai à décrire dans son ampleur. L’accueil qui lui a été fait offre une série d’illustrations, désolantes ou désopilantes, sur ce maljournalisme aux conséquences parfois dramatiques.
I – UN DÉFICIT DÉMOCRATIQUE MAL DÉBATTU
La genèse et l’accueil fait à mon essai illustrent de façon éclatante son contenu. Il devait en effet être publié par Le Seuil au début de l’automne 2001 sous le titre d’Erreur à la Une, dans la collection L’épreuve des faits co-dirigée par Patrick Rotman. Cet éditeur, par ailleurs essayiste et documentariste reconnu m’avait proposé de signer un contrat d’exclusivité en février de cette année, moyennant une avance correcte pour un auteur débutant (plus de 2000 €). Il me demandait de réduire de moitié le manuscrit afin de le rendre plus concis et agressif, ce que j’acceptais volontiers. Mais après quatre mois de collaboration, une fois les modifications effectuées et entièrement approuvées, Le Seuil a rompu le contrat sans s’expliquer véritablement.
Mon essai pouvait entraîner 115 poursuites en justice, selon un rapport juridique de 60 pages rédigé par un avocat de la maison. Le Seuil ne semblait pourtant pas remettre en cause le contenu d’un texte dont le lancement était programmé. Un de ses photographes venait de me mitrailler avec une quinzaine de pellicules aux Buttes Chaumont, et on avait convenu de m’envoyer les épreuves par courrier express en Argentine, où je devais me rendre fin juin. La lecture finale du manuscrit par l’avocat ne devait être qu’une simple formalité devant déboucher sur quelques demandes de précision ou de reformulation.
«C’est la première fois, dans ma carrière d’éditeur, qu’on abandonne un projet de publication si avancé» m’a confié Patrick Rotman au téléphone. Mais il a refusé de me recevoir et de me montrer des extraits de cet obscur rapport-de-60-pages. Je n’ai pas eu droit à des éléments d’explication consistants pour comprendre ce changement d’avis qu’il ne semblait pas partager. Le livre ne contient aucune attaque personnelle, en effet, et se base sur des faits incontestables comme mon interlocuteur l’avait souligné à maintes reprises les mois précédents. J’y montre simplement comment des journaux respectés, du Monde à Télérama et à La Dépêche du Midi, et comment des instances de la profession ou des médiologues estimés font parfois preuve de beaucoup de légèreté sans que cela n’émeuve personne.
Le Seuil a probablement changé d’avis après avoir subi des pressions, internes ou externes. Mes propositions de nettoyer le texte de tous les propos qui pouvaient paraître diffamants ont été rejetées. Patrick Rotman a admis que son invitation à rendre le manuscrit plus incisif a peut-être également contribué à cette rupture, mais je n’ai pas de regrets sur ce plan. Grâce à ses recommandations, ce qui pouvait ressembler à une thèse de doctorat, trop longue et lourde, est devenu un texte destiné à tout public intéressé par la thématique du mal français. Cette mésaventure m’a cependant mis dans une situation difficile car j’ai perdu une activité salariée en partie à cause du temps consacré à réduire le manuscrit. Elle m’a aussi confirmé que dans notre pays, on peut s'invectiver dans des pamphlets mal argumentés sur la presse ou bien multiplier les discussions sur la malbouffe tout en ignorant la question du maljournalisme.
Après cette première expérience des milieux de l’édition et sur les conseils dépités et défaitistes de Patrick Rotman, je me suis tourné vers des maisons plus modestes. Elles ont répondu favorablement pour la plupart durant tout l’été 2001, via un courriel dépaysant CAR consulté dans un cybercafé au pied des Andes ou dans la rue Florida, la principale artère piétonne de Buenos Aires. Elles étaient convaincues du caractère pertinent et non diffamant d’Erreur à la Une, ou bien plus prosaïquement intéressées de prendre la relève d’un grand confère.
De retour en France, j’ai failli signer avec les éditions Carnot. Leur sympathique patron s’est fait beaucoup connaître, depuis, en publiant L’Effroyable imposture, essai délirant de Thierry Meyssan sur les attentats du 11 septembre 2001. Mais mon choix s’est finalement porté sur Le Félin, un éditeur qu’Alain Woodrow, ancien journaliste du Monde et auteur de deux livres sur les médias, m’avait présenté et recommandé. Son catalogue d’ouvrages historico-journalistiques me paraissait plus convaincant que celui de Carnot, en effet. On y trouvait des livres de mon mentor (qui a ensuite rédigé une des postfaces de Bévues de presse), de Paul Webster, autre journaliste anglais reconnu, de Christophe de Ponfilly et même de Jacques Ellul et de Voltaire !
Un alibi juridique qui tient mal
Après bientôt deux ans de présence en librairie, je constate que nous n'avons pas reçu la moindre plainte, la moindre assignation, contrairement aux craintes ou au mensonge du Seuil. On imagine mal le lauréat du prix Albert Londres dont je montre les négligences, par exemple, contester ce qu'il a publié sans aucun scrupule dans des enquêtes annoncées en première page du Figaro. Bévues de presse n’est pourtant qu’un clone d’Erreur à la Une, allégé de certains adjectifs mordants ou de quelques bévues qui m’avaient échappé (eh oui !). J’ai également actualisé le texte avec plusieurs lignes sur le 11 septembre, notamment, car les événements de New York nous avaient fait changer de siècle. Le cas de Zacarias Moussaoui me permettait d’illustrer de façon assez spectaculaire la mauvaise couverture de la menace islamiste en France mais il n’était pas question d’aller au-delà de quelques rajouts ou modifications d’ordre cosmétique.
Je savais, à l’instar des éditeurs consultés, que l’essai était plus nuancé et documenté que la plupart des ouvrages polémiques proposés en librairie. Quelques milliers de personnes ont eu connaissance de son contenu, le livre s’étant vendu à environ 2 000 exemplaires (un chiffre normal pour un auteur inconnu mais inacceptable pour un livre qui soulève des questions qui intéressent des millions de Français). La plupart des lecteurs qui m’ont fait part de leur réaction ont jugé la démonstration sévère mais modérée. Ceux qui l’ont trouvée virulente ont généralement confondu le ton mesuré du récit avec la gravité des pratiques dénoncées. Je suis sûr, pourtant, qu’une lecture critique permettrait de me retourner quelques bévues à la figure. Mais c’est trop demander à ceux qui pourraient s’y atteler dans les pages livres ou médias des journaux, en termes de travail et de disposition à débattre de maljournalisme.
C’est l’empirisme qui m’a orienté vers cette recherche hors des sentiers habituels… et permis de dissiper les peurs des éditeurs qui pouvaient s’interroger sur le désistement du Seuil. La qualité d’un journal procédant moins de sa ligne éditoriale que du sérieux de ses enquêtes, j’ai choisi de tester la production journalistique française à travers ce dernier critère avant tout. Un restaurant n’est pas mauvais parce qu’il est chinois ou mexicain, en effet, mais parce qu’il sert des plats avariés ou insipides. D’autre part, je ne me suis pas intéressé aux trains qui arrivent à l’heure, de nombreux traités descriptifs sur la presse française ayant déjà été publiés. Il m’a semblé plus pertinent d’opérer comme beaucoup de journaux lorsqu’ils couvrent une problématique, en portant mon regard sur les locomotives en retard, ou mieux, sur les navires qui dégazent incognito en pleine mer.
Cette approche m’a conduit à critiquer des magazines qui, à l’instar des hebdomadaires Marianne ou Valeurs Actuelles, jouent plus sur la rhétorique que sur la substance journalistique. Elle m'a également permis de constater qu'il y a des rédacteurs respectés qui respectent très peu les règles professionnelles de base. Le fait que cela s’effectue trop souvent ouvertement mais dans une indifférence généralisée montre qu'il y a un malaise, des dysfonctionnements profonds dans la production de l’information. Les grands journaux nationaux tels que Le Monde et Le Figaro, L’Express et Le Nouvel Observateur, sont généralement d’un bon niveau bien entendu. Cela ne les empêche cependant pas de commettre des fautes graves, parfois, sans les reconnaître et sans off
04/02/2008 | Lien permanent
La Zone est plus belle qu'une balle

08/10/2004 | Lien permanent
Le fanatisme de la tolérance
«Tolérance : tolérez mon intolérance» Jules Renard, Journal (comme me l'a rappelé l'un de mes lecteurs, que je remercie) Voici un texte signé par Gonzague Basset-Chercot, que l'intéressé m'a bien évidemment autorisé à reproduire dans la Zone, l'un des espaces, j'en tire une gloire modeste, les plus intolérants de la Toile (tout du moins pour ce qui concerne les questions de littérature) puisque je respecte (alors que je ne le tolère point) mon lecteur comme s'il en allait de mon frère. Je n'ai pas envie de bavarder avec lui mais de discuter, je n'ai pas envie d'émettre des opinions sur la pluie et le beau temps mais de sonder ses gouffres, je n'ai pas envie, enfin, d'exposer mes idées, y compris les plus banalement enrobées d'un style ectoplasmique mais de le convaincre, de le choquer et, peut-être, si j'avais le moindre talent et une force qui me fuit, de le ravir, c'est-à-dire de le forcer. Car ce que craignent ces nains qui trompent leur solitude en s'épandant comme du fumier (fera-t-il pousser quelques patates douces ?), ce qui les fait trembler de rage de la tête aux pieds, c'est tout simplement de constater que coule, dans les veines de quelques-uns, un sang qui, faute de gravité, faute de ce poids de la présence qu'évoquait Michelstaedter, s'est tout simplement évaporé. Revenons au texte de Basset-Chercot, texte vieux de quelques années mais qui, constatant que les apôtres de la tolérance deviennent de plus en plus gras, est décidément d'une actualité plus que... brûlante. Prologue  Ils n'ont que ce mot à la bouche et le brandissent tel un étendard qui claque au vent de la modernité. Tolérance ! Pas un jour sans qu'un animateur célèbre, un intellectuel à la mode ou un homme politique ne se drapent dans ce nouvel idéal. Il faut une sacrée dose de courage pour faire profession de tolérance. La tolérance ça vous campe un homme, fichtre ! Claudel nous avait prévenu, «la tolérance il y a des maisons pour çà» et notre société se découvre progressivement en maison de passe, comptoir clos pour discussions sans alcool. Il est un bon usage de la tolérance, vital tout autant que fécond, et c'est en son nom que nous dénonçons un usage plus mauvais. Aujourd'hui, nous aimons trop l'homme et sa liberté pour le laisser devenir esclave d'un nouveau fanatisme : le fanatisme de la tolérance. Mon choix sinon rien
Ils n'ont que ce mot à la bouche et le brandissent tel un étendard qui claque au vent de la modernité. Tolérance ! Pas un jour sans qu'un animateur célèbre, un intellectuel à la mode ou un homme politique ne se drapent dans ce nouvel idéal. Il faut une sacrée dose de courage pour faire profession de tolérance. La tolérance ça vous campe un homme, fichtre ! Claudel nous avait prévenu, «la tolérance il y a des maisons pour çà» et notre société se découvre progressivement en maison de passe, comptoir clos pour discussions sans alcool. Il est un bon usage de la tolérance, vital tout autant que fécond, et c'est en son nom que nous dénonçons un usage plus mauvais. Aujourd'hui, nous aimons trop l'homme et sa liberté pour le laisser devenir esclave d'un nouveau fanatisme : le fanatisme de la tolérance. Mon choix sinon rien  Chaque après midi, la tolérance s'exhibe sur le service public au cours de l'émission C'est mon choix. Des invités y rivalisent d'originalité en comportements fantaisistes. Tel breton mange des assiettes, telle adolescente est métalliquement percée de la tête aux pieds, tel couple a renoncé d'adopter un enfant au profit d'un bébé tigre. Sympathiques énergumènes parfaitement libres de se comporter ainsi, d'autant qu'ils ne sont en général ni prosélytes ni violents. Plus préoccupante est l'habitude qui veut que dans la salle, par réflexe pavlovien de consensus insipide, tout le monde approuve sans réserve lesdits comportements. «C'est votre choix» assène lapidairement l'animatrice, et le public de s'incliner platement devant la maxime devenue loi. Tout choix en l'espèce se vaut et, pour reprendre l'injure détournée par les laudateurs de ce relativisme facile, quiconque ose en discuter le bien fondé est un fasciste. N'en déplaise aux sceptiques, il faut pourtant noter que quand la vérité est connue avec certitude, la tolérance devient sans objet. Au risque de paraître tatillon, un reste de bon sens autorise à ne pas applaudir l'hurluberlu qui déclare que deux et deux font cinq. Tenus de le respecter, nous avons le droit de le contredire. Quand il y a une vérité et un bien, la tolérance n'est qu'un signe d'ignorance ou d'indifférence morale. Parfois lâche, la tolérance cherche l'approbation plus que la vérité. Aux sources de la tolérance
Chaque après midi, la tolérance s'exhibe sur le service public au cours de l'émission C'est mon choix. Des invités y rivalisent d'originalité en comportements fantaisistes. Tel breton mange des assiettes, telle adolescente est métalliquement percée de la tête aux pieds, tel couple a renoncé d'adopter un enfant au profit d'un bébé tigre. Sympathiques énergumènes parfaitement libres de se comporter ainsi, d'autant qu'ils ne sont en général ni prosélytes ni violents. Plus préoccupante est l'habitude qui veut que dans la salle, par réflexe pavlovien de consensus insipide, tout le monde approuve sans réserve lesdits comportements. «C'est votre choix» assène lapidairement l'animatrice, et le public de s'incliner platement devant la maxime devenue loi. Tout choix en l'espèce se vaut et, pour reprendre l'injure détournée par les laudateurs de ce relativisme facile, quiconque ose en discuter le bien fondé est un fasciste. N'en déplaise aux sceptiques, il faut pourtant noter que quand la vérité est connue avec certitude, la tolérance devient sans objet. Au risque de paraître tatillon, un reste de bon sens autorise à ne pas applaudir l'hurluberlu qui déclare que deux et deux font cinq. Tenus de le respecter, nous avons le droit de le contredire. Quand il y a une vérité et un bien, la tolérance n'est qu'un signe d'ignorance ou d'indifférence morale. Parfois lâche, la tolérance cherche l'approbation plus que la vérité. Aux sources de la tolérance  En latin, tolerantia signifie patience, résignation, constance à endurer ; tollo signifie porter, supporter. Tolérer est l'effort qui consiste à accepter ce qu'on pourrait combattre. Souffrance par laquelle on supporte l'erreur et le vice, la tolérance est un laisser-faire qui fait exception à la règle, une dérogation dans le droit. Dérogation sans exclusion ni persécution mais sans approbation. Furetière en 1690 est explicite : «Tolérer : [...] souffrir quelque chose, ne s'en pas plaindre, n'en pas faire la punition. Il faut tolérer les défauts de ceux avec qui nous avons à vivre. On tolère à Rome les lieux de débauche, mais on ne les approuve pas. Il faut tolérer les abus, quand on ne peut pas les retrancher tout à fait, tolérer les crimes qu'on ne peut pas punir.» Nulle gloire ici à être tolérant. Bossuet considère le mot comme une insulte qui signifie faible, lâche et cynique. Dans ce contexte, c'est l'amour même du prochain et de la vérité qui conduit parfois à l'intolérance. Historiquement, l'intolérance fut souvent la règle et la tolérance l'exception. L'homme ne naît pas tolérant mais le devient à partir du XVIème siècle. L'édit de Nantes de 1598 marque en ce sens un tournant, acte de tolérance par lequel Henri IV accorde aux protestants des libertés nouvelles. La tolérance s'épanouira à mesure qu'on laissera derrière soi l'arrogance de l'absolu. Féconde, elle accouchera de la laïcité qui est de la tolérance instituée. Cette avancée de la tolérance constitue un formidable progrès. Malheureusement, toute avancée se gâte à sa limite et un excès peut en cacher un autre. Aujourd'hui, l'arrogance de l'absolu a laissé place à l'arrogance du relativisme. Tolérer n'est pas approuver
En latin, tolerantia signifie patience, résignation, constance à endurer ; tollo signifie porter, supporter. Tolérer est l'effort qui consiste à accepter ce qu'on pourrait combattre. Souffrance par laquelle on supporte l'erreur et le vice, la tolérance est un laisser-faire qui fait exception à la règle, une dérogation dans le droit. Dérogation sans exclusion ni persécution mais sans approbation. Furetière en 1690 est explicite : «Tolérer : [...] souffrir quelque chose, ne s'en pas plaindre, n'en pas faire la punition. Il faut tolérer les défauts de ceux avec qui nous avons à vivre. On tolère à Rome les lieux de débauche, mais on ne les approuve pas. Il faut tolérer les abus, quand on ne peut pas les retrancher tout à fait, tolérer les crimes qu'on ne peut pas punir.» Nulle gloire ici à être tolérant. Bossuet considère le mot comme une insulte qui signifie faible, lâche et cynique. Dans ce contexte, c'est l'amour même du prochain et de la vérité qui conduit parfois à l'intolérance. Historiquement, l'intolérance fut souvent la règle et la tolérance l'exception. L'homme ne naît pas tolérant mais le devient à partir du XVIème siècle. L'édit de Nantes de 1598 marque en ce sens un tournant, acte de tolérance par lequel Henri IV accorde aux protestants des libertés nouvelles. La tolérance s'épanouira à mesure qu'on laissera derrière soi l'arrogance de l'absolu. Féconde, elle accouchera de la laïcité qui est de la tolérance instituée. Cette avancée de la tolérance constitue un formidable progrès. Malheureusement, toute avancée se gâte à sa limite et un excès peut en cacher un autre. Aujourd'hui, l'arrogance de l'absolu a laissé place à l'arrogance du relativisme. Tolérer n'est pas approuver  La tolérance était indulgence, elle est devenue approbation. Pour reprendre Furetière, tolérer les lieux de débauche à Rome ne nécessite pas de les approuver. Notre société pourtant a franchi le pas, qui admoneste ceux là même qui admonestent, en vertu du principe du tout s'approuve rien ne se réprouve. La nouvelle tolérance interdit d'être contre et somme d'être pour, ce qui revient hélas à une abdication de la liberté. Quand l'intolérance est privation de la liberté d'autrui, la tolérance est parfois privation de sa propre liberté, en ce qu'elle fuit le discernement. C'est que, disent les sans-courage, tout jugement juge et tout libre-arbitre arbitre ! Mieux leur plaît la tolérance systématique, qui enjoint sans effort d'acquiescer. Tout discernement invite à prendre position, et d'abord pour soi-même, mais la mode confortable est à la désertion. Défroqués de leur position, les déserteurs de la raison pâlissent aux chandelles vacillantes de la conscience atone. «Appelles-tu liberté le droit d'errer dans le vide ?» (Saint-Exupéry) La tolérance ne tolère plus rien auprès d'elle
La tolérance était indulgence, elle est devenue approbation. Pour reprendre Furetière, tolérer les lieux de débauche à Rome ne nécessite pas de les approuver. Notre société pourtant a franchi le pas, qui admoneste ceux là même qui admonestent, en vertu du principe du tout s'approuve rien ne se réprouve. La nouvelle tolérance interdit d'être contre et somme d'être pour, ce qui revient hélas à une abdication de la liberté. Quand l'intolérance est privation de la liberté d'autrui, la tolérance est parfois privation de sa propre liberté, en ce qu'elle fuit le discernement. C'est que, disent les sans-courage, tout jugement juge et tout libre-arbitre arbitre ! Mieux leur plaît la tolérance systématique, qui enjoint sans effort d'acquiescer. Tout discernement invite à prendre position, et d'abord pour soi-même, mais la mode confortable est à la désertion. Défroqués de leur position, les déserteurs de la raison pâlissent aux chandelles vacillantes de la conscience atone. «Appelles-tu liberté le droit d'errer dans le vide ?» (Saint-Exupéry) La tolérance ne tolère plus rien auprès d'elle  L'on ne peut tout tolérer et les modernes l'ont bien compris, qui ont édicté des règles pour punir l'intolérable. Malgré quelques zones circonscrites de tolérance limitée, la tendance reste toutefois à la tolérance illimitée. Partie de la tolérance zéro, notre société en arrive à l'intolérance zéro. De fait, l'erreur fut d'habiller d'absolu une notion qui était relative. Exception devenue règle, la tolérance est le nouvel impératif catégorique d'une société qui ne souffre pourtant plus l'impératif. Le bon usage invite la tolérance à être de circonstance plutôt que de principe. Sans autre forme de procès, l'inconditionnelle tolérance dicte toutefois ses commandements. Le fanatisme de la tolérance consiste en un zèle passionné pour une doctrine, qui en oublie d'être humble et ne tolère plus qu'elle même. Intolérante, la tolérance est devenue outrancière. Rien ne semble en mesure de mettre fin à sa course effrénée dans le vide. Pas de tolérance pour les ennemis de la tolérance ! Nouveau credo des chiens de garde du tout est bien qui commence bien. Infantilisme de la nouvelle tolérance En ce qu'elle a partie liée au relativisme, la tolérance est devenue la garantie édulcorée d'une modernité sans foi ni loi, qui exhorte tout jugement à passer chemin. Teintée de nihilisme, cette tolérance promeut les différences pour finalement mieux les nier. Quand rien ne diffère et ne doit différer, tout mot devient de trop et toute idée importune. Ce mauvais usage de la tolérance porte en lui les germes de l'infantilisme en ce qu'il est un déni de responsabilité. Etre responsable c'est répondre de, être tolérant c'est ne pas répondre. Quand on ne croit fondamentalement à rien, on peut tout admettre et l'on finit par croire à tout. La vie mature avec la pensée cède alors doucement la place au face à face du fanatique et du zombie. D'un côté le fanatique intolérant qui se croit seul dépositaire d'une vérité et se refuse à douter. De l'autre l'infantile qui à force de douter de tout finit par ne plus se douter de rien. L'excès en tout est un défaut. Vil est l'excès d'intolérance, puéril l'excès de tolérance. Entre mainmise et abstention politique Au plan politique, intolérance et tolérance systématiques sont deux impasses. Hannah Arendt montre bien que c'est dans la mesure où il fonctionne à l'idéologie et à la vérité que le totalitarisme est intolérant. Une tyrannie est toujours une tyrannie du prétendu vrai, un abus de pouvoir et une mainmise abjecte. A contrario, cesser d'aimer le vrai fait également le jeu du totalitarisme. Le sujet idéal du régime totalitaire est en effet l'homme pour qui la distinction entre fait et fiction, vrai et faux, n'existe plus. La sophistique laisse les coudées franches à la manipulation qui fait le jeu du totalitarisme. Si rien n'est vrai, qu'opposer à des mensonges ? On entrevoit ici les dangers d'une société d'indulgence plénière, sourde aux admonestations salutaires. La tolérance sans frein est du néo-libéralisme des consciences, déni de souveraineté qui s'abstient sans peine et laisse faire les pires inepties. Au sommet du politiquement correct trônent l'urne et l'isoloir vides, incarnations fantoches de tolérance maximale. Je tolère donc je me tais. Silence, la tolérance vous parle !
L'on ne peut tout tolérer et les modernes l'ont bien compris, qui ont édicté des règles pour punir l'intolérable. Malgré quelques zones circonscrites de tolérance limitée, la tendance reste toutefois à la tolérance illimitée. Partie de la tolérance zéro, notre société en arrive à l'intolérance zéro. De fait, l'erreur fut d'habiller d'absolu une notion qui était relative. Exception devenue règle, la tolérance est le nouvel impératif catégorique d'une société qui ne souffre pourtant plus l'impératif. Le bon usage invite la tolérance à être de circonstance plutôt que de principe. Sans autre forme de procès, l'inconditionnelle tolérance dicte toutefois ses commandements. Le fanatisme de la tolérance consiste en un zèle passionné pour une doctrine, qui en oublie d'être humble et ne tolère plus qu'elle même. Intolérante, la tolérance est devenue outrancière. Rien ne semble en mesure de mettre fin à sa course effrénée dans le vide. Pas de tolérance pour les ennemis de la tolérance ! Nouveau credo des chiens de garde du tout est bien qui commence bien. Infantilisme de la nouvelle tolérance En ce qu'elle a partie liée au relativisme, la tolérance est devenue la garantie édulcorée d'une modernité sans foi ni loi, qui exhorte tout jugement à passer chemin. Teintée de nihilisme, cette tolérance promeut les différences pour finalement mieux les nier. Quand rien ne diffère et ne doit différer, tout mot devient de trop et toute idée importune. Ce mauvais usage de la tolérance porte en lui les germes de l'infantilisme en ce qu'il est un déni de responsabilité. Etre responsable c'est répondre de, être tolérant c'est ne pas répondre. Quand on ne croit fondamentalement à rien, on peut tout admettre et l'on finit par croire à tout. La vie mature avec la pensée cède alors doucement la place au face à face du fanatique et du zombie. D'un côté le fanatique intolérant qui se croit seul dépositaire d'une vérité et se refuse à douter. De l'autre l'infantile qui à force de douter de tout finit par ne plus se douter de rien. L'excès en tout est un défaut. Vil est l'excès d'intolérance, puéril l'excès de tolérance. Entre mainmise et abstention politique Au plan politique, intolérance et tolérance systématiques sont deux impasses. Hannah Arendt montre bien que c'est dans la mesure où il fonctionne à l'idéologie et à la vérité que le totalitarisme est intolérant. Une tyrannie est toujours une tyrannie du prétendu vrai, un abus de pouvoir et une mainmise abjecte. A contrario, cesser d'aimer le vrai fait également le jeu du totalitarisme. Le sujet idéal du régime totalitaire est en effet l'homme pour qui la distinction entre fait et fiction, vrai et faux, n'existe plus. La sophistique laisse les coudées franches à la manipulation qui fait le jeu du totalitarisme. Si rien n'est vrai, qu'opposer à des mensonges ? On entrevoit ici les dangers d'une société d'indulgence plénière, sourde aux admonestations salutaires. La tolérance sans frein est du néo-libéralisme des consciences, déni de souveraineté qui s'abstient sans peine et laisse faire les pires inepties. Au sommet du politiquement correct trônent l'urne et l'isoloir vides, incarnations fantoches de tolérance maximale. Je tolère donc je me tais. Silence, la tolérance vous parle !  Glissement décisif pour Alain Finkielkraut, l'individu moderne prend aujourd'hui pour son identité ce qui n'est que son opinion. Comme si contredire une opinion et discuter une particularité revenaient à remettre en cause une identité, autrui se sent attaqué dans son essence dès lors que je questionne son existence. Dans un espace de tolérance classique, l'opinion consent à être contredite et démentie. Dans un espace de tolérance détournée, l'opinion devient identitaire et ne souffre pas d'être discutée. Au pluralisme des opinions succède le pluralisme des identités. Ce glissement de l'opinion à l'identité est porteur de violence car à la différence des opinions, les identités ne transigent pas et récusent toute contestation. Stigmatisé, celui qui ne les reconnaît est taxé de racisme. Qui est circonspect devant la revendication d'une minorité est traité par elle de fasciste. Qui émet la moindre réserve à l'égard de la revendication des homosexuels est taxé d'homophobie. S'érige alors un espace du tout ou rien, sans discussion possible, où toute parole est perçue comme une menace. «Tout ce qui n'est pas moi est un agent de répression à mon égard !» (slogan de mai 68). On ne discute pas, on revendique Héritier direct de la polis grecque, c'est le parler-ensemble qui fait le socle de la démocratie. Que reste-t-il de la délibération dans un espace silencieux et binaire, voué tout entier à la reconnaissance ? Les nouvelles intolérances se constituent de ces identités en forme de combat qui prétendent combattre l'intolérance, d'un pluralisme identitaire qui détruit l'espace de discussion. Les nouveaux censeurs refusent aujourd'hui le dialogue, soit que toute vérité leur paraisse suspecte, soit qu'elle ne les intéresse plus. Sur l'agora moderne clairsemée on ne discute plus, on revendique. De la tolérance au respect
Glissement décisif pour Alain Finkielkraut, l'individu moderne prend aujourd'hui pour son identité ce qui n'est que son opinion. Comme si contredire une opinion et discuter une particularité revenaient à remettre en cause une identité, autrui se sent attaqué dans son essence dès lors que je questionne son existence. Dans un espace de tolérance classique, l'opinion consent à être contredite et démentie. Dans un espace de tolérance détournée, l'opinion devient identitaire et ne souffre pas d'être discutée. Au pluralisme des opinions succède le pluralisme des identités. Ce glissement de l'opinion à l'identité est porteur de violence car à la différence des opinions, les identités ne transigent pas et récusent toute contestation. Stigmatisé, celui qui ne les reconnaît est taxé de racisme. Qui est circonspect devant la revendication d'une minorité est traité par elle de fasciste. Qui émet la moindre réserve à l'égard de la revendication des homosexuels est taxé d'homophobie. S'érige alors un espace du tout ou rien, sans discussion possible, où toute parole est perçue comme une menace. «Tout ce qui n'est pas moi est un agent de répression à mon égard !» (slogan de mai 68). On ne discute pas, on revendique Héritier direct de la polis grecque, c'est le parler-ensemble qui fait le socle de la démocratie. Que reste-t-il de la délibération dans un espace silencieux et binaire, voué tout entier à la reconnaissance ? Les nouvelles intolérances se constituent de ces identités en forme de combat qui prétendent combattre l'intolérance, d'un pluralisme identitaire qui détruit l'espace de discussion. Les nouveaux censeurs refusent aujourd'hui le dialogue, soit que toute vérité leur paraisse suspecte, soit qu'elle ne les intéresse plus. Sur l'agora moderne clairsemée on ne discute plus, on revendique. De la tolérance au respect  Régi par le pluralisme identitaire et le culte de la reconnaissance, l'espace public laisse alors peu de place à l'amitié. Tout reconnaître équivaut à ne plus rien reconnaître et à tout méconnaître. Un brouillard d'insignifiances empêche d'avancer, fût-ce masqué, à la recherche d'un main amie. Royaume viril où tout n'est pas permis, l'amitié exige pour porter beaucoup de châtier un peu. «Ce que j'aime le moins dans l'ami, d'ordinaire, c'est l'indulgence» dit Gide. La tolérance est vertu positive quand elle sait ses limites et contrarie l'indifférence. En amour, la tolérance devient respect, courage en même temps que renoncement. Courage car reprendre l'autre nécessite de se découvrir aimant. Renoncement car accepter l'autre nécessite de se découvrir humble. Preuve d'empathie, la tolérance n'est plus un supporter mais un accepter. Déférence qui s'attache à accepter l'autre, non plus à s'en séparer par indifférence. Réticents au sectarisme et éternels amoureux, nous célébrons le respect de l'autre plutôt qu'une tolérance détournée de ses vertus sages par les apôtres de l'insignifiance. Épilogue Aride est la tolérance zéro, ivre la tolérance infinie. A nos yeux d'hommes tendres mais volontaires, la tolérance est affaire de pondération. Salutaire moment que la tolérance, à condition qu'elle soit pause revigorante et non repos lénifiant, terrain d'entente et non de reniement. Trait d'union entre les individus, la tolérance doit gagner en respect pour être la marque non d'une séparation mais bien d'un attachement. En attendant qu'elle redevienne ce «genre de sagesse qui surmonte le fanatisme» (Alain), un reste de bon sens nous inclinera à ne pas tout tolérer. L'amour du bien, du beau et du juste, ça oblige et ça discrimine, forcément.
Régi par le pluralisme identitaire et le culte de la reconnaissance, l'espace public laisse alors peu de place à l'amitié. Tout reconnaître équivaut à ne plus rien reconnaître et à tout méconnaître. Un brouillard d'insignifiances empêche d'avancer, fût-ce masqué, à la recherche d'un main amie. Royaume viril où tout n'est pas permis, l'amitié exige pour porter beaucoup de châtier un peu. «Ce que j'aime le moins dans l'ami, d'ordinaire, c'est l'indulgence» dit Gide. La tolérance est vertu positive quand elle sait ses limites et contrarie l'indifférence. En amour, la tolérance devient respect, courage en même temps que renoncement. Courage car reprendre l'autre nécessite de se découvrir aimant. Renoncement car accepter l'autre nécessite de se découvrir humble. Preuve d'empathie, la tolérance n'est plus un supporter mais un accepter. Déférence qui s'attache à accepter l'autre, non plus à s'en séparer par indifférence. Réticents au sectarisme et éternels amoureux, nous célébrons le respect de l'autre plutôt qu'une tolérance détournée de ses vertus sages par les apôtres de l'insignifiance. Épilogue Aride est la tolérance zéro, ivre la tolérance infinie. A nos yeux d'hommes tendres mais volontaires, la tolérance est affaire de pondération. Salutaire moment que la tolérance, à condition qu'elle soit pause revigorante et non repos lénifiant, terrain d'entente et non de reniement. Trait d'union entre les individus, la tolérance doit gagner en respect pour être la marque non d'une séparation mais bien d'un attachement. En attendant qu'elle redevienne ce «genre de sagesse qui surmonte le fanatisme» (Alain), un reste de bon sens nous inclinera à ne pas tout tolérer. L'amour du bien, du beau et du juste, ça oblige et ça discrimine, forcément.
04/02/2005 | Lien permanent
La littérature à contre-vent, par Olivier Noël

Sören Kierkegaard, Le Journal du séducteur.
«Le monde tend à la multiplication indéfinie des romanciers et de leurs expériences, à l’éclatante confusion du roman et de la vie. Seulement, pour faire coller ensemble ces millions de vies qui se voudront toutes absolument lucides et romantiques, au sens nouveau du mot, vies de roman, il faudra inventer et soutenir des situations si extrêmes, si inextricablement en proie aux démons de l’analyse, du détachement et de la révolte que cela finir comme le règne des rois dans l’Apocalypse, dans quelque Armagédon.»
Raymond Abellio, Les Yeux d’Ézéchiel sont ouverts.
«Nous sommes faits de l’étoffe dont sont tissés les vents.»
Alain Damasio, La Horde du contrevent.
 Une fois de plus, j'ouvre la Zone à un rédacteur de qualité. Si, comme le déclarait Bernanos de sa modeste demeure brésilienne et, bien sûr, de ses propres écrits, je pouvais faire que ce site borgésien soit une espèce de maison ouverte aux quatre vents, je n'aurais pas trop mal réussi dans ma volonté d'illustrer un travail rigoureux d'écriture, y compris aventureuse, soumise aux rencontres, bref, en un mot très laid, dialogique. Ainsi, après Francis Moury, dont je mettrai d'ici peu en ligne certaines de ses toutes récentes critiques consacrées à quelques-uns des plus fameux films de Tarkovski, Serge Rivron, qui n'en finit pas, à juste raison me semble-t-il, de fulminer contre les forfaitures dont se rendent coupables nos hommes politiques, mais aussi Dominique Autié, Matthieu Baumier, Gonzague Basset-Chercot, Laurent Schang, Sarah Vajda, cet espace de parole est aujourd'hui dédié à Olivier Noël, patron du site Transhumain, qui signe ici un bel article de colère et de passion. Passion pour un Verbe rédempteur (sans qu'il y aille pour Olivier, je le sais bien, d'une quelconque subordination à un clergé) et colère face à la médiocrité dans laquelle s'enfoncent, peu à peu mais inexorablement, la plupart des auteurs de langue française.
Une fois de plus, j'ouvre la Zone à un rédacteur de qualité. Si, comme le déclarait Bernanos de sa modeste demeure brésilienne et, bien sûr, de ses propres écrits, je pouvais faire que ce site borgésien soit une espèce de maison ouverte aux quatre vents, je n'aurais pas trop mal réussi dans ma volonté d'illustrer un travail rigoureux d'écriture, y compris aventureuse, soumise aux rencontres, bref, en un mot très laid, dialogique. Ainsi, après Francis Moury, dont je mettrai d'ici peu en ligne certaines de ses toutes récentes critiques consacrées à quelques-uns des plus fameux films de Tarkovski, Serge Rivron, qui n'en finit pas, à juste raison me semble-t-il, de fulminer contre les forfaitures dont se rendent coupables nos hommes politiques, mais aussi Dominique Autié, Matthieu Baumier, Gonzague Basset-Chercot, Laurent Schang, Sarah Vajda, cet espace de parole est aujourd'hui dédié à Olivier Noël, patron du site Transhumain, qui signe ici un bel article de colère et de passion. Passion pour un Verbe rédempteur (sans qu'il y aille pour Olivier, je le sais bien, d'une quelconque subordination à un clergé) et colère face à la médiocrité dans laquelle s'enfoncent, peu à peu mais inexorablement, la plupart des auteurs de langue française.Bonne lecture.
Mes activités de critique pour la revue Galaxies, avant tout motivées par cette vieille intuition exhumée à l’occasion de la découverte des Racines du Mal de Maurice G. Dantec, que de l’accouplement frénétique des «mauvais genres» et de la littérature «blanche» naîtrait un sursis, un sursaut, voire une résurrection – ou simple rémission – d’un Verbe mis à mort par la fausse parole récemment évoquée dans la Zone, ce Novlangue moderne qui réduit le champ des possibles – l’Univers –, m’ont amené à lire de nombreux romans «d’imaginaire», appellation qui ne me plaît guère – les écrivains dits «réalistes» ne feraient donc pas œuvre d’imagination ?… – mais qui en dernière analyse a néanmoins l’avantage, à condition de la considérer au sens large, de revendiquer une inventivité presque innocente (parfois naïve) au service de la fiction, c’est-à-dire de la re-création du monde, à l’opposé d’une littérature néantisée, mimétique, delermique, angotique, dont les modes de narration mêmes, dont le style même, où se concentre le peu d’énergie créatrice dont ils sont capables, phagocytent leur pouvoir d’évocation, sanctifient cette odeur de putréfaction que mon hôte n’a de cesse d’agonir. Dois-je rappeler qu’il s’agissait d’ailleurs du principal enjeu de 1984, plus encore peut-être que sa célèbre dénonciation des totalitarismes fascistes et socialistes ? C’est parce que leur langue a été ligotée en effet, déportée pourrait-on dire, que l’humanité y finit broyée par un pouvoir déshumanisé. La science-fiction et l’anticipation ont longtemps su réactiver la puissance évocatrice du Verbe – voir Fahrenheit 451 –, sa faculté à nous transporter non pas dans des paradis artificiels ou dans les meilleurs des mondes, mais au contraire dans d’autres mondes, littéralement, fantasmes ou spéculations visionnaires de celui que nous appelons nôtre. Seulement le Novlangue sait prendre à l’instar du Serpent les formes les moins suspectes, et tromper les sens des moins candides : les pressions économiques, les impératifs de ventes, ont tué les petits éditeurs, décapité les collections les plus audacieuses, poussé les auteurs à se complaire dans une écriture neutre et des récits balisés – à sacrifier, de gré ou de force, au nouveau culte de «l’art du conteur» – pernicieux avatar du relativisme et de la dictature de la médiocrité assumée – habile manœuvre des marchands pour enterrer les plus modestes ambitions littéraires.
Mais la résistance est encore armée pour déjouer les pièges de l’Adversaire : ce n’est certes pas un hasard, au-delà des lieux communs ânonnés par les uns (la SF serait une méprisable paralittérature) comme par les autres (la littérature «blanche» serait nombriliste et en déficit incurable d’imagination), si les romans les plus passionnants, ceux qui parviennent encore à m’enthousiasmer, à me faire entrevoir l’infinitude du monde, à me convaincre que la littérature est encore nécessaire et non seulement un loisir dévoreur de temps – je ne puis m’empêcher, ayant une conscience aiguë de ma propre finitude et de celle de mes proches, de combattre les innombrables futilités dont mon existence est constituée quand je devrais sans doute brûler mes livres et cesser toute activité d’écriture –, les œuvres vitales donc, ou du moins vivantes, se situent plutôt aujourd’hui dans les marges, aux bordures – aux ordures – de genres désormais absorbés et, pour les meilleurs, assimilés. La littérature du vingt-et-unième siècle, forcément transhumaine, sera celle de la fusion – de la collision – ou ne sera pas. Les écrivains d’âme et de corps devront injecter leurs visions dans un accélérateur de particules et recueillir les résultats, souvent inattendus, de l’explosive rencontre.
J’ignore à dire vrai si le paysage littéraire français a vraiment changé ou si ma perception du Réel, ébranlée par les salvateurs coups de boutoir de ces livres-univers, me joue plutôt de malins tours, mais il me semble que depuis quelques années, nous assistons à une sensible augmentation du nombre de livres insaisissables, inclassables – à ce titre regardés d’un œil torve d’un côté comme de l’autre –, électrons-livres, enfants fous des pionniers postmodernes tels Thomas Pynchon (L’Arc-en-ciel de la gravité), Bret Easton Ellis (Glamorama) ou Don DeLillo (Outremonde) mais aussi, au risque de m’attirer les foudres des bien-pensants, de Maurice G. Dantec – auteurs, parmi d’autres, qui conçoivent en effet leurs livres comme des univers abondamment nourris cependant des signes de notre monde.
Hormis quelques œuvres éparses –, citons Philippe Curval (La Forteresse de coton, parue chez Gallimard en 1967 puis rééditée en Présence du futur chez Denoël, ode à l’amour fou et géniale errance d’un schizophrène dans une Venise fantomatique) ou Antoine Volodine (dont la réédition en 2003, en un volume, des quatre premiers romans publiés par Présence du futur – Biographie comparée de Jorian Murgrave, Un navire de nulle part, Rituel du mépris, Un enfer fabuleux – fut un événement incommensurable, hélas oublié de médias visiblement vendus aux promoteurs – aux proxénètes – de tout poil) –, hormis donc quelques francs-tireurs souvent publiés par d’audacieuses collections de science-fiction, nous n’avions pas grand chose, en France, à nous mettre sous la dent… Nous disposions, entre les années 60 et 90, de bons romans de genre, dépaysants, contés avec talent ; nous avions des romans denses, intellectuels ou formalistes, mais peu possédaient ce souffle dévastateur, cette Voix transcendante, indestructible, qui est aussi voie ascendante. Il y a Tombeau pour cinq cent mille soldats et Éden Éden Éden de Pierre Guyotat, Septentrion de Calaferte, publié en 1987 après plus de vingt ans de mise à l’index ; Clémence Picot de Régis Jauffret ; Un prof bien sous tout rapport, de Bénier-Bürckel ; Houellebecq peut-être, quoique sur un mode mineur ; Marc-Edouard Nabe pourquoi pas ; et Dantec – je n’en vois guère d’autres – : ces auteurs, avec le siècle finissant, sonnaient le glas d’une littérature française moribonde, sédimentée et novlanguisée ad nauseam. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Calaferte six pieds sous terre, Jauffret bloqué sur le mode repeat, Bénier-Bürckel confronté à son impuissance à écrire autre chose que la haine – autre chose que son premier roman –, Houellebecq dilué dans ses gimmicks et ses inutiles scènes de cul ; Nabe enragé… Quant à Dantec, quand il ne dilapide pas son talent en de douteux articles pamphlétaires sur le Ring, il gâche un presque chef-d’œuvre d’une folle ambition (Villa Vortex) avec certaines facilités d’écriture et une dernière partie calamiteuse où le Verbe devient verbeux, gagné à son tour par l’emprise de la fausse parole – et Guyotat s’est apparemment enfermé dans un hermétisme quasi solipsiste dont, n’ayant pas lu les Progénitures, je ne saurais dire s’il n’est pas qu’une épouvantable posture post-joycienne…
Or en l’espace de deux ou trois ans, peut-être un peu plus, sont apparues en librairie – jamais bien longtemps hélas – des armadas d’ovnis livresques, étranges créatures littéraires surgies de tous horizons qui n’ont d’ailleurs en commun qu’un goût prononcé pour l’invention, pour l’expérimentation, la réappropriation parfois ludique, irrespectueuse, parfois encore enfiévrée, du Verbe créateur à l’ère des réseaux. La maison des feuilles, de Mark Z. Danielewski, s’il fut précédé de nombreuses expériences, émancipa d’une certaine façon les auteurs, les éditeurs, jusqu’aux lecteurs eux-mêmes, des formes sclérosées du roman. Tout était possible soudain, y compris ce qui semblait alors réservé à l’élite (ce qui n’était qu’à moitié vrai). Il convient évidemment de ne pas nous départir de la plus élémentaire prudence : ces déstructurations décomplexées du langage ne sont peut-être que les prémisses d’une déconstruction, c’est-à-dire d’une nouvelle mise à mort de la littérature que plus rien ne distinguerait alors du langage binaire, numérique, des réseaux – je crois même déceler, dans cette profusion suspecte, un nouvel attrape-couillon pour bobos et dandys mondains, toutes catégories auxquelles j’espère ne jamais m’identifier –, c’est-à-dire rien moins que la forme achevée du Novlangue orwellien – douce Apocalypse. Je ne puis toutefois m’empêcher – tropisme transhumain sans doute ! – d’y deviner a contrario, tapies au creux des pages, les prodromes d’une salutaire régénération de la puissance littéraire, l’authentique ré-enchantement d’un monde réifié dont la littérature classique ne serait plus qu’une composante parmi d’autres – quelques tétraoctets googlisables sur demande, parfaitement intégrés à l’architecture informatique de la Créature inhumaine prophétisée par Jean-Michel Truong.
Ainsi par exemple l’excellent Carte muette de Philippe Vasset, publié chez Fayard en 2004, court mais magnifique récit poétique – sous forme de prose et de courriers électroniques – d’un échec, celui de l’impossible cartographie de l’Internet, des tuyaux, centrales et satellites aux e-mails, connexions et aux informations elles-mêmes, c’est-à-dire celle du monde : avec cette minimaliste poésie des câbles, des fibres et des signaux, c’est à la naissance d’un inframonde que nous assistons, ou plutôt à celle d’une nouvelle perception du monde : un outre monde. L’univers technologique des réseaux y acquiert une mystérieuse minéralité, une réalité presque organique, inquiétante, aussi fascinante que les planètes extraterrestres où nous convie parfois la science-fiction : «Internet, ce sont d’énormes banques de données qui glissent en permanence à la surface du globe selon des itinéraires ménagés et, tout autour, le vibrionnement d’une activité incessante : des e-mails, des échanges de fichiers, des consultations de pages, tout cela comme des bancs de poissons sur les flancs d’un cétacé. Mener une exploration raisonnée de ce phénomène, ce serait en détailler les traces dans l’espace réel – quels sont les lieux mis en relations par le réseau et selon quelles voies –, un peu comme on piste un glacier depuis longtemps disparu grâce aux moraines qu’il a laissées sur son passage et aux profondes traces creusées aux flancs des montagnes.» Pour Philippe Vasset, à l’exploration géographique des derniers siècles a succédé celle, aux contours encore indécis – magique ? – de l’infosphère, des échangeurs et des pylônes. Hélas nous ne sommes pas prêts, nous autres humains doués de sentiments et de raison, à nous mouvoir sans mal dans ce nouveau Labyrinthe borgésien : cette improbable cartographie n’avait pour but que d’octroyer à la Speedial Foundation (la multinationale commanditaire du projet) le contrôle total, démiurgique, des flux d’information – dans Carte muette, tout n’est que pare-feux et faux-semblants, avatars et sociétés-écrans ; l’humanité est comme dissoute, déjà morte, déjà vaincue par le Moloch technologique : «[…] interminable jeu de taches et de souillures qui, mêlées aux noms, forment comme un texte aux lignes serrées, régulières, long relevé de connexions, d’horaires, d’aller et retour, d’identités, de montants, de latitudes, de profils, d’adresses et de casiers judiciaires, de péripéties, de rebondissements, d’itinéraires, de discours et d’alibis, interminable facture, quittance, récépissé, bordereau : autant de certificats de décès du superbe anonymat de l’espace, devenue une étendue omnisciente, lieu d’inscription d’une mémoire absolue. L’œil, le nom, la carte et le territoire désormais confondus, équivalents. / Depuis, inlassablement, en cercles autour de moi, des spectres s’irisent sur le réseau.» En 2003 déjà, dans Exemplaire de démonstration, Philippe Vasset inventait le «Scriptgenerator», machine à générer du langage, du discours et même de la fiction (audiovisuelle, écrite…) formatés selon les critères souhaités – un cauchemar qui risque cependant de se réaliser plus tôt qu’on ne croit – puisque, et le titre était déjà un indice, la fin du roman nous révélait que ce dernier n’était un pur produit commercial évidemment généré par le Scriptgenerator. Vous, moi, le monde, sommes-nous issus d’une machine à encaisser les dollars ?...
A en croire les écrivains «verticaux» de renews 1 - Terraformation (éditions è®e, 2005), ouvrage collectif soutenu par les éditions Imho (à qui nous devons la revue Inculte) et réunissant entre autres Éric Arlix (initiateur du projet, également auteur du Monde Jou, étonnant livre de résistance à la fragmentation du monde), Jacques Barbéri (à qui nous devons des œuvres puissantes et atypiques comme Narcoseet Rêve de chair), Bruce Bégout (auteur de Zéropolis et du troublant L’éblouissement des bords de route), Chloé Delaume (Corpus Simsi ou la vie considérée comme un jeu vidéo) et l’inépuisable et indispensable Claro (traducteur héroïque de Pynchon, Flint, Vollmann, Danielewski – la version française de La maison des feuilles, c’est lui ! – et auteur de plusieurs romans dont l’ambitieux Livre XIX et la petite bombe Bunker anatomie), rien ne semble impossible. «Terraformation : modifier les conditions existantes à la surface d’une planète pour la rendre habitable». Le livre est composé d’une centaine de news, jamais signées – les auteurs s’effacent, comme les personnages, comme les individus – et chronologiquement désordonnées, relatives au projet de terraformation des planètes et satellites du système solaire. Les textes, ludiques et inventifs, ploient sous les acronymes, anglicismes, termes informatiques et néologismes ; peu à peu naît alors la conviction que du Verbe seul pourrait venir le salut. Je n’ai donc pas été surpris du virage comique/allégorique pris par ce récit fragmentaire lorsque les hommes sont confrontés à la sédition inconditionnelle et définitive de tous les personnages de fiction ayant jamais existé – parmi lesquels Bartleby, qui se manifeste aux humains avec son fameux «je préfèrerais ne pas» –… Extraits de leur manifeste : «Nous, les personnages de fiction littéraire, avons décidé d’un commun accord de cesser toute activité dans le carcan hostile que constituent les livres. Fut un temps où nous pensions que nos existences, majoritairement pétries de souffrances, avaient un sens. […] Nous nous sommes rendu compte que depuis plusieurs décennies les hommes se détournaient de nous, rendant notre fidèle abnégation de plus en plus dérisoire. […] Vos écrivains ne font plus émigrer chez nous que des fausses couches de leur esprit, insipides reflets de leur appauvrissement mental et de leur banal quotidien. […] Nous sommes déterminés à radicalement changer d’environnement, laissant derrière nous pages papier, word et PDF, comme autant de vestiges de notre amer passé. Il ne s’agit donc pas d’une grève temporaire, mais bien d’une désertion définitive.»
 Comment pourrais-je enfin ne pas saluer le travail formidable abattu par un auteur que peu d’entre vous connaissent je suppose, j’ai nommé Alain Damasio (déjà auteur de la passionnante Zone du dehors chez Cylibris) avec son chef-d’œuvre, unanimement et pour une fois légitimement salué par la Critique spécialisée – mais complètement inconnu au bataillon chez les généralistes vautrés dans leur petit, très petit confort à l’imaginaire trépané –, intitulé La Horde du contrevent, publié aux éditions de la Volte. La Horde du contrevent, par ailleurs fort bel objet (accompagné d’un CD), est le récit à vingt-trois vo
Comment pourrais-je enfin ne pas saluer le travail formidable abattu par un auteur que peu d’entre vous connaissent je suppose, j’ai nommé Alain Damasio (déjà auteur de la passionnante Zone du dehors chez Cylibris) avec son chef-d’œuvre, unanimement et pour une fois légitimement salué par la Critique spécialisée – mais complètement inconnu au bataillon chez les généralistes vautrés dans leur petit, très petit confort à l’imaginaire trépané –, intitulé La Horde du contrevent, publié aux éditions de la Volte. La Horde du contrevent, par ailleurs fort bel objet (accompagné d’un CD), est le récit à vingt-trois vo
16/06/2005 | Lien permanent
L'unique pensée de Jules Lequier, par Francis Moury

 Le nom sous lequel nous connaissons Lequier est déjà un résultat de ce que désigne le titre de cet article : la liberté. Il s’est librement et tardivement renommé Lequier. Son nom pour l’état civil était Joseph Louis Jules Léquyer. Un tel résultat – passer de Jules Léquyer à Jules Lequier – n’épuise pas sa cause mais il participe déjà à la plus célèbre formule en laquelle on a souvent résumé sa philosophie : «Faire, non pas devenir mais faire et en faisant, se faire». Formule qui n’est qu’un autre résultat du même cheminement volontaire. Volontaire ? Dans le cas de l’adoption du nom nouveau, assurément oui. Dans celui du cheminement, la contingence la plus terrible a eu son mot à dire. Lequier est un philosophe de plus à verser au contingent de ceux dont la philosophie est inexplicable, voire incompréhensible si on ne connaît pas leur biographie.La vie du penseur et ses trois défaites
Le nom sous lequel nous connaissons Lequier est déjà un résultat de ce que désigne le titre de cet article : la liberté. Il s’est librement et tardivement renommé Lequier. Son nom pour l’état civil était Joseph Louis Jules Léquyer. Un tel résultat – passer de Jules Léquyer à Jules Lequier – n’épuise pas sa cause mais il participe déjà à la plus célèbre formule en laquelle on a souvent résumé sa philosophie : «Faire, non pas devenir mais faire et en faisant, se faire». Formule qui n’est qu’un autre résultat du même cheminement volontaire. Volontaire ? Dans le cas de l’adoption du nom nouveau, assurément oui. Dans celui du cheminement, la contingence la plus terrible a eu son mot à dire. Lequier est un philosophe de plus à verser au contingent de ceux dont la philosophie est inexplicable, voire incompréhensible si on ne connaît pas leur biographie.La vie du penseur et ses trois défaites Il faut donc d’emblée savoir que rien ne prédestinait en fin de compte ce jeune homme catholique breton renommé par lui-même «Jules Lequier» à la recherche philosophique d’une première vérité. Né à Quintin (Côtes du Nord) en 1814, polytechnicien de la même promotion que Charles Renouvier (le futur fondateur du «criticisme»), sous-lieutenant (décembre 1836), stagiaire pendant deux ans à l’École d’Application d’État-Major, il ne put obtenir d’y être versé. Ses années d’études et son avenir professionnel étaient sérieusement compromis. Il s’en plaignit en 1839 au Ministre de la Guerre, s’estimant victime d’une injustice. C’est à cette occasion qu’il fait appel à son cousin François Palasne de Champeaux qui était secrétaire de Lamartine. Le poète-politique influent écouta celui qui se nommait encore «Joseph Louis Jules Léquyer» et fut convaincu de plaider à son tour sa cause : en vain. Il se mit en demi-solde puis démissionna le 06 juin 1839 : première défaite. Deuxième défaite : il se présente aux élections en 1848 dans son département – une terre acquise à Lamartine et aux lamartiniens – mais ne sera pas élu. Et son état de santé psychique donne des inquiétudes à sa famille (tant qu’elle vit mais bien sûr, elle meurt…) et à ses amis. Renouvier fut ainsi le témoin de sa crise majeure. Troisième défaite : alors qu’il est déjà franchement pauvre et isolé, il tombe amoureux d’une demoiselle Deszille à qui il propose deux fois le mariage à quelques années d’intervalle, sans succès. Le 11 février 1862, il marche vers la mer de Saint Brieuc (Plérin-sur-Mer) et y nage en direction du large jusqu’à épuisement. Comme il était, paraît-il, bon nageur rompu à nager même l’hiver, on discute pour savoir si sa mort est accidentelle ou suicidaire et cette discussion est importante quand on la rapporte à sa pensée : nous y reviendrons. C’est Renouvier qui publia en 1865 les premières pages connues et essentielles de Lequier qui n’a rien publié de son vivant mais montrait parfois ses écrits à ceux qu’il en jugeait dignes.Le point commun entre deux penseursLa biographie de Lequier comporte un point commun frappant avec celle d’Auguste Comte : tous deux auront passé quelques temps dans un asile d’aliénés dont l’activité thérapeutique couvre aussi bien, à l’époque, les troubles psychiques que les troubles neurologiques ou mentaux. Comte en sortit, comme on sait, avec la mention «non guéri» signée par son médecin Esquirol tandis que la rapidité de rétablissement de Lequier surprit agréablement ses médecins qui le jugèrent probablement guéri. Dans les deux cas, ces crises psychiques furent concomitantes avec l’inspiration philosophique, si on étudie la chronologie de leurs écrits en relation avec leurs biographies respectives. Mais Comte fonde d’abord une philosophie positiviste puis une Religion de l’Humanité qui la coiffait organiquement ou la défigurait (selon les héritiers divers) tandis que Lequier trouve sa première vérité qu’il cherchait sans pour autant fonder le moindre système dessus. Ses écrits sont ensuite un travail de questionnement non moins constant. Quelle est-elle, au fait, cette première vérité ?La pensée et les pensées sur la pensée… puis retourTout le monde l’a remarqué explicitement ou implicitement (Renouvier, Delbos, Bréhier, Wahl, Grenier, et les commentateurs postérieurs à eux) la démarche de Lequier est métaphysiquement cartésienne : c’est une méditation cartésienne en apparence qui aboutit d’ailleurs positivement à l’un des fondements du cartésianisme. Résumée en son résultat immédiat et tangible, La recherche d’une première vérité semble simple : si je ne me contente pas des préjugés et que l’inquiétude philosophique la plus pure m’amène à rechercher une première vérité, c’est que je suis libre absolument d’effectuer cette recherche. En la cherchant – alors que je jugeais insuffisants toutes les réponses et tous les socles sur lesquels m’appuyer à mesure que ma recherche progressait – je l’ai donc finalement trouvée : c’est ma liberté.Bien. Effectivement, il suffisait de faire, et en faisant, on découvrait qu’on se faisait. Du même coup on découvrait qu’on n’était pas soumis à un devenir déterminé mais renvoyé à la contingence. Car l’angoisse première née de la célèbre Feuille de charmille est une angoisse absolue qui s’élève à une métaphysique de la contingence. Comme le sera celle de l’arbre noir à demi-mort dont coule la résine lumineuse dans un de ses ultimes textes les plus franchement hallucinés et qu’il faudrait comparer avec la future nausée sartrienne éprouvée devant la racine d’un arbre. Donc faire et, en faisant non pas devenir ou demeurer un élément passif du devenir et d’une interaction aberrante mais se faire. Immédiatement, naît un second problème inévitable car toujours déjà là.Autant de libertés interactives existent que d’êtres humains : comment envisager le monde et l’idée de Dieu compte tenu de cela ? Dieu lui-même se fait-il dans le temps par sa créature ? À mesure qu’on lit ces textes d’une étrange beauté, très inconfortable en dépit de la perfection de sa syntaxe qui se souvient de la rigueur d’un Maine de Biran et qui annonce la profondeur d’un Proust, on constate que Lequier, dès le départ de sa méditation qu’il a baptisée recherche et non pas méditation, nous a fait glisser dans une dimension étrange pour l’époque qui le rattache autant à saint Augustin qu’à F. W. Schelling, autant à Kierkegaard et Nietzsche (le fragment sur l’interaction infinie des actes au sein du cosmos dans Humain trop humain) qu’à Freud («là où ça était, je dois devenir») mais en fait, lui Jules Lequier, un parfait météore, non moins chu qu’Edgar A. Poe d’un désastre obscur.Certes, théoriquement, on peut dérouler la pelote du fil rouge qui relie Lequier à ses prédécesseurs : son angoisse est d’essence augustinienne. D’Augustin à Descartes puis Maine de Biran à Lequier, la conséquence est bonne : à partir de la liberté donnée enfin à la conscience comme fait inexplicable mais assuré, contingent mais certain, il s’agit de construire une anthropologie comme philosophie religieuse qui prenne en compte la situation de l’homme dans le monde, situation tragique par essence. Pourtant ce qui est remarquable en fin de compte, c’est que Lequier ait exprimé le premier d’une manière moderne l’angoisse métaphysique, la déréliction, la peur (au sens où Hobbes disait : «la grande passion de ma vie aura été la peur») qui présidaient déjà intimement aux intuitions géniales de ses prédécesseurs et l’ait fait à ce point précis de la chronologie philosophique française. Ces intuitions donnaient naissance ailleurs qu’en France à des pensées comme celles de Schopenhauer, de Nietzsche et de Kierkegaard qui pensent déjà l’angoisse elle-même comme facteur absolument positif, concret absolu. Le problème vital de Lequier est qu’il ne domine pas ce fil rouge : il l’appréhende, davantage que comme nœud gordien, comme une circularité oppressante qu’il faudrait théoriquement rompre et qu'il est pourtant absolument impossible de rompre. Il développe un aspect nouveau en France d’une intuition métaphysique aux facettes anciennes.Le déterminisme scientiste para-comtien et post-comtien, cette dégénérescence annoncée dès l’antiquité du positivisme, ne lui pose pas de problème particulier. Son compte est réglé depuis longtemps : il est réglé et bien réglé, à sa juste place, celle de la cuisine dont le XVIIIe siècle l’a fait émerger un moment. Oui il y a des lois, commodes et fonctionnant apparemment assez régulièrement pour que l’homme puisse dominer relativement la nature matérielle, biologique un peu moins, morale, sociale, économique et religieuse pas du tout. Mais elles n’expliquent rien. Auguste Comte lui-même, aussi ex-polytechnicien pauvre, radié lui aussi des cadres, répétiteur une année ou deux puis vivant de cours particuliers et enfin du fameux «subside positiviste» ne cesse de le répéter dans ses Cours de philosophie positive qui sont l’alpha et l’oméga de la France pensante de l’époque. Les positivistes comme Littré et Renan, les positivistes spiritualistes et les critiques de la science (Ravaisson, Boutroux, Lachelier, Poincaré, Le Roy, Duhem, Bergson, Meyerson) enfonceront le clou : l’idéalisme allemand kantien et post-kantien est connu et apprécié d’eux en raison, d’abord et surtout, de cet argument que le déterminisme de la science fonctionne mais qu’il ne sera jamais fondé. En matière de fondement, il faut trouver autre chose. Lequier le sait très bien. Il sait aussi, comme un Léon Chestov ou plus tard un Heidegger, qu’on a trouvé dans l’antiquité classique et au moyen-âge des fondements bien plus intéressants. Et il sait – d’une connaissance philosophique – comme eux qu’entre l’antiquité et le moyen-âge, il s’est produit un phénomène historique inédit après lequel rien ne saurait être comme avant et qu’il n’est pas sérieux de prétendre penser sans vouloir se risquer à le penser lui aussi. Surtout quand on a été élevé en Bretagne au début du XIXe siècle : il suffit de lire les Souvenirs d’enfance et de jeunesse de Renan pour en être convaincu !La recherche lequierienne de Dieu, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, n’est pourtant nullement assurée de trouver un terme défini métaphysiquement d’une manière satisfaisante: la créature posée libre, reste le problème du créateur et Lequier envisage, contemple, tourne autour des différents problèmes classiques de la théologie sans pouvoir trancher. D’où le ton authentiquement impressionnant de ses textes : une inquiétude individuelle exacerbée, une angoisse cosmique toute pascalienne face à l’aporie de la temporalité de la liberté qui pourrait aller jusqu’à introduire une temporalité dans Dieu lui-même en considérant le problème de la succession contingente des actions humaines sous le point de vue de l’éternité. Lequier esquisse régulièrement une admirable théologie dialectique qui retrouve certes saint Augustin et Pascal mais annonce non moins régulièrement l’existentialisme catholique moderne et sa vision tragique de la condition humaine. Il y a aussi chez lui des traces annexes de pragmatisme volontariste, de néo-criticisme, mais elles sont secondaires en valeur comme en importance théorique. Lequier regarde la ligne d’horizon du XXe siècle avec des yeux venus du passé le plus lointain et le plus originaire : il a d’ailleurs fallu attendre 1952 pour que les œuvres complètes de ce «Descartes tragique», révélées fragmentairement en 1865, soient éditées. Et leur édition confirme que le fragment (même étendu aux dimensions d’un livre) est bien la dimension naturelle, anti-systématique de sa pensée.La mort du penseur ou bien le suicide du penseur ?On mesure donc seulement après avoir lu ce qui précède l’importance de la signification de son geste final : un de ses proches pense qu’il ne se suicida nullement mais nagea en espérant un miracle (qui ne vint pas) et qu’il est donc mort accidentellement. D’autres la rabaissent au suicide athée. Cette ambivalence dialectique et existentielle de sa «mort-suicide» impossible à trancher qui demeure telle une contradiction possible, un acte manqué ou bien pleinement assumé, n’est-ce pas un saisissant résumé de ce qui fut, peut-être, l’unique pensée de Jules Lequier ?NB : on a jugé inutile de fournir une bibliographie, tant de Jules Lequier lui-même que des études partielles ou totales de sa vie et de sa pensée parues en France et à l’étranger, sur papier comme sur Internet : le lecteur en trouvera sans peine, ne serait-ce que par la grâce des moteurs de recherches. Qu’il se méfie simplement de la précision parfois vraie mais parfois absolument erronée de ce qu’il y verra du premier coup d’œil et veuille bien d’abord se référer aux meilleurs historiens de la philosophie, rompus aux méthodes de cette histoire et à sa rigueur. On en a cité supra qui n’épuisent pas la liste mais fournissent d’excellents points de départ. Ajoutons simplement que notre crainte (la crainte du vaillant varan Juan Asensio, qui fut ensuite seulement la mienne exprimée-reprise sur son beau site Internet, Stalker, deux craintes traçables dans son billet préfaçant ma critique cinématographique de Miracle en Alabama) que la mémoire de Lequier ne fût perdue s’avère heureusement et tout compte fait sans objet. À défaut d’être connue ou même reconnue largement du grand public, elle persiste encore récemment dans le cercle naturel qui est le sien, celui des travaux d’histoire de la philosophie.J'ajoute que plusieurs ouvrages de Jules Lequier sont en cours de numérisation par les éditions de
Il faut donc d’emblée savoir que rien ne prédestinait en fin de compte ce jeune homme catholique breton renommé par lui-même «Jules Lequier» à la recherche philosophique d’une première vérité. Né à Quintin (Côtes du Nord) en 1814, polytechnicien de la même promotion que Charles Renouvier (le futur fondateur du «criticisme»), sous-lieutenant (décembre 1836), stagiaire pendant deux ans à l’École d’Application d’État-Major, il ne put obtenir d’y être versé. Ses années d’études et son avenir professionnel étaient sérieusement compromis. Il s’en plaignit en 1839 au Ministre de la Guerre, s’estimant victime d’une injustice. C’est à cette occasion qu’il fait appel à son cousin François Palasne de Champeaux qui était secrétaire de Lamartine. Le poète-politique influent écouta celui qui se nommait encore «Joseph Louis Jules Léquyer» et fut convaincu de plaider à son tour sa cause : en vain. Il se mit en demi-solde puis démissionna le 06 juin 1839 : première défaite. Deuxième défaite : il se présente aux élections en 1848 dans son département – une terre acquise à Lamartine et aux lamartiniens – mais ne sera pas élu. Et son état de santé psychique donne des inquiétudes à sa famille (tant qu’elle vit mais bien sûr, elle meurt…) et à ses amis. Renouvier fut ainsi le témoin de sa crise majeure. Troisième défaite : alors qu’il est déjà franchement pauvre et isolé, il tombe amoureux d’une demoiselle Deszille à qui il propose deux fois le mariage à quelques années d’intervalle, sans succès. Le 11 février 1862, il marche vers la mer de Saint Brieuc (Plérin-sur-Mer) et y nage en direction du large jusqu’à épuisement. Comme il était, paraît-il, bon nageur rompu à nager même l’hiver, on discute pour savoir si sa mort est accidentelle ou suicidaire et cette discussion est importante quand on la rapporte à sa pensée : nous y reviendrons. C’est Renouvier qui publia en 1865 les premières pages connues et essentielles de Lequier qui n’a rien publié de son vivant mais montrait parfois ses écrits à ceux qu’il en jugeait dignes.Le point commun entre deux penseursLa biographie de Lequier comporte un point commun frappant avec celle d’Auguste Comte : tous deux auront passé quelques temps dans un asile d’aliénés dont l’activité thérapeutique couvre aussi bien, à l’époque, les troubles psychiques que les troubles neurologiques ou mentaux. Comte en sortit, comme on sait, avec la mention «non guéri» signée par son médecin Esquirol tandis que la rapidité de rétablissement de Lequier surprit agréablement ses médecins qui le jugèrent probablement guéri. Dans les deux cas, ces crises psychiques furent concomitantes avec l’inspiration philosophique, si on étudie la chronologie de leurs écrits en relation avec leurs biographies respectives. Mais Comte fonde d’abord une philosophie positiviste puis une Religion de l’Humanité qui la coiffait organiquement ou la défigurait (selon les héritiers divers) tandis que Lequier trouve sa première vérité qu’il cherchait sans pour autant fonder le moindre système dessus. Ses écrits sont ensuite un travail de questionnement non moins constant. Quelle est-elle, au fait, cette première vérité ?La pensée et les pensées sur la pensée… puis retourTout le monde l’a remarqué explicitement ou implicitement (Renouvier, Delbos, Bréhier, Wahl, Grenier, et les commentateurs postérieurs à eux) la démarche de Lequier est métaphysiquement cartésienne : c’est une méditation cartésienne en apparence qui aboutit d’ailleurs positivement à l’un des fondements du cartésianisme. Résumée en son résultat immédiat et tangible, La recherche d’une première vérité semble simple : si je ne me contente pas des préjugés et que l’inquiétude philosophique la plus pure m’amène à rechercher une première vérité, c’est que je suis libre absolument d’effectuer cette recherche. En la cherchant – alors que je jugeais insuffisants toutes les réponses et tous les socles sur lesquels m’appuyer à mesure que ma recherche progressait – je l’ai donc finalement trouvée : c’est ma liberté.Bien. Effectivement, il suffisait de faire, et en faisant, on découvrait qu’on se faisait. Du même coup on découvrait qu’on n’était pas soumis à un devenir déterminé mais renvoyé à la contingence. Car l’angoisse première née de la célèbre Feuille de charmille est une angoisse absolue qui s’élève à une métaphysique de la contingence. Comme le sera celle de l’arbre noir à demi-mort dont coule la résine lumineuse dans un de ses ultimes textes les plus franchement hallucinés et qu’il faudrait comparer avec la future nausée sartrienne éprouvée devant la racine d’un arbre. Donc faire et, en faisant non pas devenir ou demeurer un élément passif du devenir et d’une interaction aberrante mais se faire. Immédiatement, naît un second problème inévitable car toujours déjà là.Autant de libertés interactives existent que d’êtres humains : comment envisager le monde et l’idée de Dieu compte tenu de cela ? Dieu lui-même se fait-il dans le temps par sa créature ? À mesure qu’on lit ces textes d’une étrange beauté, très inconfortable en dépit de la perfection de sa syntaxe qui se souvient de la rigueur d’un Maine de Biran et qui annonce la profondeur d’un Proust, on constate que Lequier, dès le départ de sa méditation qu’il a baptisée recherche et non pas méditation, nous a fait glisser dans une dimension étrange pour l’époque qui le rattache autant à saint Augustin qu’à F. W. Schelling, autant à Kierkegaard et Nietzsche (le fragment sur l’interaction infinie des actes au sein du cosmos dans Humain trop humain) qu’à Freud («là où ça était, je dois devenir») mais en fait, lui Jules Lequier, un parfait météore, non moins chu qu’Edgar A. Poe d’un désastre obscur.Certes, théoriquement, on peut dérouler la pelote du fil rouge qui relie Lequier à ses prédécesseurs : son angoisse est d’essence augustinienne. D’Augustin à Descartes puis Maine de Biran à Lequier, la conséquence est bonne : à partir de la liberté donnée enfin à la conscience comme fait inexplicable mais assuré, contingent mais certain, il s’agit de construire une anthropologie comme philosophie religieuse qui prenne en compte la situation de l’homme dans le monde, situation tragique par essence. Pourtant ce qui est remarquable en fin de compte, c’est que Lequier ait exprimé le premier d’une manière moderne l’angoisse métaphysique, la déréliction, la peur (au sens où Hobbes disait : «la grande passion de ma vie aura été la peur») qui présidaient déjà intimement aux intuitions géniales de ses prédécesseurs et l’ait fait à ce point précis de la chronologie philosophique française. Ces intuitions donnaient naissance ailleurs qu’en France à des pensées comme celles de Schopenhauer, de Nietzsche et de Kierkegaard qui pensent déjà l’angoisse elle-même comme facteur absolument positif, concret absolu. Le problème vital de Lequier est qu’il ne domine pas ce fil rouge : il l’appréhende, davantage que comme nœud gordien, comme une circularité oppressante qu’il faudrait théoriquement rompre et qu'il est pourtant absolument impossible de rompre. Il développe un aspect nouveau en France d’une intuition métaphysique aux facettes anciennes.Le déterminisme scientiste para-comtien et post-comtien, cette dégénérescence annoncée dès l’antiquité du positivisme, ne lui pose pas de problème particulier. Son compte est réglé depuis longtemps : il est réglé et bien réglé, à sa juste place, celle de la cuisine dont le XVIIIe siècle l’a fait émerger un moment. Oui il y a des lois, commodes et fonctionnant apparemment assez régulièrement pour que l’homme puisse dominer relativement la nature matérielle, biologique un peu moins, morale, sociale, économique et religieuse pas du tout. Mais elles n’expliquent rien. Auguste Comte lui-même, aussi ex-polytechnicien pauvre, radié lui aussi des cadres, répétiteur une année ou deux puis vivant de cours particuliers et enfin du fameux «subside positiviste» ne cesse de le répéter dans ses Cours de philosophie positive qui sont l’alpha et l’oméga de la France pensante de l’époque. Les positivistes comme Littré et Renan, les positivistes spiritualistes et les critiques de la science (Ravaisson, Boutroux, Lachelier, Poincaré, Le Roy, Duhem, Bergson, Meyerson) enfonceront le clou : l’idéalisme allemand kantien et post-kantien est connu et apprécié d’eux en raison, d’abord et surtout, de cet argument que le déterminisme de la science fonctionne mais qu’il ne sera jamais fondé. En matière de fondement, il faut trouver autre chose. Lequier le sait très bien. Il sait aussi, comme un Léon Chestov ou plus tard un Heidegger, qu’on a trouvé dans l’antiquité classique et au moyen-âge des fondements bien plus intéressants. Et il sait – d’une connaissance philosophique – comme eux qu’entre l’antiquité et le moyen-âge, il s’est produit un phénomène historique inédit après lequel rien ne saurait être comme avant et qu’il n’est pas sérieux de prétendre penser sans vouloir se risquer à le penser lui aussi. Surtout quand on a été élevé en Bretagne au début du XIXe siècle : il suffit de lire les Souvenirs d’enfance et de jeunesse de Renan pour en être convaincu !La recherche lequierienne de Dieu, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, n’est pourtant nullement assurée de trouver un terme défini métaphysiquement d’une manière satisfaisante: la créature posée libre, reste le problème du créateur et Lequier envisage, contemple, tourne autour des différents problèmes classiques de la théologie sans pouvoir trancher. D’où le ton authentiquement impressionnant de ses textes : une inquiétude individuelle exacerbée, une angoisse cosmique toute pascalienne face à l’aporie de la temporalité de la liberté qui pourrait aller jusqu’à introduire une temporalité dans Dieu lui-même en considérant le problème de la succession contingente des actions humaines sous le point de vue de l’éternité. Lequier esquisse régulièrement une admirable théologie dialectique qui retrouve certes saint Augustin et Pascal mais annonce non moins régulièrement l’existentialisme catholique moderne et sa vision tragique de la condition humaine. Il y a aussi chez lui des traces annexes de pragmatisme volontariste, de néo-criticisme, mais elles sont secondaires en valeur comme en importance théorique. Lequier regarde la ligne d’horizon du XXe siècle avec des yeux venus du passé le plus lointain et le plus originaire : il a d’ailleurs fallu attendre 1952 pour que les œuvres complètes de ce «Descartes tragique», révélées fragmentairement en 1865, soient éditées. Et leur édition confirme que le fragment (même étendu aux dimensions d’un livre) est bien la dimension naturelle, anti-systématique de sa pensée.La mort du penseur ou bien le suicide du penseur ?On mesure donc seulement après avoir lu ce qui précède l’importance de la signification de son geste final : un de ses proches pense qu’il ne se suicida nullement mais nagea en espérant un miracle (qui ne vint pas) et qu’il est donc mort accidentellement. D’autres la rabaissent au suicide athée. Cette ambivalence dialectique et existentielle de sa «mort-suicide» impossible à trancher qui demeure telle une contradiction possible, un acte manqué ou bien pleinement assumé, n’est-ce pas un saisissant résumé de ce qui fut, peut-être, l’unique pensée de Jules Lequier ?NB : on a jugé inutile de fournir une bibliographie, tant de Jules Lequier lui-même que des études partielles ou totales de sa vie et de sa pensée parues en France et à l’étranger, sur papier comme sur Internet : le lecteur en trouvera sans peine, ne serait-ce que par la grâce des moteurs de recherches. Qu’il se méfie simplement de la précision parfois vraie mais parfois absolument erronée de ce qu’il y verra du premier coup d’œil et veuille bien d’abord se référer aux meilleurs historiens de la philosophie, rompus aux méthodes de cette histoire et à sa rigueur. On en a cité supra qui n’épuisent pas la liste mais fournissent d’excellents points de départ. Ajoutons simplement que notre crainte (la crainte du vaillant varan Juan Asensio, qui fut ensuite seulement la mienne exprimée-reprise sur son beau site Internet, Stalker, deux craintes traçables dans son billet préfaçant ma critique cinématographique de Miracle en Alabama) que la mémoire de Lequier ne fût perdue s’avère heureusement et tout compte fait sans objet. À défaut d’être connue ou même reconnue largement du grand public, elle persiste encore récemment dans le cercle naturel qui est le sien, celui des travaux d’histoire de la philosophie.J'ajoute que plusieurs ouvrages de Jules Lequier sont en cours de numérisation par les éditions de
07/02/2010 | Lien permanent
Le Maljournalisme auto-amplificateur : Le grand bazar de l'info d'Yves Agnès, par Jean-Pierre Tailleur

«Aller au devant de ce qui peut nourrir le débat. Essais, documents, romans, récits, la ligne éditoriale est tracée avec exigence. Pointer, quel que soit le genre, l’endroit où ça fait mal. Se battre contre le silence qui est la pire des plaies et avoir une démarche militante du point de vue des idées. Avec le parti pris de ne pas en avoir.» Yves Michalon.
 Les éditions Michalon ont publié dans les dernières semaines de 2005 une énième critique du journalisme français, intitulée Le grand bazar de l'info. Cet essai n’est qu’un entremêlement de propos convenus, parfois sensés mais amplement ressassés, sur les défauts les moins gênants et les plus avouables de la presse française. Les travers vraiment préoccupants et révélateurs de ses mauvaises pratiques sont occultés pour l’essentiel. L’auteur, Yves Agnès, est un ancien rédacteur en chef du Monde et a dirigé une des deux écoles de journalisme françaises les plus reconnues. Malgré (ou bien à cause) de ces deux titres dignes d’une Légion d’honneur de sa corporation, l’essai publié par Yves Michalon ne présente aucun intérêt. Le style fluide, saupoudré de pointes de grandiloquence, et les retours sur l’Histoire de la presse de ce si bien nommé Grand bazar, cachent mal sa vacuité. Mais il est utile d’analyser et de réfléchir sur son contenu car il illustre parfaitement ce que je qualifie de «maljournalisme» dans mes critiques sur les médias.
Les éditions Michalon ont publié dans les dernières semaines de 2005 une énième critique du journalisme français, intitulée Le grand bazar de l'info. Cet essai n’est qu’un entremêlement de propos convenus, parfois sensés mais amplement ressassés, sur les défauts les moins gênants et les plus avouables de la presse française. Les travers vraiment préoccupants et révélateurs de ses mauvaises pratiques sont occultés pour l’essentiel. L’auteur, Yves Agnès, est un ancien rédacteur en chef du Monde et a dirigé une des deux écoles de journalisme françaises les plus reconnues. Malgré (ou bien à cause) de ces deux titres dignes d’une Légion d’honneur de sa corporation, l’essai publié par Yves Michalon ne présente aucun intérêt. Le style fluide, saupoudré de pointes de grandiloquence, et les retours sur l’Histoire de la presse de ce si bien nommé Grand bazar, cachent mal sa vacuité. Mais il est utile d’analyser et de réfléchir sur son contenu car il illustre parfaitement ce que je qualifie de «maljournalisme» dans mes critiques sur les médias.Le livre d’Yves Agnès a ironiquement – et accessoirement – la particularité d’être sous-titré Pour en finir avec le maljournalisme. L’ancien directeur général du Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes (CFPJ) reprend ainsi un terme que j’ai lancé en 2002 dans Bévues de presse ou à travers mon site, sans jamais faire référence à l’un ou à l’autre. Le Stalker a contribué à populariser ce néologisme en en faisant un titre d’une rubrique qui réunit certains de mes textes (extraits de mon deuxième livre, Maljournalisme à la française). Ces critiques et ces constats sur la presse française sont en quelque sorte les pendants journalistiques des flèches de Juan Asensio contre la mal-littérature.
Le chien de garde du Stalker m’a proposé de réitérer l’expérience avec une critique du Grand bazar de l'info. Voici donc.
Une précision pour commencer : Yves Agnès a tout à fait le droit d’employer le mot maljournalisme, si évident avec la popularisation du terme malbouffe. Je reviendrai plus loin sur ce qui est toutefois un manque d’élégance et un aveuglement de sa part, à mettre dans la série des mésaventures parfois cocasses vécues avec Bévues de presse. Il faut d’abord se pencher sur le contenu de son essai, inquiétant car il illustre page après page l’incapacité de la presse française à se remettre en question sans faux-fuyants. Cette mauvaise habitude intellectuelle a des conséquences graves sur le plan socio-politique, à moins que l’on dénie toute contribution utile au «quatrième pouvoir».
Le grand bazar de l’info est le symptôme amplificateur des maux qu’il prétend dénoncer, en effet. En ouvrant cet essai, on a l’impression de lire une liste de sujets déjà traités ces dernières années dans Arrêt sur images, l’hebdomadaire autocritique de la télévision. Ce livre m’en a rappelé un autre, d’ailleurs, apparemment plus futile, L'Audimat à mort (2004). Son auteur Hélène Risser, une ex-collaboratrice de l’émission de France 5, concentre ses tirs sur la télé-réalité et l’info-spectacle avec une argumentation plus consistante. Elle ne se contente pas de lamentations sur des fautes déjà médiatisées par Daniel Schneidermann dans son rendez-vous dominical, son récit apportant des compléments d’information instructifs. Pour prendre un des exemples les plus éloquents, la «pipolisation» progressive de l’émission Envoyé spécial, sur France 2, est abordée en quelques lignes dans Le grand bazar. Inversement, L'Audimat à mort consacre huit pages au magazine-alibi de la chaîne publique, avec des faits qui vont au-delà de ce qu’Arrêt sur images a pu dénoncer au fil des ans. Le témoignage d’Hélène Risser est un hommage à l’écrit, tandis que ce que raconte l’ancien rédacteur en chef du Monde n’apporte rien de plus que des commentaires rapides et dérisoires entendus à la radio ou à la télévision.
Faute d’enquête en profondeur, avec un festival de platitudes en guise de diagnostic sur la mal-information en France, Yves Agnès a fait du maljournalisme tout en croyant le combattre. Les défauts de son livre ne se limitent pas aux fautes d’orthographes sur les patronymes de deux Michel, par exemple (le docteur Garretta et le philosophe Benasayag). Celui qui a pourtant publié un Manuel de journalisme manque surtout de rigueur avec une série de mensonges par omission. Des oublis qui alimentent les contrevérités entretenues depuis des années par la «médiologie» française. Illustration avec une phrase tirée du premier chapitre: «On a encore en mémoire le cas de Janet Cooke, du Washington Post, un temps lauréate en 1991 du prix Pulitzer pour un reportage entièrement fabriqué».
Ce bref rappel historique au sujet d’une faute qui secoua la presse américaine est ahurissant et significatif à de multiples titres. D’une part, Yves Agnès se trompe d’une décennie (1981 et non pas 1991). Ensuite, le reportage de Janet Cooke n’était pas «entièrement» inventé, et puis le Pulitzer lui a pratiquement été retiré sur le champ. Le Washington Post s’est même amplement expliqué sur cette faute au bout de quelques jours. Enfin et surtout, l’auteur du Grand bazar se garde de citer des bévues liées au franco-français prix Albert Londres.
Le directeur du Monde diplomatique Ignacio Ramonet, qui semble être une des références intellectuelles de l’ancien professeur de journalisme, tient les mêmes propos malhonnêtes dans son essai La Tyrannie de la communication. Malhonnêtes parce que cet exemple états-unien, ressassé depuis plus de deux décennies, permet d’occulter un point bien plus préoccupant pour la démocratie en France. Une question au cœur de la notion de maljournalisme selon la définition que j’ai donné à ce terme : l’incapacité de la presse française d’enquêter et de s’expliquer sur certaines fautes majeures qui lui sont totalement imputables.
L’ancien chargé de rubrique «Communication» du Monde reprend aussi, logiquement, le discours altermondialiste qui voit dans le néo-libéralisme le principal virus qui infecterait les journalistes français. Cette posture est souvent légitime mais d’autres essayistes l’ont développée déjà, avec plus de pertinence et d’arguments précis (Serge Halimi pour ne citer que lui). En outre, cette cause n’explique que partiellement – et toujours unilatéralement – les raisons de la mal-information en France. Je l’ai amplement démontré dans Bévues de presse en comparant certains journaux de l’Hexagone avec ceux d’autres pays aussi «sous-pression-néo-libérale», à l’avantage de ces derniers. J’ai également eu l’occasion de faire ce type de constat avec des étudiants en journalisme, en mettant en parallèle les nouvelles formules du Figaro et du Guardian ainsi que des enquêtes primées en France et aux Etats-Unis.
L’ancien patron du CFPJ ne révèle ou ne développe aucun cas de maljournalisme, il en ignore d’autres ou bien parfois, plus subtilement, il en minimise certains. On comprend mal pourquoi, par exemple, alors qu’il évoque les fautes de son ancien journal lors des affaires du sang contaminé ou Alègre-Baudis, il ne cite pas les noms des rédacteurs pris en flagrant délit professionnel. Dans le sixième chapitre intitulé «Malaise» (sic), Yves Agnès prend même la défense d’Alain Ménargues, l’ex-patron de la rédaction de Radio France Internationale, évincé fin 2004 pour avoir tenu des propos nauséabonds. «On lui reproche d’avoir qualifié Israël d’"État raciste"» explique simplement l’auteur du Manuel de journalisme. Or on a reproché à Alain Ménargues son discours antisémite lorsque par exemple il a déclaré, dans une radio d’extrême droite, que les juifs avaient créé eux-mêmes leur premier ghetto à Venise. Dans une conférence en mars 2005 à Montpellier, il a même souligné des «similitudes entre le nazisme et l'extrémisme sioniste», en ajoutant : «Entre 1933 et 1938, des SS ont visité la Palestine.»
Comme beaucoup d’observateurs des médias français, souvent insensibles à des travers inadmissibles, Yves Agnès souffre d’une infirmité intellectuelle qui ne le rend pas seulement sourd aux commentaires judéophopes d’un ex-ponte de RFI. Cette maladie corporatiste fait aussi de lui un aveugle face aux constats exposés dans Bévues de presse, les ignorant au lieu de les critiquer ou de les accepter. C’est le cas, notamment, quand il cite pour modèle – à plusieurs reprises – le quotidien Ouest France. Quelles que soient les qualités de ce journal, on ne peut pas dire qu’il soit un battant du journalisme d’investigation, à commencer dans ses zones de chalandise. Comme la plupart de ses confrères régionaux, il est même plutôt un symbole de la sous-information dont souffre la société française. Ce déficit médiatique qui conduit à l’incompréhension entre les élites parisiennes et «les gens». Cette incommunication française dont on se lamente quand les banlieues «se révoltent» ou lorsque le Front national connaît des succès électoraux...
Comme je l'ai déjà indiqué, Le grand bazar de l’info contient également des passages sur lesquels il est difficile d’être en désaccord. Son auteur regrette la précarité, l’excès de paresse ou le manque d’ambition de beaucoup de journalistes, en précisant «ces vingt dernières années». On ne comprend pas bien pourquoi la mal-information se serait particulièrement développée depuis 1986, au moment de la privatisation de TF1, mais bon... Il défend aussi l’idée de la création d’instances d’autorégulation de la profession des journalistes, non sans raison. Toutefois, le refus ou l’incapacité d’Yves Agnès de reconnaître des cas de maljournalisme majeurs – et l’idée que ces organismes seraient contrôlés par des critiques opérant comme lui – donne froid dans le dos. J’écris ces lignes au moment même où nos bonnes âmes occidentales s’indignent que la société Google ait accepté de retirer de son moteur de recherche des références à des sites qui agacent les autorités chinoises. C’est pourtant exactement ce que fait le Grand bazar, en dévalorisant, en retirant du sens au concept de maljournalisme.
Je reviens et termine sur le fait qu’entre les lignes, Yves Agnès se présente comme l'inventeur d’un néologisme que j’ai déjà amplement utilisé (pour vérifier, il suffit de taper le mot dans… Google justement). Les éditions Michalon et leur auteur ont feint d'ignorer cette antériorité alors que ce dernier, croisé lors d’une conférence sur les médias en 2002, avait entendu parler de mes travaux. Mais je regrette surtout l’appauvrissement de ce concept dans leur livre, véritable bond en arrière faute d’ignorer les constats déjà désignés du label «maljournalisme». Un journaliste et un éditeur cramponnés au Minitel à l’époque d’Internet à haut débit n’auraient pas fait mieux.
Dans mes travaux, ce nouveau terme concerne d’abord le manque d’enquêtes sérieuses dans des journaux dont il faut remettre en cause la notoriété. Cette approche induit, par voie de conséquence, un retour sur toutes les idées reçues concernant la presse française, et en particulier sur ses animaux sacrés. La réputation usurpée du Canard enchaîné par exemple, et la légèreté de nombreuses enquêtes publiées dans des hebdomadaires de droite comme de gauche (Marianne et Valeurs actuelles notamment). Ce type de remise à plat est plus riche, plus constructif, que des pleurs (et des leurres) sur la marchandisation de l’information.
De même que le terme «mal-litterature» pointe du doigt les prises pour modèles de mauvais écrivains comme les dénonce Juan Asensio, le maljournalisme doit désigner les prescriptions malhonnêtes de travaux journalistiques médiocres. A l’aide de comparaisons internationales, ce concept permet de souligner le relatif manque de débat sur la qualité des contenus des journaux, dû à la pauvreté du journalisme sur le journalisme en France. De même que la malbouffe concerne les concepteurs et les producteurs de nourriture et pas seulement les intermédiaires que sont les restaurateurs, le maljournalisme ne peut pas se limiter aux fautes de certaines rédactions. Il concerne d’abord l’indifférence ou la malhonnêteté intellectuelle de «médiologues» qui ignorent des pratiques journalistiques déplorables.
Le titre, Le grand bazar de l’info décrit bien le contenu d’un livre qui, contrairement à ce qu’indique son sous-titre, ne peut que contribuer à consolider le maljournalisme en France. A moins que ses lecteurs ne le parcourent au second degré, comme un contre-modèle de regard à avoir sur le métier d’informer. Souhaitons-le, en les invitant à réfléchir également aux prétentions affichées par Yves Michalon en page vitrine de son site : «Pointer, quel que soit le genre, l’endroit où ça fait mal. Se battre contre le silence qui est la pire des plaies». Un beau credo.
En publiant un essai sur la base du pedigree de son auteur bien plus que sur sa valeur intrinsèque, cet éditeur a indirectement abordé une autre question douloureuse, la «mal-édition» en France… Un thème sur lequel il conviendrait également de s’attarder.
01/02/2006 | Lien permanent
Entretien avec le Club Roger Nimier

 Entretiens et dialogues.
Entretiens et dialogues.Ces propos ont été recueillis par Romain Bouvier, Président du Club Roger Nimier. Les seules modifications que j'ai apportées à ce long texte ne concernent que des points mineurs et quelques corrections purement grammaticales. Depuis que j'ai répondu à ces questions, Maurice G. Dantec est mort.
 Juan Asensio, pouvez-vous, s’il vous plaît, vous présenter à nos lecteurs en quelques mots ?
Juan Asensio, pouvez-vous, s’il vous plaît, vous présenter à nos lecteurs en quelques mots ?Je suis né en 1971 à Lyon, où j’ai passé les 30 premières années de ma vie. J’y ai suivi une formation, très classique, de lettres modernes et de philosophie, d’abord à l’externat Sainte-Marie jusqu’en classe de khâgne que j’ai cubée, ensuite à l’université Jean Moulin Lyon 3, y poursuivant mes études jusqu’en thèse que j’ai abandonnée très vite. Mon directeur de l’époque, Monique Gosselin-Noat, ponte des études bernanosiennes ayant participé à la nouvelle édition des romans de Bernanos dans la collection de la Pléiade, m’avait en effet donné à traiter un sujet dont je ne voulais absolument pas (la figuration du diable dans les romans de Julien Green, François Mauriac et Georges Bernanos) et qui… avait déjà fait l’objet d’une thèse vieille d’à peine deux ou trois ans au moment où j’entamais mes propres recherches ! C’était, au mot près, le sujet qu’elle m’avait d’office demandé de traiter qui avait été disséqué en quelque deux énormes volumes. J’ai piqué une sacrée colère contre tant d’incompétence crasse, et ai écrit puis téléphoné à notre mandarine. Lorsque je lui ai fait part de ma découverte, elle m’a tout stupidement répondu que je n’avais qu’à prendre le contrepied exact de ladite thèse ! J’ai donc gardé, comme vous vous en doutez, une très piètre opinion des universitaires, censément des universitaires bernanosiens qui d’ailleurs me le rendent bien, puisqu’ils ne citent pas mes travaux dans cette nouvelle édition des romans de Bernanos, mais, en revanche, citent amplement leurs propres productions. Je constate depuis plusieurs années que le moindre universitaire auteur d’une thèse poussive se voit désormais ouvrir largement les portes de l’édition dite savante, alors même que plus aucun écrivain contemporain ou presque ne serait capable, et ne parlons pas de dignité, d’évoquer l’œuvre d’un de ceux dont il a hérité. Qui voudrait d’une préface de Yannick Haenel sur Melville, ou d’un texte de Mathias Enard sur Balzac ? Pas moi !
En tout cas, rien de nouveau sous le soleil : la petitesse se venge toujours petitement… J’ai aussi passé une année, fort oubliable, au Celsa, afin de voir de l’intérieur si je puis dire à quoi ressemblait l’enseignement délivré en matière de journalisme et, ma foi, je n’ai pas été déçu quant à la médiocrité abyssale, forcément partisane (de gauche bien sûr) de cet enseignement. J’ai créé en mars 2004 Stalker, alors que je travaillais dans une salle des marchés et que Maurice G. Dantec se faisait traîner dans la boue par les journaux à prétentions humanistes habituels. Il s’agissait de trouver une façon de répondre aux invectives à moraline lui reprochant d’avoir osé échanger quelques messages avec le Bloc identitaire d’une poignée de journalistes aussi prestigieux qu’un certain Philippe Nassif (de Technikart je crois), et un de mes collègues de bureau, informaticien, me suggéra ainsi de créer un blog. Très vite, Stalker a fait des émules dans ce qui ne s’appelait pas encore la blogosphère, mais aucun de ces blogs nés en deux minutes n’a survécu plus de quelques mois, voire années pour les meilleurs. Depuis cette époque presque préhistorique à l’échelle de la Toile, mon blog est devenu riche de quelque 1 500 notes, pas toutes écrites par moi d’ailleurs, et est très lu, puisqu’il engrange entre 30 et 40 000 visiteurs uniques par mois, pour 100 à 200 000 pages vues par mois. J’ai donné la possibilité à mes lecteurs de me verser des dons via Paypal, ce qui me permet d’acheter la plupart des ouvrages que j’évoque sur mon blog, même si j’en reçois quelques-uns en service de presse, à condition que je les demande toutefois. Il s’apparente désormais à un véritable labyrinthe et c’est ainsi très vite que je l’ai surnommé la Zone, référence évidente à l’un des chefs-d’œuvre de Tarkovski. J’ai aussi réussi à publier quelques ouvrages de critique littéraire et un bouquin étrange sur Judas Iscariote, en 2010, aux éditions du Cerf. J’emploie à dessein le terme «réussi», car désormais tout le monde se fiche de la critique littéraire, à commencer par les éditeurs, puis par les journalistes, les libraires et, en bout de chaîne, le public. Il m’arrive de collaborer à quelques revues, dont Études, alors que j’ai publié des articles dans La Revue des Deux Mondes ou bien encore L’Atelier du roman. Je ne supporte plus toutefois le principe, très lourd et donc si peu rapide et agile, de ces revues, qui ne vous paient que fort rarement, et des sommes ridicules par-dessus le marché, alors qu’il faut bien souvent essuyer un refus par quelque couillon illettré appartenant, Sésame, ouvre-toi !, au sacro-saint comité de lecture.
À la création de votre blog, Stalker, vous avez donc pris la défense de Maurice G. Dantec. Serait-il un des rares auteurs contemporains qui puisse trouver grâce à vos yeux de critique acerbe ?
J’ai pris sa défense, oui, car les imbéciles qui l’attaquaient, et qui n’avaient probablement pas lu une seule ligne d’un seul de ses romans, avaient et ont toujours pour habitude de chasser en meute, comme tous les lâches. J’ai beaucoup lu Dantec, quoique tardivement, n’y étant venu qu’avec réticence car, alors (nous étions en 2003), il était un auteur polémique qui faisait beaucoup parler de lui. C’est après avoir fait paraître dans La Revue des Deux Mondes un long article sur Villa Vortex, un roman monstrueux ridiculisé en deux lignes stupides (dans la rubrique Sifflets, je crois, du Nouvel Observateur) par Jean-Louis Ezine qui n’avait à l’évidence pas lu ce livre, que Dantec et moi avons commencé à échanger. L’avait en effet frappé, dans l’article en question pour lequel il me félicita très chaleureusement, le fait que j’y annonçais sa conversion au catholicisme, qui avait eu lieu, sans que je le sache bien sûr, quelques mois après la parution de ce texte. J’ai continué à lire Dantec, mais mon intérêt pour ses textes (les excès divers et variés du personnage m’ayant toujours laissé de marbre) a décru assez vite. Je l’ai même défendu contre la poignée de crétins mononeuronaux qui, alors, l’entouraient, et derrière le ridicule rempart de laquelle il vitupérait, assez grossièrement, contre le monde tel qu’il ne va pas. Maurice G. Dantec n’est pas un styliste de la langue française, c’est le moins que l’on puisse dire, mais il y avait toujours, même dans le plus mauvais de ses romans, des traits de fulgurance, des intuitions métaphysiques mélangées à des facilités indignes d’une rédaction d’écolier de 13 ans. M’avait alors surtout frappé son aptitude, dans les deux premiers tomes de son Journal, à évoquer des auteurs (Dominique De Roux, Ernest Hello, Léon Bloy, etc.) dont plus personne ou presque n’osait parler, et cela m’enthousiasma. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts comme on dit, et je n’ai plus de nouvelles, ni d’ailleurs ne cherche à en prendre, pour être tout à fait honnête, de Dantec, qui est du reste à ce que j’en sais assez mal en point, même si sa santé a toujours été vacillante. La dernière fois que je l’ai vu, à Paris, il était méconnaissable ; il m’a serré la main en pleurant dans mes bras, peut-être parce qu’il avait fini par comprendre que je l’avais défendu contre vents et marées, y compris contre son propre comportement destructeur et totalement paranoïaque. C’est du passé. Je ne suis même pas parvenu à lire plus de quelques pages de son dernier roman, Les Résidents, resté totalement inaperçu, alors que la moindre de ses déclarations, bien souvent infantiles, déclenchait des spasmes le plus souvent ridicules sur beaucoup de sites, de forums et sur les blogs au début des années 2000. En tout cas, nul ne pourra jamais me reprocher de ne pas avoir pris Maurice G. Dantec, en tant qu’écrivain, au sérieux.
Je réponds à la seconde de vos questions : beaucoup d’auteurs vivants trouvent grâce à mes yeux, qu’ils soient Français (Marien Defalvard, Pierre Mari, Christian Guillet, Guy Dupré, Jean Védrines, Serge Rivron) ou bien étrangers et là, force est de constater que la liste est tout de même plus conséquente : Roberto Calasso, Claudio Magris, Jaume Cabré ou Javier Cercas même si m’enquiquine leur côté «habiles techniciens du roman», Cormac McCarthy dont la lecture a été un choc, le très singulier László Krasznahorkai ou, disparu il y a quelques années, le génial Roberto Bolaño.
En tant que critique littéraire (et lyonnais d’origine de surcroît), que pensez-vous de cette formule que l’on prête à François Mitterrand à propos de l’œuvre romanesque de Rebatet : «Il y a deux sortes d’hommes : ceux qui ont lu Les Deux Étendards, et les autres » ?
Absolument tous les reproches, et les plus durs, peuvent être faits à François Mitterrand, mais enfin, c’était un assez bon lettré, aimant comme vous le savez passionnément l’œuvre d’Ernst Jünger, qu’il connaissait personnellement. Je me souviens d’avoir lu qu’il reprocha un jour à un certain Alain Juppé qui joue aujourd’hui les revenants arrogants, de ne pas connaître Paul Gadenne. S’il n’y avait qu’Alain Juppé qui ignorât l’auteur de La plage de Scheveningen, l’un des plus beaux et grands romans du siècle passé ! Qui connaît encore, hélas, le profond et tourmenté Paul Gadenne ? Certainement pas le crétin hollandais, dont on se demande même s’il a jamais entendu parler d’un mot aussi bizarre et incongru que celui de «littérature» ! Quoi qu’il en soit, j’ai lu Rebatet jeune, trop jeune peut-être et, comme tant d’autres auteurs, il me faut à présent le relire, alors qu’il semble jouir d’une certaine actualité, du moins éditoriale, qui ne s’est pas encore vraiment étendue à des auteurs comme Brasillach (évoqué par Gadenne, qui fut son condisciple en khâgne, dans le roman que j’ai indiqué, sous les traits d’un personnage du nom d’Hersent), Brasillach dont il faut lire Notre avant-guerre, ou bien le pestiféré Abel Bonnard, dont Les Modérés sont une radiographie de la France politique encore pertinente. Je me souviens en tout cas d’avoir estimé, du haut de mes 14 ou 15 ans, que Les Deux Étendards, roman au titre génial, disséquait la France de l’entre-deux guerres avec une profondeur spirituelle absente des romans de Céline, et ce seul souvenir me donne envie de relire ce roman qui avait la réputation, il n’y a pas si longtemps que cela, d’être maudit. Par ailleurs, j’allais, quelques années plus tard, retrouver le nom de Rebatet sous la plume de George Steiner, qui n’a jamais cessé de clamer son admiration pour ce roman, tout en traitant son auteur de salopard. J’ai d’ailleurs commencé ma relecture des Décombres qui vient d’être réédité, après avoir aussi relu le Rebatet de Pol Vandromme et en faisant un crochet par Les Réprouvés d’Ernst von Salomon, décrivant la nécessité d’une refondation de l’Allemagne humiliée par les sanctions des alliés et rongée par la gangrène communiste que les corps francs tentent de contenir, voire d’éradiquer. Il n’est donc pas étonnant que Lucien Rebatet, de même que d’autres qui ont décrit la complexité d’une époque où la France cherchait une forme de renaissance politique tout autant que sociale, voire spirituelle, intéresse et même fascine de nouveau, y compris les jeunes si on leur apprend encore à lire, maintenant que notre pays traverse une crise qui sera mortelle si aucun sursaut, de réelle profondeur et pas cosmétique, ne le sauve. Et puis, à tout prendre, je préfère un jeune gars un peu borné nourri au petit lait de Charles Maurras, mais qui aura au moins lu, et avec passion, Bloy, Bernanos, Jünger, von Salomon, Rebatet, Brasillach, Hansum ou Pasolini et quelques autres encore sur lesquels planent de vilains soupçons, plutôt qu’un crétin ripoliné fraîchement hypokhâgneux qui n’aura sucé que les mamelles desséchées de Gérard Genette et de Roland Barthes, l’esprit tout farci des fadaises naturalistes sans style de Maupassant et de Zola, et qui finira sous-pigiste s’il sait avaler sa bouche et fermer paradoxalement sa gueule à Télérama ou aux Inrockuptibles, à saluer le gras loukoum à orientalisme germanopratin goncourisé d’un Mathias Enard. La passion, l’excès, le courage, plutôt que ces sépulcres déjà blanchis rêvant carrière et petite épouse sage rencontrée à l’école et qui finira comme eux professeur dans le meilleur des cas, à l’âge où Jean-René Huguenin savait qu’il n’égalerait jamais Rimbaud et Carlo Michelstaedter se tirait une balle dans la tête après avoir écrit le dernier mot de sa Persuasion et la rhétorique ! En littérature comme dans tant d’autres domaines, les hommes nous manquent, alors que les journalistes et les professeurs, eux, pullulent comme des mouches sur un cadavre. Il est vrai qu’ils ont de quoi se nourrir, vu que la France se décompose à vive allure.
Il n’en reste pas moins que François Mitterrand exagère quelque peu car enfin, il est tout autant possible d’affirmer qu’il y a deux sortes d’hommes : ceux qui ont lu La persuasion et la rhétorique justement, mais aussi ceux qui ont lu Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, Nostromo de Joseph Conrad, Absalon, Absalon ! de William Faulkner, ou encore Monsieur Ouine de Georges Bernanos, et ceux qui ne les ont pas lus ! Et je suis absolument certain que d’autres pourraient vous dire qu’ils ne sont plus les mêmes depuis qu’ils ont lu Shakespeare, Dostoïevski, Stevenson ou bien encore Melville, ce qui est par exemple mon cas ! Et, pour finir sur une méchanceté, je n’en suis pas moins sûr que de pauvres âmes seraient prêtes à jurer qu’elles ont été appelées à une nouvelle vie après avoir découvert les textes d’Amélie Nothomb, de Yannick Haenel ou de Virginie Despentes !
Quel regard portez-vous sur l’œuvre de Roger Nimier et plus généralement sur le courant dit des «Hussards», sur lesquels, pour reprendre vos mots, planent encore de vilains soupçons dans le petit monde germanopratin ?
Les Hussards sont des auteurs que je connais finalement assez peu, n’ayant lu que quelques ouvrages de Chardonne, Laurent ou Nimier, bien sûr Les Épées mais aussi Le Grand d’Espagne, qui évoque Georges Bernanos. Comme bien d’autres (je songe ainsi à Péguy, transformé, par l’opération du Saint-Esprit sans doute, en auteur et même penseur de droite), ils ont été d’une certaine façon abâtardis, journalisés par tout un tas de crétins qui se proclament leurs épigones plus ou moins inspirés, revendiqués ou pas. D’ici peu, Causeur leur consacrera un dossier, si ce n’est déjà fait, et c’est ainsi qu’ils seront happés et hachés menu, puis accrochés au plafond, au milieu d’autres andouilles d’appellation et d’origine contrôlées comme Philippe Muray, devenu le saint patron de la Réaction puérile, bastiérenne, à laquelle nous assistons. Très peu pour moi que cet eczéma purement journalistique, que quelques petits Mohicans attendant les Cosaques et une paire de jolies fesses, y compris celles du Saint-Esprit, gratteront en croyant découvrir des cavernes d’originalité. Il me semble, au cas où vous me poseriez cette question, que l’esprit des Hussards a survécu plus qu’il ne survit, car il semble désormais bien mort, le temps où une seule phrase, aiguisée comme le morfil d’une dague, pouvait d’un trait précis clouer une vieille chouette radoteuse. Le dernier rétiaire de ce genre, altier et redoutable, même s’il a parfois trop donné dans un hermétisme littéraire de pacotille, était Dominique de Roux, et un livre tel qu’Immédiatement, publié aujourd’hui, vaudrait à son auteur une bonne quinzaine de procès, et une chasse à l’homme en règle, qu’il eut d’ailleurs à subir de son vivant. Je songe aussi à l’exemple tragique et lumineux de Jean-René Huguenin, mort en 1962 comme Nimier, également dans un accident de voiture. Je songe encore à Guy Dupré, hélas si profondément méconnu voire ignoré par nos élites littéraires ou ce qui en tient lieu, lequel d’ailleurs a écrit un de ses textes si subtils et profondément littéraires sur Sunsiaré de Larcône (recueilli dans Les Manœuvres d’automne), une belle femme que tout Hussard a dû tour à tour envier et maudire au moins une fois !
























































