Rechercher : bernanos%2C lapaque
Sur une île, stalker, quels livres emporteriez-vous ?, 6

26/05/2008 | Lien permanent
L’état de la littérature française sous Emmanuel Macron

 Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous.J’aimerais commencer par remercier les organisateurs de ce bel événement qui témoigne du fait que les forces vives de la nation, c’est-à-dire vous, les jeunes (et je n’oublie pas les moins jeunes !), n’êtes pas tout à fait sclérosés ni même éteints. En parlant des moins jeunes d’entre vous, j’aimerais aussi saluer Stéphane Blanchonnet, rencontré voici bien des années à Lyon, lorsqu’avec une autre personne je m’occupais de deux revues, Dialectique et Les Brandes, la première à orientation philosophico-politique, d’inspiration maurrassienne, très austère, très stricte, quasiment protestante dans son contenu et dans sa maquette, la seconde exclusivement littéraire et préoccupée de démonologie, sous les auspices du Grand d’Espagne comme Roger Nimier le surnomma, Georges Bernanos (1) bien sûr.
La cohabitation, vous vous en doutez, ne fut pas toujours évidente entre les auteurs phares de ces deux revues ! Nous avons en tout cas fait, à l’époque c’est-à-dire à la fin des années 90 et depuis, ce que nous avons pu, avec d’autres, comme les solides gaillards que sont les amis Sébastien Lapaque (2) et Jérôme Besnard, par le biais par exemple de feu la revue Immédiatement que certains d’entre vous connaissent peut-être, qui tenta de prendre la suite de Combat en se plaçant sous les auspices de Dominique de Roux (3).
1)
 Georges Bernanos dans la Zone.
Georges Bernanos dans la Zone.2)
 Une critique sur Les Identités remarquables de Sébastien Lapaque.
Une critique sur Les Identités remarquables de Sébastien Lapaque.3)
 Dominique de Roux dans la Zone.
Dominique de Roux dans la Zone.M’adressant à vous, je ne voudrais bien évidemment pas m’appesantir sur le passé, même s’il est fort proche, car c’est le présent qui nous occupe ce jour, mais aussi l’avenir c’est-à-dire, une fois de plus, vous. Pourtant, et vous le savez comme moi, le présent et a fortiori le futur de notre pays ne sont strictement rien sans le passé, sans son passé spécifiquement français, sans son passé culturellement français, sans son passé littérairement français, sans son passé spirituellement français et, pour poursuivre les anaphores si chères à Charles Péguy, sans son passé génialement français. Or, c’est ce passé qu’Emmanuel Macron semble avoir remis en cause lorsque, toujours à Lyon, qui décidément doit bien être quelque chose comme la capitale secrète de la France depuis Nostradamus, Maurice Scève et Blanc de Saint-Bonnet (4), il a déclaré le 4 février dernier, je le cite : «il n'y a d'ailleurs pas une culture française, il y a une culture en France, elle est diverse, elle est multiple». Vous noterez comment, jusque dans son phrasé parfaitement inepte, la baudruche macronienne est proche de son père, qu’il a bien évidemment tué comme il se doit, l’ignoble et ridicule pantin François Hollande. Tous deux, c’est bien simple, semblent gonflés au même hélium, celui d’un verbe vide et vidé de sa sève, raison pour laquelle ils sont parfaitement interchangeables, et vous pouvez bien sûr ajouter à cet envol de baudruches dans le ciel festiviste et versicolore de la doulce France Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, ou encore celui que Pierre Boutang (5) surnomma Foutriquet, Valéry Giscard d’Estaing. Mais voici qui nous éloigne non seulement du génial auteur du Porche du mystère de la deuxième vertu mais, aussi, de toute forme de littérature.
4)
 Sur De la douleur de Blanc de Saint-Bonnet.
Sur De la douleur de Blanc de Saint-Bonnet.5)
 Pierre Boutang dans la Zone.
Pierre Boutang dans la Zone.Revenons toutefois, pour mieux les oublier, à nos baudruches, qui sont aussi, d’ailleurs, des moutons. Relativiser la culture française, admettre qu’elle n’est pas une mais multiple, qu’elle est ouverte à la sacro-sainte diversité, au vivre-ensemblisme de dizaines de vagues migratoires qui l’ont façonnée au cours des siècles, nous faire comprendre qu’elle est là de toute éternité, sans l’effort des femmes et des hommes qui l’ont produite, souvent durant plusieurs générations, qu’elle flotte en somme à vide au-dessus de nos paysages : nous faire croire ces fadaises et ces mensonges, voilà qui est devenu une évidence partagée jusque dans le dernier village de Gaulois irréductibles, s’il en reste un, ce dont je doute. Cette relativisation de l’unicité de la culture, ce qui ne veut bien sûr pas dire son caractère univoque mais sa cohérence, son harmonie, touche le passé lui-même, et, partant, le présent, nous donc, vous, et ce que vous serez et ferez demain.
Une bonne manière de retrouver ce passé non pas tant perdu que nié voire moqué, en tout cas mis sous le boisseau pudibond du passéisme réactionnaire, c’est de pratiquer un peu d’étymologie. Nous allons faire, l’espace de quelques minutes, ce que jamais ni François Hollande, ni Emmanuel Macron, ni Giscard d’Estaing ni même 99 %, je suis généreux, de nos responsables politiques, et bientôt tous les élèves et les étudiants de France, n’ont fait ou ne vont faire. Nous allons sonder le passé français, sa culture d’une certaine façon, au travers des différentes strates évolutives de la langue française, déposées les unes au-dessus des autres, un peu comme nous pouvons lire l’histoire géologique du pays, de ce qui autrefois, voici plusieurs millions d’années, ne portait pas encore le nom de France, en contemplant les superbes falaises d’Étretat que j’ai abandonnées pour venir vous voir.
Le terme «culture» est une réfection savante datant du 14e siècle, provenant du terme «colture», lui-même emprunté au latin «cultura» ayant donné en ancien français le mot «couture », tout comme le terme latin «cultos» avait donné naissance aux deux verbes «coutiver» et «cultiver». Nous savons aussi que les Latins avaient à leur disposition trois noms plus ou moins synonymes, formés sur le supin «cultum» du verbe «colere» signifiant «habiter», mais aussi «cultiver» et «vénérer», c’est-à-dire : honorer les Muses. Le plus rare de ces trois termes, «cultio», désigne l’action de cultiver, de vénérer, et n’a rien donné en français, à la différence du mot «cultura», à savoir : l’action de cultiver la terre et, au figuré, l’action consistant à éduquer l’esprit mais aussi le fait de vénérer. Le troisième terme, «cultus», est surtout utilisé dans un sens moral et dans la langue religieuse. C’est donc ainsi que «culture» et «culte», dont les sens interféraient à l’origine, se sont progressivement différenciés au cours des siècles. Inutile de détailler plus avant cette histoire d’interférences et de spécialisations pour le moins complexe. Nous comprenons assez vite tout de même que le mot «culture» non seulement convoque, mais aussi lie de façon indissociable au moins deux notions : celle du temps qui passe et repasse sur les champs qu’il faut labourer, cultiver, afin de récolter ce qu’ils auront produit, leur culture ; celle du temps qui s’ouvre, qui est rendu présent, qui est, en un mot, rédimé, sauvé, dans le cérémonial du culte, qui consiste d’une certaine façon à récolter le fruit de ses prières, et à permettre à un fruit tout entier spirituel de prendre racine dans une terre arable, celle de l’âme.
Dans cette double acception, la culture française contemporaine, celle qui nous occupe dans cette intervention au travers du prisme de sa littérature, est, autant ne vous ménager aucun suspense, totalement inexistante. Dans un certain sens donc, il me faut bien avouer qu’Emmanuel Macron ne s’est pas trompé : la culture française contemporaine, du moins telle qu’elle s’exprime au travers de sa littérature, n’existe pas.
Oh, je sais bien qu’elle rayonne au travers du monde, cette culture française qui n’est plus vraiment rien d’autre qu’un certain art de vivre ou ce qu’il en reste (bons vins et bons fromages, belles robes et belles femmes pour les porter et, dans le meilleur des cas, quelques traductions de Michel Houellebecq (6) salué comme le nouveau colosse de Rhodes des lettres françaises moribondes, réduites à une bonne analyse sociologique sous la plume transparente de ce Français qui ressemble à notre voisin), et ce n’est certainement pas pour rien que des cars entiers de touristes venant des quatre coins du globe visitent notre pays, le voient et le photographient sous toutes ses coutures, sans jamais, bien sûr, le regarder, sans jamais lire autre chose que la version française de 50 nuances de Grey, à savoir les rinçures de Virginie Despentes. Michel Houellebecq encore, qui ne se trompe pas lorsqu’il affirme que notre pays tout entier se transforme en musée. Notre culture n'est pas vive, vivante, mais muséale, morte. Avant de venir ici, j’étais dans une région qui s’appelait autrefois la Haute-Normandie, et je crois bien qu’il m’a été impossible de photographier, à Étretat par exemple, non pas de splendides paysages façonnés par les millénaires, mais des paysages photographiés par des badauds ! Les entrepreneurs ambitieux qui dirigent ce pays de crevards, pour reprendre un terme qui a récemment défrayé la chronique, nous vantent aussi la beauté muséale de la France : oui, car ce qui est exposé dans un musée ne vit plus, tout comme la France est un pays mort, parce que, d’abord, sa culture est muséale, c’est-à-dire morte, exposée aux yeux de tous, mais point vivante, comme un cadavre placé sous les regards attentifs d’une poignée de carabins qui, eux au moins, du moins espérons-le, ne feront jamais la bêtise de confondre un cadavre avec un corps vivant.
6)
 Michel Houellebecq dans la Zone.
Michel Houellebecq dans la Zone.Cette évidence, vous me direz et je vous concèderai bien volontiers ce terme, ce paradoxe car vous avez beaucoup d’exemples de bons écrivains contemporains à me citer j’en suis sûr, est le premier point de mon exposé. Emmanuel Macron, bien qu’il ne le sache pas, a raison : il n’y a pas de culture française, et je vais même beaucoup plus loin que lui, puisque j’affirme, depuis quelques années déjà, que la littérature française est morte.
J’ai parlé de disparition de la culture française au sens large. J’en veux pour preuve absolument irrévocable l’état de sa culture, ou de sa production proprement littéraire, celle qui m’intéresse au premier chef. Voici quelques années, la revue inepte Chronic’art publiait un ouvrage collectif dans lequel mon défunt ami Maurice G. Dantec (7) évoquait le cadavre de la France qui, paraît-il, bougeait alors encore. Il s’est depuis je crois, non, j’en suis certain, arrêté de bouger. Nous allons, dans ce deuxième grand mouvement de mon propos, examiner plus minutieusement le cadavre de la littérature française, que nous imaginerons placé sur une table de métal, éclairé par la lumière crue de néons.
Les raisons de cette mort clinique sont pour le moins complexes et multiples (depuis la mort de Dieu et, consécutivement, celle de toute figure d’autorité, jusqu’à la perte de légitimité de tout discours vertical au profit d’une diffusion en rhizome comme le répète à l’envi la déconstruction postmoderniste), et ce n’est pas l’objet de mon intervention que de vous les exposer. La date précise de cette mort varie, elle-même, selon les auteurs : la tradition contre-révolutionnaire la fait remonter à la Mère de toutes les fautes, la Révolution française bien sûr. Certains auteurs, plus loin encore dans le passé, avec l’explosion de la raison raisonnante qu’aurait enclenché le Discours de la méthode de Descartes. Pour Manuel Arroyo-Stephens qui moque les Français dans un pamphlet érudit récemment traduit (8), c’est le classicisme qui est à l’origine de la quasi-nullité de la littérature française moderne. Je le cite : «On n'a pas découvert meilleur moyen pour donner de l'allure et de l'éclat aux artistes médiocres que de les obliger à suivre des règles qui cachent leur manque de talent : légiférer, en art, tue le créateur et produit des artisans. Il n'y a donc pas mieux, pour en finir avec la créativité d'un artiste, que de l'obliger à accepter des normes, des critères et des goûts émanant de ces vénérables institutions nommées académies. Rien n'est plus voisin de l'esprit français, conclut Manuel Arroyo-Stephens, que l'esprit académique» qui, du moins durant le ridicule 18e siècle, peut se confondre assez facilement avec un concours de « perruques poudrées et [de] mouches sur le visage», ou encore avec cet «art du paysage en éventail», «le vicomte maniéré des défis et l'abbé idiot des madrigaux», cet art «cérémonieux, mesuré, de la pavane» qui a donné un verbe pronominal qui, si mes souvenirs sont bons, a quelque rapport étymologique avec le mot paon, jetant ainsi une lumière non point crue mais elle-même artificielle et molle sur les habitudes françaises. Pour un très bel écrivain comme Guy Dupré (9), le merveilleux auteur des Fiancées sont froides, quelque chose s’est cassé avec la défaite de 1870, tout comme ce fut aussi le cas pour Ernest Renan, avant même que ne se déclenche la guerre d’extermination ou plutôt, selon Léon Bloy, sa pâle copie, je veux parler du premier conflit mondial. Je songe encore à ce que des auteurs comme Bernanos déjà nommé, mais aussi Brasillach ou Rebatet, et que dire de Céline, nous ont appris sur la débâcle de la Seconde Guerre mondiale. Peu importe au fond la date exacte qui signifierait, de manière claire, le début de la décadence de la littérature française, car elle ne peut de toute façon qu’être symbolique, puisqu’il est impossible de prétendre : «Mes amis, c’est à partir de cette date, et de cette date uniquement, que la France est entrée en déclin !».
7)
 Maurice G. Dantec dans la Zone.
Maurice G. Dantec dans la Zone.8)
 Contre les Français de Manuel Arroyo-Stephens.
Contre les Français de Manuel Arroyo-Stephens.9)
 Guy Dupré dans la Zone.
Guy Dupré dans la Zone.Les causes de ce déclin sont complexes, mais ses caractéristiques, elles, sont bien visibles dans ce que j’appellerais, plus que la littérature française contemporaine, la production littéraire française contemporaine. Nous allons maintenant examiner quelques-unes des particularités de cette mort ou, au mieux et si vous êtes d’indécrottables optimistes, de cette agonie.
D’abord, et c’est bien logique, la littérature française est devenue tout entière marchandise. Nous sommes à l’ère où tout se vend et s’achète, y compris les ventres des femmes, et il est donc tout à fait normal que dans un pays, le nôtre, dirigé par un représentant commercial de talent comme l’est Emmanuel Macron, cornaqué par une force de vente à la hauteur de ses prétentions de VRP international, les livres puissent se vendre comme n’importe quelle autre marchandise. Voyez le phénomène, annuel et désormais bisannuel, de la rentrée dite littéraire. En septembre, et maintenant désormais en janvier aussi, ce sont ainsi plusieurs centaines de nouveaux livres qui vont inonder les étals des charcutiers, pardon, des libraires, et il est parfaitement évident que ce ne seront pas les meilleurs livres qui auront la chance d’être lus, mais ceux qui auront bénéficié de la meilleure réclame publicitaire et de la complicité de journalistes incultes paraît-il critiques littéraires.
À la fin de l’été 2015, j’ai annoncé au public de l’Intime Festival de Namur auquel Benoît Poelvoorde (10) m’avait invité que le prochain prix Goncourt ne pouvait récompenser qu’un
05/09/2017 | Lien permanent
Vous aurez la guerre : Loïc Lorent, Michel Crépu et Guy Dupré

Félicien Challaye, cité par Loïc Lorent dans Vous aurez la guerre (Éditions Jean Paul Bayol, 2008), p. 102.
Il y a de cela peu de temps, le piètre journaliste Pierre Assouline, authentique spécialiste des préfaces, ainsi que quelques drôles qu'il ne convient pas même de nommer, trouvaient très peu recommandable de montrer ce qu'avait été l'un (l'un, pas le seul bien sûr : l'un, disons celui qui n'était point grimé, peut-être le plus réel) des visages de la France occupée par l'armée allemande.
Comme ce visage leur faisait honte ou qu'ils prétendaient, plus sûrement, l'oublier, ils voulurent à tout prix le cacher. L'énigmatique conte d'Hawthorne intitulé Le Voile noir était ainsi parodié, sans qu'ils le sachent cela va de soi, par ces beaux esprits : n'ayant (probablement) rien à se reprocher, le pasteur inventé par l'ami de Melville se voila pourtant le visage, d'horreur diffuse devant les innombrables crimes commis par ses ouailles, jusqu'à la fin de ses jours. Sur son lit de mort même, et malgré le cri de désespoir de celle qui l'avait aimé en silence, le pasteur refusa d'ôter de son visage le mystérieux voile de tissu.
Nos journalistes, eux, qui n'ont probablement pas lu une seule ligne d'Hawthorne (ou de Rick Moody, pour évoquer un auteur tout de même vivant et célèbre), ont honte d'un visage qui fut pourtant celui d'une belle femme, insoumise et rebelle, fille aînée de l'Église et Salomé coupeuse d'innombrables chefs, la France, à la fois sainte et, bien sûr, équivalence pas même bloyenne, putain. Pour son amant tudesque patiemment guetté depuis son balcon en forêt, elle accepta même de relever sa jupe sans toucher un maigre sou pour ses bons et loyaux services. Rien à faire donc, les bosses et les énormes bleus, vaguement cachés par un maquillage d'une horrible vulgarité, sous les pauvres bandages consensuels, étaient aussi peu invisibles que le sourire artificiel des comprachicos hideusement défigurés.
Pierre Assouline découvrit, mais un peu tard à son âge, que la belle vestale gardienne du feu sacré de la plus haute histoire était, depuis quelques éons tout de même, une demi-mondaine pressée de se vendre sur l'étal du boucher. Nous restons donc dans la littérature et, après Nathaniel Hawthorne, nous convoquons, toujours à l'insu de notre journaliste, François de Rosset et Charles Nodier.
Ce visage souriant, radieux même n'ayons pas peur de l'écrire, comme celui d'une femme amoureuse exigeant de son ravisseur qu'il la prenne sans cérémonie, avait été celui, photographié par André Zucca, de l'insouciance, du bonheur de vivre, voire de la complaisance, quand il n'était pas la trogne hilare, ma foi magnifiée par les yeux de notre habile photographe, d'une bien franche collaboration.
Je rappelais alors ici même, après avoir lu la note effarouchée d'un Pierre Assouline plus martial qu'un Hannibal monté sur un ânon de papier, quelque évidence historique qui semble apparemment avoir échappé à nos contempteurs au sujet de ce qu'il est convenu de nommer, pudiquement, la moins glorieuse période de notre longue histoire, à dire vrai une pantalonnade comme elle n'en connut que peu : la honteuse débâcle de 1940 ayant vu, sur les routes de France, des milliers de combattants qui avaient bien souvent détalé au seul bruit d'histoires colportées de casernes en casernes plutôt que devant des ennemis bien réels, je me bornais à faire remarquer à notre approximatif historien Pierre Assouline que les rangs des résistants avaient été pour le moins clairsemés si on les comparait à ceux de l'immense troupeau des collabos, passifs comme ceux que montraient les clichés de Zucca dénoncés par nos fiers-à-bras en chemise de soie ou parfaitement actifs, quitte à devancer les désirs allemands. Quitte, aussi, à proposer de planter le drapeau français sur un tas de fumier odorant, selon les désirs de Jean Zay dont le sang était contaminé (il ne fut bien sûr pas le seul dans ce cas) par le germe du pacifisme le plus purulent.
Loïc Lorent, un jeune auteur plus polémiste qu'historien (son livre, sans doute volontairement, fait l'économie d'un apparat critique, il s'agit d'aller vite, sans beaucoup de style), plus coléreux que réellement polémiste (l'imprécation ne peut se départir d'une écriture réelle qui est, dans le cas de notre jeune auteur, espérons-le, en gésine) rappelle ces évidences en leur donnant un beau nom qu'il affirme être une idéologie, celle du munichisme, ainsi épinglée : «Et si nous devions définir cette idéologie d’une façon «concise», nous pourrions dire que le munichisme est l’idéologie qui, sous l’influence élémentaire de pacifismes intransigeants, conduit à renoncer consciemment à la puissance et même, en temps de crise, à accepter des concessions sur l’autel de la paix et, finalement, aboutit à la capitulation» (pp. 195-6). Notre époque bien sûr est celle du nouveau-né accouché de son insigne marâtre, le néo-munichisme comme il se doit qui n'est plus seulement une idéologie mais le discours seul autorisé, donc l'auto-consomption de toute idéologie ou pour le dire autrement, l'idéologie absolue, le novlangue terminal (1) : «Le néo-munichisme, qui n’est qu’un munichisme réactualisé en fonction des nouvelles idéologies dominantes en Europe occidentale, n’est pas un discours (ce qu’il était en 1939), mais le discours obligatoire. Il n’est plus restreint, propre à certaines sphères mais est partagé par la quasi-totalité des citoyens du vieux continent» (p. 216).
Le constat est imparable, l'analyse, même répétitive et parfois fort peu encline aux subtilités politiques, féroce mais manque à ce brûlot, je l'ai dit, la griffe incassable d'un style, celui par exemple de Bernanos que rappelle d'ailleurs Lorent (2). Sébastien Lapaque le cite beaucoup lui aussi. À vrai dire, il paraît même tellement persuadé de s'être incorporé la substance la plus secrète du Grand d'Espagne qu'il ne le cite plus guère, se contentant de donner, à la réédition de Sous le soleil de Satan par le Castor Astral, une préface qui n'en est pas une, qui est même particulièrement légère si on la compare au travail honnête de Michel del Castillo pour Les grands cimetières sous la lune. Crépu, lui, cite peu Georges Bernanos, après tout digne héritier de Léon Bloy que le patron de La Revue des deux Mondes ne tient pas en une immense estime. Crépu n'aime guère les auteurs qui ont l'écume aux babines, toujours prêts à mordre à belles dents les fesses blanches des Français qui paraissent avoir oublié depuis belle lurette ce qu'est le virus de la rage.
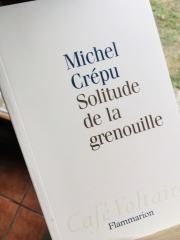 C'est pourtant Michel Crépu, et non point Lorent ni même Lapaque qui rend à Bernanos un hommage aussi inattendu que juste dans un excellent petit livre (quoique contestable sur bien des points) déjà vieux, Solitude de la grenouille dont je viens de terminer la roborative lecture. Passons sur le sujet de cet essai enlevé, passons encore sur le fait que le non proféré par les Français à la Constitution soit comparé à un sinistre Munich, ne retenons même pas la sempiternelle antienne (3) psalmodiée par l'auteur (il faut jouir; gageons du moins que Crépu jouisse intelligemment), pour ne retenir que le passage consacré à Bernanos, tout particulièrement celui de Nous autres Français : «Merveilleux, exaspérant Bernanos, qui se cogne partout [...], sa façon de secouer furieusement le taillis de ronces où il s'est enferré lui-même, en sortant au bout du compte blessé, tuméfié, bouleversant. Bernanos avec ses cannes, sa moto, ses lettres aux Anglais, son chemin de la Croix-des-Âmes, impayable, indélogeable dans son réduit monarchique du XXe siècle, seul, à Juis de Fora, au milieu de ses vaches et de ses cochons... Dites, Bernanos, vous savez que la moto n'a pas de freins... Bah, on ira dans le fossé ! Vive le Roy ! Adieu ! Adieu ! Nous autres Français est écrit durant l'année 1939-1939, l'encre des accords de Munich vient à peine de sécher, Bernanos sort tout juste des Grands cimetières sous la lune, il est déjà au Brésil, écœuré, «cuvant sa honte». Il s'est passé quelque chose, un grain qui coince décidément et qui a précipité la rupture avec l'Action française. Ce que Bernanos a vu à Majorque, les exécutions sommaires, l'horreur commise au nom de Dieu, la Croisade franquiste, la casuistique au service du meurtre, le Dogme à celui de la criminalité idéologique» (4).
C'est pourtant Michel Crépu, et non point Lorent ni même Lapaque qui rend à Bernanos un hommage aussi inattendu que juste dans un excellent petit livre (quoique contestable sur bien des points) déjà vieux, Solitude de la grenouille dont je viens de terminer la roborative lecture. Passons sur le sujet de cet essai enlevé, passons encore sur le fait que le non proféré par les Français à la Constitution soit comparé à un sinistre Munich, ne retenons même pas la sempiternelle antienne (3) psalmodiée par l'auteur (il faut jouir; gageons du moins que Crépu jouisse intelligemment), pour ne retenir que le passage consacré à Bernanos, tout particulièrement celui de Nous autres Français : «Merveilleux, exaspérant Bernanos, qui se cogne partout [...], sa façon de secouer furieusement le taillis de ronces où il s'est enferré lui-même, en sortant au bout du compte blessé, tuméfié, bouleversant. Bernanos avec ses cannes, sa moto, ses lettres aux Anglais, son chemin de la Croix-des-Âmes, impayable, indélogeable dans son réduit monarchique du XXe siècle, seul, à Juis de Fora, au milieu de ses vaches et de ses cochons... Dites, Bernanos, vous savez que la moto n'a pas de freins... Bah, on ira dans le fossé ! Vive le Roy ! Adieu ! Adieu ! Nous autres Français est écrit durant l'année 1939-1939, l'encre des accords de Munich vient à peine de sécher, Bernanos sort tout juste des Grands cimetières sous la lune, il est déjà au Brésil, écœuré, «cuvant sa honte». Il s'est passé quelque chose, un grain qui coince décidément et qui a précipité la rupture avec l'Action française. Ce que Bernanos a vu à Majorque, les exécutions sommaires, l'horreur commise au nom de Dieu, la Croisade franquiste, la casuistique au service du meurtre, le Dogme à celui de la criminalité idéologique» (4). Rien de bien neuf, donc, sous le soleil pisseux des petits camelots du Roy, qu'ils soient honteux (signant ainsi sous divers pseudonymes, comme le bravache Frédéric Morgan/Pierre Carvin, dont la photographie ci-contre, publique je le précise, est éloquente) ou déclarés : la même tonalité martiale ridicule et irresponsable dont le plus puissant combustible n'aboutira jamais à mettre en branle un piston millimétrique, la même lâcheté se jouant finalement de mots trop grands pour les petites bouches en praline de nos procrastinateurs incurables.
Rien de bien neuf, donc, sous le soleil pisseux des petits camelots du Roy, qu'ils soient honteux (signant ainsi sous divers pseudonymes, comme le bravache Frédéric Morgan/Pierre Carvin, dont la photographie ci-contre, publique je le précise, est éloquente) ou déclarés : la même tonalité martiale ridicule et irresponsable dont le plus puissant combustible n'aboutira jamais à mettre en branle un piston millimétrique, la même lâcheté se jouant finalement de mots trop grands pour les petites bouches en praline de nos procrastinateurs incurables.L'un des chapitres les plus intéressants de l'essai de Crépu est sans conteste celui (intitulé Portrait de l'artiste en vieux continent) où il tente de donner figure à ce qui n'en a pas, le Mal. Crépu l'enthousiaste, le jouisseur, le confiant, l'honnête homme au sens le plus noble de l'expression, ce nageur jamais plus à l'aise que dans une mare sollersienne où il exécute de belles figures, paraît fort mal équipé pour s'aventurer au large, encore moins descendre dans les profondeurs. La généalogie de l'esprit munichois entreprise par l'auteur aurait peut-être dû s'appuyer sur deux lectures que Crépu ne cite pas (5) et qui, dans ces domaines troubles, font office de bouteilles d'oxygène et d'hélium nécessaires à l'exploration des grands fonds : Max Picard et Guy Dupré.
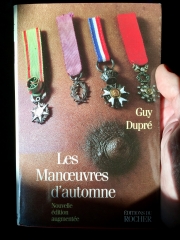 Guy Dupré... La plus anodine page de cet écrivain de race paraît gonflée de mille sucs qui nous font humer, à la brune, une forêt profonde de souvenirs, riches d'allusions innombrables, subtiles comme des essences volatiles, à un monde perdu. Lorsque je déjeunai avec lui il y a quelques semaines, l'homme se révéla d'une politesse et d'une amabilité tout à fait exquises, comme ses livres, d'ailleurs, le laissaient soupçonner. Il savait parler, déversant le flot prodigieux de souvenirs apparemment infinis, parce que, surtout, il savait se taire, son art ayant d'abord consisté à garder le silence, à ne point se précipiter pour écrire quelques vagues feuillets vite oubliés. L'homme de parole, qui s'en étonnera, était un homme du silence, c'est-à-dire de la parole non pas rimbaldiennement reniée mais gardée. Nous avons alors évoqué beaucoup plus de vivants (à peine l'étaient-ils) que de morts (bien réels, eux, plus vivants, par le pouvoir des invocations de Dupré, que nos pâles vivants) et ma conversation dut faire à ce Sphinx de la mémoire l'effet d'un bourdonnement d'insecte dérangeant un impassible éléphant peut-être bien bicentenaire ou bien quelque vieillard sans âge, comme aimait à les peindre Borges.
Guy Dupré... La plus anodine page de cet écrivain de race paraît gonflée de mille sucs qui nous font humer, à la brune, une forêt profonde de souvenirs, riches d'allusions innombrables, subtiles comme des essences volatiles, à un monde perdu. Lorsque je déjeunai avec lui il y a quelques semaines, l'homme se révéla d'une politesse et d'une amabilité tout à fait exquises, comme ses livres, d'ailleurs, le laissaient soupçonner. Il savait parler, déversant le flot prodigieux de souvenirs apparemment infinis, parce que, surtout, il savait se taire, son art ayant d'abord consisté à garder le silence, à ne point se précipiter pour écrire quelques vagues feuillets vite oubliés. L'homme de parole, qui s'en étonnera, était un homme du silence, c'est-à-dire de la parole non pas rimbaldiennement reniée mais gardée. Nous avons alors évoqué beaucoup plus de vivants (à peine l'étaient-ils) que de morts (bien réels, eux, plus vivants, par le pouvoir des invocations de Dupré, que nos pâles vivants) et ma conversation dut faire à ce Sphinx de la mémoire l'effet d'un bourdonnement d'insecte dérangeant un impassible éléphant peut-être bien bicentenaire ou bien quelque vieillard sans âge, comme aimait à les peindre Borges.Un monde perdu ai-je écrit ? Oui, surtout si l'on s'avise de tendre l'oreille vers le vacarme provenant de l'étal de vente à la criée qui horrifia Julien Gracq et que stigmatise Dupré, écrivant (op. cit., p. 179) : «De mon bureau d’éditeur j’avais vu la contagion du besoin de s’exprimer, de se justifier, de se raconter, gagner la Grande Muette, le Barreau, le Parlement, la Police, les Finances, la Médecine. À l’école de la baveuse Céline et du morse Morand, les romanciers de «mes deux» s’étaient mis à table, une table percée d’où dégoulinaient des ouvrages de simulation. Nous étions tous des simulacres.»
Un monde perdu ? Bien sûr que non car ce pessimiste absolu qu'est Guy Dupré ou, pour le dire autrement, ce réactionnaire authentique, riche de souvenirs que l'on croit ceux d'un monde non seulement révolu mais qui n'a, tout bonnement, jamais existé, convaincu encore depuis des lustres que l'épuisement des forces de la France n'a même pas eu pour cause la Grande Guerre (et encore moins, bien sûr, la Seconde) qui n'a fait que révéler ce que les plus fins esprits soupçonnaient : la France était sortie, d'un coup, de l'histoire, et bien avant que la défaite de nos armées paraphe notre capitulation morale et intellectuelle, est aussi celui qui parie sur l'existence d'une «fraternité élective et lyrique, dédaigneuse et ironique» qu'il oppose aux «appartenances familiales, mondaines, séculières» et qui constitue un «compagnonnage dans lequel on n'entr[e] qu'en restituant son sens sacramentel à la double expression «élever la voix» et «garder le silence» (6). Selon Guy Dupré, la transmission des pouvoirs de l'esprit et de la chair ne peut se faire qu'au travers des figures féminines évoquées dans ses trois romans et ses nombreux textes, comme si elles étaient de mystérieux intercesseurs de la grandeur apotropéenne échappant d'un rire à la pesanteur de la chaîne héréditaire. Un peu de la liberté canaille des femmes que Dupré a aimées s'est étrangement déposée sur ses meilleurs textes qui vous donnent l'impression de pénétrer dans un royaume antique plus consistant et pérenne que les titanesques portiques d'acier et de lumière germant aux quatre coins de la planète.
Qu'importe l'exténuation des vieux flancs de la race, semble nous chuchoter Dupré, si le grain miraculeux peut se lever après avoir germé dans les terres les plus inattendues ! Qu'importe encore l'irréalité foncière du présent puisque ce que Dupré a défini mieux que nul autre, poétiquement nommé «loi de Sainte-Beuve» (7), nous entraîne dans le cours d'un fleuve que nous pouvons, avec quelque pratique, remonter (8).
Vers quelle source improbable où se nicherait la pollution qui contamina le fleuve ? À cette question, la plus angoissante, la dernière, nul ne détient ne serait-ce qu'une vague réponse. Pas même le magicien Guy Dupré.
Notes
(1) Évident souvenir de 1984 de George Orwell et peut-être de La Fausse parole d'Armand Robin, auteur hélas presque inconnu, que ce constat : «La dénaturation du sens des mots est la matrice des tyrannies modernes» (op. cit., p. 61).
(2) «Les intellectuels qui ne sont pas tombés dans le piège du pacifisme couineur sont rarissimes. Bernanos ou Montherlant, dont les indignations rageuses offriront de sublimes objets littéraires, sont marginaux» (Ibid., p. 108).
(3) Michel Crépu, Solitude de la grenouille (Flammarion, coll. Café Voltaire, 2006), pp. 122-3 : «Ce qui disparaît en France avec la Grande Guerre, c’est tout le profond pouvoir de la légèreté, signe de finesse et d’humilité, son génie propre qui avait donné sa langue à l’Europe. Tout devient lourd, emprunté, velléitaire, privé de grâce, ne songeant qu’à des «retours» ou à des ruptures toujours plus radicales, toujours plus vaines. La légèreté perdue, la gravité s’évanouit à son tour.»
(4) Op. cit., p. 37.
(5) Crépu, qui a bien raison de mépriser le personnage fat de l'Écrivain, devrait quelque peu se méfier de celui, tout aussi ridicule et encore plus boursouflé, du Critique... Car, ma foi, contrairement aux dires de l'auteur, nous sommes quelques-uns, oui, sans doute fort peu nombreux, à avoir lu Pascal, Bossuet, Sainte-Beuve et... Lucien Bodard dont les analyses, tout de même, cher Michel, sont un peu moins imparables que celles d'un Dupré lorsqu'il s'agit de tenter d'expliquer les origines de l'épuisement français !
(6) Guy Dupré, Les Manœuvres d'automne (Le Rocher, 1997), p. 89. Je recopie cet admirable passage, qui devrait être donné, dans les salles de classe, en exemple d'humilité et de grandeur mélangées, d'implacable lucidité aussi : «C’était la fin d’une espèce et d’une aire. Que resterait-il après eux ? Que restait-il devant nous qui n’avions pas encore rassemblé nos esprits ? La liberté à la française – d’où résultait la population des copistes et des scribes accroupis, écrivant sous eux, s’arrogeant le droit à la parole et revendiquant le droit à la différence, mais qui se ressemblaient comme les soies d’une même truie. Ce n’était plus le Veau mais le Cochon d’or que seuls, debout dans les siècles des siècles, les guerriers, les poètes et les princes tenaient en respect. Il n’y a que le temps qui n’ait pas peur du Cochon, et celui qui sait jouer sa vie sans compter ses jours. Au seul Trio respectable selon Charles Baudelaire, le prêtre, le guerrier, le poète – «Savoir, tuer et créer» –, nous substituerions un composé résineux des trois. Comprendre; faire disparaître des écrans intérieurs le son des célébrités de la chanson du jour; attendre pour écrire de pouvoir écrire des ouvrages qui réjouissent le cœur des hommes et des femmes de la région des Égaux. Prêtre, soldat, poète, il ne suffisait plus d’avoir une cuillère dans chacun des trois pots, il faudrait savoir les remuer toutes en même temps. Dans le bleu des soirs d’Île-de-France pareil au bleu de Prusse des matins d’exécution, je chercherais longtemps encore le secret de conduite qui permet de lier la douceur sans quoi la vie est peu de chose au déchaînement intérieur sans quoi la vie n’est rien», ibid., p. 44.
(7) La Loi de Sainte-Beuve dont le grand critique se fait le chante dans son roman intitulé Volupté, «régit la mémoire antérieure aux premiers souvenirs et fait découler la nostalgie primordiale (et la fantasmagorie qui en procède), non de la petite enfance, mais du temps qui précède immédiatement le temps où nous sommes venus», in op. cit., p. 77.
(8) Dans ce nouveau passage admirable, Guy Dupré retrouve les vues plus que les accents d'un Léon Bloy et d'un Louis Massignon : «Nul ne connaît son propre nom, nul ne sait de quel personnage mystérieux – et peut-être mangé des vers – il tient la place… Ainsi des temps et des destinées antérieurs reçoivent-ils leur sens de temps et de destinées ultérieurs. Amours, guerres ou aventures au fond si peu e
10/06/2008 | Lien permanent
Georges Bernanos pas vraiment surpris par la nuit

Ma modeste contribution à la pratique taxidermiste ne peut cependant, en aucun cas, me préserver du véritable dégoût que j'éprouve, souvent, à lire certains auteurs, dont les cadavres encore puants semblent avoir été maquillés de frais pour parader sous les néons des plateaux de télévision. Un seul ouvrage d'eux m'a parfois suffi pour me décider à les abandonner à leur sort et je ne les ai plus jamais relus, sans doute pour de mauvaises raisons invinciblement mélangées avec de meilleures. La lecture, après tout, de même que la critique, ne sont-elles pas toutes deux des sciences inexactes et profondément partiales, n'en déplaise aux laborieux inventeurs de grilles et des schémas qui, avec leurs petits meccanos, ne cherchent qu'à se rassurer devant l'inconnu ?
Mais le temps presse, chaque seconde qui passe me rapproche un peu plus de l'heure où, devenu imbécile, ignorant, homme ancien devant les choses muettes, je ne me souviendrai peut-être même plus de mon propre nom. Il est temps de me remettre en route, porque, aunque no haya caminos, tengo que caminar. Il me faut donc, coûte que coûte, trouver la clé de l'énigme, magiquement éparpillée dans les livres innombrables qui sont comme autant de grains de sable composant la plage immense de la littérature, autant de lettres formant la longue phrase imprononçable s'enfonçant dans les ténèbres qu'évoqua William Faulkner dans Pylône.
Georges Bernanos en est un des mots les plus énigmatiques, un auteur que je ne cesse de relire, qui, même lorsque ses livres sont refermés, semble rugir dans mon crâne ou bien y chuchoter d'une voix admirable et fragile, tant ses fulgurances paraissent avoir décrit notre monde, et surtout celui qui vient, de prémonitoire et radicale façon. Contrairement à l'image sotte que les milieux catholiques et les dévots universitaires, hélas, ont donné de ses romans, ceux-ci ne peuvent se réduire à quelques romantiques chromos évoquant des curés d'un autre âge aux prises avec le Boiteux vagabondant sur les terres dévastées par les batailles de la Première Guerre et la rapine universelle. Il y a, fort heureusement pour Bernanos et pour nous, beaucoup plus, comme je tente de le montrer dans mes propres travaux.
Je l'ai répété à Matthieu Bénézet durant une émission consacrée tout entière au romancier (Surpris par la nuit sur les ondes de France Culture*) est un auteur qui reste devant nous, dont les questions angoissées sont plus que jamais les nôtres, l'un des rares romanciers à avoir sans doute pris la mesure colossale, comme Nietzsche l'exigeait, des conséquences inouïes entraînées par la mort de Dieu.
Carl Schmitt, dans une phrase ô combien célèbre de sa Théologie politique de 1922, a pu écrire que tous «les concepts prégnants de la théorie moderne de l’État [étaient] des concepts théologiques sécularisés» (1). Les textes de Bernanos, qu'il s'agisse des romans (et, singulièrement, du dernier d'entre eux, Monsieur Ouine) ou des écrits polémiques, ne font rien d'autre que de tenter de sonder cette modernité grosse d'idées chrétiennes devenues, selon le mot de Chesterton dans Orthodoxie, folles. On cite cependant moins souvent ces autres lignes de Schmitt écrites dans sa postface à l'édition de son livre datant de 1969 où il répond à Hans Blumemberg : «L’homme nouveau qui se produit lui-même dans ce processus n’est pas un nouvel Adam, ni d’ailleurs un nouveau pré-adamite et encore moins un nouveau Christ-Adam, mais à chaque fois le produit non préstructuré du procès-progrès qu’il a lui-même mis en route et qu’il maintient en état de fonctionnement.
[...]
L’homme nouveau est agressif dans le sens d’un progrès ininterrompu et d’incessantes nouveautés posées dans l’existence; il récuse la notion d’ennemi et toute sécularisation ou transposition d’anciennes représentations de l’ennemi; il dépasse le suranné grâce au neuf tiré de la science, de la technique, de l’industrie; l’ancien n’est pas l’ennemi du neuf; l’ancien se dissout lui-même et de lui-même dans le procès-progrès scientifique, technique, industriel, qui ou bien met en valeur l’ancien – à l’aune des nouvelles mises en valeur possibles –, ou bien l’anéantit comme de la non-valeur qui le gêne» (2).
Sommes-nous alors à ce point aveugles, ou bien dotés d'une mémoire labile, que nous n'avons lu le même avertissement sous la plume de Bernanos, par exemple dans une préface abandonnée au Chemin de la Croix-des-âmes paru en 1948 : «C'est très joli de dire que la conception marxiste de l'Histoire est fausse. Elle est de moins en moins fausse à mesure que les hommes se déspiritualisent davantage, c'est-à-dire réussissent de mieux en mieux à se donner l'illusion qu'ils peuvent se passer de Dieu, tentative évidemment chimérique, mais que les immenses ressources de la Technique permettront de pousser très loin, beaucoup plus loin, terriblement plus loin que ne l'imaginent de pauvres prêtres imbéciles, ou des cardinaux roublards. La déspiritualisation de l'homme, en effet, ne restera pas longtemps un problème d'éducation ou de propagande: elle peut devenir très vite, elle est sans doute déjà devenue, un problème de biologie […].» (3) ?
Avons-nous encore oublié cet avertissement encore plus ancien (puisqu'il date de 1931) contenu dans La grande peur des bien-pensants : «L'histoire tout entière du XIXe siècle est celle de ses déceptions, de ses fureurs paniques, de ses longues somnolences coupées d'accès sanguinaires dont on l'a vue chaque fois sortir exténuée, amollie, ruisselante de larmes. Nulle peut-être ne fut plus essentiellement, au sens total du mot, conservatrice. La haine du spirituel qui l'inspire d'ordinaire, cette passion où l'on serait tenté de reconnaître le signe d'une sorte de grandeur sauvage, démoniaque, n'est que la somme de ses ignorances, de ses rancunes, de ses envies. Elle a pris ses précautions contre le divin, simplement. Elle assiste sans comprendre à ce phénomène capital, unique: l'altération, peut-être désormais sans remède, du sens religieux dans l'homme moderne, qui fausse l'équilibre de la vie sociale, commence à développer d'énormes passions collectives dont la contagion menace de s'étendre d'un bout à l'autre de la planète» (4) ?
Montrer, donc, que nous n'en avons absolument pas fini de lire, de relire et d'étudier (je n'utilise pas le verbe disséquer, car ils sont diablement vivants !) les textes de Georges Bernanos, voilà ce qu'il importe de faire. C'est tout le sens des deux articles universitaires (5) qui avaient paru dans le vingt-troisième numéro des Études bernanosiennes éditées par Minard, éditeur impeccable qui vient de publier un volume des Archives Bernanos contenant une nouvelle étude sur le premier roman, époustouflant et génial, du Grand d'Espagne, Sous le soleil de Satan bien sûr que Sébastien Lapaque, pour sa réédition au Castor Astral, a hélas affublé de quelques lignes aussi visiblement hâtives qu'indigentes.
*Addendum
Écoutée, cette émission m'a particulièrement déçu : pourquoi avoir conservé au montage le passage expliquant en quelques mots plutôt confus la trame de l'histoire du village de Fenouille, alors que Claire Daudin l'avait déjà fait, et de façon plus compréhensible ? Pourquoi avoir supprimé ce qui je crois constituait la particularité de mon intervention : de longues minutes où j'expliquais à Matthieu Bénézet les raisons pour lesquelles Monsieur Ouine pouvait être à bon droit considéré comme un roman de la mort de Dieu illustrant la théologie du fantôme chère à Michel de Certeau ? Pourquoi ne pas avoir conservé cet autre passage où je rapprochais les sombres prédictions de Georges Bernanos des analyses d'un Carl Schmitt sur les concepts de la théorie de l'État qui sont tous, à ses yeux, des concepts de théologie sécularisés, comme je le souligne dans cette note ? Pourquoi avoir supprimé ce développement sur la catégorie du prophétisme telle qu'elle est exposée par Maurice Blanchot, appliquée aux livres du romancier ? Pourquoi avoir enfin considéré que n'étaient pas intéressantes (ou pertinentes, ou claires) mes analyses sur la contre-incarnation que réalise le démoniaque, à moins qu'il ne s'agisse de la dernière trace, parodique et déformée, de la présence du divin ?
Je sais bien que la loi du genre est frustrante : un montage, par définition, est un choix. Un choix pourtant, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas le contraire d'un résumé intelligent sinon fidèle. Du moins pouvais-je attendre que l'originalité, sinon la cohérence de mon intervention, eût été conservée.
Notes
(1) Carl Schmitt, Théologie politique (Gallimard, coll. Bibliothèque des sciences humaines, 1988), p. 46.
(2) Op. cit., pp. 180-1.
(3) Georges Bernanos, Essais et Écrits de combat, t. II (Gallimard, coll. La Pléiade, 1995), p. 693.
(4) Essais et Écrits de combat, t. I (Gallimard, coll. La Pléiade, 1971), p. 332.
(5) J'avais mis en ligne l'un de ces deux textes sur Knol avant de le rapatrier dans la Zone, ici.
27/10/2008 | Lien permanent
Dommage collatéral à droite

Discussion amicale, avant-hier, dans les locaux de Flammarion rue Racine où j’ai cru apercevoir Frédéric Beigbeder, avec Lakis Proguidis, à qui j’avais envoyé pour L’Atelier du roman (dont le prochain numéro est consacré à Audiberti) un long papier analysant Vingt ans et un jour, le dernier roman de Jorge Semprún, loué par presque tous les critiques de France et de Navarre, à la lumière du génial Absalon, Absalon ! de Faulkner, auteur et livre dont Semprun ne se prive jamais de rappeler l’influence sur ses propres écrits. Ma petite enquête montre l’évidence, la lettre volée exposée pourtant sous les yeux des plus éminents critiques : Semprún, en se comparant à l’auteur du Bruit et de la fureur, n’est rien de plus qu’un habile imposteur… Patience donc pour la lecture de ce texte, puisqu’il en faut pour qui prétend écrire et tenir la gageure constante d’être publié dans des revues… Nous évoquons avec Lakis la stupidité grossière et l’inculture de ces mêmes critiques et, plus généralement, des journalistes prétendument littéraires. Nous évoquons Dantec, dont il dit se méfier mais qui l’intéresse a priori par la teneur de certaines de ses déclarations. Je m’en méfie aussi, car rien n’est plus éloigné de ma complexion qu’une admiration béate, ce qui ne m’empêche pas de le lire et surtout de lire les auteurs appartenant à ce que j’appellerai son « horizon d’attente ». Non pas Anders donc, qu’il vient de découvrir, selon ses propres termes mais Dick, Spinrad et tant d’autres que j’ai lus et, parfois, dans trop de cas, dont je ne me souviens même plus.
Pour vérifier, une fois de plus, la nullité des critiques de tous bords – ici, il s’agit de celles et ceux qui font métier de «disséquer» des œuvres cinématographiques –, je suis allé voir Collateral de Michael Mann, long clip musical et nocturne que les nostalgiques de la série Miami Vice auront l’impression de revoir à l’écran. Les images sont belles, oui (et pour cause : numériques, comme s’extasient de le répéter les imbéciles), et, parfois, la musique… Et puis ? Quoi d’autre ? Rien ou plutôt, si : l’essentiel, qui peut tenir dans une courte phrase, que je soumets à la sagacité des critiques du Figaro, du Monde ou de Chronic’art, puisque apparemment ils manquent de mots pour louer le film de Mann. Cette phrase, la voici : Collateral est une œuvre dont le personnage essentiel n’est pas celui que l’on croit, Tom Cruise, et dont le sujet n’est pas, de même, celui qu’ont brillamment analysé les sots : le portrait d’un tueur. Non, le personnage essentiel est le chauffeur de taxi, Max (Jamie Foxx), et le sujet du film est aussi, inscrit visuellement dans ses images finales (les intellos parleront de discours intra-diégétique), sa lente décantation, je dirais, sans mauvais jeu de mots, son «épuration» qui, à mon sens, est restée incomplète puisque le chauffeur a sauvé une femme (Jada Pinkett) du tueur, femme qui était sa dernière cible, femme avocate que Max a embarquée fortuitement dans son taxi lors des toutes premières images du film. La boucle est donc imparfaitement bouclée. Ces deux fuyards, Max et l’avocate, voilà qui est encore trop puisqu’un seul aurait dû rester, sujet du film et de l’intérêt du tueur : le chauffeur. Mann se trompe donc. Après la mort du tueur – dont le geste banal me fait songer à la façon dont le dernier répliquant «s’endort», laissant Deckard désemparé –, il eût fallu que Jamie Foxx s’asseye en face de celui qui, d’une façon rien moins que métaphorique, a révélé son propre courage, l’a révélé en un mot et que l’un en face de l’autre, ils filent ainsi vers une destination inconnue, avalés tous deux par l’immense ville même si, je le concède, la fin choisie par Mann fait immédiatement songer à celle d’un autre fuyard, le blade runner, accompagné d’une femme lui aussi. De sorte que, pour le chauffeur de taxi, le tueur qu’il embarque n’est qu’une figure de son destin, mieux même, j’ose le terme : il est son double (double dédoublé puisque le tueur de Collateral rappelle, par son costume même, le De Niro de Heat), son âme secrète, matérialisée peut-être par le trot craintif d’un coyote que le chauffeur de taxi épargne.
J’ai dit que le sujet du film était la révélation d’une figure, celle du chauffeur de taxi. C’est vrai dans un sens mais écrire cela c’est encore ne pas renoncer à une analyse somme toute banale, journalistique donc : je vais maintenant plus loin en affirmant que Collateral est une méditation sur l’inhumanité à laquelle, tous, nous sommes réduits face à la vie monstrueuse à quoi la ville moderne nous contraint. Car je suis, comme le chauffeur de taxi Max, un type qui conduit les autres et qui s’efface devant leurs désirs, qui les mène (souvent en bateau…) d’un endroit à un autre puis qui les abandonne à leur médiocre destin, revenant moi-même à la triste grisaille de ma vie quotidienne, de banals rêves de fortune et de gloire. Le tueur est moins, alors, mon âme débarrassée de son masque anonyme qu’une forme extrême de ma volonté, c’est-à-dire, un signe qui m’est adressé pour que je n’aie pas honte de révéler ce que je suis, ange ou bourreau, comme l’avait montré Fight Club. Ainsi, à l’exemple du tueur Vincent qui dialogue avec Max (on songe à John Doe tentant de convaincre le flic joué par Brad Pitt dans Seven), le destin (et pas le hasard) nous réserve à tous, une rencontre capable de nous convertir, au sens étymologique de ce terme qui indique rien moins qu’une refonte de notre personne, un retournement. Max la saisit, ce qui suffit à faire de lui autre chose qu’un médiocre et, en faisant monter dans sa voiture le tueur, est lui-même «embarqué» au sens pascalien du terme. Car le tueur, comme le lui avoue d'ailleurs Vincent, n'est autre que Max : la prophétie se réalisera puisque le chauffeur abattra finalement Vincent, ayant conquis au passage, ce qui n'est tout de même pas rien, une âme vierge ou plutôt : ayant donné naissance à son âme qui restait momifiée jusqu'à cette nuit de toutes les révélations dans la grisaille et la nullité.
Intéressants articles de Paul François Paoli et de Sébastien Lapaque dans Le Figaro littéraire consacrés aux intellectuels de droite. Justes remarques de ce dernier d’ailleurs, expliquant l’incapacité de ces mêmes intellectuels à se fédérer en autre chose qu’un Club virtuel de l’Horloge, aussi influent soit-il… Pendant que les intellectuels de droite pérorent, posent, se défient même en duel (ainsi de Maurras face à Jacques Landau le 7 décembre 1909), les petites taupes vivianesques de la gauche, moins flamboyantes, plus discrètes, creusent sans relâche les innombrables galeries qui leur permettront de s’organiser en réseaux d’influence plus ou moins cachée et de saper ainsi les fondations mêmes d’un pays, La France et d’une culture, judéo-chrétienne qu’ils détestent au fond, fond justement où ils mâchonnent sans fin leur haine.
Il est 10 heures 20 environ au moment où je termine d’écrire ces lignes et mes yeux pleurent de douleur et de fatigue à force de fixer mon écran depuis bientôt quatre heures.
Soudain, me vient cette pensée, que je trouve être parfaitement claire, lumineuse et évidente même si je ne puis en expliquer l'origine : nous sommes tous morts mais… qui est vivant ?
30/09/2004 | Lien permanent
Léon Bloy redivivus

 Pour saluer la réédition en poche de l'impeccable Exégèse des lieux communs (que l'on préférera de loin à sa récente mouture sous la plume de Jacques Ellul) dans la collection Petite bibliothèque de Rivages Poche, je remets en ligne un vieil article de critique consacré à l'édition en deux volumes du Journal de Léon Bloy par Pierre Glaudes.
Pour saluer la réédition en poche de l'impeccable Exégèse des lieux communs (que l'on préférera de loin à sa récente mouture sous la plume de Jacques Ellul) dans la collection Petite bibliothèque de Rivages Poche, je remets en ligne un vieil article de critique consacré à l'édition en deux volumes du Journal de Léon Bloy par Pierre Glaudes.Léon Bloy, Journal 1 (Le Mendiant ingrat, Mon Journal, Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne, L'Invendable) et 2 (Le Vieux de la Montagne, Le Pèlerin de l'Absolu, Au seuil de l'Apocalypse, La Porte des Humbles), édition établie et annotée par Pierre Glaudes, Robert Laffont, coll. Bouquins.
La réédition du Journal de Léon Bloy a été un événement et continue de l’être, non pas tant pour la poignée de lecteurs perspicaces qui avaient pu en lire le texte, en quatre volumes, procuré par Joseph Bollery au Mercure de France, que pour les nouveaux lecteurs que va toucher sans aucun doute la large diffusion dont bénéficient les titres de la collection Bouquins. Guy Schoeller, directeur de cette excellente collection, est un
 homme éclectique, capable de promouvoir les oeuvres d'auteurs du Moyen Âge, d'Edgar Poe ou de Lovecraft, des sœurs Brontë ou même de Léon Daudet, le fils prodigue d'Alphonse, crétin que ne goûtait guère Bloy, l'auteur de Tartarin ayant prétendu un jour ne pas connaître le Mendiant ingrat, sur lequel se refermait lentement la porte étanche de la conspiration universelle du silence. Pour sa part, Pierre Glaudes, responsable de cette nouvelle édition (plutôt que réédition, puisque ce texte a bénéficié de la publication du premier volume du Journal inédit de Bloy, chez L'Âge d'Homme), est un très grand spécialiste de l'auteur de L'Âme de Napoléon, qu'il préface ici superbement et très finement (1).
homme éclectique, capable de promouvoir les oeuvres d'auteurs du Moyen Âge, d'Edgar Poe ou de Lovecraft, des sœurs Brontë ou même de Léon Daudet, le fils prodigue d'Alphonse, crétin que ne goûtait guère Bloy, l'auteur de Tartarin ayant prétendu un jour ne pas connaître le Mendiant ingrat, sur lequel se refermait lentement la porte étanche de la conspiration universelle du silence. Pour sa part, Pierre Glaudes, responsable de cette nouvelle édition (plutôt que réédition, puisque ce texte a bénéficié de la publication du premier volume du Journal inédit de Bloy, chez L'Âge d'Homme), est un très grand spécialiste de l'auteur de L'Âme de Napoléon, qu'il préface ici superbement et très finement (1). Quoi qu'il en soit, la lecture ou la relecture de cette œuvre grandiose est un séisme dans le monde lilliputien des actuelles productions littéraires. Car allez donc faire un tour au supermarché littéraire d'une quelconque FNAC, afin de vous délecter du spectacle : au rayon des nouveautés, le portrait de Bloy semble fixer les auteurs racoleurs qui osent étaler leurs œuvres infectes près de son Journal de l'âme, et réduire leur verbiage aigre à un mince filet limoneux, qui s'évaporera sous la chaleur de l'astre bloyen, dont le spectre étonne encore les spécialistes. De la dureté, de l'ironie, de la fureur, de l'imprécation, de la grâce, une soif furieuse de Dieu, du désespoir et de la misère, voici donc les éléments lourds qui composent l'étonnante singularité astronomique, effondrée sous son propre poids, comme s'il s'agissait d'un de ces trous noirs invisibles. Mais l'astre lourd, l'étoile super-massive a un autre secret : tous ces éléments exotiques éclairent les somptueuses drapures de la nébuleuse de l'Aigle qui, en réfléchissant leur lumière acérée, fait baigner dans ses vaporeuses dentelles les jets âpres de l'écriture bloyenne.
 C'est que, le croirez-vous, la violence, chez cet auteur, n'est pas première ; le sont en revanche le regret, l'imprescriptible nostalgie du royaume perdu, mais surtout, l'attente – énorme, puisque ses cris résonneront jusqu'à la dernière heure de Bloy, mort le 3 novembre 1917 – du retour de l'homme providentiel, saint ou démon, ange ou bête dont Le Salut par les Juifs nous donne le saisissant et mystérieux portrait, qu'un instant, Bloy, compagnon d'une prostituée (dans le milieu des années 1880) du nom d'Anne-Marie Roulé qu'il convertit et qui lui donna en échange la clé des visions qui allaient la faire sombrer dans la folie, pensera n'être autre que lui-même. C'est le secret de Bloy, éventé en partie par le verbiage paraclétien de Huysmans dans son Là-bas, néanmoins aussi impénétrable que celui de Kierkegaard, l'un et l'autre ayant déchaîné une folie de commentaires plus ou moins intelligents. Quoi qu'il en soit, la nostalgie de Bloy est une attente, ou plutôt, elle est ce que je pourrais appeler la nostalgie du futur, puisque pour l'auteur le temps qui gouverne nos destinées n'est rien de plus qu'une illusion du Démon, qui a figé le monde immédiatement après la Faute. De sorte que la lecture de son Journal, j'expose ce paradoxe révélateur de l'exégèse bloyenne, lecture faite par l'un de nos lecteurs qui sans doute n'a jamais rien su de Bloy jusqu'à ce qu'il parcoure ces lignes et qu'il en sorte retourné comme un gant, a peut-être favorisé, dans sa lutte contre les Anglais, les efforts de la Pucelle ou ceux du géant Napoléon, ou peut-être même, j'ose cette folie, a permis la naissance de Bloy à la vie érémitique et prophétique qui fut la sienne, ou encore, a permis que tel illustre mécréant, au soir de sa vie impie, trouve enfin le repos consolateur.
C'est que, le croirez-vous, la violence, chez cet auteur, n'est pas première ; le sont en revanche le regret, l'imprescriptible nostalgie du royaume perdu, mais surtout, l'attente – énorme, puisque ses cris résonneront jusqu'à la dernière heure de Bloy, mort le 3 novembre 1917 – du retour de l'homme providentiel, saint ou démon, ange ou bête dont Le Salut par les Juifs nous donne le saisissant et mystérieux portrait, qu'un instant, Bloy, compagnon d'une prostituée (dans le milieu des années 1880) du nom d'Anne-Marie Roulé qu'il convertit et qui lui donna en échange la clé des visions qui allaient la faire sombrer dans la folie, pensera n'être autre que lui-même. C'est le secret de Bloy, éventé en partie par le verbiage paraclétien de Huysmans dans son Là-bas, néanmoins aussi impénétrable que celui de Kierkegaard, l'un et l'autre ayant déchaîné une folie de commentaires plus ou moins intelligents. Quoi qu'il en soit, la nostalgie de Bloy est une attente, ou plutôt, elle est ce que je pourrais appeler la nostalgie du futur, puisque pour l'auteur le temps qui gouverne nos destinées n'est rien de plus qu'une illusion du Démon, qui a figé le monde immédiatement après la Faute. De sorte que la lecture de son Journal, j'expose ce paradoxe révélateur de l'exégèse bloyenne, lecture faite par l'un de nos lecteurs qui sans doute n'a jamais rien su de Bloy jusqu'à ce qu'il parcoure ces lignes et qu'il en sorte retourné comme un gant, a peut-être favorisé, dans sa lutte contre les Anglais, les efforts de la Pucelle ou ceux du géant Napoléon, ou peut-être même, j'ose cette folie, a permis la naissance de Bloy à la vie érémitique et prophétique qui fut la sienne, ou encore, a permis que tel illustre mécréant, au soir de sa vie impie, trouve enfin le repos consolateur. L'écriture de Bloy qui se moque du temps comme elle se moque de la racoleuse modernité et de ses corollaires assassins que sont l'idée de progrès, de réussite sociale et de morale, je pourrais la définir comme une gigantesque entreprise de déchirement du voile. En effet, le temps n'est rien, mais le Mal aussi, pourtant déchaîné dans le paroxysme de la Première Guerre que Bloy ne pense être que le prodrome de la Grande Tribulation qui se prépare, mais, tout autant, la raillerie des hommes, leur mépris, la haine que les contemporains de l'écrivain déversèrent à gros bouillon saumâtre sur la tête de ce pèlerin du Silence. Les mépris de Léon Bloy
 sont devenus légendaires, ainsi que ses pages flambantes d'une haine surnaturelle contre Huysmans – un temps son ami –, Péladan, Bourget ou Zola qui fut, aux yeux de l'auteur du Désespéré, le puits de toutes les avanies, l'immense loupe concentrant dans le foyer de son coffre-fort les rayons d'une gigantesque sottise alliée aux mérites d'un flair boutiquier sans pareil.
sont devenus légendaires, ainsi que ses pages flambantes d'une haine surnaturelle contre Huysmans – un temps son ami –, Péladan, Bourget ou Zola qui fut, aux yeux de l'auteur du Désespéré, le puits de toutes les avanies, l'immense loupe concentrant dans le foyer de son coffre-fort les rayons d'une gigantesque sottise alliée aux mérites d'un flair boutiquier sans pareil. C’est de cette haine parfois involontairement drôle, mais aussi de cette grandeur de vue, de ce génie de l'écriture (avec et sans majuscule), je pèse mes mots, qui fut probablement unique dans l'histoire des Lettres, que Jean-René Huguenin est né (celui, pamphlétaire et logocrate, du superbe Journal), mais aussi, mais bien sûr, Georges Bernanos, qui lui dédia un texte émouvant (Dans l'amitié de Léon Bloy) après avoir découvert la prose de ce Georges Darien apostolique dans les tranchées de l'Avant, où il pataugeait en regardant fixement la prunelle furieuse de son abbé Donissan. Sébastien Lapaque ou même Philippe Muray, mais également Marc-Édourad Nabe, qui l’a lu et oublié au milieu de sa collection de préservatifs, se réclament d'une aussi noble lignée, bien qu'ils n'égalent d'aucune façon la hargne de cet imprécateur né, qui écrivait, le 3 septembre 1893 : «Ma colère est l'effervescence de ma pitié...». Que voulez-vous, ces écrivains de talent (je répète que Nabe se galvaude complaisamment depuis son dernier roman, Printemps de feu) de même que tous les surgeons frénétiques se réclamant du Vieux de la montagne, aussi sincères qu'ils paraissent, auraient bien de la peine à fouailler les profondeurs d'une âme aussi véhémente que celle de Bloy, écrivant, le 19 mars 1900, dans le second volume de son Journal : «Je ne sens rien en moi que la présence, à une profondeur où je n'ose descendre, d'un sombre lac de douleurs dont les vagues me submergeront peut-être à l'heure de mon agonie». Applaudissant ce Lacordaire à la muflerie incandescente, Kafka comparait Bloy aux prophètes du vieil Israël qui secouaient leurs pieds harassés par la marche dans les déserts sur le seuil des demeures riches et avares de la Parole, en plaçant toutefois ces dangereux contempteurs de la lâcheté du Peuple élu dans les rangs des admirateurs, donc des débiteurs de Bloy. Borges, lui, génial et subtil entomologiste, écrivain pourtant au nadir de ce zénith de violence qu’est l’auteur des Histoires désobligeantes, déclarait le goûter plus qu'aucun autre, avec Carlyle et Poe.
 Mais qu'importent, au demeurant, les paternités spirituelles, qui constituent la trame réelle du monde invisible et qu'importe encore que je rapproche Bloy d'autres noms, qu'il goûta et tenta de propager dans les ornières des consciences de ses contemporains, le plus souvent engorgées par les immondices et la plus veule des médiocrités : Barbey d'Aurevilly qui fut son mentor littéraire, Villiers de L'Isle-Adam qu'il aima jusqu'à la mort misérable de l'auteur des Contes cruels, Lautréamont qu'il découvrit presque le premier, Ernest Hello qui fut son frère en souffrance et en génie : cette poignée d’écrivains et quelques autres moins connus furent les vrais compagnons du splendide vociférateur. C'est que Bloy, comme n'importe quel autre grand écrivain, est un inclassable. Le cliché fuligineux et stupide d'un Bloy antisémite (2) et réactionnaire traîne dans toutes les urinoirs de la bêtise irréparable. Sur la première fausse critique, laissons l'auteur du Salut par les Juifs répondre dans l'une de ses lettres : «L'antisémitisme, chose toute moderne, est le soufflet le plus horrible que Notre-Seigneur ait reçu dans sa Passion qui dure toujours ; c'est le plus sanglant et le plus impardonnable, parce qu'il le reçoit sur la Face de sa Mère de la main des chrétiens». Sur la seconde, pour les petits desservants qui fréquentent – encore – les cercles étriqués de l'Action Française, Bloy est sans aucune ambiguïté lorsqu'il écrit des catholiques monarchistes, dans ses remarquables Méditations d'un solitaire en 1916, «qui rêvent de je ne sais quelle restauration de la vieille bâtisse royale, où une niche à chien de garde serait offerte à Notre Seigneur Jésus-Christ», qu'ils sont à ranger dans le même sac – celui de la plus crasse nigauderie – que les prélats ralliés lesquels, comme le cardinal-archevêque de Paris, Mgr Amette, déroulent un tapis rouge (c'est le cas de le dire !) aux partisans de l'Union Sacrée : une fois la guerre terminée et gagnée, la République qu'ils idolâtres naïvement saura répondre convenablement à leurs rêves sots d'entente cordiale. Ces pitoyables socialistes de la Grâce font partie, selon l'auteur (23 septembre 1910, Le Pèlerin de l'Absolu), du «monde religieux moderne s'efforçant […] de prolonger un passé défunt dont Dieu ne veut plus».
Mais qu'importent, au demeurant, les paternités spirituelles, qui constituent la trame réelle du monde invisible et qu'importe encore que je rapproche Bloy d'autres noms, qu'il goûta et tenta de propager dans les ornières des consciences de ses contemporains, le plus souvent engorgées par les immondices et la plus veule des médiocrités : Barbey d'Aurevilly qui fut son mentor littéraire, Villiers de L'Isle-Adam qu'il aima jusqu'à la mort misérable de l'auteur des Contes cruels, Lautréamont qu'il découvrit presque le premier, Ernest Hello qui fut son frère en souffrance et en génie : cette poignée d’écrivains et quelques autres moins connus furent les vrais compagnons du splendide vociférateur. C'est que Bloy, comme n'importe quel autre grand écrivain, est un inclassable. Le cliché fuligineux et stupide d'un Bloy antisémite (2) et réactionnaire traîne dans toutes les urinoirs de la bêtise irréparable. Sur la première fausse critique, laissons l'auteur du Salut par les Juifs répondre dans l'une de ses lettres : «L'antisémitisme, chose toute moderne, est le soufflet le plus horrible que Notre-Seigneur ait reçu dans sa Passion qui dure toujours ; c'est le plus sanglant et le plus impardonnable, parce qu'il le reçoit sur la Face de sa Mère de la main des chrétiens». Sur la seconde, pour les petits desservants qui fréquentent – encore – les cercles étriqués de l'Action Française, Bloy est sans aucune ambiguïté lorsqu'il écrit des catholiques monarchistes, dans ses remarquables Méditations d'un solitaire en 1916, «qui rêvent de je ne sais quelle restauration de la vieille bâtisse royale, où une niche à chien de garde serait offerte à Notre Seigneur Jésus-Christ», qu'ils sont à ranger dans le même sac – celui de la plus crasse nigauderie – que les prélats ralliés lesquels, comme le cardinal-archevêque de Paris, Mgr Amette, déroulent un tapis rouge (c'est le cas de le dire !) aux partisans de l'Union Sacrée : une fois la guerre terminée et gagnée, la République qu'ils idolâtres naïvement saura répondre convenablement à leurs rêves sots d'entente cordiale. Ces pitoyables socialistes de la Grâce font partie, selon l'auteur (23 septembre 1910, Le Pèlerin de l'Absolu), du «monde religieux moderne s'efforçant […] de prolonger un passé défunt dont Dieu ne veut plus».Oui, comme Léon Bloy, terrible vivant au milieu des morts, plus vivant que les milliers de masques qui monologuent perpétuellement dans les caves de notre vieux pays, paraît décidément les précéder d’une perpétuelle longueur, eux qui, comme ils sont d’une pathétique mauvaise foi, ne lui pardonneront jamais cette offense.
Notes
(1) Je relève toutefois une étrange erreur, page 42 de son Introduction ; parlant de l'Inconnu que Bloy a attendu tout au long de sa vie, Pierre Glaudes écrit : «Ce personnage sublime, qui ne peut être saisi que par la négation ou par l'indéfini, relève à l'évidence de la logique du neutre, qui est proprement celle de l'utopie». Non ! Cette tentative n'est pas celle qui déboucherait sur une espèce d'entité politico-surnaturelle neutre, mais celle, apophatique, qui tente de focaliser l'attention des lecteurs sur le paradoxe absolu, c'est-à-dire l'alliance rigoureuse du oui et du non. Le neutre n'exige jamais le saut dans la foi qui, selon Kierkegaard, dénouait seul le nœud gordien de la catégorie du paradoxal.
(2) Sur cette question douloureuse et difficile, qui semble toujours résister aux hâtives lectures d’auteurs tels que Éric Marty (voir son pourtant corrosif Bref séjour à Jérusalem), une excellente mise au point nous est donnée par l'article de Denise Goitein, Léon Bloy et les Juifs, Cahier de l'Herne Léon Bloy, n° 55, (éditions de l'Herne, 1988), pp. 280-294.
11/05/2005 | Lien permanent
En attendant la fin du monde de Baudouin de Bodinat

 Cette note, à l'origine, constituait le premier volet d'un triptyque. Je n'ai apporté que quelques menues corrections de forme au texte initial.
Cette note, à l'origine, constituait le premier volet d'un triptyque. Je n'ai apporté que quelques menues corrections de forme au texte initial. Acheter En attendant la fin du monde sur Amazon.
Acheter En attendant la fin du monde sur Amazon.Quelque chose me gêne dans le dernier texte de Baudouin de Bodinat, En attendant la fin du monde paru chez Fario, un éditeur aussi discret qu’intéressant qui a d’ailleurs publié, en livre ou en revues, plusieurs textes du grand Sebald. Bien avant Baudouin de Bodinat, ce dernier avait pour coutume de proposer des textes comprenant des photographies ayant une signification directe, ou bien indirecte mais pas moins flagrante, avec le récit proposé. Mais, là où l’auteur de Vertiges n’en finissait pas de suivre une piste que lui seul savait pouvoir suivre, en déployant une écriture aussi attentive aux plus extrêmes détails que capable d’attirer notre attention sur les correspondances subtiles existant entre les cercles concentriques s’étendant depuis un abîme de noirceur, Baudouin de Bodinat ne nous mène nulle part et même, comble de l’ironie, nous laisse sur place.
Ce quelque chose qui me frappe puis, dans le même mouvement ou presque, me gêne dans le livre de Baudouin de Bodinat qui eût pu s’intituler Petit précis de phraséologie à usage réactionnaire, c’est rien de moins que l’écriture même de l’auteur. Sa structure n’est que faussement complexe, puisqu’elle est décomposable en un usage monomaniaque de participes présents et d’infinitifs qui sont moins enchaînés que juxtaposés et nous donnent ainsi l’impression d’un emboîtement de phrases entre parenthèses et d’incises s’étendant avant qu’un point final ne vienne, passagèrement du moins – avant une nouvelle explosion obéissant au même principe de gonflement irrésistible – clore cette expansion qu’on dirait invincible, et qui ne semble devoir faire halte que lorsqu’elle est figée par une photographie de rue déserte de village perdu, photographies prises, nous dit-on, par le biais de pellicules périmées, et qui apportent un contrepoint utile, par leur extrême dépouillement et même pauvreté volontaire, aux tortillements des phrases butant sur des rues désertes, où sont banalement garées des voitures banales, sous un ciel bleu lui-même insignifiant, ou bien «sous le ciel diffus; ou quand l’été s’étiole, se perd en rêverie du proche automne» (p. 68). Michel Houellebecq, désormais considéré comme un photographe, eût montré plus de volonté d’enjoliver le vide d’une bourgade de province où rien ne se passe, «moindre ville de province indécise» comme l’écrit l’auteur, mais c’est justement de cette volonté que Baudouin de Bodinat se tient éloigné, aussi sûrement qu’il se tient éloigné, du moins c’est ce que l’on veut nous faire croire (et, pour m’amuser, je l’imagine envoyer par courriel son manuscrit à son éditeur, ou bien, plus désuet encore, en l’enregistrant sur une clé USB) d’un des moyens modernes de communication par lesquels l’essence de notre monde, s’il n’a pas complètement plié bagage comme l’aura selon Walter Benjamin, se dilue et dissout. C'est donc moins la fausse complexité du style de Baudouin de Bodinat que la maigreur des résultats obtenus : quoi, tant d'incises, d'escaliers embranchés sur des escaliers, tant de portes ouvertes pour nous mener dans une cabane pas même débranchée mais équipée d'un ordinateur dernier cri et bien sûr d'une connexion, depuis laquelle nous pouvons envoyer notre texte soulevé d'une indignation qu'un livre de Jacques Ellul, qu'une ligne de Gustave Thibon eût aisément concentrée.
Une seule fois, à la dernière page de son livre, cette écriture syncopée, comme désireuse de mimer la froideur minérale ou plutôt machinale de notre modernité décriée, une seule fois l’écriture de Baudouin de Bodinat se risque à ne pas ahaner mais à s’élancer en trois phrases qui n’en sont qu’une et qui annoncent ce que d’autres livres, ceux qui suivront peut-être, auront à charge d’explorer, «cette transparence où quelque chose en soi semble sur le point de s’ouvrir et tout réconcilier» (p. 70). J’exagère, car ce village, lieu de la déambulation photographique de l’auteur, apparaissait dès les premières lignes sous la forme de tel «vieux quartier de ce gros bourg», mais aussi du beffroi demeurant «inflexible à égrener les heures» (p. 12) comme s’il fallait, pour que la banderole des récriminations de Baudouin de Bodinat soit déployée au-dessus de nos têtes diantrement modernes, qu’elle soit plantée entre deux piquets champêtres d’un de ces lieux, si communs dès que nous quittons les grandes villes, si communs qu’ils ne peuvent que nous faire suspecter que c’est le texte lui-même de l’auteur qui est une série de clichés, et sa volonté d’encadrer de simplicité (prétendument) provinciale voire paysanne un texte savant.
Cliché du cadre bucolique où le dernier sage attend la catastrophe qui vient, la catastrophe qui est déjà là plutôt, la catastrophe qu’il est trop tard pour éviter mais non point pour déplorer, ce sera un livre de plus pour les journalistes après tout. Clichés que tous ces termes, parfois des trouvailles heureuses, mais noyées dans une foule d’autres termes rapidement entrechoqués, que l’on dirait avoir été moins inventés que méthodiquement alignés par un Renaud Camus qui n’aurait pas complètement perdu le sens de la phrase et saurait, partant, que son empilement de «que» et de «&» n’a d’autre sens que se fondre dans le silence minéral d’une fin d’après-midi de bourg oublié, autant de piquets devant lesquels toutes les vaches journalistiques vont venir mâcher leur ration de lieux communs agrémentés d’un peu de fortifiant aux hormones, «sage expansif» (p. 11), «édifice social», «radiovision» ou «optiphone» (p. 12) plusieurs fois répétés, «sonorisation distractive» (p. 13), «économie d’exploitation et de pillage» (p. 17), «économie concurrentielle» (p. 23) ou encore, et ce sont les trouvailles dont j’ai parlé, «hypoxie spirituelle» (p. 57), «dégénérescence maculaire de la conscience» (p. 58), «lumignons [qui] filent, s’étouffent et puis charbonnent» (p. 18), comme si l’auteur, sur lequel tant de spéculations courent, pour gagner sa vie avant que le Septième Sceau ne rende définitivement caducs ses efforts de vigie, officiait en tant que rédacteur des débats et par ce biais alimentait son lexique professionnel de tous les termes entendus lors de réunions de Conseil d’Administration ou de Comité d’Entreprise, sans oublier celles des CHSCT, ou Comités d’hygiène et de sécurité au travail.
Nous ne sortons guère quoi qu’il en soit, écriture savante et même précieuse ou pas, plates photographies suintant l’ennui et choisies pour cette raison, de la réaction, au sens le plus commun et banal du terme, long ver cavernicole dont Renaud Camus tiendrait la queue translucide et Alain Finkielkraut la tête aveugle (à moins que ce ne soit l’inverse, pour éviter toute allusion graveleuse dont on me supposerait coupable) en passant par Éric Zemmour, la poissonnière de Causeur et toute la clique piaillante des oisillons martiaux recevant la becquée dans le nid de L’Incorrect, de l’indigent écrivant Yrieix Denis écrivant avec un organe par lequel tout mammifère expulse ce dont son corps n’a pas besoin jusqu’à Matthieu Baumier écrivant avec les pieds de Philippe Sollers, en passant par Romaric Sangars qui, lui, aimerait bien écrire avec sa main et doit se contenter d’un moignon d’esthète gourmé, sans oublier le légendaire phénix de ces hauts lieux de la consanguinité Jacques de Guillebon qui, lui, n’écrit avec rien du tout mais remplit quand même des pages entières de ses fulminations apoplectiques d’adolescent brûlé par la vision du Buisson ardent et qui doit je le suppose beaucoup aimer les textes de Baudoin de Bodinat, pour cette exquise raison que l’auteur lui donne des mots bien frappés, journalistiques donc, qu’il pourra citer dans ses revues de presse nulles.
C’est finalement peut-être cela qui manque au maniéré Baudouin de Bodinat, l’un des plus récents surgeons de ce que Julien Benda appelait le byzantinisme, sorte de croisement puissant mais instable entre le matois pessimiste Michel Houellebecq et le remarquable Jaime Semprun qui a tout dit avant lui, et dans des phrases dont la mordacité le dispute à la perfection, c’est cela qui manque à l’auteur de La Vie sur Terre, la simplicité militante d’une foi farouche, de charbonnier si l’on veut bien que cette honorable profession n’existe plus en France ni même, sans doute, en Europe, une ligne de basse en somme à son chant trop travaillé pour être autre chose que l’un des rhizomes surprenants mais point aberrants de la modernité qu’il décrie à longueur de phrase à enchâssements se voulant antimodernes et n’étant que l’extrême proue du navire rutilant mais aveugle sans son pesant barda électronique qu’est notre époque terminale. Ligne de basse qui, comme «le beffroi [qui] demeure inflexible à égrener les heures» (p. 12), permettrait à Baudouin de Bodinat de ne point se contenter de se lamenter sur le monde comme il ne va plus du tout mais accepterait de souffrir pour lui et, d’une certaine façon absolument scandaleuse, kierkegaardienne, évangélique, le rachèterait. Pour le dire encore plus simplement, et je m’étonne que Sébastien Lapaque, d’habitude si attentif à détecter les failles les plus intimes, ne l’ait pas vu, Baudoin de Bodinat est un homme, du moins un auteur triste, à la différence des deux autres que nous allons évoquer, Matthieu Grimpret et le fou écrivant qu’est Eduardo Castellani. Il manque à Baudouin de Bodinat une échappée que laissent entrevoir, je l’ai dit, les toutes dernières lignes de son texte mélancolique et peut-être même désespéré, un solide maillet pour entamer l’édifice coruscant de tant de phrases qui l’emprisonnent : «& aussi que peut-être tout le monde se doute qu’au point où en sont les choses (en vision cavalière, ou aérienne à survoler ces périphéries de lotissements, de banlieues informes qui vont s’épaissir en entassements chaotiques d’habitations et de fonctions urbaines, et ainsi de suite à perte de vue recouvrant la Terre de cette densité de peuplement en survie assistée), c’est tout simplement sans solution. Sans plus aucun moyen pour l’espèce humaine de se dégager de ce piège où elle est entrée et qui la tient» (p. 59).
23/09/2018 | Lien permanent
Il n'y a que la mauvaise presse qui sauve ou Philippe Muray ressuscité
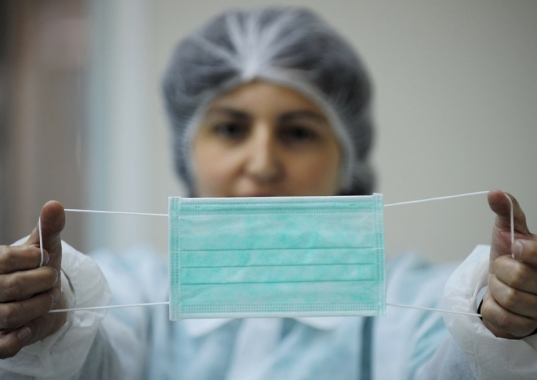
Philippe Muray.
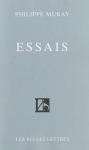 À propos de Philippe Muray, Essais (Éditions Les Belles Lettres, 2010).
À propos de Philippe Muray, Essais (Éditions Les Belles Lettres, 2010). Elias Canetti, fraîchement récompensé par le prix Nobel de littérature, eut à cœur de railler l'incurie des éditeurs et des journalistes de son propre pays : les premiers parce qu'ils avaient laissé son œuvre dans l'ombre en ne rééditant pas ses livres, les seconds parce qu'ils se précipitèrent sur ces derniers, les picorant (ou plutôt s'entreglosant) sans bien sûr les lire.
Lui qui avoua sa fascination et sa répulsion pour le grand Karl Kraus, retrouva même quelque peu de l'ire vindicative du fameux et terrifiant polémiste durant cette période bénie ou maudite, c'est selon, pendant laquelle les médiocres durent prendre un ticket numéroté et faire la queue en attendant le bon plaisir du maître désormais incontournable et bien trop visible pour qu'on puisse continuer à faire taire sa voix subtile et puissante. Il tenait, en somme, sa revanche sur les cuistres. Il était vivant. Philippe Muray, lui, ne l'est plus.
Nous ne sommes jamais assez durs avec les journalistes, c'est peut-être ce que découvrit aussi, avec un peu de stupeur tout de même, Elias Canetti. Leur médiocrité est toujours un cran au-dessus (ou au-dessous, c'est affaire de perspective) de celle que, par compassion plus qu'ignorance, nous avions cru être le maximum qu'un être humain pût supporter sans se dissoudre instantanément. Comme les créatures des très grandes profondeurs sous-marines, les journalistes se sont adaptés à des pressions extrêmes, n'ont pas besoin de lumière, se nourrissent des déchets qui lentement glissent vers leurs petites bouches translucides et, pour certains, parviennent même à écrire sans avoir, une seule fois, pris la peine de remuer leurs branchies atrophiées.
Tous ont beau ne pas être les résidents de la fosse dite de Marianne, ils n'en sont pas moins extrêmophiles, comme disent les biologistes qui paraissent tous les jours découvrir de nouvelles espèces de ces monstres mous habitués à l'obscurité la plus impénétrable. Vivants, ils sont morts car, à de pareilles profondeurs, toute dépense d'énergie inutile peut être létale. Ils végètent, ils planctonnisent, ils regardent parfois, de leurs gros yeux globuleux et aveugles, le ciel impénétrable et très profondément noir qui tend sa gueule au-dessus d'eux.
Vivants, s'agitant, ils sont déjà morts et se nourrissent de la chair de certains morts, mille fois plus vivants qu'eux.
Voyez-les, tous ces imbéciles claironnants et demi-soldes boulevardiers qui découvrent Philippe Muray quelques années seulement, ce n'est déjà pas si mal me dira-t-on, après sa mort, et encore, pressés qu'ils sont d'écrire leurs petits articulets navrants et incultes pour ne pas paraître en reste de ceux de leurs confrères, bluettes elles-mêmes incultes et creuses, voyez-les qui rédigent des papiers tellement originaux que le plus scrupuleux des experts en faux ne pourrait établir aucune différence entre eux. Ils s'agitent. Ils frétillent. Ils bavardent. Ils ne créent rien, car ils sont morts bien que vivants, et le règne des morts-vivants est une constante mais inéluctable pétrification, comme nous le voyons dans l'étonnant conte de Michel Bernanos. Il y a plus de différences entre deux ouvrières d'une termitière japonaise qu'entre deux journalistes qui partagent la même table de restaurant, rêvent de partager la même maîtresse et, quoi qu'il en soit, défendent les mêmes idées, c'est-à-dire celles qui sont l'émanation de l'air du temps.
Même le très gauchi et bientôt centenaire Jean Daniel, m'a-t-on dit, s'est subitement mis à trouver du génie à son illustre cadet contempteur, Philippe Muray, promettant à son fantôme ironique de sonner l'hallali, le derrière vissé sur sa bréhaigne, pour une cavalcade poussive de quelques centimètres sur les pâtures du lieu commun. Il ne sera pas dit que l'illustre Jean Daniel a méprisé, du moins après son trop court séjour sur terre, Philippe Muray.
Élisabeth Lévy elle-même, inflexible Cassandre du marronnier réactionnaire plutôt que du scoop véritable, causeuse lassante y compris même lorsqu'elle consent à vous laisser parler, journaliste point trop inintéressante tout de même lorsqu'elle écrit plutôt qu'elle bavarde, ronchonneuse professionnelle qui a réussi à faire reconnaître aux services de l'État la profession de mouche du coche, moderne incarnation d'une Amazone de toute éternité contrariée et peut-être même de tous les dangers réunis de la sauvage Amazonie ou de ce qu'il en reste, walkyrie miniaturisée du verbe journalistique qui ne rate jamais une occasion de se prétendre femme jusqu'aux bouts de ses flèches enduites de curare et d'affirmer qu'elle ne doit rien aux hommes (pas même sa propre naissance, référence faite à une conversation animée, désormais ancienne, en présence de Maurice G. Dantec), Élisabeth Lévy en personne n'a pas eu assez de mains et de pieds pour serrer tous ceux de ses collègues journalistes masculins lors de telle récente soirée privée (ce mardi 21 septembre vers 18 heures, au Lucernaire, un restaurant naguère fréquenté par Muray) où elle but les paroles de Fabrice Luchini, pas franchement dupe du cirque qui l'entourait et même, bien que disert et aimable, étrangement réservé.
Bien évidemment, unique couac (ou peu s'en faut) dans cette magnifique symphonie en culbute majeure, j'aurais quelque mauvaise grâce à ne point saluer le mystérieux regain d'intérêt dont paraissent (restons prudents) bénéficier les livres (en l'occurrence, ses exorcismes spirituels, regroupés en un seul beau volume préparé par Vincent Morch pour les Belles Lettres) de Muray mais enfin, nul ne m'en voudra je l'espère de jeter quelque sonde soupçonneuse dans la flache de cette subite attention, ni même de gentiment moquer le fait que le meilleur livre de cet auteur, le livre même qu'il n'a fait que décliner ou répéter jusqu'à sa mort, je veux bien sûr parler du XIXe siècle à travers les âges, est tout aussi étonnamment absent des meilleures ventes de la rentrée, catégorie essais comme il se doit.
Gageons même que cette si propitiatoire période de ventes d'ouvrages de qualité soit elle-même affublée d'une tare que Philippe Muray avait caractérisée de la façon suivante : «Il n’y a pas de lucidité sans séparation. Il n’y a pas non plus de littérature sans conflit et sans aggravation de conflit» (1).
Nous pouvons tirer deux postulats de cette constatation trempée, comme l'acier, dans un bain d'eau froide. D'abord, puisque nous voici plongés dans la mélasse la plus indifférenciée où gauche et droite se disputent la dépouille aimablement désagréable d'un mort et tentent de convoquer au-dessus de leur table barbante son mauvais génie posthume, le phénomène auquel nous assistons est tout ce que l'on voudra sauf le témoignage d'une miraculeuse prise de conscience, pour ne point évoquer, comme Muray le fait, quelque lucidité qui n'est tout de même pas la vertu la mieux partagée par nos contemporains, surtout s'ils exercent la profession immodeste de journaliste.
Ensuite, puisque ce remarquable et sans contestation possible mélodique accord sur la portée des œuvres de Muray nous a plongés dans le sucre candi des bons sentiments qui creusent, comme des larves de mouches, leur nid douillet dans la dépouille d'un auteur qui fut un redoutable vivant, il y a fort à craindre que la littérature soit, de nouveau l'absente des bouquets de toutes ces fiancées froides qui pleurent la mort d'un fiancé et même celle d'un véritable père, d'un père plus intensément père en ceci qu'il ne présente aucun lien de parenté avec les intéressées.
Pardon, vous me dites qu'il n'y a, encore elle, qu'Élisabeth Lévy qui menace de faire monter le niveau de la Seine à force d'ouvrir les vannes cyclopéennes de ses conduits lacrymaux ? J'ai cru qu'elles étaient au moins un bon millier, ces Antigones s'arrachant de douleur les cheveux et criant sur tous les toits, sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les ondes radiophoniques que c'était bel et bien le corps maltraité de leur propre malheureux frère qui était laissé sous les soleils corrupteurs des flashs des photographes qui, par conscience professionnelle sans doute, se déclarent près à déterrer un cadavre pour voir si sa texture réactionnaire l'a affublé de particularités anatomiques troublantes.
Non, il n'y a sur scène, vérification faite auprès du metteur en scène de notre impeccable et si actuelle tragédie, qu'Élisabeth Lévy mais celle-ci, phénomène qui devrait passionner et intriguer les physiciens de l'étrange et même les frères Bogdanoff, semble posséder la particularité d'être sur plusieurs plateaux d'émissions télévisées en même temps, à seule fin d'y délivrer son message aussi convenu que le bruit d'un coucou d'horloge suisse, prêt-à-consommé de crieuse et gouaille vulgaire de cabaretière éraillée rendant grâce au père, maître, intercesseur, modèle et bientôt bienheureux Philippe Muray d'avoir irrigué de sa sève polémistique les plates-bandes où poussent ses quelques navets journalistiques de si pâle couleur qu'on les confond avec des feuilles de gélatine.
La si brillante et versicolore réacosphère, ce mélange improbable de petits frontistes se planquant derrière des pseudonymes, de gros beaufs avinés commentant, comme le matin ils sont accoudés au zinc et le ballon de blanc faisant cercle sur un exemplaire de SAS, les communiqués immondes, suintant la haine et la peur la plus ignoble, la crispation identitaire autour de belles valeurs gersoises qu'hélas ces lamentables vivandiers de l'action politique véritable n'illustrent guère par leurs écrits, émis, avec un sérieux d'un grotesque inégalé, par le ridicule Parti de l'In-nocence de Renaud Camus, cette si probe congrégation d'évanescents ectoplasmes appartenant, par leur seul corps astral, à la Nouvelle Droite, ce maigre raout de puceaux proches de la quarantaine qui croient sans rire que Kierkegaard, Chesterton, Unamuno et peut-être même le Christ en personne leur soufflent à l'oreille les phrases suintantes de prétention et de vulgarité qui composent leur catéchisme névrosé et enfin ce bordel bien sous tout rapport composé de vieilles demi-mondaines confondant hostie et godemiché et ne se rendant pas compte qu'elles risquent une déchirure anale plutôt qu'une excommunication papale, la réacosphère donc, mutualisation de talents nanométriques et de prétentions himalayesques adore, mais alors là vraiment adore, paraît-il, les textes d'Élisabeth Lévy.
Ce doit donc être, hypothèse la plus sobre, un fameux signe d'excellence. Il est vrai que cette même réacosphère aime immodérément Philippe Muray, qu'elle ne cite d'ailleurs jamais très précisément, se contentant de tirer, sur sa face blême et maladive, un peu de la lumière crue que Muray dirige toujours, avec une cruauté raffinée, sur ses cibles fuligineuses.
Revenons au texte de Muray, qui poursuit, dans le même ouvrage : «Un critique, plutôt que de perdre son temps à analyser tous les romans de néo-sacristains, tous ces livres rédigés avec un style directement trempé dans le préservatif, pourrait s’amuser à les rapprocher de slogans publicitaires connus, montrer qu’ils se ramènent tous à l’une ou l’autre des injonctions récentes de la pub» (p. 13).
Un bon critique, colligeant donc les différents titres qui ont récemment fleuri à propos de la découverte, par de hardis paléontologues, d'un nouveau type humanoïde baptisé Homo festivus festivus (en somme, le sursinge qui prend conscience du fait qu'il fait la fête) en hommage à celui qui en avait théorisé le chaînon clinquant, Philippe Muray, pourrait donc montrer qu'ils ne sont que la forme la plus récente, et déjà parfaitement obsolète, de l'éternelle hydre publicitaire, dont voici quelques têtes sans beaucoup de cerveau : Exorcismes spiritueux pour Philippe Lançon (Libération Livres du 24 juin) qui commence nullement par un «Être de son époque, c'est savoir la détester», Désaccord parfait pour Laurent Lemire (Livres Hebdo du 16 septembre) qui, encore plus stupidement, n'a pas peur de faire hurler de rire ses lecteurs en calant dès son point de badinage : «Il y avait quelque chose de vrai chez Philippe Muray (1945-2006), c'est ce qu'il pensait», Le mieux-disant pour l'inégalable Aude Lancelin (Le Nouvel Observateur, semaine du 22 au 28 juillet), qui bavarde sur Fabrice Luchini, cet interprète de la Modernité qui, non content d'avoir mis Paris à ses pieds, a bel et bien réussi l'exploit de faire courber la nuque si raide de quelques journalistes après leur avoir déclaré qu'il n'était pas plus de droite que de gauche. Quoi d'autre encore, puisqu'il est vrai que même le canard le plus déplumé de France et de Navarre y est allé de sa petite bluette admirative pour Muray, histoire de ne pas rater la curée journalistique et peut-être même, qui sait, d'être repéré par les grosses légumes parisiennes ? Le petit-fils naturel de Georges Bernanos, Sébastien Lapaque, le sobre François Taillandier pour Le Figaro ou sa déclinaison en revue, le si mélomane Benoît Duteurtre (Marianne du 25 septembre) qui fait mine de s'extasier sur les rythmes délicieusement reggae du très oubliable Ce que j'aime ou l'intrusion de Léon Bloy dans la comptine pré-natale, tandis que Pierre Bottura (Philosophie Magazine du mois d'octobre) nous révèle, bien conscient qu'il prend des risques peut-être exagérés, que Philippe Muray était «romancier, essayiste et critique d'art», travail d'enquête tout de même moins poussé que celui de Tristan Savin (pour Lire du mois d'octobre), lequel rend grâce à l'histrion Luchini d'être un histrion. Subtile fausse note, celle émise par Alain Finkielkraut, l'autre père spirituel et intellectuel de notre chère Élisabeth, encore elle, note grinçante bien évidemment recueillie par l'antenne d'Arecibo d'une extrême finesse qu'est notre impénitente journaliste (Causeur numéro du mois de septembre) qui remet le couvert pour Le Point (du 16 septembre) où elle nous apprend que, chez Muray, «jubilation et exécration sont sœurs».
Si je n'avais pas connu les livres de Muray depuis quelques années, ces poussées hormonales imprimées sur papier recyclable m'auraient-elles donné envie de me jeter sur eux ?
Je ne crois pas.
Je suis même certain que non.
Il n'y a pas seulement, hélas, dans la canonisation actuelle dont Philippe Muray est la victime muette, que dévaluation du verbe, ce qui ne doit point nous étonner puisqu'il s'agit là de la plus constante et habituelle production des bouches mécaniques que sont les journalistes. En effet, si, selon notre redoutable polémiste, l'histoire de la littérature est celle des «prospérités de l'irrespect» (p. 250), nous ne pouvons que constater que Philippe Muray n'est point salué comme un véritable écrivain mais, tout au plus, comme un penseur réactionnaire, c'est-à-dire peu ou prou comme un fâcheux en perpétuelle colère contre le monde entier et nageant à contre-courant du fleuve tranquille où la France finit de noyer son ennui vertueux de n'être plus rien.
Puisque le fantôme de Muray est ces derniers temps très sollicité, j'oserai abuser quelque peu de son temps et poursuivre la lecture d'un de ses recueils de textes. Qu'est-ce qu'un bon critique selon Philippe Muray qui doit décidément se tordre de rire en nous observant du coin de l'œil ? C'est en tout premier lieu un esprit qui s'écarte de la foule et ne salue, dans un livre, que son essence la plus profondément romanesque, rien, donc, qui puisse ressembler au charlatanisme actuel consistant à mélanger pseudo-verve et acrimonies habituelles contre l'air du temps. Qu'est-ce dire ? Que Muray place la tâche du critique à une magnifique hauteur, la leste d'une lourde responsabilité. La critique est, ni plus ni moins, une œuvre qui répond à une œuvre. Non point un Du Bos, ni même un Thibaudet ou un Sainte-Beuve mais, tout simplement, tout impossiblement, un Conrad, un Joyce, un Faulkner, un romancier extravagant, un romancier sans roman, un maître du langage second cher à Foucault qui n'aurait pour seule mission que celle de pénétrer les romans qu'il n'a pas écrits, qu'il ne peut pas écrire, avec la souveraine vision de leur propre créateur.
C'est quelqu’un donc, ce critique idéal sinon rigoureusement surhumain, qui ne se considérerait pas comme «un agent culturel destiné à signaler au public des produits culturels (les livres), quelqu’un qui serait donc également un bon critique de la société [apte à devenir] un spécialiste de toute la consternante fantasmagorie qui tend socialement à rendre le roman impossible» (pp. 4-5).
Et Muray de poursuivre en écrivant que : «La connaissance de l’ennemi, la science de l’ennemi des romans, c’est-à-dire de presque tout ce qui se met en place, aujourd’hui, sous nos yeux (y compris dans certains romans, dans ceux que je viens d’évoquer par exemple, les livres de la nouvelle Bibliothèque rose universelle, les romans de l’École des sacristains), voilà ce qui pourrait être le propre de la critique, d’une critique faite dans l’intérêt de l’art romanesque, et non dans le dessein de s’auto-célébrer, de justifier sa propre existence ou carrément de nuire, comme les deux charlatanismes critiques, l’universitaire et le médiatique […]» (p. 14).
Curieux que nul, à ma connaissance du moins, n'ait songé à commenter cette célébration si spontanée et post-mortem du génie de Philippe Muray en l'éclairant par la seule lumière qui en révélerait la part d'ombre. Nous sommes ainsi parvenus au cœur de notre sujet, comme le fantôme de Muray d'ailleurs ne manque pas de nous le confirmer d'un sourire à peine esquissé.
C'est d'ailleurs, une fois de plus, l'auteur lui-même qui nous donne la clé de ce rituel propitiatoire autour d'une tombe encore fraîche, clé qui nous fait retrouver la magnifique ligne de basse qui cimente l'architecture du XIXe siècle à travers les âges. Cette clé est fort commune, qui ouvre pourtant toutes les portes, y compris celles qui sont réputées
13/10/2010 | Lien permanent
L'Imposture de Georges Bernanos

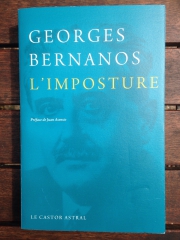 Acheter L'Imposture sur Amazon.
Acheter L'Imposture sur Amazon.S’il est un écrivain qui reste à découvrir, c’est bien Georges Bernanos, comme je l’écrivis pour Famille chrétienne (n° 1589, 28 juin - 4 juillet 2008). Aucune lecture n’a épuisé la formidable richesse de son œuvre, comme je viens de le constater de nouveau, en relisant pour la sixième fois L’Imposture, un roman d’une violence inouïe, une plongée dans la conscience d’un prêtre renégat, absolument unique dans la littérature française, dont je viens d’achever la préface pour Le Castor Astral qui réédite tous les ouvrages du Grand d'Espagne : L'Imposture devrait ainsi paraître durant la seconde quinzaine du mois de juin.
Quel incroyable roman, hélas moins connu que le premier, Sous le soleil de Satan paru en 1926 et, bien sûr, l’admirable Journal d’un curé de campagne. J'espère ne vexer aucun écrivain vivant (à vrai dire, je m'en fiche un peu) mais il me semble parfaitement évident que Bernanos n'a eu aucun héritier direct, hormis, peut-être, sur le versant polémique de son œuvre prodigieuse, Pierre Boutang, et je serai tout à fait incapable de trouver, dans la France contemporaine, un auteur dont les romans atteindraient la puissance hallucinatoire de ceux du Grand d'Espagne.
Quelle apocalypse, en effet, opposer, si ce ne sont les cauchemars d’un Dostoïevski ou d’un Céline, à celle que nous oblige à fixer un auteur ayant contemplé la prodigieuse fermentation du monde moderne de laquelle naquit l’abbé Donissan, sorti des tranchées de la Grande Guerre tout fumant de sang ? Quelle plus parfaite illustration convoquer d’un hermétisme démoniaque, à l’œuvre d’ailleurs dans L’Imposture, qui ne soit celle des plus grands, Shakespeare dans Macbeth, Barbey d’Aurevilly dans Une Histoire sans nom, Gadenne dans Le Vent noir ? Quelle puissance d’évocation du Mal, sous les plumes d'un Ernesto Sabato ou d'un Hermann Broch, pourrait ridiculiser la véritable vision du néant que Bernanos subit puis maîtrise, au prix d’années d’un travail acharné, dans Monsieur Ouine qui est sans doute le plus grand roman français du XXe siècle ? Quel plus farouche contempteur de la lâcheté dresser sur les barricades si ce n’est Bergamín qui salua l’auteur des Grands cimetières sous la lune comme un frère d’armes ? Quel plus formidable peintre de la lumière, surtout lorsqu'elle est intensifiée par des béances de ténèbres, imaginer si ce n’est Rembrandt ?
Georges Bernanos a eu peu de maîtres et encore moins d’égaux, aucun héritier de nos jours je l'ai dit, même s'il existe bien évidemment des romanciers de grand talent, qui sans doute lui doivent une partie de leur souffle, comme Didier Séraffin, Jean Védrines, Sébastien Lapaque et Julien Capron.
Georges Bernanos est ainsi, comme les plus grands écrivains le sont, devant nous.
Intégralité de ma préface, intitulé Les disciplines de l'imposture
C’est par un brutal coup de dague que nous pénétrons dans le deuxième roman de Georges Bernanos, L’Imposture, qui tout entier ressemble à une horrible blessure que l’écrivain semble ne point vouloir refermer. Violence bien réelle puisque, pour le romancier, les batailles de l’âme sont sans doute bien plus brutales que celles que les corps se livrent entre eux. Violence fascinante dont André Malraux, qui admirait Bernanos, se souviendra peut-être en y ajoutant les sucs vite éventés de l’érotisme, lorsqu’il fera s’interroger Tchen devant la fameuse moustiquaire qui lui cache l’homme qu’il faut assassiner, «moins visible qu’une ombre» sous le «tas de mousseline blanche» tombant du plafond. Il s’agit en tout cas de détruire, ici en lardant d’implacable ironie l’esprit d’un pauvre type, Pernichon, qui se joue la comédie et finira par se suicider, là en enfonçant une lame bien réelle dans une chair endormie, avec l’unique volonté de s’en débarrasser de la façon la plus rapide et, si possible, sans bagarre ni bruits, sans faire le plus petit scandale. Un éclair en somme, trouant les ténèbres qui auront vite fait de happer de nouveau les personnages qu’elles ont laissé s’échapper le temps d’une scène mémorable. Bernanos fouaillant la conscience d’un publiciste, puis plaçant sur le chemin nocturne de Cénabre un mendiant qui sera son double misérable; Malraux contractant dans La Condition humaine les muscles de Tchen autant que sa volonté : les grands romanciers semblent être ceux capables de fixer sur le papier des scènes fulgurantes, quitte à tenter ensuite de transformer en véritable orage ces explosions de chaleur sourdes et éphémères.
De fait, la pauvre âme de Pernichon crève sous le regard minéral, tranchant comme un couteau, de celui qui reçoit, avec dégoût et colère, la confidence de son misérable tas de petits secrets et de fautes imaginaires. Cénabre, à la différence de Chevance dont le nom même affirme la bonté et la garde du bien d’autrui, ne veut, lui, absolument rien recevoir des autres, une fois sa curiosité dévorante satisfaite. Dans les premières pages surprenantes de L’Imposture qui, comme une sonde, descendent à très grande vitesse dans les profondeurs de l’âme humaine, Cénabre révèle sa stature puissante de maître à l’ironie complexe, au savoir froid et altier, qui a tenté un pari aussi fou qu’impossible : «écrire de la sainteté comme si la charité n’était pas.» Il n’est assurément point, tel Pernichon, un médiocre qui se donne au plus offrant. Pourtant, quelques subtiles notations nous font vite comprendre que la médiocrité du fameux auteur des Mystiques florentins n’est guère différente de celle que sa pauvre marionnette a senti exploser comme une bulle de gaz sous le feu de son confesseur. Plutôt qu’un véritable imposteur, Cénabre se révèle, pour ainsi dire, un génial médiocre. Il est peut-être même le médiocre par excellence selon Bernanos, en tous les cas l’ébauche la plus convaincante de Monsieur Ouine. En ce miroir déformé qu’est Pernichon, Cénabre a reconnu son propre visage grimaçant de douleur, comme il reconnaîtra dans le mendiant Framboise un double avili, alors qu’il contemplera le mensonge du vagabond «du même regard avide qu’il eût regardé sa propre conscience». En fin de compte, malgré ses livres savants qui tournent autour des vies de saints sans jamais oser pénétrer dans leur cœur, il n’est qu’une pauvre âme fuyant la lumière de sa propre lucidité. Aucun partage possible entre les personnages de Bernanos, Cénabre, Pernichon et le mendiant, mais ce constat est également valable pour bien d’autres ombres parcourant les pages de L’Imposture : tous ces fantômes semblent s’adresser à quelque témoin muet qu’ils implorent secrètement d’une délivrance qui jamais ne viendra.
Que sont donc ces pages qui ouvrent L’Imposture ? Assurément moins une confrontation entre Cénabre et son protégé ridicule, le sordide Pernichon, qu’un combat entre le prêtre et le timide Chevance, le «confesseur de bonnes» à l’autorité spirituelle foudroyante. Si le double est traditionnellement l’une des figures spéculaires les plus évidentes de Satan, celui que nous pourrions a contrario appeler le frère (ou la sœur, bien sûr), Chevance puis Chantal, est le véhicule de la grâce qui libère. Et c’est peu dire qu’avec une véritable rage, le romancier ferme les unes après les autres les portes qui emprisonnent ceux qu’un autre écrivain, Julien Green, nommera des épaves. Pernichon, Catani, Mgr Espelette et Guérou à la trouble réputation, Framboise et Cénabre : autant de personnages littéralement rentrés en eux-mêmes, tombés dans un réduit où ils demeurent prostrés, incapables de faire éclater la bulle pestilentielle depuis laquelle ils contemplent une réalité déformée par leurs envies, leurs complots, leurs mensonges, leurs sordides manœuvres. C’est le même vide qui réunit ces hommes creux dans une communion pourtant impossible. La médiocrité est l’unique pain que rompent ces damnés que Bernanos condamne à une pure et simple disparition, sans appel (ni rappel) sur la scène romanesque.
Nous pourrions lire ces pages comme le prolongement et l’exploration acharnée d’un de «ces drames cachés, étouffés» que Barbey d’Aurevilly illustra dans ses Diaboliques ou dans Une histoire sans nom. Elles constituent quoi qu’il en soit l’une des plus troublantes introspections psychologiques et spirituelles que le roman français moderne nous a données. Le coup de sonde génial que Bernanos lance dans les mobiles les plus profonds de Cénabre est bien trop lucide pour que nous ne puissions soupçonner, de sa part, une condamnation indirecte des pouvoirs inquisitoriaux de tout grand écrivain, comme le théologien Hans Urs von Balthasar et Max Milner l’avaient remarqué. En ouvrant l’âme de Cénabre comme on ouvre un fruit, Bernanos ne nous convie pas seulement au juteux festin qui sera salué par ses confrères ou ses lecteurs. L’un d’entre eux, Antonin Artaud, que la scène de l’agonie de Chevance avait bouleversé, comprit d’ailleurs que Bernanos, son «frère en désolante lucidité», avait dû lui-même beaucoup souffrir pour écrire semblable œuvre. Sous les regards de ses lecteurs fascinés, l’écrivain dispose en fait ses propres entrailles. Il désigne les ruses par lesquelles le romancier de génie est le moins dupe de ses pouvoirs de vision. Ce n’est ainsi pas sans raison que Bernanos a écrit dans Les Enfants humiliés que L’Imposture lui avait coûté beaucoup de peine, objectant même, contre la réalité purement humaine de l’imposteur, des doutes radicaux : «Je ne crois plus aux imposteurs depuis que j'ai écrit L’Imposture, ou du moins je m’en fais une idée bien différente. [La] dernière ligne écrite, j’ignorais encore si l’abbé Cénabre était oui ou non un imposteur, je l’ignore toujours [...]. Pour mériter le nom d’imposteur, il faudrait qu’on fût totalement responsable de son mensonge, il faudrait qu’on l’eût engendré, or tous les mensonges n’ont qu’un Père, et ce Père n’est pas d’ici» (1). Pas étonnant que les pauvres hères dont ce roman nous fait contempler la noria monotone ne puissent se décharger de leur fardeau imaginaire, leur ridicule chevance. Pas étonnant non plus, à l’exemple de Pernichon, qu’ils soient liquidés en quelques mots par un écrivain en apparence insensible à leur sort qui évoquera le probable suicide du journaliste comme, d’un geste de la main, on chasse une pensée importune ou encore un moucheron.
Ces pages sont peut-être enfin un théâtre sur les planches duquel Dieu et diable se livrent bataille, puisque Cénabre et Chevance, nous dit Bernanos, «s’étreignaient dans le ciel». Dieu et diable s’affrontent, de même que «deux combattants qui se prennent à la gorge au-dessus d’un cadavre» qui n’est autre que celui du prêtre, comme si le romancier donnait une nouvelle vie aux mystères du Moyen Âge et nous indiquait, par la longue et belle évocation de la voix de la création (2), que le décor de son roman n’a de réalité qu’invisible et immémoriale. Ainsi, accompagner l’écrivain dans les plus secrètes contrées de l’esprit et de l’âme, c’est pénétrer dans un royaume dérobé à nos yeux de chair, dont la réalité semble cependant plus assurée que celle des rues où Cénabre erre durant une nuit. L’Imposture de Georges Bernanos, avant le crépusculaire Vent noir de Paul Gadenne qui paraîtra en 1947, nous convie à une marche harassante sur la terre vaine qu’arpentent sans relâche ni but les hommes à la cervelle remplie d’un peu de bourre, comme l’écrit T. S. Eliot. Cette exploration des ténèbres de l’âme humaine, bien sûr, n’est pas dépourvue de dangers, comme Gadenne nous le montrera dans son magnifique roman.
«Convenez cependant que je me suis bien avancé pour pouvoir, maintenant, reculer ?» Aussi banale que nous semble cette phrase lorsque Cénabre la lance avec dédain à Chevance qu’il a fait venir chez lui en pleine nuit, elle ne peut qu’éveiller l’écho d’une autre phrase, célèbre, prononcée par Macbeth devant son épouse : «I am in blood / Stepp’d in so far that, should I wade no more, / Returning were as tedious as go o’er», «Je suis dans le sang, enfoncé si profondément que, même si je n’y pataugeais plus, revenir en arrière serait aussi fastidieux qu’avancer». Macbeth avancera donc coûte que coûte et s’enfoncera dans son mauvais rêve, croyant peut-être aborder une terre au-delà du bien et du mal, jusqu’à ce que son cauchemar, les actes odieux qu’il a commis et leurs conséquences néfastes, soient dissipés comme une vapeur maligne par un rai de lumière. Il faudra la farouche décision, pour les hommes de bonne volonté, de se débarrasser de celui qu’ils appellent le tyran, il faudra même la marche, irréelle, d’une forêt tout entière s’avançant sur son château pour faire disparaître Macbeth le meurtrier. Défait, ce dernier aura les mots pitoyables de l’enfant qui trop tard mesure la portée de ses actes.
Cénabre lui aussi, nous confie Bernanos, semble ne plus pouvoir revenir des profondeurs qu’il a atteintes ni escompter «un arrêt dans la descente verticale», sans remonter chargé de précieux trésors, arrachés aux ténèbres. Non point, comme nous l’indiquerait une lecture trop hâtive de L’Imposture, l’indifférence ou même le néant, mais la joie, la joie sans retenue de celui qui n’a plus besoin d’aiguiser son mensonge quotidien à toutes les arêtes qu’une banale journée lui offrira d’abondance. Contre la volonté inébranlable et sèche du prêtre auprès de laquelle les regrets de Macbeth sonnent comme un véritable cri de libération, la lumineuse charité de deux âmes magnifiques, celles d’un humble prêtre et d’une jeune femme qui en vision contemplera l’apôtre félon, Judas Iscariote enfermé dans une solitude inconcevable, ne sera point de trop.
Enchaîné à ses résolutions comme Macbeth l’est à ses desseins, Cénabre est libre, aussi libre que l’est un damné. A-t-il trahi, comme le suggère la présence dans La Joie de la figure de Judas ? Il eût fallu pour cela avoir prêté allégeance, alors que Cénabre semble tenir pour billevesées les postulations baudelairiennes vers Dieu et Satan. Ne faisant plus qu’un avec son imposture, du moins en ayant pris la conscience la plus irrécusable, le prêtre sans foi peut ainsi jouir de «l’effusion de son affreux bonheur», même si, de sa joie, nul signe ne paraîtra sur son visage inexpressif.
Avant d’être tué, Macbeth reviendra à la raison, nous mettant en garde contre les «ennemis jongleurs («juggling fiends») qui nous ont enroulés dans le double sens» (cf. Acte V, scène 9). Cénabre, lui, avant de sombrer dans la folie, trouvera la force de prier le Père. C’est sans doute forcer le texte de Shakespeare que de supposer que le tyran aura eu le temps, d’une seule pensée tue, d’honorer à nouveau l’antique piété que le meurtre du roi Duncan a détruite dans son cœur «gorgé d’horreurs». Car c’est bien le geste impie de Macbeth qui a fait vaciller l’axe du monde, c’est bien le meurtre qu’il a commis qui fait que la nuit ne parvient plus à être dissipée par le jour. C’est son forfait inouï qui a transformé le bien en mal et inversement, alors que tous les animaux (3) deviennent des créatures enragées. La nature, déséquilibrée par l’assassinat du roi, bascule dans le chaos en raison de la folie d’un seul homme, que l’on dirait choisi avec grand soin par les puissances maléfiques. Dans l’esprit de Macbeth tourmenté gît la faille étroite par laquelle le poison subtil des sorcières va s’infiltrer, comme la lézarde minuscule finira par faire s’écrouler la majestueuse maison Usher dans le marécage qui s’étend devant elle. Dans sa geste la plus achevée, la pièce de Shakespeare nous présente le drame de la tentation, qui est celui de l’écart, tragique, entre la volonté et l’acte, le projet et sa conséquence funeste. À la différence de Macbeth, tout paraît consommé dans L’Imposture, bien que Georges Bernanos cherche sans relâche, dans les pages fébriles de son roman, à mettre le doigt sur cette faille pratiquement insoupçonnable qui a fissuré l’âme de Cénabre alors qu’il était encore jeune. Nous ne savons pas avec certitude si le prêtre, avant de sombrer dans la folie qui conclut les toutes dernières lignes de La Joie, a eu le temps de véritablement comprendre le sens de son aventure, et de quelle façon son imposture a pu bouleverser l’ordre invisible du monde. Peut-être a-t-il remis au Père, Lui adressant sa toute dernière prière, l’âme pure du petit enfant qu’il a été ?
Macbeth est un personnage que Shakespeare a peint avec beaucoup de subtilité comme un homme devenu prisonnier de son mauvais rêve, alors que, comme n’importe lequel de ses rudes compagnons, il n’a accompli aucun forfait notable avant de rencontrer les trois sœurs démoniaques qui paralyseront sa volonté par leurs paroles trompeuses. Macbeth est encore celui que Shakespeare a imaginé en héros maléfique ayant une parfaite conscience de ses pensées et actions, comprenant qu’il s’enchaîne irrémédiablement au mal qu’il est contraint de perpétrer pour faire advenir son rêve de puissance. La grandeur romantique dans le Mal semble cependant consommée, comme nous le montre le roman de Bernanos et, avant celui-ci, l’un des textes les plus connus de Joseph Conrad. Est-il ainsi exagéré de prétendre que Macbeth, dans Cœur des ténèbres, est devenu l’homme creux dont le seul pouvoir est celui de sa voix, Kurtz (4), réfugié au plus profond de la jungle où des sauvages l’adorent au sens propre du terme ? Ne peut-on en outre considérer que Macbeth est l’un des lointains ancêtres, encore tout rempli de bruit et de fureur, de Cénabre, ce personnage implacable et froid qui annonce la véritable «incarnation du
26/06/2010 | Lien permanent
La parole molle de la France

Karl Kraus, La nuit venue
Lecture d’un excellent article signé par Alexandre Adler dans Le Figaro d’hier, intitulé Qui prête main forte à al-Quaida et qui, utilement, avec précision (comme toujours avec Adler), nous rappelle le point que je mentionnai dans un récent papier, à savoir que des liens véritables ont existé, existent et existeront entre les deux Internationales, l’islamiste et la Rouge, liens qui bien évidemment constituent une vérité insupportable à entendre par notre Presse. Cette précision d’Adler dans ses démonstrations était déjà visible dans son livre, J’ai vu finir le monde ancien qui, dans un style parfois bien trop journalistique (donc : une absence de tout style…), démontrait au moins que l’Europe, obstinément, se voilait la face. Au moins Adler tentait-il avec ce livre d’explorer le cœur des ténèbres ou, pour reprendre une métaphore à Henry James, de démêler les différentes trames du motif dans le tapis même si, je le dis sans l’ombre d’une hésitation, seule la parole d’un romancier ou d’un poète peut aller réellement dans les abîmes, puis tenter d’en revenir car ce n’est pas descendre aux Enfers qui est difficile, mais bel et bien remonter à la surface, puis parler.
Pourtant, Adler s’écarte dans ce texte de la prudence onctueuse des perroquets du Monde diplomatique et, comme s’il s’agissait d’un thème musical, conclut ses lignes par un refrain que chantonneront tous les lâches, et Dieu sait que, en Europe, ils sont nombreux : c’est de trouille que crève le petit cordonnier qui a décidé de chausser l’Espagne de charentaises et c’est de trouille, on s’en serait douté, que crève la France, persuadée qu’elle va retirer les mirifiques dividendes de son inaction en Irak. «Mais aujourd’hui écrit Adler, toute l’Europe est humaniste, à tel point qu’il faudra peut-être changer l’hymne européen, la trop militariste (et maçonnique) Ode à la Joie de Beethoven, et adopter le nouveau mot d’ordre de notre temps, le «Non je ne ferai pas la guerre» qui ouvre La Veuve joyeuse des frères Strauss».
De sorte que les mots de Michel Crépu sur Bernanos (voir son Journal littéraire du mois de mars) me semblent durs. Certes, lui qui vient de relire le Journal d’un curé de campagne, le «meilleur Bernanos, le plus juste, le moins engoncé dans sa gangue», a raison de penser que ce prodigieux roman est l’une «des plus belles leçons de ténèbres de la littérature française» même si, curieusement, Michel Crépu place Monsieur Ouine un cran en dessous du Journal, ce qui à mon sens est une erreur, en tout cas si l’on considère attentivement quelle a été l’intention de Bernanos en écrivant ce livre crépusculaire lequel, qui se souvient de cela ?, a constitué pour le Journal une véritable matrice romanesque. Pourtant, Crépu affirme qu’il ne supporte plus, dans le style du romancier, ses «effets de manche», que nous pourrions plaisamment traduire par sa colère de pamphlétaire et de polémiste (je ne confonds pas les deux termes).
N’est-ce pas pourtant cette absence de colère, cher Michel Crépu, fût-elle exagérée, forcément exagérée, qui condamne la France, depuis la disparition d’un Boutang, d’un Bernanos, d’un Bloy, d’un Céline ou même d’un Darien, à sombrer dans un agréable sommeil munichois, à répéter les petites phrases à la praline de Dominique de Villepin, à s’emmailloter dans un cocon d’insignifiance et de sot consensus qu’un Philippe Muray, vous avez raison de le dire, parvient de moins en moins à railler malgré tous ses efforts ? Le stalker, qui continue – mais pour combien de temps encore ? – de marcher prudemment, à pas de loup, dans la Zone dont les dangers inconnus le guettent, a donc décidé, à sa façon modeste, somme toute étique comme le sont les flancs de l’animal sauvage, de donner la parole, une fois n’est pas coutume lui dira-t-on, à Rémi Soulié (auteur d’un magnifique livre sur Dominique de Roux) qui, justement, a écrit sur la parole pamphlétaire un bel article (publié dans Dialectique dans son intégralité) évoquant la relation entre Pierre Boutang et Georges Bernanos.
Le voici donc, bonne lecture.
 Pierre Boutang dans la Zone.
Pierre Boutang dans la Zone.«Le fond de ma nature est la vénération et la piété»
Pierre Boutang à Olivier Germain Thomas, France Culture, le 28 janvier 1992.
«Il a repris bien des fois la même pensée, si chère à son cœur déçu, lorsqu'au seuil de l'ombre […], pressentant la faillite possible de toute espérance humaine, il approchait le plus près possible du papier ses yeux d'aveugle, traînant de ligne en ligne sa main tremblante […]».
Georges Bernanos, La Grande peur des bien-pensants.
Voici deux symptômes de ce qu'il faut bien appeler un refoulement – le mot ne plairait pas à Pierre Boutang mais il aurait convenu à son ami Maurice Clavel qui, à propos de mai 68 parla du retour du Grand Refoulé (Dieu) –; le premier, diagnostiqué par Dominique de Roux en 1972 dans Immédiatement, le second, plus anecdotique et récent : «Pierre Boutang, son Blake ! Un tel livre en Angleterre lui vaudrait une chaire de poétique à Cambridge. En France, tous les blackboulés du talent vont faire la fine bouche et le silence. Voilà les intellectuels français, république d'envieux, de sodomisés mentaux».
(Ceci, écrit quatre ans avant la pétition des sodomisés mentaux contre Boutang). Second symptôme, La Semaine de Radio France (samedi 8 mai, vendredi 14 mai 1999), Stéphane Martinez, à propos des entretiens sur France Culture avec Jean-Luc Marion : «Précisons que Jean-Luc Marion a succédé à Paul Ricœur, en tant que professeur au département de l'Université de Chicago, et qu'il occupe actuellement à la Sorbonne la chaire de métaphysique, détenue jadis par Emmanuel Lévinas...».
Pierre Boutang, l'auteur de L'Ontologie du secret, est lui-même mis au secret, dans un Purgatoire qu'il aurait par ailleurs depuis longtemps exploré et subverti. Ce procédé rappelle les meilleurs temps de la photographie d'art soviétique où les indésirables disparaissaient après montage ou, plus aimablement, les manipulations du ministère de la Culture qui, à l'occasion du transfert des cendres de Malraux au Panthéon, supprime des photographies de l'écrivain la cigarette qu'il avait aux lèvres. Il s'agit, au bout du compte, d'un même processus de réécriture de l'Histoire, petite ou grande, à des fins prétendues ou non de purifications éthiques. Passons.
Sans aucunement prétendre à l'exhaustivité, Pierre Boutang consacre au moins quatre articles à Bernanos, directement ou indirectement. Le premier, qui m'a été signalé par Stéphane Giocanti, date du lendemain de la mort de l'auteur de Monsieur Ouine – juillet 1948 – et a été publié dans Aspects de la France, tout comme le second – une semaine plus tard, Grandeur et misère de Bernanos, ainsi que le troisième, plus spécifiquement consacré au Grand d'Espagne de Nimier mais où Boutang en profite pour approfondir et mieux cerner la nature de sa relation avec Bernanos (repris dans Les Abeilles de Delphes). Le quatrième, enfin, a été publié en 1982 dans Royaliste, à l'occasion de la publication du livre de Gérard Leclerc, Avec Bernanos. Lire consécutivement ces contributions permet de relever une évolution sensible dans la pensée de Pierre Boutang à l'endroit de l'auteur de La Lettre aux Anglais.
D'emblée (juillet 1948), Boutang pose la grandeur de Bernanos – il est significatif de noter que les textes auxquels il s'intéresse (en particulier) ont tous les deux l'adjectif grand dans leur titre (La Grande Peur des Bien-pensants et Les Grands Cimetières sous la lune) : «Je ne peux taire en Bernanos la présence de la grandeur». Le philosophe parle même de piété, de pitié et de respect. Pierre Boutang s'attache à montrer que sur le fond, Bernanos ne s'est pas renié. (cf. également La Terreur en question, Éditions Fasquelle, 1958, p. 63).
Mais l'essentiel n'est pas là. Dans les trois articles d'Aspects de la France et La République de Joanovici, Boutang est encore sous le coup de ce qu'il appelle la querelle de Bernanos et de Maurras (rupture de 1932). Le philosophe se range sans ambiguïté du côté de Maurras. Boutang a, mutatis mutandis, la même attitude qu'Aragon à l'égard de Paul Nizan au moment de l'annonce du Pacte germano-soviétique. Comme Nizan récuse une alliance jugée contre-nature, Aragon et ses amis le traitent de fou, de flic, etc. De la même façon, Boutang se range du côté de l'orthodoxie maurrassienne et retrouve des mots voisins de ceux d'Aragon pour qualifier l'attitude de Bernanos évoquant les «anathèmes fous du malheureux exilé».
Il fait même preuve d'une certaine inélégance dans les sous-entendus sur la vie privée de Bernanos : «[...] quels échecs secrets dans l'éducation de ses enfants [...] peuvent expliquer cet échec essentiel [...] (je n'ai) aucune indulgence pour la vie d'un homme qui n'a pas su se retenir dans la fidélité, [il fut un] vieil exilé amer, acharné».
Schématiquement, Pierre Boutang est proche du premier Bernanos (La Grande Peur) et du dernier qui continue de pourfendre la démocratie, mais il rejette l'avant-dernier, comme il le dit lui-même, celui du ploutocrate Coty (p. 269 des Abeilles de Delphes) et du Figaro, mais aussi, celui des Grands cimetières qu'il ne pourra admettre que très tard, et encore (nous y viendrons plus loin). Dans La République de Joanovici (1949), les attaques sont vives : «Sa belle colère (celle de Bernanos) était rendue vaine par le camp qu'il avait choisi. Sa vision d'émigré sur les malheurs de la France vaincue [...] Ses déclarations radiophoniques d'une terre lointaine l'avaient associé aux pucerons de la démocratie-chrétienne qu'il avait nommés et qu'il méprisait».
Pierre Boutang reproche en fait à Bernanos d'avoir donné des gages à la démocratie-chrétienne haïe (d'une haine constante, et par lui, et par l'auteur de Sous le Soleil de Satan). Il va jusqu'à évoquer les vaines ombres comme Albert Béguin, qui s'accaparent Bernanos.
En 1982, Pierre Boutang rugit encore contre les misérables faussaires qui ont voulu enrôler Bernanos. (Il leur promet la meule au cou !). Certes, Bernanos n'a pas cédé à la tentation (méthode Coué) ; il a continué de «châtier la démocratie-chrétienne qui avait rêvé de faire de lui un complice, la tourbe démocrate chrétienne, la funeste démocratie-chrétienne, l'hypocrisie démocrate-chrétienne» : «Entre B et nous, ce ne sont que querelles de famille, de paroisse et de voisinage». (On peut néanmoins s'interroger, rétrospectivement, sur le cinquantième anniversaire de la mort de Bernanos (1998) et les craintes prémonitoires de Boutang... Bernanos n'a-t-il pas été désamorcé, même si un député prétendu gaulleux s'insurge contre une conférence pourtant irréprochable de Sébastien Lapaque ? Boutang s'interrogeait, en effet, dans Les Abeilles de Delphes : «Puisque La Grande Peur est aujourd'hui introuvable, nous proposons à Béguin et aux pucerons démocrates chrétiens de fonder un comité pour sa réédition». (Qui serait en fait sa réédition). Pierre Boutang a été entendu puisque La Grande Peur a été réédité, et en effet, par un puceron, l'abbé Julliard – Serge Julliard ou Jacques Julliard, je les confonds – avec Nihil obstat et Imprimatur et tout et tout...).
En 1980, à l'occasion d'un numéro spécial de Royaliste sur Pierre Boutang royaliste et philosophe, l'attitude du philosophe évolue, jusqu'à minimiser les désaccords ou les réserves avec Bernanos. Il reconnaît que Maurras et le Grand d'Espagne se rejoignent sur l'essentiel qui est le Roi. Bernanos est même qualifié de vieil et pur camelot du roi à deux reprises (dans le Maurras et le Précis de Foutriquet), ce qui ressemble fort à un retour en grâce. À propos des Grands Cimetières, la deuxième œuvre de Bernanos qui, symboliquement, intéresse Boutang – même si elle l'indispose – l'évolution des considérations du philosophe est à elle seule révélatrice, en raccourci, du changement de l'évaluation. En 1952, dans Les Abeilles : «Je refuse de toute ma force les thèses qui servent de prétexte aux Grands cimetières». Et en 1980 : «J'ai été bouleversé par Les Grands cimetières».
En 1984, dans le Maurras, cet aveu : «[...] les Grands cimetières, que ma fidélité m'empêcha de lire au moment de leur parution». En 1981, Boutang se rattrape et met en épigraphe du Précis de Foutriquet un extrait des Grands cimetières. En 1982, pour filer la métaphore communiste, Pierre Boutang fait son autocritique dans l'article sur le livre sus-cité de Gérard Leclerc : «[C'est une] œuvre qui importe autant par La Grande Peur que Les Grands cimetières ou Scandale de la vérité. L'affaire Coty a été sottement envenimée des deux côtés; [Il souligne l']absurdité de la querelle». (Dans son Maurras, il minimise aussi les désaccords; il reproche même à Maurras, de façon voilée, une attention insuffisante à l'affection très respectueuse que Bernanos avait pour lui. Bernanos avait un «cœur sublime»). MAIS : Boutang ne peut s'empêcher de rappeler, même dans les dernières années, que dans Les Grands cimetières, c'est Bernanos qui s'est trompé sur la gloire posthume de Maurras et les obsèques nationales (dans son compte rendu du livre de Gérard Leclerc). (Il l'avait fait également en 1952 dans Les Abeilles; Pierre Boutang est obstiné, et même entêté, ce n'est pas une surprise). En définitive, Pierre Boutang, sur Bernanos, rejoint Nimier : La Grande Peur et Les Grands Cimetières ont le même enracinement.
Il s'agit d'être contre les hommes d'ordre, les honnêtes gens, les bien-pensants, le parti clérical; la distinction entre les deux maîtres livres de Bernanos est peut-être artificielle... De plus, c'est dans Les Grands Cimetières que Bernanos rend hommage aussi à Drumont : «Dans ma treizième année, le livre de mon maître m'a découvert l'injustice, l'injustice toute vivante, avec son regard glacé». On peut en outre relever, dans la distance qui sépare Pierre Boutang de Bernanos, un regard différent sur l'Histoire royale de la France. Boutang est venu au Roi par Louis XI et Louis XIV, suite à la leçon de Maurras (l'État, etc.) ; Bernanos est spontanément plus proche de la royauté de saint Louis, «la jeunesse de la France», dit-il. Dans son Maurras, Pierre Boutang explique qu'il faut concilier les deux, l'efficacité du pouvoir et son humilité. On pourrait ainsi résumer la situation, en quelques mots-clés, et très schématiquement une fois de plus : Bernanos : Foi, Louis IX, enfance, roi incarné, sentiment, adhésion du cœur, royalisme, action, mystique.
Maurras : Agnosticisme, Louis XI, Louis XIV, idée royale, raison, démonstration, monarchisme, intellect, politique.
Boutang réaliserait une manière de synthèse entre les deux : Enfance (le royaume des pères), foi, camelot du roi (action), métaphysique, mystique, politique.
Plus précisément, après cet itinéraire factuel oscillant, on se doute que les deux œuvres dialoguent, qu'il existe une proximité textuelle et esthétique entre les deux hommes. Elle m'apparaît tout d'abord dans ce que Pol Vandromme, dans son bel essai La Droite buissonnière, appelle la «vivacité à la Bernanos» de Boutang.
D'un point de vue littéraire, elle se manifeste dans une veine précise qui est celle du pamphlet – si inadéquat que soit le mot – mais telle est la forme qui favorise le mieux l'expression des deux regards. Posons, en premier lieu, que Bernanos récuse l'appellation de pamphlétaire et de polémiste (esthétisme répugnant, narcissisme), et que Pierre Boutang se contredit. La République de Joanovici a pour incipit : «Je n'écris pas de pamphlet». Mais l'auteur du Foutriquet reprend à son compte la formule péjorative de vil pamphlétaire... Réglons une fois pour toutes, pour Bernanos et Boutang, la querelle de terminologie en partant, comme l'indique Pierre Boutang, de l'étymologie – même s'il en a une science parfois très personnelle : «Un pamphlet, c'est une œuvre qui a pour objet de tout brûler, c'est une torche» (Boutang a donné pour la première fois cette définition tirée du grec dans La Dernière Lanterne du 3O juin 1948, pp.4-5). Le mot convient bien car Drumont cité par Bernanos et Boutang écrit de ses ennemis : Mettons-leur le feu au ventre (La Fin d'un monde).
En conséquence, nous pouvons nous accorder sur le terme de... brûlot. Dans tous les cas, il s'agit bien, comme le dit une tête chantante du gaullisme contemporain, d'allumer le feu.
Quatre textes de Boutang (Sartre est-il un possédé ?, La République de Joanovici, La Terreur en question, Le Précis de Foutriquet) et deux revues (La Dernière Lanterne, Paroles françaises), peuvent être assimilés, bon an mal an, au pamphlet. Il les range lui-même ainsi dans ses bibliographies; dans le Foutriquet, il reconnaît avoir écrit deux pamphlets ou deux libelles (Joanovici, La Terreur); dans La Dernière Lanterne il écrit : «Les régimes de liberté honorent les pamphlétaires morts»
N'oublions pas, enfin, que dans le Tableau de la littérature française (1962), Pierre Boutang consacre son article au texte considéré comme le roi des pamphlets, la Satire Ménippée. Nul hasard là non plus.
Le polémiste authentique est toujours un prophète comme le prophète est toujours, de Jérémie à saint Jean Baptiste, un violent bretteur. C'est vrai de Barbey, Bloy, Bernanos, Boutang (on pourrait s'interroger sur cette transmission sacramentelle alphabétique, transmission secrète, comme dirait l'auteur de L'Ontologie du secret). Le souffle de l'Esprit pénètre celui qui brûle – c'est le cas de le dire – d'une sainte colère. Voici deux passages éminemment prophétiques de <>La Terreur (1958) 1) pour les affaires intérieures (pp. 25-26) : «Or l'argent, et celui du capitalisme international, ne s'accommode tout à fait que des partis et des hommes de gauche; s'il est une droite ploutocratique et fermement républicaine (i.e Le Figaro, dont le surmoi serait Le Monde) qui le sert depuis un siècle, elle lui coûte moins cher et lui donne moins de plaisir que la gauche qu'il tient et corrompt en secret; la gauche, en
18/03/2004 | Lien permanent

























































