« Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, par Francis Moury | Page d'accueil | Une mort dans la famille de James Agee : deuil et filiation au fond d’une âme sudiste, par Gregory Mion »
29/08/2020
Entretien avec Baptiste Rappin à propos de Tu es déjà mort ! Les leçons dogmatiques de Ken le survivant
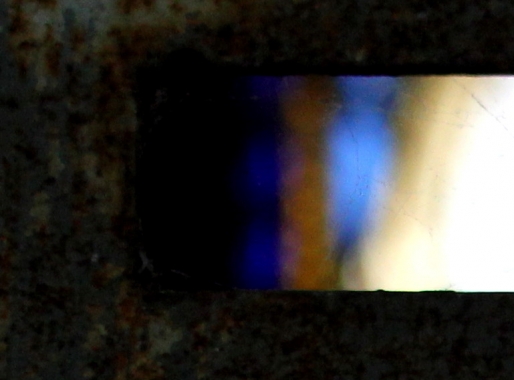
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Baptiste Rappin dans la Zone.
Baptiste Rappin dans la Zone. Apocalypse et civilisation selon Baptiste Rappin, par Francis Moury.
Apocalypse et civilisation selon Baptiste Rappin, par Francis Moury. Acheter Tu es déjà mort ! sur Amazon.
Acheter Tu es déjà mort ! sur Amazon.Juan Asensio
Cher Baptiste, ton dernier ouvrage paru, Tu es déjà mort !, sous-titré Les leçons dogmatiques de Ken le survivant récemment édité par Ovadia, me fait penser, l’unicité et la justesse de la voix en plus, à tel ouvrage collectif, aux propositions résolument inverses des tiennes, consacré à la trilogie Matrix conçue comme une machine philosophique (Ellipses, 2003). L’un des termes du titre, «dogmatiques», fait référence à la pensée de Pierre Legendre, que tu as évoquée dans une série de notes parues dans la Zone, alors que ton ouvrage lui-même n’hésite pas à convoquer des exemples littéraires mais aussi la saga post-apocalyptique japonaise Ken le survivant (Hokuto no Ken, dont le site officiel se trouve ici). Comment expliquer un tel mélange des genres et, question qui en découle immédiatement, ne risques-tu pas de provoquer quelques haussements de sourcils chez tes collègues professeurs d’Université, lesquels pourraient te reprocher l’hétérogénéité des œuvres que tu utilises, mêlant philosophie, littérature et bande-dessinée ?
Baptiste Rappin
Quelle étrange question ! Je ne me la suis, à vrai dire, jamais posée. Mais tout compte fait, elle me paraît bien logique : un «enseignant-chercheur», car c’est ce que je suis censé être selon les termes de l’administration, s’adresse à un public universitaire, c’est-à-dire à la fois à ses collègues, supposés être spontanément intéressés aux «productions» de leurs congénères, et à ses étudiants, souvent contraints de se farcir l’indigeste prose de leurs professeurs afin d’obtenir des diplômes qui ne reflètent plus la maîtrise d’un champ disciplinaire et la hauteur de vue associée, mais la simple capacité à se conformer à d’absurdes prescriptions (la meilleure des préparations pour le marché du travail !). Cette évidence est pourtant trompeuse à l’heure de l’industrie de la formation universitaire et de la recherche académique : en effet, il existe une telle profusion d’articles dits «scientifiques» et de telles «niches» d’enquêtes que seule une poignée de personnes, à l’échelle de la planète, se trouve concernée par de tels écrits dont l’inflation galopante (on l’observe, par exemple, au rythme fou de création des revues scientifiques) n’a d’équivalents que la profonde insignifiance et le nihilisme radical qui les habitent.
Bref, un «enseignant-chercheur» n’écrit pas pour des universitaires, il écrit en vue d’être publié dans des revues classées, car tel est, à l’heure actuelle, le seul critère d’avancement de carrière. Mais mon cas particulier ne me semble pas procéder de la logique que je viens de décrire : en effet, j’ai une si piètre opinion de l’Université, qui n’est plus que le fantôme de ce qu’elle fut, ou de ce qu’elle a pu, en quelque occasion, être, que j’espère ne pas être lu de mes collègues; et c’est ce qui, de fait, se produit : hyper-spécialisés, sous-cultivés, ils sont bien souvent incapables de comprendre ce que j’écris, ce qui génère un haussement d’épaules ou de sourcils non pas en raison des idées que je porte, ou du style de mon écriture, mais en vertu de leur incompréhension, de leur ignorance crasse, qui les conduisent à me classer parmi les «marginaux» (et comme il faut de tout pour faire un monde…).
Mais je me dois de franchir un pas supplémentaire et poser ici, en toute simplicité, que je n’écris pour personne, qu’un auteur (écrivain, philosophe, romancier, etc.) conséquent ne doit écrire pour personne, à destination de personne, ne doit surtout pas tomber dans le piège d’adapter son discours à une cible, n’a absolument pas à prendre en compte les besoins d’un marché. C’est, dans mon esprit, le lecteur qui doit partir à la recherche des auteurs, et il découvrira, lira et rencontrera ceux qu’il mérite de découvrir, de lire et de rencontrer. Plût au ciel que mes ouvrages ne côtoient pas ceux de Raphaël Enthoven, Adèle Van Reeth, Michel Onfray ou Emmanuel Faye sur les étagères d’une bibliothèque ! Plût au ciel qu’un amateur de Cécile Coulon ne se prenne à pénétrer dans la Zone !
Alors pourquoi écrire si je n’écris pour personne ? Ce qui m’obsède depuis maintenant deux décennies, c’est de comprendre comment l’humanité, et en particulier sa composante occidentale, a pu en arriver à un tel état de décadence, de délabrement, de déréliction. Un tel questionnement ne connaît évidemment pas de frontières disciplinaires : il se nourrit, potentiellement, de toutes les œuvres dont a accouché l’esprit humain au cours de son histoire, et c’est la raison laquelle je recours à la philosophie, que je lis des romans, que je me tiens informé des avancées de la science, que je me plonge dans la théologie, que j’emprunte, dans Tu es déjà mort le chemin de traverse du manga japonais.
Juan Asensio
Oui, finalement, tu indiques, dans cette première réponse, les maux que tu ne cesses d’analyser, pour les décrier, dans tes autres textes, ceux que tu as publiés en livres et ceux dont tu alimentes la Zone, maux qui tiennent à la fois à une crétinisation généralisée, institutionnalisée, qui va de pair avec une destruction méthodique du langage donc, pardonne-moi ce raccourci quelque peu cavalier avec lequel le penseur méthodique ne sera peut-être pas de prime abord d’accord, le Verbe, l’Être.
De l’Être, il est beaucoup question dans ton ouvrage : je crois même pouvoir avancer que ton livre est une méditation, aussi précise que belle, sur l’Être, sur la spécificité inouïe de l’Occident qui a pensé l’Être et en a proposé un discours aussi cohérent que puissant, depuis les Grecs jusqu’à Heidegger. Or, et c’est l’utilité heuristique des textes post-apocalyptiques, l’Être se désagrège, non seulement parce qu’il peut être discrètement, ou au contraire «d’un seul coup d’éponge par la foudre nucléaire» (p. 76) ou une autre catastrophe planétaire, détruit – évoquons dans le premier cas La Mort du fer de Serge Simon Held, dans le second La Route de Cormac McCarthy, que nous retrouverons plus avant –, mais aussi parce que le discours sur l’Être se raréfie au profit du bavardage indifférencié sur l’étant. Ces catégories heideggeriennes, tu les évoques dans ton ouvrage, et les illustres par l’exemple du monde dévasté que décrit le célèbre manga japonais qui, écris-tu en soulignant ton propos, «relève plutôt d’une expérience de pensée anthropologique poussée à un point de radicalité rarement égalé» (p. 49). Pourquoi donc ? Parce que le Japon aurait connu avec la Seconde Guerre mondiale une «réinitialisation qui l’aurait rendu totalement perméable au projet postmoderne de liquidation des structures passées», ce pays ayant vécu, le premier, la «disparition physique de toute trace du passé, de la table rase, de l’annihilation de l’histoire», l’archipel japonais étant de plain-pied «entré dans la société postindustrielle» (p. 69), et, dès lors, le manga pouvant de fait être considéré comme «le récit imagé et symbolique de la déconstruction généralisée» (p. 70). Le Japon est donc la tête de pont de l’Occident tout entier et Ken le survivant la matérialisation du «projet postmoderne» ne visant qu’à émietter l’univers (cf. p. 74) ?
Autre question, qui choquera les optimistes, autrement dit les sots : la catastrophe ou, pour l’appeler d’un terme plus générique, l’Effondrement, a bel et bien déjà eu lieu, n’est-ce pas, ce que nous savons du reste par les textes d’un Zamiatine, d’un Dick (Ubik en est l’exemple le plus frappant !) d’un Orwell, d’un Jaime Semprun ou d’un Günther Anders, et de tant d’autres (comme le remarquable W. G. Sebald, que je te recommande vivement de lire ou relire) ?
Baptiste Rappin
On pourrait en effet croire, de prime abord, que cet ouvrage, Tu es déjà mort !, ouvre une brèche ou constitue une parenthèse dans la suite logique des livres que je consacre à l’étude de la société industrielle et managériale. Ce n’est pourtant pas le cas, bien au contraire. Penser le management et penser Ken le survivant, c’est la même chose ! Non pas parce que penser, à chaque reprise, nécessite l’activation de circuits neuronaux, ce serait là l’explication processuelle de la cybernétique, mais parce que le management et le manga nous confrontent tous deux à la dévastation du monde, à l’oubli de l’être, à la fuite des dieux, à la corrosion du Logos, parce qu’ils nous mettent aux prises avec le nihilisme le plus radical et nous plongent dans des univers insensés et insignifiants.
Alors Tu es déjà mort ! part d’une hypothèse qui est la suivante : le manga est une production esthético-industrielle japonaise qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale et au largage de deux bombes atomiques sur l’Archipel. Tous les mangas, quel que soit leur genre, mettent en scène un déficit d’origine, une faille généalogique, un traumatisme identitaire. C’est d’ailleurs très certainement parce qu’ils reflètent le délabrement démographique contemporain qu’ils connaissent un tel succès, notamment en France, qui est le deuxième marché mondial du manga, après le Japon bien sûr. Le manga donne ainsi à voir des univers déconstruits, soit symboliquement (absence de parents par exemple), soit physiquement (situations post-apocalyptiques), et c’est la raison pour laquelle je fais le pari qu’il constitue une expérience de pensée anthropologique tout à fait inédite et radicale. Je note également ici que la déconstruction ne s’observe pas qu’au contenu du manga, mais aussi à sa forme : absence de couleurs et, surtout, de mots. Il s’agit donc d’une absence de monde qui met en scène une absence de monde, dans une sorte de redoublement du nihilisme que n’offre pas, ou plus difficilement, le style romanesque.
Mais que se passe-t-il au fur et à mesure que l’on avance dans l’ouvrage ? Eh bien on réalise que l’hypothèse n’est pas à confirmer, car elle est déjà vérifiée, et même intégralement vérifiée : tous les éléments de la déconstruction que je retire de l’analyse du manga sont bel et bien présents, et bien ancrés, dans notre monde, si bien que l’on peut effectivement dire, rationnellement et sans exagération, que l’effondrement a déjà eu lieu, qu’il n’est pas devant nous comme le crient les collapsologues (le collapsologue, cette figure du «dernier progressiste»), mais derrière nous comme le savent les plus lucides des penseurs, et en particulier ceux que tu cites. Alors quel nom porte l’effondrement et quelle est la preuve la plus éclatante de son existence ? L’effondrement s’appelle «société industrielle», ou encore «machinisme», ou encore «management», voire «capitalisme», et la preuve réside dans le lien de cause à effet entre industrialisation et chute brutale, et je crois irréversible, du taux de fécondité. Quelques exemples : Japon (1,44), Corée du Sud (1,25), Italie (1,43), Allemagne et Espagne (1,49), Canada (1,60), Suède (1,88), etc. Comme le dit Pierre Legendre, l’être humain, parce qu’il est un animal symbolique, est le seul animal à avoir besoin d’une raison de vivre pour se reproduire. Or, précisément, il me semble que la société industrielle n’est pas en mesure d’offrir pas un tel horizon et qu’on peut dès lors la définir comme une forme de suicide planétaire. Le point exquis de la gouvernance en quelque sorte.
Il est vrai que la dévastation subite de la planète est une éventualité qu’il ne faut pas exclure : une guerre atomique, une pandémie (une vraie, cette fois-ci), la disparition de l’eau, la percussion de la Terre par une comète, sont en effet autant de scenarii possibles. Et c’est bien ce que, de façon générale, les romans et les films mettent en mots et en images. Mais je crois plus crédible la thèse d’un effondrement long, ou, plus exactement, d’un temps de latence entre l’effondrement et son résultat, la désolation : et ce temps de latence correspond précisément à la déstructuration (très rapide à l’échelle de l’histoire des sociétés humaines) des invariants anthropologiques par la société industrielle, processus qui mène à l’enrayement de la généalogie et, par là-même, à l’affaissement des taux de fécondité (que l’immigration ne compense guère, ou que superficiellement, car les immigrés qui quittent un pays dit «sous-développé» mettent moins de deux générations à adopter le style de vie industriel et moderne).
Je conclus cette réponse par une dernière remarque : le titre de l’ouvrage, Tu es déjà mort, qui est une phrase que le héros de Ken le survivant prononce à chaque fois qu’il met à mort son adversaire par la pression de points vitaux, traduit très exactement ce temps de latence que j’évoquais au paragraphe précédent : le guerrier croit être encore en vie alors que la technique de Kenshiro est en train d’agir en lui et de déstructurer son corps. Par analogie, les sociétés industrielles se sentent encore en vie, encore que nombre d’entre nous recherchent des expériences de plus en plus intenses pour rompre avec la morbidité de la vie quotidienne (nous sommes là dans ce que Platon nommerait volontiers un «fantasme», terme que les Latins traduiront par «simulacre»), mais le processus de déconstruction est bel et bien devenu la norme en tous domaines, philosophique, politique, scientifique, littéraire, scolaire, etc.
Juan Asensio
«Quand l’effondrement parvient à son terme, écris-tu, alors la guerre de tous contre tous reprend ses droits» (p. 53) et, quelques pages plus loin : «Devenir ou rester homme, spécialement par temps post-apocalyptique, ne va en effet guère de soi» (p. 63), doux euphémisme, certes, pour affirmer, contre tous les ravis de la crèche progressiste, que les temps pour le moins farouches que décrivent les textes post-apocalyptiques, mais aussi les mangas ou des films comme Mad Max, sont ceux où l’homme descend non seulement au niveau de la bête (Hobbes et son fameux Léviathan, que tu évoques dans ton ouvrage) mais, parfois, plus bas qu’elle ! Nous ne pouvons entrer dans le détail des innombrables possibilités romanesques que les écrivains ont imaginées pour tenter de contrebalancer les forces d’entropie, de destruction ou de dissolution, de déconstruction comme tu l’analyses, par d’ultimes embardées de courage, d’inventivité ou même de très franche abnégation voire de sacrifice pur et simple (chez McCarthy, le père pour son fils), et je me permets de renvoyer le lecteur intéressé par ces questions à ma désormais conséquente enquête, intitulée Au-delà de l’effondrement.
Tu privilégies l’étude des motifs d’espoir dans Ken le survivant mais, surtout, dans La Route de Cormac McCarthy qui n’a pu, je crois, que frapper et même bouleverser tous ceux qui ont lu ce roman aussi crépusculaire que somptueux.
Mieux que tout autre à mon sens, il évoque un monde destiné à périr mais, aussi et c’est le point le plus important à mes yeux et comme tu viens de le rappeler, dont le langage et même la faculté de langage, chez l’homme, semble se replier : à mesure que la création s’amenuise, nul besoin de la nommer, n’est-ce pas ?
Or, les derniers chapitres de ton ouvrage cherchent à définir les moyens nous permettant de bâtir ou rebâtir une espèce d’arche capable de nous sauver du déluge à venir ou plutôt, de sa déhiscence la plus puissante puisque, en fait, nous savons que le déluge a déjà eu lieu, et que, chaque jour davantage, notre rafiot prend l’eau : «De notre point de vue, au sein de l’époque industrielle, la catastrophe fut toujours déjà-là, car elle lui est consubstantielle» (p. 80), écris-tu ainsi en soulignant ton propos. Cette arche, suivant les leçons dogmatiques de Pierre Legendre, tu la nommes la Référence, affirmant que : «pour ne pas tomber dans le piège de l’immanence autoréférentielle et ne pas devenir de simples organisations, strictement utilitaires et fonctionnelles, les institutions sont toutes tenues de maintenir un lien à une Référence» (p. 224). Cette Référence, le père et son fils, que Cormac McCarthy évoques magnifiquement, sont-ils eux aussi à sa recherche, ou tout est-il définitivement perdu, mort, dans ce roman de la désolation absolue ?
Baptiste Rappin
La route fut pour moi une lecture traumatisante, un choc auquel je ne m’attendais pas. Presque une expérience du sacré, au sens du numen de Rudolf Otto : ce que je ressentais au moment de tourner chaque page fut un mélange d’envie, de curiosité et de fascination d’un côté, de crainte et d’anxiété de l’autre. Bref, une lecture asphyxiante, mais si profonde, si inspirante, qu’elle accompagne Tu es déjà mort ! du début à la fin, qu’elle en forme même la trame dans la mesure où chaque chapitre s’ouvre par un extrait du roman de Cormac McCarthy.
Parmi les signes manifestes de l’état post-apocalyptique du monde figure, tu le rappelles dans ta question, l’éclipse progressive des choses, qui se fondent dans les déserts de sable, du langage, à qui il manque désormais l’horizon d’un référent (les romans post-apocalyptiques, de ce point de vue, mettent bien en exergue que la promotion du signifiant assurée par les tenants de la déconstruction relève du pur jeu spéculatif), et donc de la mémoire et du principe d’identité. De même, dans Ken le survivant et dans les mangas de façon générale, la langue s’appauvrit et se réduit à l’interjection et à l’insulte, et c’est bien normal puisque le principe même du manga, qui séduit la jeunesse contemporaine, c’est l’enchaînement rapide des images, de telle sorte que l’action devient immédiatement transparente et qu’un volume peut se «lire» en quelques minutes.
Ceci étant dit, je dirais qu’il faut distinguer deux choses : d’une part, ce dont les héros et les personnages des univers post-apocalyptiques sont porteurs ; d’autre part mon intention théorique, que je situe à la jointure de la philosophie et de l’anthropologie. Alors, oui, il est vrai que le fils dans La route et Kenshiro dans Ken le survivant portent un espoir, ils sont les dernières incarnations d’humanité au sein d’un état de nature qui ne précède plus la société mais lui succède. Ils témoignent ainsi que l’humanité n’est jamais donnée, et qu’elle est toujours une conquête, que c’est une victoire de l’âme que de choisir le suicide plutôt que le cannibalisme, ou que d’aider les plus faibles au lieu de profiter de sa force pour les tyranniser. On pourrait ainsi dire des mondes dévastés qu’ils plantent le décor idéal pour faire voir ce qu’il en est réellement du salut des âmes.
Mais ce n’est pas vraiment ce qui m’intéressa dans les situations post-apocalyptiques, et je suis gêné par les termes que tu utilises dans ta question : «espoir», «arche», «déluge», «moyen», qui donnent d’une part une coloration chrétienne à mon essai et font d’autre part croire que j’ai tenté de formuler un «programme de civilisation», ou de proposer des «solutions» face au «problème» de la perte des repères. Ni l’un ni l’autre ne rendent compte de mon intention initiale qui consiste à se plonger dans l’absence de civilisation pour en penser les ressorts fondamentaux, les invariants même. C’est en ce sens qu’une grande partie de l’ouvrage prépare le moment conclusif : en faisant ressortir les traits saillants de l’absence de monde, que l’imaginaire post-apocalyptique met justement en mots, cela me permet de voir briller la civilisation, non pas par sa présence, mais par son absence. Au fond, la dernière partie de Tu es déjà mort !, que l’on peut brièvement présenter comme un essai d’anthropologie générale, constitue le miroir inversé de la déconstruction préalablement analysée. Y a-t-il ici matière à espoir ? Peut-être certains l’entendront de cette oreille. Peut-on en retirer des moyens afin de bâtir une arche naviguant sur les eaux du déluge ? Peut-être certains, pragmatiques, y décèleront des axes d’orientation et des pistes d’action. À titre personnel, je crains que le problème soit ici en même temps la solution : à savoir, l’effondrement, c’est-à-dire, ainsi que je l’expliquai plus haut, la lente extinction de l’humanité.
Juan Asensio
Si l’Être est le Verbe, du moins dans la longue tradition judéo-chrétienne de laquelle nous dépendons encore de tant de façons, tout est affaire de langage et il était donc plus que logique, nécessaire à vrai dire, que tous les penseurs de la déconstruction, de Barthes à Deleuze en passant par Blanchot et l’inévitable Derrida, coqueluche de tous les ridicules commis du Neutre, s’attaquent à lui. Tu écris ces mots sans ambiguïté : «Le monde qui vient, le monde qui reste, le monde résiduel, n’est pas un nouveau paradigme : il signe bien plutôt la fin de tout paradigme, l’absence de possibilité de l’édification de tout modèle. Seuls y subsistent, imperturbables, les mirages qui font désormais apparaître les oasis comme de fragiles illusions» (p. 168). Ce Neutre, cette «écriture du désastre» pour singer l’un de ces auteurs, tu en voies l’inexorable progression en filant la métaphore du sable, de l’avancée du désert comme nous pouvons la voir dans le classique de J. G. Ballard, Sécheresse (The Drought), écrivant que «le désert de l’indifférence agit comme un processus continu d’indifférenciation au sein duquel tout étant vient à perdre sa propriété, tout ce qui lui est propre, pour se fondre dans le commun» (p. 161). Quels remèdes peux-tu imaginer pour tenter de freiner cette avancée, pour le moins rapide, de toutes ces entreprises de démolitions comme le disait dans un autre contexte Léon Bloy, que tu nommes pour ta part des «entreprises de désolation, c’est-à-dire d’ensablement, de désertification et de désertion de la culture qui sapent, érodent et émiettent les pierres de l’édifice civilisationnel pour les dissoudre en grains de sable» (p. 148) ? Quels remèdes, sinon d’action très profonde dans et pour le langage, déconstruit, attaqué de toutes parts en tant que Matrice de nos représentations ?
Baptiste Rappin
Ta question me permet de compléter ma réponse précédente. C’est certainement par déformation professionnelle – ma fréquentation des milieux managériaux – que j’en suis venu à rejeter, de façon radicale et péremptoire, toute forme de raisonnement utilitariste qui recourt aux catégories de l’action dans ses modalités ingénieriques : «moyen», «remèdes», «leviers», «processus», etc. Je crois que l’effondrement provient justement de cette logique d’emprise sur le monde et les êtres humains, et il me semble, par conséquent, que la reproduction de ce type de raisonnement concourt, par nature, à la réalisation de ce que, pourtant, sa conception avait originellement pour but d’éviter. La raison est assez simple, je n’invente rien : dans un système technicien, ce n’est plus l’acteur qui se trouve à l’origine de l’action, lui-même n’est plus que le rouage d’un système, si bien que nous n’avons plus prise sur la mégamachine. Elle doit désormais vivre son destin, jusqu’à son terme très certainement tragique : tout ce que nous pouvons faire relève donc de l’éthique, c’est-à-dire de la formation de l’âme. Rester debout au milieu des ruines, se tenir à «hauteur d’homme» (c’est l’expression très juste que tu utilises dans ton commentaire de La route dans la Zone), voilà la tâche assignée à ceux qui refusent de se mêler aux derniers hommes. Il est d’ailleurs significatif que les périodes d’effondrement s’accompagnent du fleurissement de philosophies non plus ontologiques et politiques mais éthiques, je pense bien sûr ici à l’épicurisme et au stoïcisme de la période hellénistique. Quand «sauver les phénomènes», c’est-à-dire le monde et la cité, n’est plus possible, alors la sotériologie s’adresse à la seule intériorité qui prend la forme obsidionale d’une «citadelle», pour reprendre ici la célèbre expression de Pierre Hadot.
Mais quelle citadelle peut bien bâtir un homme postmoderne perdu dans le désert de la post-apocalypse ? Je pense à l’unique et magnifique roman de George Stewart, La Terre demeure. Après une pandémie qui a décimé la planète, le héros, Ish, rencontre miraculeusement quelques-uns de ses congénères et parvient à former une tribu qui s’étoffe au fur et à mesure du récit, jusqu’à compter trois générations et une trentaine de membres. Ish fréquente la bibliothèque, lit les ouvrages qu’elle contient, tisse de la sorte un lien entre passé et avenir afin de donner un sens au présent; mais aucun membre de la Tribu ne souhaite recevoir son enseignement, en dehors d’un fils qui, malade, mourra. Le seul intérêt des autres réside dans la chasse à la conserve dans les allées des supermarchés de l’ancien monde : ils demeurent de stupides consommateurs vivant dans l’instant, réduisant l’existence à la vie biologique, à la survie, sans aucun attrait pour ce que Hannah Arendt nommait la «vie de l’esprit», c’est-à-dire l’essence symbolique de l’être humain. Ce que laisse entrevoir le roman est bien une régression de l’humanité à l’animalité, dont on voit bien que l’érosion progressive du langage, ici symbolisée par le refus des livres, constitue le moteur. Je conclus en forme de retour sur le paragraphe précédent : quelle sorte de citadelle intérieure peuvent construire des consommateurs ? Quelle prophylaxie peuvent-ils déployer quand la perception du monde se limite à l’écoute de ses besoins vitaux ?
Juan Asensio
Le roman de George R. Stewart, réédité par les éditions Fage avec ma préface, est en effet assez remarquable. Revenons à cette Référence, que tu exposes par le menu dans l’avant-dernier chapitre de ton livre. Sans trop entrer dans les détails de ta démonstration, tu sembles admettre, avec Pierre Legendre, que cette Référence ultime n’est point tant Dieu que la possibilité même de garantir une fidélité à des principes universels, non pas tant une nature humaine univoque bien sûr, soit l’universalisme benêt et même benoîtement criminel des Droits de l’Homme qui seront invoqués pour justifier l’anéantissement de populations entières de colonisés, que «l’inscription institutionnalisée de l’être humain dans le monde» (p. 225), autrement dit l’universalité. Cette universalité ne peut être garantie que par ladite Référence définie comme possibilité analogique : l’homme se réfère à l’univers et y lit sa destinée et, partant, il ne peut s’y sentir comme une quantité négligeable, vouée à s’agiter l’espace de quelques secondes misérablement, absurdement. Cette visée est donc politique, politico-philosophique même, au sens le plus noble du terme : tu cherches les conditions pour rebâtir ce qui ne cesse d’être détruit ou qui menace à tout instant de s’effondrer.
Pourtant, tu n’évoques guère une autre possibilité, à vrai dire indiquée par le sujet même qui est le tien : l’Apocalypse qui est Révélation et, dans sa dimension messianique, Restauration. Comment articuler ce retour et recours nécessaire à la Référence, à laquelle il nous est toujours possible de participer et un versant plus surnaturel et dont nous ne sommes absolument pas les maîtres, qui hante cependant les religions du Livre, la réflexion politique mais aussi l’imaginaire humain au sens le plus large, depuis des temps immémoriaux ?
Baptiste Rappin
Ta question m’est douloureuse, car elle interroge directement mon rapport tourmenté au christianisme. Je me rappelle ta réaction quand tu as découvert la première phrase de la quatrième de couverture, avant même la parution de l’ouvrage; tu me fis très précisément remarquer : «mais «apocalypse» s’écrit avec un «A» majuscule !». J’ai pourtant choisi de conserver la minuscule, non seulement à cet endroit, mais également à chacune des occurrences du terme dans le livre. Et je crois que l’on retrouve ici la dichotomie naturel/surnaturel sur laquelle tu construis le raisonnement de ta question. Mais ces catégories me sont, pour ainsi dire, étrangères, dans le sens où je me réclame d’un héritage avant tout grec qui privilégiera les dualités sensible/intelligible ou visible/invisible à la dichotomie naturel/surnaturel.
Comme Heidegger et contre Gilson, je tiens qu’il ne peut exister rien de tel qu’une philosophie chrétienne, que ce qu’il peut y avoir de philosophique dans le christianisme relève de la philosophie et non du christianisme, que la foi est une modalité de la connaissance étrangère au logos. Et les chrétiens conséquents combattent, à juste titre donc, la raison naturelle, c’est-à-dire la philosophie, au nom de la Révélation et de ses messages, anathème que l’on retrouve dans toutes les formes religieuses de désintermédiation qui vont du protestantisme aux hérésies issues de la doctrine évolutionniste, de l’abbé calabrais Joachim de Flore jusqu’à l’attente messianique d’un Léon Bloy et à la théologie de Jean-Luc Marion («Dieu sans l’être»).
Mais il se trouve qu’en même temps la patristique puis la scolastique se formulèrent dans les catégories de la philosophie grecque, que cette même philosophie – non sans déformations voire trahisons – chemina jusqu’à nous par l’intermédiaire des théologiens du Livre. Et que l’Église fut l’institution qui permit à la civilisation européenne, sous la forme de la Chrétienté, de perdurer. Les États modernes se construisirent sur le modèle du droit canon, l’administration calqua sa structure sur la bureaucratie céleste, l’Université médiévale consacra dans ses statuts le «droit souverain de l’esprit» qui fait plus que défaut à son épigone postmoderne. Bref, nous devons tant au catholicisme.
Alors y a-t-il une intervention surnaturelle dans le cours des sociétés humaines ? Je l’ignore et ne saurais le savoir, mais je puis l’envisager comme une possibilité. Et si la réponse était négative, cela signifierait-il que les humains seraient maîtres de leur destin et de leur histoire ? Je ne le crois guère. Intervention divine ou non, irruption du surnaturel dans l’histoire ou non, de toute façon, les humains ne sont pas maîtres de leur destinée dans la mesure où, jetés dans le monde, ils sont les enfants moins de leurs parents biologiques que d’un Texte, c’est-à-dire de la Parole de la Référence.
C’est la raison pour laquelle mon propos est bien de facture anthropologique, et non pas théologique, et que la possibilité de l’Apocalypse, au sens qu’elle prend dans l’Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, n’est guère évoquée. On peut d’ailleurs y voir une ligne de démarcation très nette entre le travail de Jean Vioulac et le mien : dans Apocalypse de la Vérité, ouvrage paru en 2014 et très certainement moins connu que les autres, Jean Vioulac enterre le logos grec dont la nature métaphysique a conduit à la dévastation de la planète, et cherche à ressourcer la pensée auprès de l’Incarnation et du logos johannique : «Parce que la catastrophe contemporaine est l’accomplissement téléologique du Commencement grec, la pensée est par sa détresse contrainte à la «nécessité de préparer l’autre Commencement», et il s’agit alors de rompre avec le destin de la Grèce […]» écrit ainsi le philosophe (p. 97). L’autre commencement, c’est bien sûr la voie chrétienne que la métaphysique a étouffée.
Je m’inscris en faux contre ce choix destinal : je tiens que l’emballement de la raison tient moins à la métaphysique grecque, qu’à une trahison envers celle-ci, que le logos s’est montré infidèle à lui-même, comme charmé et hypnotisé par sa propre puissance au lieu de rester aimanté par l’horizon du Vrai, du Bien et du Beau. Aussi, si Restauration il doit y avoir, je la perçois moins comme un autre Commencement, fût-il celui de l’Incarnation, que comme un retour, et même un retour à Ithaque, comme une Odyssée donc : comme la répétition du commencement grec





























































 Imprimer
Imprimer