« Les braves gens ne courent pas les rues de Flannery O’Connor, par Gregory Mion | Page d'accueil | Battling Malone (pugiliste) de Louis Hémon : la barbarie des aristocrates et l’humanité des prolétaires, par Gregory Mion »
28/03/2023
Le Passager de Cormac McCarthy

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Cormac McCarthy dans la Zone.
Cormac McCarthy dans la Zone.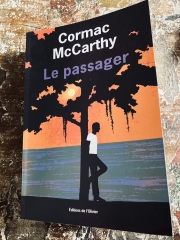 Acheter Le Passager sur Amazon.
Acheter Le Passager sur Amazon.C'est en lisant Borges dans ses Otras Inquisiciones, bizarrement traduites en français par Enquêtes, que j'ai pour la première, et dernière fois aussi, du moins jusqu'à ce que Cormac McCarthy ne me la remette sous les yeux dans son Passager (1), lu la phrase que Daniel von Czepko écrivit en 1655, extraite de Sexcenta monodisticha sapientum (III, II), qui suit : «Vor mir war keine Zeit, nach mir wird keine seyn», immédiatement suivie de ce passage que ne reprend pas Cormac McCarthy, «Mit mir gebiert sie sich, mit mir geht sie auch ein», que nous pourrions traduire par quelque proposition de solipsisme aussi radical que : Avant moi il n'y avait pas de temps, après moi il n'y en aura pas et Avec moi il est né, avec moi il mourra aussi.
Chez Cormac McCarthy, une citation est toujours un indice, forcément partiel, du sujet, du moins de l'un des thèmes, sans doute le plus profond et essentiel du Passager, qui réside dans un questionnement sur ce que l'on entend par réalité, par quelle grande catégorie de truchement intellectuel, verbal ou mathématique en l'occurrence, on tentera d'en rendre compte et aussi, de quelle façon on parviendra à la sauver, à retarder le plus possible son extinction, le long labeur du temps pour le dire avec John
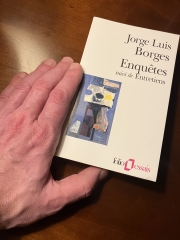 Brunner étant notre allié le plus précieux, et aussi notre ennemi le plus acharné. C'est donc aussi bien sûr lier la trame pouvant paraître simpliste mais pas moins lacunaire du Passager à la redoutable question du temps, que ce même diable ironique et ingénieusement érudit que fut Borges tenta de réfuter dans le texte citant Daniel von Czepko dès son ouverture et se refermant par une autre citation, celle-ci provenant de L'errant chérubinique datant de 1675 d'Angelus Silesius, distique que je donne ici dans sa langue originale : «Freund, es ist auch genug. Im Fall du mehr willst lesen, / So geh und werde selbst die Schrift und selbst das Wesen» et que Roger Munier a traduit par «Ami, j'arrête là. Si tu veux lire encore, / Va, toi-même deviens l'écriture et l'essence», une injonction assez mystérieuse, qui semble nous éloigner de toute forme de littérature et même de parole autre qu'intérieure, qui pourrait nous donner, mais il est encore trop tôt pour le dire, une des clés interprétatives, qui sait, du Passager et peut-être même de Stella Maris ou, pourquoi pas, des derniers mots, sans doute, que couchera publiquement Cormac McCarthy sous forme de roman crépusculaire, totalement inutile devant l'ultime confrontation, celle qui se passera de toute parole je l'ai dit autre qu'intérieure, unique, essentielle, et comme telle éternelle car elle ne sera pas perdue et sera recueillie et sera conservée jusqu'à l'ultime seconde de l'univers et même au-delà.
Brunner étant notre allié le plus précieux, et aussi notre ennemi le plus acharné. C'est donc aussi bien sûr lier la trame pouvant paraître simpliste mais pas moins lacunaire du Passager à la redoutable question du temps, que ce même diable ironique et ingénieusement érudit que fut Borges tenta de réfuter dans le texte citant Daniel von Czepko dès son ouverture et se refermant par une autre citation, celle-ci provenant de L'errant chérubinique datant de 1675 d'Angelus Silesius, distique que je donne ici dans sa langue originale : «Freund, es ist auch genug. Im Fall du mehr willst lesen, / So geh und werde selbst die Schrift und selbst das Wesen» et que Roger Munier a traduit par «Ami, j'arrête là. Si tu veux lire encore, / Va, toi-même deviens l'écriture et l'essence», une injonction assez mystérieuse, qui semble nous éloigner de toute forme de littérature et même de parole autre qu'intérieure, qui pourrait nous donner, mais il est encore trop tôt pour le dire, une des clés interprétatives, qui sait, du Passager et peut-être même de Stella Maris ou, pourquoi pas, des derniers mots, sans doute, que couchera publiquement Cormac McCarthy sous forme de roman crépusculaire, totalement inutile devant l'ultime confrontation, celle qui se passera de toute parole je l'ai dit autre qu'intérieure, unique, essentielle, et comme telle éternelle car elle ne sera pas perdue et sera recueillie et sera conservée jusqu'à l'ultime seconde de l'univers et même au-delà.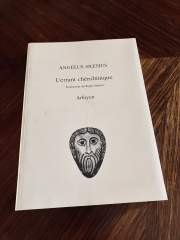 Comment parler, dans le cas d'un écrivain n'ayant aucun problème à se taire véritablement (c'est-à-dire médiatiquement, en se tenant prudemment éloigné des médias) durant des années entre la parution de chacun de ses romans, d'une quelconque urgence ? C'est pourtant cette urgence, répétée de roman en roman depuis au moins Suttree, splendide parabole se déroulant dans une lumière phosphorescente, venue d'un gouffre sur lequel on n'ose se pencher, que signifie Le Passager, mince rai de lumière paradoxale trouant l'épaisseur de la nuit, tout proche d'être englouti par elle, comme une espèce de course contre la montre infernale car on la sait promise à l'échec devant la certitude que le train pris pour aller de Boston jusqu'à Mexico ne retardera certes pas l'intrusion de la mort, mais dilatera, du moins il faut l'espérer, la bulle si fragile du présent destinée à être crevée puis jetée au fond de quelque barranca aux flancs escarpés, comme nous le montre un très beau texte de Conrad Aiken qui jamais n'écrivit que pour dérouler le long flux de sa mémoire et ainsi, lui aussi, à sa façon, ralentir le fin inéluctable de tout récit, de toute remémoration. Dans Un cœur pour les dieux du Mexique, l'héroïne meurt aux toutes dernières pages du livre alors que celle du Passager est déjà morte avant même que ne commence l'histoire, mais je crois pourtant que les personnages masculins de ces deux romans, comme d'ailleurs le Consul de Sous le volcan de Malcolm Lowry, essaient de toutes leurs forces de retrouver celle qu'ils vont perdre ou qu'ils ont perdue, et, dans les deux cas, échouent.
Comment parler, dans le cas d'un écrivain n'ayant aucun problème à se taire véritablement (c'est-à-dire médiatiquement, en se tenant prudemment éloigné des médias) durant des années entre la parution de chacun de ses romans, d'une quelconque urgence ? C'est pourtant cette urgence, répétée de roman en roman depuis au moins Suttree, splendide parabole se déroulant dans une lumière phosphorescente, venue d'un gouffre sur lequel on n'ose se pencher, que signifie Le Passager, mince rai de lumière paradoxale trouant l'épaisseur de la nuit, tout proche d'être englouti par elle, comme une espèce de course contre la montre infernale car on la sait promise à l'échec devant la certitude que le train pris pour aller de Boston jusqu'à Mexico ne retardera certes pas l'intrusion de la mort, mais dilatera, du moins il faut l'espérer, la bulle si fragile du présent destinée à être crevée puis jetée au fond de quelque barranca aux flancs escarpés, comme nous le montre un très beau texte de Conrad Aiken qui jamais n'écrivit que pour dérouler le long flux de sa mémoire et ainsi, lui aussi, à sa façon, ralentir le fin inéluctable de tout récit, de toute remémoration. Dans Un cœur pour les dieux du Mexique, l'héroïne meurt aux toutes dernières pages du livre alors que celle du Passager est déjà morte avant même que ne commence l'histoire, mais je crois pourtant que les personnages masculins de ces deux romans, comme d'ailleurs le Consul de Sous le volcan de Malcolm Lowry, essaient de toutes leurs forces de retrouver celle qu'ils vont perdre ou qu'ils ont perdue, et, dans les deux cas, échouent.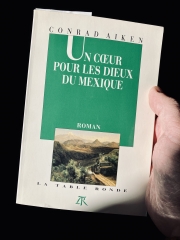 Cette intention fébrile chez Cormac McCarthy, peut-être même réellement désespérée, que nous pourrions rapprocher de celle d'un Duns Scot tentant de trouver quelque cause par soi de l'individuation qui n'est rien d'autre qu'une forme d'indivisibilité ne pouvant être tronçonnée en parties subjectives, cette visée propre à l'édification de quelque arche ultime est elle-même sujette à caution car les nombreuses discussions, parfois assez techniques ou paraissant n'être que des digressions savantes mais hors-sujet, sur des questions arides de mathématiques, par définition assez éthérés pour le commun des mortels, ne parviennent pas à résoudre la double aporie de la mort, par suicide, d'Alicia, la jeune sœur prodige du personnage principal, Bobby Western au nom symbolique, et celle du déclenchement du feu nucléaire, «spectre fongiforme qui avait fleuri dans l'aube tel un lotus maléfique, cette fusion de solides qui n'avaient jamais été censés fondre [et qui] renfermaient une vérité propre à faire taire toute poésie pendant mille ans» (p. 162), surrection de l'effroi planétaire devant la puissance inimaginable de l'atome évoquée plusieurs fois, mais jamais de façon plus sidérante que dans une scène (cf. p. 514 : «Des petites bêtes prostrées hagardes dans ce soleil soudain et impie avant de n'être plus») qui est le calque inversé, démoniaque, d'une autre scène, inoubliable, décrivant l'allégeance fascinée des créatures de la nuit fixant un arbre en feu touché par la foudre dans Méridien de sang. Non seulement, donc, «la physique tente de figurer le monde avec des nombres», ce qui est une parfaite évidence mais, comme le dit l'un des personnages à Bobby Western, Asher, il n'est pas certain «que ça explique quoi que ce soit» (p. 218), surtout si le simple fait de perdre, dans la tentative de façonner une théorie scientifique, une seule dimension physique, d'oublier la prise en compte de quelque furtif x dans l'équation à tant d'inconnues exotiques, impliquait d'abdiquer «tout droit au réel» (p. 159). En clair, bien plus que les mathématiques et les théories physiques n'empêchent notre monde de sombrer, elles bâtissent des univers sans doute puissamment fascinants mais parfaitement impossibles à habiter pour les banales créatures à trois dimensions que nous sommes. Leur évidence semble même à ce point glaciale qu'elles conduisent une jeune femme aussi belle qu'intelligente à se tuer, peut-être parce que le mystère de sa propre inconnue forcerait inconsidérément la matrice et fausserait par trop abusivement le si bel ordonnancement de l'équation.
Cette intention fébrile chez Cormac McCarthy, peut-être même réellement désespérée, que nous pourrions rapprocher de celle d'un Duns Scot tentant de trouver quelque cause par soi de l'individuation qui n'est rien d'autre qu'une forme d'indivisibilité ne pouvant être tronçonnée en parties subjectives, cette visée propre à l'édification de quelque arche ultime est elle-même sujette à caution car les nombreuses discussions, parfois assez techniques ou paraissant n'être que des digressions savantes mais hors-sujet, sur des questions arides de mathématiques, par définition assez éthérés pour le commun des mortels, ne parviennent pas à résoudre la double aporie de la mort, par suicide, d'Alicia, la jeune sœur prodige du personnage principal, Bobby Western au nom symbolique, et celle du déclenchement du feu nucléaire, «spectre fongiforme qui avait fleuri dans l'aube tel un lotus maléfique, cette fusion de solides qui n'avaient jamais été censés fondre [et qui] renfermaient une vérité propre à faire taire toute poésie pendant mille ans» (p. 162), surrection de l'effroi planétaire devant la puissance inimaginable de l'atome évoquée plusieurs fois, mais jamais de façon plus sidérante que dans une scène (cf. p. 514 : «Des petites bêtes prostrées hagardes dans ce soleil soudain et impie avant de n'être plus») qui est le calque inversé, démoniaque, d'une autre scène, inoubliable, décrivant l'allégeance fascinée des créatures de la nuit fixant un arbre en feu touché par la foudre dans Méridien de sang. Non seulement, donc, «la physique tente de figurer le monde avec des nombres», ce qui est une parfaite évidence mais, comme le dit l'un des personnages à Bobby Western, Asher, il n'est pas certain «que ça explique quoi que ce soit» (p. 218), surtout si le simple fait de perdre, dans la tentative de façonner une théorie scientifique, une seule dimension physique, d'oublier la prise en compte de quelque furtif x dans l'équation à tant d'inconnues exotiques, impliquait d'abdiquer «tout droit au réel» (p. 159). En clair, bien plus que les mathématiques et les théories physiques n'empêchent notre monde de sombrer, elles bâtissent des univers sans doute puissamment fascinants mais parfaitement impossibles à habiter pour les banales créatures à trois dimensions que nous sommes. Leur évidence semble même à ce point glaciale qu'elles conduisent une jeune femme aussi belle qu'intelligente à se tuer, peut-être parce que le mystère de sa propre inconnue forcerait inconsidérément la matrice et fausserait par trop abusivement le si bel ordonnancement de l'équation.Identiquement, la force du Verbe, sa capacité à dire quelque chose d'un monde sur l'horreur fondamentale duquel Cormac McCarthy insiste à plusieurs reprises, est à son tour plus d'une fois remise en question, car «l'héritage du verbe est chose fragile malgré toute sa puissance» (p. 191), comme l'illustrera la consomption du langage que nous avons analysée dans La Route, le monde mourant lentement et entraînant dans sa disparition cendreuse la parole devenue grise, inutile, incapable de faire revivre, ni même évoquer un monde disparu, effondré. Si donc «numération et nomination sont les deux faces d'une même pièce» (p. 269, en italiques) parfaitement démonétisée, et en considérant le fait que Sheddan et Western, hommes de mots et de nombres, savent tous deux lequel l'emportera sur l'autre (cf. p. 195), il nous semble que Le Passager porte un titre qui évoque de manière assez transparente une errance existentielle voire ontologique qui dépasse bien sûr le cadre de la seule disparition, pour le moins énigmatique, d'un des occupants d'un avion dont la carcasse rouille au fond des eaux, et que Bobby Western est descendu fouiller, arrachant aux ténèbres le visage décomposé des passagers dont l'identité nous demeurera inconnue.
Car, il faut d'emblée le préciser aux lecteurs optimistes, c'est-à-dire imbéciles, Le Passager est un roman qui, comme Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme et, bien sûr, La Route, est hanté par la déliquescence de toute chose, et même la fin prochaine du monde, le motif pouvant être interprété comme un véritable cri d'alarme devant l'évidence d'un univers qui se délite, sans qu'il soit concevable de supposer qu'il accueillerait l'homme comme sa plus éminente création. Cormac McCarthy, dans l'une de ces belles scènes énigmatiques dont il a le secret, ouvre son roman sur le motif entrecroisé du suicide de l'héroïne surdouée et de l'effritement d'une réalité qui n'est plus vertébrée, oxygénée par le sacré : ainsi, le cadavre d'Alicia, «la tête inclinée et les paumes légèrement ouvertes», peut-il être comparé à «ces statues œcuméniques qui réclament par leur attitude qu'on prenne en compte leur histoire» mais aussi qu'on considère «les fondations du monde qui puise son essence dans le chagrin de ses créatures» (p. 7, toute la scène est en italiques). Nous ne savons trop ce qui est premier dans l'effondrement du monde, ce que Max Picard a appelé la fuite devant Dieu ou bien l'occultation de ce dernier, son mouvement inconcevable d'éclipse, d'amenuisement, de contraction, déçu de n'être plus le centre de l'attention labile de celui qu'Il a créé pour être célébré.
Qui, dans ce roman, éprouve un chagrin indicible ? Le frère d'Alicia évidemment, et pourtant, son chagrin ne lui suffit pas à bâtir un monde, ni même à parvenir à échapper aux antiques paradoxes d'une définition de la réalité ne débouchant sur rien d'autre, et cela à l'infini, que sur une tentative d'établir les contours de toute définition possible, la matrice rationnelle qui sera capable d'interpréter non pas le monde mais une partie infime de ce dernier, et cela en tenant bien sûr compte du fait que l'observation de la réalité ne peut que modifier cette dernière, comme n'a cessé de nous le répéter la théorie quantique depuis qu'elle a laissé planer le doute d'un Dieu stochastique, jouant aux dés, dans les plus fins esprits scientifiques du siècle passé : «Comme quoi la recherche d'une définition de la réalité était inexorablement enfouie dans et sujette à la définition qu'elle recherchait. Ou comme quoi la réalité du monde ne pouvait pas faire partie des catégories contenues dans ledit monde» (p. 71, en italiques). Son chagrin n'est pas même capable d'empêcher que le souvenir de sa sœur adorée, objet d'une passion incestueuse ne faisant guère de doute même si la barrière de l'acte n'a apparemment pas été levée, ne s'efface, même s'il semble placer Bobby Western dans un état qui lui permet, avant de pouvoir communiquer avec un des êtres grotesques, le Kid, ayant peuplé quotidiennement l'univers mental d'Alicia, d'accepter la présence «des créatures inconnues» (p. 440) habitant une «vieille ferme de l'Idaho» (p. 438) dans laquelle il a trouvé refuge. Non, Bobby Western ne se trouve jamais au seuil d'une révélation, comme si le moteur du récit ne survivait pas au récit, comme s'il s'agissait de se résoudre à ne pouvoir connaître que des pans de réalité coupés du domaine de leur création (cf. p. 417), comme si, une fois que la pièce s'est obscurcie et que le bruit des voix s'est estompé il avait compris que «le monde et tout ceux qu'il contient [allaient] bientôt cesser d'exister» (p. 418). Non, décidément, «toute perte est éternelle» (p. 529) et les plus longues et complexes discussions sur le concept de réalité n'apporteront qu'une consolation de façade.
Comment, dans ces conditions pour le moins problématiques et jetant un doute si profondément cartésien sur ce dont il est possible de s'assurer, essayer de définir sa propre identité, que la phénoménologie nous indique pourtant, malgré les innombrables coupures de la conscience, être indivisible, si «toute ligne d'univers est discrète et [si] les césures forment un vide sans fond» (p. 81) ? La fuite, l'errance, la tentative de fonder, même de façon éphémère, un havre de paix, du moins un refuge où se reposer et surtout fuir ses énigmatiques poursuivants qui, comme le mystérieux tueur du récit implacable d'Howard McCord, veulent votre peau, voilà qui est une réponse imparfaite, que l'on devine assez maigre, en ceci qu'elle figure une indécision insupportable, terminale, apocalyptique, l'étymologie de ce mot n'étant elle-même qu'un leurre puisque la révélation ne révèle rien, si ce n'est l'horreur principielle qui sera triomphante, aussi, à la fin : «Il aurait pu être le premier homme du monde. Ou le dernier» (pp. 87-8), et la certitude que le monde est ténèbres, leitmotiv obsédant du roman de Cormac McCarthy (2), ténèbres des origines cachant des créatures innommables et ténèbres qui viennent sur les ruines d'un passé «qui n'était même plus concevable» (p. 234) à quelques années pourtant de distance, «une noirceur sans nom ni mesure» (p. 147, en italiques), alors que «la nature de la nuit qui vient» (p. 177) est l'objet de supputations de plus en plus désabusées, s'il est vrai selon le romancier qu'il n'est nul «besoin d'être Nostradamus pour voir vers quoi on s'achemine», ainsi exposé sobrement : «Les plus haïssables des criminels réclameront un statut. Les tueurs en série et les cannibales revendiqueront le droit à leur mode de vie» (p. 198), une société panoptique, aux murs de béton plus transparents que ceux, en verre, du Nous autres de Zamiatine, où «tout le monde est en état d'arrestation» (p. 399), autant de sombres constats que Cormac McCarthy exposait, avant ce roman, par le truchement du personnage du shérif, aux idées pour le moins réactionnaires comme n'ont pas dû manquer de s'en effrayer les sots, de No Country for Old Men.
Comme les hommes qui sont sur les traces de Bobby Western, le contraignant à prendre la fuite, une menace sans nom rôde dans les derniers romans de Cormac McCarthy mais elle s'est affinée à l'extrême, spiritualisée pourrions-nous dire dans Le Passager, délaissant le recours à la figuration, la trop didactique cristallisation d'une substance dans un tube à essai que constateront tour à tour les élèves difficiles à étonner d'un cours de physique, autour d'un personnage fantasmatique comme celui du juge Holden ou du tueur Chigurh, menace imprécise, infigurable, inimaginable, «quelque bête trempée de sueur, quelque abomination sifflante et encapuchonnée pérégrinant sur le sentier» (p. 266, en italiques) qu'il est impossible de nommer mais dont nous sommes pourtant certains qu'elle ne demande qu'à éclore, se révéler au grand jour, telle une «chose impie» qui «déjà avait empoisonné et ramené à la boue primordiale tous les êtres vivants de ce territoire [et qui] était encore bien loin d'en avoir terminé» (p. 246), faisant advenir ce jour prochain «où toute mémoire de cet endroit et de ces gens serait rayée du registre du monde» (p. 249), propos et vocabulaire qui auraient pu être ceux de Méridien de sang, danger surnuméraire faisant naître cette aube où «le dernier témoin qui aurait pu mettre un nom sur ces visages repose sous terre entre quatre planches à côté d'eux et s'il n'est pas lui-même sans nom il le sera bientôt» (p. 268, en italiques).
Un univers gnostique, quelle que soit «l'inconcevable noirceur de la Terre» (p. 294), ménage toujours une porte de sortie, un corridor d'accès assurant la communication entre les différents univers, avant que «les ténèbres soudaines [ne s'abattent] comme une fonderie s'arrête pour la nuit» (p. 380), mais il semble que nul Marlow ne puisse selon Cormac McCarthy tenter de sauver notre Kurtz (mentionné p. 383) enfoncé au plus profond de la nuit, comme si Western avait eu l'idée saugrenue de «découvrir la vraie nature des ténèbres», la «ruche des ténèbres, la tanière d'icelles» (p. 386), et s'aventurer dans la «vastitude noire» pour n'y découvrir que l'informe qui tant fascina Arthur Machen et son si répétitif disciple Lovecraft, «rien qu'une énorme bouillabaisse qui s'agite dans la vase», «des baleines et des calamars», «des krakens avec des yeux comme des soucoupes et des testicules de trente mètres de long», et aussi «une grande puanteur et puis plus rien» (p. 387), comme s'il nous était définitivement impossible non seulement de remonter aux origines du monde, pour tenter de tomber sur une vérité première, quelque singularité imperturbable qu'il serait peut-être facile de désigner comme Dieu (3), mais aussi et surtout comme si nous étions condamnés à nous mouvoir dans un univers de pures apparences, car «on ne peut pas saisir le monde», on peut juste «dessiner une image», puisque «que ce soit un auroch sur le mur d'une caverne ou une équation aux dérivées partielles ça revient au même» (p. 391).
Les «portes de la nuit», ainsi que «l'antre des innommables» (p. 18, en italiques) nous sont hermétiquement fermées et, même si une Alicia ou son frère, sur ses traces, ont cru entrevoir la frontière du sombre royaume, se disant, peut-être, que «la bonté de Dieu se manifeste aux lieux les plus étranges» (p. 102), je crains qu'ils n'aient très vite, tous deux, renoncé à considérer que ce dernier avait encore quelque trace de puissance, Alicia par exemple l'ayant vu en rêve «pleurer sur l'argile froide de son corps d'enfant à un carrefour sans nom, agenouillé pour toucher son œuvre morte» (p. 265, en italiques), comme si nous ne pouvions décidément parier, avec une chance raisonnable de gagner, sur l'existence de Dieu, comme si nous ne pouvions que nous pénétrer que d'une seule assurance, désespérante bien davantage que propre à aiguiser notre lucidité, à savoir que «la torche du mal [est] toujours à l'abri du vent» (p. 395) et que le mal (cette fois-ci portant une majuscule dans le texte du romancier) «n'a pas de solution de repli [puisqu'il] est tout bonnement incapable d'envisager l'échec» (p. 513), souvenir lointain de Macbeth avouant qu'il lui serait plus difficile de faire un seul pas en arrière que de s'enfoncer dans la nuit.
Cormac McCarthy n'est jamais plus direct que lorsque son ton devient oraculaire, comme dans ce beau passage où un certain Jeffrey qui a connu Alicia lorsqu'elle était internée, résume admirablement le propos essentiel du Passager : «Je ne crois rien de Dieu. Je crois juste en Dieu. Kant avait tout compris quand il parlait du ciel étoilé au-dessus de soi et de la loi morale en soi. La dernière lumière que verra l'incroyant ne sera pas le soleil qui s'éteint. Ce sera Dieu qui s'éteint. Chacun naît avec la faculté de voir le miraculeux. Ne pas le voir, c'est un choix. Tu crois sa patience infinie ? Moi je crois qu'on arrive au bout. Je crois qu'il y a des chances qu'on soit encore de ce monde pour le voir se mouiller le bout des doigts et se pencher pour dévisser le soleil» (pp. 453-4).
Il ne nous semblera dès lors pas exagéré de prétendre que Le Passager est, comme Monsieur Ouine de Georges Bernanos, tout entier prophétique selon le mot d'Albert Béguin, et aussi que c'est un roman métaphysique questionnant la réalité d'un monde qui semble définitivement plongé dans les eaux profondes du mal, englouti dans les ténèbres, et qui par endroits, surtout au dernier chapitre, mime l'oralité de La Route, figurant un langage réduit à l'essentiel, «fragile chandelle vacillant dans les ténèbres» (p. 516), épure seule capable de transmettre quelque chose, si tant est qu'il reste encore quelque chose à transmettre à l'homme solitaire parcourant, sur cet avant-poste de la vieille Europe qu'est l'île d'Ibiza où Bobby Western s'est réfugié, «tant de vestiges de mondes éteints», «comme les ossements de navires dans les rochers des mers du lointain Nord» (p. 532).
Le constat final est donc beaucoup plus sombre si faire se peut que celui de La Route, où le fils pouvait encore témoigner (4) de ce que son père lui avait appris, de ce qu'il fut et de ce que fut le monde avant qu'il ne naisse et s'éveille à l'horreur d'un univers dévasté, mort, sans que jamais il ne nous soit précisé quelle est l'origine de cette dévastation qui, dans Le Passager, est sans ambiguïté rattachée à la surrection démoniaque de la bombe atomique, le propre père mort de Bobby Western (lui-même «solitaire coureur des rivages se hâtant pour distancer la nuit, infime et sans ami et valeureux» (p. 535)), ayant «créé avec la pure poussière de la terre un soleil maléfique à la lumière duquel chaque homme voyait à travers linge et chair, tel un hideux présage de sa propre fin, les os dans le corps de l'autre» (p. 515) : «Voici une histoire. Le dernier d'entre les hommes seul dans l'univers qui s'enténèbre autour de lui. Qui pleure toutes choses d'un unique chagrin. Des vestiges pitoyables et exsangues de ce qui fut son âme il ne tirera rien dans quoi confectionner la moindre chose divine pour le guider en ces derniers des jours» (p. 513). Dans La Route encore, nous nous souvenons que le geste en apparence le plus banal de l'enfant était capable, selon son père, de créer de nouveaux mondes peut-être préservés de la destruction, car leur germe était celui d'une célébration.
Alors ce sera la nuit, de fer ou de plomb, et les ténèbres recouvriront tout, comme au début. Ce n'est pas une vue de l'esprit puisque «la vérité du monde constitue une vision si terrifiante qu'elle fait pâlir les prophéties du plus lugubre des augures que la Terre ait jamais portés». Alors, il faudra bien admettre «l'idée que tout cela sera un jour réduit en poussière et éparpillé dans le néant», idée qui «devient moins une prophétie qu'une promesse» (p. 528), et, alors encore, «à la fin des fins», «il n'y aura plus rien qui ne puisse être simulé», toute chose pouvant être reproduite à l'infini, toute chose coupée de ses racines et produite à la demande, et alors et de nouveau, «ce sera l'ultime abolition des privilèges» car il n'y aura pas d'autre monde possible, à moins d'oser admettre que le seul autre monde possible, «c'est la stupeur qu'on lit dans ces silhouettes grotesques gravées au feu dans le béton» (p. 536), un monde infernal donc, dernier témoignage du feu infernal généré par l'homme s'étant pris pour Dieu, qui nous apporte l'effroyable certitude que l'univers, et l'homme qui s'y tient de moins en moins droit, a déjà été détruit quelques secondes après que des gens en flammes ne rampent «parmi les cadavres comme une vision d'horreur dans un immense crématorium», portant «leur peau dans leurs bras comme un ballot de linge pour ne pas qu'elle traîne dans les gravats et la cendre et ils se croisaient hébétés dans leurs trajets d'hébétude sur les vestiges fumants, ceux qui voyaient guère mieux lotis que les aveugles» (p. 161). Alors, il n'y aura plus aucun passager, le mot aura même perdu sa signification puisque nul passage ne sera plus possible d'un monde vers l'autre et que les hommes resteront saisis et comme pétrifiés de terreur en voyant que même les braises ne rougeoient plus dans les ténèbres universelles, comme le montrent les si éprouvantes dernières minutes du Cheval de Turin.
«Dans la nuit à venir il songea que des hommes s'assembleraient dans les collines. Allumant leurs maigres feux des actes et des pactes et des poèmes de leurs pères. Autour de documents qu'ils ne sauraient plus lire dans ce froid à en dépouiller les hommes de leur âme» (p. 405, je souligne).
Notes
(1) Cormac McCarthy, Le Passager (The Passenger, 2022, traduction de Serge Chauvin, Éditions de l'Olivier, 2023). Je signale, tant le fait est devenu rare, que le texte proposé aux lecteurs français a été excellemment relu et amendé. Je n'ai pas pris connaissance du roman dans sa langue originale mais il m'a semblé, bien qu'un lecteur m'ait fait remarquer que la langue des dialogues entre Alicia et le Thalidomide Kid était pour le moins difficile à rendre en français, que la traduction donnée par Serge Chauvin s'inscrivait dans le sillage de celles d'un François Hirsch. Je ne sais, donc, si cette traduction est aussi fidèle que possible, voire réussie, mais je constate qu'elle ne dépare en rien toutes celles qui nous ont fait découvrir les romans de Cormac McCarthy, singulièrement les plus récents, lui conférant un style immédiatement reconnaissable.
(2) Les occurrences de la nuit ou des ténèbres sont innombrables dans notre roman, qui l'apparentent à un roman que nous pourrions qualifier de gnostique comme l'est Méridien de sang mais aussi à la trilogie romanesque d'Ernesto Sabato, surtout le deuxième volume, Héros et tombes : «des ténèbres et un froid pétrifiant» (p. 42), «dans les ténèbres de ces profondeurs bathypélagiques» dans lesquelles s'enfonce Bobby Western exerçant le métier de plongeur pour y chercher, selon l'un de ses amis, «Dieu sait quoi» (p. 40), jusque «dans le noir sans origine» (p. 133) qui sera aussi celui de la fin du monde, puisque «les horreurs du passé s'émoussent, et ce faisant nous rendent aveugles à un monde qui se précipite vers des ténèbres excédant les hypothèses les plus amères» (p. 199).
(3) C'est bien une telle singularité, à elle-même sa propre origine et son propre témoin, qui seule serait capable de stopper l'infinie prolifération des causes et des conséquences, des propositions issues d'autres propositions, des équations enfantées par d'autres équations, à la lettre donc, le Verbe ou l'Un absolu : «Tu ne peux pas avoir quelque chose avant que se pointe autre chose. C'est ça le problème. S'il y a une seule chose tu ne peux pas dire où elle est ni ce qu'elle est. Tu ne peux pas dire si elle est grosse ou si elle est petite ni de quelle couleur elle est. Rien n'est quelque chose tant qu'il n'y a pas autre chose» (p. 270), rien assurément, hormis l'Origine, la Fondation, appelons-les : Dieu.
(4) Ce n'est plus le cas dans Le Passager : «Si tu ensevelis la clef du parchemin quelle autre pierre sacrée te fera voir ta perte ?» (p. 517).





























































 Imprimer
Imprimer