Rechercher : alain soral
Exterminez toutes ces brutes ! de Sven Lindqvist

 Joseph Conrad dans la Zone.
Joseph Conrad dans la Zone.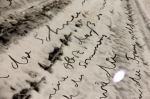 Apologia pro Vita Kurtzii.
Apologia pro Vita Kurtzii.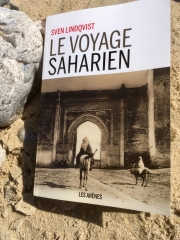 Acheter Le voyage saharien sur Amazon.
Acheter Le voyage saharien sur Amazon.Comme dans Les plongeurs du désert, un ouvrage que j'ai récemment évoqué, Sven Lindqvist est assailli par les rêves, souvent peu agréables, mais aussi par une certitude qui traversera toute l'étude intitulée Exterminez toutes ces brutes !, qui est sans doute son livre le plus connu : celle d'être déjà mort, mais celle, aussi, symboliquement, d'être confronté à une mort évidente, massive, connue de tous mais refusée également de tous (du moins de l'immense majorité de ses congénères), parce qu'elle a été reléguée dans les oubliettes de l'histoire de la colonisation.
J'avais déjà évoqué cette dimension dans une note que j'avais voici quelque temps consacrée à ce texte ô combien polémique de Lindqvist, dans laquelle j'écrivais : «En fait, comme Marlow dont il a reproduit le dangereux voyage, Lindqvist nous a rapporté du plus profond du désert, de sa propre âme donc, un savoir dont il soupçonnait la présence, comme Marlow sait, intimement, que presque rien ne le sépare de Kurtz, comme Macbeth sait qu'il ne pourra pas résister à la tentation et qu'il est déjà le meurtrier de son roi annoncé par les trois sorcières, comme nous savons que bien peu de choses nous séparent d'un de ces criminels errants décrits par Cormac McCarthy. C'est très vite que surgit, dès les toutes premières lignes du livre à vrai dire, cette affirmation douloureuse, qui sera plusieurs fois répétée jusqu'aux dernières pages : «J'aimerais disparaître dans ce désert où personne ne peut me joindre, où j'ai tout le temps possible. Disparaître et revenir seulement quand j'aurai compris ce que je sais déjà» (1). L'entrée dans le désert, alors même que l'auteur déclare ne pas aimer voyager (cf. p. 179), n'est évidemment pas anodine dans les ouvrages de Lindqvist, comme si la pénétration dans le silence et la solitude (certes entrecoupés de rencontres) était nécessaire pour faire advenir, à la surface de la conscience, ce qui y restait jusqu'alors enfoui, comme s'il fallait que la méditation sur la phrase célèbre de Kurtz, Exterminez toutes ces brutes ! ne puisse avoir réellement de sens qu'à l'unique condition, tel un nouveau Marlow, de s'enfoncer dans l'inconnu (un inconnu certes relatif, à notre époque, mais qui était une réalité parfaitement tangible durant la colonisation).
Il s'agit ainsi, en rejoignant la source occulte, l'organe battant chamade des ténèbres, de montrer ce qui est je l'ai dit une évidence, du moins pour Sven Lindqvist qui du reste affirme que tout le monde, peu ou prou, savait, non seulement que la colonisation, sous des dehors plus ou moins respectables, était une affreuse et sale besogne, une tâche non seulement humiliante pour les colonisés (et, aussi, dans une moindre part, pour les colons) mais bien souvent purement et simplement meurtrière, mais que l'extermination de peuples entiers par les colons européens n'a pu que rendre possible celle de plusieurs millions de Juifs et de Tziganes : «La phrase «Exterminez toutes ces brutes !» n'est pas plus éloignée du cœur de l'humanisme que Buchenwald de la Goethneaus à Weimar. Cette idée a été presque complètement refoulée», et cela «même par les Allemands, ajoute Lindqvist, dont on a fait les uniques boucs émissaires des théories de l'extermination, lesquelles, en réalité, appartiennent à toute l'Europe» (p. 186).
Posée tranquillement de la sorte, cette affirmation a pu déclencher, on le comprend, quelques tempêtes médiatiques, bien que la France, on se demande pourquoi sinon parce que ses prétendues élites journalistiques ne s'intéressent guère qu'à leur nombril, en ait été relativement épargnée, et surtout prêter le flanc à des critiques soulignant par exemple le fait que Sven Lindqvist va souvent assez vite en besogne et établit des parallèles qui sont, en vérité, d'audacieuses concaténations; ses détracteurs diraient même : des liens directs inopérants, d'odieux raccourcis journalistiques, comme celui-ci : «L'article de [Charles] Dilke», intitulé Civilization in Africa publié en 1896 dans la revue Cosmopolis, le mois même où Joseph Conrad écrivit Un avant-poste du progrès qu'il adressa, précisément, à cette même revue, «est une esquisse de la nouvelle de Conrad, laquelle préfigure Au cœur des ténèbres publié deux ans plus tard» (p. 213). Sven Lindqvist use et abuse de ces rapprochements, par exemple lorsqu'il compare l'épisode bien réel, ô combien célèbre, de Stanley sauvant Emin Pasha à celui de Marlow et de Kurtz, le premier prenant en charge la mémoire du second, charge que George Steiner illustrera de façon métaphorique en parlant de portage dans Le Transport de A. H. : «Tout comme Stanley a remonté le Congo pour sauver Emin, Marlow, dans le roman de Conrad, remonte le fleuve pour sauver Kurtz. Mais Kurt", ajoute Lindqvist, «ne veut pas être sauvé» (p. 239). Plus loin, Lindqvist usera et abusera, une fois encore, de ces rapprochements, par exemple entre Conrad et Wells, celui de la célèbre aventure du Docteur Moreau et de celle de l'homme invisible, ou encore entre Conrad et son ami R. B. Cuninnghame Graham, particulièrement celui de Mogreb-el-Acksa et de Higginson's Dream (qui bien sûr n'ont pas été traduits en français), l'un et l'autre paraissant préoccupés, selon notre chercheur, d'une unique question qu'il résume de la sorte : «Quelle que soit notre manière d'agir, notre simple présence semble constituer une malédiction pour tous les peuples qui ont conservé leur humanité originelle» (p. 295). Dans les dernières pages de son ouvrage, Sven Lindqvist résumera ses propos de sa façon habituellement claire et assurée : «Je ne prétends pas que Joseph Conrad ait entendu le discours de lord Salisbury. Il n'en avait pas besoin. Ce qu'il avait lu de Dilke dans Cosmopolis, de Wells dans La Guerre des mondes et de Graham dans Higginson's Dream lui avait suffi. Tout comme ses contemporains, Conrad ne pouvait pas éviter d'entendre parler des génocides incessants qui marquèrent son siècle» (p. 383).
Dans les pages qui suivent, Sven Lindqvist évoque les théories de Cuvier, Lyell et, le plus connu de ces savants, Darwin, appliquant la méthode qu'il déclare avoir suivie pour rédiger sa thèse de doctorat, et qui vaut pour son ouvrage, même si nous serions bien évidemment enclins à parler de parallèles frappants (ou saugrenus) plutôt que de véritables preuves : «Je n'ai jamais créé de figure plus fictive que le «je» du chercheur dans ma thèse de doctorat. C'est un «je» qui commence dans une ignorance feinte et qui, lentement, parvient au savoir, non pas de manière saccadée et hasardeuse, comme cela a été le cas, mais progressivement, preuve par preuve, selon les règles» (p. 326).
Dans son livre, Sven Lindqvist ne feint pas l'ignorance : nous l'avons vu, dès le début, il sait. Il sait que la colonisation des terres si riches en matières premières et précieuses par les Européens a été non seulement une très sale affaire mais qu'elle a multiplié les génocides et les exterminations. Il sait, surtout, que le pire reste à venir lorsqu'il déclare, avec l'assurance de ce que nous pourrions appeler, à la suite de Barbey d'Aurevilly, un prophète du passé : «La pression de milliards de personnes affamées et désespérées n'est pas encore assez forte pour que les puissants envisagent la solution de Kurtz comme la seule humaine, la seule possible, la seule profondément logique. Mais ce jour n'est pas tellement éloigné. Je le vois venir. C'est pour cela que j'étudie l'histoire» (p. 342) affirme Lindqvist, qui sait aussi que les génocides n'ont pas commencé avec le nazisme car Adolf Hitler, pas plus que Joseph Conrad, n'avait besoin de se trouver à l'Albert Hall quand lord Salisbury prononça son discours sur le phénomène de la colonisation d'immenses territoires par les Européens et, surtout, la nécessité impérieuse de séparer les nations du monde en vivantes et mourantes, les fortes devenant de plus en plus fortes et, logiquement, les faibles de plus en plus faibles, les secondes pouvant du coup être rasées par les premières : «L'air qu'il [Hitler] respirait dans son enfance, ainsi que tous les autres Occidentaux, était baigné par la conviction que l'impérialisme est un processus nécessaire biologiquement et qui, selon les lois de la nature, conduit à l'élimination inévitable des races inférieures» (p. 383).
Sven Lindqvist ne conteste pas l'unicité de la Shoah comme a pu implicitement le faire un Richard L. Rubinstein dans son Genocide and Civilization paru en 1987, mais il en limite fortement la portée. En effet, la Shoah fut unique en Europe, parce que les plans nazis consistaient à éliminer totalement les Juifs mais, ajoute aussitôt l'auteur, «l'histoire de l'expansion occidentale dans d'autres parties du monde montre maints exemples d'extermination totale de peuples entiers» (p. 412). Et Sven Lindqvist de préciser sa pensée concernant le nazisme et, singulièrement, celui qui en fut le chef : «Hitler lui-même fut guidé durant toute sa carrière politique par un antisémitisme fanatique qui trouvait ses racines dans une tradition millénaire, tradition qui avait souvent conduit à des massacres de Juifs. Mais le pas entre massacre et génocide ne fut pas franchi avant que la tradition antisémite ne rencontre la tradition du génocide qui avait surgi durant l'expansion européenne en Amérique, en Australie, en Afrique et en Asie» (p. 414). Et, au cas où nous n'aurions pas compris à quelle conclusion Sven Lindqvist veut nous faire parvenir (lui qui, comme je l'ai dit, a vite compris cette évidence), la voici très clairement exposée, avec la clarté de celui qui sait qu'il n'a pas à forcer le ton pour établir une évidence : «Auschwitz fut l'application moderne et industrielle d'une politique d'extermination sur laquelle reposait depuis longtemps la domination du monde par les Européens» (p. 415, je souligne).
Nous voici non pas parvenus, avec les camps d'extermination, au cœur des ténèbres, mais plutôt très en aval du fleuve qui en coule, Joseph Conrad ayant, lui, réussi à remonter jusqu'à la source empoisonnée, qu'il a figurée sous les traits de Kurtz et, derrière lui pour ainsi dire, comme l'inimaginable et pour le coup non figurable noyau de corruption, Kurtz pour lequel Marlow, et Lindqvist ne relève guère ce point dans son livre, mentira, ne craindra pas de mentir comme si, à l'instar de Lord Jim, plus que lui encore peut-être, il était, malgré sa folie destructrice, l'un des nôtres, comme si, en somme, Conrad lui-même, par le biais de son célèbre narrateur, admettait que nous ne pouvions pas ne pas savoir quelle horreur se tapissait sous les dehors d'une mission prétendûment civilisatrice : la conquête des plus faibles par les plus puissants. Sven Lindqvist s'étonne ainsi qu'il se trouve encore «des lecteurs du roman de Conrad pour affirmer qu'il manque d'universalité et de portée générale», alors même que, malgré les silences diplomatiques et les fermes dénégations entourant cette dramatique question, «tout le monde était au courant» (p. 432) du cauchemar qu'était la colonisation. Et, poursuit l'auteur, «lorsque ce qui avait été commis au cœur des ténèbres se répéta au cœur de l'Europe, personne ne le reconnut», personne «ne voulut reconnaître ce que chacun savait» (p. 433), et cela tandis que nous le savions et savons déjà, nous assure Sven Lindqvist aux toutes dernières lignes de son ouvrage, car «ce ne sont pas les informations qui nous font défaut», puisque ce qui nous manque, ce ne sont pas les informations, les procès-verbaux minutieux et les relations méthodiques des explorateurs rendant compte des punitions corporelles quotidiennes, des mauvais traitements infligés aux populations colonisées, sans compter leur extermination pure et simple, car, donc, «ce qui nous manque, c'est le courage de comprendre ce que nous savons et d'en tirer les conséquences» (p. 434).
Note
(1) Sven Lindqvist, Exterminez toutes ces brutes ! in Le voyage saharien (traduit du suédois par Alain Gnaedig, Les Arènes, 2018), p. 177.
21/09/2019 | Lien permanent
Les Apocalypses de Ray Bradbury, par Francis Moury

Notes de lecture sur Ray Bradbury, L'Homme illustré [The Illustrated Man] (1951), traduction C. Andronikof, éditions Denoël, collection Présence du futur, 1954.
Ce recueil classique de nouvelles de science-fiction peut trouver place dans une anthologie eschatologique car quatre nouvelles ont la fin du monde pour sujet.
1) The Highway [La grand-route] (pages 55 à 59) constitue un traitement minimaliste de l'apocalypse atomique. Cette nouvelle est intéressante pour cette raison stylistique mais s'avère, somme toute, assez décevante. Un paysan mexicain voisin d'une route frontalière avec l'Amérique, est surpris par le nombre considérable et inhabituel de voitures qui remontent en direction du Nord. Il alimente en eau le radiateur de la dernière, retardataire, conduite par un adolescent et ramenant de très jeunes filles en larmes. «Vous ne savez pas ?» [...] répondit l'autre en se retournant et en agrippant le volant. Il se pencha. «C'est arrivé.» [...]» (page 58). Quoi donc ? «La fin du monde»... mais le paysan mexicain en question ne comprend pas la sens de la notion ou du concept de monde. Il saisit bien que quelque chose d'anormal se passe, il en est angoissé et c'est au lecteur de prendre sur lui-même le fardeau de la terrible information, le héros en étant mentalement incapable. Il y a quelque chose de faulknérien dans ce quasi-monologue d'un univers mental débile mais cette décalcomanie faulknérienne n'est pas assez sincère pour emporter l'adhésion. On reste sur sa faim.
2) The Last Night of the World [titre très mal traduit par La Nuit dernière alors qu'il aurait fallu bien évidemment le traduire par La Dernière nuit] (pages 123 à 127) est lui aussi minimaliste mais plus intéressant car plus original. Le 19 octobre 1969, un homme avoue à son épouse avoir rêvé que le monde allait finir durant la nuit suivante. Tous ses collègues de bureau ont fait le même rêve. Son épouse lui confirme que les femmes de son quartier ont également rêvé le même avertissement. Le doute n'étant plus permis, la résignation individuelle comme collective l'emporte sur la peur. Les informations du soir de la télévision et de la radio n'annoncent pas la nouvelle : tout le monde la connaît et sa redondance semble inutile. Sans rien avouer à leurs deux petites filles, les deux époux agissent comme chaque jour puis se couchent en se souhaitant mutuellement bonne nuit, sachant qu'aux alentours de minuit, tout le monde mourra. La curiosité ici provient de deux éléments : le rêve prophétique collectif et le traitement mi-psychologique, mi-sociologique d'une résignation qui n'est à proprement parler ni religieuse ni athée mais purement rationnelle et morale. Ici l'Apocalypse est annoncée, en route mais pas encore survenue en dépit du fait que Bradbury annihile d'avance, semble-t-il, tout suspense possible relativement à sa définitive réalité. Par-delà la banalité des propos parfois très platement moralistes échangés par le couple protagoniste, un terrible poids pèse du début à la fin sur la nouvelle.
3) The Exiles [Les Bannis] (pages 128 à 143) traite d'une apocalypse beaucoup plus originale, à savoir l'apocalypse littéraire. Cette nouvelle annonce son roman de politique-fiction Fahrenheit 451 (publié en 1953 puis traduit en 1955 chez le même Denoël et adapté au cinéma par François Truffaut en 1966) mais elle est beaucoup moins connue que ce dernier.
Elle se rattache assurément autant à la politique-fiction qu'à la science-fiction par son cadre : en 2120, des cosmonautes terriens, en route vers Mars dans une fusée, sont assaillis par d'étranges cauchemars qui finissent par tuer certains d'entre eux. La cause s'en trouve sur Mars car les fantômes des grands auteurs de la littérature fantastique anglaise et américaine, y survivent tels des bannis : ils y ont trouvé refuge alors que la Terre brûle leurs livres depuis cent ans, dominée par un régime pseudo-rationaliste détruisant purement et simplement ce qu'il considère irrationnel. Les corps et les âmes de William Shakespeare, d'Edgar Allan Poe, d'Ambrose Bierce, d'Algernon Blackwood, d'Arthur Machen, et d'autres écrivains y sont encore animés d'une vie, certes chétive mais pourtant capable d'influencer, à distance et par magie, les cauchemars des pionniers humains. Cauchemars mortels destinés à faire échouer cette colonisation car, de fait, si ces pionniers ignorent certes tout des succubes, des vampires, et des démons, les cauchemars dans lesquels ces créatures interviennent, les tuent bel et bien. Tel est, en tout cas, le dernier moyen de défense restant à la disposition de ces pathétiques mais dangereux fantômes.
La page 131 fournit une spectaculaire et curieusement hétéroclite énumération des auteurs en question (d'ailleurs lacunaire puisque des écrivains protagonistes de la nouvelle n'y sont pas nommés et inversement) qui vaut la peine d'être recopiée :
«Selon la loi, il est interdit à quiconque de posséder de tels livres. Ceux que vous voyez là sont les derniers exemplaires, conservés à des fins historiques dans les caves plombées du Musée. Smith se pencha pour lire les titres poussiéreux : Contes de Mystère et d'Imagination, par Edgar Allan Poe, Dracula par Bram Stoker, Frankenstein par Mary Shelley, Le Tour de Vis (1) par Henry James, La Légende du Val Dormant, par Washington Irving, La Fille de Rappacini, par Nathaniel Hawthorne, L'Incident du pont de Owl Creek, par Ambrose Bierce, Alice au Pays des Merveilles par Lewis Carroll, Les Saules, par Algernon Blackwood, Le Magicien d'Oz, par Frank Baum, L'Ombre étrange sur Innsmouth (2), par H. P. Lovecraft. Et d'autres livres encore par Walter de la Mare, Wakefield, Harvey, Wells, Asquith Huxley tous des auteurs interdits. Tous brûlés la même année que furent interdits le carnaval et Noël.»
Le capitaine de la fusée, une fois sur Mars, brûle ces volumes afin d'en finir avec les vestiges de l'ancien monde, entraînant simultanément – sans en avoir conscience – la destruction ou la fuite sur une autre planète (fuite évoquée par Algernon Blackwood comme une ultime possibilité de survie mais énergiquement refusée par Edgar Poe qui tente un dernier combat tandis que Charles Dickens refuse de les aider !) des fantômes de ses auteurs. Lesquels fantômes auront assisté auparavant à la «mort» de deux autres fantômes : celle d'Ambrose Bierce et celle du Père Noël, ombres à peine corporelles, bientôt auto-carbonisées ou dissoutes après, sans doute, qu'une dernière âme enfantine terrestre ait cessé de croire au Père Noël, après aussi que le dernier volume physique terrestre de Bierce ait été détruit ou bien que son dernier lecteur l'ait oublié. Les trois sorcières du Macbeth de Shakespeare ouvraient Les Bannis d'une manière spectaculaire en envoûtant les cosmonautes : elles aussi auront, une dernière fois mais en vain, composé leurs filtres, désormais inopérants. L'équipage survivant constate que la planète Mars est, apparemment, un désert inhospitalier. À peine l'un d'eux perçoit-il d'étranges cris, émis à mesure que chaque ouvrage achève de brûler, sans pouvoir établir entre ces deux faits la moindre relation inductive de cause à effet. Cette parabole oscille entre poésie, fantastique, horreur et épouvante, science-fiction, politique-fiction mais elle constitue surtout un curieux exemple d'eschatologie littéraire et esthétique : un peu comme si la littérature de science-fiction tentait de signer l'arrêt de mort de la littérature fantastique alors que celle-ci vampirise celle-là une fois de plus, à la fois sur le plan du contenu comme sur le plan formel.
Sur le plan de la simple histoire littéraire, il faut noter la comique récrimination de Dickens qui se plaint d'être catalogué par ses confrères comme écrivain fantastique : à peine a-t-il signé quelques contes de fantômes, comme tout bon écrivain anglais normalement constitué doit pouvoir un jour en écrire ! Il faut aussi noter que Shakespeare constitue l'auteur ayant créé le plus de créatures de fiction vivant elles aussi encore d'une vie fantomatique sur Mars mais lui-même n'apparaît pas. Bien sûr, le thème de l'interdiction de la lecture sur la Terre sera à nouveau traité dans le roman de politique-fiction de 1953 mais il est ici annoncé par cette très curieuse histoire au carrefour du fantastique et de la science-fiction.
4) L'Heure H [Zero Hour] (pages 229 à 240) narre une apocalypse discrète, au sens mathématique pur de la «quantité discrète» en jouant sur les unités de temps, de lieu et d'action. Des extra-terrestres investissent le psychisme des enfants (3) puis leurs jeux, en apparence innocents, afin d'envahir le monde à l'insu de leurs parents qui se retrouvent acculés et terrorisés lorsque l'invasion se produit, comprenant trop tard que leurs enfants, à présent totalement asservis aux envahisseurs, vont les guider jusqu'à eux pour les tuer. La vivacité de l'intrigue est dynamique car elle est constituée de multiples indices isolés les uns des autres que seul le lecteur rassemble intellectuellement tandis qu'ils échappent aux protagonistes adultes. Le passage du soupçon à la terreur panique de la conclusion, achevant brutalement d'éclairer l'ensemble, fait penser à la construction d'une nouvelle de terreur dans le genre de celles de Robert Bloch ou Richard Matheson. Il n'y a là rien d'étonnant car il existe chez Bradbury non seulement une veine de science-fiction mais encore une veine sombre de pure terreur : elle explique que les noms de Bloch, Bradbury et Matheson se croisent régulièrement non seulement dans les anthologies littéraires de nouvelles de science-fiction mais aussi, à l'occasion, dans des anthologies littéraires vouées à l'horreur et à l'épouvante.
Notes
1) Henry James, Le Tour d'écrou [The Turn of the Screw] (1898), traduit par M. Le Corbeiller (Bibliothèque fantastique Marabout, éditions Gérard & Cie, Verviers 1972) et nouvelle traduction in Henry James, Nouvelles complètes, tome IV (1898-1910) (éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade-NRF n°571, 2011).
2) H. P. Lovecraft, Le Cauchemar d'Innsmouth [The Shadow over Innsmouth] (1936), traduit par Jacques Papy in H. P. Lovecraft, La Couleur tombée du ciel éditions Denöel, 1954, pages 91 à 162 du retirage de 1973. NB : ce recueil porte le titre de la première des quatre nouvelles dont il est composé.
3) Bradbury a aussi imaginé des extra-terrestres investissant le psychisme humain dans une histoire adaptée au cinéma : It Came From Outer Space [Le Météore de la nuit] (États-Unis, 1953) réalisé par Jack Arnold.
03/08/2018 | Lien permanent
En attendant la fin du monde de Baudouin de Bodinat

 Cette note, à l'origine, constituait le premier volet d'un triptyque. Je n'ai apporté que quelques menues corrections de forme au texte initial.
Cette note, à l'origine, constituait le premier volet d'un triptyque. Je n'ai apporté que quelques menues corrections de forme au texte initial. Acheter En attendant la fin du monde sur Amazon.
Acheter En attendant la fin du monde sur Amazon.Quelque chose me gêne dans le dernier texte de Baudouin de Bodinat, En attendant la fin du monde paru chez Fario, un éditeur aussi discret qu’intéressant qui a d’ailleurs publié, en livre ou en revues, plusieurs textes du grand Sebald. Bien avant Baudouin de Bodinat, ce dernier avait pour coutume de proposer des textes comprenant des photographies ayant une signification directe, ou bien indirecte mais pas moins flagrante, avec le récit proposé. Mais, là où l’auteur de Vertiges n’en finissait pas de suivre une piste que lui seul savait pouvoir suivre, en déployant une écriture aussi attentive aux plus extrêmes détails que capable d’attirer notre attention sur les correspondances subtiles existant entre les cercles concentriques s’étendant depuis un abîme de noirceur, Baudouin de Bodinat ne nous mène nulle part et même, comble de l’ironie, nous laisse sur place.
Ce quelque chose qui me frappe puis, dans le même mouvement ou presque, me gêne dans le livre de Baudouin de Bodinat qui eût pu s’intituler Petit précis de phraséologie à usage réactionnaire, c’est rien de moins que l’écriture même de l’auteur. Sa structure n’est que faussement complexe, puisqu’elle est décomposable en un usage monomaniaque de participes présents et d’infinitifs qui sont moins enchaînés que juxtaposés et nous donnent ainsi l’impression d’un emboîtement de phrases entre parenthèses et d’incises s’étendant avant qu’un point final ne vienne, passagèrement du moins – avant une nouvelle explosion obéissant au même principe de gonflement irrésistible – clore cette expansion qu’on dirait invincible, et qui ne semble devoir faire halte que lorsqu’elle est figée par une photographie de rue déserte de village perdu, photographies prises, nous dit-on, par le biais de pellicules périmées, et qui apportent un contrepoint utile, par leur extrême dépouillement et même pauvreté volontaire, aux tortillements des phrases butant sur des rues désertes, où sont banalement garées des voitures banales, sous un ciel bleu lui-même insignifiant, ou bien «sous le ciel diffus; ou quand l’été s’étiole, se perd en rêverie du proche automne» (p. 68). Michel Houellebecq, désormais considéré comme un photographe, eût montré plus de volonté d’enjoliver le vide d’une bourgade de province où rien ne se passe, «moindre ville de province indécise» comme l’écrit l’auteur, mais c’est justement de cette volonté que Baudouin de Bodinat se tient éloigné, aussi sûrement qu’il se tient éloigné, du moins c’est ce que l’on veut nous faire croire (et, pour m’amuser, je l’imagine envoyer par courriel son manuscrit à son éditeur, ou bien, plus désuet encore, en l’enregistrant sur une clé USB) d’un des moyens modernes de communication par lesquels l’essence de notre monde, s’il n’a pas complètement plié bagage comme l’aura selon Walter Benjamin, se dilue et dissout. C'est donc moins la fausse complexité du style de Baudouin de Bodinat que la maigreur des résultats obtenus : quoi, tant d'incises, d'escaliers embranchés sur des escaliers, tant de portes ouvertes pour nous mener dans une cabane pas même débranchée mais équipée d'un ordinateur dernier cri et bien sûr d'une connexion, depuis laquelle nous pouvons envoyer notre texte soulevé d'une indignation qu'un livre de Jacques Ellul, qu'une ligne de Gustave Thibon eût aisément concentrée.
Une seule fois, à la dernière page de son livre, cette écriture syncopée, comme désireuse de mimer la froideur minérale ou plutôt machinale de notre modernité décriée, une seule fois l’écriture de Baudouin de Bodinat se risque à ne pas ahaner mais à s’élancer en trois phrases qui n’en sont qu’une et qui annoncent ce que d’autres livres, ceux qui suivront peut-être, auront à charge d’explorer, «cette transparence où quelque chose en soi semble sur le point de s’ouvrir et tout réconcilier» (p. 70). J’exagère, car ce village, lieu de la déambulation photographique de l’auteur, apparaissait dès les premières lignes sous la forme de tel «vieux quartier de ce gros bourg», mais aussi du beffroi demeurant «inflexible à égrener les heures» (p. 12) comme s’il fallait, pour que la banderole des récriminations de Baudouin de Bodinat soit déployée au-dessus de nos têtes diantrement modernes, qu’elle soit plantée entre deux piquets champêtres d’un de ces lieux, si communs dès que nous quittons les grandes villes, si communs qu’ils ne peuvent que nous faire suspecter que c’est le texte lui-même de l’auteur qui est une série de clichés, et sa volonté d’encadrer de simplicité (prétendument) provinciale voire paysanne un texte savant.
Cliché du cadre bucolique où le dernier sage attend la catastrophe qui vient, la catastrophe qui est déjà là plutôt, la catastrophe qu’il est trop tard pour éviter mais non point pour déplorer, ce sera un livre de plus pour les journalistes après tout. Clichés que tous ces termes, parfois des trouvailles heureuses, mais noyées dans une foule d’autres termes rapidement entrechoqués, que l’on dirait avoir été moins inventés que méthodiquement alignés par un Renaud Camus qui n’aurait pas complètement perdu le sens de la phrase et saurait, partant, que son empilement de «que» et de «&» n’a d’autre sens que se fondre dans le silence minéral d’une fin d’après-midi de bourg oublié, autant de piquets devant lesquels toutes les vaches journalistiques vont venir mâcher leur ration de lieux communs agrémentés d’un peu de fortifiant aux hormones, «sage expansif» (p. 11), «édifice social», «radiovision» ou «optiphone» (p. 12) plusieurs fois répétés, «sonorisation distractive» (p. 13), «économie d’exploitation et de pillage» (p. 17), «économie concurrentielle» (p. 23) ou encore, et ce sont les trouvailles dont j’ai parlé, «hypoxie spirituelle» (p. 57), «dégénérescence maculaire de la conscience» (p. 58), «lumignons [qui] filent, s’étouffent et puis charbonnent» (p. 18), comme si l’auteur, sur lequel tant de spéculations courent, pour gagner sa vie avant que le Septième Sceau ne rende définitivement caducs ses efforts de vigie, officiait en tant que rédacteur des débats et par ce biais alimentait son lexique professionnel de tous les termes entendus lors de réunions de Conseil d’Administration ou de Comité d’Entreprise, sans oublier celles des CHSCT, ou Comités d’hygiène et de sécurité au travail.
Nous ne sortons guère quoi qu’il en soit, écriture savante et même précieuse ou pas, plates photographies suintant l’ennui et choisies pour cette raison, de la réaction, au sens le plus commun et banal du terme, long ver cavernicole dont Renaud Camus tiendrait la queue translucide et Alain Finkielkraut la tête aveugle (à moins que ce ne soit l’inverse, pour éviter toute allusion graveleuse dont on me supposerait coupable) en passant par Éric Zemmour, la poissonnière de Causeur et toute la clique piaillante des oisillons martiaux recevant la becquée dans le nid de L’Incorrect, de l’indigent écrivant Yrieix Denis écrivant avec un organe par lequel tout mammifère expulse ce dont son corps n’a pas besoin jusqu’à Matthieu Baumier écrivant avec les pieds de Philippe Sollers, en passant par Romaric Sangars qui, lui, aimerait bien écrire avec sa main et doit se contenter d’un moignon d’esthète gourmé, sans oublier le légendaire phénix de ces hauts lieux de la consanguinité Jacques de Guillebon qui, lui, n’écrit avec rien du tout mais remplit quand même des pages entières de ses fulminations apoplectiques d’adolescent brûlé par la vision du Buisson ardent et qui doit je le suppose beaucoup aimer les textes de Baudoin de Bodinat, pour cette exquise raison que l’auteur lui donne des mots bien frappés, journalistiques donc, qu’il pourra citer dans ses revues de presse nulles.
C’est finalement peut-être cela qui manque au maniéré Baudouin de Bodinat, l’un des plus récents surgeons de ce que Julien Benda appelait le byzantinisme, sorte de croisement puissant mais instable entre le matois pessimiste Michel Houellebecq et le remarquable Jaime Semprun qui a tout dit avant lui, et dans des phrases dont la mordacité le dispute à la perfection, c’est cela qui manque à l’auteur de La Vie sur Terre, la simplicité militante d’une foi farouche, de charbonnier si l’on veut bien que cette honorable profession n’existe plus en France ni même, sans doute, en Europe, une ligne de basse en somme à son chant trop travaillé pour être autre chose que l’un des rhizomes surprenants mais point aberrants de la modernité qu’il décrie à longueur de phrase à enchâssements se voulant antimodernes et n’étant que l’extrême proue du navire rutilant mais aveugle sans son pesant barda électronique qu’est notre époque terminale. Ligne de basse qui, comme «le beffroi [qui] demeure inflexible à égrener les heures» (p. 12), permettrait à Baudouin de Bodinat de ne point se contenter de se lamenter sur le monde comme il ne va plus du tout mais accepterait de souffrir pour lui et, d’une certaine façon absolument scandaleuse, kierkegaardienne, évangélique, le rachèterait. Pour le dire encore plus simplement, et je m’étonne que Sébastien Lapaque, d’habitude si attentif à détecter les failles les plus intimes, ne l’ait pas vu, Baudoin de Bodinat est un homme, du moins un auteur triste, à la différence des deux autres que nous allons évoquer, Matthieu Grimpret et le fou écrivant qu’est Eduardo Castellani. Il manque à Baudouin de Bodinat une échappée que laissent entrevoir, je l’ai dit, les toutes dernières lignes de son texte mélancolique et peut-être même désespéré, un solide maillet pour entamer l’édifice coruscant de tant de phrases qui l’emprisonnent : «& aussi que peut-être tout le monde se doute qu’au point où en sont les choses (en vision cavalière, ou aérienne à survoler ces périphéries de lotissements, de banlieues informes qui vont s’épaissir en entassements chaotiques d’habitations et de fonctions urbaines, et ainsi de suite à perte de vue recouvrant la Terre de cette densité de peuplement en survie assistée), c’est tout simplement sans solution. Sans plus aucun moyen pour l’espèce humaine de se dégager de ce piège où elle est entrée et qui la tient» (p. 59).
23/09/2018 | Lien permanent
Au-delà de l'effondrement, 55 : Le dernier Blanc d'Yves Gandon

 L'effondrement de la Zone.
L'effondrement de la Zone.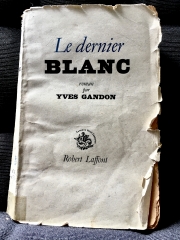 Lire un de ces vieux romans aux pages cassantes qui ont été écrits par un auteur oublié réserve une surprise aussi appréciable qu'instructive. Parcourant sa quatrième de couverture, nous y découvrons souvent des noms et des titres tout aussi oubliés, qui firent peut-être, qui sait, les délices de quelques journalistes saluant, de leurs formules convenues, quelque nouveau grand talent, quelque roman prodigieux signé par un auteur qui, comme il se doit, de pouvait qu'acquérir au fil des années une grande réputation : Michel Manill, Diomède Catroux, Marie Mauron, tant d'autres gloires d'un jour ou d'une heure !
Lire un de ces vieux romans aux pages cassantes qui ont été écrits par un auteur oublié réserve une surprise aussi appréciable qu'instructive. Parcourant sa quatrième de couverture, nous y découvrons souvent des noms et des titres tout aussi oubliés, qui firent peut-être, qui sait, les délices de quelques journalistes saluant, de leurs formules convenues, quelque nouveau grand talent, quelque roman prodigieux signé par un auteur qui, comme il se doit, de pouvait qu'acquérir au fil des années une grande réputation : Michel Manill, Diomède Catroux, Marie Mauron, tant d'autres gloires d'un jour ou d'une heure !Il n'en reste pas moins que le roman d'Yves Gandon, Le dernier Blanc, qui reçut le Prix Alfred Née en 1946 doté de 2 400 francs, mériterait comme tant d'autres évoqués dans cette série post-apocalyptique qu'est Au-delà de l'effondrement d'être réédité dans une collection de poche bénéficiant d'un grand tirage. Pourquoi pas dans celle intitulée Folio Science-Fiction que dirige un certain Pascal Godbillon aux éditions Gallimard et qui, si j'en juge par ses navrantes dernières publications, sombre dans la médiocrité commerciale la plus convenue ? Il y aurait pourtant matière, et belle et riche matière, à rééditer par exemple La Terre demeure de George R. Stewart, Surface de la planète de Daniel Drode ou encore La Mort du fer de S. S. Held plutôt que de nous emmieler avec les productions d'Alain Damasio !
Comme son titre l'indique, le roman d'Yves Gandon évoque la vie, bientôt la survie du dernier Blanc, qui est aussi le dernier Français (à moins bien sûr que l'un de ses amis, inventeur de génie, ait réussi son pari de se poser puis de vivre sur Mars, ce dont il ne nous est rien dit), puis la captivité du héros dans l'une des trois «vastes fédérations, elles-mêmes soumises à un Conseil Suprême habilité pour trancher leurs discords» (p. 67) qui se partagent désormais la planète. Voici comment l'auteur présente son personnage : «Le dernier blanc est un Français de condition modeste, mais de la bonne espèce, tel qu'il s'en peut voir encore aujourd'hui, malgré l'abaissement trop certain de l'esprit public» (1).
Le roman commence in medias res, par la description du sort cruel réservé au dernier Blanc dans un monde désormais gouverné par les Noirs et les Jaunes, enfermé dans une cage dorée surveillée 24 heures sur 24 par d'affables geôliers : «Car ce n'est pas l'individu William Durand qui, en moi, intéresse les foules, mais ce que les Indiens primitifs appelaient le «visage pâle»» (p. 19). C'est une très belle jeune femme, Hannah Pierce, journaliste du Colour City Times, qui fera le récit de la vie du personnage principal, avant que ne survienne la catastrophe de la peste blanche (ou «coccus albus2», due à une invention de guerre, qui décimera peu à peu tous les Blancs. Encadrant cette parenthèse où se déploie la vie passée du dernier Blanc, nous revenons au monde actuel, notre futur donc, celui de l'éradication fulgurante de tout Blanc, où le personnage principal est considéré comme une bizarrerie scientifique à laquelle il sera accordé de se rendre dans le pays qui l'a vu naître, ruiné et vidé de tous ses habitants, Yves Gandon ayant imaginé bien sûr, au préalable, que seuls des Blancs y habitaient, ce qui est une facilité romanesque assez flagrante.
Yves Gandon insiste plusieurs fois sur le fait que la disparition des Blancs de la surface de la Terre n'est due qu'à leur folie guerrière (cf. p. 293) car, avant tout, notre roman est un réquisitoire contre la guerre, contre les guerres, plusieurs étant décrites par l'auteur, la dernière, donc, la cinquième je crois (2), conduisant à l'effondrement que l'on sait.
C'est d'ailleurs comme une juste rétribution de leur folie que les nouveaux maîtres de la Terre, qui finiront eux aussi, bien sûr, par s'entredéchirer, interprètent la disparition des Blancs : «Mes enfants, nous assistons au début glorieux d'une nouvelle phase de l'histoire des hommes. La race blanche est éliminée de la surface de la terre. L'ère chrétienne est close [comme si l'Afrique noire n'était pas chrétienne en partie !]. Cette année comptera officiellement comme la première de l'ère libérée. N'oubliez jamais que les blancs ont péri victimes de leur diabolique orgueil, qui engendra chez eux une frénésie jalouse, résolue dans le sang. Leur terrible exemple doit nous servir de leçon. Le monde appartient désormais aux races de couleur; elles sauront vivre en bonne intelligence, pour le développement harmonieux d'une civilisation nouvelle» (p. 25).
Ardente peinture des ravages de la guerre (cf. p. 84) et cruelle description d'un Occident fatigué (3) et inlassablement taraudé par un mal qui le ronge (4), discrète charge contre l'inconstance féminine (5) à la langue délicieusement surannée (6), Le dernier Blanc est aussi une parabole étrange, n'hésitant pas à rappeler tel conte d'Edgar Poe dans l'un de ses chapitres intitulé Histoire des sept (cf. pp. 195-218), riche de belles images de ruine et de désolation : «Je revois à Reims, sur la place de la cathédrale, des groupes de cadavres prosternés autour de la statue de Jeanne d'Arc, au pied des tours dorées par un feu ancien» (p. 213).
Ce n'est toutefois pas tant la description d'un Paris désert gagné par la végétation (cf. pp. 281, 296) et à la Tour Eiffel «raccourcie d'une trentaine de mètres» (p. 280) qui retient l'attention du lecteur, ni même la stigmatisation de la folie destructrice ayant affligé l'Europe (7), ni même encore, discrète évocation qui ferait plaisir à Renaud Camus, le mention d'une Europe «où ne résidait aucun homme de couleur depuis l'application de la doctrine de Monroë : «L'Europe aux Européens !»» (p. 223) (8), mais l'éloge de la singularité française : «Et William Durand songeait que sa patrie à lui n'était pas seulement déchue, mais qu'elle avait cessé même de figurer une réalité vivante à la surface de la terre. Elle ne représentait plus qu'un souvenir, un nom glorieux comme celui des Incas ou de la première dynastie memphite, cette France qu'il retrouvait, dans son cœur et son esprit, si lumineuse et douce et fraîche, avec ses fleuves, ses forêts, ses prés et ses champs, ses vignes et ses femmes, cette France diverse et une, légère et forte, frivole et sérieuse, nonchalante et capable de tous les réveils, cette France que l'on ne comprenait pas parce qu'elle comprenait trop, que l'on disait futile parce qu'elle offensait la lourdeur commune, cette France dont les grands hommes inventaient sans profiter de leurs inventions, parce que leur but était de trouver et non de vendre, ô France des artistes et des poètes, des têtes claires, des têtes folles et des têtes charmantes, des travaux et de la vie joyeuse, de la pensée, du plaisir et de l'amour, France où étaient nées Marie-Jeanne et Manette !» (p. 277).
Il est donc plus qu'étonnant que ce roman singulier et tout stoïcien dans sa conclusion qu'est Le dernier Blanc d'Yves Gandon, à l'instar du passable Camp des Saints de Jean Raspail devenue l'unique référence littéraire des identitaires et autres animalcules fronto-catholiques, n'ait pas connu, dans cette flache persuadée de connaître la prochaine irruption d'un tsunami, une destinée plus éclatante que celle qui a été la sienne. Mais il est vrai, aussi, que c'est l'orgueil formidable de l'homme blanc que critique, en tout premier lieu, Yves Gandon, ce qui après tout risque d'indisposer nos modernes petits apôtres camusiens, qui bientôt jureront (qui, s'ils étaient cohérents avec leurs pensées, jureraient déjà) par la seule vertu de l'eugénisme racial.
Notes
(1) Yves Gandon, Le dernier Blanc (Robert Laffont, 1945), p. 12.
(2) «Aucune des guerres du XXe ne se déroula à la ressemblance de celle qui la précédait. Après la guerre de position venait la guerre de mouvement; la troisième avait tourné en guerre de siège à la façon du moyen âge. Celle-ci commençait en coup de foudre, et la France surprise, amollie par vingt ans de vie facile, semblait incapable d'une réaction victorieuse» (p. 78).
(3) Des sociétés se formaient qui, sous le couvert d'«études pour l'amélioration du couple humain», n'étaient qu'entreprises de chiennerie. On parlait aussi de nouvelles religions, mais elles se ressemblaient toutes par un naïf recours aux opérations de magie noire. Ainsi se confirmait cette fatalité historique d'après laquelle les peuples vainqueurs, obnubilés par un triomphe payé trop cher, se détruisent en fin de compte eux-mêmes, pour tomber plus bas que le vaincu, en attendant que celui-ci, revigoré du vin amer de la défaite, leur assène le coup de grâce» (pp. 105-6).
(4) «Une force obscure et insurmontable travaille sourdement les chefs-d’œuvre de l'esprit humain. Ce termite invisible ronge, jusqu'à les dissoudre, les fondations du plus fier édifice qui, en s'effondrant, développe un nuage où l'oubli le reçoit. Tout le reste n'est que dérision et paroles dans le vent» (p. 152).
(5) La première femme de notre héros, ainsi que ses deux jeunes enfants, périront sous les bombes. La seconde compagne du personnage principal le trompera, en esprit sinon en chair, comme il finira par l'appendre après plusieurs années de captivité, lors de son retour dans les ruines de Paris.
(6) «Au cas que le choix m'en eût été laissé, je n'eusse jamais imploré du ciel la vocation de témoin qui m'était réservée» (p. 161).
(7) Bien résumée dans ce passage, point dépourvu de clichés tout de même rachetés par une belle chute : «La France, hélas ! la France était morte, comme étaient mortes les nations sœurs ou ennemies [...], la France était morte, dis-je, et l'avaient accompagnée au tombeau la fanfaronne Italie et l'ardente Espagne, l'Angleterre de Shakespeare et la Germaie de Luther, la divine Hellade et la sainte et la rouge Russie, les Pays-Bas d'Erasme et le Portugal de Camoëns, les blonds Scandinaves et les sages montagnards suisses : hier l'Europe» (p. 214).
(8) Remarquons, d'ailleurs, un vocabulaire très souvent dépréciateur, raciste diraient nos modernes et sourcilleux lecteurs, utilisé par l'auteur à l'endroit des Noirs, mais aussi des «Japs» et des «Chinetoques» (cf. p. 252). N'oublions pas que le personnage principal du roman se gausse de la proposition que lui soumet un savant, qui consiste à le faire se reproduire avec des femmes de couleur disons discrète, moins accentuée que celle de Noires : «Les Aïnos sont d'origine mongole, mais une autre race – d'origine africaine – celle des Peuhls, présente, à l'état pur, de très beaux types féminins. Les femmes peuhls qui n'ont pas subi de métissage ne sont pas noires, mais cuivrées. Leur bouche bien dessinée n'a rien de négroïde, leur nez est droit, leur visage n'accuse pas de prognathisme notable. Bref, en accouplant vos produits de femmes aïnos et de femmes peuhls, nous mettrions dans notre jeu les meilleures chances d'obtenir, par sélection sévère, une race blanche approximative, qui serait au blanc de votre espèce ce qu'est, par exemple, à un Soudanais un «new-negro», soit, en trois ou quatre générations, une «race-résultat» réunissant les meilleures garanties de résistance et de stabilité. Son acclimatation en France, puis, progressivement, dans les autres régions d'Europe, ferait le reste» (pp. 258-9). N'oublions pas encore qu'est moquée l'aptitude des «races de couleur» à créer, car elles ne sont considérées, du moins par l'un des personnages du roman, que comme étant capables d'«apporter de petits perfectionnements pratiques» (p. 274).
15/04/2015 | Lien permanent
Au-delà de l'effondrement, 39 : Terre brûlée de John Christopher

 Tous les effondrements.
Tous les effondrements.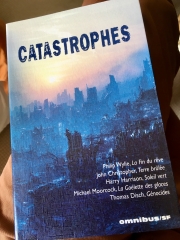 Paru en 1956 sous le titre original No Blade of Grass et traduit en 1975 par Alain Dorémieux pour les éditions Opta, le roman de John Christopher (1), de son vrai nom Samuel Youd, pourrait être lu comme le prologue de La route de Cormac McCarthy.
Paru en 1956 sous le titre original No Blade of Grass et traduit en 1975 par Alain Dorémieux pour les éditions Opta, le roman de John Christopher (1), de son vrai nom Samuel Youd, pourrait être lu comme le prologue de La route de Cormac McCarthy.Nous sommes d'abord frappés par l'économie des moyens qu'utilise Christopher pour évoquer, de façon tout à fait crédible, la brutale réapparition des réflexes premiers chez les hommes (cf. p. 332) devant l'ampleur de la catastrophe planétaire provoquée par la propagation rapide d'un virus baptisé le Chung-li (2) qui a pour propriété de détruire les plants de riz puis très vite, sous une de ses formes mutantes, de s'attaquer à l'ensemble des céréales.
Les verdoyantes prairies anglaises, puisque l'histoire se déroule, comme celle du Rat blanc de Christopher Priest en Angleterre, ont tôt fait de se transformer en étendues de terre pulvérulente sillonnée par des bandes plus ou moins animées d'intentions amicales.
Nous suivons le voyage, en voiture puis à pied, d'un groupe de Britanniques qui, informés des plans criminels du Gouvernement (raser au moyen de bombes atomiques les principales villes anglaises, afin que le pays puisse à peu près décemment nourrir les survivants), ont décidé de quitter Londres pour rejoindre une terre familiale, au Nord de l'île, qu'ils estiment être à l'abri des hordes de misérables qui ne vont pas tarder à parcourir les routes du pays à la recherche d'une nourriture de plus en plus rare.
Parcours semé d'embûches, de violence, de viols et même de meurtres, cortèges de malheurs prévisibles, n'en déplaise aux belles âmes, des mondes qui s'écroulent que nous pourrions résumer admirablement par cette phrase : «Quand l'estomac crie famine, il n'y a plus que sa loi qui compte !» (p. 223), et cela y compris pour les si policés sujets de Sa Gracieuse Majesté : «Ce sera un spectacle intéressant de nous voir tous, Britanniques jusqu'au bout des ongles et la bouche pincée, pendant que les nuages d'orage vont s'amasser. Inattaquables. Mais qu'arrivera-t-il quand nous craquerons ?» (p. 238).
Et, de fait, nos personnages ne craquent pas, surtout celui qui est désigné comme assumant le rôle de chef de la petite troupe, John Custance qui, bien vite, témoignera de l'insensibilité et de l'indifférence nécessaires (cf. p. 323) pour parvenir à rejoindre la terre de son frère David et formera, avec l'inquiétant et redoutable Pirrie (le personnage sans doute le mieux campé par Christopher, qu'on regrette presque de voir mourir à la fin du roman), un couple de combattants aguerris et, surtout, intraitables. Dans ce livre, sont à peine esquissés les contours d'une phénoménologie du charisme du chef devenu «figure de proue» (p. 375), cette autorité mystérieuse qui investit un être plutôt qu'un autre à la faveur d'un événement dont il a, seul, mesuré la profondeur sacrée : «Alf Parsons fut le premier à s'exécuter, mais les autres se mirent en file derrière lui. Plus que jamais, cela ressemblait à un rituel. Celui-ci, avec le temps, pourrait en venir jusqu'au genou ployé, mais même cette simple poignée de main représentait, de façon indiscutable, l'hommage du féal à son suzerain» (pp. 341-2). Les meilleurs romans décrivant la fin du monde fourmillent toujours de la description de ces minuscules attitudes humaines qui, demain peut-être, deviendront le substrat de cérémonies sacrées sinon religieuses.
Nombreuses sont les déclarations faites par l'auteur, peut-être simplistes, mais d'une simplicité qui est la condition première de la survie en temps de banqueroute (cf. p. 337), sur la nécessité, alors que toute loi a été abrogée, de revenir au système de la vengeance pure et simple (cf. p. 282), du châtiment expéditif pour la faute commise par celles et ceux qui, plus vite que des loups encagés redevenus libres, sont retournés à l'état de bêtes sauvages : «dans le passé, la justice a toujours été rendue dans les règles. Maintenant, le mot de justice lui-même ne veut plus rien dire, au milieu de ce champ où ce sont les armes qui parlent» (p. 284).
Cette simplicité s'explique selon John Christopher par l'urgence de la situation : John Custance n'est en aucun cas une brute et ne peut ainsi s'empêcher de penser à ceux qui, au moment même où il traverse les terres britanniques ravagées, «perpétuaient la tradition, qui continuaient à parler le langage de l'amour pendant que Babel se dressait autour d'eux» (p. 299) mais ces chimères ont désormais presque autant de poids que «les critères moraux» formant «une lignée remontant à près de quatre mille ans» et pourtant balayés «en un jour» (ibid.).
De façon assez poétique, John Christopher, bien davantage qu'une nostalgie du monde cassé, perdu, évoque les nouvelles légendes (3) qui finiront par donner un peu d'humanité au monde détruit par le virus : «L'imagination de John dérivait. Et si tout cela n'était qu'un mauvais rêve, dont ils allaient s'éveiller pour retrouver le monde ancien, ce monde de tous les jours qui déjà se mettait à avoir l’auréole magique de ce qui est irrémédiablement perdu ? Il y aurait des légendes, songea-t-il, qui parleraient de larges avenues entièrement illuminées, de millions d'individus vivant côte à côte sans penser à s'entretuer, de trains, d'avions et d'automobiles, de nourriture dans toute sa diversité. Et qui parleraient aussi des policiers : gardiens, dépourvus de colère et de malice, d'une loi s'étendant d'un bout à l'autre de la Terre» (p. 291).
Renaissance, après le déluge, des mythes fondateurs communs à toutes les cultures, comme celui d'un Âge d'Or.
Cette citation est loin de constituer un exemple unique, comme nous le voyons tout au long du roman : «Au fait, je réfléchissais à une chose : tu crois qu'il s'écoulera combien de temps avant que les voies ferrées cessent d'être identifiables ? Vingt ans ? Trente ans ? Et combien de temps les gens se rappelleront-ils qu'il existait autrefois des choses qu'on appelait les trains ? Est-ce que nous raconterons des contes de fées à nos arrière-petits-enfant en leur parlant de monstres de métal qui avalaient du charbon et vomissaient de la fumée ?» (p. 317).
La leçon du roman est cependant riche de son ambiguïté car, si, à la fin de leur périple, une poignée de personnages parvient (non sans avoir tué le frère de John, comme une moderne transposition de l'épisode de Caïn et Abel) à s'abriter dans la terre promise, Éden perdu reconquis de haute lutte, l'auteur prend le soin, à plusieurs reprises, d'affirmer que la survie n'est qu'une possibilité parmi d'autres, l'une d'entre elles constituant même le scénario le plus radical : «D'abord la Chine, ensuite le reste de l'Asie, maintenant l'Europe. Les autres parties du monde tomberaient à leur tour, même si elles restaient incrédules jusqu'à la fin. La nature effaçait avec un chiffon l'ardoise de l'histoire humaine, la laissant vierge pour les pathétiques gribouillages de ceux qui, en des points quelconques à la surface du globe, survivraient en petit nombre» (pp. 317-8).
Ambiguïté redoublée par le fait que, selon l'auteur, regagner ou gagner, et cela à n'importe quel prix, un havre de paix, une citadelle (4) qui a été perdue est l'unique rempart contre la sauvagerie. En somme, nous pourrions prétendre à bon titre que l'instauration d'une utopie est un événement qui ne peut s'encombrer de bons sentiments et nécessite une mise entre parenthèses, qu'on espérera la plus brève possible, des règles de conduite dans une société qui, de toute façon, s'est délitée en quelques jours à peine : «Ceux qui n'arriveront pas à trouver un terrain d'où on ne pourra pas les déloger, ceux-là finiront dans la sauvagerie... si seulement ils survivent» (p. 339).
Nous retrouvons ici la très antique idée selon laquelle la fondation d'une cité est la première pierre qui permet à l'homme de redresser la tête, et d'envisager une survie qui, au fil de siècles d'efforts et de souffrances, pourra même se transformer en vie digne d'être vécue.
La civilisation, en somme, n'est absolument pas un dû et, comme toute chose sur cette planète, sans doute même plus que n'importe quelle autre chose, doit être payée au prix fort.
Notes
(1) Ce roman peu connu a été recueilli dans l'excellent recueil intitulé Catastrophes publié par Omnibus (dans la collection SF) en 2005. Toutes les citations entre parenthèses renvoient à notre édition.
(2) «Les virus sont des trucs bizarres [...]. Ils sont comme des principautés ou des empires, à leur échelon. Ils conquièrent tout pendant un siècle ou pendant trois mois, et puis ils sont éliminés. Ce n'est pas souvent qu'on rencontre chez eux l'équivalent de Rome, avec une puissance qui s'étend sur un demi-millénaire» (pp. 244-5).
(3) «[...] ce serait là comme une sorte de légende du futur qu'on se raconterait au coin du feu, un rêve éveillé» (p. 317). Notons que c'est justement ce rêve éveillé qui permettra peut-être, selon John Christopher, de redonner une âme et un élan d'exploration aux survivants : «Une légende qui, peut-être un jour, finirait par pousser les nouveaux barbares à travers l'océan, pour trouver une terre aussi rude et brutale que la leur» (ibid.).
(4) «Vous ne voyez donc pas que la justice et les parts égales sont des notions périmées quand il s'agit de défendre une citadelle contre l'assaut des barbares ?» (p. 350).
14/02/2012 | Lien permanent
Le Roman d'Oxford de Javier Marías

 Arthur Machen dans la Zone.
Arthur Machen dans la Zone.Publié dans sa langue d'origine en 1989, Todas las almas, littéralement, Toutes les âmes a été traduit en français sous le titre aussi infidèle qu'idiot qu'est Le Roman d'Oxford (1) car, même si ce texte merveilleusement subtil évoque, avec un humour cruel et jubilatoire, le séjour d'un professeur d'espagnol dans la ville du même nom, sans oublier d'y faire figurer quelques excentriques Anglais (il s'agit évidemment d'une épithète de nature), le véritable motif dans le tapis du livre est un secret qui, comme tous les secrets, tient moins son être paradoxal d'exister que d'être conté, révélé et, alors, de n'en être plus un de secret, bien sûr ! : «Quoi qu'il en soit, aucun secret ne peut ni ne doit être gardé à jamais envers quiconque, et il doit absolument trouver ne serait-ce qu'un destinataire une fois dans la vie, une fois dans sa vie de secret» (p. 163), et c'est, selon l'écrivain, pour obéir à cette impérieuse nécessité que les personnes (donc les personnages) existent et, même, «réapparaissent» (p. 164) même s'il nous avertit, dès la première page de son roman, que «celui qui raconte ici ce qu'il a vu et vécu n'est plus celui qui l'a vu et vécu, ni même son prolongement, son ombre, son héritier ou son usurpateur» (p. 9). C'est donc un autre, ayant subi ce qu'il appelle une perturbation puis la racontant, et dans l'acte même de raconter retrouvant la trame de sa propre identité, point si labile que cela, comme si cette reconquête n'avait finalement eu pour but véritable que celui d'offrir un écrin au secret qu'il importe d'entourer, de servir puis de révéler, révélation qui ne pourra pas manquer de vous transformer en profondeur, jusqu'à n'être plus celui que vous avez été ou prétendu être.
 Je ne dirai évidemment rien de ce secret que la maîtresse du narrateur, qui d'ailleurs est sur le point de congédier celui qui est, au moment de leur dernière nuit, quasiment son ancien amant, va lui révéler, mais je puis toutefois dire qu'il a un rapport, lointain peut-être (mais aucun rapport n'est lointain dans le monde des âmes que s'efforce de peindre l'écrivain) avec Arthur Machen, que j'ai été absolument ravi, et bien sûr assez surpris, de retrouver dans un roman contemporain, évidemment pas français car la couche de crasse qui entoure les cerveaux de ce qui passe pour des écrivains, en France, est au moins aussi épaisse que la voûte plantaire d'un pithécanthrope qui par mégarde se retrouverait propulsé sur la terrasse bruyante de la célèbre brasserie Lipp.
Je ne dirai évidemment rien de ce secret que la maîtresse du narrateur, qui d'ailleurs est sur le point de congédier celui qui est, au moment de leur dernière nuit, quasiment son ancien amant, va lui révéler, mais je puis toutefois dire qu'il a un rapport, lointain peut-être (mais aucun rapport n'est lointain dans le monde des âmes que s'efforce de peindre l'écrivain) avec Arthur Machen, que j'ai été absolument ravi, et bien sûr assez surpris, de retrouver dans un roman contemporain, évidemment pas français car la couche de crasse qui entoure les cerveaux de ce qui passe pour des écrivains, en France, est au moins aussi épaisse que la voûte plantaire d'un pithécanthrope qui par mégarde se retrouverait propulsé sur la terrasse bruyante de la célèbre brasserie Lipp.
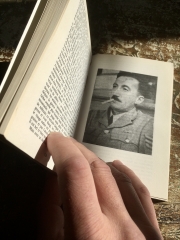 collection malsaine de livres» (p. 125). Qu'est-ce que peut être une collection malsaine ? Nous ne le saurons pas.
collection malsaine de livres» (p. 125). Qu'est-ce que peut être une collection malsaine ? Nous ne le saurons pas.Nous apprenons, toujours par le biais de la page française de ladite encyclopédie électronique, bien moins conséquente (comme c'est très souvent le cas) que l'original, l'article anglais, que : «En tant qu'exécuteur littéraire de Matthew Phipps Shiel, John Gawsworth hérite du trône de la micro-nation du Royaume de Redonda et se proclame roi Juan Ier. À sa mort en 1970, Jon Wynne-Tyson devient son exécuteur littéraire et se proclame roi Juan II. En 1997, il abdique en faveur de l'écrivain espagnol Javier Marías qui se proclame roi Xavier Ier et devient l'exécuteur de Shiel et de Gawsworth.» Nous avons évoqué dans la Zone un texte, assez étrange, de M. P. Shiel, Le Nuage pourpre, sans bien sûr nous douter à l'époque de la constellation dans laquelle, peu ou prou, il s'inscrivait et faisait luire sa propre petite lueur.
Si, parfois, «le vrai savoir est sans importance» nous assure l'auteur, et donc, si «on peut alors l'inventer» (p. 19), il nous importe finalement assez peu de démêler la part entre la réalité, telle, du moins, que nous la donnent des livres et des livres de livres, de la fiction, puisque Javier Marías nous assure que «nous nous condamnons toujours par ce que nous disons, non par ce que nous faisons» (p. 40), comme si la réalité non seulement était sujette à caution, mais était proprement labile, faillible, mais comme si, en fait, elle ne méritait d'être vécue que diffractée sans fin par les mots qui la disent, la mort apparaissant ainsi non seulement pour la disparition définitive d'une conscience, ce qui est beaucoup, mais comme l'impossibilité de poursuivre une lecture entreprise «avec une infinie curiosité», ce qui est proprement «inconcevable», tout comme l'est le fait d'imaginer que «la vie comme seul codex» puisse un jour cesser de nous proposer «d'autres livres» (p. 43) à lire, jusqu'à en oublier de vivre ou établir du curieuses relations entre des auteurs utilisant plusieurs pseudonymes (tels que «Terence Ian Fytton Armstrong et Orpheus Scrannel et John I, King of Redonda, et aussi parfois Fytton Armstrong tout court ou J. G. ou même G simplement», p. 128) ou entre des auteurs se lisant les uns les autres, s'appréciant ou au contraire se détestant cordialement mais formant quand même, là encore, une constellation dont les astres, au moment où nous croyons les voir jeter puissamment leurs flots de rayonnements dans la nuit, sont morts depuis des millions d'années.
Ces relations ne sont pas seulement curieuses mais inquiétantes, comme le montre l'art d'Arthur Machen, dont «les horreurs sont très subtiles», art qui dépend «pour une large part de l'association d'idées», «de la conjonction d'idées», «de la capacité à les réunir», comme ceci : «Vous pouvez fort bien ne jamais associer deux idées de telle façon qu'elles révèlent leur horreur, l'horreur de chacune d'elles, et ainsi ne pas vous en rendre compte de toute votre vie. Mais vous pouvez tout aussi bien vivre constamment dans l'horreur si vous avez le malheur d'associer continuellement les idées complémentaires» (p. 101), comme si l'horreur ne dépendait décidément de rien d'autre que de la capacité d'un esprit à établir des correspondances entre deux réalités, en apparence anodines si on les considère isolement, l'horreur n'étant donc produite que de leur association fantasmatique ou plutôt, cauchemardesque.
Un chien n'ayant que trois pattes en raison d'un accident ne peut, quelle que soit sa férocité, inspirer de l'horreur. En sommes-nous bien certains toutefois ? Pas davantage, me direz-vous, une jeune femme qui vend des fleurs au coin de la rue. Associer un chien dont une des pattes est réduite à un moignon et une jeune femme qui vend des fleurs, voilà qui est moins banal car, alors, il est possible de laisser filer son imagination, ce que ne peut faire, vous me l'accorderez, qu'un écrivain comme l'auteur parlant au travers de son personnage principal : «Que le chien soit avec elle serait plus litigieux. Ce serait peut-être terrifiant. Le chien est sans patte. S'il lui avait appartenu, il ne l'aurait sûrement pas perdue dans une bagarre stupide à la suite d'un match. Çà c'est un accident. Les risques du métier de chien d'un homme boiteux. Mais avec elle peut-être l'aurait-il perdue pour une autre raison. Le chien est sans patte. Pour une raison plus importante. Plus grave. Pas par accident. Il est difficile d'imaginer cette jeune fille dans une bagarre. Peut-être l'aurait-il perdue par sa faute. Peut-être, pour que ce chien ait perdu sa patte en appartenant à cette fille, aurait-il fallu qu'elle l'ampute elle-même» (p. 102, l'auteur souligne), et voilà que, subitement, alors que rien ne la convoquait, point le domaine de l'horreur.
L'horreur, finalement, est comme le secret, comme la vie elle-même, dans son opacité qui n'est ni bienveillante ni malveillante, mais qui est, tout bonnement, et dont tout grand écrivain et peut-être, plus largement, tout grand artiste a eu l'intuition, avant qu'il ne sente au-dessus de son épaule souffler le vent de l'aile de l'imbécillité ou bien qu'il ne sache plus comment dire ce qu'il a vu, l'espace de quelques dixièmes de seconde qui, comme l'aleph selon Borges, contiennent non pas des mondes mais des univers : «les choses n'existent que lorsqu'on en parle, ou, ce qui revient au même», elles «n'évoluent pas et finissent par s'estomper si on leur nie ou refuse l'existence verbale» (p. 153), comme si nous ne vivions que pour écouter des histoires, comme si vivre pour vivre n'avait aucun intérêt, en dépit même de l'appétit, pourtant insatiable, qu'évoque un des personnages au narrateur, alors qu'il mourra à la fin du roman, peut-être encore plein de volonté pour découvrir de nouvelles choses et, surtout, lire de nouveaux livres, tous ceux que l'on a pas lus, tous ceux qui nous auront fait l'affront de nous survivre, tous ceux qu'il n'aura donc pu lire : «je t'assure que même maintenant je continue à en vouloir davantage : je veux tout; et ce qui me fait me lever le matin c'est toujours l'attente de ce qui est sur le point de venir et ne s'annonce pas, c'est l'attente de l'inattendu, et je ne cesse de rêver ce qui doit venir, exactement de la même façon que quand j'avais seize ans et que j'ai quitté l'Afrique pour la première fois, et que tout était possible parce que tout est possible avec la méconnaissance» (p. 160).
Avec la connaissance, de moins en moins de choses deviennent possibles, apparemment, mais la frayeur et même l'horreur, elles, augmentent à mesure que nous sommes capables d'établir des relations entre des choses, des situations ou des êtres que rien de prime abord ne semble relier, selon l'infini pouvoir de suggestion de la littérature, notre cerveau réceptif accroissant ses connaissances, allant vers la connaissance car, si «nous nous condamnons toujours par ce que nous disons» ou bien «par ce que l'on nous dit» (p. 164), nous semblons aussi nous condamner par ce que nous lisons, comme semble le penser le narrateur, accablé par sa capacité à créer des correspondances (cf. p. 174 avec le motif, vu dans Un cœur si blanc, du traducteur du traducteur du...), appelons-les des compléments, des membres de phrases faulknériens s'insérant dans des phrases elles-mêmes (parfois) faulknériennes, les poupées dans d'autres poupées, certaines d'entre elles grimaçantes ou présentant un curieux air point tout à fait rassurant, perturbant, et cela à l'infini, cette mise en perspective perpétuelle accroissant ainsi immanquablement la possibilité de la survenue de l'horreur, le «complément terrifiant du vieillard [étant] l'enfant, le complément terrifiant de l'enfant [étant] le vieillard, celui du baiser est l'enfant et celui de l'enfant le baiser, celui du baiser le vieillard et celui du vieillard le baiser, mon baiser (ce sont trois idées, plus celle de Clare Bayes qui reste au milieu), le baiser donné par une personne interposée mais pas par un visage interposé, car c'est le même visage même si les âges diffèrent, et que diffère le sexe, incarnations ou représentations» (p. 194).
Notes
(1) Javier Marías, Le Romand d'Oxford (traduction de l'espagnol par Anne-Marie et Alain Keruzoré, Rivages, collection de littérature étrangère, 1989, puis Rivages, coll. Rivages poche. Bibliothèque étrangère, 1994).
12/10/2021 | Lien permanent
Tri dashuri atërore në kohëra të turbullta: Virgjili, Tarkovski dhe McCarthy
 Voici la traduction albanaise d'une longue note, parue ici. Je dois cette traduction, comme les autres réalisées dans cette même langue, à l'amabilité d'Anila Xhekaliu, que je remercie une nouvelle fois.
Voici la traduction albanaise d'une longue note, parue ici. Je dois cette traduction, comme les autres réalisées dans cette même langue, à l'amabilité d'Anila Xhekaliu, que je remercie une nouvelle fois. Ce long article a été d'abord publié dans le deuxième numéro de la revue Pasqyra e te rrefyemit.
Ce long article a été d'abord publié dans le deuxième numéro de la revue Pasqyra e te rrefyemit.Ky tekst është publikuar për herë të parë në 2010.
“Midis të gjitha formave ideale (domethënë realiteteve honxhobonxho në gjendjen e tyre të dukjes sheshit dhe përmbushjes së plotë), kishte në to pra atë formën e veçantë të babait. Gjithçka dukej se shugurohej në raport me të. [Ky] fakt origjinal […] ishte më shpirtëror se shpirti, përthithte, le ta themi kështu, shpirtin dhe përmbushte vetminë. Krijonte një fuqi ‘legjitime’ që asgjë nuk mund të më bënte ta kundërshtoja. Një dashuri dhe një respekt i huaj për çdo parapëlqim më viheshin në dukje.”
Pierre Boutang, Politika (politika e shikuar si shqetësim) (Jean Froissart, 1948), fq. 22-24.
Të gjallët dhe të vdekurit tek Eneida
 Devotshmëria është njëra nga ato gjërat shumë të bukura dhe fjalët shumë të lashta që, ngaqë nuk përdoret më, erret në harrim, kur kjo nuk gjendet tek qesharakja e përçuar në mënyrë të përpiktë dhe të shpejtë nga zelli i shkrimtarucëve. Cili prej këtyre dy puseve është më i thelli? Devotshmëria është një nga këto realitete zhdukja e të cilëve, për të ringjallur pohimin e trishtë që bënte Malraux, mund t`i shpjerë njerëzit aktivë e pesimistë në zhbërje si me dhunën fashiste. Një nga ilustrimet e tij më të larta na është dhënë pa asnjë dyshim nga Eneida e Virgjilit (1) që, ndonëse nuk është në origjinën e legjendës së Eneut (2), e ka përqasur epikën e tij madhështore. Episodi, që ka frymëzuar një numër të madh skulptorësh e piktorësh (3), më i famshmi i Eneut është, pius Aeneas, duke shpëtuar birin e tij Askanin dhe mbajtur në shpinë babain e tij Ankisin, nip i Laomedonit bir i Ilusit II dhe pasardhës i Dardanit, ai vetë bir i Zeusit dhe Elektrës, njërës nga vajzat e Atlasit. Një statujëz shumë e bukur me origjinë etruske datuar e gjysmës së parë të shekullit V para Jezu Krishtit paraqet Ankisin duke shtrënguar duart rreth qafës së të birit që e mban të ulur mbi supin e tij të majtë, kështu atë e bir përbëjnë një njeri të vetëm, çka mbase nuk është kurrsesi vetëm një e vërtetë metaforike. Kjo gjenealogji, megjithatë e thjeshtë, ilustron mjaft mirë për çfarë bëhet fjalë kur shkruajmë këtë fjalë të shkurtër të dashurisë atërore për të cilën flet gjatë: jo aspak aq shumë për atësinë apo birësinë, sa për idenë e një zinxhiri të gjatë të artë duke u shtrirë përgjatë shekujve dhe duke u dhënë atyre historinë mërshore dhe kujtesën për bindjen e detyrës për nderimin e kësaj atësie e birërie, siç e kërkon Eksodi (15,12) e risjellë në kujtesë nga Shën Pali (Ep 3, 14-19: “Përulem në gjunj para Atit të Zoti Tonë Jezu Krishtit prej të cilit çdo atësi, në qiell e në tokë, mban emrin e tij”), ku bëhet fjalë për atin e tij të vërtetë dhe atin e atit të tij ose të shumë zotave, të Zotit, atit veçanërisht Biri i të cilit është artizani, mbartësit e të cilit jemi, të vegjël a të mëdhenj nëse do ta parafrazonim fjalorin e budizmit.
Devotshmëria është njëra nga ato gjërat shumë të bukura dhe fjalët shumë të lashta që, ngaqë nuk përdoret më, erret në harrim, kur kjo nuk gjendet tek qesharakja e përçuar në mënyrë të përpiktë dhe të shpejtë nga zelli i shkrimtarucëve. Cili prej këtyre dy puseve është më i thelli? Devotshmëria është një nga këto realitete zhdukja e të cilëve, për të ringjallur pohimin e trishtë që bënte Malraux, mund t`i shpjerë njerëzit aktivë e pesimistë në zhbërje si me dhunën fashiste. Një nga ilustrimet e tij më të larta na është dhënë pa asnjë dyshim nga Eneida e Virgjilit (1) që, ndonëse nuk është në origjinën e legjendës së Eneut (2), e ka përqasur epikën e tij madhështore. Episodi, që ka frymëzuar një numër të madh skulptorësh e piktorësh (3), më i famshmi i Eneut është, pius Aeneas, duke shpëtuar birin e tij Askanin dhe mbajtur në shpinë babain e tij Ankisin, nip i Laomedonit bir i Ilusit II dhe pasardhës i Dardanit, ai vetë bir i Zeusit dhe Elektrës, njërës nga vajzat e Atlasit. Një statujëz shumë e bukur me origjinë etruske datuar e gjysmës së parë të shekullit V para Jezu Krishtit paraqet Ankisin duke shtrënguar duart rreth qafës së të birit që e mban të ulur mbi supin e tij të majtë, kështu atë e bir përbëjnë një njeri të vetëm, çka mbase nuk është kurrsesi vetëm një e vërtetë metaforike. Kjo gjenealogji, megjithatë e thjeshtë, ilustron mjaft mirë për çfarë bëhet fjalë kur shkruajmë këtë fjalë të shkurtër të dashurisë atërore për të cilën flet gjatë: jo aspak aq shumë për atësinë apo birësinë, sa për idenë e një zinxhiri të gjatë të artë duke u shtrirë përgjatë shekujve dhe duke u dhënë atyre historinë mërshore dhe kujtesën për bindjen e detyrës për nderimin e kësaj atësie e birërie, siç e kërkon Eksodi (15,12) e risjellë në kujtesë nga Shën Pali (Ep 3, 14-19: “Përulem në gjunj para Atit të Zoti Tonë Jezu Krishtit prej të cilit çdo atësi, në qiell e në tokë, mban emrin e tij”), ku bëhet fjalë për atin e tij të vërtetë dhe atin e atit të tij ose të shumë zotave, të Zotit, atit veçanërisht Biri i të cilit është artizani, mbartësit e të cilit jemi, të vegjël a të mëdhenj nëse do ta parafrazonim fjalorin e budizmit. Kujtojmë se fjala latine pietas tregon ndjenjën që bën të njohim dhe përmbushim detyrat ndaj zotave, besnikërinë, detyrat ndaj prindërve dhe atdheut duke qenë veçse zgjatje e kuptimit të parë, jashtëzakonisht besimtar, përfshirë aty në botën romake që i ngrinte kult të parëve, sidomos të vdekurve të dashur (ose të urryer por të respektuar). Nëse episodi i Eneut duke mbajtur të atin në shpinë, duke ia mbathur nga qyteti në flakë i Trojës, është ose do të duhej të jetë i njohur nga të gjithë, vetëm më të kultivuarit e lexuesve të Virgjilit kujtohen se kënga e pestë e Eneidës gjallon ritet mortore të caktuara nga Eneu në nderim të atit të tij (4) dhe që kënga e gjashtë e Eneidës tregon saktë dhe me hollësi për pjesën e saj zbritjen, në fund të Erebesë, perandoria e paqëndrueshme e Plutonit, e birit të përvëluar për ta parë sërish të atin të paralizuar nga Jupiteri qyshkur ai ka zbuluar dashuritë e tij me Venusin. Disa mbase pikërisht nga këta lexues nuk e dinë kurrsesi se është motivi i devotshmërisë që u jep dymbëdhjetë këngëve virgjiliane bashkë njësinë e tyre, që është përsëri ai që përafron tekstin virgjilian me dy kryeveprat e Homerit, Iliadën dhe Odisenë. Kështu komentuesve të panumërt u ka bërë përshtypje struktura në dy pjesë e veprës së poetit nga Mantova, kremtimi i aventurave të heroit gjatë gjashtë këngëve të para mandej gjatë gjashtë të tjerave betejat e ashpra të tij për të ndërtuar në Latium një Trojë të re, Romën sigurisht, të denjë për lavdinë e dikurshme të qytetit të vjetër të shkatërruar nga grekët. “Trojani Enea, i famshëm për dashurinë për atin dhe armët e tij” shkruan Virgjili në këngën e gjashtë të Eneidës, secila prej këtyre dy cilësive duken të pandara nga njëra-tjetra. Devotshmëria, në fakt, nuk mungon absolutisht në betejat e përgjakshme e madje disa sakrifica (5) që shkrimtari përshkruan, sikur ajo të mos ishte kurrsesi në kohën e ritit të varrosjes së të vdekurve të rënë në luftë në këngën XXIV të Iliadës, meqë në këngën e njëmbëdhjetë të Eneidës që është vendosur një pushim i shkurtër për të varrosur të shtrenjtët e rënë në luftë nga të dyja anët, kur Enea shqipton një laudatio funebris mbi trupin pa jetë të Pallas, bir i Arkadian Evandrit, besëlidhës i trojanit në luftën e tij kundër latinëve. Disa rreshta më përpara, në fund të këngës së dhjetë, ky Enea i vetëm nuk kishte provuar të zhbindë Lausin për ta luftuar, ndërkohë që ky i fundit ziente të ndërfutej mes babait të tij, Mezenzit, besëlidhës i Latinit armikut të Eneas dhe tërbimit të luftëtarit të madh të dikurshëm për pasardhësit artistikë të gjithë Perëndimit? I riu Laus vdiq, i vrarë nga Enea ndërkohë që babai i tij, pak kohë më përpara se të vdesë në radhën e tij nga goditjet e Trojanit, do të qajë birin e tij të vdekur duke përdorur një shëmbëlltyrë që të lë pa mend: “Unë, babai yt, ia detyroj shpëtimin tim plagëve të tua, dhe jam në jetë nga vdekja jote”. Babai duke jetuar nga vdekja e birit të tij, ç'është e vërteta, gjatë gjithë kohërave, qe një nga goditjet më të pakuptueshme e të tmerrshme të fatit që mund t`i jetë dhënë një burri për të duruar.
Theodor Haecker, në një vepër të rëndësishme kushtuar kryeveprës së Vigjilit, shkruan, duke kujtuar zbritjen e Eneas në Ferr, këta rreshta të artë për temën e devotshmërisë së heroit, që Alain Badiou-së do t`i ishte dashur të bluante para publikimit qëllime të ngushta për universalitetin e pretenduar të “diskursit të Birit” kur është lehtësuar nga partikularizmi i neveritshëm që has në vepër në diskursin e Atit (6). Kundër broçkullave të të pafeve (në kuptimin e parë të kësaj fjale) të këtij lexuesi mendjengushtë siç është Alain Badiou, le të bëjmë të njohura disa qartësi mbi njeriun duke patur birin dhe atin, duke nderuar kujtimin e njërit dhe duke i mësuar tjetrit kujtimin dhe kultin e të parëve, krejt siç ata ndriçojnë tekstin e Virgjilit sipas Haecker : “I devotshëm, Enea është në mënyrë origjinale në cilësinë e tij të ‘birit’. Dashuria për prindin romak është tek ai në shtëpi të vet. Të jesh i devotshëm, do të thotë të jesh djali që do që të kryejë detyrat. Të duash të kryesh apo përmbushësh detyrat e tua nga dashuria shenjëzon të jesh i devotshëm. Vetë ai baba dhe paraardhës i Cezarit dhe Cezar Augustit, Enea shikon tek biri i tij dhe tek biri i birit të tij të parët dhe etërit e birit që janë të devotshëm kundrejt etërve të tyre dhe të parëve të tyre. Raporti i dyanshëm mes atit dhe birit me përparësinë e atit është themeli i dashurisë virgjiliane për prindin. Jo për të dashurën, jo për të rrëmbyer mbretëreshën, jo nga vështrimi i një veprimi heroik, por për atin e tij që Enea zbret në perandorinë nëntokësore deri në fushat e Champs-Élysées, ku i ati e ngjatjeton duke qarë.”[krh. Eneida, 6, v. 687-696]» (7).
Sakrifica e atit themelon bashkësinë e të gjithë të gjallëve
Filmi madhështor i Tarkovskit i titulluar Sakrifica do mund të ishte njëra nga ilustrimet më bashkëkohore nga më të shquarat e dashurisë atërore. Historia e treguar në këtë vepër të adhurueshme është shumë e njohur: në këmbim të kthimit të rrjedhës së ngjarjeve në normale, domethënë një ditë para shpërthimit të luftës atomike, një baba i një familjeje dhuron si sakrificë shëlbuese shtëpinë e tij që e djeg me duart e veta, braktis të vetët, heq dorë nga biri i tij i adhurueshëm, i premton më në fund Zotit për të mos folur kurrë më asnjë fjalë të vetme, me qëllimin sidomos për të mos provuar të shpjegojë gjestin e tij. I shpallur i çmendur, do të çohet manu military në një azil, duke patur kohën të vërtetojë që bota që ai ka shpëtuar me gjestin e tij sidomos të pakuptueshëm për sytë e të afërmve të tij është kthyer në rregullsinë monotone të ditëve të tij të qeta, të grisura megjithatë, para se të kryejë dhurimin e tij, nën zallahinë e madhe të bombave dhe ulërimave të avionëve që përshkojnë qiellin. E pabesueshmja, kjo lufta e fundit ku nuk do ketë fitimtarë dhe humbës, ndodhi. Mrekullia, kthimi në normale ose më tepër, në një botë të ndryshuar në mënyrë të pakapshme meqë një njeri ka mbajtur premtimin e tij, zë vend tek ai gjithashtu.
Nuk është pra e zmadhuar të pretendojmë që Sakrifica na përshkruan, me një ekonomi mjetesh të habitshme, një univers të ditës së mëpasme, botën që gjendet përtej shkatërrimit. Disa skena të tmerrshme të rrugëve të rrënuara dhe turma të tmerruara nuk mund të mos na tregojnë zemrën e territ, prej ku ujtis armiku i vetëm që vë, tek personazhet e ndryshme, maskën e tij të shtrënguar. Është Aleksandri që e tregojnë me emër, dhe madje, duke e thirrur, ngadhënjyes, çastin kur ai lutet: frika jonjerëzore, kafshërore, që kërcënon të shkatërrojë arsyen e të mbijetuarve shumë më thellë se e bëjnë apo do ta bëjnë bombat. Kundër saj, kundër perandorisë së saj që shtrihet që Aleksandri lyp ndihmën e Zotit, i cili do ta përmbushë përbetimin e tij pasi, duke ndjekur lutjet e njëpasnjëshme të mikut të tij fabrikuesit Otto, do të ketë bërë dashuri me Marian, njërën nga dy shërbyeset e tij që, sipas fjalëve (rrëfyer nga i njejti Otto, amator historish të çuditshme mbi të cilat ai heton), ka disa pushtete të jashtëzakonta, në këto rrethana, siç duket të na e sugjerojë realizuesi, dhuntinë, aq të rrallë e të thjeshtë, për të dashur. Përfundimisht, gjenia e Tarkovskit a nuk është për të na sugjeruar se shkaku real i apokalipsit, më pak se çmenduria e një teknike të bërë shkatërruese nga të qenit instrumentalizuar nga njerëzit, qendron tek ligësia, mosbesimi, tek përçmimi, prej të cilëve Maria e përulur është viktima e parë madje mu në gjirin e shtëpisë së Aleksandrit ? Realizuesi rus a nuk kishte guxuar të linte të kuptohej me shkathtësi se njerëzit që stalker shoqëronte në Zonë ishin të paaftë për t`i mbajtur përbetimet e tyre më të fshehta për të vetmen dhe uniken arsye ngaqë ata vinin aty pa gëzim, të zhgënjyer, të dëshpëruar madje, për t`ia mbathur mjerimit të tyre shumë më tepër se ishin të etur për ta zbuluar të vërtetën?
Aleksandri nuk do të ketë patur kohë, para se të jetë dërguar larg të vetëve, për ta dëgjuar zërin e birit të tij, i quajtur Djali i Vogël, që mbetet me këmbëngulje memec deri në të gjitha skenat e fundit të filmit (8), kur, nën pemën që ai ka mbjellë me babain e tij dhe që këmbëngul për ta ujitur, do të shqiptojë fjalët e para të ungjillit sipas Shën Gjonit, duke i drejtuar babait të tij Aleksandër të shpallur i çmendur një pyetje që do të mbetet pa përgjigje, pema duke mbetur e thatë meqë mrekullia e kthimit ka ndodhur tashmë. Në njëfarë mënyre, Tarkovski lë në hije faktin për ta ditur nëse parabola që Aleksandri i tregon birit të tij në fillim të filmit do të realizohet, nëse pema do të përfundojë duke lulëzuar përsëri ngaqë, çdo mëngjes në orë të caktuar, me këmbëgulje dhe devotshmëri, një njeri do të ketë ardhur për ta ujitur pavarësisht rrethanës: një pemë e vdekur nuk mund të çelë prapë gjethe. Mbase, veç kësaj, njëra dhe tjetra mrekulli, lulëzimi i pemës së tharë, i shpresuar më shumë se i provuar dhe kthimi në normale, ashtu siç lufta përfundimtare nuk kishte ndodhur ende, nuk janë tjetër veçse dy ëndrra. Sakrifica e pranuar nga Aleksandri do të ishte pra e rremë?
Nëse dyanësia, shumë e shtrenjtë për modernët, ekziston në mënyrë të pavënë re tek Sakrifica (krejt siç ekzistonte tek Stalker, krejt siç ajo është shenjë e shumë veprave të mëdha, me të vërtetë të hapura në pafundësi për interpretime), ky lexim relativist nuk mund të na përshtatet: akti i besimit i çuar në inkandeshencën e saj dhe bërë mrekulli, si përfundim, thellon realitetin dhe thyen të gjitha shtrëngesat e rishfaqjes mendore. Duke rivendosur natyrën në rrjedhën e tij, duke vënë me një fjalë gjërat në vend, mrekullia, me mëshirën e saj të plotë që e shenjon, nuk mund të kihet frikë nga rrugët e vetme të shpjegimit racional ose nga të tjera që, duke ngjallur me shumë kujdes mundësinë e të çuditshmes apo të mbinatyrshmes, duke i mëshuar fort in fine racionalitetit më të përgjithshëm. Shpjegimi me mënyrën e dyanësisë, madje të mistershmes, është një truk i vogël që do t`ua lëmë amatorëve të gjëegjëzës, që pyesin veten ende për të ditur, për shembull, nëse atë Donisani, prifti i thjeshtë dhe i gdhendur keq i romanit të parë të Bernanos, ka takuar realisht ngasësin e tij nën rreckën e një xhambazi ose nëse truri i stërmunduar i shenjtit të ri të Lumbres që nuk i ndahet vizioni i të keqes ka bërë vetëm që ta ëndërrojë këtë takim. Meqë autori, ku bëhet fjalë për Bernanos apo Tarkovskin, ka paraqitur në romanin e tij ose në filmin e tij dyndjen e menjëhershme pikëlluese të së mbinatyrshmes, nuk mund të bëjmë asgjë tjetër veçse për ta pranuar sikur përfshihej mrekullisht në thurimën e reales, e të përditshmes më të varfër. Kështu, tek Stalker, është vetë vajza e vogël e ciceronit që gëzon pushtete të jashtënormales, sikur Tarkovski kërkonte të na tregonte se jeta e përditshme dhe monotonia e saj e përsëritshme është prej një pasurie të padyshimtë, kërkimi i Zonës së mistershme duke mos qenë tjetër në fund të llogarisë veçse përshkrimi i pasqyrës së apostullit, përmjet të cilës nuk këqyrim tjetër veçse gjërat dhe qeniet të shformuara dhe të errësuara. Duke u kthyer nga Zona që ne, spektatorët, sikur të na jenë hapur sytë, mundim më në fund të shohim realitetin që na tregon Tarkovski.
Në të vërtetë, mrekullia që Aleksandri ka kërkuar me lutjen e tij nuk ka prishur asgjë, meqë futet përsosmërisht në këtë ditë të re të paspikatur, të rëndomtë dhe madje të padëgjuar, të personazhit, sjellja e tij për më pak të çuditshmen duke mos qenë asgjë tjetër, në sytë e tij, veçse unikja, e drejta, pra mënyra e devotshme për të mbajtur betimin që nuk e ka bërë para asnjë qenie njerëzore. Nëse dashuria ndaj prindit është e mrekullueshme, mbase ngaqë shenja e saj e vetme dalluese është të jetë plotësisht e parëndësi, pakëz më e theksuar se fakti i ujitjes, ditë pas dite, të një peme, një gjest i thjeshtë, na thotë Aleksandri, si ai i të pirit e një gote uji në zgjim. Devotshmëria nuk mund të jetë tjetër veçse punë e më të mëdhenjve, e njerëzve më kërkues, e më të fortëve gjithashtu, e atyre që qëndrojnë sypatrembur, meqë ajo e ndërton autoritetin dhe pushtetin e saj mbi atë që askush nuk mund as di ta shohë, meqë autoriteti i saj është pranim i dhuntisë të plotë, sakrificë, dhe shfaqja e saj më e përgjithshme, e veshur me gjeste gënjeshtare të cilave askush nuk ua kupton shenjëzimin, duke u futur në thurimën e orëve të mërzitshme dhe të ngadalta, është dhe nuk mund të jetë ndryshe veçse e pakuptueshme për sytë e atyre që rrethojnë njeriun e devotshëm që, dora-dorës zhbëhen rrotull tij lidhjet e lashta duke bashkuar botën e njerëzve me universin e shenjtë të zotave, do të jetë i marrë përherë e më shumë si një i çmendur i shkretë, një vegimtar goja e të cilit murmurit një lutje drejt një qielli të zbrazët.
Në veprën e Tarkovskit, është pra devotshmëria e babait, e vetmja për t`u patur dhënë besimin fjalëve dhe veprimeve të një gruaje të flakur tej nga shoqëria dhe magjistareje të dëgjuar, që shpëton birin e saj dhe ngre një bashkësi shpirtërore kundër gllabërimit të ngadaltë dhe të sigurt të shpirtit nga të mirat materiale. Duke u sakrifikuar, duke qenë njëherësh i sakrifikuar dhe sakrifikuesi, njeriu harron veten, i kushtohet tjetrit, birit të tij sigurisht por gjithashtu të gjithë të tjerëve, që nuk do të dinë asgjë për veprimin e tij dhe, po ta njihnin, do talleshin me të sipas të gjitha gjasave. Kundër zvarritjes të pafundme të raportimit universal, akti i besimit është, në thelb, absolutja e pabotueshme. Kështu Aleksandri, kur është i mbyllur në ambulancën që po e shpie në azil, largohet, mbase, nga xhami, që i biri të mos e shohë dhe që kështu, mrekullia mbetet e mbyllur madje tek njeriu që është më i shtrenjti për sytë e babait, i biri. Zhdukja e babait që për të nderuar premtimin e tij duhet të ruajë qetësinë, për t`i lënë birit të tij një botë në paqe duhet të largohet pak prej tij, ndreq baraspeshën por me kushtin e vetëm që të jetë, Aleksandri, i pakuptueshëm nga të tijët dhe tmerrësisht i urryer nga bota, për të cilën ka vendosur të sakrifikohe
01/03/2016 | Lien permanent
La résurrection intégrale de MMF, Midi-Minuit Fantastique, par Francis Moury

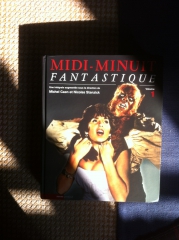 À propos de Midi-Minuit Fantastique, tome 1, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée sous la direction de N. Stanzick et M. Caen, Éditions Rouge Profond, 2014.
À propos de Midi-Minuit Fantastique, tome 1, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée sous la direction de N. Stanzick et M. Caen, Éditions Rouge Profond, 2014.C’est le 10 février 2014 qu’a donc enfin été publié le premier tome 1 de cette nouvelle édition – et non pas simple réédition, ce qui eût déjà été remarquable ! – de la célèbre revue Midi-Minuit Fantastique, éditée à l’origine par Éric Losfeld / Le Terrain Vague entre 1962 et 1970. Elle comptera quatre tomes au total et un index général tiré à part au moment de la parution du quatrième et dernier tome.
Midi-Minuit était un cinéma parisien du Boulevard Bonne Nouvelle, spécialisé dans le cinéma fantastique et le cinéma populaire de genres (à l’époque qualifié de ou pensé comme «mauvais genre» par la critique généraliste française) : horreur et épouvante, science-fiction, péplums, films érotiques, films d’espionnage, western italien, film policier violent, et tant d’autres catégories, sans oublier les films uniques, inclassables ou les films d’arts et essais expérimentaux distribués par hasard, «by jest or mistake / par plaisanterie ou par erreur», comme disait H. P. Lovecraft, dans le circuit commercial populaire qui était celui du Midi-Minuit.
C’est ce cinéma dont Herbert P. Mathese a dressé la programmation (sélective et non pas exhaustive contrairement à ce que croyaient certains critiques au moment de sa parution) dans la célèbre note de quatre ou cinq pages qui occupe le cœur de son livre sur José Benazeraf, la caméra irréductible (Éditions Clairac, 2007), note justement remarquée qui synthétisait admirablement ce que fut le cinéma bis dans l’histoire du cinéma mondial, et de quelle façon celui-ci fut reçu en temps réel en France, en exploitation commerciale.
C’est ce cinéma que j’avais tenté de faire revivre en 1985 au Bergère, après avoir convaincu son propriétaire Roger Boublil – qui venait de céder le véritable Midi-Minuit mais possédait encore les droits du nom – de rebaptiser Le Bergère, ce qui donnait dans le PariScope : Midi-Minuit, ex-Bergère. La résurrection fut brève (j’ai raconté en 2001 sa genèse et son histoire dans mes Souvenirs des cinémas parisiens parus dans Les Temps modernes n°601, souvenirs dont une version internet existe sur le blog Cinéastes.net puis une version encore plus longue et plus complète, qui se trouve à présent en ligne sur le blog de H. P. Mathese-Images) et le cinéma, tout comme la revue, retombèrent dans l’oubli sauf chez les cinéphiles et les historiens du cinéma.
La revue Midi-Minuit Fantastique fut ainsi baptisée en 1962 en hommage à ce cinéma précisément synonyme de voyage hors des frontières du temps et de l’espace, à la découverte du rêve, du cauchemar, de ce que le cinéma produisait de plus fort et de plus puissant en matière d’extases psychiques, d’ouverture sur Éros et Thanatos.
Ce n’était pas une revue intellectuelle (en dépit de certaines plumes sachant marier, de temps en temps, aussi bien l’esthétique du cinéma que l’histoire du cinéma) mais factuelle, à la manière anglo-saxonne : elle était avide de filmographies, de documents iconographiques inédits voire rarissimes (pavés presse, photos de plateau, photos d’exploitation, affiches, affichettes), de dessins originaux, de textes littéraires parfois inédits, de bandes-dessinées de SF, d’entretiens accordés par certains cinéastes majeurs (Roger Corman, Terence Fisher, Riccardo Freda, Jacques Tourneur, Edgar G. Ulmer) ou mineurs mais toujours passionnants (William Castle, Domenico Paolella, Don Sharp). Pour la première et la dernière fois, je crois que MMF est la seule revue (je ne tiens pas compte, en écrivant cela, des «fanzines» qui étaient contemporains de MMF mais qui n’étaient, hélas, pas des revues régulièrement éditées) à avoir jamais publié un entretien avec Don Sharp, le cinéaste des beaux Kiss of the Vampire [Le Baiser du vampire], Curse of the Fly et Face of Fu-Manchu [Le Masque de Fu-Manchu]. Ce sont d’abord pour ces entretiens et pour l’iconographie les accompagnant qu’il faut posséder l’intégrale de la revue dans sa bibliothèque, sans oublier les archives d’histoire du cinéma. Je crois qu’aucune revue française n’avait jamais consacré au cinéaste William Castle ou à l’acteur Bela Lugosi des articles aussi complets que ceux que lui consacrèrent MMF. Les contributeurs étaient très variés (Alain Le Bris, Michel Caen, Jean-Claude Romer, Roland Lethem, Jean Boullet), le niveau était inévitablement inégal mais on y trouvait pourtant régulièrement des trésors. Comment oublier, par exemple, les dossiers Inoshiro Honda et Koji Wakamatsu auxquels le cinéaste Roland Lethem (qui fut aussi le complice de Jean-Pierre Bouyxou pour La Science-fiction au cinéma, Éditions UGE, coll. 10/18, 1971) avait contribué ? Le cinéaste Jean Rollin lui-même (dont l’âge d’or coïncida avec la seconde période grand format de MMF) avait publié un dossier remarqué sur Gaston Leroux dans les deux derniers numéros, 23 et 24.
Certains numéros spéciaux sont demeurés longtemps fameux, notamment les premiers sur Terence Fisher, sur King Kong (l’original de 1933 bien entendu), mais aussi sur Dracula ou encore Les Chasses du comte Zaroff. C’étaient des Cahiers de l’Herne cinéphiliques, mutatis mutandis : témoignages de première main, iconographie à laquelle des collectionneurs contribuaient passionnément et qu’alimentaient en temps réel les distributeurs et les producteurs, correspondances ou lettres originales reproduites en fac-similé, rien n’y manquait. Le célèbre numéro 8 prisé des collectionneurs sur Érotisme et épouvante dans le cinéma anglais contient des plans d’orgies, coupés au montage ou par la censure, de classiques du cinéma fantastique aussi importants que The Flesh and the fiends [L’Impasse aux violences] (G.-B., 1959) de John Gilling ou encore que Jack The Ripper [Jack l’éventreur] (G.-B., 1958) de Robert S. Baker et Monty N. Berman. Le passage au grand format accentua cette diversification parfois excessive : dans le numéro 17 de juin 1967, le cinéaste Jean-Pierre Mocky se retrouvait interviewé à quelques pages de Barbara Steele, ce qui n’avait évidemment aucun sens alors que Mocky avait trahi Jean Ray en adaptant en film comique La Cité de l’indicible peur ! Le succès venant, la revue pouvait certes distribuer (via Les Films de l’Étoile) et programmer (au Studio de l’Étoile) des reprises (comme Freaks de Tod Browning, Island of Lost Souls [L’île du Dr. Moreau] d’Erle C. Kenton, ou bien L’Homme léopard de Jacques Tourneur) et des exclusivités (The Premature Burial [L’Enterré vivant] (États-Unis, 1962) de Roger Corman d’après Edgar Poe) avec un peu de décalage. Un certain sensationnalisme pouvait toutefois gravement gâter l’événement : Michel Caen n’hésitait pas à inviter un brave nécrophile se vantant de dormir dans son cercueil afin de poser en sa compagnie dans le hall du Studio le soir de la première. On était loin de la finesse du film de Corman, de sa profondeur aussi. Mais enfin l’essentiel était bien de le voir (on ne disait pas encore «visionner» : on réservait alors ce terme aux visionneuses de diapositives 24/36) et c’était grâce à MMF, aux Films de l’Étoile et au Studio de l’Étoile qu’on le voyait ! On pouvait donc passer sur ces quelques errements (réservant d’ailleurs des surprises qui sont le propre de l’errance, sa rançon positive : il y avait par exemple un aspect non pas fantastique mais insolite chez Mocky qui était très bien illustré par le dossier cité plus haut), tant la richesse d’ensemble était grande. Ce n’est pas pour rien, on le voit, que la revue MMF – ainsi qu’on l’abrégeait affectueusement en supprimant le trait d’union entre les deux «M» – était vendue dans la plus ancienne librairie surréaliste parisienne qu’était alors Le Minotaure.
Ce premier tome de 672 pages est, en outre, assorti d’un DVD de 205 minutes contenant de nombreuses archives d’émissions de télévision d’époque devenues invisibles (des entretiens filmés avec Barbara Steele ou avec Jean Boullet qui fut le parrain historique et esthétique de MMF) à moins de fouiller les archives de l’INA et des téléfilms fantastiques français devenus tout aussi rares tels que Le Puits et le pendule d’Alexandre Astruc d’après Edgar Poe.
Voici le sommaire de la revue, valant mieux que bien des discours :
• n°1 — mai 1962 : Terence Fisher.
• n°2 — juillet/aout 1962 : Les Vamps fantastiques.
• n°3 — octobre/novembre 1962 : King Kong.
• n°4/5 — janvier 1963 : Dracula.
• n°6 — juin 1963 : La Chasse du comte Zaroff.
• n°7 — septembre 1963 : Actualité du fantastique.
• n°8 — janvier 1964 : Érotisme et épouvante dans le cinéma anglais.
• n°9 — juillet 1964 : Le Tour du monde du fantastique.
• n°10/11 — hiver 1964/1965 : Castle, Corman, Fisher.
• n°12 — mai 1965 : Jacques Tourneur, Domenico Paolella, Barbara Steele.
• n°13 — novembre 1965 : Edgar G. Ulmer, Les Festivals.
• n°14 — juillet 1966 : Christopher Lee, Fu Manchu.
• n°15/16 — décembre 1966/janvier 1967 : Trieste, San Sebastian.
• n°17 — juin 1967 : Barbara Steele, Jean-Pierre Mocky.
• n°18/19 — décembre 1967/janvier 1968 : Polanski, Christopher Lee, Barbarella.
• n°20 — octobre 1968 : Michael Powell, Inoshiro Honda.
• n°21 — avril 1970 : Koji Wakamatsu, Le Studio de l’Étoile.
• n°22 — été 1970 : Science-fiction, Bert I. Gordon.
• n°23 — automne 1970 : Gaston Leroux I.
• n°24 — hiver 1970 : Gaston Leroux II.
Nota bene : Un ultime numéro double, le 25/26, est resté inédit du fait de l’acharnement de la censure contre l’éditeur de Midi-Minuit Fantastique, Éric Losfeld, au début des années 70. Au sommaire de ce n° 25/26, annoncé pour mai 1972, puis pour 1973 : Tarzan, Pierre Mac Orlan, Terence Fisher… Il sera publié pour la première fois dans le quatrième volume de L’intégrale Midi-Minuit Fantastique.
Première bonne nouvelle : l’ensemble de la revue est réédité dans un format unique de reliure sous jaquette. Finie la séparation physique entre la première période du petit format (de 1962 à 1966, du n°1 au N°13) et la seconde période grand format (de 1966 à 1971, du n°14 au n°24).
Deuxième bonne nouvelle : la couleur fait son apparition et on découvrira un certain nombre de documents photographiques en couleurs pour la première fois, telle cette esquisse dessinée pour King Kong par Willis O’Brien dans le MMF n°3.
Troisième bonne nouvelle : les documents photos ont été pour un grand nombre d’entre eux rephotographiés à la source : leur définition et leur précision sont supérieures à celle de la première édition !
Quatrième bonne nouvelle : les couvertures originales sont soigneusement reproduites afin que les collectionneurs retrouvent immédiatement l’ordre de chaque numéro et son esthétique originale au sein du tome, dans l’ordre de parution.
Cinquième bonne nouvelle : il y a des inédits ! Textes, photos, dessins qui n’avaient pas trouvé place à l’époque, mais qui la trouvent à présent, en raison d’une rationalisation de l’espace, gain d’un travail acharné mené en collaboration entre Nicolas Stanzick (dont on a déjà lu la belle étude sociologique, historique et esthétique Dans les griffes de la Hammer, Éditions BDL sur une partie de la production Hammer Films et sur sa réception critique et publique en France de 1955 à 1975, dans laquelle l’auteur de ces lignes avait répondu aux questions posées par Nicolas) et Michel Caen, l’un des rédacteurs en chef de la revue originale. C’est ainsi que le mythique double n° 25-26 demeuré inédit à cause de l’arrêt de la revue en 1971 va enfin voir le jour, avec des articles notamment consacrés à Terence Fisher qu’on attend de lire avec impatience !
Ce que symbolisa – autant que ce que fut réellement ! – la revue Midi-Minuit Fantastique pour la génération de cinéphiles qui avait eu vingt ans en 1960 : l’ouverture des portes du rêve (comme disait Geza Roheim), portes qui s’ouvraient d’une manière inédite en France et même en Europe, puisque jamais aucune revue – si incroyable que cela puisse paraître aujourd’hui – n’y avait été consacrée au cinéma fantastique, d’horreur et d’épouvante, de science-fiction ou au cinéma bis, suivant une autre expression qui devait devenir célèbre. Alors qu’aux USA, plusieurs revues existaient (Famous Monsters of Filmland, Creepy, Eery, Vampirella : ces trois derniers titres arriveront ensuite en France, adaptés par une partie de l’ancienne équipe de MMF à partir de 1970 environ, prenant de facto le relais éditorial de MMF mais avec des présentations très différentes : le concept de cinéma bis, notamment, sera popularisé par Creepy, Eery et Vampirella dans la lignée directe de MMF) et rencontraient donc un large public, à l’échelle de l’Amérique du Nord, Canada anglophone inclus.
Cette réédition de 2014 redonne vie esthétique et historique à ce symbole, en l’enrichissant encore d’éléments inédits et du dialogue à venir avec les lecteurs des générations contemporaines qui redécouvriront ainsi un pan englouti de l’histoire et de l’esthétique du cinéma mondial tel qu’il fut – tel qu’il est encore réellement vivant, actif, effectif puisque l’œuvre d’art, à la différence de ses créateurs, a ce privilège non seulement de renaître elle-même à chaque nouveau regard mais encore de faire renaître la «Weltanschauung» (la «vision du monde» comme la phénoménologie husserlienne le précise) qui l’entourait. Il va falloir s’habituer à contempler en couleurs sur la jaquette du tome 1 la photo d’Yvonne Romain terrifiée par Oliver Reed alors qu’elle fut pour nous une photo à tout jamais N.&B. mais on s’y habituera, avec le temps d’autant plus facilement que l’originale N.&B. nous attend, à sa place, en première de couverture du n°1. Telle qu’en elle-même enfin…
Quelques images sont disponibles ici.
Nota bene : parmi les éléments inédits essentiels dans ce tome 1 : la préface de Michel Caen (quatre pages) et l’introduction de Nicolas Stanzick, Midi-Minuit Has Risen From the Grave (26 pages environ) : ces pages comprennent nombre de documents inédits : photos des midi-minuistes au travail ou en virée, lettre manuscrite de Merian C. Cooper, etc. Autre élément majeur : le chapitre central, qui est une sorte de numéro inédit de MMF, conçu avec des textes d'hier et d'aujourd'hui : L'Entracte du Midi-Minuit. On y trouve aussi bien une rubrique érotique consacrée à l’actrice Marie Devereux (Nicolas a retrouvé ses superbes nus photographiés par Harisson Marks en Angleterre en version haute définition), un entretien avec Fellini sur les Fumetti (par Michel Caen et Francis Lacassin), et un long texte de Nicolas Stanzick sur ce qu’il qualifie de chef-d’œuvre oublié du cinéma français : Fantasmagorie, un moyen métrage de Patrice Molinard (beau-frère de Georges Franju, photographe de plateau du Sang des Bêtes) avec Édith Scob dans le rôle d'une femme-vampire croqueuse d'enfant, errant dans une sorte d'étrange Transylvanie val-d'oisienne...
19/03/2014 | Lien permanent
Pierre Boutang ex cathedra, par Francis Moury (Infréquentables, 2)

 Pierre Boutang dans la Zone
Pierre Boutang dans la ZoneCe texte a paru sous le titre Ma rencontre avec Pierre Boutang comme professeur de philosophie à la Sorbonne (1983 – 1984) dans la revue Dialectique n°10 (Lyon, février 2003) en guise de préface autobiographique à l’édition des Notes manuscrites prises à trois séminaires de doctorat (Recherches sur les noms divins) et à un cours d’agrégation (La nature et les espèces de l’irrationnel) inédits de Pierre Boutang, professés à Paris-IV Sorbonne en 1983-1984. Nous en donnons ici une version revue et corrigée, qui n'a pu trouver sa place, par sa taille, dans le dossier consacré aux infréquentables publié dans la revue La presse littéraire parue en 2007.
Dans sa toute récente biographie sur Pierre Boutang, Stéphane Giocanti, s'il cite ce texte de Francis Moury, oublie fort opportunément de rappeler qu'il a par deux fois, d'abord dans sa version papier puis dans la Zone, été publié dans des supports dont il ne pouvait, cet auteur malmené dont nous n'avons jamais beaucoup goûté la préciosité royaliste, que connaître le propriétaire. Je remets ce précieux témoignage de Francis en une, étant donné que 2016 est l'année du centenaire de la naissance de Pierre Boutang.
Prologue
«Les Pères de l’Église d’Occident ne se groupent pas, comme ceux d’Orient, en écoles compactes et bien tranchées. Dans les pays latins, il n’existait aucun grand centre littéraire, où l’enseignement fût donné par des professeurs et des maîtres, comme S. Pantène, Clément et Origène, à Alexandrie, ou Diodore de Tarse, à Antioche. Privés de ce secours, les docteurs des Églises d’Italie, d’Afrique et des Gaules, séparés d’ailleurs, la plupart, les uns des autres par le temps comme par les lieux, se sont formés eux-mêmes d’une manière indépendante. Aussi, en dehors de l’unité doctrinale commune, ils ont puisé leurs opinions particulières, sur les questions qui n’étaient pas décidées par l’Église, dans l’étude, la lecture et leurs réflexions personnelles. Les écrits de leurs devanciers, grecs et latins, ont naturellement exercé sur leurs esprits une grande influence, et souvent, quand ils ne les ont pas trouvés d’accord ensemble, ils ont cherché à les concilier par des opinions moyennes, comme nous allons en voir des preuves nombreuses.»
F. Vigouroux, Mélanges bibliques – La Cosmogonie mosaïque d’après les Pères de l’Église, suivie d’études diverses relatives à l’Ancien testament et au Nouveau testament, § V Les Pères latins, seconde éd. Berche & Tralin revue et augmentée, 1889, p. 89.
«Quand nous disons – ainsi que le Christ l’a dit lui-même – qu’il faut tout abandonner et se dépouiller de tout, il ne nous est point permis de l’entendre au sens où l’homme n’aurait plus besoin de travailler ni de rien faire. L’homme ne sera jamais libéré de sa tâche et de ses soucis tant qu’il vivra. Mais il faut entendre par là que nul pouvoir chez l’homme, quoi qu’il fasse ou qu’il ne fasse pas, quoi qu’il connaisse ou qu’il sache, quand bien même on y ajouterait celui de toutes les créatures, n’est capable de produire l’Unité.»
L’Anonyme de Francfort, citation présentée et traduite par Jean Chuzeville, Les Mystiques allemands du XIIIe au XIXe siècle, Grasset, 1935 - 1956, p. 184.
«Quel nom donner à cette puissance inconnue qui fait hâter le pas des voyageurs sans que l’orage se soit encore manifesté, qui fait resplendir de vie et de beauté le mourant quelques jours avant sa mort et lui inspire les plus riants projets, qui conseille au savant de hausser sa lampe nocturne au moment où elle éclaire parfaitement, qui fait craindre à une mère le regard trop profond jeté sur son enfant par un homme perspicace ? Nous subissons tous cette influence dans les grandes catastrophes de notre vie, et nous ne l’avons encore ni nommée, ni étudiée : c’est plus que le pressentiment, et ce n’est pas encore la vision. »
Honoré de Balzac, Œuvres complètes, Scènes de la vie parisienne, Histoire des Treize § 1, Ferragus, chef des Dévorants, éd. Michel Lévy frères, 1865, p. 64.
«D’ailleurs, observons la Blatte à la sortie de son abri sous faible éclairement, au moment de ses premières explorations sur un labyrinthe étroit, entouré d’eau qui l’empêche de se déplacer en dehors : sa démarche est hésitante, pleine de «circonspection», sa tête se déplace à gauche et à droite, tandis que ses antennes brassent l’air en tous sens et inspectent la sortie de son gîte ; elle monte dessus, le contourne pendant que sa vitesse s’accroît progressivement. Enfin, elle se précipite sur le plateau et fonce droit devant elle, le corps parallèle au plateau, les palpes maxillaires dirigées vers le sol, jusqu’à ce qu’elle rencontre un obstacle frontal qu’elle longe pendant quelques fractions de seconde avant de repartir dans une autre direction. […] Ce n’est qu’après un long séjour sur le labyrinthe que la démarche de l’Insecte devient moins rapide, plus sinueuse, qu’elle est entrecoupée de haltes plus nombreuses aux carrefours. Parallèlement, les «mimiques» de la Blatte évoluent : aux arrêts, elle se dresse sur ses pattes, de sorte que la tête domine tout le corps et que les antennes inspectent l’environnement. Souvent même elle avance dans cette position : les traces sont alors ondulées.»
Roger Darchen & Paul-Bernard Richard, Quelques recherches sur le comportement explorateur “chronique” de Blatella germanica, in Journal de psychologie normale et pathologique, 57e année, n°1, Conduites des animaux et intelligence animale, éd. P.U.F., janvier-mars 1960, pp. 83-84.
Introduction
 Photographie de Louis Monier prise dans la bibliothèque de Pierre Boutang.
Photographie de Louis Monier prise dans la bibliothèque de Pierre Boutang.On me demande souvent :
«– Pourquoi aviez-vous choisi Boutang comme directeur de thèse ?» ou plus brièvement encore mais plus directement, comme me l’avait autrefois demandé Régis Debray : «– Pourquoi vous et Boutang ?».
À cette question je ne crois possible de répondre qu’en évoquant, d’une part, l’ambiance intellectuelle, sociale et politique de l’époque et le retentissement qu’elle pouvait avoir sur un apprenti philosophe «lambda» et, d’autre part, en brossant succinctement mon itinéraire personnel. Je préviens cependant le lecteur : ces deux réponses fournies avec autant d’honnêteté que possible, il n’est pas encore certain que cette rencontre puisse être finalement placée davantage sous le signe de la nécessité que sous celui de la contingence.
Pour un élève philosophe préparant en 1979 le concours d’entrée à l’E.N.S. à Louis-le-Grand, on peut dire sans risque d’erreur que les perspectives étaient assez sombres. Le métier de fonctionnaire était à l’époque totalement déconsidéré par la société civile. Cette dernière était caractérisée par certaines expressions : «les années-fric», «la montée de l’individualisme», la «dégradation de la cohésion sociale». Quant à ceux qui ne rêvaient que d’en gagner, du fric, on ne peut pas dire que les perspectives étaient mirobolantes non plus : la montée du chômage en flèche, la crise économique et sociale avaient amené la chute de Giscard et l’élection de Mitterrand, entraînant une panique boursière mémorable en raison, notamment, des nationalisations et de la présence de ministres communistes au gouvernement.
Dans ce contexte, je me rappelle très bien notre professeur d’histoire Jean Mathiex nous disant (je cite de mémoire) : «– Vous autres les khâgneux littéraires, vous devez bien avoir conscience que vous avez le choix : soit poursuivre dans les différentes disciplines que vous avez choisies et crever de faim, soit devenir crémiers et gagner de l’argent !» et d’ajouter une autre fois : «– Vous aurez sacrifié les meilleures années de votre vie à la préparation du concours le plus difficile : pour les rares d’entre vous qui le réussiront, ils en seront récompensés, mais le sort des autres sera si pénible qu’il vaut mieux que vous n’y pensiez pas»… jouissant malicieusement du frisson collectif qu’une telle déclaration avait produit dans nos rangs.
En outre, d’un point de vue purement philosophique, mon professeur Barnouin m’avait fortement impressionné. Davantage même qu’Hubert Grenier l’année suivante. Barnouin nous avait cité Épicure : «La philosophie, c’est le plaisir et la peine, c’est la vie et la mort» ! Barnouin nous avait demandés : «– Quelle est la question que pose Kant ?» et il avait ajouté, avec un souverain mépris : «– Ne me répondez surtout pas par les trois questions qui servent à résumer son système dans les mauvais manuels – que pouvons-nous connaître ? que devons-nous faire ? que nous est-il permis d’espérer ? – car je vous préviens que cela ne suffira pas ; ce n’est pas cela, la véritable question kantienne. Alors, qui d’entre vous la dira, qui d’entre vous la connaît… personne ?». J’avais levé timidement le doigt. « – Oui ? Nous vous écoutons…»
«– Comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ?»
«– Très bien ! Votre nom ?»
Cela avait créé un lien entre nous : nous nous étions reconnus immédiatement et c’est de la reconnaissance que naît l’estime, jamais autrement. Descartes le savait : l’admiration est la passion la plus noble.
Barnouin, enfin et surtout, nous avait fait découvrir, à l’occasion d’un cours magnifique sur l’idée de méditation chez Descartes, la perfection du système de Hegel.
Et à l’époque je pensais, en mon for intérieur : «– Ou bien le système de Hegel est vrai, et alors tout est déjà dit, inutile même de lire un autre que lui. Ou bien il a tort, le réel n’est pas rationnel et le rationnel n’est pas le réel. Et dans ce cas, ce ne sont pas le social ou la politique qui peuvent sauver l’homme, mais éventuellement la communion esthétique ou mystique. Sans que pour cela on doive d’ailleurs renoncer au rationalisme, à condition qu’il ne prétende pas réduire l’aporie».
Avec comme conséquence que la société civile ne pouvait guère offrir d’autre alternative de salut social que d’être artiste ou prêtre.
Quant à l’idée d’enseigner… enseigner à qui ? Dans quel but ?
Ceux qui savaient lire pouvaient bien lire par eux-mêmes, comprendre ce que nous avions nous-même compris, se sauver par eux-mêmes. Ce n’était pas l’idée de passer trente ans dans une classe de terminale à répéter chaque année trois formules de Kant ou de Descartes ou du père Bachelard qui me semblait vaine, c’était l’idée de corriger des milliers de dissertations dont une ou deux par an seraient valables et de servir un système et une société que j’abominais et méprisais chaque jour davantage. Impitoyable adolescence.
Après deux classes de Première supérieure (1980 et 1981), au cours desquelles nous avions, tous, perdu un ou deux kilogrammes d’une année sur l’autre en raison des soixante heures de travail hebdomadaire que nous fournissions en moyenne, aussi après deux échecs au concours – dont le Président du Jury, en philosophie, était en 1981 le maître hégélien Bernard Bourgeois que je devais retrouver en 1997 à Paris-I donnant un cours de licence sur Fichte et un cours d’agrégation sur… Nietzsche, tous deux formulés dans le plus pur langage hégélien: le temps retrouvé ! –, je me retrouvais une licence en poche et un peu fatigué à la Sorbonne. À ce stade, il fallait penser à la maîtrise : c’était le moment de faire son choix parmi les professeurs de la Sorbonne. On nous serinait sans cesse, de l’autre côté de la rue Saint Jacques, que la vraie Sorbonne, c’était Paris-IV et non pas Paris-I, excroissance récente et sans grande valeur qui avait surtout – Dicunt, narrant, tradunt – donné lieu à d’homériques mais véridiques luttes de chiffonniers entre les Directeurs d’U.E.R. lorsque s’était posée la question du partage des volumes en dotation dans les Bibliothèques respectives de chaque organisme ! Bref on devait s’inscrire, si on était fidèle à notre récent passé, à Paris-IV pour y préparer l’agrégation, quitte à suivre de temps en temps les cours de Paris-I qui trouveraient grâce à nos yeux d’élite.
Donc choisir un professeur pour diriger sa maîtrise, et un professeur de Paris-IV…
Ce fut d’abord Maurice Clavelin : j’aimai sa rigueur, la netteté et la clarté de son enseignement de la philosophie des sciences et de la connaissance. Il donnait des cours de licence sur la «philosophie de la physique» et la «philosophie des mathématiques» que l’on comprenait aisément. C’était un grand pédagogue. Lorsque je lui avais expliqué que j’aimais bien les Positivistes spiritualistes, il m’avait proposé Émile Meyerson, ce qui m’avait passionné. Il dirigeait l’U.E.R. de philosophie de Paris-IV à l’époque où Raymond Polin (celui de La Création des valeurs des années 40, qui venait de publier en 1977 chez Vrin dans la collection Problèmes et controverse une critique amère et désabusée de la société giscardienne et sa mérécratie intitulée La Liberté de notre temps) était président de la Sorbonne. Mais sa discipline, et son enseignement dans les terminales des lycées, était elle-même en crise, soumise à des attaques dont les causes étaient internes et externes. Il suffit de lire l’article de Polin paru dans Le Figaro du mercredi 20 juin 1979 intitulé Quel avenir pour la philosophie ? – Point de vue : Régénérer l’enseignement, pour avoir une mise au point détaillée de ces deux types de cause, à ce moment précis.
L’enseignement en général était en crise, ouverte, déclarée et ce n’est pas la réforme du ministre Savary qui allait arranger les choses. Elle donna lieu aux manifestations de «Mai 83», qui fut notre «Mai» à nous et auxquelles je pris part sur le pont Alexandre III et au Quartier latin. Nous étions réticents à l’idée que le personnel chargé de l’entretien des locaux universitaires puisse se voir attribuer un droit de vote identique en valeur à celui d’un enseignant. Cette perversion démocratique nous semblait la marque indubitable d’un début de dictature communiste qu’il convenait de mettre au pas. Le ministre socialiste Alain Savary fut contraint de retirer son projet. Et elle donna surtout lieu à un article de Bernard Bourgeois lui-même dans Le Monde du vendredi 7 octobre 1983, dialectique, vigoureux, glacé et définitif dont le titre décourageant était L’École sans sa République ? En fait, face à la démocratie socialo-libérale marchande et barbare, ses arguments pour défendre l’enseignement humaniste et son fleuron, la philosophie, étaient déjà ceux employés par Léon Brunschvicg dans un discours de remise des prix au lycée Condorcet le 31 juillet 1902 (paru dans Les études philosophiques – 4e année, n°2 – avril-juin 1949, pp. 118 et sq. sous le titre Le Devoir des éducateurs puis dans Nature et Liberté sous le titre L’Éducation de la liberté; cf. : Brunschvicg, Écrits philosophiques, t.III, § bibliographie complète, n°28 de la p. 258, éd. P.U.F., coll. B.P.C., 1958). Régis Debray lui-même les a en somme repris dans un admirable article publié à l’adresse du débile Claude Allègre dans Le Monde du 3 mars 1998. Comme si chaque grand philosophe d’une génération passait à son successeur le flambeau tout au long du XXe siècle, flambeau condamné à l’obscurité et arguments qui ne touchent jamais l’oreille du ministre, dont seul le nom change.
À la fin de l’année universitaire 1982, Clavelin me donne la maîtrise avec mention «bien» (Paris-IV n’accordait la mention «très bien» qu’aux Normaliens) et me dit : «– Je ne puis vous garder avec moi pour une thèse de doctorat en philosophie des sciences car vous avez une formation littéraire.» Je me demandai si Léon Brunschvicg m’eût chassé de son domaine pour la même raison mais j’acceptai l’argument. Il me semblait aussi que j’avais fait le tour, grâce à Clavelin, de la philosophie des sciences et de la connaissance. Et puis, Boutroux, Poincaré, Hamelin, Le Roy, Bergson, et tant d’autres avaient déjà dit le dernier mot sur le rapport entre science et philosophie, entre science et réalité... Ce qui m’avait plu chez Meyerson, c’est qu’il les résumait tous : l’irrationnel recule devant l’assimilation de la raison mais n’est pas réductible. Mon démon philosophique me réclamait une autre source où m’abreuver. Il fallait chasser à nouveau, non pas l’être, comme chez Platon, mais un professeur !
La rencontre
C’est dans ce contexte que mon parrain, le Dr Francis Pasche (1910-1996), ancien Président de la Société Psychanalytique de Paris, lorsque je lui cite le nom de Boutang (qui avait à Paris-IV une chaire d’Ontologie et de métaphysique : le degré le plus élevé des matières philosophiques) me dit son admiration pour sa culture et son intelligence. Ils avaient passé des vacances en voisins sur une île grecque, Skorpios ou Délos, quelques années ou mois plus tôt…
Pour moi, Boutang, c’était le disciple de Charles Maurras, les « Camelots du roi » : lointain même si j’avais lu et annotée in extenso en 1978 la petite étude de Pol Vandromme, Maurras, L’église de l’ordre (éd. du Centurion, coll. Humanisme et religion, 1965). Et même si j’ai, par la suite, découpé pour l’y ranger dedans, pliée dans un rabat du verso, la critique de René Rémond sur le Maurras, la destinée et l’œuvre de Boutang qui devait paraître chez Plon en 1984, donc un an plus tard. J’avais même poussé le zèle étudiant jusqu’à y inclure un autre découpage d’un article de Gilbert Comte sur une biographie de Jacques Bainville par Jean Montador.
Boutang, c’était aussi sa prestation chez un Pivot narquois qui lui disait :
« – Bravo pour cet imparfait du subjonctif ! » et à qui Boutang répondait : « – Ah bon, parce que ça aussi, ça doit disparaître ? »
La grande classe.
Et Boutang, ce fut surtout – médiatiquement parlant, le dialogue télévisé en direct avec Steiner (en sueur, très excité, pathétique pour tout dire) où il nous promenait comme en se jouant sur les sommets les p
15/03/2016 | Lien permanent
Damnation de Béla Tarr, par Olivier Noël

16/11/2006 | Lien permanent






























































