Rechercher : alain soral
Les larmes du Stalker. Entretien avec Marc Alpozzo, 3

02/08/2008 | Lien permanent
Le corps politique de Gérard Depardieu de Richard Millet

 Richard Millet dans la Zone
Richard Millet dans la ZoneSi elle était douée d'un cerveau, la blonde de Neuilly dont nous avions esquissé le très rapide portrait estimerait que l'un des plus récents essais de Richard Millet (nous n'osons dire, le dernier, tant ce cacographe parvient à publier, à un rythme sidérant, ses cacographiques productions) est pour le moins embrouillé. Il n'en est pas moins intéressant, non pas tant pour ses propres qualités d'écriture, ses vues sur telle ou telle thématique, la profondeur de son raisonnement, que parce qu'il nous offre la vision, assez incroyable tout de même pour qui ne possède aucune notion scientifique en tératologie, de la destruction progressive d'une intelligence qui s'enferme volontairement dans un discours tournant à vide, devenu fou, lui-même monstrueux. Si le cerveau, nous l'avons dit hypothétique, de notre lectrice blonde était en outre assez bien configuré, il pourrait même lui suggérer que le plus récent essai, et non le dernier donc, car il n'y a jamais de dernier essai de Richard Millet, n'est que la plus récente confirmation de l'imposture intellectuelle constante, répétée, point du tout honteuse et même fière de son courage, de plus en plus folle et abjecte, que représente un essai de cet auteur qui écrit dans un cabanon paradoxal, public, puisqu'il parvient fort aisément à se faire publier. J'appelle fou l'essayiste Richard Millet, et complice de sa folie tout éditeur qui publie ses essais. J'appelle imbécile, en revanche, ou mauvais lecteur, ou lecteur tellement idéologisé qu'il ne sait plus lire, toute personne qui prend pour argent comptant le développement inquiétant de la folie de cet homme. Il apparaît de cela qu'un éditeur, qui est d'abord un lecteur, peut être un parfait imbécile, ou un mauvais lecteur, c'est au fond un peu la même chose.
 J'ai aussi bien écrit, noir sur blanc, qu'un essai de Richard Millet est une imposture intellectuelle, que nul ne semble devoir désigner comme telle, dans ce pays où pourtant le dernier concierge se pique de lettres, et je crains même que cette série de débâcles que sont les textes à prétentions intellectuelles de Richard Millet ne finisse par me faire relire un ouvrage comme Le sentiment de la langue avec bien peu d'aménité, pour y lire, ou plutôt y redécouvrir, toutes les petitesses que j'ai lues dans les textes qui ont suivi ce dernier.
J'ai aussi bien écrit, noir sur blanc, qu'un essai de Richard Millet est une imposture intellectuelle, que nul ne semble devoir désigner comme telle, dans ce pays où pourtant le dernier concierge se pique de lettres, et je crains même que cette série de débâcles que sont les textes à prétentions intellectuelles de Richard Millet ne finisse par me faire relire un ouvrage comme Le sentiment de la langue avec bien peu d'aménité, pour y lire, ou plutôt y redécouvrir, toutes les petitesses que j'ai lues dans les textes qui ont suivi ce dernier.Richard Millet est loin, mais alors très loin des préoccupations immédiates de notre ridicule blonde et mon lecteur pourrait à bon droit se demander pourquoi, venu lire un article sur un des innombrables essais du dernier écrivain de race française (comme on le dit des vaches charolaises) encore vivant, je l'ennuie avec les aventures convenues (amourettes et gaudrioles plus ou moins virtuelles, Emma s'ennuie et elle a baisé tous les Charles) d'une connasse tout aussi plate qu'une limande élevée dans une piscine genevoise. Eh, que ne me remercie-t-il pas plutôt, cet ingrat, puisque, en évoquant tout autre chose qu'un essai de Richard Millet, par exemple la trajectoire fulgurante d'une idiote, je lui inflige en somme la même punition que ce dernier administre à ses lecteurs, lui qui ne parle jamais, ou presque jamais, du sujet qui devrait être celui de son livre, que je rappelle obligeamment : le corps politique de Gérard Depardieu, soit quelque chose comme la beaufisation intégrale de la France mâtinée de très vagues considérations de théologie politique ! De la sorte, en lui infligeant une telle punition, je devance son ennui, et le dégoûte de lire Richard Millet, dont par surcroît il associera la logorrhée aux maigres cavalcades d'une bourgeoise décérébrée.
 Puis c'est en partie faux d'affirmer cela car parler de la pluie et du beau temps, d'une blonde se piquant de réfléchir, de son probable amant tout aussi ridicule qu'elle, des affres de Micheline ou de Delphine, c'est encore, toujours, évoquer la France ou ce qu'il en reste, donc évoquer Richard Millet ou ce qu'il reste de ce polygraphique et patient compilateur de sa propre geste auréolée de la gloire des Anciens, les Français de souche, les simples, les gueux, les Depardieu. En quelque sorte, sombrer dans la vulgarité, la facilité, c'est immédiatement retrouver un certain nombre d'auteurs (Soral, Millet, etc.) tout autant embourbés dans ces matières à fumerolles, alors qu'ils prétendent s'en tenir soigneusement éloignés : la France beaufarde a les intellectuels qu'elle mérite, après tout.
Puis c'est en partie faux d'affirmer cela car parler de la pluie et du beau temps, d'une blonde se piquant de réfléchir, de son probable amant tout aussi ridicule qu'elle, des affres de Micheline ou de Delphine, c'est encore, toujours, évoquer la France ou ce qu'il en reste, donc évoquer Richard Millet ou ce qu'il reste de ce polygraphique et patient compilateur de sa propre geste auréolée de la gloire des Anciens, les Français de souche, les simples, les gueux, les Depardieu. En quelque sorte, sombrer dans la vulgarité, la facilité, c'est immédiatement retrouver un certain nombre d'auteurs (Soral, Millet, etc.) tout autant embourbés dans ces matières à fumerolles, alors qu'ils prétendent s'en tenir soigneusement éloignés : la France beaufarde a les intellectuels qu'elle mérite, après tout. Livre ouvert, aussitôt refermé mais il faut pourtant se forcer à l'ouvrir de nouveau, tant la première page, qu'il faudrait citer intégralement, est caricaturale : déploration, grandeur en toc, aigres lyres de la France qui n'est plus mon bon Monsieur Pinot, toutefois retenue de sombrer dans l'abîme de la décrépitude par la seule présence de rétiaire, de combattant (dans les phalanges chrétiennes d'une imagination qui se prendrait pour la réalité ?), de dernier, bien sûr, grand écrivain français vivant, Richard Millet l'unique, suite de mots sans beaucoup de sens ni d'ordre, qui s'appellent les uns les autres, confrontent leurs sonorités et les trouvent agréables, font la bagarre puis, parce qu'en fait ils n'ont de force qu'une factice énergie, s'écroulent minablement, se transforment en flache sentant la merde sèche, pulvérulente. Ces mots merdeux, qui poissent et collent aux yeux, à la langue et au cerveau : «décomposition», «effacement historique», «déclin programmé», «bien-être», «humanisme athée», «indifférence générale», «peuple français», «mouvement vertical de l'assimilation», «droit au sang», «immigration de masse», «guerre civile», «multiculturalisme officiel», «expiation des crimes de l'Europe», «fécondes tensions post-dialectiques», «forme nouvelle de barbarie». Je précise que tous ces mots tiennent, chez Richard Millet, dans une seule phrase, et que nous pourrions les mettre à peu près dans l'ordre que nous souhaiterions, comme d'ailleurs l'auteur lui-même ne manque pas de le faire (1), car l'ordre des mots, chez Richard Millet, n'a aucune espèce d'importance, puisque cela compte seulement qui les fait s'entrechoquer dans un cliquetis de bibelots en fer blanc. Tout au plus, parce qu'il finit lui-même par s'embrouiller quelque peu la concaténation, l'auteur saupoudre sa soupe indigeste de «soit» et de «autrement dit» (p. 9), censés, du moins sommes-nous fondés à le supposer, lier le potage, et empêcher que ses différentes composantes, racisme sourd, envie plutôt que saine colère, ignorance crasse (y compris et surtout, en littérature), victimisation mensongère, auto-éploration impudique, gras mensonges à vertus romanesques (la Guerre du Liban), bêtise de comptoir, ne soient point trop disparates.
Ailleurs, c'est le remugle de l'accumulation paraphrastique, déferlement de méchants mots que rien ne relie, pas même, peut-être, comme nous aurions pu l'attendre d'un homme qui se redit écrivain du soir au matin, leur sonorité, baratin d'escamoteur de petit pois vaguement gréé par de martiaux «nous, veilleurs des confins» (p. 10), ce «nous» qui, chez Richard Millet, n'est jamais qu'un «moi», un lui, lui et encore lui, lui contre tous les autres, surtout si l'autre n'est pas vraiment, comme lui, blanc et catholique.
«Nous qui ne donnons pas dans le culturel» (p. 14), nous qui «ne crions pas dans le désert», ne «courons pas dans la nuit», «ne sommes pas encore morts», alors que «le capitalisme a pourtant programmé [notre] disparition» (p. 15), nous qui «revendiquons le surnaturel chrétien», dont «la pratique littéraire, écrit Richard Millet, est l'autre nom» (p. 16), alors que, quelques pages avant, ce littéraire était aussi peu défini, censé englober «tous les arts, y compris le politique» (p. 13), nous qui, n'est-ce pas, mon cher Richard, ne sommes pas capables d'écrire autre chose que de grandes affirmations creuses que vous, vous, Richard Millet, ne prenez jamais la peine d'analyser ni même, voyez de quoi nous nous contenterions, de développer quelque peu.
Celui, lecteur intrépide ou fanatique, mais hagard toutefois d'avoir survécu à cette traversée de l'insignifiance, celui qui a réussi à venir à bout de ce premier chapitre ridicule, immonde, loufoque, pitoyable, indigeste, involontairement comique, découvre enfin l'acteur principal de ce drame de l'insignifiance bavarde qu'est un essai de Richard Millet : Gérard Depardieu bien sûr, qui «incarne la France» (p. 17) et qui, comme les pages qui suivent auront tôt fait de nous le démontrer, n'est qu'un prétexte, tout comme Anders Breivik était, pour Richard Millet le confusionniste, un prétexte pour cracher sa haine, faire preuve de son faux talent de bonimenteur, nous jouer la saynète de l'homme ostracisé, le plus ostracisé de France, à placer à la queue leu leu, loup qui, chez lui, n'est qu'une bécasse affligée de logorrhée, des mots creux derrière lesquels Richard Millet n'est pas plus capable de nous tromper que ne nous tromperait un dresseur d'ours quant à l'amour qu'il prodigue à sa pauvre bête. Et c'est, en conséquence, un nouveau déferlement de grands mots vides et d'expressions faussement originales, donnons-en quelques-uns : «barbarie petite-bourgeoise», «inversion générale des valeurs» (p. 21), «devenir yankee du monde», «indifférenciation générale» (p. 23), «mondialisation capitaliste» (p. 24), «actualisation de la Terreur qu'est le Culturel» (p. 28), «uniforme du capitalisme mondialisé» (p. 29), «victorianisme pornographique» (p. 42), «dégénérescence de l'universalité» (p. 47), tant d'autres encore, je pourrais citer, ainsi, intégralement le texte de Richard Millet, puisque jamais nous ne sommes confrontés à une idée quelque peu originale, à tout le moins, une idée qui serait prise sans ménagement, décortiquée, analysée, poursuivie de seuil en seuil et d'image en image. Aussitôt posée sur une branche, l'intelligence de Richard Millet, fluette comme un moineau mais obsédée comme un phénix qu'on empêcherait de brûler, ne songe qu'à s'élancer dans le ciel, exécuter son petit numéro de penseur volatil(e), et c'est cette petite danse insignifiante, ce vol pusillanime et picrocholin, que certains, en France, tiennent pour une preuve de style littéraire et même, et même, de pensée !
Ainsi, du corps politique de Gérard Depardieu, thématique qui eût pu nous laisser croire que Richard Millet, à tout le moins, esquisserait quelque ébauche d'analyse sur le corps du Roi, celui, invisible, pas moins réel, du royaume de Dieu qu'il est censé incarner et représenter, en convoquant pourquoi pas les grands auteurs de la théologie politique, au premier rang desquels, sur cette question, Ernst Kantorowicz bien sûr. Qu'avons-nous, en lieu et place d'une analyse, eût-elle été modeste, sur cette thématique fascinante des deux corps du Roi, dans la rinçure prétentieuse de Richard Millet ? Nous avons ceci : «Ceci est mon corps», semble suggérer Depardieu, comme pour mieux signaler la vérité de ce que révèle ce corps dont il nous fait don, la mort de la culture française accompagnant la France d'une disparition devenue label» (p. 35) ou bien, plus loin : «Depardieu : l'ultime monstre sacré, sur qui la politique n'a pas de prise» (p. 36). N'est-ce pas tout simplement prodigieux de hardiesse et de hauteur intellectuelles ?
Bon. Est-ce bien tout ? Oui. Vraiment ? Oui, vous n'avez qu'à lire ce livre, si vous croyez que j'exagère. Vous n'avez qu'à vous confronter, façon de parler, à des jugements aussi péremptoires et creux, vagues généralités ronflantes, que ceux sur Les Valseuses, «film littéraire, la littérature cherchant la profondeur dans la surface, en subvertissant l'horizontalité par un langage contestant l'innocence perverse et sans langue des scénarios redondants et plagiaires qui se proposent aujourd'hui sous les noms d'art, de roman, de film, de musique...» (p. 43) ou encore cette autre fadaise, parlant d'un «abîme matérialiste, dont l'islamisme est une des figures pornographiques» (p. 49). C'est en somme toujours le même procédé : Richard Millet emploie un grand mot qui ne veut plus rien dire et, d'une virgule, grâce à un participe présent (cf. p. 43), établit une identité qu'il s'imagine sans doute être parlante, alors qu'elle n'est, au mieux, qu'imprécise, peu concluante, le plus souvent mensongère, toujours grandiloquente, avec un autre mot qui ne veut plus rien dire. Ce petit tour de passe-passe passe, mais oui, pour de la pensée.
Et cela continue ainsi durant des pages, que dis-je, des livres, l'accumulation cliquetante des mots creux, «l'obsession d'une humanité en transhumance sexuelle postidentitaire mais régulée par l'hygiénisme pornographique» (pp. 55-6), mots creux qui se brisent face au roc impavide du «Nous», le pluriel de majesté que Richard Millet, du haut de son trône de verbosités, s'adresse à lui-même : «Nous savons, nous autres hérétiques du Bien» (p. 51), nous qui «n'abandonnons pas, même dans notre résignation à ne plus être français» (p. 65), avec, parfois, soyons justes, une idée intéressante, que Richard Millet, tout pressé de dévider sa pelote de mots pourris, n'attrape même pas au passage (2), pas plus qu'il n'analyse cette impossibilité de la figure et de la chair du père, que Depardieu est censé, si je puis dire, incarner (cf. p. 77), car la pensée, si ce mot n'est pas trop fort, de Richard Millet ne fonctionne, mais à plein régime, comme une mécanique devenue folle, que par des associations d'idées, pas même, non, par des associations de mots et même de sons qui doivent le mettre en transe, ce par quoi Richard Millet est incontestablement poète, mais poète dégénéré, poète enfermé dans un camp de concentration verbal d'où il ne s'échappera que mort ou bien, et c'est le rêve de tous les fous, lorsque la Terre entière se sera convertie à son chamanisme incantatoire.
Et cela repart bien sûr, car, désormais, du moins depuis quelques années, Richard Millet, comme d'ailleurs Renaud Camus, ne peut plus se taire, et que les mots ont empoisonné son cerveau. Ils ne tarderont pas à empoisonner son corps et alors cette pourriture verbale s'incarnera dans le corps même de Richard Millet qui deviendra, même si nous ne le lui souhaitons pas un tel destin eschatologique, un corps politique, un corps gonflé d'une merde et d'une boue de pourriture que quelque intrépide journaliste (le si mignonnet Romaric Sangars ?) souhaitera gifler et alors, à quelles débauches de dolorisme n'assisterons-nous pas, sous la plume faisandée de Richard Millet devenu, enfin, Monarque visible, outragé, risible, Christ cloué sur la Croix de l'Opprobre d'être Français, et dernier écrivain, et phare de lumière trouant les ténèbres de la barbarie universelle ! : «Pas de sagesse, donc, mais la foi, la toute-puissance de la foi, et son accomplissement dans le doute, la nuit profonde, trouée d'éclairs, la déréliction, même, et tout ce qui mène à la joie à travers les flammes» (p. 83).
Et cela repart disais-je, Richard Millet étant toujours parfaitement incapable de nous expliquer pour quelle raison inouïe le corps politique et le corps romanesque de Depardieu seraient une seule et même réalité (cf. p. 89), ou pour quelle raison que nous devinons profonde, organique même, le fait de «péter en barytonnant, comme dit Rabelais» (p. 91), doit livrer une vérité de dernière heure du monde sur la France actuelle, mais Richard Millet, généreux cacographe ne s'arrêtant pas aux détails, préfère ouvrir le robinet, avec lui jamais grippé faisons-lui confiance, d'un lyrisme de clown non pas triste mais écumant de rage, d'un de ces princes contrefaits à la voix déformée que nous avons pu voir (ou plutôt, seulement : entendre) dans Les harmonies Werckmeister de Béla Tarr. Il nous prédit l'Apocalypse et, de fait, c'est un peu comme si sa prose désordonnée, sans queue ni tête, allait finir par en hâter la venue car, bien souvent, ce sont les prophètes de malheur qui hâtent la survenue de ces derniers, trop contents que les événements confirment les délires qui les faisaient tenir pour fous à lier.
Et le monotone filet de langue putréfiée se remet à couler; à vrai dire, il n'a jamais cessé de couler, comme la rigole de pus qui s'écoule d'un bubon éclaté, finalement la meilleure image qui pourrait caractériser la prose malade de Richard Millet : «ce kitsch qui est le destin politique de la postlittérature française», ou encore «le narcissisme politico-romanesque, semblable à des cris d'oiseaux piaillant au crépuscule – le babil postlittéraire» (p. 93), quelques passages (cf. p. 97, où le style syncopé de ce gribouilleur fonctionne), miraculeusement, sauvant le livre de Richard Millet de l'imposture complète et de l'échec patent, absolu, de toute forme d'analyse, comme nous le constatons dans l'extrat qui suit : «Ce que nous montre la filmographie de Depardieu, dans le meilleur comme le pire, c'est le mouvement par lequel la culture s'est réduite à la propagande, à la sociologie, à la moraline, à une langue qui s'est d'abord dégradée au cinéma avant de dégénérer dans le journalisme puis dans la narratique qui tient lieu de roman et de «grand récit»» (p. 100). En marge de ce passage, j'ai noté : Ah bon ?, commentaire aussi banal que lapidaire qui pourrait devenir le titre d'une improbable thèse sur l'écriture de Richard Millet essayiste, même si l'essai boursouflé (3) que nous venons d'évoquer est, peut-être, le moins mauvais (4) de tous ceux que nous avons évoqués auparavant, ce qui ne peut que nous donner une idée assez précise du niveau de ces derniers et de la production pléthorique d'un auteur malade de tout dire, et ne disant plus rien, ne suintant plus rien d'autre qu'un filet morne de banalités et de mots-valises, où l'auteur transporte, d'un éditeur à l'autre, ses haines recuites.
Je n'irai pas regarder de près ce jus de morgue, et ne sais donc pas si le corps politique de Richard Millet et non plus celui de Gérard Depardieu, «grand miroir de notre déchéance, de notre absence au monde et à nous-mêmes» (p. 107), est aussi celui de la France, mais il est évident, pour qui sait lire
02/09/2015 | Lien permanent
En territoire ennemi de Didier Goux, Dupont Lajoie de la critique (dite) littéraire

 Imaginons qu'un honnête homme, il doit bien en exister un pour les besoins de notre petite saynète désobligeante, accablé par la grisaille de sa vie quotidienne décide, comme Wakefield, de tout plaquer et, dans un formidable élan de courage ou d'inconscience, se rende dans la librairie des Belles Lettres, boulevard Raspail, en quête de sensations fortes, de ces sensations derrière lesquelles l'homme moderne qui n'est peut-être plus vraiment ni franchement un homme honnête mais qui est en tout cas, ça oui, un homme moderne, délaissant le cours tranquille de sa vie petite-bourgeoise, s'élance, impavide et droit, lorsqu'il a épuisé tous les possibles et se dise, la main en visière sur l'horizon du trottoir d'en face, tout proche de franchir le seuil de la célébrissime librairie dont l'emblème est une vieille chouette grecque : Advienne que pourra !. Suivons-le discrètement dans son périple, de loin comme Virgile ne pouvant plus accompagner Dante dès que la lumière se fait trop vive, et que les corps éthérés de l'Empyrée remplacent les corps suppliciés en Enfer.
Imaginons qu'un honnête homme, il doit bien en exister un pour les besoins de notre petite saynète désobligeante, accablé par la grisaille de sa vie quotidienne décide, comme Wakefield, de tout plaquer et, dans un formidable élan de courage ou d'inconscience, se rende dans la librairie des Belles Lettres, boulevard Raspail, en quête de sensations fortes, de ces sensations derrière lesquelles l'homme moderne qui n'est peut-être plus vraiment ni franchement un homme honnête mais qui est en tout cas, ça oui, un homme moderne, délaissant le cours tranquille de sa vie petite-bourgeoise, s'élance, impavide et droit, lorsqu'il a épuisé tous les possibles et se dise, la main en visière sur l'horizon du trottoir d'en face, tout proche de franchir le seuil de la célébrissime librairie dont l'emblème est une vieille chouette grecque : Advienne que pourra !. Suivons-le discrètement dans son périple, de loin comme Virgile ne pouvant plus accompagner Dante dès que la lumière se fait trop vive, et que les corps éthérés de l'Empyrée remplacent les corps suppliciés en Enfer.Pénétrant, quelque peu intimidé tout de même, et nous le comprenons fort bien, notre bravache, depuis que la librairie de L'Âge d'Homme a été transformée en bar à glaces, dans l'un des derniers temples parisiens du savoir livresque, classique, antique, humaniste, au sens premier de ce terme aujourd'hui galvaudé par tous les imbéciles journalistiques et picoré par toutes les oies blanches de l'antiracisme, notre honnête homme mâtiné de Rusticus Elpidius, de Marbode, de Tyro Prosper et de quelques autres auteurs pas moins connus, promène son regard sur les rayons impeccablement rangés de la collection, fameuse dans le monde entier, Guillaume Budé, puis déchiffre, avec un sourire émerveillé, les noms difficiles de nombre d'auteurs, latins et grecs, syriaco-assiriens et moldavo-érythréens, parfaitement oubliés si ce n'est de deux ou trois savants qui nous ont fourni l'édition impeccable, irremplaçable, génétique, le fruit de toute une vie d'érudition, de leurs textes aujourd'hui parfaitement indémodables, aussi inactuels qu'un jet d'alacrité nietzschéenne, infiniment plus brûlants que le pissat pour âne universitaire distillé par l'affreux Roland Barthes, ce demi-dieu pour jobarthiens incultes et prétentieux.
Quelques minutes de tranquille déambulation donc, pendant lesquels des milliers de volumes ont jeté un regard serein sur le placide amas de cellules, toutes mortelles, qui se déplace parmi leur granitique immobilité, se sont écoulées lorsque notre Wakefield temporaire est arraché à ses rêveries où Paulin de Pella dialogue avec Dracontius et Sidoine Apollinaire apprend sa langue dans les vers d'Aurelius Prudentius Clemens.
– «Bonjour. Puis-je vous renseigner, Monsieur ?»
O lux beatissima, / Reple cordis intima / Tuorum fidelium, voilà ce qu'en toute simplicité se dit notre lettré dans l'unique langue de la culture (que nous ne prendrons du coup pas la peine de traduire, tant elle est claire), ravi d'un souffle puissant vers l'Empyrée béatifique du savoir, en détournant son regard des rangées de livres qui montent jusqu'au plafond, et plus précisément de la belle couverture saumon du volume regroupant la série intitulée Contre les blennorragies de Saint Théodulphe d'Antioche, et en le posant, émerveillé, sur la vasque de voluptés intellectuelles qui se tient devant lui. Il lui semble, pas plus d'une unique seconde mais inoubliable, tant la vision de l'aleph est insoutenable, être la proie d'une hallucination visuelle et même auditive, en contemplant, que dis-je, en se perdant dans le regard d'un noir profond de la jeune femme qui lui fait face, et que nous appellerons Paloma Ladrillos. Paloma (Colombe, tout de même; Ladrillos est beaucoup moins poétique) est experte en rédaction de Reader's Digest et autre compendiums vite écrits jamais lus regroupant les plus mémorables sentences d'auteurs antiques. Derrière sa silhouette intimidante, son collègue, que nous nommerons Fulminant Rapière, dont notre érudit vient à peine de remarquer la présence, semble plongé dans la lecture du 4578e volume de Jimmy Guieu intitulé Pique-nique sur Ganymède. Notre lettré retient instantanément le titre de ce livre lu apparemment dans une concentration extrême par Fulminant et se promet de se pencher, dès qu'il en aura l'occasion, sur cet auteur qui ne peut être, a priori, que diablement intéressant, puisqu'il est lu par un libraire travaillant à la librairie la plus réputée, ou il s'en faut de très peu, de Paris, donc de la France, partant du monde entier. Quelque classique moderne ignoré, sans doute, que ce Jimmy Guieu, digne hériter de Camille Flammarion ? Diable, comment est-ce possible que sa culture littéraire possède d'aussi condamnables béances ! Il s'en veut en silence, fermant, de rage, ses poings dans les poches de son costume trois pièces ! Se promettant une nouvelle fois de combler cette impardonnable lacune, notre badaud inspiré se répond mentalement, du ton le plus amène qui soit, aussi exquis qu'un vers de saint Bernard murmuré par une jeune étudiante à son amant (ou l'inverse), Tu praeclarus / Es thesaurus / Omnium charismatum, / Sane plenus / Et amoenus / Hortus es aromatum, ce qui veut à peu près dire, en français si lamentablement extensible :
– «Bonjour. Oui, à vrai dire, vous tombez à pic. Je cherche des textes que nous pourrions appeler, voyons, comment dire, hum... C'est un gros mot, pardonnez-moi de le prononcer : voilà, je cherche des textes conservateurs, et même, ah, que nous dépassons vite les maigres ressources du langage n'est-ce pas ?, et même, hum, des textes, voyons, comment dire une fois de plus, ô divin Cratyle viens à mon secours, alors que je me sens comme Lord Chandos, démuni, abandonné, seul sur le rivage du monde, l'océan du langage se retirant de la plage, bref, des textes, voilà j'y viens ne me brusquez pas, des textes, en un mot comme en mille, réactionnaires. J'ai ainsi vu que vous aviez édité plusieurs titres de Philippe Murray, mais je ne suis pas vraiment intéressé par les obsessions annales que cet auteur consigné dans son Journal. N'auriez-vous pas en vente quelque livre de... hum, voyons, ce grand poète de l'achritude bathmologique, cet écrivain barrésien de la tuyauterie, naturelle ou pas, qu'est Renaud Camus ?
– Monsieur, lui répond notre libraire amazone, le regard noir d'une colère à peine contenue, notre maison, souligne-t-elle d'un rictus, ne pratique la tolérance qu'à l'égard des grands livres et des grands auteurs», le débit ultra rapide de sa voix marquant une pause imperceptible (sauf aux oreilles si bien éduquées de notre lettré, qui est mélomane) sur certains mots qui paraissent vouloir planter leurs crocs sur le cerveau de notre intrépide lecteur aimant les auteurs réactionnaires mais qui ne l'est bien évidemment pas lui-même, réactionnaire, faudrait pas pousser l'inélégance quand même, jusqu'à faire siennes les sales idées des autres et se recouvrir de leur puant paletot.
Une goutte de transpiration s'est mystérieusement condensée sur l'un des épais carreaux de la coquette paire de lunettes rondes de notre vaillant héros du savoir, mais, en dépit de ce discret avertissement lui annonçant qu'un lion (une lionne) rôde cherchant qui dévorer, il décide sans plus attendre de réunir toutes ses forces pour faire face au courroux de la libraire. Il ne s'en laissera pas conter, et ses petits poings se ferment significativement une nouvelle fois dans les poches de sa veste sortie du pressing écologique. Il vient d'ailleurs de s'apercevoir d'un détail étrange : l'artiste tatouage que notre Amazone arbore sur l'un de ses avant-bras et qui s'étend jusqu'à sa longue et fine main semble, comme les lettres que Nabuchodonosor put lire sur le mur de son palais, luire d'une aura de jugement dernier. Il perd d'un seul coup les maigres moyens qu'il avait réussi à mobiliser pour se lancer dans la bataille digne d'un Attila et, lamentablement il faut bien le dire, se retrouve la bouche ouverte, les sons, décidément joueurs et surtout peureux, refusant de sortir de sa gorge aussi savamment nouée qu'un nœud de marin melvillien.
L'inexorable Paloma Ladrillos paraît toutefois s'être radoucie.
– «Je puis néanmoins vous suggérer, Monsieur, plusieurs auteurs comme Trasibule de Chrasimaque ou Nonce de Bidophoron dont les titres bien connus feront votre miel et, je crois pouvoir vous le certifier, constitueront le joyau de votre bibliothèque fièrement réactionnaire. Mais Renaud Camus, non, nous n'avons pas ce genre de marchandise en rayon».
Notre Candide constate, un peu réconforté, que le courroux de la Gardienne semble s'être évanoui à la mention des noms célèbres et, enhardi et retrouvant par la grâce des dieux grecs et latins l'usage de la parole, il se risque à poursuivre :
– «Certes, certes mais... Voyons, comment vous dire, commence-t-il à bégayer alors que ses lunettes de nouveau glissent sur son nez, sans doute huilé par une sueur qui décidément n'en finit pas de perler sous l'action d'une peur intestinale bien que parfaitement compréhensible en de telles circonstances, voyons, vous comprenez (non, elle semble ne pas comprendre, il suffit de voir son regard qui flamboie de nouveau : une nébuleuse de noirceur), j'aimerais, hum... des auteurs... euh, comment dire, plus... enfin moins... bref, des auteurs plus actuels, finit-il par lâcher dans un souffle à peine audible, voire, ose-t-il préciser, des auteurs pour ainsi dire vivant, euh, à notre époque... Madame», ce dernier mot comme avalé par une voix qui vient de détaler devant l'imminence d'un danger inouï.
Ayant apparemment entendu le mot vivant qui a réagi dans son esprit comme une formule de magicien, le collègue de notre altière cicérone lève le nez de son bouquin et fixe sur notre lettré égaré en territoire ennemi un regard pas moins insoutenable que celui de notre Médée antique. Il viendra à son secours, car c'est un valeureux chevalier égaré dans une époque abjecte.
– «Bref, dit-il, vous cherchez un auteur couillu, pas vrai ? Pour un instant, notre lettré, décontenancé par un propos aussi brutal, dont il ne sait s'il est attaque ou défense, détourne son regard de celui, ténébreux, d'Armide et le fixe sur ce Gauvain des temps modernes, érudit et soudard.
– Disons que... Oui... Vous résumez assez bien, je dois le dire admirablement même, mon propos.
– Je le résume tellement bien que c'est la raison pour laquelle vous avez mentionné Renaud Camus, pas vrai ? En voilà un d'auteur couillu, suffit de voir comme tous les femmelins bien-pensants lui tombent dessus depuis qu'il s'est mis en tête de lutter, seul sur les hautes tours de son munificent château, contre les hordes musulmanes menaçant de remplacer toutes les croix du Gers par des croissants trempés dans le sang des nouveaux martyrs chrétiens !
– À proprement parler, cher Monsieur, les, euh... les attributs, les balls, comme on le dit dans la langue de Shakespeare, de Renaud Camus ne m'intéressent pas, et puis vous n'êtes pas sans savoir que ce grand auteur, ce magnifique écrivain, ce souchien intransigeant, ce chantre de la France éternelle, ce mirmidon implacable, en effet, des hordes sarrasines, chinoises, juives, noires, jaunes et rouges, ce Messie aux fesses poilues de l'innocence la plus pure, ce Roland furieux contre le Grand Remplacement, cet Amadis, forcément de Gaule, ce chantre inaltérable de la beauté des campagnes françaises et de la laideur des banlieues hélas également françaises, bref, que l'immarcescible et totalement désintéressé de sa propre remarquable personne, j'ai nommé Renaud Camus, a évoqué ses mâles attributs durant plusieurs pages endiablées, réellement shakespeariennes, de l'un des volumes récents de son merveilleux et intussusceptible Journal, de sorte que n'importe lequel de ses lecteurs peut connaître les aventures mirifiques et réellement haletantes de ces modernes Rhadamisthe et Zénobie de la culture achrienne que sont, Monsieur, j'ose le dire, les couilles du dernier honnête homme dont la France peut s'enorgueillir de posséder les visions politiques les plus confondantes de pénétration».
Songeant aux évidence qu'il vient de proclamer, notre lettré se demande si ses interlocuteurs vont bien comprendre que les vues politiques remarquables en question appartiennent bien à Renaud Camus plutôt qu'à ses couilles mais, las, il aurait l'air bête à devoir préciser semblable évidence.
– «Ouais, je vois, le rassure d'ailleurs immédiatement le passionné de Jimmy Guieu. J'ai ce qu'il vous faut, un auteur qui en a en somme, hein, des lourdes, des bien massives, des intrusives, des franches, des assommantes, pas de petites timides et refoulées, des coquettes, des rentrées, des innocentes en somme; non, non, c'est tout l'inverse, des bien sorties, des poilues, des qui sentent le mâle, des Paul et Virginie de la réaction, des cailleresques inséparables qui font le coup de poing et de boule, forcément, oui Monsieur, des cojones, en quelque sorte, de pata negra, de magnifiques sphères armillaires séchées à l'air de Malaga, deux féroces molosses nourris pas seulement au lait ça c'est sûr, mais au grain, et au grain fermenté, proche de passer du solide au gazeux en un clin d’œil, sublimation que ça s'appelle comme par hasard, deux couguars éburnéens (attention, faux-ami) biberonnés au sangre de toro il n'y a pas de doute, et il les cache pas, hein, lui, ses balls, comme tous les petits planqués, frontistes et même nazillons malgré eux, à cause des perturbateurs endocriniens qu'ils bouffent à leur insu, des Charles Martel virtuels qui écrivent sous pseudonyme, nom de plume mon cul !, et qui crachent leur haine de l'étranger, Noir ou Arabe, derrière leur écran, et rasent les murs quand ils prennent le métro de peur d'en croiser un à qui leur tronche de goret policé ne plairait pas, non non, pas de ces petites damoiselles refoulées à gueule de bonze ascétique ou de vieille tenancière de maison close, notre homme, lui, il en est très fier, de ses bijoux miroitant de mille feux de rade et de cambuse torve, il les pose sur la table, lui au moins, et même sur tous les zinc de comptoirs où, dès 7 heures 30 du matin et jusqu'à environ 2 heures du matin suivant, et alors il raconte en gueulant ses exploits frontistes qu'aucun Le Tasse hélas, n'a pu coucher par écrit et pour cause, puisque plus personne ou presque ne sait écrire, sauf les cons qui prétendent écrire alors qu'ils ne le savent pas et qu'il faudrait, pour évoquer les exploits de Didier Goux, un nouveau Rabelais pour la verve gaillarde, un Lautréamont enfoncé dans toutes les venelles, un Céline même, voire, justement, un autre Didier Goux se faisant le héraut de l'autre ! Tenez, un livre de Didier Goux, ça ne peut s'encadrer entre du Cardinal de Retz et du René Boylesve, foi de camusien transi et hélas, comme son maître, fort piètre photographe !
– Vous me mettez l'eau à la bouche si je puis dire. Quel est donc ce Pétrarque redivivus de la trois fois sainte réaction ?
– Quoi, vous vivez dans un château sans électricité ni eau ma parole ? C'est lui voyons, lui, indique notre excellent libraire, pointant son doigt sur la couverture rouge brique du dernier volume disponible d'un livre qui s'est vendu comme un poster de Yannick Haenel lors d'un colloque sur le néant, comme il ne manque pas de l'indiquer à notre fin lettré, car oui, en effet, cela se vend même comme des petits pains multipliables christiquement, presque aussi bien que le lourd volume de Philippe Muray, devenu la coqueluche de tous les couillons qui tétaient le sein de leur maman quand celui-ci publiait son 19e siècle à travers les âges et écrivait, comme celui-ci d'ailleurs (nouveau doigt tendu vers le dernier exemplaire en question, que notre lettré est désormais tout prêt de considérer comme relevant de l'ordre du miracle), et écrivait donc des textes peu reluisants où des pépés forcément fatales se faisaient dévaliser le frigidaire par des héros forcément patibulaires. Que voulez-vous, Les Belles Lettres sont de leur temps comme on dit, et, après le beau succès commercial de la collection de poésie dirigée par notre Dante franco-français, j'ai nommé Francis Lalanne, il faut bien vivre, pas vrai, en vendant quelques condensés du petit livre brun du Front National, c'est porteur, surtout en ce moment, c'est sexy, c'est même trendy paraît-il, comme le dit notre directeur des ventes, puis les livres de Finkielkraut et de Camus, voire ceux de Soral, sont si faciles à écrire ! Enfilade de platitudes, et le fait qu'elles soient affublées de l'étiquette journalistique réactionnaire ne les rend pas moins plates mais encore plus alléchantes pour le client ! Finkielkraut, Camus et, petit séide de ce dernier, le plus doué c'est dire de ces amoureux du miroir, Didier Goux, lequel pousse la vénération pour Narcisse jusqu'à lui copier sa manie pleurnicheuse de raconter la moindre de ses secondes insignifiantes de vie sous la forme d'un Journal, autant de polygraphes qui ressemblent à des agités dans le bocal desquels on aurait jeté les mots Noir, Arabe, Musulman, Immigration, Grand Remplacement, comme s'il s'agissait d'une poignée de pétards allumés, bref, de tels textes écrits par de tels auteurs, c'est tout de même plus aguichant que les douze volumes de Nonos de Panopolis n'est-ce pas, même si ma collègue, ici présente, et dont je ne vanterai jamais assez la discrète efficacité qui me permet de dévorer les meilleurs auteurs de science-fiction, est capable de rédiger en trois jours un volume tiré au cordeau qui expliquera à tous les benêts en mal de rattrapage journalistique l'intérêt apocastatique de ne pas ignorer pareil auteur essentiel, plaisamment condensée par ses soins savants en un Reader's Digest à prétentions intellectuelles.
Tenez, poursuit notre exalté, je vais vous raconter une petite anecdote très amusante, je trouve, moi, poursuit l'implacable lecteur de Jimmy Guieu. Il y a quelques mois, un de ces universitaires voûtés et accablés par on ne sait quelle nostalgie secrète est venu rencontrer l'une des huiles des Belles Lettres, pour lui proposer un projet sur Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, un g
18/09/2017 | Lien permanent
Jésus – une étude d'histoire christologique, par Francis Moury
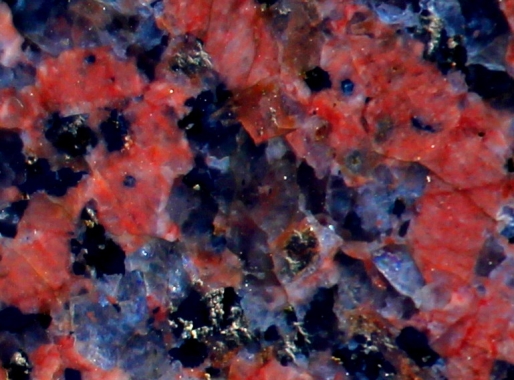
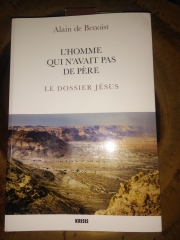 Notes de lecture sur : Alain de Benoist, L'Homme qui n'avait pas de père. Le dossier Jésus (éditions Krisis, 2021, 970 pages). Acheter ce livre sur Amazon.
Notes de lecture sur : Alain de Benoist, L'Homme qui n'avait pas de père. Le dossier Jésus (éditions Krisis, 2021, 970 pages). Acheter ce livre sur Amazon.«On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace; c'était l'hiver [et] Jésus se promenait dans le Temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent donc et lui dirent : "Jusques à quand tiendrez-vous notre esprit en suspens ? Si vous êtes le Christ, dites-le nous franchement." Jésus leur répondit : "Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas : [cependant] les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage. Mais vous ne croyez point, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et jamais elles ne périront et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et nul ne peut les ravir de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un"».
Évangile selon saint Jean X, 23-25 (traduction Augustin Crampon 1923, légèrement revue).
«Comme il enseignait dans le temple, "les princes des prêtres et les docteurs de la loi et les sénateurs du peuple s'assemblèrent et lui firent cette demande : en quelle puissance faites-vous ces choses ?" (Évangile selon saint Luc, XX, 1-2) [...] Et néanmoins Jésus ne leur donne sur ce sujet aucune instruction. "Je ne vous dirai pas non plus en quelle puissance j'agis." (ibid., XX, 8) Mais il se contente de les confondre devant le peuple, de mauvaise foi et d'hypocrisie, comme l'on va voir. [...] Ils avaient donc deux témoignages : celui de sa parole et, ce qui était encore plus fort, celui de ses miracles. S'ils consultaient après cela, un mauvais esprit les poussait. La vérité éternelle, qu'ils consultent mal, n'a rien à leur répondre et n'a plus qu'à les confondre devant tout le peuple. Ainsi nous arrivera-t-il, quand nous la consulterons contre notre propre conscience sur des choses déjà résolues : nous ne cherchons qu'à tromper le monde ou à nous tromper nous-mêmes.»
Jacques-Bénigne Bossuet, Méditations sur l'Évangile (écrites vers 1687, publiées posthume en 1731, éditions Desclée et Cie., Paris 1903, pages 213-215).
«Seuls les uniques, ceux qui par rapport à leur "temps" sont dans l'abri du retrait, sont capables un jour d'appeler le Dieu et de persévérer dans l'attente de ce qui vient le plus éminemment. Et c'est alors chaque fois le lointain et l'inaccessibilité qui dictent la manière dont naît pour le grand nombre une sorte de possession et de familiarité tangible, et le ton où le caractère de ces uniques s'accorde pour sauver une histoire-destinée déployant pleinement son essence.»
Martin Heidegger, Réflexions XII-XV/-Cahier noirs 1939-1941 (traduction Guillaume Badoual, éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque de philosophie, 2021, p. 161).
Cette considérable mise au point des études historiques consacrées à la vie du Christ, depuis les récits des évangiles antiques aux recherches archéologiques et philologiques les plus récentes, est le fruit de dizaines d'années de travail. Elle s'ouvre par deux citations antiques (une d'Aristote et une de Tertullien) qui s'équilibrent bien; elle est dédiée à Louis Rougier, Jean-Marie Paupert et Simon Claude Mimouni.
Disons un mot de ces trois dédicataires.
Louis Rougier (1889-1982) avait débuté par la philosophie des sciences avant de devenir un historien des religions mais aussi un penseur de l'histoire et de la politique : son œuvre est assez variée. Son étude sur Celse ou le conflit de la civilisation antique et du christianisme primitif (éditions du Siècle, 1925) avait eu les honneurs d'une recension (bienveillante) par Joseph Bidez et d'une autre (plus sévère car signalant des emprunts effectués parfois sans guillemets au travail antérieur de Causse) par Eugène de Faye. Plus tard et parmi bien d'autres études publiées, Louis Rougier fut aussi l'auteur de La Religion astrale des Pythagoriciens (éditions PUF, collection Mythes et religions, dirigée par Paul-Louis Couchoud, 1959). Or, il faut savoir que Paul-Louis Couchoud fut l'un des représentants français de la «thèse mythiste» qui faisait de Jésus un mythe humanisé, «avatar d'un Dieu sauveur adoré bien des siècles avant Tibère» (page 85).
Jean-Marie Paupert (1927-2010) avait été dominicain au Saulchoir et fut un proche du père Marie-Dominique Chenu (1895-1990), l'historien bien connu de la théologie médiévale. Paupert renonce à la vie religieuse puis étudie à la Sorbonne avant de partager son temps entre la direction d'une collection religieuse chez l'éditeur Arthème Fayard et la publicité de la firme pétrolière Total. Il oscilla entre catholicisme réformateur et traditionaliste.
Simon Claude Mimouni (né en 1949), ancien élève de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, fut notamment professeur à l'École Pratique des Hautes Études, section des sciences religieuses où il enseigna de 1995 à 2017 les origines du christianisme et l'histoire des premières communautés chrétiennes, en particulier dans leur rapport au judaïsme depuis le second siècle avant notre ère jusqu'au second siècle après notre ère.
Alain de Benoist a, pour sa part, déjà publié plusieurs livres ayant trait aux questions religieuses : Avec ou sans Dieu (1970), Comment peut-on être païen ? (1981), Fêter Noël. Légendes et traditions (1982), Les traditions d'Europe (1982), L'Éclipse du sacré (1986), Jésus sous l'œil critique des historiens (2001), Jésus et ses frères (2006), La Puissance et la foi (2021). Son nouveau Dossier Jésus, divisé en six parties, comptant au total environ un millier de pages, est une somme d'une belle richesse historique autant que religieuse, mais aussi philosophique concernant certains chapitres. Les philosophes le liront donc aussi avec intérêt, eux qui n'ont — ainsi que le rappelait très bien Emilio Brito en 1980 — «jamais cessé d'interpréter le Christ» (1). Entendons : l'interpréter à partir de sa réalité religieuse comme de sa réalité historique. Toute la question étant, évidemment, de savoir ce que recouvre ce «comme» et de quelle nature peut bien être cette médiation entre histoire et religion.
Concernant le premier terme (l'histoire), il faut naturellement commencer par le commencement : la réalité historique de Jésus en son temps (éditions Arthème Fayard, 1945, revue et corrigée, 1947) — selon le beau titre donné par Daniel-Rops (Henri Petiot, 1901-1965) au second volume de son Histoire sainte — et la méthode applicable à cette réalité. C'est l'objet de la première partie (La Recherche, pages 11 à 122) du livre d'Alain de Benoist.
Alain de Benoist n'en doute pas et l'écrit : Jésus a certainement existé. La question, après deux mille ans et l'établissement consacré d'une religion mondiale, pourrait sembler oiseuse sinon spéculative mais ce serait une erreur de perspective car elle fut constamment brûlante depuis le dix-huitième siècle. Alain de Benoist résume très soigneusement son évolution : une «première quête» (qu'on peut commodément dater 1474 à 1901 ou 1774 à 1901 selon qu'on opte comme terminus a quo pour les recherches historiques de H. S. Reimarus publiées en Allemagne par Lessing à partir de 1774 ou bien pour la Vita Christi du chartreux Ludolphe de Saxe en 1474), une seconde période «sans quête» (qu'on peut dater 1906 à 1953 et qui est caractérisée par un certain découragement relativement à la possibilité d'une restitution historique de Jésus), une troisième période nommée «nouvelle quête» (qu'on peut dater 1953 à la fin des années 1970). Tout n'y est certes pas mentionné (car il y faudrait non seulement des volumes mais encore des bibliothèques entières) : je ne crois pas qu'y figure, par exemple, la savoureuse démonstration du logicien anglais Richard Whately, Historic Doubts about Napoleon Buonaparte (2), dans lequel Whately montrait, en 1819, que les mêmes arguments attaquant la vérité du christianisme pouvaient nous faire douter de l'existence de Napoléon, alors même que ce dernier était encore vivant. Ses étapes principales — les Vies du Christ (par exemple celle de G.W.F. Hegel, de David Strauss, d'Ernest Renan), leur influence et les critiques qu'elles occasionnèrent, initiant notamment en guise de contre-offensive la naissance de l'historiographie catholique moderne sous les auspices de Fulcran Vigouroux (3), puis Marie-Joseph Lagrange (4) le fondateur en 1890 de l'École biblique de Jérusalem — sont mentionnées, parfois étudiées plus en détails. J'y ajouterais volontiers, concernant la première moitié du vingtième siècle les noms de Jean Michel Alfred Vacant, Eugène Mangenot, Émile Amann, Réginald Garrigou-Lagrange (5) en raison de leur contribution au collectif Dictionnaire de théologie catholique qui demeure un monument des études historiques et théologiques françaises. À ses côtés, il faut bien avouer que l'unique volume, pourtant si remarquable – en dépit du fait qu'il accordait trop peu de place à la philosophie médiévale : pour le reste, il demeure admirable — d'André Lalande (1867-1964) et des membres et correspondants de la Société Française de philosophie, j'ai nommé le vénérable Vocabulaire technique et critique de la philosophie (1902-1923 puis éditions revues et légèrement augmentées jusqu'en 1993 au moins) fait très pâle figure quantitative alors que sa matière est pourtant plus étendue chronologiquement puisque l'histoire de la philosophie occidentale depuis les Grecs à nos jours couvre 2500 ans environ.
L'histoire de la position du Vatican et les successives encycliques sur l'étude historique des évangiles sont utilement mentionnées et analysées. C'est l'encyclique Divino afflante spiritu (1943) du pape Pie XII «qui a permis aux exégètes catholiques de s'affranchir en partie des condamnations antimodernistes des papes du siècle précédent. Elle sera suivie, pendant le concile de Vatican II, d'une Instruction sur l'historicité des Évangiles publiée (le] 23 avril 1964 par la Commission biblique pontificale qui déclarait accepter la méthode de l'exégèse historico-critique et a abouti, notamment, à l'abandon de la notion (pourtant augustinienne et fondamentale] d'inerrance : littéralement parlant, tout ne serait donc pas nécessairement vrai dans la Bible. Mais cette libéralisation ne s'appliqua encore que très partiellement à l'étude des évangiles. L'abbé Jean Steinmann l'a appris à ses dépens lorsqu'il fut interdit de publication à cause de quelques lignes de sa Vie de Jésus, parue en 1962» (p. 53).
Citons, à ce sujet, le passage de la «constitution dogmatique» du pape Paul VI, intitulée Dei verbum (1965) qui ne fait d'ailleurs, je pense, que reprendre en partie ce qu'écrivaient déjà les Pères grecs et romains de l'Église : «Il n'est pas contraire à la vérité d'un récit que les évangélistes rapportent les actes et les paroles de Jésus de façons diverses et qu'ils expriment ses déclarations de manières variées. C'est d'une façon différente, en effet, que la vérité est proposée dans des textes diversement historiques ou prophétiques ou poétiques ou relevant d'autres genres d'expression» (p. 54).
Un chapitre est consacré aux critères retenus par les historiens pour valider l'authenticité de telle ou telle section des évangiles. Le «critère d'embarras» ou le «critère de discordance» s'applique, par exemple, à un fait ou une parole se révélant comme une source d'embarras historique ou théologique, notamment pour les premières communautés chrétiennes. Ces paroles ou ces faits auraient donc des chances d'être historiquement réels en raison même des contradictions soulevées dont une pure propagande aurait au contraire soigneusement fait l'économie : par exemple le baptême du Christ par saint Jean Baptiste rapporté par saint Marc et par saint Luc relève d'un tel critère car ce baptême était effectué par Jean en vue du pardon des péchés. Or Jésus, étant considéré par les Évangiles comme le Fils de Dieu, n'a évidemment pas besoin de se faire pardonner ses péchés; ce qui explique que saint Matthieu fasse dire à saint Jean Baptiste : «C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi !» (cité p. 29). Le «critère de cohérence» est inverse car les historiens qui l'adoptent tiennent le raisonnement suivant : «[...] une parole ou un acte de Jésus a plus de chance d'être authentique s'il est cohérent avec l'ensemble du récit ou avec d'autres actes et paroles dont on a établi l'authenticité» (page 30). Plusieurs dizaines d'autres critères sont présentés, illustrés et, in fine, critiqués car leur luxuriance logique ne laisse pas de porter, finalement, presque à faux : ils se concurrencent et, à l'occasion, s'annulent réciproquement. C'est le cas des deux critères cités supra : le critère d'embarras est l'inverse du critère de cohérence. Qui choisit l'un, devrait logiquement renoncer à l'autre.
Lire cette étonnante liste de critères élaborés, pour l'essentiel, durant le dix-neuvième et le vingtième siècles, revient un peu, sur le plan philosophique, non pas tant à revivre intellectuellement les circonstances conceptuelles de la naissance du cercle de Vienne que celles, un peu plus anciennes, dans lesquelles Victor Brochard (1848-1907) avait soutenu – sous l'influence de la philosophie néocriticiste de Charles Renouvier (1815-1903) et sous celle de la philosophie trans-rationaliste probabiliste d'Antoine-Augustin Cournot (1801-1877) – sa thèse de doctorat De l'erreur (1879). On se souvient de la question que Brochard posait : «On peut se demander ce que l'erreur est en elle-même, comment elle est possible en des intelligences dont la fonction essentielle semble être de connaître la vérité, comment elle apparaît sous tant de formes diverses, tantôt partielle et comme dissimulée entre plusieurs vérités, tantôt générale et faussant, par la place qu'elle occupe, les vérités mêmes qui l'entourent; presque toujours si étroitement unie à la vérité qu'elle peut à peine en être détachée par la plus minutieuse attention, et mêlée de vérité plus souvent encore qu'elle n'est mêlée à la vérité.»
La position du problème contenait (selon la future formule de Henri Bergson dans la première partie de La Pensée et le mouvant, (éditions PUF, collection BPC, 1934-1938, dernière réédition revue du vivant de Bergson) une présupposition de sa solution : la vérité n'était qu'une hypothèse confirmée, l'erreur qu'une hypothèse réfutée. Mais surtout – et c'était au fond le plus important ! – Brochard concluait (6) : «Non seulement le scepticisme est désarmé mais, on l'a vu plus haut, il reste, au-delà de la vérité démontrée, un vaste champ pour la croyance; à côté de la certitude scientifique, il y a place pour une certitude d'une autre nature; la métaphysique et la religion sont légitimes comme la science, quoique à des titres différents. Les constructions métaphysiques ou religieuses, en tant qu'elles sont pensées par chacun de nous, procèdent de la même activité spontanée et créatrice de l'esprit, qui découvre aussi en les reconstruisant les vérités de la science. Si l'esprit peut découvrir la vérité dans un cas, pourquoi ne le pourrait-il pas dans l'autre ? De quel droit limiterait-on sa puissance ?»
Faudrait-il alors, pour échapper au point de vue étroitement critériologique, privilégier un Jésus purement mythique aux dépends du Jésus historique ? Ce serait trahir l'essence même du christianisme, celle de l'incarnation divine non pas en un in illo tempore mythique – temps qui est, par exemple, encore en partie le temps indoeuropéen du Zoroastre historique, fondateur du mazdéisme (7) – mais en une période et un lieu précis de l'histoire humaine. Alain de Benoist a raison de citer Henri-Irénée Marrou («À la différence d'autres religions qui offrent à leurs fidèles un credo de propositions intemporelles, le christianisme se présente comme une religion essentiellement historique [...] La foi chrétienne exige que les événements de la vie de Jésus aient été bien réels, soient des événements historiques situés dans l'espace et le temps.») (8) et non moins raison de citer Henri-Charles Puech («[...] le christianisme est une religion historique au double sens du terme [...] il naît à un moment précis de l'histoire, et sa fondation comme sa foi reposent sur une personne – celle de Jésus – dont, en dépit des efforts des mythologues [...] l'historicité ne fait point de doute, mais encore et surtout [...] il donne au temps une valeur concrète et attache à son développement [...] une valeur sotériologique») (9) à ce sujet : on ne saurait mieux poser le problème ni le résumer plus clairement. Peut-être, d'ailleurs, le lecteur — surtout le lecteur catholique, bien sûr, mais l'hypothèse concerne aussi les autres – reviendra-t-il sagement, après un détour par cette savoureuse section critériologique (relevant tout à la fois de la logique, de l'épistémologie et de la philosophie des sciences puisqu'elle pose la question de savoir comment valider logiquement l'authenticité d'un fait rapporté ou bien celle d'une proposition concernant un fait) à la méthodologie hellénistique de saint Augustin qui, déjà bien conscient des différences et des divergences entre les évangiles, avait cru possible seize siècles plus tôt d'en venir à bout par son ample et souvent lumineux De Consensu evangelistarum (10) ?
Cette première partie se poursuit par une étude critique de trois thèses jadis célèbres, aujourd'hui abandonnées : d'abord la thèse de Jésus Essénien (à la formule de Renan, écrite en 1894 et citée page 61 : «Le christianisme est un essénisme qui a largement réussi», s'opposent les sages remarques d'Adolf von Harnack, écrites en 1900 et citées page 66 : «Les Esséniens accordaient la plus extrême importance à la pureté légale et se tenaient strictement à l'écart, non seulement des impurs mais de ceux qui étaient moins stricts [...] Chez Jésus, nous trouvons l'exact contraire de cette manière de vivre : il va à la rencontre des pécheurs et mange avec eux. Cette différence fondamentale suffit à garantir qu'il était très éloigné des Esséniens»), ensuite la thèse de Jésus Zélote (certains passages des évangiles rapprochent Jésus de cette secte religieuse et nationaliste mais d'autres l'en écartent fondamentalement), enfin la thèse de Jésus Aryen (notamment introduite par le philosophe allemand Ernst Haeckel (ou Häckel, 1834-1919) et par Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), avant d'être reprise et popularisée par l'exégèse
16/11/2021 | Lien permanent
La vie des autres de Florian Henckel von Donnersmarck, par Germain Souchet

26/02/2007 | Lien permanent
Infréquentables

J'ajouterai, dans les jours à venir, quelques nouveaux portraits d'infréquentables qui, eux, auraient dû paraître dans l'ouvrage que je projetais de publier, prolongement naturel du numéro de la revue, et qui ne verra très certainement jamais le jour, faute d'éditeurs, en France, dignes de ce nom.
Trois personnes ont refusé ma proposition : Arnaud Bordes, auteur d'un portrait d'Antoine Adam qui paraîtra dans la revue Rébellion, Michel Marmin, auteur d'un texte sur Sade (qu'il ne m'a du reste jamais envoyé...), parce que j'ai écrit tout le mal que je pensais de cette navrante bagatelle qui se prétend roman et dont l'auteur est un certain Émile Brami se disant éditeur, enfin Alain Paucard, auteur d'un ridicule et complaisant autoportrait, directeur littéraire pour L'Éditeur et auteur, selon ses propres dires, d'un navet publié par cette même maison décidément peu surprenante.
Rappel des portraits d'Infréquentables et autres textes relatifs à ce dossier déjà publiés sur ce blog.
 Ernst Jünger, par Dominique Autié (Infréquentables, 1).
Ernst Jünger, par Dominique Autié (Infréquentables, 1). Pierre Boutang, par Francis Moury (Infréquentables, 2).
Pierre Boutang, par Francis Moury (Infréquentables, 2). Bruno Dumont, par Ludovic Maubreuil (Infréquentables, 3).
Bruno Dumont, par Ludovic Maubreuil (Infréquentables, 3). Joseph de Maistre, par Olivier Bruley (Infréquentables, 4).
Joseph de Maistre, par Olivier Bruley (Infréquentables, 4). Spengler l'infréquenté, par Jean-Luc Evard (Infréquentables, 5).
Spengler l'infréquenté, par Jean-Luc Evard (Infréquentables, 5). Un grand catholique : Carl Schmitt, par Rémi Soulié (Infréquentables, 6).
Un grand catholique : Carl Schmitt, par Rémi Soulié (Infréquentables, 6). Georges Darien, un barbare intolérant, par Nicolas Massoulier (Infréquentables, 7).
Georges Darien, un barbare intolérant, par Nicolas Massoulier (Infréquentables, 7). Pierre Gripari, portrait de l'écrivain en joyeux pessimiste, par Anne Martin-Conrad (Infréquentables, 8).
Pierre Gripari, portrait de l'écrivain en joyeux pessimiste, par Anne Martin-Conrad (Infréquentables, 8). La mise à mort de don Juan, par Paul-Marie Coûteaux (Infréquentables, 9).
La mise à mort de don Juan, par Paul-Marie Coûteaux (Infréquentables, 9). Konstantin Leontiev, l'inaudible, par Thierry Jolif (Infréquentables 10).
Konstantin Leontiev, l'inaudible, par Thierry Jolif (Infréquentables 10). Ivan Illich, critique de la modernité industrielle, par Frédéric Dufoing (Infréquentables, 11).
Ivan Illich, critique de la modernité industrielle, par Frédéric Dufoing (Infréquentables, 11). La maison de Roux ou Dominique de Roux, l’indispensable contemporain, par Jean-Luc Moreau (Infréquentables, 12).
La maison de Roux ou Dominique de Roux, l’indispensable contemporain, par Jean-Luc Moreau (Infréquentables, 12). Le 2 novembre de Maurice Barrès. Sur le tombeau d’un homme libre, par Raphaël Dargent (Infréquentables, 13).
Le 2 novembre de Maurice Barrès. Sur le tombeau d’un homme libre, par Raphaël Dargent (Infréquentables, 13). Chardonne, le don, le manque, par Didier Dantal (Infréquentables, 14).
Chardonne, le don, le manque, par Didier Dantal (Infréquentables, 14). Un Léon superbe et généreux, par Ian Wambrechtein (Infréquentables, 15).
Un Léon superbe et généreux, par Ian Wambrechtein (Infréquentables, 15). Philippe Muray, la légende du siècle, par Jean-Gérard Lapacherie (Infréquentables, 16).
Philippe Muray, la légende du siècle, par Jean-Gérard Lapacherie (Infréquentables, 16). Pier Paolo Pasolini, par Serge Rivron (Infréquentables, 17).
Pier Paolo Pasolini, par Serge Rivron (Infréquentables, 17). La musa impossibile di Mario Praz. Testo, contesto, ipertesto, par Raffaele Alberto Ventura (Infréquentables, 18).
La musa impossibile di Mario Praz. Testo, contesto, ipertesto, par Raffaele Alberto Ventura (Infréquentables, 18).Varia
 Intermède comique offert par Renaud Camus.
Intermède comique offert par Renaud Camus.Sur les infréquentables, par Jean-Louis Kuffer.
Les Infréquentables deviennent un livre (pensai-je, naïvement, à l'époque).
24/11/2010 | Lien permanent
Sur Paul Gadenne et quelques hongres comme Philippe Sollers

03/03/2004 | Lien permanent
Marc-Édouard Nabe n'enfonce pas vraiment le clou

 J’avoue que je ne connaissais pas Wladimir Weidlé jusqu’à ce que la revue d’Alain Santacreu, Contrelittérature (mon Dieu, je note que Luc-Olivier d'Algange, une fois de plus, s'y est répandu sur des kilomètres de Toile...!) ne l’évoque par l’entremise du préfacier de son ouvrage (intitulé, superbement, Les abeilles d’Aristée), Bernard Marchadier. Ce livre imposant, composé de quatre parties aux titres éloquents (Le crépuscule des mondes imaginaires ou encore Minuit de l’art), publié une première fois en 1936 chez Gallimard puis remanié dans les années cinquante, est en fait une étude magistrale sur le déclin de l’art occidental, étude fouillée, passionnante et lyrique qui ne peut se résumer en quelques lignes, d’où la place que j’accorde à de larges extraits de ce livre. En fait, Weidlé paraît tétanisé à l’idée que l’art qu’il évoque, aussi bien littéraire que pictural ou architectural, ne parvient plus à s’incarner : «Il n’y a d’art que s’il y a incarnation, et quoi donc serait incarné si ce n’est l’image de l’homme et celle du monde, tel qu’il se révèle à l’homme ?». Faire de l’art une tentative d’incarnation, c’est affirmer d’emblée que l’art sans l’homme est un art déshumanisé ou, si l’on veut, qu’il peut aboutir, ce qui est aujourd’hui le cas, à un art totalement dépouillé de la notion de figure, déconstruite avec acharnement et, je crois pouvoir le dire, avec haine par les équarrisseurs de tous bords.D’où vient cet oubli, cette haine donc, une fois de plus, de l’incarnation ? La réponse que Weidlé donne est ambiguë et ne manquera pas de toutes les façons de faire bondir les sots, qu’ils soient universitaires ou amateurs d’art contemporain. C’est d’abord l’oubli de Dieu, c’est l’indifférence par rapport à la religion qui entraîne la pétrification de l’art, sa lente dessiccation qui fait de lui, dit l’auteur avant d’autres, un cadavre. Weidlé écrit ainsi : «On purifie l’art et la poésie comme on fait pour l’alcool, en opérant par analyse et abstraction, en substituant aux «nourritures terrestres» un assortiment de pilules nutritives. Le laboratoire travaille à plein rendement. Le temple désaffecté est en ruine. À sa place il n’y aura rien et l’herbe poussera sur les pierres, si l’artiste, trop longtemps séparé de la vraie foi, n’y construit pas avec l’aide de celle-ci une cathédrale indestructible, si l’art condamné à errer dans des pays sans chemin ne se souvient pas de sa patrie abandonnée, n’y cherche et n’y trouve pas, une fois de plus, sa justification suprême». Mais c’est aussi la perte d’une espèce d’innocence originelle, corollaire inévitable d’une sanctification de la foi dans les actes les plus anodins de la vie de nos pères, innocence que les modernes selon l'auteur tentent par tous les moyens de reconquérir à l’exemple d’un Mallarmé ou d’un Joyce, qui explique que nous soyons tombés dans le règne d’une technique strictement reproductrice, pas même un artisanat: «La seule présence parmi nous, au cours des années formatrices du siècle, de ce génie [Mallarmé] aussi vaste, bien que moins élevé et moins profond que les génies d’autrefois, construisant avec une application infinie son énorme et vain gratte-ciel babylonien, est révélatrice, plus qu’aucune autre, de nos erreurs et du destin que nous avons fait à toute spontanéité créatrice. […] Cette Somme démesurée des plus alléchantes contorsions verbales, cet Art poétique en dix mille leçons n’est pas une incarnation vivante de l’art; il est l’autopsie de son cadavre». Le mot est lâché. Il résonne dans nos oreilles comme la brutale interruption, par une tête déjà vidée de son sang, de la fulgurante descente d’un couperet.L’artiste moderne nous dit Weidlé, est désormais incapable de regarder son œuvre comme autre chose qu’un simple instrument, parfaitement interchangeable avec n’importe quelle autre technique, pour la réalisation… de quoi ? Du grand Œuvre que l’artiste déposera aux pieds de son Créateur ? Non, puisque l’artiste est abandonné. Ainsi du poète, dans une image très belle : «Dieu s’est caché : le monde n’est plus. Dans les ténèbres, le poète seul, créateur sans majuscule, est responsable pour chaque parole, pour chaque battement de cœur». Il s’agira donc, dans le meilleur des cas, de refuser de s’abandonner au règne de la quantité dénoncé par d’autres, de tenter de dissiper l’illusion d’un art qui n’est plus de l’art mais bel et bien une imposture («Aucune époque antérieure au siècle dernier n’a même conçu l’idée d’une floraison aussi énorme d’impostures, de mensonges, d’absurdités et de faux-semblants». L’art sans conséquences analysé brillamment par Domecq n’est pas loin…), confinée dans la reproduction, ou plutôt le clonage débridé d’un phocomèle monstrueux sur lequel on greffera quelques trouvailles, antennes, bidets, membres humains épars ou boites de conserve rouillées, que l’on présentera ensuite à la parade des horreurs, devant un public faussement ébahi. Freaks triomphe et nous continuons d’applaudir.Alors messieurs les bien-pensants, Weidlé, réactionnaire ou pas ? Comme l’a été à vos yeux le Caillois de Babel ? Comme l’a été encore le Steiner de Réelles présences, qui semble être l’un des dignes héritiers de Weidlé ? Comme l’ont été, plus récemment et avec bien moins de panache, un Waldberg et un Jourde ? À votre décharge, cette phrase peut prêter son flanc à vos crocs de bébé : «Si le progrès est la mort de la poésie, quel est donc le poète qui ne se rendrait pas coupable de réaction ?». De la petite moustache sale de Lindenberg perlent déjà quelques gouttes de salive… Réactionnaire, non. Weidlé est juste en tous les cas, infiniment pertinent et certainement pas fasciné par un retour, plus ou moins fantasmé par certains, vers une Origine mythique estampillée vierge de toute contamination. Lisons ainsi l’auteur affirmer que : «Ce dont on a le plus soif, au fond, ce n’est pas l’art du passé, ce sont les conditions dans lesquelles cet art a pu fleurir; ce n’est pas telle image, c’est le libre exercice de l’Imagination qui les engendre toutes». Phrase définitive, comme celle-ci d’ailleurs, que je crois de simple bon sens, qui affirme que l’artiste, comme Paul Gadenne le déclarait, est incapable de borner son horizon à l’écuelle que les petits derridiens se proposent de nous faire renifler ad vitam aeternam : «L’artiste, même incroyant, même entièrement oublieux de tous les enseignements de la foi, célèbre dans son art un mystère, un sacrement, dont l’ultime raison d’être est religieuse. Si le miracle cesse de se produire, si l’art dont il est le pain quotidien périt d’inanition, ce n’est pas parce que le sacrificateur a péché, c’est parce qu’il refuse d’accomplir le sacrement».Et puis, Weidlé n’a-t-il pas répété que l’art n’était pas malade, qu’il n’avait donc pas besoin d’un médecin, mais, puisqu’il est agonisant, voire mort, d’un miracle ? Oui : «On ne guérit pas de la mort. L’art n’est pas un malade qui attend le médecin, mais un mourant qui espère en la résurrection. Il se lèvera de son grabat dans la clarté calcinante du jour nouveau ; sinon, il nous faudra l’ensevelir, et sa glorieuse histoire résonnera à nos oreilles comme une longue oraison funèbre».
J’avoue que je ne connaissais pas Wladimir Weidlé jusqu’à ce que la revue d’Alain Santacreu, Contrelittérature (mon Dieu, je note que Luc-Olivier d'Algange, une fois de plus, s'y est répandu sur des kilomètres de Toile...!) ne l’évoque par l’entremise du préfacier de son ouvrage (intitulé, superbement, Les abeilles d’Aristée), Bernard Marchadier. Ce livre imposant, composé de quatre parties aux titres éloquents (Le crépuscule des mondes imaginaires ou encore Minuit de l’art), publié une première fois en 1936 chez Gallimard puis remanié dans les années cinquante, est en fait une étude magistrale sur le déclin de l’art occidental, étude fouillée, passionnante et lyrique qui ne peut se résumer en quelques lignes, d’où la place que j’accorde à de larges extraits de ce livre. En fait, Weidlé paraît tétanisé à l’idée que l’art qu’il évoque, aussi bien littéraire que pictural ou architectural, ne parvient plus à s’incarner : «Il n’y a d’art que s’il y a incarnation, et quoi donc serait incarné si ce n’est l’image de l’homme et celle du monde, tel qu’il se révèle à l’homme ?». Faire de l’art une tentative d’incarnation, c’est affirmer d’emblée que l’art sans l’homme est un art déshumanisé ou, si l’on veut, qu’il peut aboutir, ce qui est aujourd’hui le cas, à un art totalement dépouillé de la notion de figure, déconstruite avec acharnement et, je crois pouvoir le dire, avec haine par les équarrisseurs de tous bords.D’où vient cet oubli, cette haine donc, une fois de plus, de l’incarnation ? La réponse que Weidlé donne est ambiguë et ne manquera pas de toutes les façons de faire bondir les sots, qu’ils soient universitaires ou amateurs d’art contemporain. C’est d’abord l’oubli de Dieu, c’est l’indifférence par rapport à la religion qui entraîne la pétrification de l’art, sa lente dessiccation qui fait de lui, dit l’auteur avant d’autres, un cadavre. Weidlé écrit ainsi : «On purifie l’art et la poésie comme on fait pour l’alcool, en opérant par analyse et abstraction, en substituant aux «nourritures terrestres» un assortiment de pilules nutritives. Le laboratoire travaille à plein rendement. Le temple désaffecté est en ruine. À sa place il n’y aura rien et l’herbe poussera sur les pierres, si l’artiste, trop longtemps séparé de la vraie foi, n’y construit pas avec l’aide de celle-ci une cathédrale indestructible, si l’art condamné à errer dans des pays sans chemin ne se souvient pas de sa patrie abandonnée, n’y cherche et n’y trouve pas, une fois de plus, sa justification suprême». Mais c’est aussi la perte d’une espèce d’innocence originelle, corollaire inévitable d’une sanctification de la foi dans les actes les plus anodins de la vie de nos pères, innocence que les modernes selon l'auteur tentent par tous les moyens de reconquérir à l’exemple d’un Mallarmé ou d’un Joyce, qui explique que nous soyons tombés dans le règne d’une technique strictement reproductrice, pas même un artisanat: «La seule présence parmi nous, au cours des années formatrices du siècle, de ce génie [Mallarmé] aussi vaste, bien que moins élevé et moins profond que les génies d’autrefois, construisant avec une application infinie son énorme et vain gratte-ciel babylonien, est révélatrice, plus qu’aucune autre, de nos erreurs et du destin que nous avons fait à toute spontanéité créatrice. […] Cette Somme démesurée des plus alléchantes contorsions verbales, cet Art poétique en dix mille leçons n’est pas une incarnation vivante de l’art; il est l’autopsie de son cadavre». Le mot est lâché. Il résonne dans nos oreilles comme la brutale interruption, par une tête déjà vidée de son sang, de la fulgurante descente d’un couperet.L’artiste moderne nous dit Weidlé, est désormais incapable de regarder son œuvre comme autre chose qu’un simple instrument, parfaitement interchangeable avec n’importe quelle autre technique, pour la réalisation… de quoi ? Du grand Œuvre que l’artiste déposera aux pieds de son Créateur ? Non, puisque l’artiste est abandonné. Ainsi du poète, dans une image très belle : «Dieu s’est caché : le monde n’est plus. Dans les ténèbres, le poète seul, créateur sans majuscule, est responsable pour chaque parole, pour chaque battement de cœur». Il s’agira donc, dans le meilleur des cas, de refuser de s’abandonner au règne de la quantité dénoncé par d’autres, de tenter de dissiper l’illusion d’un art qui n’est plus de l’art mais bel et bien une imposture («Aucune époque antérieure au siècle dernier n’a même conçu l’idée d’une floraison aussi énorme d’impostures, de mensonges, d’absurdités et de faux-semblants». L’art sans conséquences analysé brillamment par Domecq n’est pas loin…), confinée dans la reproduction, ou plutôt le clonage débridé d’un phocomèle monstrueux sur lequel on greffera quelques trouvailles, antennes, bidets, membres humains épars ou boites de conserve rouillées, que l’on présentera ensuite à la parade des horreurs, devant un public faussement ébahi. Freaks triomphe et nous continuons d’applaudir.Alors messieurs les bien-pensants, Weidlé, réactionnaire ou pas ? Comme l’a été à vos yeux le Caillois de Babel ? Comme l’a été encore le Steiner de Réelles présences, qui semble être l’un des dignes héritiers de Weidlé ? Comme l’ont été, plus récemment et avec bien moins de panache, un Waldberg et un Jourde ? À votre décharge, cette phrase peut prêter son flanc à vos crocs de bébé : «Si le progrès est la mort de la poésie, quel est donc le poète qui ne se rendrait pas coupable de réaction ?». De la petite moustache sale de Lindenberg perlent déjà quelques gouttes de salive… Réactionnaire, non. Weidlé est juste en tous les cas, infiniment pertinent et certainement pas fasciné par un retour, plus ou moins fantasmé par certains, vers une Origine mythique estampillée vierge de toute contamination. Lisons ainsi l’auteur affirmer que : «Ce dont on a le plus soif, au fond, ce n’est pas l’art du passé, ce sont les conditions dans lesquelles cet art a pu fleurir; ce n’est pas telle image, c’est le libre exercice de l’Imagination qui les engendre toutes». Phrase définitive, comme celle-ci d’ailleurs, que je crois de simple bon sens, qui affirme que l’artiste, comme Paul Gadenne le déclarait, est incapable de borner son horizon à l’écuelle que les petits derridiens se proposent de nous faire renifler ad vitam aeternam : «L’artiste, même incroyant, même entièrement oublieux de tous les enseignements de la foi, célèbre dans son art un mystère, un sacrement, dont l’ultime raison d’être est religieuse. Si le miracle cesse de se produire, si l’art dont il est le pain quotidien périt d’inanition, ce n’est pas parce que le sacrificateur a péché, c’est parce qu’il refuse d’accomplir le sacrement».Et puis, Weidlé n’a-t-il pas répété que l’art n’était pas malade, qu’il n’avait donc pas besoin d’un médecin, mais, puisqu’il est agonisant, voire mort, d’un miracle ? Oui : «On ne guérit pas de la mort. L’art n’est pas un malade qui attend le médecin, mais un mourant qui espère en la résurrection. Il se lèvera de son grabat dans la clarté calcinante du jour nouveau ; sinon, il nous faudra l’ensevelir, et sa glorieuse histoire résonnera à nos oreilles comme une longue oraison funèbre». Passer de la lecture du remarquable et ténébreux ouvrage de Wladimir Weidlé au dernier livre signé du tonitruant Marc-Édouard Nabe, J’enfonce le clou, c’est un peu décider de ne plus contempler telle magnifique icône pour se consacrer à l’analyse d’un vulgaire chromo criard, l’une de ces babioles graisseuses que les Grecs déposent pieusement à l’endroit où leur façon exotique de conduire a privé l’un des leurs des plaisirs purement terrestres d’un Muscat de Samos. Attention cependant, je ne jette pas l’anathème sur Nabe, qui d’ailleurs s’empresserait de le ramasser et de lui témoigner une attention de tous les instants, comme s’il s’agissait pour lui d’arroser une plante souffreteuse qu’il exhiberait ensuite avec fierté. Certains textes, notamment l’analyse superbe consacrée à la Passion de Mel Gibson, sont remarquables de justesse et de violence. Stigmatiser l’Occident pourrissant, drapé dans sa trouille-très-chrétienne (ou plutôt catholique) n’est également pas pour me déplaire, quitte à manier un peu trop facilement le paradoxe théologique en affirmant plusieurs fois que la seule terre de chrétienté, aujourd’hui, est désormais la terre «où il y a de l’islam». Je ne peux toutefois que constater que, systématiquement, Nabe cherche à choquer pour le simple plaisir de choquer. Ainsi revendique-t-il haut et fort la transformation, par les actes terroristes, de l’horreur en œuvre artistique puisque l’art, selon lui, n’est absolument plus capable, de nos jours, de rivaliser avec la réalité. Nabe a bien évidemment raison; jetez un coup d’œil sur les meilleures ventes littéraires et vous ne pourrez qu’affirmer, avec l’auteur du splendide et jouissif Alain Zannini, que la littérature française ne vaut (presque) plus rien et que, symétriquement, c’est sur ce rien que poussent de plus en plus de champignons blafards, les journalistes de Paris, comme on parle des champignons de la même cave. Nabe a raison, oui, mais ce n’est pas tant l’horreur terroriste décidée par quelques fous qu’il faut admirer que stigmatiser, au contraire, le ridicule pathétique dans lequel nos lettres ont lamentablement coulé, elles qui ne parviennent même plus à surnager dans la bassine de la culture, cette flache d’eau croupissante dans laquelle Nabe n’en finit pas de jeter ses vieilles carcasses d’insultes rouillées. Une fois de plus, il a raison mais on se demande alors par quelle mystérieuse abnégation l’auteur n’a pas décidé d’écrire une œuvre qui serait justement à la hauteur de notre époque, en sublimant par son art l’horreur mécanisée, en clouant au pilori le vieux pantin culturel. Car enfin, la facilité avec laquelle les prétentions nabiennes peuvent être balayées d’un geste est tout simplement déconcertante : que fait Nabe dans ce livre, J’enfonce le clou, lui qui exalte l’art contre la culture ? Du culturel voyons ou bien, si l’on tient quelque peu à sauver les meubles et la réputation (exagérée) d’incendiaire que traîne avec lui le grincheux impénitent, de l’anti-culturel, ce qui est à peu près rigoureusement la même chose… Un proverbe brésilien affirme comiquement qu’un pauvre mange de la viande lorsqu’il se mord la langue. Nous pourrions dire que Nabe, qui crache toutes les fois qu’il le peut sur la culture, en mange pourtant dès qu’il tire sa langue… Marc-Édouard Nabe préfère donc, en enfonçant un clou émoussé sur une bûche creuse, faire œuvre de diariste plutôt que de romancier, sans doute parce que, depuis quelque temps, le don romanesque de Nabe, presque miraculeusement éclot dans Alain Zannini, est tout simplement tari. Il est vrai qu’Alain Zannini, s’il laissait entrevoir la réhabilitation romanesque d’un écrivain d’immense talent contre l’homme de lettres approximativement bloyen, pouvait aussi nous faire craindre un enlisement dans les sables de la redite, qui eut d'ailleurs lieu avec l'ouvrage qui a directement suivi ce roman. Pour Nabe, le mirage messianico-révolutionnaire qu’est l’Irak, dont il a sans doute vu la terrible réalité, comme d’autres qu’il décrie, depuis une terrasse d’hôtel de luxe, n’aura pas duré plus longtemps qu’un printemps tiède.
Passer de la lecture du remarquable et ténébreux ouvrage de Wladimir Weidlé au dernier livre signé du tonitruant Marc-Édouard Nabe, J’enfonce le clou, c’est un peu décider de ne plus contempler telle magnifique icône pour se consacrer à l’analyse d’un vulgaire chromo criard, l’une de ces babioles graisseuses que les Grecs déposent pieusement à l’endroit où leur façon exotique de conduire a privé l’un des leurs des plaisirs purement terrestres d’un Muscat de Samos. Attention cependant, je ne jette pas l’anathème sur Nabe, qui d’ailleurs s’empresserait de le ramasser et de lui témoigner une attention de tous les instants, comme s’il s’agissait pour lui d’arroser une plante souffreteuse qu’il exhiberait ensuite avec fierté. Certains textes, notamment l’analyse superbe consacrée à la Passion de Mel Gibson, sont remarquables de justesse et de violence. Stigmatiser l’Occident pourrissant, drapé dans sa trouille-très-chrétienne (ou plutôt catholique) n’est également pas pour me déplaire, quitte à manier un peu trop facilement le paradoxe théologique en affirmant plusieurs fois que la seule terre de chrétienté, aujourd’hui, est désormais la terre «où il y a de l’islam». Je ne peux toutefois que constater que, systématiquement, Nabe cherche à choquer pour le simple plaisir de choquer. Ainsi revendique-t-il haut et fort la transformation, par les actes terroristes, de l’horreur en œuvre artistique puisque l’art, selon lui, n’est absolument plus capable, de nos jours, de rivaliser avec la réalité. Nabe a bien évidemment raison; jetez un coup d’œil sur les meilleures ventes littéraires et vous ne pourrez qu’affirmer, avec l’auteur du splendide et jouissif Alain Zannini, que la littérature française ne vaut (presque) plus rien et que, symétriquement, c’est sur ce rien que poussent de plus en plus de champignons blafards, les journalistes de Paris, comme on parle des champignons de la même cave. Nabe a raison, oui, mais ce n’est pas tant l’horreur terroriste décidée par quelques fous qu’il faut admirer que stigmatiser, au contraire, le ridicule pathétique dans lequel nos lettres ont lamentablement coulé, elles qui ne parviennent même plus à surnager dans la bassine de la culture, cette flache d’eau croupissante dans laquelle Nabe n’en finit pas de jeter ses vieilles carcasses d’insultes rouillées. Une fois de plus, il a raison mais on se demande alors par quelle mystérieuse abnégation l’auteur n’a pas décidé d’écrire une œuvre qui serait justement à la hauteur de notre époque, en sublimant par son art l’horreur mécanisée, en clouant au pilori le vieux pantin culturel. Car enfin, la facilité avec laquelle les prétentions nabiennes peuvent être balayées d’un geste est tout simplement déconcertante : que fait Nabe dans ce livre, J’enfonce le clou, lui qui exalte l’art contre la culture ? Du culturel voyons ou bien, si l’on tient quelque peu à sauver les meubles et la réputation (exagérée) d’incendiaire que traîne avec lui le grincheux impénitent, de l’anti-culturel, ce qui est à peu près rigoureusement la même chose… Un proverbe brésilien affirme comiquement qu’un pauvre mange de la viande lorsqu’il se mord la langue. Nous pourrions dire que Nabe, qui crache toutes les fois qu’il le peut sur la culture, en mange pourtant dès qu’il tire sa langue… Marc-Édouard Nabe préfère donc, en enfonçant un clou émoussé sur une bûche creuse, faire œuvre de diariste plutôt que de romancier, sans doute parce que, depuis quelque temps, le don romanesque de Nabe, presque miraculeusement éclot dans Alain Zannini, est tout simplement tari. Il est vrai qu’Alain Zannini, s’il laissait entrevoir la réhabilitation romanesque d’un écrivain d’immense talent contre l’homme de lettres approximativement bloyen, pouvait aussi nous faire craindre un enlisement dans les sables de la redite, qui eut d'ailleurs lieu avec l'ouvrage qui a directement suivi ce roman. Pour Nabe, le mirage messianico-révolutionnaire qu’est l’Irak, dont il a sans doute vu la terrible réalité, comme d’autres qu’il décrie, depuis une terrasse d’hôtel de luxe, n’aura pas duré plus longtemps qu’un printemps tiède.
26/10/2004 | Lien permanent
La démonologie dans la Zone
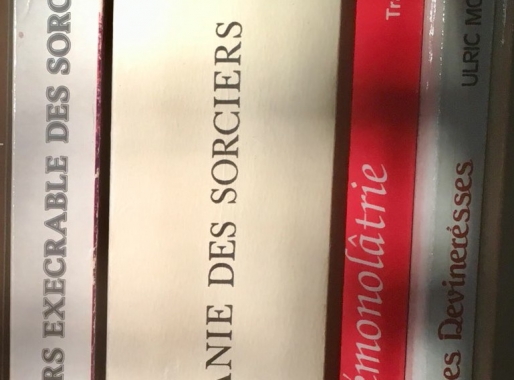
Littérature
 Apologia pro Vita Kurtzii : Suttree de Cormac McCarthy.
Apologia pro Vita Kurtzii : Suttree de Cormac McCarthy. Apologia pro Vita Kurtzii, 2 : Méridien de sang de Cormac McCarthy.
Apologia pro Vita Kurtzii, 2 : Méridien de sang de Cormac McCarthy. Apologia pro Vita Kurtzii, 3 : David Peace en terre du Yorkshire.
Apologia pro Vita Kurtzii, 3 : David Peace en terre du Yorkshire. Apologia pro Vita Kurtzii, 4 : Le jour de la colère de Dieu de Jean-François Colosimo.
Apologia pro Vita Kurtzii, 4 : Le jour de la colère de Dieu de Jean-François Colosimo. Apologia pro Vita Kurtzii, 5 : No Country for Old Men de Cormac McCarthy.
Apologia pro Vita Kurtzii, 5 : No Country for Old Men de Cormac McCarthy. Apologia pro Vita Kurtzii, 6 : Exterminate all the brutes !
Apologia pro Vita Kurtzii, 6 : Exterminate all the brutes ! Lord Jim de Joseph Conrad.
Lord Jim de Joseph Conrad. L'Échelle de Jacob, Alain Cugno, Marianne Closson, etc.
L'Échelle de Jacob, Alain Cugno, Marianne Closson, etc. Fair is foul, and foul is fair : Macbeth ou l'ontologie noire.
Fair is foul, and foul is fair : Macbeth ou l'ontologie noire. Ici et là-bas, toujours, le diable : à propos de Là-bas de J.-K. Huysmans.
Ici et là-bas, toujours, le diable : à propos de Là-bas de J.-K. Huysmans. Les Bienveillantes attendront... encore un peu.
Les Bienveillantes attendront... encore un peu. Georges Bernanos dans la Zone.
Georges Bernanos dans la Zone. Monsieur Ouine de Georges Bernanos.
Monsieur Ouine de Georges Bernanos. Le démoniaque selon Sören Kierkegaard dans Monsieur Ouine de Georges Bernanos (article d'abord mis en ligne sur Knol, site qui n'existe plus).
Le démoniaque selon Sören Kierkegaard dans Monsieur Ouine de Georges Bernanos (article d'abord mis en ligne sur Knol, site qui n'existe plus). O Demoníaco segundo Sören Kierkegaard em Monsieur Ouine de Georges Bernanos (traduction en portugais du précédent, par Carlos Sousa de Almeida).
O Demoníaco segundo Sören Kierkegaard em Monsieur Ouine de Georges Bernanos (traduction en portugais du précédent, par Carlos Sousa de Almeida). Un Démon de petite envergure de Fédor Sologoub.
Un Démon de petite envergure de Fédor Sologoub. Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos.
Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos. Identification du démoniaque (extrait de l'avant-propos de La Littérature à contre-nuit).
Identification du démoniaque (extrait de l'avant-propos de La Littérature à contre-nuit).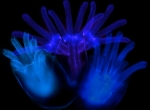 Judas revu et corrigé par Pierre-Emmanuel Dauzat.
Judas revu et corrigé par Pierre-Emmanuel Dauzat. Le Démon de Hubert Selby Jr.
Le Démon de Hubert Selby Jr. Le Mal absolu de Pietro Citati.
Le Mal absolu de Pietro Citati.  La Légende du Grand Inquisiteur de Dostoïevski.
La Légende du Grand Inquisiteur de Dostoïevski. La voix de la nuit de Marcel Beyer.
La voix de la nuit de Marcel Beyer. Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski.
Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski. L'exorciste de William Peter Blatty et Rosemary's baby d'Ira Levin.
L'exorciste de William Peter Blatty et Rosemary's baby d'Ira Levin. L'Ange des ténèbres d'Ernesto Sábato.
L'Ange des ténèbres d'Ernesto Sábato.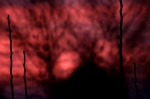 Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov.
Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov.Cinéma
 Damnation de Béla Tarr ou la sécheresse de l'âme.
Damnation de Béla Tarr ou la sécheresse de l'âme. Damnation de Béla Tarr, par Olivier Noël.
Damnation de Béla Tarr, par Olivier Noël. Manhunter de Michael Mann.
Manhunter de Michael Mann. The Ususal Suspects/Seven.
The Ususal Suspects/Seven. Saraband d'Ingmar Bergman.
Saraband d'Ingmar Bergman. Les envoûtés de John Schlesinger, par Francis Moury.
Les envoûtés de John Schlesinger, par Francis Moury. Les Vierges de Satan, par Francis Moury.
Les Vierges de Satan, par Francis Moury. La chambre des tortures de Roger Corman, par Francis Moury.
La chambre des tortures de Roger Corman, par Francis Moury. Les deux visages du Dr. Jekyll, par Francis Moury.
Les deux visages du Dr. Jekyll, par Francis Moury. Dracula au cinéma, une série de plusieurs notes par Francis Moury.
Dracula au cinéma, une série de plusieurs notes par Francis Moury. L’Exorciste de William Friedkin : la densité du Mal, par Gregory Mion.
L’Exorciste de William Friedkin : la densité du Mal, par Gregory Mion. M le maudit de Fritz Lang, par Francis Moury.
M le maudit de Fritz Lang, par Francis Moury.Peinture
 Satan graveur : Les Sataniques de Rops.
Satan graveur : Les Sataniques de Rops. Satan graveur : Les Désastres de Goya.
Satan graveur : Les Désastres de Goya. Deux portraits du diable : Daniel Arasse, Arturo Graf.
Deux portraits du diable : Daniel Arasse, Arturo Graf. On ne voit décidément plus rien, ni Dieu ni diable, sans Daniel Arasse (premières lignes d'un article paru dans la revue Études du mois d'avril 2015.
On ne voit décidément plus rien, ni Dieu ni diable, sans Daniel Arasse (premières lignes d'un article paru dans la revue Études du mois d'avril 2015.Histoire
 Le diable et l'historien Robert Muchembled.
Le diable et l'historien Robert Muchembled. Le corps du diable d'Esther Cohen. Varia.
Le corps du diable d'Esther Cohen. Varia.Théologie, varia, livres
 Entretien avec le Père Charles Chossonnery, exorciste.
Entretien avec le Père Charles Chossonnery, exorciste. Sur la collection Atopia, aux éditions Jérôme Millon.
Sur la collection Atopia, aux éditions Jérôme Millon.

























































