Rechercher : alain soral
De quoi Richard Millet, Alain Finkielkraut et quelques autres sont-ils le nom ?

C'est dans Notre inquiétude qu'Henri Petiot dit Daniel-Rops écrivit en 1927 ces mots que nous pourrions faire nôtres, à la réserve près que la mystique militaire ou sportive qu'évoque l'auteur a été remplacée par une atonie hollandiste aussi pitoyable que logique : «Nos peuples occidentaux sont inquiets; ils paraissent savoir que leur adolescence est finie. Les efforts qu'ils font pour se créer de nouvelles forces sont moins des retours vers la jeunesse que des rajeunissements de vieillards. Et pour nous le signe le plus net de la décadence est la substitution d'une volonté à un instinct. La foi vive et brutale des premiers âges est remplacée par un élan, sincère, mais conscient. Au culte instinctif de la force qui est une nécessité pour les peuples qui se battent on substitue une mystique militaire ou sportive» (1).
Si Daniel-Rops prête à l'inquiétude une vertu spirituelle évidente, il semble que celle qui est aujourd'hui devenue la maîtresse exclusive des Européens, et singulièrement des plus tourmentés et accablés d'entre eux, les Français, soit débarrassée de toute aura fécondante. Nous nous inquiétons effectivement mais beaucoup moins que nous nous ennuyons, et nous nous ennuyons à nous décrocher la mâchoire.
Nous ne possédons plus, de l'inquiétude, que la face ténébreuse, terreuse en quelque sorte ou plutôt boueuse, strictement matérielle, cette boue et cette matière étant finalement bien adaptées à notre époque, réduite, par nos dirigeants (c'est le mot, bien plus que chefs ou hommes politiques) à n'être qu'une morne esplanade, parfaitement horizontale et débarrassée de tout attrait vers le ciel (ou l'Enfer, c'est tout un, et pas besoin de lire Baudelaire ou Barbey d'Aurevilly !), où croupissent des individus qui ne sont plus des personnes, qui s'ignorent, lorsqu'elles ne se haïssent pas, les unes les autres. Autant de Frances que de Français, c'est une évidence.
Dans un livre saisissant et remarquablement documenté qui n'a pas reçu la publicité qu'il aurait largement méritée (2), David Engels, établissant de nombreux rapprochements entre la situation des peuples européens contemporains et le déclin de la République romaine tardive, rappelait quelques chiffres, édifiants comme disent les journalistes : «En 1999, en France, on estimait à 23 % le nombre des citoyens ayant un parent ou un aïeul immigré. Entre 1999 et 2005, un million d'étrangers a reçu la nationalité française» (3).
Et l'auteur, illustrant la méthode qu'il a choisie, de citer la troisième Satire de Juvénal, qui décrit la vie dans la «mégapole [Rome bien sûr] en énumérant les incendies, les bâtiments qui s'écroulent, les bouchons, les accidents, les foules, les brigandages et les disputes. Mais il insiste surtout sur la raison la plus insupportable de cette existence : la présence des nombreux étrangers», citant l'auteur latin : «Quelle race est la mieux vue de nos richards et m'inspire le plus d'éloignement, je me hâte de vous le dire, sans aucun respect humain. Je ne puis, ô Quirites, supporter une Rome grecque. Et encore ! Qu'est-ce que représente l'élément proprement achéen, dans cette lie ? Il y a beau temps que le fleuve de Syrie, l'Oronte, se dégorge dans le Tibre, charriant la langue, les mœurs de cette contrée, la harpe aux cordes obliques les joueurs de flûte, les tambourins exotiques, les filles dont la consigne est de guetter le client près du cirque» (4).
Nous pourrions commenter ce passage par un propos de David Engels qui déclare : «Cet exemple classique [celui d'Athènes résistant aux Perses] nous prouve que la cohésion et la valeur d'un ensemble politique résident dans la force de son identité, et non dans la quantité de ses richesses ou de ses territoires» (5).
L'actualité fourmille (6) d'exemples d'une population européenne qui n'en peut plus, mais que dire de l'état des esprits en France, ce pays naguère phare de l'humanité et bientôt réduit à n'être qu'un corps malade souffrant d'une occlusion intestinale, les idéologies roses et rouges faisant office de bouchon de merde précambrienne, et dont les habitants multiplient les jacqueries face à un pouvoir non seulement parfaitement incompétent mais qui tente de masquer son incompétence économique et politique en modifiant profondément les mœurs et les habitudes de la société, aussi lassée que, bientôt si ce n'est déjà le cas, ruinée dans ses franges les plus modestes et fragiles ! Le pouvoir socialiste pallie son incurie économique, de nos jours comme sous le règne de François Mitterrand, en jouant la carte cornée du symbolisme : le mariage pour tous, les jeux pour tous (illustrés par la politique ô combien caricaturale puisque festiviste du Maire de Paris), à défaut que le pain, lui, soit partagé pour tous. Toujours plus, de jeux surtout, et les petits blancs devenus les esclaves modernes d'un gouvernement, de gouvernements successifs pour lesquels ils ont tout simplement cessé d'exister.
La question de l'immigration incontrôlée qui sévit dans notre pays et, partant, celle du racisme institutionnalisé supposé de l'ensemble des Français contre lequel le pseudo-écrivain Yann Moix a pu pousser sa petite chansonnette ridicule cristallise cette atmosphère lourde, précédant peut-être quelque orage ou, à tout le moins, fait divers qui mettra comme on dit le feu aux poudres. Nous savons qu'il en faut finalement peu, en France, pour réveiller certaines volontés d'en découdre.
Peut-être s'agit-il de remettre à l'honneur (ou au déshonneur, hurleront les antiracistes) quelque moderne lex papia de peregrinis comme en l'an 65, laquelle interdisait d'office aux non-citoyens, à l'exception des Italiques, de s'installer à Rome : «En même temps, sur la proposition d'un certain Caïus Papius, tribun de la plèbe, tous les étrangers résidant à Rome, à l'exception des habitants de la contrée qui porte maintenant le nom d'Italie, furent chassés, sous le prétexte qu'ils étaient trop nombreux et qu'ils ne paraissaient pas dignes de vivre avec les Romains» (7). David Engels encore, dans son livre qui est le contre-exemple absolu du story telling racoleur de Laurent Obertone et de sa fâcheuse tendance à établir des comparaisons entre le règne animal et le règne humain, écrit : «L'intégration exagérée de tout ce qui est étranger, corollaire d'une absence pathologique de limites, implique, à la longue, la chute de tout élément identificatoire fort, et représente un risque politique non négligeable dans un monde qui se définit de plus en plus par un durcissement des identités religieuses, politiques et ethniques les plus archaïques» (8). Et l'auteur d'enfoncer le clou de ses affirmations et de tirer les conséquences probables sinon certaines de ses comparaisons éloquentes : «[...] il y a deux mille cent ans comme aujourd'hui, l'appartenance ethnique; le comportement démographique, les traditions familiales, l'identité culturelle, spirituelle, intellectuelle et artistique, et finalement les idéaux sécuritaires, institutionnels, fédéraux et politiques sont devenus si conflictuels que la résolution de cette crise devra, soit passer par une implosion du système pour trouver sa résolution, soit par un retour en force à un autoritarisme conservateur» (pp. 260-1), l'auteur de conclure son ouvrage aussi polémique qu'impressionnant en nous rappelant que c'est l'Empire qui a suivi la République romaine tardive : «Tout d'abord, la lente dissolution civique et culturelle du corps politique se trouverait neutralisée par l'avènement d'une autocratie charismatique héréditaire ou élective, basée sur la loyauté et la compétence d'une petite élite gouvernementale indépendante du libre jeu des partis politiques, bien que ce dernier puisse éventuellement être maintenu afin de respecter les formes extérieures de «liberté» et de «démocratie»» (p. 270), les Européens, comme nous le rappelle David Engels, semblant bien plus attachés à la sécurité qu'à la liberté. Un gouvernement fort, autoritaire même, pourvu que la chienlit soit éradiquée et la prospérité de tous, du moins du plus grand nombre, soit assurée, et je doute que les Français défileront par centaines de milliers pour hurler, de toute la force de leurs slogans dressés comme de petits poings, leur haine de la peste brune.
Abondamment documenté, sourcé, d'un ton sobre mais efficace, le livre de David Engels devrait être lu de toute urgence par notre René de la littérature contemporaine, dolent comme les tournesols plaintifs d'un des contes les plus énigmatiques de Poe, Silence, j'ai nommé Richard Millet bien sûr qui, dans un nouveau petit livre aussi ridicule que mal écrit, monte sur son rocher en carton-pâte et déclame sous un vent de sèche-mains l'antienne chassieuse de l'indignation anti-antiraciste. Je me souviens d'un comique involontaire du nom de Jacques de Guillebon qui signait, dans une revue du nom d'Immédiatement qu'il fit couler en quelques mois de ses bons offices, des éditoriaux enflammés où il affirmait que le monde n'avait qu'à bien se tenir et oser encore exister après sa déclamation prophétique. Richard Millet, bien que de nombreuses années l'aîné de notre Manfred de bénitier, est devenu, en quelques essais ineptes, le Jacques de Guillebon de la littérature pré-apocalyptique, ce qui n'est pas un mince exploit dans l'ordre du grotesque.
Publié par Pierre-Guillaume de Roux qui, en tant qu'éditeur, devrait sans doute conseiller une bonne fois par toute à Richard Millet de revenir à ces vrais beaux romans qu'il a, paraît-il, écrits dans une vie antérieure, à l'époque où il inondait de sa prose presque chacune des nombreuses collections de Gallimard, De l'antiracisme comme terreur littéraire (9) présente l'avantage de pouvoir se lire durant un court trajet en RER, un de ces redoutables trajets de Paris à Paris ou plutôt de Paris à Ouagadougou où, comme l'a fait remarquer l'auteur avec effroi, il peut vous arriver, vous, femme ou homme blancs, catholiques, hétérosexuels bien sûr (zut, Renaud Camus va tiquer sur cet impératif catégorique), de vous retrouver le seul spécimen de ce type avouons-le de plus en plus rare à Paris, ville française pour quelques années encore, mais depuis des lustres plus franchement blanche, hétérosexuelle et, pardonnez du peu, catholique.
Que sont les solides analyses de Richard Millet censées nous peindre l'effroyable situation des Français de souche au sein même de leur propre pays si peu souchien ? De la déclamation au kilomètre, des envolées lyriques d'une pauvreté stylistique guillebonnesque, donc, ici, frappante, d'autant plus frappante que cet écrivant ne méritant plus le nom d'écrivain, qui ne cesse pourtant de nous répéter qu'il est le dernier écrivain français digne de ce nom, est incapable, contrairement au programme qu'il s'est fixé, de nous révéler l'envers du décor, c'est-à-dire : la vérité. Ainsi, s'il n'est pas un menteur, puisque nous voulons accorder à ce Sphinx si peu énigmatique le bénéfice de la bonne foi, Richard Millet est, du moins en tant qu'écrivain, un impuissant. Un impuissant qui stigmatise l'impuissance française à redresser le cap, un impuissant du langage et de la pensée qui accable la littérature contemporaine (pas seulement française, notre homme a tout lu, quoique de travers), n'est-ce pas assez comique ?
Formules creuses et non pas vérité, comme, dès les premières lignes du livre, cette sentence de magicien constipé qui ne parviendrait même pas à ouvrir une porte de foyer Sonacotra, réclame clignotant dans la nuit de la défaite française, enseigne criarde de bar malfamé où tous les imbéciles viennent chercher une lampée de vin de vigueur et ne se voient servir qu'une limonade sans gaz : «Ce qu'on appelle littérature, aujourd'hui, et, plus largement, la culture, n'est que la face hédoniste d'un nihilisme dont l'antiracisme est la branche terroriste» (p. 11). Chacun de ces mots, assemblés dans cette phrase qui se veut sans doute coup de marteau et qui, de fait, plutôt que vous assommer, vous noie dans une purée de pois, mériterait plusieurs pages d'explication mais Richard Millet, lui, ne démontre pas, même en un seul paragraphe, mais assène des rébus et enchaîne le vent au vent, les grandes tirades gonflées à l'hélium d'un matadorisme de comptoir dignes du petit cousin d'un La Varende pris de boisson aux grandes tirades toutes pleines de mots portant majuscule, les formules autotéliques aux formules toutes faites censés désigner l'ennemi de la Vérité : «hypermarché des doxas définitionnelles» (p. 15), «Propagande» (p. 19 et sq.) répété une bonne cinquantaine de fois, tout comme «idéologie mondialiste» (p. 23), «parti médiatico-littéraire appelé aujourd'hui Culture» (pp. 26-7), «Nouvel Ordre moral» (p. 31), «assemblage ethnico-social» (p. 34), «l'Empire» (p. 35), «Programme contemporain» (p. 40), «terreur postmessianique» (p. 46), «nihilisme antiraciste» (p. 47), etc. Aucun de ces mots, pourtant riche d'un sens qu'il eût fallu à tout le moins développer, n'est expliqué, Richard Millet remplaçant le clinquant par la pesanteur d'une pensée qui, dans notre cas, semble s'être évaporée sous l'action d'un puissant rayonnement venu de haut : la haine peut-être ?
Pourtant, Richard Millet ne cesse de nous répéter que celui qui peut se targuer de s'appeler écrivain est, en tout premier lieu, l'artiste seul capable de nommer les choses, ce que jamais notre bon Homais de l'anti-antiracisme ne semble donc être en mesure de faire, qui se réfugie derrière la boursouflure et l'hyperbole auto-satisfaite, la pleurnicherie tintinnabulante se voulant force de renversement. Millet ne nous bouscule pas, il nous englue : «Est-il criminel de prétendre nommer les choses, et dire non seulement la couleur des gens, leur ethnie, leur race, leur comportement [...] ?» (p. 43), alors même que notre héraut annonçait la couleur, si je puis dire, dans cette tirade ridicule si elle n'était, d'abord, involontairement drôle : «nous sommes des écrivains, donc une constellation, cela même qui s'inscrit en blanc sur le noir de l'immensité, non le contraire, et nous séparant des accusateurs parce qu'ils ne le sont pas, écrivains, quoiqu'ils y prétendent, et donc libres, nous, de nommer le monde» (p. 24). Richard Millet ne nomme rien, si ce n'est, peut-être, l'étrange sorte de lèpre mentale qui paralyse son cerveau, le Parkinson qui afflige sa main d'un tremblé que nul ne pourra confondre avec l'effet de style du grand peintre. Les derniers textes (mais il en paraît toujours un, après quelques mois d'incubation) de Richard Millet ne sont pas grand-chose, mais ce pas grand-chose n'émousse pas le caractère pathétique du spectacle qu'ils nous offrent : une dissolution, moins dans les hordes racailles que dans une langue devenue aphasique.
Il est après tout curieux, mais pas très étonnant, que ce soient toujours les plus mauvais écrivains qui s'affublent des caractéristiques prestigieuses de ceux pour lesquels ils se prennent, les grands écrivains, et nous n'étonnerons que les cancres en rapprochant Richard Millet de Yannick Haenel ou Antoni Casas Ros, deux nullités littéraires qui, elles aussi, prétendent nous dessiller les yeux en nous dévoilant ce qui se cache derrière les trompeuses apparences, et se prennent pour des hérauts de la vérité contre le nihilisme rampant, le fait que ces trois écrivants se situent aux extrêmes opposés du spectre politique n'étant, ici, qu'un détail d'assez peu d'importance. Évoquant le nihilisme dont il a découvert l'existence dans le regard de son maître Philippe Sollers bien davantage que dans les textes de Jacobi, Dostoïevski, Nietzsche ou Heidegger (10), Yannick Haenel ne parle que de sa propre nullité et fatuité toute pressée, comme un citron, de dégorger son jus, de préférence à grand renfort de publicité sollersienne, donc dûment réglée par Gallimard, comme Richard Millet, lorsqu'il évoque son furieux anti-antiracisme, recouvre son furieux racisme d'un masque qui se veut provocateur et martial, aussi martial que l'est le paumé que Yannick Haenel cache derrière un masque dogon macéré dans un bocal du Flore.
Il est de fait frappant que Richard Millet et Yannick Haenel partagent une commune nullité stylistique dans la grandiloquence spectrale, l'un et l'autre se prenant en fin de compte pour des espèce d'hérésiarques initiés aux plus insoupçonnables mystères, l'enseignement ésotérique qu'ils ont la bonté de délivrer aux pauvres manants que nous sommes pardonnant par avance toutes leurs parades stylistiques, comme s'il s'agissait de paons présomptueux sûrs de leur munificent plumage mais peu certains de la vigueur de leur semence : ainsi Richard Millet n'a-t-il as peur de se considérer comme «un exilé de l'intérieur, un singe de l'immigré, sommé de renoncer à [sa] culture afin de mieux «accueillir l'autre» par un tour de passe-passe, une supercherie, une substitution maléfique obéissant à la logique de l'indifférenciation qui est la négation de toute littérature et contre quoi [il] propose [son] nom, dans toute sa nudité, dans la fermeté de ses syllabes comme dans l'éclat qu'il suscite et qui n'aveugle que les imbéciles» (pp. 21-2), Millet se voyant encore comme étant «seul, donc, et non pas contre tous mais dressé contre l'unanimité clabaudante dans la lumière du crépuscule, laquelle donne à toute chose, on le sait, un singulier éclairage où la vérité n'apparaît pas moins bien qu'en plein midi» (p. 25), l'auteur de poursuivre en soulignant qu'il parle, lui, «dans l'aube ou bien parmi les ombres, et non pas caché mais à la lisière où le Verbe se sépare de l'Idéologie, et si passionnément attaché à découvrir la vérité [qu'il] lui sacrifie [son] être social» (ibid.), être social qui est pourtant toujours salarié chez Gallimard, édité par Pierre-Guillaume de Roux et apparaissant régulièrement sur les plateaux de certaines émissions télévisées, comme une simple recherche sur la Toile le prouve d'abondance. Les spectres sont toujours bavards, nous le savons depuis les vieux textes du Moyen Âge et Richard Millet, lui, comme un moderne M. Valdemar ou le héros de Ubik, n'en finit pas de nous haranguer depuis l'autre côté de l
08/12/2013 | Lien permanent
La Horde du Contrevent d’Alain Damasio : une apologie du vivant, du mouvement et de la créativité, par Gregory Mion

 Gregory Mion dans la Zone.
Gregory Mion dans la Zone. La littérature à contre-vent, par Olivier Noël.
La littérature à contre-vent, par Olivier Noël. La horde des contresens, par Jean-Baptiste Morizot.
La horde des contresens, par Jean-Baptiste Morizot.«Si l’on a un grand dessein, n’est-on pas au-dessus, non seulement de la calomnie qui s’attache à ce dessein, mais même de ce qu’il a d’injuste, de criminel ? – Il me le semble. Non que l’on sanctifie le crime par son but, mais on le grandit.»
Friedrich Nietzsche, La volonté de puissance.
«L’homme est l’avenir de l’homme.»
Francis Ponge.
«[…] dans une collectivité qui se reprend sans cesse et se juge et se métamorphose, l’œuvre écrite peut être une condition essentielle de l’action, c’est-à-dire le moment de la conscience réflexive.»
Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?
La quête du vent : un itinéraire surhumain pour augmenter les pouvoirs du vivant
Plus de dix ans après sa parution, La Horde du Contrevent continue de fasciner. Les très rares apparitions publiques de son auteur, Alain Damasio, contribuent à perpétuer la fascination, bien entendu. Il est vrai que le seul nom de Damasio suscite le détour dans une conversation. C’est une réelle marque d’autonomie littéraire, loin de tout processus combinard ou de machine promotionnelle. La qualité du travail de Damasio lui permet en effet de se dispenser des relations toujours suspectes avec le pouvoir. De toute façon, l’exigence de son œuvre est un repoussoir pour les lecteurs inconséquents. Beaucoup trop d’articles ont néanmoins manqué leur rendez-vous avec La Horde du Contrevent, soit par légèreté caractéristique, symptôme désormais généralisé du journalisme français, soit par le biais d’une arrogance fondamentalement universitaire. Ainsi les uns se sont souvent contentés de signaler que Damasio avait révolutionné le genre de la science-fiction, sans jamais établir la moindre distinction formelle entre la pratique d’un genre émérite et l’ambition de Damasio qui consiste moins à prévoir les futurs difficiles de l’humanité qu’à proposer un diagnostic critique du présent, et les autres, avec une morgue emblématique, ont attaqué l’auteur sur le terrain de l’exactitude philosophique, qui l’accusant de mal avoir lu Nietzsche, qui lui reprochant un usage hasardeux des concepts deleuziens. Ces derniers ont sûrement oublié que la tâche du romancier, pour autant qu’il en ait une, ne concerne pas la stricte restitution des pensées ou des thèses d’un corpus. Le roman peut s’inspirer d’un matériau qui lui préexiste, mais ce n’est jamais qu’une ressource amovible, une colonne vertébrale souple à partir de laquelle pourront se greffer des corps étrangers. Ceci étant, les affections de Damasio pour la philosophie sont sérieuses et attentives, à tel point que les taxer d’imprécision révèle non seulement la sotte fatuité de ces critiques, ainsi que l’évidente lecture superficielle du roman qui fut la leur, roman dont nous voudrions ardemment défendre les propositions (1).
Pour aller au plus général et pour commencer, nous rappellerons un tant soit peu l’objet de La Horde du Contrevent. Le livre raconte le parcours de vingt-trois spécialistes du «contre», précocement formés à rencontrer tous les types de vent recensés jusqu’alors et à en déjouer les plus vives manifestations. L’enjeu est de remonter le souffle du vent comme on remonterait un fleuve, afin d’atteindre son poumon présumé, connu sous le nom évocateur d’Extrême-Amont. S’il n’est guère de coordonnées spatio-temporelles pour nous indiquer l’époque et la topographie globale du monde où a lieu cette aventure, c’est que la relative présomption d’un bout-du-monde où se cuirasserait le vent suggère une extension des limites physiques connues, de même que cela nous laisse entendre la durée d’une quête millénaire dont il importe peu de fournir une datation scrupuleuse. Ce n’est donc pas une vue d’ensemble que nous offre Alain Damasio, en l’occurrence une description exhaustive qui nous dévoilerait les dimensions totales de cet univers sous forme de plan large, mais plutôt une succession de paysages violemment attaqués par le vent, quoique de manière variable, et dont l’épaisseur et la couleur transparaissent au fur et à mesure que les personnages en arpentent les territoires. Il faudrait en fait imaginer une sorte de Terre plate où chacun aurait connaissance de son point fédérateur de rassemblement (la ville d’Aberlaas, située en Extrême-Aval – cf. p. 678), et où nul n’aurait jamais atteint le point opposé tant convoité, l’Extrême-Amont, sinon par l’intermédiaire des paroles spéculatives et des appétits explorateurs. Il s’agirait peut-être aussi d’un monde où le divin se serait déplacé dans les consciences, n’étant plus assimilable à quelque chose d’extra-mondain, d’invisible et de relativement inatteignable (la prière et l’immortalité de l’âme pouvant cependant faire office de matières conductrices), un monde, en somme, où Dieu aurait pris la forme de tous les vents et dont le culte aurait moins la valeur d’une liturgie apaisante que celle d’une conquête incertaine et acharnée. Eu égard à cette possible métamorphose du divin, il est amusant de constater qu’une expression idiomatique comme «Dieu merci» s’est transformée en «Vent merci».
Conformément à cela, on comprend que si l’on parvenait à localiser l’Extrême-Amont, on aurait en même temps circonscrit le plus grand des mystères, du moins aux yeux de ceux qui donnent leur assentiment à ce terminus terrestre. L’origine du vent serait ici comparable à un Fiat Lux en mouvement perpétuel, respiration première depuis laquelle le monde viendrait au monde, souffle pneumatique qui ferait que toutes les choses tiennent ensemble. Une telle conception de la création explique la volonté de former des hommes et des femmes d’exception qui auront pour mission de rejoindre l’extrémité du vent. Par conséquent, depuis huit siècles et sans relâche, on entraîne des enfants à la poursuite de l’Extrême-Amont. On leur enseigne l’art du «contre», évidemment, mais ce socle commun de connaissances est enrichi par des spécialités individuelles qui détermineront le rôle de chaque membre de la Horde. Soumis à des techniques de sélection sans pitié, les enfants qui sont appelés à devenir l’élite du contre sont évalués par des «hordonnateurs», soucieux de recruter les meilleurs en vue de se rendre à l’endroit même où l’humanité ne paraît plus avoir droit de cité. En outre, le roman nous relate la pérégrination impressionnante de la 34e Horde, conduite par le 9e Golgoth, une force de la nature qui a pour mandat de «tracer», de conditionner la «Trace», c’est-à-dire la route la plus adéquate pour marcher contre le vent en toutes circonstances (cf. p. 510).
Personnalité affirmative à tous les points de vue, Golgoth est un centre actif qui stimule un plus haut degré de puissance et de vitalité. À la tête de la Horde, il achemine ses coéquipiers vers ce qu’ils ont de plus profondément énergétique, de sorte à ce qu’ils puissent convertir en affirmation tout ce qui en eux pourrait vouloir se laisser aller à la négation, aux tendances recroquevillées, au repli. En d’autres termes, Golgoth est celui qui incite la Horde à sélectionner ses forces dominantes dans l’écheveau des rapports de forces qui se jouent entre les vents lunatiques et les forces intrinsèques à chaque individu composant cette 34e Horde. Dans un sens nietzschéen défendu par Damasio, Golgoth est celui qui apprend à ses partenaires la maîtrise de la volonté de puissance. En tant que telle, cette volonté complète de l’intérieur les forces propres de chacun. La volonté de puissance peut soit affirmer, soit nier, soit créer, soit détruire, et Golgoth ne vise que l’affirmation nette, «les passions affirmatives» (2), à savoir le tempérament de création qui se maintient dans l’énergie, le caractère qui acquiesce à ce que la vie a de plus fertile et dont le «oui» est une exceptionnelle puissance créatrice. Ne serait-ce déjà que dans l’exubérance du langage de Golgoth, ces passions se distinguent. La voix de Golgoth est celle d’un Stentor argotique; il débite des encouragements fleuris et ses remontrances résonnent longtemps dans les têtes. Il possède un talent de la métaphore qui exerce une véritable dimension de transport, de mouvement, ainsi toutes les gueulantes de Golgoth métaphorisent littéralement ses troupes : la Horde se réajuste dans le chaos de ses énergies, elle se transfère dans une conscience affirmative et se relève des pires épreuves, comme ce «furvent» qu’il faut affronter au début de l’épopée et qui réclame l’astuce de quelques «contrevents» (3). Dans le cas hypothétique où la Horde ne serait pas capable de s’affirmer, elle croulerait sous une puissance de négation, dans la sinistre souricière des forces réactives qui mènent au ressentiment, à la mauvaise conscience et à des idéaux ascétiques inappropriés. Ce serait alors la consécration d’un monde qui empêcherait les êtres d’aller au bout de leurs pouvoirs positivement créateurs (4).
Pour toutes ces raisons, il convient de poser que Golgoth incarne le cœur (et même le chœur) de la Horde. Il est celui qui ne doit pas mourir pour que la Horde reste en vie. C’est lui qui a toute créance pour recruter ou licencier en cours de route (ou «déshordonner»), sur le chemin ardu de l’Extrême-Amont. C’est lui qui marque la peau de ses hommes au fer rouge, qui inscrit sur les corps le blason qui assigne à chaque recrue son symbole et l’idée de sa fonction. Quiconque se montre faible ou déshonore la Horde est susceptible d’avoir un morceau de sa peau scalpé par Golgoth, la surface du derme où jadis fut gravé le signe distinctif de tel ou tel guerrier du vent (cf. p. 373). On apprécie par ailleurs l’usage ingénieux que l’auteur fait de ces signes : chaque section du texte est précédée par un symbole qui nous renseigne sur la focalisation interne adoptée. De cet expédient narratif résulte une superbe alternance stylistique, une polyphonie, et très vite la lecture permet d’identifier les personnages selon la vocation de leur langage, selon les inflexions qui leur sont propres, et ce procédé nous offre également des données fiables sur les caractères en présence. Le jeu des symboles apporte du reste une utilisation à la fois divertissante et stimulante de la typographie, puisque les signes sont parfois agencés pour nous exposer schématiquement la tactique de la Horde, en l’occurrence la formation mise en place pour résister au vent (cf. par exemple pp. 672, 656 et 654). Et puisque nous en sommes aux aspects singuliers et productifs de la narration, notons que la pagination du livre est décroissante, indice d’une Horde dont le temps et les forces sont éventuellement comptés, indice, encore, d’une régression dont l’objectif sera de la convertir en progression, en matière expansive, quels que soient les efforts exigés pour y parvenir. Le dépeuplement de la Horde est une impression de toute manière assez tangible dès les premiers instants de cette odyssée des tramontanes, aussi n’est-ce rien dire que d’anticiper sur l’éreintement, sur l’essoufflement (cf. p. 39), et donc sur la nécessité faire et refaire vivre, de repeupler après les épreuves létales de cette «ascèse extrême» (p. 608), trait de discipline presque inhumain qui immortalise les réputations de ces soldats de l’impossible.
La renommée de cette 34e Horde provient justement du fait qu’elle possède une hargne inédite dans l’activité de contredire le vent, ainsi qu’elle est dotée d’une admirable faculté de se prescrire des devoirs immenses, de même encore que cette popularité repose sur les profils extraordinaires qui en font l’effectif. La conjonction de ces atouts engendre un pôle remarquable de vitalité malgré les obstacles auxquels la Horde doit remédier. Un pied mis devant l’autre constitue déjà une victoire, un avantage pris sur le vent, une fraction inventive qui honore les dispositions créatrices dignes d’une volonté de puissance qui concourt à l’affirmation. Avancer en direction de l’Extrême-Amont est synonyme de vivacité, alors que reculer vers l’Extrême-Aval, ce serait mourir et passer à côté de notre potentiel, être séparé de ce que l’on peut. Aguerris au «vent facial», les gens de la Horde gagnent du terrain dans ce «merdier hurlant» (p. 695), écoutent avec rigueur les conseils avisés de Golgoth en ce qui concerne les vagues du vent (cf. p. 691), «[boivent] le vent à sa source» (p. 653), dans la promesse d’une reprise de respiration toujours plus pénible mais paradoxalement toujours plus tonifiante. Si la Horde est chaque fois unique en son genre, charpentée seulement par quelques dizaines de braves qui choisissent les voies du contre-courant ou qui ne font que pérenniser les sacrifices de leurs aînés partis avant eux, elle n’en reste pas moins archétypale, programmatique pour l’humanité, exemplaire vis-à-vis des perspectives préférentielles qui devront fortifier le monde de demain, comme le furent les discours dionysiaques de Zarathoustra : la Horde ne montre pas le Surhomme à proprement parler, mais elle le prépare, elle délivre l’homme de ses maladies affaiblissantes et le propulse vers une «grande santé» (5), c’est-à-dire à destination d’un état qui ne sera pas l’absence typique de douleur qui nous pousserait au ramollissement, mais bel et bien vers une aptitude à surmonter continuellement une souffrance énorme, sans répit aucun dans la mesure où l’obtention définitive de cette santé demeure impensable. Le cas échéant, l’homme perdrait à coup sûr de sa capacité à se renouveler, à renverser les digues et les remparts des valeurs tutélaires qui nous ont alanguis et jetés sur des lits de mort. Ne nous y trompons pas, en effet, car la «grande santé» telle que Nietzsche la conçoit est une vigoureuse relation de l’homme avec la témérité, à l’instar de Golgoth qui encourage les siens à ne pas regarder en arrière, à s’obstiner dans la Trace et dans le Contre, parce que ce sont les deux postures favorables à l’évolution, à la force du devenir-vivant, à la métamorphose humaine décisive qui se mettra en situation de créer des valeurs plutôt que de se reposer sur des prescriptions caduques, image désespérante de l’homme actuel qui s’accoude à la balustrade d’un vieux garde-fou, aux antipodes de l’homme à venir, de l’homme qui se doit de devenir et de vouloir être ce qu’il est devenu.
Le concept nietzschéen de «grande santé» concorde donc parfaitement avec les dangers successifs encourus par la Horde. Ce n’est qu’en s’abandonnant aux forces inhumaines du vent que l’homme pourra habiter un déséquilibre fonctionnel, parce que principe d’une résistance continue et d’une volonté forcenée de renversement, de modification, de remaniement, de transfiguration du négatif en positif, de l’insalubre en salubre, de l’ancien en nouveau. C’est une ascèse remarquablement difficile et particulièrement active, certes, étant donné qu’elle oblige à se mettre à découvert, dans les couloirs mortels du vent de face, à distance des villes fortifiées où les tempêtes de vent sont exploitées par la science et servent des hommes sans noblesse (cf. pp. 346-296), toutefois ce modèle de mortification est celui-là seul qui érige les êtres de la force, les hommes de volonté qui découvrent aussi bien la joie de se surmonter, de se dépasser, fût-ce au travers d’une ambition possiblement fatale, que celle de créer des valeurs nouvelles. À vrai dire tout le vouloir est là : il réside dans l’esprit de celui qui devient créateur et qui tourne le dos aux vieilles rengaines. Certains ont eu la tentation de dénoncer une entreprise individualiste au regard des recommandations de Nietzsche, mais c’était ignorer que la réévaluation du monde par le biais d’une élaboration de valeurs innovantes, aussi bien d’ailleurs que la revalorisation de soi, prédisposent à la liaison la plus absolue avec l’humanité, avec cette idée centrale qui consiste à remettre le vivant d’aplomb, à se faire l’ambassadeur d’un plaidoyer du mouvement (cf. p. 621), à pouvoir dire joliment que «le cosmos est mon campement» (p. 621), à pouvoir constater dans la violence inouïe d’un vent l’occasion de la vaincre et de réadapter le morituri te salutant en «Furvent, ceux qui vont mûrir te saluent !» (p. 672). On pourrait voir dans ces conduites la nature d’une ordonnance pour le corps fiévreux du monde entier, avec l’espoir d’apercevoir à l’horizon la silhouette du médecin-philosophe, car il n’y a que lui qui serait à même de guérir la Terre de ses épidémies de somnolence.
L’audace de la Horde et les risques qu’elle encourt la différencient de fond en comble de ceux qu’on appelle les Abrités, autrement dit les sédentaires, les malades, les troupeaux qui existent en fonction d’un ascétisme contre-productif parce qu’ils n’ont peut-être pas accepté de tuer l’ancien Dieu et de le relocaliser dans le Vent. Ce sont ceux qui existent en quelque sorte «assis», dans la confiance technologique, dans le confort intellectuel des valeurs qui permettent encore d’ajourner les questions posées par le vent. Les Abrités entretiennent la mémoire d’un passé peu dynamique, ce qui n’empêche pas la Horde de leur venir en aide, lorsque des hameaux ont été dévastés par un souffle qui eût exigé d’autres réflexes, d’autres manières de savoir et de sentir (cf. pp. 645-4). Il ne fait aucun doute que le surnombre des Abrités prouve que les forces réactives ont triomphé dans le monde, tout comme il n’est pas douteux que ces densités de populations soient condamnées au ressentiment, aux regards en arrière qui s’affligent et à l’esprit de vengeance, esquichées dans la droite conception d’un temps qui s’initie dans la Création et qui s’achève dans le Jugement Dernier, sans aucune espèce de marge de manœuvre qui revendiquerait un temps fort, un intervalle, un appel d’air qui impliquerait une élévation des aspirations et le recueillement de plusieurs inspirations libératrices. Pour
05/08/2015 | Lien permanent
Le Salut par les Juifs de Léon Bloy

 Israël dans la Zone.
Israël dans la Zone. Léon Bloy dans la Zone.
Léon Bloy dans la Zone.«Ici, les riches, chrétiens ou non, sont atroces. Nos juifs eux-mêmes, nos puissants juifs n'ont pas compris que l'auteur du Salut par les Juifs avait poussé en faveur de leur nation le plus grand cri qu'on ait entendu depuis le commencement de l'ère chrétienne.»
Léon Bloy, Correspondance 1900-1914 Léon Bloy Josef Florian (L'Âge d'Homme, coll. Correspondances, 1990), lettre du 2 décembre 1900, p. 18.
Les toutes premières lignes du Salut par les Juifs de Léon Bloy sont la preuve accablante que l'antisémitisme, malgré ses innombrables transformations historiques, présente des caractéristiques constantes. Changez ainsi, dans les lignes qui suivent, «M. Drumont», appelé par Bloy «l'acéphale contempteur de Sem» (p. 39) par «M. Soral» ou bien, puisqu'il s'agit de lui, «Alain Soral», et vous serez convaincus par mes dires : «SALUS EX JUDÆIS EST. Le Salut vient des Juifs ! J'ai perdu quelques heures précieuses de ma vie à lire, comme tant d'autres infortunés, les élucubrations antijuives de M. Drumont, et je ne me souviens pas qu'il ait cité cette parole simple et formidable de Notre-Seigneur Jésus-Christ, rapportée par saint Jean au chapitre quatrième de son Évangile» (1).
L'une de ces caractéristiques constitue, du moins pour un catholique qui, en dépit de toute évidence, haïrait les Juifs, la preuve irréfutable de sa stupidité intellectuelle, puisque tous les livres antisémites se réfutent en une seule phrase : «Le Christ était juif». Nous ne savons pas si Alain Soral est, sans même penser à un catholique de combat, un tout banal catholique, et ne pouvons donc affirmer qu'il serait, en toute rigueur, un magnifique exemple de crétin particulièrement prolixe, même s'il est vrai que le beau et surtout très efficace travail de Frédéric Dufoing pourrait à tout le moins nous laisser penser que Soral, penseur auto-proclamé pour pré-adolescent à intelligence infundibuliforme, ne sait absolument pas penser, ou alors pense comme il boxe, en faisant la danseuse, c'est-à-dire le malin. Mais faire le malin, face à un livre comme celui de Léon Bloy, c'est assurément risquer de voir se dissoudre les comiques prétentions à la réflexion de Soral, comme les moucherons des pissotières sont dissouts par un seul rayon de lumière selon Rimbaud.
C'est en 1892 que le livre de Léon Bloy a été publié, par Adrien Demay, commissionnaire en librairie et ami de l'auteur depuis plusieurs années. Je doute fort que l'ouvrage de Bloy ait marqué les esprits au point de leur faire renoncer aux amphigouris très largement distribués de Drumont, qui à l'époque était très lu. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1906 que Le Salut par les Juifs sera réédité, avec une préface datée du 19 novembre 1905 dans laquelle Léon Bloy affirme que son livre «est sans aucun doute, le témoignage chrétien le plus énergique et le plus pressant en faveur de la Race Aînée, depuis le onzième chapitre de Saint Paul aux Romains» (p. 346). Ces termes reprennent le prospectus d'éditeur qu'Adrien Demay avait joint, en 1892, au livre, et où nous pouvons lire ces phrases qui elles-mêmes sont sans la moindre ambiguïté : «L'auteur franchement hostile aux antisémites dont il démontre le néant intellectuel, ne craint pas de prendre parti pour la race d’Israël, au nom des intérêts les plus hauts, et il va jusqu'à prétendre que le salut du genre humain est solidaire de la destinée des Juifs. Ce livre où Léon Bloy, si connu pour son éloquence extraordinaire, paraît s'être surpassé, sera sans doute regardé comme la réponse la plus directe aux agressions injurieuses dont l'Église catholique, elle-même, condamne les emportements» (p. 345).
La ligne de défense (et surtout d'attaque, car il ne peut renier sa nature et il est molosse féroce avant que d'être agneau) de l'écrivain est donc ici clairement tracée : l'antisémite, celui qui hait le Juif parce qu'il est Juif, ne peut que haïr le Juif Jésus-Christ et, nous le verrons, parce que ce dernier est le Pauvre par excellence, l'antisémite est donc finalement celui qui hait le pauvre, alors même qu'il dénonce la puissance financière de la communauté exécrée. Qui hait le Juif hait donc Léon Bloy, voilà l'idée jamais clairement exposée qui innerve la prose exubérante du Mendiant ingrat, et qu'il indiquera très clairement et de fort belle façon à une de ses correspondantes, qui s'étonnait des pages que l'écrivain consacra au poète juif Rosenfeld dans Le Sang du Pauvre, ce très grand livre qui poursuit la méditation sur l'Argent : «écrivant un livre sur le Pauvre, comment aurais-je pu ne pas parler des Juifs ? Quel peuple est aussi pauvre que le peuple juif ? Ah ! je sais bien, il y a les spéculateurs, les banquiers. La légende, la tradition veulent que tous les juifs soient des usuriers. On refuse de croire autre chose et cette légende est un mensonge. Il s'agit là de la lie du monde juif. Ceux qui le connaissent et le regardent sans préjugés savent que ce peuple a d'autres aspects et que, portant la misère de tous les siècles, il souffre infiniment. Quelques-unes des plus nobles âmes que j'ai rencontrées étaient des âmes juives», écrit-il ainsi à la date du 2 janvier 1910 dans son Journal (t. III, Le Vieux de la montagne, Le Pèlerin de l'absolu, Mercure de France, 1963, p. 129).
La suite de cet article figure dans Le temps des livres est passé.
Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici.
28/11/2019 | Lien permanent
La monnaie des défaites : Renaud Camus, Richard Millet, cœurs brûlants dans une fumée de mots

 Richard Millet dans la Zone.
Richard Millet dans la Zone. Renaud Camus dans la Zone.
Renaud Camus dans la Zone. Contre Alain Soral, par Frédéric Dufoing.
Contre Alain Soral, par Frédéric Dufoing. La lecture de l'ouvrage absolument passionnant de Jeannine Verdès-Leroux intitulé Refus et violences (1) doit être vivement recommandée à celles et ceux qui penseraient, bien à tort, que quelque chose a changé fondamentalement en France depuis la période de l'entre-deux guerres qui fut immédiatement suivie par celle de la Seconde Guerre mondiale.
La lecture de l'ouvrage absolument passionnant de Jeannine Verdès-Leroux intitulé Refus et violences (1) doit être vivement recommandée à celles et ceux qui penseraient, bien à tort, que quelque chose a changé fondamentalement en France depuis la période de l'entre-deux guerres qui fut immédiatement suivie par celle de la Seconde Guerre mondiale.L'atmosphère de notre époque, que nous pourrions caractériser comme étant une espèce de déflation générale des esprits, absolument pas compensée par la nullité profonde, intellectuelle, politique, viscérale même, de nos hommes politiques, est assez comparable à celle qu'analyse méticuleusement l'historienne, en citant précisément et d'abondance les textes et les auteurs de ces années-là, années qui continuent d'alimenter, comme une nappe souterraine contaminée moins profonde qu'on ne le pense un cours d'eau en apparence calme, les nôtres.
Lisons ainsi Maurice Blanchot, à l'époque où il n'était pas encore devenu le gourou éthéré et reclus des universitaires poussifs et de tous ceux qui, ne comprenant rien à ses études faussement ésotériques ainsi qu'à la littérature qu'il n'a cessé de commenter puis de parasiter, trouvent bon de citer l'un de ses propos énigmatiques et creux entre deux paragraphes de Derrida et d'Agamben : «Il est nécessaire qu'il y ait une révolution, parce qu'on ne modifie pas un régime qui détient tout, qui a ses racines partout, on le supprime, on l'abat. Il est nécessaire que cette révolution soit violente, parce qu'on ne tire pas d'un peuple aussi aveuli que le nôtre les forces et les passions propres à une rénovation par des mesures décentes, mais par des secousses sanglantes [...]. Cela n'est pas de tout repos, mais justement il ne faut pas qu'il y ait de repos. C'est pourquoi le terrorisme nous apparaît actuellement comme une méthode de salut public» (2).
Cette rhétorique volontiers guerrière, d'autant plus surprenante et comme délégitimant tout ce qu'écrirait par la suite de vague et de faussement profond l'apôtre de l'effacement que fut Maurice Blanchot, ne nous étonne guère : elle est exactement celle de la réacosphère, qu'il s'agisse de sites, de blogs ou de forums (et maintenant de pages et de murs sur les réseaux sociaux), et c'est bien évidemment proférer une platitude que de répéter qu'Internet a provoqué ou favorisé, provoqué et favorisé une formidable explosion de ce type de propos, et de bien pires car enfin, n'est pas Maurice Blanchot, qui veut, pour ce qui est de l'écriture en tout cas.
Plus même car, de cette réacosphère aussi peu homogène qu'une chorba oubliée au soleil de midi grouillante de bestioles, nous pourrions affirmer, toutes proportions gardées cela va de soi, ce que l'auteur écrit de la collaboration, qu'elle présente comme «un agrégat de petits milieux», composé non pas d'une seule idéologie, «mais des thèmes faits de haines et de chimères dont chacun se construit une constellation particulière, en en accentuant certains, en en mettant d'autres en sourdine, voire en en occultant d'autres. Les idées des collaborationnistes, c'est le national-socialisme pour certains, et l'antidémocratisme, l'antisémitisme, l'anticommunisme, le pacifisme, le progermanisme, le goût d'un chef, d'une hiérarchie, d'une élite, d'un ordre, un désir de violence, de rééducation, le mépris haineux et puéril de son propre pays» (p. 250).
Description plus vraie que nature, n'est-ce pas, de notre théâtre virtuel rempli d'esprits macérés, de ratés, de grooms et de vieilles grues, de roulures et de paillasses de la réaction, de bouvières maurrassiennes, de rivettes et de gitons camusiens, de bardaches et de folles, de garcettes la culotte perpétuellement baissée entre deux hommes, la croupe ouverte entre deux ruades enrubannées de motifs savamment abscons, description plus vraie que nature de ce sous-milieu d'animalcules animés, en fin de compte, des mêmes intentions que celles qu'Alain Robbe-Grillet prête à son propre père dans Le miroir qui revient (Éditions de Minuit, 1984, p. 242), qui déteste cordialement, la Libération venue : l'inévitable «laisser-aller, la démagogie, le profit individuel, la mascarade parlementaire, la «politique du chien crevé» [...] et la dégradation française», à laquelle un Maurras cru pallier en se mettant sans beaucoup d'hésitations aux ordres de Pétain, garant, lui au moins, d'une forme de gouvernement rappelant la monarchie et, surtout, osant secouer la Judée comme il disait.
J'ai bien des fois écrit que celles et ceux qui, le plus souvent derrière des pseudonymes ou, version doublement apeurée de ces poltrons, des noms de plume, écrivaient des propos racistes, suprématistes, antisémites, n'étaient que des lâches ou, pour le dire avec Jeannine Verdès-Leroux, des «littérateurs», des «semi-intellectuels qui cherchent leurs émois dans «la politique» [et qui] savent, au fond, de manière sourde, qu'ils ne sont pas les vrais, importants écrivains, intellectuels» (p. 33). Ainsi, il me semble que le jugement que Jules Romains prête à Georges Mandel sur Charles Maurras pourrait bon an mal an parfaitement convenir à un Renaud Camus : «Il n'est pas très dangereux parce qu'il n'est pas un homme d'action, parce qu'il est le contraire d'un tribun ou d'un entraîneur d'hommes, parce qu'il se nourrit de phrases, parce qu'il a peur du danger» (3).
Renaud Camus, combien de divisions ? Fort peu à vrai dire, l'essentiel de sa grosse centaine de lecteurs français (je ne sais rien de ceux de Navarre) étant constituée de vieux grisons et de rombières quasiment momifiées, de petites pédales plus ou moins déclarées amatrices de musique de chambre, de Lolitas creuses qu'attire son goût pour l'art contemporain et la politesse proverbiale du Châtelain de Plieux et qui sont pressées, pour une ou deux nuits, de se dénicher un amant qui les sodomisera oui mais, en levant le petit doigt je vous prie, à moins qu'elles ne se cherchent, entre deux galipettes ou pas même divorcées de leur cher époux, l'homme de leur vie qui les comblera de bonheur, d'extase et de marmots, de bonnes femmes intouchables tellement elles sont laides, pseudo-intellectuelles s'extasiant devant son usage du point-virgule, et de quelques déclassés, le plus souvent d'une laideur frôlant la caricature, qui enroberont leur racisme et leur antisémitisme banals d'une gaze d'innocence, pardon, de non-nocence. La peur, une ignoble trouille, voilà ce qui constitue l'unique ciment liant cette théorie disparate de demi-soldes de la réflexion politique et de vivandiers de la France éternelle s'enthousiasmant de combats jamais menés, la grande peur de Renaud Camus pouvant ressembler, pour ce que j'en sais, à celle que confia Drieu dans son Journal, en juin 1944 : «J'étais faible, profondément faible. Fis de petits-bourgeois peureux, pusillanimes. Je rêvais dans mon enfance d'une vie lente, confinée. J'ai toujours eu peur de tout. Mais il y avait un autre homme en moi qui rêvait de plaies et de bosses, comme chez la plupart des petits-bourgeois. Mais le «goût» de la force ne pouvait plus s'exprimer chez moi qu'intellectuellement» (cité par l'auteur, p. 222, je souligne).
Que cherche donc Renaud Camus ? Les demeures françaises et étrangères où se nicherait l'esprit des vieux maîtres et leur si inimitable style de vie ? Une France préservée des laideurs publicitaires et des horreurs solécistiques détruisant la grammaire ? Un pays offrant quelques centaines de milliers de billets retour, pour commencer, à toutes ces racailles qui osent le traiter de petit Gaulois et le toiser de haut lorsqu'il monte dans une rame de métro parisien ? Les consonances juives des noms des journalistes de France Culture, réminiscence étonnante du jeune Maurras débarqué à Paris en 1885, et s'étonnant de la présence un peu trop voyante à son goût des «lettres juives» envahissant les enseignes commerciales chargées de noms en K, W et Z : «Les Français étaient-ils encore chez eux ?» (Au signe de Flore, Grasset, 1933, p. 31; l'auteur souligne), propos qui exsude littéralement de la moindre ligne écrite par l'auteur ? Renaud Camus cherche-t-il aussi une société enfin débarrassée, comme il nous le dit lorsque j'osai lui rappeler quelque terrible vérité historique ayant pour nom l'extermination, du poids insupportablement mémoriel des Juifs réduits par millions en cendres ? Renaud Camus se cherche, avant tout, un maître bien vivant, et qui le rudoie, et qui le soumette, au charisme duquel, au sens que Jean-Luc Evard a donné à ce terme, il faut à tout prix succomber en faisant mine de résister car, ma foi, une coquette a toujours de ces prétentions-là, et ne peut consentir à céder au vertige de la prise qu'à l'unique condition d'estimer qu'elle a tout fait pour résister au délicieux ravissement. Il est tout de même étrange que l'écrivain français dont la vie quotidienne, méthodiquement exposée dans ses innombrables volumes de journaux, est l'une des plus plates qu'il m'a été donné de lire, soit, pour un certain nombre de ses lecteurs, le synonyme enthousiasmant de la vitalité de penser et, qui sait, d'agir. Ces jeunes camusiens, comme il est comique tout de même de les voir récuser «un régime qui n'offre à la ferveur de jeunes Français que le frigidaire et l'automobile» si platement démocratiques, selon la réponse donnée à Philippe Ariès dans L'Esprit public (juillet-août 1961, p. 21) au nom d'un pantouflard qui n'a jamais hésité à décrire en 200 pages un problème de tuyauterie domestique bouchée, voire de couille gauche affreusement pendante, défigurant la fière tenue générale, malgré un usage intensif si l'on en croit lesdits journaux, d'un autre type de robinet.
Ces semi-intellectuels, ces nonistes transis (non aux Arabes, aux Noirs, aux Juifs, aux conspirations financiaro-tsahalistes, aux panneaux publicitaires, à la vulgarité, au remplacisme, à l'immigration, etc.) que sont Renaud Camus, Richard Millet, Alain Soral, Marc-Édouard Nabe, Alain Finkielkraut de plus en plus, à mesure qu'il journalise sa pensée, le pullulement des barbouilleurs de Causeur, des échotiers du Salon beige, de NOVOpress, des rubricards des Nouvelles de France, les plumeux à sextuple pseudonyme de tant d'autres petits cloaques haineux où le talent est plus rare qu'un Arabe ou un Noir maurrassiens, sont indirectement le sujet de cette note, comme ils constituent celui de l'auteur, selon ses propres termes (cf. p. 33).
Certes, ils nous répéteront, ces petits blancs malaimés et méprisés dans leur propre pays, que l'époque est à la violence, devant le vide politique, la faiblesse, sur la scène internationale, de la France, la paupérisation sociale qui s'y accélère, l'irresponsabilité et l'incurie des différents gouvernements qui se sont suivis depuis quelques dizaines d'années déjà. Ils parleront même de décadence et, pour les plus érudits d'entre eux (mais il y en a si peu, dans cet attroupement de faibles geignards), citeront un grand livre aujourd'hui oublié et paru en 1979, Politique étrangère de la France, La Décadence. 1932-1939 (4). L'auteur pouvait ainsi y écrire des mots encore valables aujourd'hui, moyennant la prise en compte évidente d'un changement de contexte historique : la France, «privée d'une partie de ses élites morales par le carnage de 1914-1918, n'a pas su trouver les hommes qui auraient pu infléchir le destin» (5). Des hommes, en 2013 ? Des commis, des énarques, des technocrates, des idéologues, des intellectuels, des littérateurs, des bonnes femmes, mais pas d'hommes ou alors, qu'on me les désigne du doigt et qu'ils osent sortir du rang !
Si les mots ont un sens, nous devons leur prêter une grande attention, et trouver ainsi pertinente la distinction que l'auteur opère entre certains de ces auteurs de l'entre-deux guerre, comme Maurice Blanchot mais aussi Thierry Maulnier, qu'il range dans la catégorie des nationaux-révolutionnaires (6), et les autres, la tourbe quasiment indistincte des collaborateurs enragés, dont Brasillach (7) ou l'antisémite démentiel, le haineux Céline («Une immense haine me tient en vie. Je vivrais mille ans si j'étais sûr de voir crever le monde», écrit-il ainsi dans une lettre à Albert Paraz, cf. p. 257), l'immonde Maurras sont les parangons.
Pourtant, force est de constater que Jeannine Verdès-Leroux ne cesse de s'interroger sur son sujet même, point aisément qualifiable : comment des hommes ont-ils pu, à force de mots, pouvoir désirer l'éradication des Juifs de France (8) et même d'Europe, comment «concilier cette volonté de changer le monde avec la volonté d'être minoritaire, à contre-courant» ? Et d'ajouter : «Ces énoncés renvoient plus aux angoisses, aux refus, à une envie d'échapper à l'étreinte du monde (l'auteur cite Thierry Maulnier) qu'à une explication de choix politiques» (p. 88). Et Jeannine Verdès-Leroux, de caractériser assez bien la nébuleuse extrémiste française de cette époque lorsqu'elle écrit : «Ils rejettent avec violence, insolence, la démocratie, le présent, et en appellent à un «homme nouveau»; ils suivent de manière qui leur paraît irrésistible une Histoire européenne, une flamme qui s'allume un peu partout en Europe, les images de cette flamme à qui la guerre d'Espagne a donné «leur pouvoir d'expansion, leur coloration religieuse» [comme l'écrivait Brasillach]. Bien sûr, certains, éblouis par cette flamme, évitent de voir, ou d'apercevoir, bien des épisodes, des actes, des cruautés du fascisme, tandis que d'autres (comme Rebatet) voient et aiment les camps et les férules... Il faut remarquer enfin que ces fascistes français n'avaient pas de chef, élément pourtant crucial d'un vrai fascisme» (p. 104).
Pas de chef, là est toute la question, nous l'avons dit. Ces hommes, nos hommes actuels se cherchent un chef, la trace d'un charisme aujourd'hui disparu, l'étreinte d'une foule où se fondre, dont suivre les mouvements, profonds et invisibles, qu'on dirait être ceux qui animent une puissante vague, mais ne le trouvent pas, car, derrière les paravents intellectuels de leurs adhésions plus ou moins sincères, se cache l'envie d'être conduits, d'être les serviteurs de ce qu'ils considèrent comme étant un grand homme (ou une grande femme; n'oublions ainsi pas que Renaud Camus a appelé à voter pour Marine Le Pen lors des dernières élections présidentielles) : «La force des attachements à ces régimes qui apparaissent à un individu ordinaire uniquement haïssables et redoutables ne s'explique jamais par des intérêts matériels ou une adhésion à des idées» (p. 109, l'auteur souligne).
Parmi tant d'autres comme Gustave Le Bon ou Armand Robin, Raymond Abellio, a magnifiquement décrit ce mouvement de vassalisation, en lui conférant une dimension sexuelle troublante : «Si l'on voit dans tout remuement de foules un acte sexuel, il en est de son issue, quand la fièvre de l'éloquence retombe, comme d'un orgasme : si l'amour, des deux côtés, a été réussi, on entre de régions inconnues mais sacrées, où cohabitent une ardeur et un effroi qu'on ne domine ensemble, après, que par le respect. [...] Et certes, il reste un prix à payer. Autant la descente de l'homme est facile, car l'espèce est toujours ouverte à qui vint à elle, autant le retour de l'homme à lui-même est difficile, et il faut payer ce retour. C'est Orphée remontant des Enfers en y laissant son Eurydice. Il en est alors de l'orateur, quand il cesse de parler, comme de l'amant se retirant du corps de sa maîtresse et posant sur elle un regard de trop, un regard d'amant mais à nouveau un regard d'homme, un regard en arrière qui ne sait pas se perdre dans la distance infinie de l'arrachement et revient en tremblant sur lui-même» (9).
La question sous-jacente de la très belle étude de Jeannine Verdès-Leroux est celle de l'impact réel de paroles extrêmes sur les actions politiques et même, plus largement, sur le climat intellectuel d'un pays. Car, s'il est évident qu'un «Zola solitaire n'aurait pas changé le sort du capitaine Dreyfus», si les «intellectuels qui lançaient des appels et des condamnations, dans L'Insurgé ou L'Émancipation nationale et autres journaux, savaient bien l'absence d'effets de leurs actions», puisque des «écrits n'ont du poids que quand ils reprennent, amplifient, martèlent des opinions diffuses» et qu'ils ont du succès parce qu'ils «épongent des réactions, des sensibilités, des intolérances et leur donnent forme, jamais quand ils «inventent» une pensée, jamais quand ils sont singuliers», nous devons toutefois admettre que ce type d'écrits ou de paroles «auront de l'effet sous l'occupation quand ils reprendront des préjugés, des peurs, des égoïsmes, des réflexes bas, leur donnant ainsi un statut» (p. 123, l'auteur souligne). L'écrit, ici, est considéré comme la caisse de résonance de pensées plus ou moins consciemment acceptées, dévoilées au grand jour, et qu'un homme doué d'une perception aigüe du mal, comme le mystérieux Prince des Harmonies Werckmeister ou le Marius R
12/01/2014 | Lien permanent
Le Grand Remplacement suivi de Discours d'Orange de Renaud Camus

 Richard Millet dans la Zone.
Richard Millet dans la Zone. Renaud Camus dans la Zone.
Renaud Camus dans la Zone. Langages viciés.
Langages viciés.Le Grand Soubassement de la position politique camusienne ou un peu d'histoire française ne nous fera pas de mal
C'est dans un texte, intitulé La droite révolutionnaire entre les anti-lumières et le fascisme et ajouté en guise d'introduction à son étude désormais classique quoique contestable, La droite révolutionnaire, que Zeev Sternhell affirme qu'il existe une spécificité française du fascisme : selon l'historien, notre pays a constitué «le véritable laboratoire idéologique du fascisme en tant que phénomène européen» (1). La conclusion de cet ouvrage, bien plus utile, pour comprendre ce qui est en train de se tramer dans la France contemporaine, que les élucubrations complotistes du ridicule Alain Soral, les analyses aigries de Café du Commerce d'Alain Finkielkraut, les renvois de bile et les montées de chaleur égotiste de Richard Millet, les stupidités néo-darwinistes de Laurent Obertone, bien plus important encore que les aperçus rien de moins que sommaires de Renaud Camus lui-même, sur la situation de notre pays menacé par le double séisme qu'il appelle la Grande Déculturation et le Grand Remplacement, la conclusion du livre de Zeev Sternhell insiste donc sur la spécificité française du fascisme enraciné de longue date sur notre sol, et qui ne doit finalement pas grand-chose à son prétendu modèle transalpin : «Le fascisme de l'entre-deux-guerres ne fait, en réalité, que reprendre et développer, en les adaptant aux conditions nouvelles, les éléments essentiels de la révolte du tournant du siècle» (p. 544). L'auteur n'hésite même pas à affirmer que le fascisme français ne doit finalement rien du tout au fascisme italien, et que c'est même l'inverse qui est exact, le fascisme français pouvant être considéré comme une espèce de matrice des fascismes européens : «Le fascisme français se présente ainsi comme un phénomène autonome, possédant ses propres racines et ne devant rien à l'étranger. Si imitation il y a, c'est de la part des Italiens, y compris Mussolini, venus chercher l'inspiration chez les syndicalistes révolutionnaires et les nationalistes français» (p. 548), la «littérature fasciste de l'entre-deux-guerres» représentée par les textes de Drieu, Brasillach, Rebatet ou Céline, n'ayant du reste que «fort peu de chose à ajouter aux thèmes développés par Barrès, Le Bon, Drumont, Berth ou Sorel. Mis à part le motif ancien combattant et les références à Rome ou à Berlin, on croirait avoir sous les yeux une version modernisée du Testament d'un antisémite ou des Cahiers du Cercle Proudhon» (p. 549).
L'auteur affirme dans le corps de son ouvrage que ce sont les idées développées par trois des adversaires les plus farouches des Lumières, Taine, Renan et Nietzsche, qui seront réutilisées par leurs continuateurs désireux de lutter contre la démocratie (cf. p. 29), idées formant dès lors le terreau d'une nouvelle droite, distincte des trois droites qu'analyse René Rémond dans ses Droites en France, et qu'il appelle la droite révolutionnaire : «Cette droite populaire, parfois prolétarienne mais violemment antimarxiste, sécrète un nationalisme de la Terre et des Morts, de la Terre et du Sang. N'est-il pas étrange de voir en ce phénomène nouveau, pur produit de la crise de conscience du tournant du siècle, des profonds changements qui affectent la société, une forme de bonapartisme ? Cette droite nouvelle répond à des besoins intellectuels, sociaux, psychologiques, que le bonapartisme, produit de la société pré-industrielle, n'entrevoyait même pas. Le bonapartisme manque de ces deux ingrédients essentiels : le radicalisme antimarxiste et le nationalisme organique, à caractère biologique» (p. 45).
Poursuivons l'évocation de l'analyse de l'historien qui affirme que c'est précisément parce que «le fascisme ne représentait qu'une forme radicalisée des aspects majeurs de la révolte contre les Lumières, parce qu'il était tout d'abord un phénomène de culture qu'il a pu exercer l'attrait qui fut le sien. Cette révolte débouche le lendemain de la Grande Guerre et à la suite des crises des années vingt sur un véritable cataclysme. Le fascisme, le nazisme et en France la révolution nationale de Vichy ne constituent pas des révolutions politiques : les trois régimes entendent façonner une autre civilisation, une autre société et un autre homme» (p. 46). Ainsi le fascisme, que l'on ne s'y trompe pas, est un mouvement d'abord révolutionnaire, dans le sens où il prétend être le «générateur d'une civilisation nouvelle qui remplacerait complètement la civilisation libérale et bourgeoise, rationaliste et individualiste», un Marcel Déat pouvant reprendre «mot pour mot», et «très probablement sans le savoir», «les critiques que formulait déjà la génération de 1890, en s'attaquant au «libéralisme économique qui est un matérialisme bourgeois auquel fera pendant le matérialisme ouvrier du marxisme, tous deux incontestablement fils du rationalisme» (p. 549), ou un Déat stigmatisant ce rationalisme, ajoute Zeev Sternhell, «bardé de fer et chargé de catastrophes» qui est un «refus de tout aristocratisme, négation de la hiérarchie, négation de la personne, négation de l'État en tant qu'outil de la communauté». C'est contre ce «vieux monde des droits naturels, poursuit Sternhell, de l'individualisme, des menaces anarchiques, de la matière et de la raison que se lève le fascisme» (pp. 549-50).
Ces quelques lignes nous montrent par avance que, si la pensée de Renaud Camus peut être caractérisée, bien que difficilement nous le verrons, comme une réaction à connotation xénophobe davantage que raciste, elle n'est pas spécifiquement fasciste, même si elle est d'accord avec certaines des thèses fascistes, notamment telle forme d'organicisme, dans lequel nous pourrions inclure la doctrine barrésienne de la Terre et des Morts, mais aussi, à quelques réserves près sans doute concernant la parenté de sang et la négation de la liberté individuelle (encore que...), les «principes de la subordination absolue de l'individu à la collectivité, la négation de son autonomie» (p. 553), ou encore la notion de communauté vivante, «où la fraternité abstraite, nous explique Marcel Déat dans Pensée allemande et Pensée française (Aux Armes de France, 1944), est remplacée par la parenté du sang».
Que manque-t-il donc à Renaud Camus pour que nous puissions affirmer clairement que sa pensée serait d'inspiration fasciste ? C'est très simple : le culte de la force ou, comme l'écrit encore Drieu, «la brutalité, le simplisme barbare d'un moderne» (p. 546). Toutefois, si j'étais méchant ou inconscient allez savoir, suivant le modèle de Patrick Buisson (voir 1940-1945 : années érotiques. Vichy ou les infortunes de la vertu, Albin Michel, 2008), je m'aventurerais dans le domaine fort mouvant de la psychanalyse à prétentions historicisantes, et analyserais en conséquence bien des textes de Renaud Camus dans le sens d'une volonté, d'un espoir, d'un phantasme si typiquement homosexuels de soumission, donc de l'exigence, a contrario, d'un homme fort qui mate la racaille et les forts en gueule. J'épargnerai bien évidemment ces fadaises à mes lecteurs. Si la pensée politique de Renaud Camus, ou ce qui passe pour tel dans l'esprit de ses zélateurs, ne peut être définie comme étant fasciste ou fascisante, son horizon plus ou moins conscient, lui, peut l'être.
Plutôt que du fasciste, Renaud Camus pourrait être rapproché de l'image traditionnelle du conservateur, telle que la raille Brasillach, pour bien montrer, là encore, tout ce qui sépare la figure bourgeoise de ce dernier de celui qui n'a plus rien à perdre, le fasciste justement, qui ne veut rien conserver et tout détruire, pour bâtir un nouvel ordre : «Nous sommes très mal élevés. Nous savons qu'il faut de l'argent pour vivre et nous avons horreur des ascètes, mais nous n'aimons pas l'argent pour l'argent. Nous n'avons pas grand-chose de commun entre nous malgré les apparences, M. le conservateur. Nous défendons quelques vérités comme il nous paraît qu'on doit les défendre, c'est-à-dire avec violence, avec fougue, avec irrespect, avec de la vie. Cela vous a été parfois utile, M. le conservateur. Cela vous le sera peut-être un jour encore. Aux moments où vous pensez n'avoir pas besoin de ces compromettants gardes du corps, vous préférez parler d'autre chose et les regarder de très loin. Ils courent leurs risques à eux, n'est-ce pas ? Cela ne vous concerne pas. Vous l'avez bien dit, M. le conservateur. Leurs risques à eux. Pas les vôtres. Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous ne sommes pas les troupes de choc des bien-pensants. Nous ne sommes pas les SA du conservatisme» (pp. 545-6).
Conservateur, ou, c'est tout un selon Brasillach, bien-pensant, Renaud Camus ? Nous y reviendrons, car ces distinctions ne sont bien évidemment claires qu'en apparence. Revenons à la thèse de notre historien. En somme, si le fascisme a pu pénétrer de façon indéniable la société française (Sternhell va plus loin et parle de l'ensemble de l'Europe), c'est parce qu'il ne fait que «traduire en termes politiques, grâce à toutes les techniques de la politique moderne, un ensemble d'idées d'une respectabilité sans faille» (p. 49) comme la lutte contre les Lumières, le libéralisme, la démocratie, le socialisme, le communisme bien sûr et, en un mot qui fit alors florès et sonna comme une insulte à cette époque, le matérialisme.
Pour combattre le «désordre établi», concept forgé par Emmanuel Mounier dans les années trente, un certain nombre d'intellectuels n'hésiteront pas à soutenir le régime de Pétain qui, une fois encore nous répète Sternhell, ne constitue pas une aberration dans la continuité des régimes politiques français mais apparaît bel et bien comme le couronnement politique d'un foisonnement d'idées en lutte contre celles, si corruptrices selon nos penseurs, Rousseau bien sûr mais aussi Kant, des Lumières : «C'est la profonde conviction que la victoire nazie consacrait l'infériorité morale et intellectuelle de la culture des Lumières et de la Révolution française qui rend la Révolution nationale possible. Vichy en France, comme le fascisme en Italie et le nazisme en Allemagne, ne devient intelligible que si l'on considère la Révolution nationale comme le couronnement d'un affrontement continu entre deux écoles intellectuelles faisant partie au même titre du patrimoine culturel européen et français. Ce qui explique la grande maturité des idées mises en œuvre pendant les vingt années qui séparent les deux guerres mondiales. En France, Vichy ne représente ni un accident de parcours ni une aberration. Certes, jamais la contestation «antimatérialiste» ne parvient en France à prendre le pouvoir en période de paix et de stabilité. Aussi longtemps que le pays n'est atteint par aucune crise majeure, aussi longtemps que la croissance économique, si faible soit-elle, suffit pour assurer l'emploi aux ouvriers et un pouvoir d'achat raisonnable à la petite bourgeoisie, les forces contestataires sont condamnées à végéter. Aussi longtemps qu'aucune défaite militaire ne vient ébranler la relative stabilité dont jouit le pays, le consensus républicain condamne les révolutionnaires à l'impuissance. Il en est ainsi en France, comme en Allemagne et en Italie, jusqu'au jour où les conditions de crise, de désarroi, de frustration et d'humiliation fournissent ses troupes à l'idéologie révolutionnaire. Dans les trois pays, l'idéologie de rupture mise en place de longue date ne parvient à occuper la scène politique qu'au moment où elle s'articule sur une profonde crise nationale» (pp. 64-5).
Si j'ai pris le soin de citer longuement cet extrait, c'est bien évidemment parce que le mécanisme qu'il détaille est encore parfaitement valable de nos jours, qu'il nous semble même plus valable que jamais, si nous tenons compte de la paupérisation accélérée du pays, à laquelle s'ajoute, fait incontestablement nouveau par son ampleur, la volonté inébranlable du pouvoir socialiste en place de modifier profondément les comportements et (même, sans doute, in fine), les coutumes et les croyances des Français, par le biais de plusieurs réformes dites sociétales, et qui sont bien sûr, d'abord, profondément idéologiques, cassent en tout cas les derniers liens familiaux, symboliques, nationaux, qui cimentaient un peuple totalement méprisé et, nous le constatons chaque jour, profondément divisé.
Le reste de l'ouvrage de Zeev Sternhell, qui évoque différents mouvements populistes, le plus souvent de gauche, comme le boulangisme sur lequel vint se greffer Barrès (2), mouvement populaire symbolisant les «débuts de la politique des masses dont il a accéléré sérieusement la mobilisation politique» (p. 50) qui éclot pendant une époque troublée comme l'est la nôtre (3), ne concerne pas directement notre propos, même s'il nous semble patent que bien des groupuscules politiques actuels pourraient faire leur le programme de ce mouvement contestant l'ordre libéral, tel que l'auteur le présente : «Au parlementarisme, les boulangistes opposent le culte du chef, à la prétendue incohérence des institutions, le sens de l'autorité, au capitalisme, une certaine forme de populisme appuyé sur un paroxysme verbal antibourgeois destiné surtout à mobiliser les couches populaires» (p. 79). À peu de choses près, le clown Soral pourrait être qualifié, selon cette définition donnée par Sternhell, de Boulanger au rabais.
De la même façon, c'est avec Déroulède et sa fameuse Ligue des patriotes que, selon l'auteur, «le nationalisme se présente, tout d'abord, comme une révolte contre la démocratie, une critique négative de la faiblesse, de l'incohérence et du caractère impersonnel du régime. En outre, ce nationalisme populaire, autoritaire et antiparlementaire est aussi un nationalisme des rancœurs contre les riches et les injustices économiques; il s'en prend non seulement à la démocratie libérale en tant que régime politique, mais aussi au type de société qu'elle met en place, il exige une réforme de l'État et, en même temps, il s'attaque, au nom de la solidarité du groupe-nation, aux injustices sociales» (p. 101).
C'était l'époque, aussi, et ce point est essentiel selon Zeev Sternhell, où les foules prenaient conscience de leur poids politique. Comme Gustave Le Bon le répète dans sa célèbre Psychologie des foules (4), il faut toujours faire usage «d'une image saisissante», il faut «présenter les choses en bloc, et ne jamais en indiquer la genèse» (5), car c'est là, selon Zeev Sternhell, «le fondement conceptuel de la théorie des mythes de Sorel, du nationalisme organique de Barrès, tout comme de l'idée selon laquelle «la foule est toujours intellectuellement inférieure à l'homme isolé» (6), qui jouera d'ailleurs un rôle capital dans les débuts de la sociologie. La critique de l'individualisme de la démocratie et de ses institutions, du parlementarisme et du suffrage universel doit énormément, poursuit l'historien, à cette nouvelle vision de l'homme conçu comme un être fondamentalement irrationnel, déterminé par des contraintes historiques et biologiques, motivé par des sentiments et des associations d'images, mais jamais par des idées» (pp. 187-8). Nous sommes là à l'antipode de la position politique, du moins telle qu'il la couche par écrit, de Renaud Camus, amateur se voulant ô combien éclairé de la raison, partant des Lumières, s'adressant, avant qu'à leurs tripes, au cerveau de ses lecteurs, si tant est qu'il en ait.
Renaud Camus, idéologue perclus, meneur sans charisme d'ombres d'ombres xénophobes, châtelain soi-mêmiste pas vraiment fasciste, pas vraiment raciste, pas vraiment maurrassien, pas vraiment barrésien, pas vraiment populiste, bref, pas vraiment grand-chose sinon vraiment camusien, ce qui n'est pas grand-chose tout de même
Les différents éléments que nous venons brièvement d'exposer suffisent à montrer tout ce qui sépare je le disais Renaud Camus des théoriciens et idéologues du nationalisme révolutionnaire, de droite comme de gauche, ayant abouti selon Zeev Sternhell au fascisme non pas hors-sol ou bien importé en France mais bel et bien spécifiquement français. Renaud Camus, tout d'abord, n'aime pas les foules. Nous pourrions même prétendre à bon droit qu'il les hait, sa doctrine de l'in-nocence ne pouvant être, quoi qu'il en dise, que l'apanage d'une élite socio-culturelle non seulement supérieurement cultivée mais disposant encore de loisirs et d'argent pour se cultiver encore plus, lire encore plus, allez voir le plus grand nombre possible d'expositions, voyager autant que possible, bien sûr, et pas seulement en France mais aux quatre coins du globe. Lisez les innombrables périples sexuels avant que de devenir, plus sagement, géographiques et culturels, redites cacochymes du Grand Tour que les jeunes premiers européens popularisèrent jadis, qui jalonnent chacun des volumes de son interminable et ennuyeux Journal; pénétrez-vous de son goût de la beauté, de l'harmonie, de la discrétion, de la politesse, de la solitude, certes entourée de livres et d'une foule de suiveurs plus ou moins orthodoxes; voyez-le, cent fois par page, évoquer la moindre apparition d'un bouton de sébum sur son auguste visage lui-même photographié à longueur d'heure (Le Jour ni l'Heure, n'est-ce pas), de jour, de semaine, de mois et d'année par ses propres soins, bref, imprégnez-vous des textes de Renaud Camus, de son goût pseudo-lévinassien de soi-même comme un autre qui n'est jamais rien d'autre que soi et encore soi, resoi et soisoisoi jusqu
10/03/2014 | Lien permanent
Aux rats des pâquerettes : quand Netchaïev voit rouge, Marc-Édouard Nabe rit jaune
 Marc-Édouard Nabe dans la Zone.
Marc-Édouard Nabe dans la Zone. Sur les Gilets jaunes : J. G. Ballard et Patrick Buisson.
Sur les Gilets jaunes : J. G. Ballard et Patrick Buisson. Bien sûr, ce nouveaux brûlot de Marc-Édouard Nabe, le trente-et-unième de ses ouvrages, n'est absolument pas débarrassé des facilités qui rendent franchement pénible, pour ne pas dire rédhibitoire la lecture de la presque totalité de ses derniers textes : attaques physiques (nous ne comptons plus les gros culs ou même les «gros seins juteux juste avant qu'ils ne soient plus tétables» d'Aude Lancelin, p. 63), les petites ou grandes insinuations de coucheries, les insultes pures et simples, pourtant très drôles lorsqu'elles concernent Alain Finkielkraut, devenu le saint héraut de tous les crétins droituriers (des fins de race terminés à l'eau bénite du Figaro et de Valeurs actuelles jusqu'aux dandys en sucre candi de L'Incorrect en passant par Causeur), notre plus grand penseur journalistique, donc, qualifié de «pleurnichosophe» (p. 66) et de christique «FinkINRI», p. 65 ou de «Finkie-Christ» (p. 30), facilités qui suffiront je le crains à dissuader la plupart des lecteurs, hormis le petit cercle de ses thuriféraires et adorateurs transis, comme tel (ex)-ravi de la crèche nabienne, dans laquelle il n'y a hélas pas qu'un seul âne et beaucoup de moutons.
Bien sûr, ce nouveaux brûlot de Marc-Édouard Nabe, le trente-et-unième de ses ouvrages, n'est absolument pas débarrassé des facilités qui rendent franchement pénible, pour ne pas dire rédhibitoire la lecture de la presque totalité de ses derniers textes : attaques physiques (nous ne comptons plus les gros culs ou même les «gros seins juteux juste avant qu'ils ne soient plus tétables» d'Aude Lancelin, p. 63), les petites ou grandes insinuations de coucheries, les insultes pures et simples, pourtant très drôles lorsqu'elles concernent Alain Finkielkraut, devenu le saint héraut de tous les crétins droituriers (des fins de race terminés à l'eau bénite du Figaro et de Valeurs actuelles jusqu'aux dandys en sucre candi de L'Incorrect en passant par Causeur), notre plus grand penseur journalistique, donc, qualifié de «pleurnichosophe» (p. 66) et de christique «FinkINRI», p. 65 ou de «Finkie-Christ» (p. 30), facilités qui suffiront je le crains à dissuader la plupart des lecteurs, hormis le petit cercle de ses thuriféraires et adorateurs transis, comme tel (ex)-ravi de la crèche nabienne, dans laquelle il n'y a hélas pas qu'un seul âne et beaucoup de moutons. Un autre travers ou tic de langage pourrait être retenu contre l'écrivain furibond : cette manie de trouver ou plutôt de nous faire croire qu'il trouve, généralement à la fin de ses chapitres, telle ou telle métaphore dont il salue lui-même, d'un sourire on le devine, la justesse, comme si, bon prince, il nous permettait d'assister, quasiment en direct, à la fabrique d'une de ses chutes colorées ou bien enlevées. Ce doit être une des vertus de l'auto-édition que d'avoir le privilège d'assister à une séance de pure création verbale, en plus d'éprouver le plaisir de voir le patron de la librairie Le Dilettante vous donner en main propre un exemplaire du livre de Nabe, avec la mine de Moïse rapportant des hauteurs montagneuses les Tables de la Loi. Cela donne : «Il faut se rendre à l'évidence : la démocratie selon les Gilets jaunes, c'est une démocratie Internet, une démocratie deux points zéro. Une internetocratie, en somme. L'Internetocrassie ! La Démocranet...» (p. 78). Chaque fin de chapitre, chaque page même nous montre ce procédé en action, Nabe filant comme pas un la métaphore, jusqu'à ce qu'il finisse par trouver son titre, après quelques hésitations qui, au moins, sont toujours très drôles. Mention spéciale pour cette «ex-sainte Jaune d'Arc» à propos de la «soi-disant pin-up Ingrid Levavasseur» (p. 83), idiote utile de la Macronie dont on s'étonne que Nabe n'ait pas fait davantage usage, tant elle symbolise, petit bout de femme avenante pourtant, tous les reproches que l'écrivain concentre sur le front mou, à ras d'herbe consciencieusement mâchée, des Gilets jaunes.
J'ai aussi lu, ici ou là, que Nabe, incapable du moindre courage physique mais n'hésitant pourtant pas à proposer une nabologie du terrorisme et même à oser défier l'Amazone sollersienne Josyane Savigneau, avait beau jeu de railler les Gilets jaunes qui eux, au moins, manifestent et vont même jusqu'à affronter, pour certains, nos si dignes représentants des forces de l'ordre, au risque d'y perdre tel ou tel de leur membre, comme s'il fallait être aussi chaste qu'un eunuque pour oser parler des relations entre un homme et une femme, comme s'il fallait être courageux tel Gauvain pour peindre des batailles épiques ou picrocholines, comme s'il fallait en somme être un être purement immatériel, sans le moindre péché, avant d'oser écrire ou encore, comme s'il fallait savoir écrire avant que d'oser le faire, impératif catégorique qui aurait au moins l'avantage, s'il était strictement respecté, de débarrasser les étals des librairies de 99 % de leur marchandise avariée. Cette méchanceté qui se veut argument rate sa cible hilare. Ainsi considéré, Nabe, accablé de tous les vices par les imbéciles, y compris de ceux qu'il n'a jamais hésité, comme des bubons, à nous faire exploser sous les yeux, n'aurait pas dû publier, encore moins écrire une seule ligne et, sans bien sûr établir de lien direct entre ce dernier et ceux qu'il admire, que dire de Rebatet ou Céline mais aussi de Dostoïevski qui eux, pour le coup, auraient été condamnés à une éternité de silence ! Je préfère un démon qui sait écrire (mais je ne prends pas Nabe pour un démon) à un saint confit dans ses dévotions et qui s'aviserait de les coucher par écrit.
La littérature pousse sur un sol trouble et le pamphlet, lui, germe spontanément sur un sol tapissé d'une matière plus qu'identifiable, au fumet caractéristique : les prudes, les universitaires, s'ils osent, parleront de fumier, mais le mot merde est tout aussi valable je pense, et convient même bien davantage à la pousse des bambous à bout effilé sur lesquels Nabe se propose d'aligner quelques têtes (1), non seulement celles de ses ennemis habituels (Soral en lécheur de cul des policiers, cf. p. 28, Dieudonné l'habitué des horions, mais aussi quelques petits nouveaux comme le très hanounesque Éric Naulleau qui a droit à cette saillie, du reste absolument justifiée tant ce bon éditeur est devenu un piètre figurant de la fausse impertinence, un mime poussif de la liberté de pensée qu'il a bradée au plus offrant : «En dix ans de télé, le critique littéraire est devenu le pire corporatiste médiatique qui soit : pour Naulleau, s'attaquer à la sainte télé, c'est déjà du fascisme !», p. 27). Ces nullards, tant d'autres que Nabe étrille, méritent tous les coups de trique et tortures bloyennes, donc raffinées, qu'il est possible et même nécessaire d'imaginer, mais ce n'est là que la surface de la flache jaune pisse comme il se doit, que Nabe ne nous expose que pour se donner le plaisir de lancer une sonde qu'il espère vite voir descendre plus bas, beaucoup plus bas, vers une eau bien plus sombre et même franchement noire, qui donne sa puissance corrosive à ce libelle qui prône la dévastation bien davantage qu'une méthodique corrosion démocratiquement recyclacble.
La rage de Nabe s'explique très vite, dès l'exergue en fait, de Jules Renard, lequel affirme qu'il ne faudrait jamais voir la gueule, plutôt laide et même franchement repoussante on l'aura compris, du peuple. Le peuple que Nabe moque dans son texte n'a pas une sale gueule : il n'a tout simplement aucune gueule car, à vrai dire, il n'existe pas. Il croit exister et même vivre, s'agiter, consommer : mais il ne vit pas, bien qu'il consomme à outrance, il est d'ores et déjà dévasté, ainsi que la prétendue plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées saccagés bien avant que quelques vitrines n'explosent par des débarquements de touristes à portables intégrés. Cette inexistence du peuple qui se croit exister est le thème fondamental de notre texte, bien plus que l'opposition assez artificielle entre masse et peuple (cf. p. 35), le premier, seul, étant capable de mener selon l'auteur une révolution, la Révolution. Creusons davantage encore, histoire de descendre le plus bas possible sous terre, au ras de nos pâquerettes ou pissenlits si l'on veut, afin de déterminer l'exacte nature des racines de cette plante toute bardée de piquants, ni pâquerette ni pissenlit assurément, que Marc-Edouard le jardinier nous prévient de ne pas trop venir respirer. La racine qui infuse une sève survitaminée à la belladone nabienne est de nature eschatologique, évidence qu'il ne faut jamais craindre de rappeler à celles et ceux qui ne savent décidément pas lire tant, au-delà des Bloy, Céline, Rebatet, Ramuz et même Darien que l'auteur eût, ici, pu citer en songeant à l'extraordinaire violence de La Belle France, c'est l'Apocalypse johannique qui constitue la matrice de toute écriture (pas seulement celle d'Alain Zannini, comme je l'avais montré), et même, bien sûr, de toute pensée de Nabe. Nabe fait peur aux imbéciles qui le bannissent de leurs petits raouts policés parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne veulent pas comprendre, pour les plus intelligents, que la violence de ses textes n'a de sens que comme palimpseste truculent d'un texte autrement plus explosif. Les références à la Révélation, les métaphores nous indiquant l'horizon eschatologique sont ainsi nombreuses, directes ou pas, comme lorsque Nabe évoque plaisamment «Drouet, le nouveau Moïse» (encore lui) qui «ouvre la voie [et] roule des messianiques au milieu des éclopés en fauteuil roulant, sur béquilles, tous se répandant comme une marée jaune... Non, une diarrhée jaune, plutôt. La courante des miracles !» (p. 18).
C'est ce tropisme pour l'Apocalypse, cet apocalyptisme constant qui explique, a contrario, la petitesse métaphysique de la jacquerie moquée par Nabe, le fait que les Gilets jaunes soient incapables de désirer une véritable Révolution, un déferlement de destructions qui ne se contenterait pas de vouloir amender quelques mesures gouvernementales mais qui ferait table rase du théâtre vermoulu où se joue la comédie sociale d'une France crevée. Nabe ne se trompe évidemment pas, qui affirme sans ciller que «les GJ ont peur de la révolution à faire», ce qui est après tout bien normal puisque Edgar Quinet, selon l'auteur, a amplement montré que ce sont ceux qui avaient commencé à faire la Révolution française qui ont finalement préféré sombrer dans la Terreur, et cela parce qu'ils ont eu peur de ce qu'ils avaient déclenché : «Des auto-terrorisés par leur propre audace mystico-philosophico-métaphysique, alors qu'ils étaient capables de renverser les planètes et de déboussoler le soleil lui-même» (p. 37). Il a ainsi beau jeu de comparer les événements de février 1934 avec ceux qui, désormais, au rythme des manifestations dans toute la France tous les samedis, font l'actualité : «OK, la BAC de février 34, ce n'est pas au flash-ball qu'elle neutralisait les «casseurs», mais ces casseurs-là n'hésitaient pas à mourir s'il le fallait pour détruire l'Assemblée nationale, et pas seulement pour démanteler ses palissades de travaux...» (p. 38).
En fait, tous les Français, des médias jusqu'aux politiques en passant par les juges, la police et bien sûr les Gilets jaunes, sont finalement d'accord «pour une France en marche telle qu'elle est, ou bien telle qu'elle devrait être, ce qui revient au même» pour la banale raison qu'ils «kiffent tous l'Ordre, ces bourricots !» (p. 40), et que «les Jaunes» ne cherchent qu'une seule et unique chose selon Nabe : «consommer autant que les autres, c'est tout», puisqu'ils ne cherchent pas «à entraîner les riches dans une non-consommation, ou disons un ralentissement de la consommation, non», mais banalement, bourgeoisement, lâchement, «rejoindre les riches dans une consommation effrénée telle qu'ils en ont été privés, frustrés, exclus» (p. 46). Si ce «protestant sublime» (p. 49) qu'est Ramuz évoque et invoque un besoin de grandeur à la source des révoltes visant un peu plus haut que le seul contentement matérialiste, les Gilets jaunes, eux, ne cherchent assurément pas l'être, mais l'avoir clinquant : «Une soif de spirituel manque à l'évidence aux GJ horriblement matérialos !» (pp. 50-1), Nabe ne se gênant pas pour leur faire un procès d'intention et leur répéter sur tous les tons que «tous les GJ, si on les presse un peu comme des citrons, avoueront vite que ce n'est pas juste pour vivre dignement et ne pas crever de faim ni arrêter de crouler sous les taxes qu'ils se battent, mais pour avoir ce que les riches ont à leur place» (p.51).
L'Apocalypse, du moins, en attendant celle-ci, la grande table rase que Nabe appelle de ses vœux les plus chers, est Révélation, qui ne peut être séparée de la Destruction, qui pose, estime Nabe, des «questions fondamentales et constructives» (p. 58) que jamais les Gilets jaunes ne se posent ni ne posent car, finalement, en dépit même des scènes de violence, l'écrivain estime que nous ne sommes que dans la seule indignation, «dans le respect et la croyance en des «valeurs démocratiques», en une police des polices qui fasse son travail» (p. 74), comme si les Gilets jaunes ne cherchaient jamais rien tant que de voir leur action, leurs revendications, être avalisées par la Société, qui finira bien par récompenser ses brebis égarées qui n'ont qu'un seul désir : regagner le troupeau protecteur ! Contre ces peureux, ces timides du Grand Abrasement, Nabe dégaine Bakounine pour qui l’État doit «être radicalement démoli» car il est «tutélaire, transcendant, et centralisé», le penseur révolutionnaire ne faisant manifestement pas partie du bagage intellectuel (pour ainsi dire, ajouterait Nabe) des Gilets jaunes qui ne veulent finalement guère plus que destituer Macron, le fait de vouloir abattre l’État étant «encore un leurre de cocu de la Révolte, de conspi même» ajouterait l'écrivain, ce conspirationniste croyant «comme un connard que tout est dans les mains à ficelles d'un seul groupe de marionnettistes» (p. 86).
Juger les Gilets jaunes à cette aune eschatologique c'est aussi, immédiatement, pointer un phénomène que Nabe met en scène assez efficacement. C'est logique après tout car, se voulant, comme le héros mystérieux de Dick, Maître du Haut Château, il ne peut que nous montrer la totale illusion de notre société et, bien davantage encore, que nous n'existons tout simplement pas. Quoi, se scandalise le badaud, le Gilet jaune qui vient de perdre un œil ou une main, êtes-vous bien certain qu'il ne s'agisse que d'une illusion ? Absolument lui répond l'auteur de La sauterelle pèse lourd (et Nabe, donc), qui s'amuse à rappeler que «cet assez grand troupeau de ploucs déboule du net» puisque «c'est une foule sortie de la misère de la virtualité». Certes, «leur misère est réelle, on est bien d'accord, mais l'expression de cette misère est une misère aussi» (p. 77) puisque cette expression ne saurait être imaginée, selon les Gilets jaunes les plus déterminés, en dehors de la société, pour la détruire de fond en comble. Citant encore Bakounine, Nabe remarque qu'avant de «vouloir se libérer du Pouvoir, les individus doivent se libérer du pouvoir qu'ils ont eux-mêmes sur eux à cause de l'esprit de société devenu leur seconde nature...» (p. 87).
C'est encore trop peu, c'est faire encore preuve de peur selon Nabe, qui termine son livre en citant des extraits du Catéchisme révolutionnaire de Netchaïev, «co-écrit avec Bakounine en 1868» (p. 88), dont la violence radicale, exclusivement orientée vers la destruction pure et simple de la société, s'appuie sur la certitude, pour le révolutionnaire lui-même, d'être un homme condamné d'avance. Nabe, pourtant, ne cesse de douter : quelle force d'ébranlement véritable, intrinsèquement livré à sa propre propagation, pourrait donner un peu de consistance à ces «touristes du Grand Soir» qui, sur la tabula rasa prétendent «mettre une toile cirée à carreaux vichy, avec des rondelles de sauciflard dessus, un bon kil de rouge» (p. 91) ? L'auteur ne répond pas, comme s'il avait compris, et cela bien avant de se pencher sur le cas des Gilets jaunes, que l'Apocalypse ne pouvait ébranler qu'un monde qui n'aurait pas été, en somme, dédoublé, évidé de sa substance, les Gilets jaunes n'étant finalement rien de plus, tout comme chacun d'entre nous bien sûr, que de piètres hologrammes, des révolutionnaires de pacotille «tellement empreints de virtualité et pétris de fausses informations par dix ans, au moins, de pratique Internet, que le réel où [ils débouchent] ne [leur] fait plus rien !...».
Dès lors, Nabe ne peut plus conclure son livre vif comme une matraque de CRS assenée sur la face hébétée d'un manifestant que par un piteux «C'est foiré, c'est foiré» (p. 93), aussi morne, terne, décoloré, qu'était bigarrée la toute première page toute zébrée des couleurs (jaune, bleu, blanc, rouge et même rose, sans oublier le noir) d'une lutte qui, comme les Gilets jaunes, se dégonfle et puis, «et puis, pschitt...» (p. 10), rien, quoi.
<Note
(1) Parfois, seulement, solution beaucoup moins esthétique, il propose de les faire exploser d'une balle, comme celle de Romain Goupil : «Comment on fait pour abattre un «dinosaure» tel que Romain Goupil ? Eh bien, c'est simple : on prend une échelle de pompier et on monte jusqu'en haut, et quand on parvient à la tête minuscule de la vieille bête au long cou devenue stupide en cinquante ans, on lui tire un coup de révolver dans la boîte crânienne. Goupil avait déjà disparu; désormais, il n'existe plus» (p. 39).
04/05/2019 | Lien permanent
Richard Millet le dernier homme : sur Désenchantement de la littérature

 Avant-proposÉtrange petit livre que Désenchantement de la littérature, agitant mille idées, n'en développant réellement aucune, enchaînant des phrases qui semblent ne pouvoir se résoudre à conclure, désireuses avant tout de traduire le cheminement intellectuel de l'auteur (et plus que cela, les idées recouvrant les idées, les mots faisant naître d'autres mots, la phrase chutant à quelques bons kilomètres de son point de départ et, en fin de compte, le raisonnement ayant été comme instantanément vaporisé, sublimé, sans que nous puissions rien en retenir), à maintes reprises aussi déroutant, fascinant, brouillon, que Harcèlement littéraire était plat, bête, journalistique, réduit à un faux dialogue entre un écrivain apparemment bien content qu'on l'interroge et deux plaisantins ne comprenant apparemment pas grand-chose aux réponses qu'il leur livrait.S'agit-il encore d'un brûlot, tout de même d'une autre portée et surtout d'une tout autre écriture que le lavement pour professeur sur le retour rédigé à la hâte par Tzvetan Todorov, bizarrement revenu de ses lubies et s'émouvant, tout d'un coup, alors qu'il a jeté sur le cadavre de la littérature française, avec beaucoup d'autres, sa petite pelletée de terre, que notre littérature ne vaille effectivement plus grand-chose ?S'agit-il d'un manuel de survie moins étrange que peu honnête à l'usage des écrivains en terre vaine qui ne décrirait la toute dernière marche de l'empire de la parole que pour mieux refuser de la gravir puis de basculer dans un domaine dont nul n'a jamais rapporté la moindre description puisque «ce dont on ne saurait parler, il faut le taire» ?S'agit-il d'une fausse Saison en enfer, ni lointainement rimbaldienne ni même vaguement sincère, puisque, dissertant sur le silence sans jamais se taire, elle se bâtit sur une aporie ou plutôt une imposture, aussi bien intellectuelle qu'existentielle ? Imagine-t-on le ridicule absolu de Rimbaud (oui, on l'imagine bien puisqu'il existe : Alain Borer), devenu potentat de l'édition, gloser sur ses productions passées, accabler les écrivains de reproches (souvent fondés, là n'est pas la question) et nous décrivant les terres arides d'Abyssinie sans jamais vouloir s'y perdre ?S'agit-il d'une pâle copie des Nourritures terrestres, ayant retenu, sous une livrée pessimiste qui ne trompe guère que les imbéciles, l'essentielle leçon de Gide : le vacillement, l'attention à l'insignifiance du radotage moralisateur, la leçon se voulant provocatrice d'ébranlements vertigineux et ne parvenant pourtant pas, chez l'un, à se défaire de sa défroque grisâtre, protestante, chez l'autre, Millet, en apparence seulement autoritaire, cachant (mal) en fait sa crainte, son hésitation absolue, commodément nichées sous un vernis apodictique ?Si j'ai bien lu les toutes premières pages de cet ouvrage, si Richard Millet se tient à ce qu'il a écrit (mais il y a peu de chances qu'il s'y tienne, puisque, comme il le confie dans un récent entretien paru dans Le Point du jeudi 30 août 2007, il y a des choses qu'on doit faire parce qu'on doit manger...), s'il est d'une étoffe de mâle et non point de femmelin comme Patrick Kéchichian, alors il faut poser ces deux conséquences, radicales :– Richard Millet fait son adieu tour à tour majestueux, égocentrique, navré, peut-être même désespéré mais jamais ironique aux lettres, du moins à l'écrivain, non pas tant sa figure, de toute façon quasiment disparue en France nous dit-il, encore honorée par une société tout entière il y a quelques décennies qu'à sa propre parole, son don d'écriture, sa figure (elle aussi a disparu, selon Millet, depuis que Lévinas en a reproduit, une dernière fois avant son éclipse, la singulière beauté).– traversant le désert, la foi paraît paradoxalement suspendue, comme absente alors que le désert creuse la foi et la nourrit de sa sécheresse : la volonté de se taire prive la littérature de son socle, un catholicisme s'incarnant dans une terre réduite à un plan de cadastre. Je ne sais dans quel ordre placer cette disparition : est-ce la foi perdue ou, je l'ai dit, plutôt suspendue, qui frappe d'irréalité l'écriture ? Est-ce le renoncement à l'écriture (seulement romanesque ?), plus ou moins préparé depuis Lauve le pur qui débarrasse la terre rugueuse à étreindre de ses arrière-mondes surnaturels mais fuligineux ? Cette dernière hypothèse est peut-être la bonne, si j'en crois les toutes dernières lignes de l'Avant-propos : «Ce qui suit est une façon aussi désespérée que volontaire de me soustraire à la séduction exercée par la grammaire – et par grammaire j'entends non seulement ce qui a constitué mon ancienne démarche, mais aussi l'au-delà de la langue dans lequel retrouver la figure non rhétorique, inhumaine, nécessaire, de l'éternité» (je souligne). Et puis, ne s'agit-il pas, pour Richard Millet qui ne cesse d'insister sur le risque que comporte sa tentative, sur une solitude arc-boutée au paradoxe, ne s'agit-il pas, en retrouvant l'essence de l'ici-bas, en congédiant l'au-delà, de redonner une réelle présence, une chair, une succulence aux mots trahis, trahis par les imbéciles comme, apparemment, trahis par Millet lui-même ? Se taire donc, après tant de livres édités puis bien souvent réédités par Gallimard, ou bien poser les bagages pesants, se débarrasser des vieilles hardes, jeter au feu les rinçures et tenter de quêter les syllabes muettes d'une langue devant laquelle, par désespoir de ne jamais pouvoir l'apprendre ni la maîtriser, Lord Chandos a résolu de se taire : «J'ai su en cet instant, avec une précision qui n'allait pas sans une sensation de douleur, qu'au cours de toutes les années que j'ai à vivre [...], je n'écrirai aucun livre anglais ni latin : et ce, pour une unique raison, d'une bizarrerie si pénible pour moi que je laisse à l'esprit infiniment supérieur qu'est le vôtre le soin de la ranger à sa place dans ce domaine des phénomènes physiques et spirituels qui s'étale harmonieusement devant vous : parce que précisément la langue dans laquelle il me serait donné non seulement d'écrire mais encore de penser n'est ni la latine ni l'anglaise, non plus que l'italienne ou l'espagnole, mais une langue dont pas un seul mot ne m'est connu, une langue dans laquelle peut-être je me justifierai un jour dans ma tombe devant un juge inconnu» (op.cit., p. 51). Pour Millet, assurément, cette langue n'est plus la française, assaillie de toutes parts. Quant à l'autre langue, l'inconnue, pour en apprendre les mystérieux trésors, Richard Millet devra non seulement s'absenter au monde, se ranger (il le répète suffisamment) du côté des parias, mais aussi ne plus écrire. Apparemment, il est peut-être utile de rappeler à Millet que l'au-delà de la littérature n'est plus la littérature, mais son silence, c'est-à-dire l'adieu à la littérature et non point l'au revoir sans cesse affirmé, la décision de faire silence sans cesse procrastinée. 1 «Tout homme qui parle est hanté par la nuit.»Nuit qui vient, celle de l'obscurité généralisée mais aussi nuit des temps nous rappelle Millet : la parole et sa survie minérale sur la paroi, la tablette puis la page, semble miroiter de ces éclats de feux que les hommes allumèrent pour se protéger des bêtes. Ainsi toute parole véritable garde la mémoire d'une halte nocturne où elle était conjuration, et effroi contenu, sublimé par le conte. Nous ne voyons plus la nuit et le feu mort à petit... feu dans de sages cheminées bourgeoises : inutile donc d'écrire de longues et splendides analyses (Weidlé) ou des brûlots décousus (Millet) pour constater que sans ses deux alliés les plus précieux, la littérature, du moins en France, est devenue la putain de moins en moins docile de Philippe Sollers ou la truie que fouaille Darrieussecq. En plein jour.Et c'est dans cette nuit que paraissent murmurer les étranges paroles de cet Autrichien apparemment aussi malchanceux que l'a été Peter Handke dans l'usage des mots, non pas la trop connue Lettre, mais celles d'un texte au moins aussi fascinant intitulé Les mots ne sont pas de ce monde (Rivages poche, coll. Petite Bibliothèque, 2005, pp. 127-8) où Hofmannsthal affirme que nulle langue, pas même celle de l'Éden perdu ne peut directement évoquer l'être ou la chose, dans une secrète succion de sa sève : «Cela va un peu te perturber au début, car on a cette croyance chevillée au corps – une croyance enfantine – que, si nous trouvions toujours les mots justes, nous pourrions raconter la vie, de la même façon que l’on met une pièce de monnaie sur une autre pièce de monnaie de valeur identique. Or ce n’est pas vrai et les poètes font très exactement ce que font les compositeurs; ils expriment leur âme par le biais d’un médium qui est aussi dispersé dans l’existence entière, car l’existence contient bien sûr l’ensemble des sonorités possibles mais l’important, c’est la façon de les réunir; c’est ce que fait le peintre avec les couleurs et les formes qui ne sont qu’une partie des phénomènes mais qui, pour lui, sont tout et par les combinaisons desquelles il exprime à son tour toute son âme (ou ce qui revient au même : tout le jeu du monde)». De sorte que Millet, écrivain, ne peut écrire sur la littérature qu'en écrivant des romans, non pas des traités. Mais les romans évoquent la littérature comme nos propres yeux sont incapables de se figurer le regard qu'ils lancent au monde et aux personnes. Je ne puis que constater que je vois ou, ayant perdu la vue, que je ne vois plus. De même pour l'écriture. Ainsi, écrivant et faisant paraître son Désenchantement de la littérature, Richard Millet la trompe deux fois : en prétendant vouloir se taire alors qu'il ne cesse d'écrire qu'il va se taire, qu'il traverse une crise dont l'issue probable sinon certaine sera le mutisme plutôt que le silence, en tentant ensuite de réifier une matière, celle-là même qu'il a fait gonfler comme une pâte, dont il ne peut s'extraire, dont nul écrivain digne de ce nom ne peut s'extraire, fût-il aussi souple et rusé que le baron de Münchausen. L'esclave habitant le marbre du sculpteur génial ne parviendra jamais à se libérer de sa gangue qui est tout : non seulement la matrice mais la sculpture finale, qu'importe qu'elle soit restée à l'état brut, vagues traits s'extrayant de la pierre pourtant infiniment plus riches et vivants, puisque gros de tous les gestes imaginés par son créateur, que le modèle une fois terminé, déjà mort dans son immobilité béate. 2 «Je suis le troisième homme»Déclare Peter Handke que cite Richard Millet. Millet, lui, n'est assurément pas ce troisième homme parce qu'il a socialement réussi alors que l'écrivain véritable, selon l'auteur lui-même, est l'homme, est l'artiste se ruant vers l'échec comme s'il s'agissait d'un trésor que lui seul voit et convoite. Il est son suprême plaisir, et qu'on ne vienne pas me dire que Charles Baudelaire eût été heureux une fois élu à l'Académie française ! Richard Millet n'est pas un de ces vaincus qu'il déclare admirer (19) et, de ce fait, il appartient lui-même à cette France journalisée, désacralisée, dévirilisée, virtualisée, sans plus de littérature qu'il dénonce à juste raison et donc, comme il se doit, il n'hésite pas à poser quelque banalité absolue, d'ailleurs tout autant valable pour les romans qu'elle l'est pour la littérature et l'art : «au sein d'une civilisation rongée par le mensonge, le roman serait donc une des voies d'accès à la grammaire du monde» (26). Sans l'écrire ainsi noir sur blanc, je crois que cette riche pensée est à peu près celle de n'importe quel collégien s'étant pris, à l'adolescence, pour Arthur Rimbaud. Apparemment, il est bon de répéter les plus consternantes banalités, de peur qu'elles ne soient oubliées, voire ignorées nous dirait l'écrivain. Dans ce cas, il eut été fort utile que Millet nous donne quelque exemple illustrant ses dires, assurément moins ridicule que la preuve, selon le bon Michel Crépu dont le moral est décidément au zénith de son éclat (et, une fois encore, la perspicacité littéraire à son nadir), que la rentrée littéraire 2007 est formidable, éblouissante, remarquable, exceptionnelle : l'honnête Linda Lê... Richard Millet n'est assurément pas ce vaincu même si chacune des lignes de ce petit livre exsude la pose du mystique (28), du chrétien paradoxal puisqu'il se veut l'Unique. Or, c'est le sens même de l'adjectif chrétien que d'être l'Unique. 3, 4, 5, 6 et 7 «Jusqu'à quel point devrais-je me renier moi-même»«Mais il est une chose dont je suis sûr : le temps viendra où, dans le monde, s’élèvera un Je qui dira tout bonnement «Je» et parlera à la première personne. Aussi bien sera-t-il le premier à communiquer au sens le plus strict la vérité éthique et éthico-religieuse». Qui écrit cela ? Pas Richard Millet, qui ne croit plus en rien, pas même, nous répète-t-il, à ses propres dons, indéniables, d'écrivain. L'auteur de ces lignes n'est autre que Kierkegaard (La Dialectique de la communication [1847] (Payot & Rivages, coll. Petite Bibliothèque, 2004, p. 63), que Millet ne cite pas, qu'il aurait dû citer, dans un livre tel que le sien mais surtout, qu'il aurait dû relire et longuement méditer avant d'écrire Désenchantement de la littérature. il est vrai que cette fort utile lecture, sans doute, eût décidé Millet à ne point faire paraître sa petite charge. L'écrivain ne doit donc point se renier (44), se croire ou se rêver saint, guerrier (40) ou même, comble du ridicule, paria (49) ni, de façon cette fois parfaitement honteuse (car nous savons qu'il ne sera le chef de file de rien du tout, que son bureau, chez Gallimard (1), ne peut accueillir toute la misère littéraire du monde, que son rôle est de lutter contre ses propres collègues, amis, maîtresses et ennemis, comme l'enseigne le Christ, que ce nous qui devient pléthorique dans notre livre n'est qu'un pluriel de majesté, etc.), se prétendre chef de file d'une armée de l'ombre qui, pour mieux saper l'édifice pourri d'une France rongée de l'intérieur, appellerait la sainte violence des Mongols, des Huns et des Cosaques (54) mais, humblement, sans trompette ni buccin d'apocalypse de carnaval, se contenter de vivre sa foi et d'écrire afin de retrouver la «verte primitivité» du philosophe danois. Richard Millet aurait ainsi pu méditer la toute première leçon kierkegaardienne, totalement absente des pages de son livre tourmenté, poseur et catastrophiste : cette leçon essentielle est l'ironie. Ou alors, posture tout aussi ironique d'une certaine façon, pratiquer l'incognito, par exemple, Millet évoque d'ailleurs cette possibilité, en quittant la France et en honorant sa grandeur passée dans une nouvelle langue (46) ou par le truchement d'un autre support que l'écriture (60), effectivement l'une des voies possibles de la survie de la littérature, comme je le rappelais dans ma note intitulée Synesthésies.En attendant cette hypothétique reconversion de la littérature française qui se fera par le souterrain (certainement pas celui, de la profondeur d'un nombril de figurine Playmobil, qu'arpentent les éboueurs de l'insignifiant que sont les ridicules Costes, Soral, Nabe et, m'a-t-on dit, un ténébreux Monsieur Loyal du nom de Laurent James), que nous reste-t-il ?Le dernier déshonneur d'une France ayant perdu sa littérature (à quelques exceptions près, j'ai sur ce blog-même salué suffisamment d'auteurs de talent...), l'ultime farce d'un pays étant apparemment parfaitement incapable de nous donner un écrivain de la dimension d'un Péguy, d'un Claudel d'un Céline ou d'un Bernanos (cette petite liste n'est absolument pas limitative, à l'exclusion de quelques pitres insignes, comme Philippe Sollers), le dernier tour que nous joue le nihilisme triomphant selon Millet, est de nous désespérer un peu plus, en nous faisant comprendre ce tragique (et très ironique pour le coup !) tour du diable : les polémistes d'hôtel de luxe comme Richard Millet le solitaire contrarié, sont des tireurs borgnes tirant à blanc sur des cibles identifiées depuis des lustres; les écrivains eux-mêmes ou ce qu'il en reste, comme Camus, Dantec ou Houellebecq, sont d'habiles phraseurs dont les phrases se saponifient aussi vite qu'elles ont été écrites, faute de sang pour leur donner vie; les critiques, ah, les critiques !, méprisent des écrivains dont les livres ne sont pas même capables de les ravir hors de ce monde une seule seconde (2); les lecteurs enfin, vous-mêmes mes amis, ne comprenez pas que la littérature française est une Ophélie errant sur le fleuve de la mémoire que plus personne ne se soucie d'enterrer dignement.Il est temps de passer à autre chose.Oui mais à quoi ? Rien puisque, pour fermer cette note ouverte avec les toutes premières lignes que Wittgenstein écrivit en guise de préface à son Tractatus logico-philosophicus, «la limite ne pourra donc être tracée que dans le langage, et ce qui se situe au-delà de cette limite sera simplement du non-sens».Notes(1) Je serais assez curieux de savoir ce que le patron de cette prestigieuse maison d'édition pense de certaines des dernières déclarations de Richard Millet considérant qu'à peu près tout ce qu'il lit, donc ce qu'il lit également pour son employeur, ne vaut rien.(2) «Le critique serait donc le plus malaisé s’il refusait d’être «transformé» par l’œuvre comme elle le demande, et si – pour l’aberrance d’une lucidité – ce fût le seul désormais que le courant ne traverserait plus, un isolant, un interrupteur», Georges Blin, La cribleuse de blé (José Corti, 1968), pp. 67-68.
Avant-proposÉtrange petit livre que Désenchantement de la littérature, agitant mille idées, n'en développant réellement aucune, enchaînant des phrases qui semblent ne pouvoir se résoudre à conclure, désireuses avant tout de traduire le cheminement intellectuel de l'auteur (et plus que cela, les idées recouvrant les idées, les mots faisant naître d'autres mots, la phrase chutant à quelques bons kilomètres de son point de départ et, en fin de compte, le raisonnement ayant été comme instantanément vaporisé, sublimé, sans que nous puissions rien en retenir), à maintes reprises aussi déroutant, fascinant, brouillon, que Harcèlement littéraire était plat, bête, journalistique, réduit à un faux dialogue entre un écrivain apparemment bien content qu'on l'interroge et deux plaisantins ne comprenant apparemment pas grand-chose aux réponses qu'il leur livrait.S'agit-il encore d'un brûlot, tout de même d'une autre portée et surtout d'une tout autre écriture que le lavement pour professeur sur le retour rédigé à la hâte par Tzvetan Todorov, bizarrement revenu de ses lubies et s'émouvant, tout d'un coup, alors qu'il a jeté sur le cadavre de la littérature française, avec beaucoup d'autres, sa petite pelletée de terre, que notre littérature ne vaille effectivement plus grand-chose ?S'agit-il d'un manuel de survie moins étrange que peu honnête à l'usage des écrivains en terre vaine qui ne décrirait la toute dernière marche de l'empire de la parole que pour mieux refuser de la gravir puis de basculer dans un domaine dont nul n'a jamais rapporté la moindre description puisque «ce dont on ne saurait parler, il faut le taire» ?S'agit-il d'une fausse Saison en enfer, ni lointainement rimbaldienne ni même vaguement sincère, puisque, dissertant sur le silence sans jamais se taire, elle se bâtit sur une aporie ou plutôt une imposture, aussi bien intellectuelle qu'existentielle ? Imagine-t-on le ridicule absolu de Rimbaud (oui, on l'imagine bien puisqu'il existe : Alain Borer), devenu potentat de l'édition, gloser sur ses productions passées, accabler les écrivains de reproches (souvent fondés, là n'est pas la question) et nous décrivant les terres arides d'Abyssinie sans jamais vouloir s'y perdre ?S'agit-il d'une pâle copie des Nourritures terrestres, ayant retenu, sous une livrée pessimiste qui ne trompe guère que les imbéciles, l'essentielle leçon de Gide : le vacillement, l'attention à l'insignifiance du radotage moralisateur, la leçon se voulant provocatrice d'ébranlements vertigineux et ne parvenant pourtant pas, chez l'un, à se défaire de sa défroque grisâtre, protestante, chez l'autre, Millet, en apparence seulement autoritaire, cachant (mal) en fait sa crainte, son hésitation absolue, commodément nichées sous un vernis apodictique ?Si j'ai bien lu les toutes premières pages de cet ouvrage, si Richard Millet se tient à ce qu'il a écrit (mais il y a peu de chances qu'il s'y tienne, puisque, comme il le confie dans un récent entretien paru dans Le Point du jeudi 30 août 2007, il y a des choses qu'on doit faire parce qu'on doit manger...), s'il est d'une étoffe de mâle et non point de femmelin comme Patrick Kéchichian, alors il faut poser ces deux conséquences, radicales :– Richard Millet fait son adieu tour à tour majestueux, égocentrique, navré, peut-être même désespéré mais jamais ironique aux lettres, du moins à l'écrivain, non pas tant sa figure, de toute façon quasiment disparue en France nous dit-il, encore honorée par une société tout entière il y a quelques décennies qu'à sa propre parole, son don d'écriture, sa figure (elle aussi a disparu, selon Millet, depuis que Lévinas en a reproduit, une dernière fois avant son éclipse, la singulière beauté).– traversant le désert, la foi paraît paradoxalement suspendue, comme absente alors que le désert creuse la foi et la nourrit de sa sécheresse : la volonté de se taire prive la littérature de son socle, un catholicisme s'incarnant dans une terre réduite à un plan de cadastre. Je ne sais dans quel ordre placer cette disparition : est-ce la foi perdue ou, je l'ai dit, plutôt suspendue, qui frappe d'irréalité l'écriture ? Est-ce le renoncement à l'écriture (seulement romanesque ?), plus ou moins préparé depuis Lauve le pur qui débarrasse la terre rugueuse à étreindre de ses arrière-mondes surnaturels mais fuligineux ? Cette dernière hypothèse est peut-être la bonne, si j'en crois les toutes dernières lignes de l'Avant-propos : «Ce qui suit est une façon aussi désespérée que volontaire de me soustraire à la séduction exercée par la grammaire – et par grammaire j'entends non seulement ce qui a constitué mon ancienne démarche, mais aussi l'au-delà de la langue dans lequel retrouver la figure non rhétorique, inhumaine, nécessaire, de l'éternité» (je souligne). Et puis, ne s'agit-il pas, pour Richard Millet qui ne cesse d'insister sur le risque que comporte sa tentative, sur une solitude arc-boutée au paradoxe, ne s'agit-il pas, en retrouvant l'essence de l'ici-bas, en congédiant l'au-delà, de redonner une réelle présence, une chair, une succulence aux mots trahis, trahis par les imbéciles comme, apparemment, trahis par Millet lui-même ? Se taire donc, après tant de livres édités puis bien souvent réédités par Gallimard, ou bien poser les bagages pesants, se débarrasser des vieilles hardes, jeter au feu les rinçures et tenter de quêter les syllabes muettes d'une langue devant laquelle, par désespoir de ne jamais pouvoir l'apprendre ni la maîtriser, Lord Chandos a résolu de se taire : «J'ai su en cet instant, avec une précision qui n'allait pas sans une sensation de douleur, qu'au cours de toutes les années que j'ai à vivre [...], je n'écrirai aucun livre anglais ni latin : et ce, pour une unique raison, d'une bizarrerie si pénible pour moi que je laisse à l'esprit infiniment supérieur qu'est le vôtre le soin de la ranger à sa place dans ce domaine des phénomènes physiques et spirituels qui s'étale harmonieusement devant vous : parce que précisément la langue dans laquelle il me serait donné non seulement d'écrire mais encore de penser n'est ni la latine ni l'anglaise, non plus que l'italienne ou l'espagnole, mais une langue dont pas un seul mot ne m'est connu, une langue dans laquelle peut-être je me justifierai un jour dans ma tombe devant un juge inconnu» (op.cit., p. 51). Pour Millet, assurément, cette langue n'est plus la française, assaillie de toutes parts. Quant à l'autre langue, l'inconnue, pour en apprendre les mystérieux trésors, Richard Millet devra non seulement s'absenter au monde, se ranger (il le répète suffisamment) du côté des parias, mais aussi ne plus écrire. Apparemment, il est peut-être utile de rappeler à Millet que l'au-delà de la littérature n'est plus la littérature, mais son silence, c'est-à-dire l'adieu à la littérature et non point l'au revoir sans cesse affirmé, la décision de faire silence sans cesse procrastinée. 1 «Tout homme qui parle est hanté par la nuit.»Nuit qui vient, celle de l'obscurité généralisée mais aussi nuit des temps nous rappelle Millet : la parole et sa survie minérale sur la paroi, la tablette puis la page, semble miroiter de ces éclats de feux que les hommes allumèrent pour se protéger des bêtes. Ainsi toute parole véritable garde la mémoire d'une halte nocturne où elle était conjuration, et effroi contenu, sublimé par le conte. Nous ne voyons plus la nuit et le feu mort à petit... feu dans de sages cheminées bourgeoises : inutile donc d'écrire de longues et splendides analyses (Weidlé) ou des brûlots décousus (Millet) pour constater que sans ses deux alliés les plus précieux, la littérature, du moins en France, est devenue la putain de moins en moins docile de Philippe Sollers ou la truie que fouaille Darrieussecq. En plein jour.Et c'est dans cette nuit que paraissent murmurer les étranges paroles de cet Autrichien apparemment aussi malchanceux que l'a été Peter Handke dans l'usage des mots, non pas la trop connue Lettre, mais celles d'un texte au moins aussi fascinant intitulé Les mots ne sont pas de ce monde (Rivages poche, coll. Petite Bibliothèque, 2005, pp. 127-8) où Hofmannsthal affirme que nulle langue, pas même celle de l'Éden perdu ne peut directement évoquer l'être ou la chose, dans une secrète succion de sa sève : «Cela va un peu te perturber au début, car on a cette croyance chevillée au corps – une croyance enfantine – que, si nous trouvions toujours les mots justes, nous pourrions raconter la vie, de la même façon que l’on met une pièce de monnaie sur une autre pièce de monnaie de valeur identique. Or ce n’est pas vrai et les poètes font très exactement ce que font les compositeurs; ils expriment leur âme par le biais d’un médium qui est aussi dispersé dans l’existence entière, car l’existence contient bien sûr l’ensemble des sonorités possibles mais l’important, c’est la façon de les réunir; c’est ce que fait le peintre avec les couleurs et les formes qui ne sont qu’une partie des phénomènes mais qui, pour lui, sont tout et par les combinaisons desquelles il exprime à son tour toute son âme (ou ce qui revient au même : tout le jeu du monde)». De sorte que Millet, écrivain, ne peut écrire sur la littérature qu'en écrivant des romans, non pas des traités. Mais les romans évoquent la littérature comme nos propres yeux sont incapables de se figurer le regard qu'ils lancent au monde et aux personnes. Je ne puis que constater que je vois ou, ayant perdu la vue, que je ne vois plus. De même pour l'écriture. Ainsi, écrivant et faisant paraître son Désenchantement de la littérature, Richard Millet la trompe deux fois : en prétendant vouloir se taire alors qu'il ne cesse d'écrire qu'il va se taire, qu'il traverse une crise dont l'issue probable sinon certaine sera le mutisme plutôt que le silence, en tentant ensuite de réifier une matière, celle-là même qu'il a fait gonfler comme une pâte, dont il ne peut s'extraire, dont nul écrivain digne de ce nom ne peut s'extraire, fût-il aussi souple et rusé que le baron de Münchausen. L'esclave habitant le marbre du sculpteur génial ne parviendra jamais à se libérer de sa gangue qui est tout : non seulement la matrice mais la sculpture finale, qu'importe qu'elle soit restée à l'état brut, vagues traits s'extrayant de la pierre pourtant infiniment plus riches et vivants, puisque gros de tous les gestes imaginés par son créateur, que le modèle une fois terminé, déjà mort dans son immobilité béate. 2 «Je suis le troisième homme»Déclare Peter Handke que cite Richard Millet. Millet, lui, n'est assurément pas ce troisième homme parce qu'il a socialement réussi alors que l'écrivain véritable, selon l'auteur lui-même, est l'homme, est l'artiste se ruant vers l'échec comme s'il s'agissait d'un trésor que lui seul voit et convoite. Il est son suprême plaisir, et qu'on ne vienne pas me dire que Charles Baudelaire eût été heureux une fois élu à l'Académie française ! Richard Millet n'est pas un de ces vaincus qu'il déclare admirer (19) et, de ce fait, il appartient lui-même à cette France journalisée, désacralisée, dévirilisée, virtualisée, sans plus de littérature qu'il dénonce à juste raison et donc, comme il se doit, il n'hésite pas à poser quelque banalité absolue, d'ailleurs tout autant valable pour les romans qu'elle l'est pour la littérature et l'art : «au sein d'une civilisation rongée par le mensonge, le roman serait donc une des voies d'accès à la grammaire du monde» (26). Sans l'écrire ainsi noir sur blanc, je crois que cette riche pensée est à peu près celle de n'importe quel collégien s'étant pris, à l'adolescence, pour Arthur Rimbaud. Apparemment, il est bon de répéter les plus consternantes banalités, de peur qu'elles ne soient oubliées, voire ignorées nous dirait l'écrivain. Dans ce cas, il eut été fort utile que Millet nous donne quelque exemple illustrant ses dires, assurément moins ridicule que la preuve, selon le bon Michel Crépu dont le moral est décidément au zénith de son éclat (et, une fois encore, la perspicacité littéraire à son nadir), que la rentrée littéraire 2007 est formidable, éblouissante, remarquable, exceptionnelle : l'honnête Linda Lê... Richard Millet n'est assurément pas ce vaincu même si chacune des lignes de ce petit livre exsude la pose du mystique (28), du chrétien paradoxal puisqu'il se veut l'Unique. Or, c'est le sens même de l'adjectif chrétien que d'être l'Unique. 3, 4, 5, 6 et 7 «Jusqu'à quel point devrais-je me renier moi-même»«Mais il est une chose dont je suis sûr : le temps viendra où, dans le monde, s’élèvera un Je qui dira tout bonnement «Je» et parlera à la première personne. Aussi bien sera-t-il le premier à communiquer au sens le plus strict la vérité éthique et éthico-religieuse». Qui écrit cela ? Pas Richard Millet, qui ne croit plus en rien, pas même, nous répète-t-il, à ses propres dons, indéniables, d'écrivain. L'auteur de ces lignes n'est autre que Kierkegaard (La Dialectique de la communication [1847] (Payot & Rivages, coll. Petite Bibliothèque, 2004, p. 63), que Millet ne cite pas, qu'il aurait dû citer, dans un livre tel que le sien mais surtout, qu'il aurait dû relire et longuement méditer avant d'écrire Désenchantement de la littérature. il est vrai que cette fort utile lecture, sans doute, eût décidé Millet à ne point faire paraître sa petite charge. L'écrivain ne doit donc point se renier (44), se croire ou se rêver saint, guerrier (40) ou même, comble du ridicule, paria (49) ni, de façon cette fois parfaitement honteuse (car nous savons qu'il ne sera le chef de file de rien du tout, que son bureau, chez Gallimard (1), ne peut accueillir toute la misère littéraire du monde, que son rôle est de lutter contre ses propres collègues, amis, maîtresses et ennemis, comme l'enseigne le Christ, que ce nous qui devient pléthorique dans notre livre n'est qu'un pluriel de majesté, etc.), se prétendre chef de file d'une armée de l'ombre qui, pour mieux saper l'édifice pourri d'une France rongée de l'intérieur, appellerait la sainte violence des Mongols, des Huns et des Cosaques (54) mais, humblement, sans trompette ni buccin d'apocalypse de carnaval, se contenter de vivre sa foi et d'écrire afin de retrouver la «verte primitivité» du philosophe danois. Richard Millet aurait ainsi pu méditer la toute première leçon kierkegaardienne, totalement absente des pages de son livre tourmenté, poseur et catastrophiste : cette leçon essentielle est l'ironie. Ou alors, posture tout aussi ironique d'une certaine façon, pratiquer l'incognito, par exemple, Millet évoque d'ailleurs cette possibilité, en quittant la France et en honorant sa grandeur passée dans une nouvelle langue (46) ou par le truchement d'un autre support que l'écriture (60), effectivement l'une des voies possibles de la survie de la littérature, comme je le rappelais dans ma note intitulée Synesthésies.En attendant cette hypothétique reconversion de la littérature française qui se fera par le souterrain (certainement pas celui, de la profondeur d'un nombril de figurine Playmobil, qu'arpentent les éboueurs de l'insignifiant que sont les ridicules Costes, Soral, Nabe et, m'a-t-on dit, un ténébreux Monsieur Loyal du nom de Laurent James), que nous reste-t-il ?Le dernier déshonneur d'une France ayant perdu sa littérature (à quelques exceptions près, j'ai sur ce blog-même salué suffisamment d'auteurs de talent...), l'ultime farce d'un pays étant apparemment parfaitement incapable de nous donner un écrivain de la dimension d'un Péguy, d'un Claudel d'un Céline ou d'un Bernanos (cette petite liste n'est absolument pas limitative, à l'exclusion de quelques pitres insignes, comme Philippe Sollers), le dernier tour que nous joue le nihilisme triomphant selon Millet, est de nous désespérer un peu plus, en nous faisant comprendre ce tragique (et très ironique pour le coup !) tour du diable : les polémistes d'hôtel de luxe comme Richard Millet le solitaire contrarié, sont des tireurs borgnes tirant à blanc sur des cibles identifiées depuis des lustres; les écrivains eux-mêmes ou ce qu'il en reste, comme Camus, Dantec ou Houellebecq, sont d'habiles phraseurs dont les phrases se saponifient aussi vite qu'elles ont été écrites, faute de sang pour leur donner vie; les critiques, ah, les critiques !, méprisent des écrivains dont les livres ne sont pas même capables de les ravir hors de ce monde une seule seconde (2); les lecteurs enfin, vous-mêmes mes amis, ne comprenez pas que la littérature française est une Ophélie errant sur le fleuve de la mémoire que plus personne ne se soucie d'enterrer dignement.Il est temps de passer à autre chose.Oui mais à quoi ? Rien puisque, pour fermer cette note ouverte avec les toutes premières lignes que Wittgenstein écrivit en guise de préface à son Tractatus logico-philosophicus, «la limite ne pourra donc être tracée que dans le langage, et ce qui se situe au-delà de cette limite sera simplement du non-sens».Notes(1) Je serais assez curieux de savoir ce que le patron de cette prestigieuse maison d'édition pense de certaines des dernières déclarations de Richard Millet considérant qu'à peu près tout ce qu'il lit, donc ce qu'il lit également pour son employeur, ne vaut rien.(2) «Le critique serait donc le plus malaisé s’il refusait d’être «transformé» par l’œuvre comme elle le demande, et si – pour l’aberrance d’une lucidité – ce fût le seul désormais que le courant ne traverserait plus, un isolant, un interrupteur», Georges Blin, La cribleuse de blé (José Corti, 1968), pp. 67-68.
30/09/2007 | Lien permanent
Maurice G. Dantec est dans la Zone

18/09/2006 | Lien permanent
Méditations d'un solitaire en 1916 de Léon Bloy

Rappel.
 Léon Bloy dans la Zone.
Léon Bloy dans la Zone. C'est au fond le problème qui est celui de tous les mystiques désireux de laisser un témoignage écrit de leur expérience qui, dans l'un de ses derniers livres où le vieil écrivain fourbu mais, comme toujours, en colère, a ramassé sa pensée, a saisi Léon Bloy : comment dire ce qui ne peut être dit ? Comment évoquer la seule rencontre qui compte, celle faite avec Dieu ? Comment, avec le verbe maigre des littérateurs, tenter d'évoquer le Verbe dans sa plénitude inconcevable et permettre à d'autres, connus ou inconnus, pourquoi pas futurs écrivains, de reprendre le flambeau de l'universelle analogie au moyen de laquelle Léon Bloy a cru pouvoir expliquer la profondeur inconnue du monde ?
Il faut, d'abord, comme tout mystique, avoir renoncé aux mondanités et fait le vide, et Dieu sait de quelle féroce manière Bloy a pu mettre en pratique son rigoureux programme, qui n'a de fait nécessité aucune retraite véritable, longue de plusieurs années. Cette solitude plénière, cette solitude admirable de l'écrivain qui, se sachant sans doute proche de la mort et désireux, enfin, de pouvoir contempler Celui à qui il a osé s'adresser depuis des années, n'est point la tabula rasa de celles et ceux qui à la solitude préfèrent le mépris et la peur, et se confinent dans des retraites fébriles qui n'en sont pas vraiment, comme le tueur professionnel, avant d'accomplir son ultime mission, s'accorde quelques journées à la fraîche, loin d'une foule qui lui permettra pourtant d'accomplir son forfait. La solitude de Léon Bloy ne fait table rase de rien, puisqu'il sait parfaitement qu'elle est sa vocation : la lutte, pas la retraite, le pas tenu contre les imbéciles de toutes obédiences.
Ainsi, la solitude de Léon Bloy ne peut être comprise que parce qu'elle s'est toujours efforcée de transmettre et d'enseigner, à sa façon certes si peu orthodoxe qu'elle continue de contrarier la métamorphose en grenouilles pimpantes des têtards de bénitier. La solitude de Léon Bloy, c'est le point qui nous semble le plus frappant, s'accompagne d'une remise en question du don d'écriture, comme s'il fallait encore et coûte que coûte, du sein de la colonne de silence dont il s'est pourtant tant de fois amèrement plaint, parvenir à écrire, c'est-à-dire délivrer, aux autres, autant qu'ils soient les plus nombreux mais c'est bien sûr un vœu pieux, un message : «[…] je parle ou […] je croasse dans les ténèbres au fond d'un désert où ne viendront m'entendre que ceux qui se sont éloignés de tous les chemins de la multitude» (1).
Si la solitude est une élection, l'écriture en est une autre et Léon Bloy aura tout de même assez vite compris que ses textes jamais ne pourraient toucher autant de personnes, du moins superficiellement, que ceux d'un Émile Zola. Et pour cause car, en écrivant, Bloy ne cherche rien d'autre qu'à se faire pure transparence, afin que son écriture soit le miroir point trop déformant, il l'espère du moins, de phrases qu'il est seul, dans les ténèbres, à avoir pu contempler, et qu'il désespère de partager avec ses lecteurs, bien souvent devenus ses amis.
Solitude remplie d'une formidable colère, d'abord contre l'ennemi de la France, l'Allemagne (2), solitude essentielle, blanchotienne si l'on veut à condition de la comprendre comme une réelle présence au monde et non son abstraction maladive et, surtout, comme l'assurance de l'existence d'une communauté d'amis et de fidèles, fussent-ils morts (3).
Solitude de Léon Bloy qui est le lieu, plus élevé que la montagne de Zarathoustra, depuis lequel l'écrivain, au soir de sa vie, va contempler la multitude bruyante, affligée par les souffrances de la Grande Guerre, cherchant dans l'affreuse et impudique grégarité du troupeau un sens qui ne peut se conquérir que de haute lutte, dans et par la solitude justement, que Bloy ne cesse de magnifier dans le début de ses méditations, par exemple par cette image superbe et frappante : «Je suis seul dans l’antichambre de Dieu» (p. 229) et qu'il poursuit et file en écrivant : «Plus on s'approche de Dieu, plus on est seul. C'est l'infini de la solitude» (ibid.), non sans oublier de mentionner quel aura été, tout au long de sa vie, son unique intention : «Et que seront devenus mes pauvres livres où je cherchais l’histoire de la Trinité miséricordieuse ?» (ibid.).
Cette seule question, bouleversante, suffit à témoigner de l'humilité de Léon Bloy, qui est si souvent confondu par les imbéciles avec la monodique éructation d'un fol en Christ égaré au XXe siècle. Tout proche de la mort, Léon Bloy résume en deux mots, qu'il noue de la plus incroyable façon, le sens de son existence : la solitude, l'écriture.
Seul, tout proche, il le pressent sans doute, lui qui a pressenti tant de choses, de tomber dans la main terrifiante du Dieu vivant, Léon Bloy interprète les événements qu'il lit dans la presse, puisqu'il ne peut participer directement, il s'en désole d'ailleurs, aux combats, durant lesquels il eût pu rencontrer, sans bien évidemment rien savoir de lui, Georges Bernanos ayant découvert l’œuvre du Mendiant ingrat dans la puanteur boueuse des tranchées. La Grande Guerre, par son caractère éminemment diabolique, ne peut qu'être un signe, l'un de ces innombrables signes (mais celui-ci, du moins l'espère-t-il, plus puissant que les autres) de l'Événement que l'écrivain attend depuis des lustres et qu'il ne peut se résoudre de ne pas attendre, même à bout de forces : «Tout ce que je peux dire, c'est que l’Étranger qu'il faut attendre sera certainement un vagabond, étant envoyé par CELUI dont il est écrit que nul ne sait d'où Il vient ni où Il va. Un vagabond de l'Absolu, de la Douleur, de l'Insomnie, si prodigieux que tout ce qui est stable et délimité reculera devant lui et que ses plus proches en auront peur» (p. 234).
Il est intéressant de noter que l'écriture bloyenne, sommée de dire ce qui par essence échappe au pouvoir des mots, procède selon une gradation apophatique caractéristique. Si nous ne pouvons absolument rien dire de la nature de Celui qui reviendra pour juger notre foi vacillante (voire, plus de foi du tout, antienne de Bloy contre l'Église française (4)) et annoncer une venue autrement plus terrible, la seconde venue du Christ, au moins pouvons-nous tenter de dire ce qu'Il n'est pas : «Et il sera tellement un homme de rien qu'on ne pourra pas lui supposer un étage quelconque de sainteté, une parcelle infinitésime de l'esprit de prophétie. Il ne sera probablement pas autre chose qu'un reflet de la Gloire dans un cloaque, mais un reflet si redoutable que les montagnes craindront d'être consumées !» (ibid.).
Nous retrouvons ici une thématique de Bloy bien connue de ses lecteurs. Non seulement les démons ne sont qu'une image renversée des bons anges (5), mais Celui qui les dominera sera probablement l'un des premiers d'entre eux, le plus puissant peut-être, en vertu du principe d'identité spéculaire, que Léon Bloy n'a cessé de commenter dans chacun de ses livres, eux-mêmes placés comme des miroirs les uns en face des autres, créant un entrelacement infini des textes qui se répondent entre eux. Si un seul texte est bien incapable de figurer Dieu, peut-être que plusieurs parviendront, à force d'accumulations de mots et d'images, à évoquer, même très imparfaitement, sa nature, grâce à la vertu de correspondances universelles dont Bloy a quêté toute sa vie le chiffre ? : «Les croquants dont je suis ne savent rien ou presque rien au-delà de leurs aïeux immédiats, paternels ou maternels; mais les uns comme les autres ignorent invinciblement leur parenté surnaturelle, et les gouttes d'un sang plus ou moins illustre dont se réclament les superbes ne constituent pour personne l'IDENTITÉ. Vous pouvez savoir qui vous engendra, mais, sans une révélation divine, comment pourriez-vous savoir qui vous a conçu ? Vous croyez être né d’un acte, vous êtes né d’une pensée. Toute génération est surnaturelle» (p. 238, l'auteur souligne). Implicitement, c'est affirmer que l'écriture, qui est une génération, est elle aussi d'origine surnaturelle, et que celui qui écrit doit rendre compte, doit rendre des comptes de la façon dont il a utilisé le langage.
Si les hommes ont été faits à l'image et à la ressemblance de leur créateur, cette affirmation entraîne des conséquences inouïes : «Qui donc sommes-nous, en réalité, pour que de tels défenseurs nous soient proposés et surtout, qui sont-ils eux-mêmes, ces enchaînés à notre destin dont il n'est pas dit que Dieu les ait faits, comme nous, à sa Ressemblance et qui n'ont ni corps ni figure ?» (p. 237).
Léon Bloy utilise ici un procédé que nous pourrions nommer de gradation hyperbolique : si nous ne pouvons avoir la moindre idée des anges qui sont affectés à notre salut ou à notre damnation, nous pouvons encore moins tenter de nous représenter des créatures faites à l'image de Dieu, qui sont donc supérieures aux précédentes, donc, nous ne pouvons strictement rien savoir de nos semblables sans un regard particulier, peut-être surnaturel, dont le Donissan de Bernanos foudroiera Mouchette. Ce procédé, dont l'utilisation constante est parfois fort lassante et, surtout, minimise l'effet escompté, n'est à nos yeux jamais mieux illustré que dans ce type de phrases : «La malédiction d’un seul enfant est une chose panique, surhumaine, qui déconcerte les plus forts. Le cœur humain n’est pas fait pour supporter cela. Mais la malédiction d’une multitude d’enfants, c’est un cataclysme, un prodige de terreur, une chaîne de montagnes sombres dans le ciel avec une chevauchée ininterrompue d’éclairs et de tonnerres sur leurs cimes; c’est l’infini des aboiements de tous les gouffres; un je ne sais quoi de tout puissant qui ne pardonne pas et qui tue l’espérance de tout pardon» (p. 267). On dirait que Léon Bloy, dans son écriture même, figure l'escalade du pèlerin vers le sommet où il pourra contempler la lumière. En quelque sorte, si je ne craignais d'utiliser quelque image trop facile, je pourrais affirmer que tous les livres de Léon Bloy ont constitué sa montagne du Purgatoire, qu'il a escaladé sans relâche jusqu'à sa mort.
Le principe d'identité, tel que Bloy a cru le trouver dans les textes saints, puis, surtout, tel qu'il l'a développé par ses exégèses fort peu canoniques, implique je l'ai dit des liens non seulement entre le visible et l'invisible, entre les vivants et les morts, le passé et le futur (puisque Dieu se situe hors du temps) mais aussi, bien évidemment, entre les pécheurs et les saints et entre les démons et les anges qui n'ont pas chuté : «Tel mouvement de la Grâce qui me sauve d'un péril grave a pu être déterminé par tel acte d'amour accompli ce matin ou il y a cinq cents ans par un homme très obscur de qui l'âme correspondait mystérieusement à la mienne et qui reçoit ainsi son salaire» (p. 240).
Au passage, et pour que le clown hystérique Alain Soral, cloné par d'innombrables crétins tout aussi fébriles que lui, se souvienne de nous, signalons-lui que Léon Bloy, par définition, est l'un des écrivains qu'il est le plus difficile de transformer en apôtres de thèses antisémites (comme je l'ai montré dans ma note sur Le Salut par les Juifs) et racistes (au sens d'une supériorité de telle ou telle race sur telle autre, alors même qu'il n'hésite pas à employer le mot de race qui, à son époque, semblait pouvoir être utilisé sans précautions oratoires laborieuses), lui qui déclare sans ambages : «Silence infini dans les ténèbres ou dans la lumière, on ne sait pas. Mais alors sans doute, il y a des rencontres et des surprises ineffables. Des voix inaudibles, des visages d’âmes se reconnaissent pour toujours à travers les cloisons diaphanes des races et les translucides murailles des siècles...» (p. 241). Accepter humblement l'existence du difficile dogme de la communion des saints, en extrémiser ses implications théologiques et surtout poétiques, c'est admettre que tout correspond avec tout, l'ordure avec la sainteté, les ténèbres avec la lumière, alors que la Bible nous affirme pourtant que les premières ne contiennent pas les secondes, mais aussi le passé avec le présent.
Léon Bloy insiste sur l'universel échange dont les mailles enserrent le monde, et dont le dogme de la communion des saints ne semble nous offrir qu'un écho assourdi, presque timide, au vu des audaces (6) de l’exégèse bloyenne : «Alors, que se passe-t-il dans le vaste monde invisible ? Il est difficile et téméraire d’y penser. Un psaume lu sans attention, un Ave Maria dit sans amour bondissent aussitôt mot par mot, lettre par lettre dans l’Infini, semblables à des forces torrentielles déchaînées par un insensé, capables de bouleverser des mondes et ne pouvant plus être arrêtées que par la poitrine miraculeuse d’un martyr» (p. 248).
La langue ne saurait donc s'aventurer dans une dimension qui englobe celle où un homme réalise sa vie d'homme, et la creuse d'une profondeur vertigineuse. Il n'est pas étonnant que ce soit l'approche de la mort qui rende suraiguë la sensibilité de Léon Bloy et semble lui conférer une qualité de voyant (7) qu'Arthur Rimbaud crut conquérir par la souffrance et l'automutilation morale volontaire, qualité de voyant qui libère l'écrivain de ses dernières timidités théologiques si je puis dire, le poussant à écrire sans fard : «Des âmes apparentées spirituellement à la vôtre que vous ne pouviez pas connaître et qui sont une multitude, vous les connaissez maintenant, vous les voyez de votre nouvelle demeure. Aussitôt après votre départ de ce monde, elles vous ont été montrées. Vous avez su alors pourquoi vous étiez venu dans notre bagne et pourquoi vous avez été forcé d’en sortir» (p. 250).
Bien évidemment, nous devons remarquer que l'écriture de Léon Bloy se caractérise, du moins dans ses derniers ouvrages, par une figure que nous pourrions qualifier comme étant une aporie surmontée ou bien quelque borgésien trope de Monsieur Valdemar, non point parce que l'écriture serait parvenue, enfin et contre toute attente, à évoquer ce qui échappe à son emprise, mais parce qu'elle fait comme si le dialogue entre le visible et l'invisible était non seulement possible mais immédiatement vérifiable, sous nos propres yeux exposé. Le court-circuit qu'opère ainsi la dernière phrase bloyenne citée est remarquable, puisque l'écrivain parvient à nous donner quelque idée de ce que nous sommes réellement, grâce à l'évocation d'une impossibilité, celle de notre propre mort; en somme, il nous permet de connaître cette expérience si souvent décrite par des femmes et des hommes qui ont vécu, durant quelques minutes et avant de revenir à la vie, l'état de mort clinique, où ils se sont décrits surplombant leur propre cadavre. Un écrivain qui, une fois au moins après avoir accumulé des milliers de phrases, n'est pas capable de provoquer chez son lecteur ce sentiment d'extra-territorialité est un farceur.
Une autre façon, pour Léon Bloy, de fixer l'invisible et de nous en rapporter quelques aperçus réside, loin de ces procédés si finement caractérisés par Michel de Certeau dans sa Fable mystique, dans l'utilisation d'une langue toute simple, quitte à s'inspirer, en en citant de longs passages, de celle du Poverello, Saint François d'Assise (cf. pp. 255-8), ou bien encore dans l'invention d'une parabole qui, par sa vertu énigmatique, saisira les esprits et les confrontera à l'urgence du questionnement. Ne pouvoir dire l'invisible, ce qui dépasse les mots et même la vision, c'est aussi montrer, paradoxalement, par la vertu de phrases très simples tout autant que par celle d'un exemple qui est en apparence, mais seulement en apparence, comme toute parabole, très clair, que l'insoupçonnable transperce nos mots les plus banals, que l'invisible se niche au plus secret des mots les plus ridiculement communs, ceux-là même par lesquels le petit Saint saluait Frère Soleil : «J'ai su l'histoire d'une pauvre bohémienne qui entendit, un jour, nommer le Dieu vivant. Elle ne savait absolument rien, pas même une autre langue que le patois de sa tribu. Mais elle avait pu saisir ces deux mots. Aussitôt elle quitta tout, prit son petit enfant dans ses bras et se mit à courir le monde comme une insensée, demandant partout le Dieu vivant» (pp. 258-9), brève histoire aussi épurée qu'une phrase de l'humble François que Léon Bloy commente ainsi : «Cette créature extraordinaire me paraît un symbole de l'âme humaine affamée de son principe de vie et qui erre sans relâche dans nos sociétés sans Dieu», quitte, bien évidemment, à en tirer un coruscant sermon, cette fois-ci pour le moins éloigné de la simplicité franciscaine, contre la médiocrité où se complait l'époque : «Mais aujourd'hui, au seuil de l'Apocalypse où nous voici parvenus, sur le bord extrême d'un abîme dont la profondeur nous est inconnue, – alors qu'il ne s'agit même plus de la révoltante médiocrité du monde chrétien, mais seulement de savoir, comme la pauvre bohémienne, si on peut compter sur un Dieu vivant; – il est affolant de penser que nul n'en sait rien et que personne, à l'exception de quelques êtres douloureux déjà marqués pour la mort, n'en veut entendre parler» (p. 259).
Marqué par la mort, la solitude et la colère, Léon Bloy est un de ces «êtres douloureux» qui paraissent à bout de forces, puisqu'ils se désolent de la procrastination de Celui qu'ils attendent (d'un bout à l'autre du livre résonne douloureusement cette question, début du psaume 12 : «Usquequo Domine ?», jusqu'à quand, Seigneur ?) et qu'ils n'ont presque plus, et c'est dans cette ultime réserve que se tient l'écriture, la patience d'attendre. Léon Bloy, dans son livre, ne cesse de rappeler l'urgence absolue de cette venue, qui dessillera les yeux et nous permettra, enfin, de voir directement, et non pas au travers d'un miroir : «Mais quand donc se manifestera-t-il enfin, le Dieu vivant, le Dieu adorable de la Crèche et du Calvaire, le Dieu des pauvres soldats qui agonisent dans les tortures, et que personne ne cherche plus ?» (p. 260), qui nous permettra aussi de remonter le cours du temps jusqu'à l'instant de la Chute d'Adam, car, en effet, selon l'écrivain : «Le temps n'existait pas dans la pensée de l'homme avant sa chute. Adam qui participait à l'éternité divine sous les frondaisons béatifiques de son Paradis ne pouvait en avoir aucune idée. Sa prévarication le lui révéla et ce fut son principe de mort» (p. 268), qui nous permettra e
22/03/2013 | Lien permanent
Actualité bloyenne : Maxence Caron, Emmanuel Godo et Yves Leclair
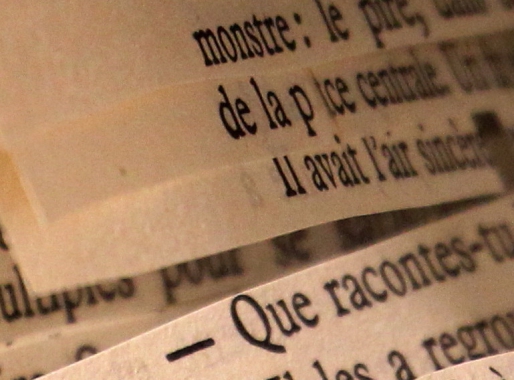
 Léon Bloy dans la Zone.
Léon Bloy dans la Zone.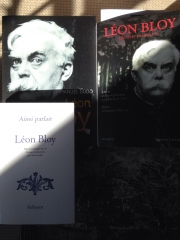 Léon Bloy, Essais et Pamphlets, édition établie et présentée par Maxence Caron, préface d’Augustin Laffay, o.p. (Robert Laffont, coll. Bouquins, 2017, 1 600 pages, 34 euros). Acheter sur Amazon.
Léon Bloy, Essais et Pamphlets, édition établie et présentée par Maxence Caron, préface d’Augustin Laffay, o.p. (Robert Laffont, coll. Bouquins, 2017, 1 600 pages, 34 euros). Acheter sur Amazon.Emmanuel Godo, Léon Bloy, écrivain légendaire (Le Cerf, 2017, 348 pages, 24 euros). Acheter sur Amazon.
Ainsi parlait Léon Bloy. Dits et maximes de vie choisis et présentés par Yves Leclair (Arfuyen, 2017, 175 pages, 13 euros). Acheter sur Amazon.
Il faut remercier Maxence Caron, plusieurs fois évoqué dans la Zone comme ici, de proposer aux lecteurs un fort beau volume regroupant quelques textes remarquables de Léon Bloy comme Le Sang du pauvre, L’Âme de Napoléon, mais aussi Le Salut par les Juifs que le ridicule Alain Soral s’obstine à considérer comme une longue philippique antisémite (1). Les fous ont de ces manies qui les dévorent, certes, et les fous doublés d’imbéciles heureux, eux, en sont littéralement rongés mais jamais n’en crèvent. Un bon éditeur essaiera toujours de caractériser la nature d’un texte qu’il publie, mais l’exercice, appliqué aux livres du Mendiant ingrat, est assez risqué en plus d’être simpliste. Il serait en effet aisé de soutenir que les essais de Bloy, pour reprendre un terme du reste impropre, sont systématiquement pamphlétaires et que ses pamphlets toujours s’entent sur un système ou plutôt une matrice théologico-poétique aussi paradoxale que pourvoyeuse d’images étonnantes, somptueuses, à vrai dire inégalées dans la langue française. Il serait aussi facile de s’étonner de l’absence, dans ce volume, des Dernières colonnes de l’Église alors qu’y figurent les radiographies de la stupidité contemporaine telle qu’elle se donne dans et par la langue quotidienne disséquée par le génial maître écorcheur dans ses Propos d’un entrepreneur de démolitions. La préface de ce recueil de textes, signée par le dominicain Augustin Laffay, est ouvertement apologétique, dans laquelle l’auteur se pose la curieuse question de la sainteté de celui qui fut le secrétaire bénévole de Barbey d’Aurevilly, avant de reculer, non sans humour, en posant une évidence : «Pour être franc, le risque n’est guère élevé de voir un jour sa statue dans les églises, surmontant un tronc en forme de calice pour recueillir le Sang du Pauvre». Si Léon Bloy s’est toujours mis à genoux devant l’autorité de l’Église vicaire du Christ, on peut dire que c’est le cou grêle des ecclésiastiques mondains et des laïcs grenouillant dans les sacristies qu’il a posé sur le billot de sa tonitruante (et ô combien méritée) alacrité : «exégète laïc et théologien en veston (de velours côtelé), Léon Bloy a des audaces propres à inquiéter les produits des séminaires sulpiciens et même romains». C’est en effet peu dire, à l’heure où, un siècle après sa mort, Léon Bloy continue de faire peur aux imbéciles qui n’ont lu de lui que trois phrases rageuses, sans comprendre où elles prenaient leur source, et qui lui reprochent qui son intolérance, qui sa pauvreté feinte, qui ses insultes, qui sa mauvaise foi absolue, j'en passe et j'en oublie. Je me souviens encore des propos que m’écrivit l’ancien patron de La Revue des Deux Mondes, suintant comme à l’accoutumée sa fausse aménité et tout en sourires chassieux, me conseillant de mettre moins de «carburant bloyen» dans mes articles ! Lui, pour réussir comme on dit, a sacrément augmenté la dose de son carburant sollersien, ce qui ne permettra pas à son tacot poussif, repeint aux couleurs de la rue Sébastien-Bottin, d’aller bien loin. Bien plus convaincant, et surtout plus court que le «portrait moral et spirituel» de l’écrivain auquel se livre Augustin Laffay est le texte que Jacques Maritain, filleul de Bloy, a consacré à «ce prétendu pamphlétaire» dont il scrute le secret, qui n’est rien d’autre qu’une «extraordinaire dilection pour les âmes», un «amour de Dieu et des âmes qui emporte tout». Ce sont finalement les différentes notices rédigées par Maxence Caron dans un style parfois un peu affecté mais toujours bouillonnant de colère qui nous donnent la pleine mesure de cet écrivain dans les textes duquel on tombe comme dans un puits qui serait mystérieusement ouvert sur le ciel, lorsqu’il affirme à juste titre que «Colère et Charité ne constituent pas chez Bloy les deux aspects d’une opposition mais la simultanéité d’un même feu spirituel» qui après tout n’est que «la force originelle d’un catholicisme ne pouvant s’entendre, par essence, avec les palpitations de confort qui font frémir d’aisance le bourgeois». C’est en somme répéter une évidence, que nous répétons à notre tour : «Vouloir séparer la colère bloyenne de la charité chrétienne, y prétendre par une réaction réflexe, comme l’ont fait et le font tous les imbéciles» c’est, «chez qui ose ce discours, parler pour sa propre condamnation et pour témoigner de sa propre végétativité quant au Vrai et quant au Livre». Curieux voisinage entre Léon Bloy et Maxence Caron, l’ensemble des notices que le second consacre aux livres du premier pouvant à bon droit être considérées comme un essai à part entière, moins consacré du reste à l’écrivain qu’à un style de vie de plus en plus inimaginable de nos jours, aux faits et gestes, aux paroles aussi «raffinés et violentes, autrement dit bloyens pleinement», ainsi que contre « toute la masse des ordures du journalisme ». Il est évident que, par le truchement de l’écrivain publiant Léon Bloy devant les cochons, Maxence Caron s’en donne à cœur joie contre, il est vrai, l’engeance la plus méprisable de France, appelant de ses vœux «l’anéantissement de la gent journalistique, crétineuse et damnable», Caron termine l’une de ses notices d’une envolée qui le fait d’ores et déjà flotter assez haut au-dessus de ses contemporains, et qui contribuera sans doute à accroître sa réputation d’obscurité coruscante et, jugeront les couillons, bien trop précieuse pour n’être pas ostentatoire, qu’on en juge : «L’affaire dont Bloy s’occupe est un cas particulier noyé dans la masse événementielle et dont plus personne ne se souvient, et c’est là tout l’intérêt de son livre : partant du cas de quiconque qui est homme, et donc seul dans sa pauvreté face à l’iniquité de la communauté des autres hommes mués en dévorante meute de fraternité, l’écrivain apparaît comme témoin existentiel d’un symbolisme nouveau : car il est à la fois, d’une part, la volonté même d’ouvrir la pauvreté humaine, la figure persécutée, à la conscience de la miséricorde qui la protège, à la pensée du Paraclet dont l’imminence l’appelle et la présence la défend; d’autre part, la volonté de regrouper devant le regard de la Vérité, dont l’Amour rejeté est le seul Juge terminal, l’aigreur mortifère des homicides adversaires de leurs frères». Nous sommes bien évidemment à quelques lieues salutaires de la petite écriture à prudentes notules de bas de page telle que la pratiquent les clones de l’Université, et à quelques années-lumière des phrases-limaces des journalistes, et c’est heureux que dans une phrase écrite en bon français soient ainsi désignées la cohérence d’une pensée et d’une écriture fulgurantes et la clé interprétative, symbolique et essentielle, avec laquelle ouvrir cette demeure où devraient converger, en pèlerinage accompli à genoux et sur des tessons de verre, l’immense majorité du troupeau de nos écrivassiers contemporains !
 C’est ce même souci de cohérence non seulement esthétique mais intellectuelle et spirituelle qui anime le beau travail d’Emmanuel Godo. Dans son essai assez vif et intéressant qui un temps seulement semble emprunter la voie biographique (et, dans ce cas, force est de constater qu’il ne nous apporte strictement aucun élément nouveau, et ce n’est du reste absolument pas sa prétention, par rapport au travail fondateur de Joseph Bollery paru au début des années 50), l’auteur insiste avec justesse sur l’une des principales idées que Bloy développe dans chacun de ses livres, qui n’est autre que la certitude, qualifiée par l’essayiste comme étant «l’un des murs les plus puissamment porteurs de son œuvre», «que le monde dit réel est la figuration symbolique d’une vérité d’un ordre supérieur qu’il réfracte de manière déformée mais significative». Si nous tenons, comme l’auteur, que Léon Bloy «a construit une œuvre fascinante», lui-même pouvant être considéré comme «un instrument de mesure du désastre ambiant», nous sommes bien plus réservés sur la volonté, à peu près constante et répétée sur tous les tons par Emmanuel Godo, consistant à faire de Léon Bloy un écrivain parfaitement conscient non seulement de ses dons si singuliers d’exécrateur surpuissant mais de pauvre éructant la tristesse de vivre dans une société oublieuse de Dieu. Cette volonté donne d’ailleurs son sous-titre à l’essai d’Emmanuel Godo, l’auteur ne craignant ainsi pas d’affirmer que l’intraitable écrivain «effacera, une à une, les preuves de son avènement littéraire, détruira les biais par lesquels sa figure d’écrivain s’est constituée», cette opération ayant pour but, en bâtissant inlassablement sa propre légende de «mendiant ingrat», d’ériger une «figure d’absoluité» au sein d’un monde vautré dans le relativisme. Que Léon Bloy, plus que tout autre, ait eu, assez vite, la claire conscience de son rôle et même de sa destinée, nul ne saurait le contester, car tout grand écrivain est aussi un grand lecteur, et, d’abord, un lecteur de sa propre évolution à l’art, à la vie, à cette verticalité que Bloy érigea comme une colonne de silence l’élevant au-dessus de ses pairs, comme un rapace inédit, pour la consternation de tous les médiocres, mais enfin, la ligne de partage nous semble finalement assez mince entre cette claire vision d’un destin supérieur et la pantomime calculée du metteur en scène de son propre génie, célinienne par excellence bien davantage que bloyenne.
C’est ce même souci de cohérence non seulement esthétique mais intellectuelle et spirituelle qui anime le beau travail d’Emmanuel Godo. Dans son essai assez vif et intéressant qui un temps seulement semble emprunter la voie biographique (et, dans ce cas, force est de constater qu’il ne nous apporte strictement aucun élément nouveau, et ce n’est du reste absolument pas sa prétention, par rapport au travail fondateur de Joseph Bollery paru au début des années 50), l’auteur insiste avec justesse sur l’une des principales idées que Bloy développe dans chacun de ses livres, qui n’est autre que la certitude, qualifiée par l’essayiste comme étant «l’un des murs les plus puissamment porteurs de son œuvre», «que le monde dit réel est la figuration symbolique d’une vérité d’un ordre supérieur qu’il réfracte de manière déformée mais significative». Si nous tenons, comme l’auteur, que Léon Bloy «a construit une œuvre fascinante», lui-même pouvant être considéré comme «un instrument de mesure du désastre ambiant», nous sommes bien plus réservés sur la volonté, à peu près constante et répétée sur tous les tons par Emmanuel Godo, consistant à faire de Léon Bloy un écrivain parfaitement conscient non seulement de ses dons si singuliers d’exécrateur surpuissant mais de pauvre éructant la tristesse de vivre dans une société oublieuse de Dieu. Cette volonté donne d’ailleurs son sous-titre à l’essai d’Emmanuel Godo, l’auteur ne craignant ainsi pas d’affirmer que l’intraitable écrivain «effacera, une à une, les preuves de son avènement littéraire, détruira les biais par lesquels sa figure d’écrivain s’est constituée», cette opération ayant pour but, en bâtissant inlassablement sa propre légende de «mendiant ingrat», d’ériger une «figure d’absoluité» au sein d’un monde vautré dans le relativisme. Que Léon Bloy, plus que tout autre, ait eu, assez vite, la claire conscience de son rôle et même de sa destinée, nul ne saurait le contester, car tout grand écrivain est aussi un grand lecteur, et, d’abord, un lecteur de sa propre évolution à l’art, à la vie, à cette verticalité que Bloy érigea comme une colonne de silence l’élevant au-dessus de ses pairs, comme un rapace inédit, pour la consternation de tous les médiocres, mais enfin, la ligne de partage nous semble finalement assez mince entre cette claire vision d’un destin supérieur et la pantomime calculée du metteur en scène de son propre génie, célinienne par excellence bien davantage que bloyenne. Ce n’est du reste pas vraiment une critique mais, je l’ai dit, une réserve, car le travail d’Emmanuel Godo est riche en aperçus remarquables sur l’œuvre de Léon Bloy, qui a ses yeux est et n’est pas un écrivain. Il est un écrivain car nous aurions incontestablement quelque peine à prétendre le contraire, en lisant des œuvres qui sont très certainement parmi les plus riches en images et en métaphores, en saillies assassines et en trouvailles stylistiques, mais aussi en puissance et en finesse, de la langue française. Il n’est pas un écrivain, et Emmanuel Godo insiste sur ce point à la fin de son étude, parce qu’il a très vite eu conscience de l’imperfection non seulement de ses propres dons remarquables mais de toute position exclusivement esthétique. Plus qu’un écrivain donc : Léon Bloy, comme un Kierkegaard ou un Kraus, est un inquiéteur professionnel désirant comme Barbey qui fut son maître «allumer une poudrière sous les pieds des sots», provoquer «la surrection effective d’un désir d’essentiel, la prise de conscience que l’âme non seulement existe mais qu’elle a besoin d’un aliment de haute intensité», un «pamphlétaire incontrôlable, un polémiste outrancier oscillant entre scatophilie et délire visionnaire, le tout cimenté par un style aussi véhément qu’inventif», un électron libre d’une prodigieuse énergie jamais affilié à quelque parti des lettres ou politique que ce soit, et n’hésitant pas à distribuer ses coups les plus féroces contre les auteurs catholiques et les prélats incultes et lâches. Il sait qu’il vit «une époque crépusculaire qui ne se sauvera que par un sursaut des âmes que la politique est inapte à produire».
Emmanuel Godo a raison de souligner que c’est la pauvreté même, les souffrances grandes ou petites mais en tous les cas le plus souvent quotidiennes consignées méthodiquement dans les pages de son extraordinaire Journal qui donne à ses textes une aura unique. Bloy est un témoin qui se veut écrivain, non l’inverse, et sa pauvreté peut ainsi être considérée comme la «source douloureuse, instable, indécente, inacceptable, presque indicible, qui confère une force de vérité à des textes qui ne peuvent dès lors jamais être considérés uniquement sous un angle littéraire ou esthétique puisque se trouve mêlé à eux quelque chose de cette souffrance initiale». C’est donc «la pauvreté qui fait du texte bloyen une parole vivante, née hors des institutions et rétive à toute réception académique». Dès lors, ce n’est pas «d’une position de surplomb que nous vient cette parole», puisqu’en fait «elle vient de plus bas que nous pour nous dire que nous sommes en deçà de l’espérance», étant donné que la voix prophétique de Bloy «nous touche dans la mesure exacte où elle n’émane pas d’une position de surplomb mais au contraire d’un homme qui se trouve plus bas que terre, dans un espace de mépris et de rejet, celui qui est dévolu dans la société bourgeoise au pauvre». Écrivant depuis un lieu que, la plupart du temps, fuient les écrivains bedonnants et consacrés par les honneurs, Léon Bloy n’est pas, ne peut pas seulement être un pamphlétaire comme, à tort, tous les imbéciles, un siècle après sa mort, le pensent encore, sans oublier de lui jeter le mot à la figure. Emmanuel Godo écrit à ce titre : «Le considérer comme un pamphlétaire revient à penser qu’on peut lire son œuvre du bout des lèvres, en en humant la tonalité, en en goûtant l’outrance, sans se laisser emporter là où sa parole entend mener le lecteur. C’est le comble, pour Bloy, de l’assassinat : qu’on puisse le lire sans être ébranlé, sans être saisi par la force du propos, sans reconnaître dans ses mots l’aliment spirituel dont notre âme a besoin. Ce que l’époque appelle pamphlétaire poursuit Emmanuel Godo, c’est le prophète qui lui fait peur, celui dont elle espère conjurer la subversion en lui assignant la fonction subalterne d’amuseur public. Le nommer, c’est déjà l’assujettir, le ramener dans le champ de la relativité».
Non seulement Emmanuel Godo répond à l’objection que nous lui adressions plus haut, mais il file la métaphore de l’écrivain qui n’en est qu’un malgré lui, celle de «l’œuvre qui est autre chose qu’une œuvre», puisque ses textes «rendent un son de parole vraie», à quelques salutaires années-lumière des benêts catholiques de son époque (rassurons-nous, ils existent toujours, puisque La Croix leur propose sa pâtée pour souris de confessionnal) : «Il est à noter que Bloy pense son œuvre comme une réponse à la défaillance catholique. Colonne en vue d’une refondation, exemple, cierge pascal, conservatoire de la parole vraie, arche, flamme pour une croisade à venir, elle se donne comme une alternative au simulacre et au désastre».
Témoin, grogneur impénitent, relaps en somme, Léon Bloy ne dédaigne pas la pose et la prose prophétique, car son œuvre «s’adresse à ses lecteurs toutes affaires cessantes» c’est le cas de le dire, «exige d’eux la même conscience tragique d’un abandon, d’une perte fondamentale à laquelle il n’est pas possible de répondre avec demi-mesure». Ainsi pouvons-nous éclairer le véritable sens qu’Emmanuel Godo confère au terme «légendaire» qu’il accole à Léon Bloy, terme qu’il faut entendre «dans son sens le plus pleinement étymologique», legenda, ce qu’il faut lire, car «Bloy donne à son œuvre une force paradoxale : censée ne pas être littéraire, se désintéresser des questions strictement esthétiques, elle gagne de sa gratuité apparente un surcroît d’efficacité littéraire» puisqu’elle se présente au lecteur «mue par des motifs supérieurs» : l’œuvre de Léon Bloy «se conçoit dans ce dessin exclusif» qui n’est autre que le fait de «redonner conscience du sens théologique de leur vie et de leur destinée collective à des hommes qui en ont été privés par leur choix d’une pensée démystificatrice».
«Herméneute privilégié de la Providence», «sémioticien extralucide», Léon Bloy est celui qui, mieux que n’importe lequel de ses contemporains voit le sens véritable des événements, qui ne peut être que symbolique, donc de la trame même qui constitue le tissu de l’Absolu : «Dans le monde renversé [depuis la Chute], l’homme qui n’interroge pas la réalité visible comme figuration d’une réalité invisible est comme l’homme qui, devant le miroir, se laisse prendre au piège de l’image». Dès lors, si Léon Bloy peut avouer à bon compte qu’il n’écrit que pour Dieu, c’est parce que son œuvre convoque l’homme (les idiots journalistiques écriraient, ici : l’interpelle), parce qu’elle prétend aller les chercher alors même que, de crainte estomaquée, ce dernier aurait bien plutôt tendance à la fuir. Ce que l’œuvre de Léon Bloy exige, c’est «un embrasement de tout son être, un au-delà du sens, la remise en question radicale des valeurs et des critères d’évaluation sur lesquels se fonde la société prétendument humaine».
Michel Houellebecq, le prudent, tortueux et, finalement, le huysmansien Michel Houellebecq, ferait bien de lire cet essai d’Emmanuel Godo sur un écrivain qu’il n’aime guère, si j’en juge parce qu’il a écrit sur lui dans son dernier roman, Soumission. Voici les tous derniers mots que je dédie à ce Folantin condamné à ne jamais se transformer en Durtal des lettres françaises : «On ne referme pas un livre de Léon B
11/10/2017 | Lien permanent



























































