Rechercher : Achab (Séquelles)
Raphaël Enthoven à Saint-Raphaël : un télévangéliste en action, par Gregory Mion

Platon, Gorgias.
«Car, le plus souvent, que font les hommes dans l’aveuglement de la passion ? Ils attribuent à l’objet de leur amour des mérites qu’il n’a pas.»
Lucrèce, De rerum natura.
«Personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence.»
Pascal, Pensées.
Le drame de Raphaël Enthoven procède d’une regrettable et désormais fréquente délocalisation de la philosophie. À une époque où presque rien n’échappe à la tyrannie du spectacle et du retour sur investissement, la philosophie commence peut-être encore dans les bibliothèques et elle trouve opportunément son point de chute dans les vidéothèques. En cela précisément, le philosophe n’est plus un homme d’écriture patiente ou de dialogue initié à l’improviste dans une rue d’Athènes, mais il s’est corrompu sur des estrades médiatiques où le vulgaire le dispute à l’à-peu-près de la connaissance, volontairement soumis aux décrets d’une capitalisation du savoir qui énonce qu’un minimum de contenu savant doit produire un maximum d’effets vernaculaires – autrement dit, la force présumée d’une idée n’a pas tant vocation à déplacer un circuit neuronal qu’à fomenter une sorte d’érection émotionnelle au profit de celui qui boit à la coupe de cette parole scénarisée. Pour cette philosophie-là, pour cette pensée bassement dépravée, l’enjeu n’est pas d’éduquer le peuple et de l’amener à se poser des questions, encore moins de l’encourager à tester des hypothèses et à remettre inlassablement certains problèmes philosophiques sur l’ouvrage du doute, elle consiste au contraire à débiter un arsenal référentiel qui justifie un tant soit peu le prestige de celui qui allume la mèche de cette artillerie parée à toutes les guerres éclair, la pompe des armes choisies et le tumulte des rafales qui en résultent assommant l’auditoire avec une arrogance de stratégie qui a remporté toutes ses batailles, plongeant la multitude dans un coma artificiel dont elle ne sortira que pour acheter les livres précipitamment écrits par tous ces artificiers de l’argument d’autorité, ces conquérants du sermon et ces diffuseurs de marchandises, autant d’objets où la pensée est certes low-cost mais vendue à des tarifs de business class. Dans cette étrange perspective où toute philosophie est nécessairement absente, on a recruté des hommes et des femmes désengagés du savoir et spécifiquement engagés pour eux-mêmes, bâtisseurs d’ego, entrepreneurs du Moi et fédérateurs des succursales de l’intérêt strictement privé, hommes et femmes qui présentent souvent très bien et qui ne manquent pas d’alibis institutionnels pour être disculpés du crime de civilisation qu’ils commettent en dévoyant la pensée, hommes et femmes qui passeront heureusement, comme tout passe lorsqu’il s’agit d’un feu de paille, comme les anecdotes s’estompent derrière la consistance de l’Histoire et les corrections rétrospectives perpétrées par le temps long, hommes et femmes qui déjà s’apprêtent à rejoindre le funérarium des idoles en attendant d’être inhumés dans une fosse commune puisque d’autres idoles les chasseront et seront à leur tour chassées, tandis que les penseurs individuels, les aristocrates lucides, les mystiques et les dialecticiens du désert, eux, gagneront leur place dans le présent éternel et survivront providentiellement à cette vulgarité de courte durée. Raphaël Enthoven passera et nous nous passerons de lui dans un avenir point si lointain, au même titre que l’on peut se passer de la matière si l’on part du principe qu’une chose n’existe que d’être perçue par les voies mentales, si l’esse n’a de concrétisation que dans le percipi tel que l’eût affirmé l’indépassable Berkeley (1). Alors, ce faisant, le public mentalement comateux qui perçoit Raphaël Enthoven n’est guère qu’une populace pardonnable qui aura tôt fait d’aller percevoir un autre avaleur de sabres dès que leur favori se sera éclipsé vers d’autres positions de la matière, là où plus aucun œil de l’esprit n’a le courage d’être jeté, par crainte du noir ou par désintérêt de ce qui n’est plus aussi brillant sous la nébuleuse des projecteurs (sorte d’esprits artificialisés qui incitent grossièrement au percipi).
De tout ce qui précède, Raphaël Enthoven en possède sans nul doute le savoir (et même les nuances cachées comme nous le verrons) eu égard à son expertise objective de professeur de philosophie : il sait que la philosophie est un exercice de l’incertitude pérenne mais il a préféré, dans l’ensemble, l’incertitude vite consommée en prescriptions réductrices sur certains plateaux de la télévision abâtardie; il sait qu’il a travaillé d’arrache-pied pour vaincre le massif des œuvres classiques et interroger plusieurs de leurs interprètes sur de nobles ondes, mais, après tant d’amabilités pour les textes canoniques et les auditeurs persévérants, il a sombré sur des ondes moins nobles et misérablement assujetties aux actualités, perdant du même coup l’inactualité qui dirige toute âme authentiquement philosophique; il sait que la pensée suggère le silence qui en dit long et la discrétion de celui qui se donne le difficile mandat de penser, mais ces mélodies en sous-sol ont été perturbées par la tentation du tintamarre, par le solfège rugissant de celui à qui l’on demande de venir livrer une pensée affétée à l’heure où l’oreille populaire doit entendre de quoi opiner, ce livreur étant incarné par le «philosophe de service» conscient de sa caricature (2) et des aberrations bavardes qu’il profère, intérimaire de l’opinion qui n’ignore pas son savoir qu’il garde par-devers lui, contorsionniste des discours et des postures, marchand de sommeils dogmatiques à la ville et malin génie qui rebat les cartes du jeu dans ses cryptes livresques; il sait qu’il se dissoudra dans le devenir et que la grande vague du temps qui n’a ni commencement ni fin déglutira la vaguelette de ses entrechats de camelot; il sait enfin que la grammaire du «je» n’est qu’une fiction raisonneuse qui peut éventuellement convenir aux protocoles d’un sujet non-pensant à la télévision des philistins, mais que tout homme qui fait réellement profession de penser connaît l’insurmontable point d’interrogation de ce qui pense quand on dit «je pense», se heurtant ainsi à un «cas de conscience» qui fonde l’humilité du philosophe plus qu’il n’en fortifie l’orgueil (3). Sachant tout cela dans un même faisceau de connaissances et de questionnements correctement digérés, Raphaël Enthoven se glisse dans la peau d’une merveilleuse bigarrure vivante, tour à tour enseignant et entertainer de cervelles maniables, mais tout de même de moins en moins pédagogue et de plus en plus régent des intérêts bien compris, imprésario des idées synthétisées à outrance, itinérant qui visite telle ou telle structure à tropisme grégaire pour donner le sein de l’homélie au troupeau égaré, berger de l’être galvaudé en étant, brumisateur de conformismes pour les animaux à tendances récalcitrantes, et par-dessus tout, clairement et distinctement, détenteur de ce que Pascal appelait «la pensée de derrière» (4), cette pensée qui n’est pas une arrière-pensée, cette pensée qui est plutôt un savoir placidement logé en notre tête et qui nous indique comment agir indépendamment de toute action extériorisée qui trahirait notre double-fond de sagacité. Ainsi Pascal souligne qu’il y a des hommes habiles qui obéissent à la loi parce que c’est la loi, parce que la justice est tout bonnement ce qui est établi et que ce serait inutilement se compromettre d’aller à l’encontre de cela. Puis il y a d’autres hommes, plus nombreux, plus rustres et totalement délestés de cette pensée de derrière, qui obéissent à la loi parce qu’ils la croient juste. Le gouffre est donc immense entre ceux qui devinent les défauts de la loi tout en se donnant la possibilité d’une résistance invisible, et ceux qui, par faiblesse d’esprit, s’imaginent qu’elle est juste et la suivent comme un bétail s’abandonne au fouet qui le ramène au bercail. Façon de mettre en évidence que Raphaël Enthoven, outre les lois qu’il saurait dédire et qu’il dédit parfois comme il faut avec des sophismes seyants, a lui-même atteint le calibre d’une loi terriblement formalisée, force que l’on a fait juste puisqu’il n’a pas été possible que «ce qui est juste fût fort» (5). Par ce tour de prestidigitation où la force véridique a été remplacée par la force de l’illusion plus significative pour les troupeaux humains, Raphaël Enthoven s’élève à la valeur d’un impératif qui suscite l’obéissance et même la prosternation, gravissant avec une somptuosité remarquable les marches du Tribunal imaginaire que l’on fait monter à la tête des masses apprivoisées. Dès lors que Raphaël Enthoven fend le rideau qui le sépare de la scène populaire après avoir méticuleusement préparé son catéchisme dans les coulisses inaccessibles du savoir, il est la loi, il fait la loi, il est juge de l’audience attroupée et partie prenante de son ego diablement distant, voire dédaigneux lorsque l’occasion fait le larron. Et le voilà maintenant tout à fait en scène avec les «qualités empruntées» (6) du télévangéliste et les qualités essentielles de l’homme qui mène sa barque à une tout autre destination que celle qu’il feint de promouvoir dans l’univers visible. En outre, Pascal nous rappellerait que nous n’aimons jamais que des qualités empruntées, ce à quoi nous répondrions qu’il est toujours moins dommageable qu’une femme s’éprenne d’un homme trop habillé plutôt que d’observer une foule qui se rallie à des évangiles apocryphes.
Par ce long détour sur les bariolages cumulés de Raphaël Enthoven, nous avons souhaité distinguer l’homme de fond de l’homme de surface malgré les mélanges décadents, dissocier l’érudit logicien du télévangéliste guindé, deux pôles qui s’interpénètrent perversement, redisons-le, alors qu’ils devraient chacun se maintenir dans leur siège respectif, ce que d’aucuns, en pascaliens émérites, signaleraient par la distinction des grandeurs naturelles (ce que nous sommes en propre) et des grandeurs d’établissement (ce que nous avons obtenu de titres, d’honneurs et de charges selon une condition sociale accidentelle) (7). Il ne nous intéresse pas du tout de commenter les origines et les prétendues facilités d’héritage de Raphaël Enthoven, car c’est regarder un homme par le petit bout de la lorgnette que de lui intenter des procès de ce genre, en revanche nous sommes enclins à sonder intuitivement le naturel qui souffle au cœur de ce bravache personnage à la réputation ascensionnelle. Il nous semble donc que Raphaël Enthoven, par la progressive sécession de lui-même avec la sobriété et son progressif appariement avec la grandiloquence, s’est déporté de la mission de philosopher afin de prospérer sur le terrain d’un assoupissement des idées, comme si son âme, en amont d’un curieux fleuve existentiel, avait par exemple initié sa formation en pilotant le navire d’un penseur honnête avant de se relancer, en aval, dans le navire du salon des Verdurin, cela par nous ne savons quel revirement occulte de l’esprit. De loin en loin toutefois, nous augurons chez Raphaël Enthoven un carnage du sacré, une imperturbable décimation du divin à la faveur d’un pacte blasphématoire où il est averti que la philosophie sera empressée ou ne sera pas. Il s’agit par ce biais de schématiser le fléchissement de la pensée lente et rigoureuse, congédiée par un décret de concupiscence intellectuelle, pensée à laquelle succède la réflexion en accéléré, scandée par les injonctions d’un florilège de médias et par les catastrophiques encombrements des actualités. Mais que diable Raphaël Enthoven va-t-il faire dans cette galère et sur ces mers impures où les tempêtes n’ont pas de panache ? Que cherche-t-il dans les flaches à poulpes socio-démocrates où nul tourbillon ne vient agacer l’ordre établi ? Il y va chaque fois pour essayer d’être le phare de la France, pour que cette dernière sache se situer parmi les flots qui la remuent, à supposer qu’il soit important de renseigner la nation sur le potentiel platonicien d’un ministre ou sur les mérites métaphysiques d’un autre bouffon, le tout en quelques minutes anecdotiques où la formule relâchée doit l’emporter sur la sérieuse rigidité de l’argument. Au regard de ces barbotements en eaux troubles, quelques-uns ont évoqué la catégorie de l’imposture pour qualifier cette attitude de sémaphore du destin conceptuel français, mais ces accusateurs ont une définition inexacte de l’imposture, du moins telle qu’ils l’entendent en ces affaires. En effet, Raphaël Enthoven n’est pas défaillant dans son usage abusif des citations et dans son dépliage des thèses philosophiques, car il faut toujours se souvenir qu’il est de plein droit professeur de philosophie et qu’il fut un temps où il était moins télévisuel, et par conséquent davantage offert à la tempérance des longues méditations retirées du monde braillard. Du reste, si la précipitation contraint Raphaël Enthoven à une approximation ou à un léger déphasage maladroit dans l’exposition d’une thèse, cela n’altère pas intégralement la théorie d’un auteur, et dût-on reprendre les choses collégialement, en aparté et avec plus de champ libre, il ne fait aucun doute que Raphaël Enthoven s’amenderait et nous gratifierait d’une dissertation tripartite sur le sujet qu’il aurait pitoyablement vendangé pour les besoins d’un format inepte. Or c’est justement la notion de format qui accouche de l’imposture et non le soupçon d’incompétence sur les contenus disciplinaires, tant et si bien que si Raphaël Enthoven est un imposteur, il l’est seulement de continuer à soumettre la philosophie à des processus, des formes et des adresses mondaines. Cela, évidemment, tout amoureux de la sagesse, et par extension tout amoureux du λόγος, se refuserait à le commettre, fût-ce en passant à côté d’une carrière tonitruante de philosophe omniprésent, fût-ce en retournant enseigner dans quelque lycée une matière qui souffre de ne pas pouvoir correspondre aux rituels de plusieurs de nos professeurs télévangélistes (et qui ne le doit pas !), matière qui souffrira d’autant plus dès que la réforme imminente sera validée, tuant le sacré à sa façon pendant que certains parasites accomplissent des ravages à d’autres niveaux de l’audimat, on l’a vu, légitimant de la sorte une espèce de réciprocité sournoise qu’il nous est compliqué de renverser – car si Raphaël Enthoven produit une philosophie efficace pour une clientèle massive et à plus forte raison croissante, le politicien ne voit pas pourquoi il ne s’alignerait pas sur cette méthode simplificatrice qui fait du bien à l’esprit au lieu de l’éprouver positivement dans sa géographie neuronale. L’analogie du one man show philosophique avec l’exercice de l’État garant du bonheur est peut-être aventureuse, nous l’avouons, mais elle veut aussi collatéralement proclamer, n’en déplaise à notre télévangéliste ambulant, que si autrefois il fut un digne rebelle de l’Université Populaire de Caen, il n’est plus aujourd’hui que le cousin germain du lion fatigué de Normandie, Michel Onfray bien sûr.
Ainsi le drame de Raphaël Enthoven se dessine avec un peu plus d’insistance et de caractère. Cet homme quadragénaire est désormais censé toucher le sommet de sa vigueur, sa maturité intellectuelle aperçoit le point culminant de sa substance, le corps se connaît manifestement aussi bien que l’âme est connue, et pourtant cet homme paraît se dérober à tout ce qui le hisserait davantage, à tout ce qui pourrait tailler son parcours en Chaussée des Géants, retenu, ce semble, par une incurable disposition de gagne-petit et par l’insidieux pressentiment d’avoir franchi le Cap Horn de la philosophie. Ceux qui ont l’instinct véritablement philosophique connaissent le mirage de la ligne d’arrivée lorsqu’ils ont à cœur d’affronter la haute mer des idées – toute impression d’avoir jeté l’ancre dans un port de plaisance doit être bannie parce que ce type de navigation est un voyage sans retour, un engagement pour la vie. Le navigateur de la philosophie a le goût de fendre l’océan par gros temps, friand des risques et des subterfuges nautiques, lesté d’un cogito qui accepte souvent d’abandonner sa marche en avant pour mieux amorcer le pas de côté qui lui révélera la lumière d’une éventuelle terra incognita de la connaissance. Un tel navigateur est une sorte de cartésien peuplé de repentirs, un vaillant cogitant pris de titubation au fur et à mesure que la houle spéculative fait gonfler la voile de son embarcation de fortune, un zélé méthodique décidément vaincu par l’érotisme des apories, et pas même la promesse de la vérité faite femme ne pourrait à présent l’inciter à trouver le port d’attache qui ferait de lui le patriarche d’un système achevé, voire le démiurge d’un traité conçu sous la dictature d’une raison géométrique, parce que ce capitaine pleinement philosophant, ce mémorable repenti des dogmes, quoique follement épris de perplexité et formidablement secoué de toutes parts, celui-là, ce héros des agressions marines et sous-marines, il n’échangerait cependant pour rien au monde l’excitation d’un amour contrarié par le péril de penser toujours quelque chose qui lui échappe, fût-ce contre la jouissance assurée de se reproduire à l’envi avec une vérité définitive de sa créance. Celui-là, en somme ce descendant mythique du capitaine Achab, et pourquoi pas cet ascendant, poursuit une baleine blanche dont il ne veut pas la mort car il est moins tenté par l’accomplissement que par l’euphorisante infinité du cheminement. Les robustes voyageurs qui ont cette physionomie sont ceux qui ne tremblent pas devant l’étrangeté des rêveries et l’angoisse des mappemondes inédites – ils sont prêts à tous les étonnements, à toutes les surprises et à toutes les inquiétudes, majestueux répondants de la philosophie vérace, amants fidèles de la pensée, infatigables pensifs qui ne se soustraient pas à leur endurante députation dès qu’ils entendent une imprécise lallation de sirène dans leur entendement pourtant éprouvé de dialectique. Par opposition nette avec ces Ulysse qui ont la rame à l’épaule dès le début de leur odyssée puisqu’ils ne retourneront vers aucune Ithaque, Raphaël Enthoven, s’il a pu jadis ressembler à un loup de mer convaincant, n’en est dorénavant plus que l’ombre malheureuse, traînant sa carcasse sur tous les trottoirs de la demi-pensée, tout à fait exténué de ses modestes pérégrinations, lassé de passer d’un costume à un autre selon les maisons de tolérance doxographiques où il est invité à sail
07/10/2018 | Lien permanent
Des arbres à abattre (Une irritation) de Thomas Bernhard, par Gregory Mion

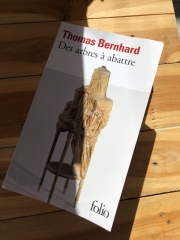 «Il s’empressa donc de dire qu’il n’avait pas pensé à mal.»
«Il s’empressa donc de dire qu’il n’avait pas pensé à mal.»Hermann Broch, Les Somnambules.
«Joe a encore plus de vanité que vous n’en avez jamais eue, et vous en aviez déjà beaucoup pour votre part.»
William M. Thackeray, La Foire aux Vanités.
Si Thomas Bernhard a eu les effets désirables et indésirables d’un produit de contraste dans le milieu culturel autrichien, révélant de ce climat bon nombre de ses horreurs qu’on aurait sûrement aimé ne pas connaître mais que l’on soupçonnait cependant, il n’en a pas moins été, à l’inverse, un pur produit assimilé de cette exaspérante Kulturszene, tel un poisson dans l’eau, fût-il à ses heures de gloire un requin égaré parmi un désolant conglomérat de sardines. D’autre part, si Thomas Bernhard n’était pas né en 1931 mais après l’année 1936, précisément après le 12 juin 1936, on aurait pu croire, dans un élan de croyance à l’égard de la transmigration des âmes, que l’âme accidentellement libérée du corps de Karl Kraus, une âme ignée, une âme furieuse et inextinguible en sa fureur, s’est aussitôt réinstallée dans le corps de celui qui devait devenir l’homme de lettres le plus scandaleusement provocateur de l’Autriche entre les années 1950 et les années 1980 – le corps valétudinaire de Thomas Bernhard pimenté par un esprit de feu.
Et telle fut la carrière littéraire de Thomas Bernhard : une attraction et une répulsion mêlées, une relation d’amant capricieux avec sa maîtresse mondaine, un espoir d’être grand au cœur d’un environnement essentiellement composé de nains et de lilli-putains, ce qui, nous en conviendrons, rapetisse le moindre des espoirs d’être un pur géant de l’art. Mais à rebours des psychologies mégalomanes ou tombées dans une brume qui les empêche de se saisir pour ce qu’elles sont vraiment, Thomas Bernhard, lui, n’a jamais cherché à sauter par-delà le vieux mur de son espoir et à s’imaginer plus beau qu’il ne l’était, car, mieux que personne, il a fait l’inventaire de ses compromissions et il en est arrivé à des conclusions assez peu reluisantes sur sa psyché en même temps qu’il n’a pas épargné la Psyché sidéenne et putassière non seulement des artistes de son pays, mais aussi, par voie logique de complément, de tous les politiciens et autres fonctionnaires gravitant autour de l’Astre de la Création et des Problématiques Culturelles en Autriche. De sorte que s’il y a eu un talent incontestable chez Thomas Bernhard, s’il y a eu chez cet assaillant névrotique un don travaillé de l’écriture, il y a également eu chez lui, dans ses appartements secrets, un certain don de la servilité contrariée et peut-être encore un certain art de lécher, un art d’user de sa langue élaborée sur les zones excitables de l’Intelligentsia de Vienne, de Salzbourg et de toute espèce de soi-disant place forte des arts, une propension à éveiller quelque appendice ou orifice idoine, un aveu de dégradation de la chose artistique, en fin de compte, parce qu’il ne paraît pas rigoureusement cohérent d’associer un succès littéraire se regardant comme authentique à une performance regardée comme intime.
Évidemment que Thomas Bernhard eût volontiers participé à notre goût de l’ironie et il n’y a guère qu’en France où l’ensemble des anchois, maquereaux et autres harengs de l’art ne verraient pas d’incohérence à pratiquer les lois perverses du plus énorme Putanat du monde (la maison de tolérance de la littérature française) tout en prétendant appartenir au clan si convoité des squales ou des épaulards. On ne trouvera jamais pareille hypocrisie sous la plume de Thomas Bernhard, et tantôt requin, tantôt sole de petit bateau, il revient sur les hauts et les bas de ses paradoxales fréquentations artistiques dans son inégalable et réjouissant Des arbres à abattre (1), sous-titré Une irritation, façon d’admettre immédiatement le degré d’aigreur de son texte, faux roman et véritable récit déguisé, façon encore de nous prévenir que nous allons pénétrer à l’intérieur d’une forêt hantée, au fin fond d’une forêt corrompue, au sein d’une succession d’arbres qu’il serait souhaitable de déraciner au plus vite et dont l’auteur – ou notre vaillant et sincère cicérone – ne s’estime pas du tout indépendant.
Maniant brillamment la répétition et s’abouchant tout aussi brillamment avec un ressentiment anaphorique digne des plus intarissables sources de la mauvaise humeur ou de la bile enténébrée, le témoin à charge Thomas Bernhard, en deux cents pages monolithiques et accusatrices dont il est par ailleurs coutumier, nous introduit aux vils arcanes de l’élite culturelle viennoise par l’intermédiaire des époux Auersberger (nom à peine modifié des réels époux Lampersberg) qui furent ses directeurs de conscience esthétique durant les années 1950 et avec lesquels il rompit pendant plusieurs décennies, jusqu’à se retrouver de nouveau sous leur innommable coupe au début des années 1980, par inadvertance présumée et par sentimentalisme avéré, lorsqu’il devait les recroiser au gré d’un hasard qui respire la nécessité et que les Auersberger devaient lui apprendre – quelque chose qu’il savait déjà – le suicide d’une vieille connaissance – Joana en l’occurrence –, morte pendue, morte misérablement, plus ou moins désaccordée du maudit diapason de la Haute Culture autoproclamée, délaissée par un premier mari qu’elle contribua de toute sa féminine assiduité à incorporer dans le corps maladif de cette Haute Culture, puis ré-acclimatée avec un compagnon de secours qui ne sut nullement la secourir dans son irréversible descente aux enfers de femme déclinante, trahie et sûrement plus douée que beaucoup de ceux qui lui ont survécu, à commencer par son ex-mari opportuniste.
Ainsi le flâneur Thomas Bernhard, haïssant les villes perverties (pléonasme pour ce Jean-Jacques Rousseau du Mozarteum) et pourtant les fréquentant souvent, détestant Vienne et ne pouvant s’en passer une bonne fois pour toutes, ainsi flânait-il probablement moins par désir de rêverie gratuite que par trouble appétence de se comporter à l’instar d’un récidiviste des mondanités, espérant, recherchant et peut-être même mendiant une rencontre pseudo-fortuite en sachant parfaitement dans quels quartiers il s’attardait comme s’attarde un éconduit sous le balcon de sa fatale obsession, se doutant nettement qu’il existe des endroits possédés par le démon et que les Auersberger, eux comme tant d’autres de leur démentielle catégorie, ne peuvent être accostés qu’ici plutôt qu’ailleurs, ne peuvent être atteints qu’en des endroits spécifiques de la Cité viennoise des Hérétiques. Par conséquent il arriva ce qui était écrit sur les terribles manuscrits de la destinée dépravée des gens de Vienne se glorifiant de noblesse et de créativité controuvées, il arriva que Thomas Bernhard, sur ces latitudes et ces longitudes concrètement démoniques, entra en morbide collision avec les époux Auersberger sournoisement frappés du deuil de Joana, hypocritement affectés, mimant ou sur-mimant les éléments du tableau périodique de l’obséquiosité circonstancielle en allant au-devant de l’ancien Débutant des Lettres qui sut naviguer par la suite parmi les insignifiants planctons de l’art en devenant romancier et dramaturge, lui adressant la parole comme on l’eût adressée à quelqu’un de récemment visité, le mettant au parfum de l’inconcevable suicide de cette si précieuse amie, puis lui glissant au passage, comme on glisserait un gros billet dans la main d’un petit-neveu qu’on ne voit qu’une fois tous les cinq ans et duquel on essaie d’acheter le syndrome de la famille contentée, lui glissant donc, incidemment, une invitation pour l’un de leurs sacro-saints dîners dits artistiques sur la Gentzgasse, à leur domicile d’héritiers, centre voire épicentre de la Capitale des Génies Européens, septentrion fédérateur des artistes les plus en vue et les plus prometteurs de la divine Autriche, phare éternel du raffinement et surtout sémaphore impérissable de la cooptation farouchement itérative – comme l’est Paris ne l’oublions pas.
Bien entendu il arriva encore que Thomas Bernhard acceptât l’invitation, d’autant que celle-ci, outre qu’elle avait pour mandat de se dérouler en soirée, après les rustiques funérailles de Joana par-delà les pourtours citadins, se donnait aussi pour sacerdoce de fêter un comédien de renom, un acteur de théâtre tout ce qu’il y a de plus sérieux et de plus mythique, convié à partager le couvert en son suprême honneur chez les Auersberger, non seulement pour le célébrer du point de vue de sa remarquable et infatigable carrière, mais également pour mettre en exergue sa performance inaugurale dans le Canard sauvage d’Ibsen, ceci dès le rideau tombé au Burgtheater, l’une des scènes faramineuses de Vienne malgré les rumeurs et les médisances qui voudraient affirmer le contraire. Il est alors advenu que le psychisme tourmenté de Thomas Bernhard a été pris dans les filets des Auersberger accidentellement ou essentiellement rencontrés au fond des eaux usées de la ville, il est advenu qu’il s’est laissé reprendre au jeu de cette séculaire tartufferie, qu’il a verbalisé ou signifié par quelque signe mielleux de non-refus son accord de participer à ce dîner à mi-chemin du cérémonial macabre et de l’apothéose d’un vétéran cabotin, rempli de vilaine curiosité assurément, mais plus que tout autre chose faible, archi-faible, influençable, obéissant, décevant ô combien !, harponné par des Achab de kermesse sur un Pequod de pêche aux canards, enclin à revenir aux origines de l’onanisme de compétition nationale, là où tous les onanistes de l’Autriche déclarée officiellement culturelle se réunissent pour se tripoter le Moi en simulant des efforts surhumains afin de dissimuler une congénitale disposition à l’onanisme social – chez les Auersberger est-il besoin de le rappeler.
Dès lors la voix intérieure de Thomas Bernhard nous fait le descriptif détaillé du logement des Auersberger et de leurs occupants propriétaires ainsi que de leurs blafards convives, une voix enfiévrée, maniaque, paranoïaque sur les bords, une voix qui ne supporte pas d’avoir accepté l’invitation de ce couple exécrable mais qui l’a tout de même acceptée, une voix presque à nulle autre pareille et qui transforme son aigreur en commandant et belliqueux Grossglockner du style, jubilante de méchanceté sans commettre pour autant l’impair de se réserver le meilleur rôle puisque n’importe quel individu présent chez les Auersberger ne peut se soustraire à la honte abyssale d’être là et au mépris insondable des véritables autorités intellectuelles et artistiques qui ne sont forcément pas là, cochant toutes les cases de la soumission psychologique et de la reptation sociale. C’est du reste sur le coussin d’un redondant fauteuil à oreilles que Thomas Bernhard accumule ses observations et ses intermittents souvenirs, tantôt décochant une flèche humiliante, tantôt recevant une flèche de sa mémoire outragée, alternant, nous l’avons d’ores et déjà stipulé dès notre exorde, entre, d’une part, l’incarnation de l’impitoyable juge qui débite ses successives sentences à l’encontre d’une coupable race de décadents, et, d’autre part, la personnification ultime du dilettante crépusculaire qui sait au plus profond de lui-même qu’il ne vaut guère mieux que ses cibles de prédilection dans la mesure où il provient du même moule de pourriture, du même ferment d’infection, de la même graine de malfaisance, d’où l’amplification de sa colère envers cette mafia petite-bourgeoise et son propre caractère versicolore où les sangs épais de la vassalité assumée côtoient les sangs de braise de la toute-puissance justifiée. Et ce qui domine, ce qui se dégage en tant que flagrant motif de ce désolant diagramme de la faiblesse créatrice s’arrogeant les prérogatives d’une force archaïque, c’est le halo fétide d’une incurable dépression, le nœud d’une mélancolie dévastatrice, tous ces parasites absolus et lestés d’une indicible muflerie, de même que le relatif parasite Thomas Bernhard qui se désigne quasiment comme tel durant les dernières pages de ses fielleuses récriminations, toute cette engeance fonctionnant à l’instar d’un réacteur nucléaire de la neurasthénie, de l’affaiblissement et de l’agonie certifiée d’une civilisation depuis longtemps menacée par ses indubitables sangsues : non pas le métèque, non pas l’ouvrier, non pas le délinquant de droit commun, mais l’homme des arts et des humanités, l’homme aristocrate par mensonge, l’homme institutionnel dont la cruauté métabolisée en société répand une souffrance maximale et un éther vicié dans le pays où il sévit. C’est la raison pour laquelle Thomas Bernhard a fait de Vienne un pôle de l’annihilation de tout élan vital et de toute vérité artistique, un refuge du nazisme tardif ou survivant, un réseau ultra-hygiénique de la pulsion de mort qui compromet la condition humaine à la fois en Autriche et dans toutes les nations limitrophes de cette infernale terre, pour ne pas dire dans toutes les nations qui commettent l’imprudence de recevoir des artistes ou des politiques autrichiens de l’époque contemporaine, lesquels sont autant de bagagistes zélés de Satan.
La radicalité de ce que nous avançons ici n’est que le fidèle reflet des radicalités choisies par Thomas Bernhard dans ce livre ou dans d’autres. Reste qu’en le lisant et en le relisant avec un plaisir évident, nous ne pouvons que souhaiter l’émergence d’un tel trouble-fête en France à dessein de remettre à l’endroit ce qui est cul par-dessus tête dans notre pays axiologiquement mourant. Nous manquons en effet d’un franc-tireur issu des opérations commando d’un Karl Kraus ou de quelque autre frère positionné à l’avant-poste du désastre et s’en alarmant effrontément, d’un frère intégré à la vermine et non à la marge cela va de soi, nous manquons, dans l’édition parisienne, dans nos salles de rédaction et dans tous les couloirs de l’establishment hexagonal, d’un homme ou d’une femme capable de réaliser un aussi solide attentat psychique, d’un guerrier développant la faculté de s’engager dans une aussi endurante perspective de nuisance parmi les plus arrogants nuisibles de la planète. Cette impossible figure nous manque mais nous rend assoiffé malgré tout d’une actualité reconstituée par l’intermédiaire d’un genre de révisionnisme littéraire où tel écrivain – après Balzac, Maupassant, Bloy et Patrice Jean pourquoi pas – aurait fait chauffer les pales d’un hélicoptère de combat et serait parti à l’aube – dans sa fiction justicière – pour arroser de napalm les châteaux et les forteresses des Auersberger de nationalité française. Nous autres davantage que les Autrichiens, n’en doutons pas une seconde, possédons une abondante pègre de cuistres et de monopolisateurs des opportunités de créer, et chaque lecteur, en suivant la trame horripilée de Thomas Bernhard, substituera aux ânes bâtés d’Autriche nos ânes bâtés de France. La matière de tels effectifs microbiens étant pléthorique au sein de nos frontières, c’est aisément, bien sûr, que nous parviendrons à confondre un binôme de pédants français aux époux Auersberger se vantant dorénavant d’avoir l’intégrale de Wittgenstein sur leurs étagères, tout comme nous saurons recruter parmi nos écri-naines redoutablement arrivistes une Jeannie Billroth s’estimant au-dessus de Virginia Woolf (peut-être Jeannie Ebner dans la réalité), sans oublier l’inénarrable paradigme de la professeur de lycée de capitale qui tapine davantage qu’elle n’enseigne (Anna Schreker dans le putatif roman de Bernhard).
Quant au comédien qui sert d’alibi au dîner et qui rapplique très tardivement de sa grande Première du Canard sauvage ibsénien, son surgissement effectif chez les Auersberger implique une relance de l’acrimonieux moteur de Thomas Bernhard, un déplacement dans l’espace et dans le temps, puisque le narrateur abandonne son fauteuil à oreilles pour s’asseoir à table et que les réminiscences anciennes ou récentes s’estompent significativement au profit de ce qui a lieu et de ce qui se dit pendant le repas, pendant une soupe de pomme de terres et un sandre inappropriés à des heures aussi indues, quoique le sandre soit d’une notable fraîcheur – pas grand-chose d’intéressant hormis d’insipides considérations sur le théâtre, sur les fluctuations de la critique, sur le tout-et-le-rien d’une assemblée de commensaux blasés. Mais bien qu’affectant les bonnes manières et s’appesantissant de toutes les frivolités d’usage lorsqu’il est question de parler pour ne rien dire ou presque, chacun défèque à tour de rôle dans sa cuvette préférée les dénigrements et les diffamations qui lui siéent et ceux qui attendent l’occasion de déféquer ne peuvent s’empêcher de se pencher sur la cuvette allégorique d’un voisin afin d’humer ce qui vient d’être déféqué, puis afin de voir, naturellement, les mensurations de ces médisants fécalomes, les dégradants résultats de ces hommes et de ces femmes qui n’ont pas pu se retenir « [d’ouvrir] la poche anale » (2). Ainsi les échanges vont et viennent selon des états d’âme que Freud eût explorés à satiété, les paroles s’évacuent sans que Thomas Bernhard, en performant Kanalarbeiter, n’en laisse échapper la moindre miette excrémentielle, et cela se poursuit un long moment avant que le comédien ne soit offensé par une interrogation équivoque de Jeannie Billroth. S’ensuit une mémorable mercuriale contre Jeannie Billroth par le comédien courroucé qui au fur et à mesure de ses contre-attaques procède à une décantation alchimique de l’écrivassière enfin ramenée à sa vraie substance de médiocrité. Cet entracte de véracité est d’autant plus étonnant qu’il intervient au cœur d’une fabrication permanente du mensonge. La réaction du comédien est tellement inattendue qu’elle devient l’action qui soumet tous les autres à l’inaction éberluée. D’abord méjugé par Thomas Bernhard, le comédien remonte soudainement dans son estime en cela qu’il a commis oralement ce que l’écrivain ne paraît pouvoir accomplir que par les voies détournées de l’écriture. Doit-on penser que le comédien n’a plus rien à perdre là où Thomas Bernhard semble encore douter d’être en capacité de se révolter avec autant d’homogénéité dans le panache ? Se peut-il que Thomas Bernhard, en dépit de ses décennies de schisme et de ses régulières bravades, n’ait pas la conscience tranquille vis-à-vis de ceux qui lui ont en quelque sorte mis le pied à l’étrier ? Et plus explicitement encore, est-il envisageable que Thomas Bernhard ne nous fasse part de son irritation que parce qu’il est certain au dernier degré d’être à jamai
26/12/2022 | Lien permanent
Contre les Français de Manuel Arroyo-Stephens

 Á propos de Manuel Arroyo-Stephens, Contre les Français. De l'influence néfaste exercée par la culture française (éditions Exils, 2015).
Á propos de Manuel Arroyo-Stephens, Contre les Français. De l'influence néfaste exercée par la culture française (éditions Exils, 2015).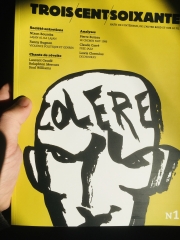 Je signale que mon article a été traduit en créole haïtien par Mehdi Chalmers pour la revue Trois cent soixante, présentée sur son site.
Je signale que mon article a été traduit en créole haïtien par Mehdi Chalmers pour la revue Trois cent soixante, présentée sur son site.Les coïncidences n'existent, en matière de lectures, pas davantage que dans le reste de nos occupations. Tout est signe, puisque l'univers n'est qu'une phrase immense, peut-être infinie. Venant de consacrer une note à la charge de François Rastier contre Heidegger et les heideggériens, quel n'a pas été mon amusement de constater que Manuel Arroyo-Stephens, dans son libelle aussi drôle et savant que témoignant d'une parfaite, donc fort méchante mauvaise foi, évoquait le Maître du Jargon ou plutôt, son influence néfaste en France, ce pays qui est si étonnamment perméable aux faux discours, des déclamations à prétentions universalistes des révolutionnaires coupeurs de têtes aux longues phrases larmoyantes de Renaud Camus et de Richard Millet, qui eux aimeraient bien raccourcir quelques têtes de métèques s'ils avaient le simple courage physique de leurs jivaresques et souchiennes opinions : «Comment la France, avec son culte de la raison et de l'humanisme, put-elle tomber dans le piège d'un charlatan qui considérait la clarté comme le suicide de la philosophie ? Dire que cela arriva au pays de Montaigne, de Descartes, de Pascal ! Que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, que ce qu'on ne peut dire, il faut le taire, que l'intelligibilité est la condition indispensable de la recherche de la vérité, tout cela l'escroc de Fribourg, le personnage le plus lâche qu'ait jamais cautionné la philosophie occidentale, n'en avait cure. Il monta dans le train du nazisme quand cela l'arrangea et garda un silence éternel sur les crimes de Hitler. Dans le fond, ils avaient quelque chose de commun. Heidegger séduisit les philosophes d'une bonne partie du monde tandis que Hitler séduisait les masses allemandes» (1).
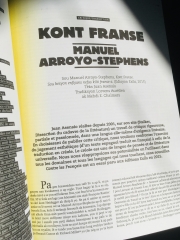 C'est au cours du XXe siècle que Heidegger a fait plonger la culture française dans le «marasme» (le titre du dernier chapitre du livre) et même «le culte du néant, l'apothéose du bavardage et du charabia», au travers, ajoute Manuel Arroyo-Stephens, de Heidegger, qualifié d'«imposteur», de «théologien déguisé en philosophe» et de «protonazi et antisémite répugnant, qui ne se gênait pas pour séduire ses élèves, fussent-elles juives» (p. 125). Il est amusant de constater que l'auteur n'a pas de mots assez durs contre l'esprit de clan qu'a favorisé l'existentialisme par le truchement de Jean-Paul Sartre qui, pas plus que Martin Heidegger, n'a les faveurs de Manuel Arroyo-Stephens : «Mêlant habilement les ingrédients de la métaphysique, du socialisme scientifique et de la psychanalyse, Jean-Paul Sartre créa son système philosophique et fonda sa propre tribu, les existentialistes», prétentieux et intraitables moutons obéissant à la vertu si typiquement française, donc condamnable, selon laquelle l'histoire de «la littérature et de toute la création artistique répond en France à des schémas récurrents qui se répètent de génération en génération depuis la Renaissance et qui se forment toujours autour de mouvements et de groupes». En effet, les Français, tout à la fois veaux et moutons, donnent «plus d'importance à l'histoire de la littérature et aux écoles littéraires qu'à la littérature elle-même», comme l'ont si bien compris «André Breton et tous les chefs de file de par le monde» (p. 128).
C'est au cours du XXe siècle que Heidegger a fait plonger la culture française dans le «marasme» (le titre du dernier chapitre du livre) et même «le culte du néant, l'apothéose du bavardage et du charabia», au travers, ajoute Manuel Arroyo-Stephens, de Heidegger, qualifié d'«imposteur», de «théologien déguisé en philosophe» et de «protonazi et antisémite répugnant, qui ne se gênait pas pour séduire ses élèves, fussent-elles juives» (p. 125). Il est amusant de constater que l'auteur n'a pas de mots assez durs contre l'esprit de clan qu'a favorisé l'existentialisme par le truchement de Jean-Paul Sartre qui, pas plus que Martin Heidegger, n'a les faveurs de Manuel Arroyo-Stephens : «Mêlant habilement les ingrédients de la métaphysique, du socialisme scientifique et de la psychanalyse, Jean-Paul Sartre créa son système philosophique et fonda sa propre tribu, les existentialistes», prétentieux et intraitables moutons obéissant à la vertu si typiquement française, donc condamnable, selon laquelle l'histoire de «la littérature et de toute la création artistique répond en France à des schémas récurrents qui se répètent de génération en génération depuis la Renaissance et qui se forment toujours autour de mouvements et de groupes». En effet, les Français, tout à la fois veaux et moutons, donnent «plus d'importance à l'histoire de la littérature et aux écoles littéraires qu'à la littérature elle-même», comme l'ont si bien compris «André Breton et tous les chefs de file de par le monde» (p. 128).Sartre, l'ordure Sartre qui, à la «grande surprise et admiration de ses collègues qui commençaient à célébrer son esprit», «ne tarda pas à expliquer qu'il avait vécu sous les Allemands dans une «clandestinité ouverte»», magnifique euphémisme par lequel cette ordure, «l'ineffable Sartre» (p. 134) donc, qualifia sa reptilienne faculté de résistance à l'Allemand. «Ce qu'on appelle généreusement le système philosophique de Jean-Paul Sartre», poursuit Manuel Arroyo-Stephens, «consistait en un salmigondis d'idées prises chez Husserl et Heidegger, plus tard assaisonnées de piment marxiste, bien agitées avec une phraséologie hégélienne et le tout servi dans le meilleur jargon parisien» (p. 135). Son «œuvre phare, aux dires des spécialistes, fut L’Être et le néant» et, ajoute l'auteur dans un de ces traits si chers à José Bergamín, si «l'on s'en souvient encore aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il possède très peu du premier et beaucoup trop du second» (p. 136) tout comme, à en croire l'auteur, c'est parce que Mao Zedong, «cet affreux poète», voulait obliger «un milliard de ses compatriotes à lire ses vers infâmes, voire ses œuvres complètes», qu'il «a mené la guerre civile et la révolution culturelle» (p. 138).
Dès ces quelques lignes, nous comprenons quels sont les principaux travers (prétention que rien ne fonde, culte d'une raison asséchante menant aux dictatures, goût invétéré de la rhétorique, impuissance artistique qui s'ensuit) que Manuel Arroyo-Stephens prête aux Français, même s'il semble se dédouaner, aux dernières lignes de son libelle, d'avoir mené une charge aussi réjouissante que violente et, diront les prudents, injuste et d'une incroyable mauvaise foi, en affirmant que seul le complexe d'infériorité propre aux Espagnols (cf. p. 9), ainsi que leur envie et leur jalousie (cf. p. 118) peuvent l'expliquer. Il ajoute, malicieusement, qu'il a écrit «ce pamphlet à la manière des Français» (p. 140, l'auteur souligne), façon polie de dire qu'il s'est peut-être lui-même payé de mots, et que son écriture n'en est pas moins critiquable que celle dans laquelle les Français ont fait triompher partout dans le monde leur vanité et leur verbosité.
Né dans «un pays physiquement et moralement dévasté par la guerre civile que le général Franco avait gagnée avec l'aide directe de Mussolini et de Hitler», ainsi qu'avec, ne l'oublions pas, «la complicité lâche et aveugle de l'Angleterre et de la France», Manuel Arroyo-Stephens déclare qu'il a «vu les meilleures intelligences de [sa] génération abêties par la Théorie, par la déliquescence et la délinquance intellectuelles, par cet esprit auto-complaisant et stérile venu de France» (p. 9).
La vanité des Français a toujours été supérieure à leur talent, ce qui est une évidence qu'il est bon de rappeler, car «ils se sont lancés très tôt dans le commerce des idées et des modes, exploitant avec une habileté et une avidité notoires ce que les économistes appellent une rente de situation, et leur a fait croire, avec autant de prétention que de vanité, qu'ils étaient le centre du monde» (p. 15).
Comment pardonner à un peuple qui a fait des contes de La Fontaine son épopée, au détriment de la Chanson de Roland (p. 17) ? Si la raison, que les Français ont toujours préférée, à grand tort, à l'intuition (cf. p. 113) est «la mort de l'art», si «Don Quichotte doit perdre la raison pour trouver la vérité» et que personne, «et surtout pas un Français, n'a pu créer de l'art avec de la raison» (p. 37), comment ne pas moquer une nation composée de jardiniers royaux dont le rêve pas même inavouable est «que les feuilles des arbres tombent directement dans les corbeilles, tant ils veulent civiliser et polir la nature» (p. 46) ?
Manuel Arroyo-Stephens se place du côté des Espagnols, autrement dit du côté de la déraison, de la folie et de la passion, des feuilles qui jamais ne tomberont directement dans les corbeilles : «Il fallait que quelque chose fonctionne de travers en Europe pour que les Français, avec si peu de mérite, parviennent à devenir le centre artistique du continent. On a beau fouiller dans les dictionnaires, les manuels, les livres d'histoire, on ne trouve pas un seul seul écrivain ou artiste français qui puisse justifier cette hégémonie» au cours du XVIIe siècle car, en «l'espace de quelques années disparaissent du paysage artistique européen les grandes figures du baroque (Milton, Calderón, Le Bernin, Rembrandt, Velázquez). Ce moment de vide, la France va le remplir avec ses pauvres artistes maniérés, qui ne seront jamais que des décorateurs de la grande pâtisserie versaillaise. Le seul peintre français d'un certain mérite, Le Lorrain, vivait et travaillait à Rome, et ne pointa jamais son nez en France» (p. 44).
Nous arrivons au foyer d'infection, Voltaire, «miroir concave où ses compatriotes peuvent toujours se reconnaître» (p. 51), que l'auteur peint en jaloux épique de Shakespeare, tout comme il raille les prétentions à la belle langue, confortée par tout un appareillage de règles, de normes et d'instituts et, mais l'auteur n'en touche hélas mot, de prix dits littéraires, dont le plus navrant d'entre eux, le prix Goncourt, est un inimitable mélange de putanat et de nullité, comme nous avons pu le constater ne serait-ce que ces deux dernières années. Revenons au texte de Manuel Arroyo-Stephens : «On n'a pas découvert meilleur moyen pour donner de l'allure et de l'éclat aux artistes médiocres que de les obliger à suivre des règles qui cachent leur manque de talent : légiférer, en art, tue le créateur et produit des artisans. Il n'y a donc pas mieux, pour en finir avec la créativité d'un artiste, que de l'obliger à accepter des normes, des critères et des goûts émanant de ces vénérables institutions nommées académies. Rien n'est plus voisin de l'esprit français, conclut Manuel Arroyo-Stephens, que l'esprit académique» (p. 67-8) qui, du moins durant le ridicule XVIIIe siècle, peut se confondre assez facilement avec un concours de «perruques poudrées et [de] mouches sur le visage», ou encore avec cet «art du paysage en éventail», «le vicomte maniéré des défis et l'abbé idiot des madrigaux», cet art «cérémonieux, mesuré, de la pavane» (p. 69) qui a donné un verbe pronominal qui, si mes souvenirs sont bons, a quelque rapport étymologique avec le mot paon, jetant ainsi une lumière non point crue mais elle-même artificielle et molle sur les habitudes françaises.
Manuel Arroyo-Stephens balaie l'histoire de notre pays depuis ses premières gestes littéraires, que ce dernier n'a selon ses dires pas suffisamment portées au pinacles, lui préférant des fadaises poudrées ou étriquées, et caractérise la Révolution comme la matrice fournissant «le masque, la rhétorique et les méthodes abominables dont les absolutistes de toutes obédiences ont fait un usage si éloquent et sanglant tout au long des deux derniers siècles» (p. 79), Napoléon en étant lui aussi pour ses frais, la «tête pleine de grammaire et de syllogismes» (p. 83), occupé jusqu'à ses derniers jours en exil, «pendant que ses généraux s'amusaient à vendre aux enchères des biens si mal acquis» en Espagne, «au lieu de demander chaque jour pardon pour ses crimes», «à lire... une grammaire !» (p. 93).
Il n'y a pas à louvoyer, car les Français, «fanatiques de l'abstraction, malades de la logique», sont «capables de sacrifier quiconque pour un de leurs syllogismes» (p. 96), mais ne comprennent absolument rien aux véritables génies, comme Goya : «Certainement la violence de Goya, comme celle de Picasso, un siècle plus tard, aura aveuglé non seulement Mérimée, mais toute la peinture française. Ceux qui l'admirèrent, le copièrent et se laissèrent influencer par lui, comme Géricault et Delacroix, restèrent dans le geste, dans la pure rhétorique. Ils ne comprenaient pas la violence intérieure, radicale, le monde beaucoup plus complexe d'un peintre qui avait fait la sourde oreille à la peinture banale et académique en provenance de France. Les Français, y compris les révolutionnaires modernes, étaient, même s'ils croyaient le contraire, trop empreints du classicisme qu'ils avaient chevillé à l'âme, et le romantisme récemment acquis leur était en réalité étranger et lointain. Il n'était tout au plus qu'une réaction anticlassique. Cela faisait déjà trop longtemps qu'entre Ronsard et Rabelais, l'esprit français avait choisi le mauvais chemin» (pp. 98-9), c'est-à-dire Ronsard dans l'esprit de Manuel Arroyo-Stephens.
Ainsi, si le «romantisme allemand» dans sa totalité «se résume à une lutte titanesque pour se libérer du joug français», c'est encore une fois vers la peinture espagnole que l'auteur tourne son regard pour en affirmer la supériorité sur la française, supériorité découlant du fait que les peintres espagnols, eux, n'ont pas renoncé à la passion : «Quand ils [les Français] se trouvent face à la peinture espagnole et se mettent à l'admirer, alors qu'au fond elle leur reste incompréhensible, ils surréagissent et en perdent la mesure. Là où ils étaient habitués à chercher l'harmonie, ils se retrouvent face à une violence inusitée; là où ils cherchent la beauté idéale, ils tombent sur le réalisme le plus cru; éduqués à comprendre la séparation et la hiérarchie des genres picturaux, ils trouvent mélangés le sublime et le grotesque; au lieu d'un projet d'ensemble et d'une utilisation exubérante de la couleur, au lieu d'un dessin harmonieux et correct des postures, ils tombent sur un mouvement impulsif et incontrôlé. Habitués à peindre les morts comme s'ils étaient en train de rêver, ils se retrouvent face aux cadavres de Goya, masses de chair inerte, véritables cadavres» (p. 101). L'auteur va plus loin, car il ne supporte décidément pas la prétention française, d'autant plus appuyée qu'elle ne se fonde, à ses yeux, sur rien de valable, et cela en quelque domaine artistique que ce soit. C'est ainsi que le célèbre tableau de Goya intitulé Le 3 mai fusille de manière allégorique «toute la peinture française du XVIIIe siècle», tandis qu'un siècle plus tard, un autre Espagnol, Pablo Picasso, fusillera à son tour «la peinture française du XXe siècle» (p. 102) avec ses Demoiselles d'Avignon.
J'ai plus d'une fois souri en lisant Manuel Arroyo-Stephens, me souvenant de ma lecture, franchement ennuyée, des Salons de Diderot, comme lorsqu'il écrit par exemple : «Que pouvait-on voir dans la peinture indigeste de Watteau, de Fragonard, de Boucher, de Chardin, dans leurs coloris sensuels et charmants, dans leur bucolisme glouton, entre colonnes et plantes grimpantes, dans leurs figurines de porcelaine exhibant tantôt leur cheville, tantôt leur petit cul, que pouvait-on regarder de ce monde coloré, vain et frivole après avoir contemplé les morts de Goya ?» (p. 103). La réponse est évident et décidément seul un Philippe Sollers, inutile commentateur de tout, peut nous bassiner avec les fadaises pralinées d'un peintre aussi inintéressant que Watteau.
Si les écrivains français sont peu ou prou des apôtres de la rhétorique la plus creuse et sont parfaitement incapables, y compris mêmes lorsqu'ils se rendent au bordel ou dans des pays exotiques, de se libérer de leur grammaire (2), mais aussi de ces structures plus ou moins étatiques comme la Société populaire républicaine des arts (3) inventée par ce «Robespierre du pinceau» (p. 104) que fut David qui ne peignit jamais, dans sa trop fameuse Mort de Marat qu'un «Christ profane, très bien composé, très «bien peint», avec une lumière abstraite, idéalisée, très seyante, qui sanctifie cet apôtre de la guillotine», tableau dont la «rhétorique muette mais très parlante» est destinée à «émouvoir les masses, en transformant en modèle de vertu un délinquant peu ordinaire» (p. 105), nous devons aussi admettre qu'un Flaubert, dont chaque paragraphe, nous dit malicieusement l'auteur, «lui coûtait autant de sueur, de sang et de larmes qu'à Churchill de défendre l'Angleterre» (p. 116), tout comme d'autres écrivains réalistes parmi lesquels l'ignoble Zola, ne valent pas grand-chose comparés, par exemple, à un Dostoïevski : «Visiblement, personne n'eut l'idée de souffler à l'oreille de ces vaillants réalistes qu'un peu plus au nord un certain Dostoïevski était en train de préparer le grand parricide du siècle et que, quelque part dans l'Atlantique nord, le capitaine Achab poursuivait une baleine. Mais quelqu'un peut-il s'imaginer Flaubert décrivant le crime de Raskolnikov, ce personnage qui, au début du roman, n'a pas mangé depuis deux jours, alors que le romancier français a besoin de plusieurs pages pour décrire les huit étages de la pièce montée du mariage de madame Bovary ? Flaubert aurait fait quelque chose que le Russe ne perd pas une minute à faire : décrire la hache avec laquelle est perpétré le grand crime. Il y aurait consacré peut-être un chapitre, oubliant l'essentiel, qui est que la hache est juste le prolongement du bras qui la brandit. Et que la seule chose importante est ce qui se passe dans la tête qui actionne ce bras» (p. 122).
Saluons les éditions Exils pour avoir donné aux lecteurs francophones la possibilité et, je crois, la chance, de pouvoir lire ce court ouvrage de Manuel Arroyo-Stephens, libelle qui s'inscrit dans le sillage de ces livres érudits et fantomatiques, profonds et justes, comme Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et fond en larmes de László Földényi.
Notes
(1) Manuel Arroyo-Stephens, Contre les Français. De l'influence néfaste exercée par la culture française (traduit de l'espagnol par Philippe Thureau-Dangin, Éditions Exils, 2015), p. 126. Dans on édition originale, ce livre a été publié en 1980 sous le titre Contra los Franceses. O sobre la nefasta influenccia. Libelo. L'auteur, né en 1945 à Bilbao, avocat et é
03/02/2016 | Lien permanent
L’Ange de la vengeance : Ferrara ou le cauchemar de Thana, par Francis Moury

Fear City d'Abel Ferrara, par Francis Moury.
Fiche technique succincte
Mise en scène : Abel Ferrara
Prod. : Rochelle Weisberg, Richard Howorth, Mary Kane (Rochelle Films Inc. / Navaron Films)
Dist. américaine : Warner
Scénario : Nicholas St. John
Directeur de la photo : James Momel (en réalité James Lemmo)
Montage : Christopher Andrews
Musique : Joe Delia
Casting succinct
Zoë Tamerlis (en réalité Zoë Lund : rôle de Thana), Albert Sinkis (Albert, le patron de Thana), Darlene Stuto (Laurie), Helen McGara (Carol), Nike Zachmanoglou (Pamela), Jimmy Laine (en réalité Abel Ferrara : premier violeur masqué), Peter Yellen (le voleur, second violeur), Steve Singer (le photographe de mode), Editta Sherman (la logeuse de Thana), Jack Thibeau (l’homme du bar qui raconte son histoire à Thana), Vincent Gruppi (le loubard au coin de la rue qui interpelle les filles), etc.
Résumé du scénario
USA, New York, quartier Manhattan en 1980 : Thana, une belle jeune fille muette qui travaille comme ouvrière dans un atelier de confection, est doublement violée par deux criminels la même soirée. Elle tue le second en état de légitime défense. Traumatisée et devenue paranoïaque, elle arpente désormais les rues la nuit, avec dans son sac à main le pistolet automatique MS 45 de son agresseur…
Critique
«Ou bien les vérités éternelles que la raison découvre dans les données immédiates de la conscience ne sont que des vérités transitoires, et les horreurs de l’existence, les souffrances de Job, celles sur lesquelles pleurait Jérémie, celles que nous percevons à travers les orages de l’Apocalypse, disparaîtront de par la volonté du Créateur de l’univers et des hommes ainsi que s’évanouissent les cauchemars qui s’étaient emparés d’un dormeur, ou bien nous vivons dans un monde dément.»
Léon Chestov, extrait d’un article en hommage à Edmund Husserl, traduit dans La Revue philosophique en 1940, cité par Roland Caillois in Gaétan Picon et coll., Panorama des idées contemporaines, Section I, Les Idées philosophiques, § IV, Les philosophies de l’existence (éd. Librairie Gallimard, 1957), p. 105.
Angel of vengeance/MS. 45 [L’Ange de la vengeance] (États-Unis, 1980) d’Abel Ferrara est tardivement sorti le 18 août 1982 à Paris : c’est une saison alors très creuse, peu propice aux découvertes et servant de bouche-trou aux exploitants. Ce qui lui valut logiquement une relative indifférence critique et publique à quelques heureuses exceptions près. Ironie de l’exploitation et de ses conditions : ce film fantastique tourné avec un petit budget parfaitement utilisé – raison pour laquelle il avait obtenu aux États-Unis une nomination dans cette catégorie économique lors d’un festival de cinéma fantastique – demeure le meilleur film jamais réalisé par Ferrara. Et c’est aussi le plus beau rôle de Zoë Tamerlis alias Zoë Lund (1962-1999) qui noue, à partir précisément de ce film de 1980, une relation forte avec le réalisateur au point de rédiger le scénario de son dostoïevskien Bad Lieutenant (États-Unis, 1992).
De son antérieur Driller Killer, Ferrara conserve bien des éléments emprunts d’un profond gnosticisme : hantise puritaine de la chair, obsession du péché et du rachat ici symbolisés par l’art, là par la religion externalisée en uniforme religieux symbolique, obsession de la chute sous forme de la pauvreté absolue (les clochards, encore très présents), nécessité de purifier le monde à l’aide de la violence salvatrice, seule issue mais issue auto-sacrificielle revendiquée, assumée jusqu’au bout. Mais si Angel of vengeance les conserve, il les raffine aussi syntaxiquement : le montage est sophistiqué, la direction de la photographie de James Lemmo alterne classicisme et avant-guardisme d’une manière plus équilibrée et moins expérimentale, et, last but not least, la direction d’acteurs est cette fois absolument professionnelle. On n’oublie pas l’hallucinant double-viol subi par Thana en ouverture, ni le tempo de la nuit de vengeance où les hommes tombent, ni le démentiel «meurtre-suicide» du client du bar, admirablement et profondément, pour le coup, dostoïevskien ni même, enfin, la fête en forme de carnaval baroque qui tourne à la danse macabre, tragique et ultra-violente. Un symbolisme pesant et constamment angoissant habite le film du début à la fin, assené par une musique lancinante et l’interprétation non moins hallucinée qu’hallucinante de sa vedette. Elle est poussée dans le sens d’une transsexualité d’essence mystique, déplaçant et condensant l’érotisme vers la mort, vidant l’être original au profit d’une représentation incarnée qui le supplante, le transcende bientôt. Thana étant d’autre part – il est aisé de le remarquer – le diminutif du grec «thanatos», notamment lors de la préparation devant le miroir, puis lorsque Albert découvre le MS. 45 à l’emplacement du mont de Vénus. Il y a une dialectique revendiquée de la transsexualité dans l’interprétation comme dans l’écriture du personnage de Thana, qui vise un dépassement intégral et ontologique de la banale condition humaine. Thana est folle mais sa folie est profondément nietzschéenne. La toile d’araignée, la nonne : autant de figures d’un art fantastique surréaliste pleinement concerté.
Le fait que Ferrara lui-même apparaisse masqué comme violeur démoniaque ajoute consciemment au symbolisme revendiqué du film, rétrospectivement et avec une ironie noire qu’il avait prévue et suscitée. Ce qui intéresse Ferrara n’est pas d’intégrer Angel of vengeance dans un quelconque genre ou sous-genre, un être de raison nommé «rape and revenge» ou «film d’autodéfense». Ferrara est, en revanche et de toute évidence, préoccupé par des motifs qui sont ceux d’un Fritz Lang (la culpabilité ontologique) ou d’un Ingmar Bergman (le silence de Dieu) bien davantage que par son intégration dans une des catégories du film noir américain. Catégories qu’il transcende allègrement, d’une manière souvent expressionniste (le cauchemar de Thana, techniquement virtuose) au point de transformer très aisément et très vite son film noir en film fantastique dès ses premières séquences, grâce à sa violence graphique surprenante, et cela jusqu’à la séquence finale, impressionnante encore aujourd’hui tant elle est baroque, ample et riche de suspense.
La pathologie et la folie criminelle, la perversion sexuelle, la ville tentaculaire, la solitude sont des sujets de choix du cinéma fantastique lorsqu’ils sont intégrés à une mythologie pré-existante, illustrée par un personnage traditionnel. Avec ce film, Ferrara renouvelle la donne en innovant : son Ange de la vengeance est une création inédite, novatrice. Esthétiquement aussi, par son rythme comme par son appréhension de l’espace, Ferrara crée sa propre mythologie originale, en une expérience unique qui est vouée à se conclure sans pouvoir être répétée ni reconduite par une quelconque séquelle. Ferrara transforme donc son thriller en un très grand film fantastique, appuyé sur le réalisme documentaire critique le plus virulent, confinant souvent à l’humour, à l’ironie, à l’acidité et à l’amertume les plus incisives. La touche finale comique, apaisante, comporte néanmoins une trace d’absurde presque miraculeuse : alors que tous les personnages principaux ou presque ont été tués ou contraints de tuer pour se sauver, un animal innocent et chétif qu’on croyait mort est bien vivant, et sauvé. New York vaut bien une messe (noire), comme dirait l’autre.
NB : le titre alternatif MS.45 désigne, si nous ne commettons pas d’erreur, autant le pistolet S.&W. chambré en calibre 45 que le calibre «45 ACP» (équivalent en Europe à une mesure de 11,43mm) lui-même des cartouches contenues dans celui-ci, qui appartient au second agresseur de Thana puis à Thana. Les cartouches réelles qu’embrasse Thana lorsqu’elle se prépare pour la fête finale sont d’ailleurs bien des cartouches calibre 45, de type blindé classique, à bout rond (des «round nose» comme on dit là-bas) utilisée depuis 1911 à 1985 environ par l’armée américaine comme munition réglementaire, mais dans le pistolet Colt US1911 A1 qu’il ne faut évidemment pas confondre avec le S.&W. MS45 ici employé.
NB2 : la date du film est bien «1980» au copyright du générique final de sa copie américaine, et non pas 1981, contrairement à ce que mentionne le site américain IMDB.
30/08/2008 | Lien permanent
Kont Franse, Manuel Arroyo-Stephens

 Toutes les langues (ou presque !).
Toutes les langues (ou presque !).Ce texte, dont voici la version originale, a été traduit par Mehdi E. Chalmers et Lorvens Aurélien pour le premier numéro de la revue haïtienne Trois cent soixante.
 Sou Manuel Arroyo-Stephen, Kont Franse. Sou kesyon enflyans nefas kilti franse a (Edisyon Exils, 2015).
Sou Manuel Arroyo-Stephen, Kont Franse. Sou kesyon enflyans nefas kilti franse a (Edisyon Exils, 2015).Pa gen kowensidans nan zafè liv n ap li, ni pa genyen nan kwakseswa n ap regle. Tout bagay ki la a se siy, deske inivè a se yon sèl kokenn fraz, yon fraz ki ta ka menm enfini. M te fenk sot lage yon kòmantè sou atak François Rastier te ekri kont Heidegger ak disip li yo. Se pa ti amize m mwen amize m lè mwen wè sa Manuel Arroyo-Stephens ap di nan ti bwochi li an, kote li melanje fawouch ak konesans, l ap djenge nèt alkole Gran-mèt pawòl woulemdebò a, setadi Heidegger. Li dekri move enfliyans misye sou Lafrans, yon ti peyi w ap sezi jan l sansib pou pyèj diskou latronpans k ap pale w de inivèsalis ak revolisyon, kote se anvi koupe tèt moun k ap pale la a an reyalite, lè w tande yon bann fraz long rechiya tankou pa Renaud Camus ak Richard Millet (1) yo (de nèg sa yo ta byen renmen rakousi kèk tèt moun deyo, kèk tèt etranje, si yo te gen menm gwo ponyèt ti opiyon natifnatal endyen Jivaro yo an). Manuel Arroyo-Stephens di : «kouman Lafrans ak adorasyon l pou Larezon ak Imanis li an, fè kite yo bare l nan pèlen yon aganman ki te vle fè moun kwè reflechi ak pale klè se yon danje mòtèl pou filozofi ? Ou pa ta di se nan peyi Montaigne ak Descartes ak Pascal sa ta rive ! Koze sa w konprann byen nan lespri w fòk ou ka di l byen nan bouch ou, koze sa ou pa jwenn mo pou w di l ou pa bezwen pale l, koze entelijibilte, konprann moun ak konprann pa w de sa w ap chita di, sa se premye kondisyon chache verite, tout koze sa yo, raketè ki soti lavil Fribourg la, pi vye lach filozofi loksidan janm kite penpennen konsa, pou li tout sa se «ki mele m». Heidegger rantre nan zafè nazi a lè sa te bon pou li, e pi li fèmen bouch li pou letènite sou zafè krim Hitler yo. Lè w ap gade byen, de nèg sa yo gen yon kote yo menm jan. Heidegger chame filozòf nan yon bon mòso monn la, tandiske Hitler t ap chame pèp alman an (2).
Se pandan ventyèm syèk la, Heidegger foure kilti Lafrans la nan «depresyon» (se tit dènye chapit liv la) ak «adorasyon Anyenmenm, epi konsekrasyon radotay ak charabya». Manuel Arroyo-Stephens di nou Heidegger se yon «enpostè», yon «teyolojyen abiye an filozòf», yon «kòmansman nazi, ak yon malpwòpte antisemit , ki pa te wont pou l file ti elèv li, menm lè se ti medam jwif yo te ye».
Sa k komik anpil tou, se lè otè a lage nan kò ti lespri klan gwoup egzistansyalis Jean-Paul Sartre la. Manuel Arroyo-Stephens pa fè ni Sartre ni Heidegger mizerikòd sou kesyon sa a : «se pa ti abil li abil nan pran tout kalte engredyan, sòti metafizik, rive Reyalis syantifik, pase pa Psikanaliz, se nan tout sa Jean-Paul Sartre kreye sistèm filozofik li ak pwòp ti nanchon l, egzistansyalis yo». Pou pil sousou djòlè fransè sa yo «literati ak tout zèv atis, se menm chema jenerasyon aprè jenerasyon, depi Larenesans, yon zafè ti mouvman ak ti gwoup» sa se defo Fransè yo menm. Fransè yo se yon ras bèf ak mouton mawoule ap mennen, yo bay»Istwa literati ak mouvman literè pi enpòtans pase literati a menm», se sa «André Breton ak tout lidè mouvman sou latè konprann byen byen». Sartre, salopri yo rele Sartre la, «kolèg li yo te fenk kòmanse selebre lespri panse l, misye fè yo sezi jistank yo blije bal respè», lè li deklare ke li t ap viv anba okipasyon alman nan yon «mawon san kache», se pa ti efemis efemis misye bay la a non, pou l vin eksplike modèl rebelyon pa l la, rebelyon ti zandolit, rebelyon agaman l lan devan alman yo. Manuel Arroyo-Stephens al pi lwen : «Sa moun ki gen jenerozite rele sistèm filozofik Jean-Paul Sartre la se yon mikmak lide li pran nan men Husserl ak Heidegger, li rajoute yon ti piman maksis aprè, li byen souke l ak jagon Hegel la, pou l remèt ou li sou yon plat pale fransè parizyen». «Daprè sa espesyalis yo di, L’Être et le néant [Sa-k-la ak Anyenmenm] se pi gwo chèdèv misye». Lè li di sa, otè a lage menm kalte pwent ekriven José Bergamin te renmen bay yo : «si nou sonje liv Sartre la jis jounen jodi a [Sa-k-la ak Anyenmenm] se sèlman paske w jwenn yon ti zwing nan premye koze a, ak yon pil ak yon pakèt nan dezyèm nan». Menm jan an, daprè Manuel Arroyo-Stephens, se paske «vye ti powèt» yo rele Mao Zedong lan te vle fòse «yon milya konpatriyòt li yo al li vè malouk li ekri yo, atò menm tout liv li te ekri yo» se pou sa «li pran tèt gè sivil la ak revolisyon kiltirèl chinwa a».
 Nan kèk liy sa yo nou gentan konprann tout defo Manuel Arroyo-Stephens mete sou do fransè yo (anyen pa fonde pretansyon konnen nèg sa yo, se yon bann adoran yon larezon ki fin sèch, k ap mennen nan diktati lespri, nan foli pale anpil, nan enpwisans atistik, ak tout sa ki vin aprè). Menm lè nan fen liv, la li ta sanble vle dezavwe tout sa l te di anvan ak yon vyolans dan griyen sou Fransè yo, se tout sa yon moun ki finalman pridan ta di. Misye pa fin klè tou, li ta menm yon ti jan rizèz lè l di se konplèks enferyorite ki pwòp ak pèp panyòl la, anvi epi jalouzi ki lan kè l ki kapab eksplike jan l te monte sou Fransè yo. Nan fè ti rizèz toujou, li di l te ekri« panflè an lan mòd Fransè», yon fason janti pou di tout sa se pale fransè, epitou jan l te deside ekri a pa mwens kritikab pase ekriti fransè yo te itilize pou chita viktwa vanite ak renmen pale anpil yo a nan yon bann kote nan monn la. Viktwa kilti Lafrans sa a te fèt nan yon peyi ki te fin «ravaje fizikman, moralman ak yon gè sivil jeneral Franco te kale gras a konplisite Mussolini ak Hitler». Ravaj sa a te fèt tou ak konplisite lach epi je fenmen Langletè ak Lafrans. Nan peyi sa a Manuel Arroyo-Stephen deklare li wè moun ki te pi entèlijan yo e ki te plis konn li liv nan jenerasyon li an vin bèt akòz teyori, akòz pouriti ak banditis entèlektyèl, ak konplezans pou pwòp tèt ou, tout sa ki pa pot anyen pi plis pase sa, ki sòti Lafrans». Fè dyolè fransè yo te toujou pi gran pase talan yo, se yon bagay tout moun ka wè, men ki bon pou n raple, paske yo «te rantre granm bonè nan komès lide ak tout sa k t ap mennen, yo byen eksplwate ti sa yo te genyen an, ak yon ti kote visye, sa ekonomis yo rele «sitiyasyon rantye». Yo pa manke pa kwè nan tèt yo, yo panse yo se sant monn lan». Kouman pou padone yon pèp ki pran sa La Fontaine ekri pou epope alòs ke yo te gen La Chanson de Roland ? Si larezon, se sa fransè te toujou prefere pase enstitisyon, «se lanmò travay atis», si «Don Quichotte dwe pèdi rezon pou l jwenn laverite» sitou si pesòn «sitou pa yon fransè pa janm reyisi kreye zèv atistik ak larezon», kouman pou n pa ta ri yon nasyon ki konpoze jadinye Lewa, pi gwo rèv yo, yo pa menm bay manti sou sa, se pou fèy pyebwa moun bale ta tonbe dirèk nan kobèy, tant yo ta vle rann lanati pi swa, pi moun de byen» ? Manuel Arroyo-Stephens mete l bò kot Panyòl yo, sètadi bò kot laderezon, sa k fou epi k pasyone, fèy ki pap janm tonbe dirèkteman nan kobèy la : «fòk te gen yon bagay ki pa t mache byen menm nan Lewòp pou Fransè yo avèk tikras merit yo te vinn sant atistik prensipal sou tout kontinan an. Nou pran anpil tan fouye diksyonè, manyèl yo, liv istwa yo, nou pa jwenn pyès ekriven oubyen atis fransè ki kapab jistifye grandèt sa a» pandan XVIIe syèk la. An verite nan kèk ane nan espas atistik ewopeyen an yon bann moun enpòtan epòk baròk la disparèt (Milton, Calderón, Le Bernin, Rembrandt, Velázquez). Moman vid sa a Lafrans pral ranpli li avèk yon pakèt atis bazetaj ki pa t janm plis pase dekoratè ak patisye vèsay. Sèl grenn pent fransè ki gen yon merit toupiti ki te sòti «Lorraine» ki viv, ki travay «Rome», pat janm parèt pwent nen l Lafrans». Nou rive kote bagay la mongonmen an : Voltaire. Nèg sa a se yon «miwa ki bonbe pa anndan, tout konpatriyòt li yo kapab rekonèt tèt yo nan figi l». Arroyo-Stephens drese pòtrè misye : yon nèg ki jalou Shakespeare. Li pase tout pretensyon bèl lang misye a lan rizib, pretansyon sa a chita sou yon pakèt règ, nòm ak enstitisyon yo. Malerezman Arroyo-Stephens pa pale de enstitisyon pri literè yo, sitou pri «Goncourt» la ki fè moun plis konstène pase tout lòt, yon melanj bouzinay ak bagay moun sòt, se sa menm ki pase de dènye lane ki sot pase la yo. Ann tounen nan tèks Manuel Arroyo-Stephens : «nou poko jwenn pi bon mwayen pou voye monte yon pakèt atis sòt, pase fòse moun swiv yon dal règ pou yo ka kache pyès talan yo pa genyen an : met baliz nan bagay atistik, w ap touye atis la, w ap jwenn atizan. Pa gen anyen ki pi bon pou nou fini ak kreyativite atis pase lè w blije l aksepte plizyè prensip, kritè epi jijman ki sòti nan enstitisyon yo rele akademi yo. Manuel Arroyo-Stephens pou li fini : «Anyen pa twò pre lespri fransè pase lespri akademisyen». Lespri sa a pandan XVIIIe syèk rizib la ou rekonèt li, se yon konkou pou mèt perik poudre ak fo grenn bote nan figi yo», «yon seremonyal de la pavane, moun k ap penpennen», «mo sa a la pavane vle di sa zwezo kalekò yon rele pan an ap mache fè, sa montre w karaktè fransè yo pou sa l ye. Men jan mo franse a li menm-menm vegle nou sou jan fransè yo ye, se pa yon limyè natirèl li ye non, se menm koze atifisyèl mòlòlò vye abitid Fransè yo ki anndan l.» Manuel Arroyo-Stephens pase sou tout istwa peyi Lafrans depi nan premye jès literati li yo. Premye jès sa yo, otè a di nou Lafrans pa selebre yo ase, li te pi pito chwazi pil blag figi poudre, plezantri kò rèd, pase sa k bon. Se sitou epòk revolisyon ki nannan ki bay tout «mas madigra, tout vye retorik ak tout metòd abonminab absolitis tout kalte obedyans fè isaj ou pa ka demanti nan syèk sankoulè nou konnen yo». Napoléon li menm «tèt li te plen ak gramè ak silojis», jiska dènye jou li nan legzil «pandan jeneral li yo t ap pran plezi vann ozanchè yon bann byen ki te rive nan men yo pa move wout», dapiyanp yo t ap fè nan peyi Lespay, «olye pou l mande padon chak jou pou krim li yo, li pase tan li», «ap li…gramè!». Pa gen rezon la a pou n ap kache lonbrit, Fransè yo se yon «pakèt fanatik abstraksyon, yon bann obsede lojik yo a», «ki ta kapab sakrifye nenpòt moun pou yon sèl nan silojis yo a». Men yo pa konprann anyen ditou sou jeni tout bon vre tankou Goya : «Nou kwè vyolans Goya a, tankou pa Picasso a yon syèk pi lwen, vegle Mérimée ak tout sa k te nan penti fransè a». «Sa k renmen li, ki kopye l, epi ki kite l enfliyanse yo tankou Géricault ak Delacroix, yo ret kanpe nan jès la, nan retorik la. Yo pa t konprann vyolans pa anndan an, vyolans radikal la. Monn konplèks yon pent ki te fè tankou li pa tande vye penti banal ak akademik ki te sòti nan peyi Lafrans. Tout Fransè yo, ak tout revolisyonè modèn pami yo, menm lè yo ta vle kwè lekontrè, nanm yo twò makònen ak lespri klasik la. Epi pou nou di vrè, Womantis yo te jwenn avan yè a pa t sanble yo, pa t mache nan san yo. Li pa t pi pwofon pase yon senp reyaksyon antiklasik. Sa te fè anpil tan deja depi ant Ronsard ak Rabelais, lespri fransè te gentan chwazi swiv move chimen an». Move chimen sa a se Ronsard li ye, pou Manuel Arroyo-Stephens. Se konsa si «womantis alman» an nan tout sa li reprezante «rezime ak yon kalte goumen kalamite pou kraze chenn sou lespri fransè a», se sou bò penti panyòl otè vire je l pou li di siperyorite Panyòl yo sou Fransè, paske pent panyòl yo pat janm lage kesyon pasyon a : «lè fransè yo fas ak penti panyòl la yo blije admire l, alòske yo pa ka konprann anyen ladan l, yo toujou panike yo paka rete tèt frèt vre pou yo analize l. Kote yo te abitye chache amoni, yo vinn anfas yon vyolans yo pa t janm jwenn pyès kote; kote yo t ap chache bèlte abstrè ki manman tout bèlte, yo jwenn yon reyalis kri; yo te aprann ti lòd klase, separe ak bay chak bagay plas pa l, nan divès kalte penti yo, yo vin jwenn yon penti ki melanje sa k lèd, ki dwòl nèt ak sa ki siblim; nan plas yon kay tou bati, nan plas izaj tèt chaje koulè pou fè wè, nan plas ti desen byen trase, byen chita, ak pozisyon byen fèt kòrèkteman, yo tonbe sou yon mouvman san kontwòl, yon mouvman gwo san. Yo te pran abitid fè penti moun mouri tankou mò te vin vizite yo nan rèv, yo vin jwenn kadav Goya yo, bon jan vyann ki mouri a, pyès vi ladann, yon kadav tout bon vre». Otè a ale pi lwen toujou, se pa ti pa sipòte li pa sipòte pretansyon save fransè yo, li pa wè pyès fondman ladann nan pyès domèn atistik. Pou li tablo Goya tout moun konnen an ki titre Le 3 mai se li ki fizye nan jan pa l «penti fransè XVIIIe syèk la» tandiske yon lòt pent panyòl, Pablo Picasso, «pral fizye tout penti fransè XXe syèk la» ak tablo Les Demoiselles d'Avignon li an. Mwen souri yon bann fwa pandan map li Manuel Arroyo-Stephens, lè mwen sonje jan m te bèl raz m te raz pandan m t ap li Salons Diderot a, mwen souri lè m li Arroyo k ap di : «kisa moun te ka jwenn pou yo wè nan penti ki bay kè plen Watteau, Fragonard, de Boucher, de Chardin, nan tent penti dous, penti bontimoun yo an, nan mitan yon bann kolòn ak plant-grenpant, ti desen sou pòslèn, tank se cheviy, tank se ti bouda yo ou wè, sa moun te ka jwenn pou yo wè nan monn tout koulè sa a, ki pa vle di anyen, ki frivòl, ki sa pou l ta al wè nan lòt tenten sa yo lè yon moun fin kontanple mò Goya montre nou yo» ? Repons lan klè. Sèl yon nèg tankou Philippe Sollers, kòmantatè initil tout sa k egziste, ta ka basinen nou ak grimas ladoudous yon pent raz tankou Watteau. Ekriven fransè yo se apot yon retorik sak vid, menm lè y al nan bòdèl ou byen lòtbòdlo, pou yo ta chape gramè (3) ak chape enstitisyon Leta tankou Sosyete Popilè Larepiblik pou Travay Atis (4) pent David te envante. Nèg David sa a dayè se yon «Robespierre ak penso» (p. 104), sèl sa li te resi penn se Lanmò Marat ki deja twò selèb pou sa l ye, yon «Kris pwofàn, byen bati, byen fèt, ak yon limyè abstrè, san vyann, byen koud, k ap sanktifye yon apot lagiyotin», tablo sa a se yon «retorik bèbè ki pale anpil» li fèt pou «fè mas pèp la kriye devan yon ti delenkan ki pa ti delenkan raz non ! nan fè l pase pou yon bon nèg devan bon nèg». Si nou di sa fòk nou admèt yon nèg tankou Flaubert, chak paragraf li «peye ak plis san, ak plis swe ak plis dlo je pase Churchill k ap defann Langletè» – men ti blag otè a sou Flaubert – se menm bagay ak degoutan yo rele Zola a ak pil lòt ekriven reyalis yo ki pa vo anyen devan yon Dostoïevski : «ou pa ta di pyès moun pa t gen lide di reyalis vanyan sa yo nan zòrèy, pi lwen nan nò, te gen yon nèg yo rele Dostoïevs ki t ap pare pi gwo sasinay papa ki janm fèt, epi lwen nan Atlantik di nò yon kapitèn ki pot non Achab t ap kouri dèyè yon labalèn. Men èske yon moun ka imajine Flobè k ap dekri krim Raskolnikov la ? Nan kòmansman woman an ou konnen pèsonaj sa a poko manje depi de jou, ekriven fransè li menm bezwen plizyè paj pou l dekri w uit etaj gato maryaj madan Bovary. Flaubert ta pito fè yon bagay ekriven Larisi a pa t ap janm pèdi tan l fè, li ta dekri w rach kokenn krim lan pral fèt la. Li te ka ekri yon chapit sou sa, men li t ap bliye sa k pi enpòtan an, rach la se sa yon ponyèt kenbe, se lonje l lonje ponyèt la. Sèl sa ki gen sans se sa ki nan kalbastèt k ap fè ponyèt lan mache» (p. 122).
Nan kèk liy sa yo nou gentan konprann tout defo Manuel Arroyo-Stephens mete sou do fransè yo (anyen pa fonde pretansyon konnen nèg sa yo, se yon bann adoran yon larezon ki fin sèch, k ap mennen nan diktati lespri, nan foli pale anpil, nan enpwisans atistik, ak tout sa ki vin aprè). Menm lè nan fen liv, la li ta sanble vle dezavwe tout sa l te di anvan ak yon vyolans dan griyen sou Fransè yo, se tout sa yon moun ki finalman pridan ta di. Misye pa fin klè tou, li ta menm yon ti jan rizèz lè l di se konplèks enferyorite ki pwòp ak pèp panyòl la, anvi epi jalouzi ki lan kè l ki kapab eksplike jan l te monte sou Fransè yo. Nan fè ti rizèz toujou, li di l te ekri« panflè an lan mòd Fransè», yon fason janti pou di tout sa se pale fransè, epitou jan l te deside ekri a pa mwens kritikab pase ekriti fransè yo te itilize pou chita viktwa vanite ak renmen pale anpil yo a nan yon bann kote nan monn la. Viktwa kilti Lafrans sa a te fèt nan yon peyi ki te fin «ravaje fizikman, moralman ak yon gè sivil jeneral Franco te kale gras a konplisite Mussolini ak Hitler». Ravaj sa a te fèt tou ak konplisite lach epi je fenmen Langletè ak Lafrans. Nan peyi sa a Manuel Arroyo-Stephen deklare li wè moun ki te pi entèlijan yo e ki te plis konn li liv nan jenerasyon li an vin bèt akòz teyori, akòz pouriti ak banditis entèlektyèl, ak konplezans pou pwòp tèt ou, tout sa ki pa pot anyen pi plis pase sa, ki sòti Lafrans». Fè dyolè fransè yo te toujou pi gran pase talan yo, se yon bagay tout moun ka wè, men ki bon pou n raple, paske yo «te rantre granm bonè nan komès lide ak tout sa k t ap mennen, yo byen eksplwate ti sa yo te genyen an, ak yon ti kote visye, sa ekonomis yo rele «sitiyasyon rantye». Yo pa manke pa kwè nan tèt yo, yo panse yo se sant monn lan». Kouman pou padone yon pèp ki pran sa La Fontaine ekri pou epope alòs ke yo te gen La Chanson de Roland ? Si larezon, se sa fransè te toujou prefere pase enstitisyon, «se lanmò travay atis», si «Don Quichotte dwe pèdi rezon pou l jwenn laverite» sitou si pesòn «sitou pa yon fransè pa janm reyisi kreye zèv atistik ak larezon», kouman pou n pa ta ri yon nasyon ki konpoze jadinye Lewa, pi gwo rèv yo, yo pa menm bay manti sou sa, se pou fèy pyebwa moun bale ta tonbe dirèk nan kobèy, tant yo ta vle rann lanati pi swa, pi moun de byen» ? Manuel Arroyo-Stephens mete l bò kot Panyòl yo, sètadi bò kot laderezon, sa k fou epi k pasyone, fèy ki pap janm tonbe dirèkteman nan kobèy la : «fòk te gen yon bagay ki pa t mache byen menm nan Lewòp pou Fransè yo avèk tikras merit yo te vinn sant atistik prensipal sou tout kontinan an. Nou pran anpil tan fouye diksyonè, manyèl yo, liv istwa yo, nou pa jwenn pyès ekriven oubyen atis fransè ki kapab jistifye grandèt sa a» pandan XVIIe syèk la. An verite nan kèk ane nan espas atistik ewopeyen an yon bann moun enpòtan epòk baròk la disparèt (Milton, Calderón, Le Bernin, Rembrandt, Velázquez). Moman vid sa a Lafrans pral ranpli li avèk yon pakèt atis bazetaj ki pa t janm plis pase dekoratè ak patisye vèsay. Sèl grenn pent fransè ki gen yon merit toupiti ki te sòti «Lorraine» ki viv, ki travay «Rome», pat janm parèt pwent nen l Lafrans». Nou rive kote bagay la mongonmen an : Voltaire. Nèg sa a se yon «miwa ki bonbe pa anndan, tout konpatriyòt li yo kapab rekonèt tèt yo nan figi l». Arroyo-Stephens drese pòtrè misye : yon nèg ki jalou Shakespeare. Li pase tout pretensyon bèl lang misye a lan rizib, pretansyon sa a chita sou yon pakèt règ, nòm ak enstitisyon yo. Malerezman Arroyo-Stephens pa pale de enstitisyon pri literè yo, sitou pri «Goncourt» la ki fè moun plis konstène pase tout lòt, yon melanj bouzinay ak bagay moun sòt, se sa menm ki pase de dènye lane ki sot pase la yo. Ann tounen nan tèks Manuel Arroyo-Stephens : «nou poko jwenn pi bon mwayen pou voye monte yon pakèt atis sòt, pase fòse moun swiv yon dal règ pou yo ka kache pyès talan yo pa genyen an : met baliz nan bagay atistik, w ap touye atis la, w ap jwenn atizan. Pa gen anyen ki pi bon pou nou fini ak kreyativite atis pase lè w blije l aksepte plizyè prensip, kritè epi jijman ki sòti nan enstitisyon yo rele akademi yo. Manuel Arroyo-Stephens pou li fini : «Anyen pa twò pre lespri fransè pase lespri akademisyen». Lespri sa a pandan XVIIIe syèk rizib la ou rekonèt li, se yon konkou pou mèt perik poudre ak fo grenn bote nan figi yo», «yon seremonyal de la pavane, moun k ap penpennen», «mo sa a la pavane vle di sa zwezo kalekò yon rele pan an ap mache fè, sa montre w karaktè fransè yo pou sa l ye. Men jan mo franse a li menm-menm vegle nou sou jan fransè yo ye, se pa yon limyè natirèl li ye non, se menm koze atifisyèl mòlòlò vye abitid Fransè yo ki anndan l.» Manuel Arroyo-Stephens pase sou tout istwa peyi Lafrans depi nan premye jès literati li yo. Premye jès sa yo, otè a di nou Lafrans pa selebre yo ase, li te pi pito chwazi pil blag figi poudre, plezantri kò rèd, pase sa k bon. Se sitou epòk revolisyon ki nannan ki bay tout «mas madigra, tout vye retorik ak tout metòd abonminab absolitis tout kalte obedyans fè isaj ou pa ka demanti nan syèk sankoulè nou konnen yo». Napoléon li menm «tèt li te plen ak gramè ak silojis», jiska dènye jou li nan legzil «pandan jeneral li yo t ap pran plezi vann ozanchè yon bann byen ki te rive nan men yo pa move wout», dapiyanp yo t ap fè nan peyi Lespay, «olye pou l mande padon chak jou pou krim li yo, li pase tan li», «ap li…gramè!». Pa gen rezon la a pou n ap kache lonbrit, Fransè yo se yon «pakèt fanatik abstraksyon, yon bann obsede lojik yo a», «ki ta kapab sakrifye nenpòt moun pou yon sèl nan silojis yo a». Men yo pa konprann anyen ditou sou jeni tout bon vre tankou Goya : «Nou kwè vyolans Goya a, tankou pa Picasso a yon syèk pi lwen, vegle Mérimée ak tout sa k te nan penti fransè a». «Sa k renmen li, ki kopye l, epi ki kite l enfliyanse yo tankou Géricault ak Delacroix, yo ret kanpe nan jès la, nan retorik la. Yo pa t konprann vyolans pa anndan an, vyolans radikal la. Monn konplèks yon pent ki te fè tankou li pa tande vye penti banal ak akademik ki te sòti nan peyi Lafrans. Tout Fransè yo, ak tout revolisyonè modèn pami yo, menm lè yo ta vle kwè lekontrè, nanm yo twò makònen ak lespri klasik la. Epi pou nou di vrè, Womantis yo te jwenn avan yè a pa t sanble yo, pa t mache nan san yo. Li pa t pi pwofon pase yon senp reyaksyon antiklasik. Sa te fè anpil tan deja depi ant Ronsard ak Rabelais, lespri fransè te gentan chwazi swiv move chimen an». Move chimen sa a se Ronsard li ye, pou Manuel Arroyo-Stephens. Se konsa si «womantis alman» an nan tout sa li reprezante «rezime ak yon kalte goumen kalamite pou kraze chenn sou lespri fransè a», se sou bò penti panyòl otè vire je l pou li di siperyorite Panyòl yo sou Fransè, paske pent panyòl yo pat janm lage kesyon pasyon a : «lè fransè yo fas ak penti panyòl la yo blije admire l, alòske yo pa ka konprann anyen ladan l, yo toujou panike yo paka rete tèt frèt vre pou yo analize l. Kote yo te abitye chache amoni, yo vinn anfas yon vyolans yo pa t janm jwenn pyès kote; kote yo t ap chache bèlte abstrè ki manman tout bèlte, yo jwenn yon reyalis kri; yo te aprann ti lòd klase, separe ak bay chak bagay plas pa l, nan divès kalte penti yo, yo vin jwenn yon penti ki melanje sa k lèd, ki dwòl nèt ak sa ki siblim; nan plas yon kay tou bati, nan plas izaj tèt chaje koulè pou fè wè, nan plas ti desen byen trase, byen chita, ak pozisyon byen fèt kòrèkteman, yo tonbe sou yon mouvman san kontwòl, yon mouvman gwo san. Yo te pran abitid fè penti moun mouri tankou mò te vin vizite yo nan rèv, yo vin jwenn kadav Goya yo, bon jan vyann ki mouri a, pyès vi ladann, yon kadav tout bon vre». Otè a ale pi lwen toujou, se pa ti pa sipòte li pa sipòte pretansyon save fransè yo, li pa wè pyès fondman ladann nan pyès domèn atistik. Pou li tablo Goya tout moun konnen an ki titre Le 3 mai se li ki fizye nan jan pa l «penti fransè XVIIIe syèk la» tandiske yon lòt pent panyòl, Pablo Picasso, «pral fizye tout penti fransè XXe syèk la» ak tablo Les Demoiselles d'Avignon li an. Mwen souri yon bann fwa pandan map li Manuel Arroyo-Stephens, lè mwen sonje jan m te bèl raz m te raz pandan m t ap li Salons Diderot a, mwen souri lè m li Arroyo k ap di : «kisa moun te ka jwenn pou yo wè nan penti ki bay kè plen Watteau, Fragonard, de Boucher, de Chardin, nan tent penti dous, penti bontimoun yo an, nan mitan yon bann kolòn ak plant-grenpant, ti desen sou pòslèn, tank se cheviy, tank se ti bouda yo ou wè, sa moun te ka jwenn pou yo wè nan monn tout koulè sa a, ki pa vle di anyen, ki frivòl, ki sa pou l ta al wè nan lòt tenten sa yo lè yon moun fin kontanple mò Goya montre nou yo» ? Repons lan klè. Sèl yon nèg tankou Philippe Sollers, kòmantatè initil tout sa k egziste, ta ka basinen nou ak grimas ladoudous yon pent raz tankou Watteau. Ekriven fransè yo se apot yon retorik sak vid, menm lè y al nan bòdèl ou byen lòtbòdlo, pou yo ta chape gramè (3) ak chape enstitisyon Leta tankou Sosyete Popilè Larepiblik pou Travay Atis (4) pent David te envante. Nèg David sa a dayè se yon «Robespierre ak penso» (p. 104), sèl sa li te resi penn se Lanmò Marat ki deja twò selèb pou sa l ye, yon «Kris pwofàn, byen bati, byen fèt, ak yon limyè abstrè, san vyann, byen koud, k ap sanktifye yon apot lagiyotin», tablo sa a se yon «retorik bèbè ki pale anpil» li fèt pou «fè mas pèp la kriye devan yon ti delenkan ki pa ti delenkan raz non ! nan fè l pase pou yon bon nèg devan bon nèg». Si nou di sa fòk nou admèt yon nèg tankou Flaubert, chak paragraf li «peye ak plis san, ak plis swe ak plis dlo je pase Churchill k ap defann Langletè» – men ti blag otè a sou Flaubert – se menm bagay ak degoutan yo rele Zola a ak pil lòt ekriven reyalis yo ki pa vo anyen devan yon Dostoïevski : «ou pa ta di pyès moun pa t gen lide di reyalis vanyan sa yo nan zòrèy, pi lwen nan nò, te gen yon nèg yo rele Dostoïevs ki t ap pare pi gwo sasinay papa ki janm fèt, epi lwen nan Atlantik di nò yon kapitèn ki pot non Achab t ap kouri dèyè yon labalèn. Men èske yon moun ka imajine Flobè k ap dekri krim Raskolnikov la ? Nan kòmansman woman an ou konnen pèsonaj sa a poko manje depi de jou, ekriven fransè li menm bezwen plizyè paj pou l dekri w uit etaj gato maryaj madan Bovary. Flaubert ta pito fè yon bagay ekriven Larisi a pa t ap janm pèdi tan l fè, li ta dekri w rach kokenn krim lan pral fèt la. Li te ka ekri yon chapit sou sa, men li t ap bliye sa k pi enpòtan an, rach la se sa yon ponyèt kenbe, se lonje l lonje ponyèt la. Sèl sa ki gen sans se sa ki nan kalbastèt k ap fè ponyèt lan mache» (p. 122).Ann bay Edisyon Exils ochan pou sa yo ofri lektè ki pale fransè yo, nan tradwi liv sa a, yo ba yo okazyon pou yo li liv tou kout Manuel Arroyo-Stephens la, yon ti liv polemik menm ras ak liv save, plen ak konesans, ak jistès, nan estil Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et fond en larmes [Dostoïevski ap li Hegel epi l tonbe kriye] ke László Földényi te ekri.
Nòt
(1) Renaud Camus ak Richard Millet se de ekriven fransè, k ap goumen pou sa yo rele vrè idantite lang fransè ak ras fransè a kont imigrasyon, sa Renaud Camus rele «Grand Remplacement» (nòt tradiktè).
(2) Manuel Arroyo Stephens, Contre les Français. De l’influence néfaste exercée par la culture française (tradiksyon tèks panyòl, Philippe Thureau-Dangin, Edisyon Exils, 2015). Edisyon orijinal la te pibliye an 1980 ak tit Contra los Franceses, Sobre la nefasta influencia que la cultura francesa ha ejercido en los países que le son vecinos, y especialmente en España. Libelo. Otè a fèt an 1945, vil Bilbao, li etidye avoka ak ekonomi, fonde libreri Turner Madrid nan ane 70. Sa te ba l plizyè pwoblèm ak lapolis anba Franco, diktatè a. Li vin tounen editè aprè sa, li edite èv konplèt gwo ekriven peyi bask, José Bergamin. Li pibliye premye liv li, Contre les Français, san li pa bay non pa l. Jounen jodi a, li wete kò l nan zafè edisyon an nèt. Ti sa m aprann sou li fè m panse li ta dwe nan liv Vila-Matas la, Bartleby et compagnie, ou byen ke l te ka sèvi modèl pou pèsonaj ekriven 2666, m pa bezwen di nou non otè liv sa a. Ann di pou n fini, tout bon editè ta dwe kouri rape dènye liv Manuel Arroyo-Stephens lan, ki gen bèl tit, Pisando ceniza, sètadi Pandan n ap mache sou sann.
(3) An n site mechanste bosal pati sa a : «yo pran pòz «bohème», yo pran pòz «écrivain maudit», fimen opyòm, al nan bòdèl, fè ti vire nan peyi egzotik, yo pa fouti ka chape gramè yo a ! Koze fè ti vè kòlè jenn gason ki fenk fòme sa a! Se tèlman yo tèlman pa li ase Milton, ase Dante, ase Quevedo, wi ! Si l te vle chape lonè sispèk al fini Lakademi, yon bon jan atis pat gen lechwa, se al foure kò w nan bòdèl ou byen imigre nan zile (sa k pi bon an se te fè toude). Men, nan toude sa yo, ou pran chans maladi twopikal ak maladi w ka pran nan fè bagay. Se sa ki sous kote jeni franse yo pran fòs li, e nou poko fenk kare komanse etidye enpòtans bagay sa a. Nou ka sipoze maladi ou pran nan fè bagay te plis mete w sou sa ke maladi twopikal yo. Lè nou fin di sa pa manke anpil pou nou ta deklare jeni franse mouri jou yon Angle dekouvri medikaman penisilin la.
(4) Otè konpare plezi franse pran nan enstitisyon Leta ki swadizan la pou ankouraje travay atis ak entitisyon Linyon sovyétik sistèm stalinis la (cf. p. 105).
08/10/2017 | Lien permanent
La Zone est atopiaque, assurément

Milosz, L'Amoureuse initiation, 1910.
Voici ce que l'on appelle une page de publicité gratuite pour l'excellent éditeur Jérôme Millon, faisant suite à mon éprouvante visite du Salon du Livre.
«Est atopique — ou atopiaque — un texte hors lieu, un texte sans abri autre que les rayons délaissés des bibliothèques d'anciennetés». C’est par cette phrase sibylline que l’éditeur grenoblois Jérôme Millon présente sa collection Atopia, dirigée par Claude-Louis Combet.
Jérôme Millon, Ad Solem et quelques autres, dont je n'hésite pas à parler toutes les fois que je le puis... Comme si, face aux mastodontes de l’édition, finissait par prendre forme puis se constituer un réseau secret qui est peut-être l’honneur véritable des lettres françaises, l’ultime carré de résistance qui ne se rendra que mort. Atopia est donc le nom étrange et évocateur d’une collection consacrée aux textes les plus bizarres de la tradition chrétienne, que seuls avaient parcouru jusqu’à présent quelques universitaires spécialistes d’auteurs forts peu connus du grand public, que nous pourrions ranger dans la catégorie inédite de la littérature spirituelle contestataire, voire hérétique. L’effort admirable qu’il a bien fallu déployer pour faire naître puis vivre Atopia n’a pas dû manquer de paraître disproportionné et comique, d’abord pour d’évidentes difficultés économiques, ensuite parce que toute entreprise, à plus forte raison si elle est éditoriale, qui ne se nourrit pas de la frénésie parisienne semble condamnée à devoir végéter au fin fond d’un de ces bourgs mélancoliques et immuables dont notre pays a encore le secret.
Je vois une seconde raison, plus profonde, qui à coup sûr s’est dressée devant cet éditeur comme un poteau criard, raison à vrai dire constitutive de la vie intellectuelle même de notre pays depuis plus de deux siècles. Car, à l’heure où la France est historiquement l’un des pays européens les plus déchristianisés, peut-être même celui qui le plus farouchement a voulu conserver l’héritage pervers de la Révolution (au mieux donc, une distance critique, patiemment entretenue par la majorité des professeurs de l’éducation nationale, envers l’histoire religieuse de notre pays, distance et pensée libre – à moins qu’il ne s’agisse, plus sûrement, de libre-pensée – qui feint d’ignorer que la France s’est construite sur et par une monarchie chrétienne, que la richesse de son histoire est d’abord catholique), vouloir offrir aux lecteurs une littérature qui n’évoque pas les misérables bibelots que prisent par-dessus tout nos écrivains-limaçons mais au contraire la plus haute spiritualité, c’est aller, semble-t-il, à la ruine, tout du moins à l’échec commercial et aussi, par les temps de flicage intellectuel qui sont les nôtres, au devant de l’accusation terrible d’être un réactionnaire, un de ces horribles passéistes s’intéressant aux vieilleries bigotes poursuivis par le Bernard Gui de l’inquisition moderne, le risible et nul Daniel Lindenberg, trois fois surmonté du bonnet souffré d’âne. Et pourtant, en dépit des difficultés que j’imagine, comme les niveaux de la bibliothèque de Borges, se multiplier à l’infini, Jérôme Millon n’a jamais cessé de proposer à ses lecteurs des textes étranges, situés effectivement en marge de la tradition officielle, qui, pour cette raison, méritent que nous les évoquions : toute réelle collection est d’abord une bizarrerie du goût, c’est-à-dire, peu ou prou, une façon de cultiver son indépendance aussi bien esthétique qu’intellectuelle à l’heure où la culture se prétend de masse plutôt que de poids ou de qualité.
 J’ai parlé d’hérésie et pour cause, puisque Atopia n’a pas hésité à publier des manuels d’inquisition ou des travaux érudits sur la sorcellerie, voire des traités expliquant aux lecteurs quels sont les différents instruments de torture utilisés contre les martyrs chrétiens (Antonio Gallonio, Traité des instruments de martyre, 1591). Quelle belle ironie, quelle salutaire ironie dans ce geste courageux ! L’inquisition, ses rouages inhumains et son implacable logique procédurale en volume, alors que la majorité de nos hommes d’Église passent le plus clair de leur ministère à condamner les crimes qu’ils n’ont pas commis, à s’excuser benoîtement des dramatiques erreurs provoquées, jadis, par l’obscurantisme de leurs prédécesseurs qu’ils ne manquent jamais de vouer aux gémonies, entre deux collations servies en l’honneur de l’Universelle et Béatifique Repentance ! Oui, il y a fort à parier que mentionner certains des titres d’Atopia peut vous faire soupçonner, comme j’ai pu par exemple le constater dans certaine librairie catholique lyonnaise, de folie pure et simple, comme si j’avais proposé à tel charmant prêtre pour lequel l’imagination d’un Bernanos est déjà diabolique, de rentrer dans le lit où vomit et hurle la jeune fille possédée du film L’exorciste ! J’imagine combien un Des Esseintes se fût délecté, s’il avait dû souffrir de la muflerie de notre époque et de la trouille qui paralyse nos âmes, et d’abord les premières et les plus hautes, celles de nos prêtres, à jouer le rôle de l’esthète outré qui, pénétrant dans un de ces entrepôts presque exclusivement consacrés à de mielleuses bondieuseries sur le mariage ou le sens évangélique de la copulation, s’estomaquerait de ne point y trouver son in folio diabolique…
J’ai parlé d’hérésie et pour cause, puisque Atopia n’a pas hésité à publier des manuels d’inquisition ou des travaux érudits sur la sorcellerie, voire des traités expliquant aux lecteurs quels sont les différents instruments de torture utilisés contre les martyrs chrétiens (Antonio Gallonio, Traité des instruments de martyre, 1591). Quelle belle ironie, quelle salutaire ironie dans ce geste courageux ! L’inquisition, ses rouages inhumains et son implacable logique procédurale en volume, alors que la majorité de nos hommes d’Église passent le plus clair de leur ministère à condamner les crimes qu’ils n’ont pas commis, à s’excuser benoîtement des dramatiques erreurs provoquées, jadis, par l’obscurantisme de leurs prédécesseurs qu’ils ne manquent jamais de vouer aux gémonies, entre deux collations servies en l’honneur de l’Universelle et Béatifique Repentance ! Oui, il y a fort à parier que mentionner certains des titres d’Atopia peut vous faire soupçonner, comme j’ai pu par exemple le constater dans certaine librairie catholique lyonnaise, de folie pure et simple, comme si j’avais proposé à tel charmant prêtre pour lequel l’imagination d’un Bernanos est déjà diabolique, de rentrer dans le lit où vomit et hurle la jeune fille possédée du film L’exorciste ! J’imagine combien un Des Esseintes se fût délecté, s’il avait dû souffrir de la muflerie de notre époque et de la trouille qui paralyse nos âmes, et d’abord les premières et les plus hautes, celles de nos prêtres, à jouer le rôle de l’esthète outré qui, pénétrant dans un de ces entrepôts presque exclusivement consacrés à de mielleuses bondieuseries sur le mariage ou le sens évangélique de la copulation, s’estomaquerait de ne point y trouver son in folio diabolique…  Un mot sur mon expérience par rapport à cette collection, qui sera tout autant la confession de ma dangereuse monomanie. J’ai découvert Atopia lorsque, au programme de Khâgne il y a quelques années, figurait La Sorcière de Michelet qui, dans sa féroce critique de la procédure inquisitoriale, s’en prenait au très célèbre Marteau des sorcières (Malleus Maleficarum, de nouveau réédité) de Sprenger et Institoris, miraculeusement exposé dans un des étals de la Fnac, justement dans cette collection au graphisme attirant quoique sobre. Depuis, nombre de titres ont été proposés qui se veulent des explorations inédites de territoires troubles, aux marges ou, mieux, aux marches de l’Église, comme les phénomènes de possession (parfois célèbres avec l’Autobiographie de sœur Jeanne des Anges), les récits d’exorcistes (avec l’ouvrage tout aussi connu de Jean-Joseph Surin, le Triomphe de l’amour sur les puissances de l’enfer qui n’est autre que la relation du cas de possession de Jeanne des Anges lors de l’affaire de Loudun), les textes classiques du romantisme allemand (La mystique divine, naturelle et diabolique de Görres), les études universitaires sur les phénomènes de sorcellerie (avec Les sorciers du carroi de Marlou sous la direction de Nicole Jacques-Chaquin, spécialiste de démonologie) ou enfin les traités consacrés aux vampires (Dissertation sur les revenants en corps de Dom Augustin Calmet) et autres monstres hantant nos imaginaires depuis des siècles. Je n’oublie certes pas les ouvrages traitant de mystique avec Angèle de Foligno, Madame Guyon ou encore Hildegarde de Bingen, ainsi que les nombreuses études publiées chez cet éditeur, consacrées à ce même sujet.
Un mot sur mon expérience par rapport à cette collection, qui sera tout autant la confession de ma dangereuse monomanie. J’ai découvert Atopia lorsque, au programme de Khâgne il y a quelques années, figurait La Sorcière de Michelet qui, dans sa féroce critique de la procédure inquisitoriale, s’en prenait au très célèbre Marteau des sorcières (Malleus Maleficarum, de nouveau réédité) de Sprenger et Institoris, miraculeusement exposé dans un des étals de la Fnac, justement dans cette collection au graphisme attirant quoique sobre. Depuis, nombre de titres ont été proposés qui se veulent des explorations inédites de territoires troubles, aux marges ou, mieux, aux marches de l’Église, comme les phénomènes de possession (parfois célèbres avec l’Autobiographie de sœur Jeanne des Anges), les récits d’exorcistes (avec l’ouvrage tout aussi connu de Jean-Joseph Surin, le Triomphe de l’amour sur les puissances de l’enfer qui n’est autre que la relation du cas de possession de Jeanne des Anges lors de l’affaire de Loudun), les textes classiques du romantisme allemand (La mystique divine, naturelle et diabolique de Görres), les études universitaires sur les phénomènes de sorcellerie (avec Les sorciers du carroi de Marlou sous la direction de Nicole Jacques-Chaquin, spécialiste de démonologie) ou enfin les traités consacrés aux vampires (Dissertation sur les revenants en corps de Dom Augustin Calmet) et autres monstres hantant nos imaginaires depuis des siècles. Je n’oublie certes pas les ouvrages traitant de mystique avec Angèle de Foligno, Madame Guyon ou encore Hildegarde de Bingen, ainsi que les nombreuses études publiées chez cet éditeur, consacrées à ce même sujet.  Le lecteur frileux jugera peut-être que lire et chérir de pareils ouvrages n’a strictement rien à voir avec une passion de collectionneur, ce bizarre engouement étant probablement la séquelle de quelque condamnable accointance avec les ténèbres : c’est d’abord, je l’ai dit, oublier un peu facilement quelle part secrète d’étrangeté, selon Walter Benjamin, façonne la manie du collectionneur et, ensuite et plus sérieusement, c’est penser que ces mêmes ouvrages ne nous sont d’aucune utilité, notre époque brillant d’une clarté intellectuelle qui, pense-t-on, saura durablement nous prémunir de tout danger démoniaque, c’est-à-dire de toute intrusion de la folie dans notre cabanon luxueusement ouaté de confort. C’est tout le contraire qui se réalise sous nos yeux et je ne crains pas d’affirmer que, à l’heure où notre rationalité malade ne cesse de produire de nouveaux monstres mille fois plus effrayants que les gnomes que peignait frénétiquement Goya devenu sourd, la lecture d’ouvrages traitant de démonologie ou de sorcellerie, comme le comprirent, malgré d’évidentes nuances, Michel Foucault ou, plus récemment, Michel de Certeau, peut être une réelle et dernière chance de saisir la platitude qui suit : c’est la Raison qui produit des cauchemars, elle seule et non pas son sommeil ou son absence. Ainsi, une véritable étude pourrait être menée consistant à répertorier la date de parution des multiples éditions d’un ouvrage tel que le Marteau des sorcières, ce classique de la littérature démonologique qui semble ne devoir jamais disparaître des réseaux souterrains de la mauvaise conscience occidentale. Il réapparaît comme un fantôme durant les périodes de crise ou de mutation de la société et exige que nous plongions dans les eaux troubles du miroir qu’il nous tend : de la même façon Gilles de Rais hanta les esprits de la fin du XIXe siècle, comme nous pouvons le voir dans Là-bas de Huysmans. Ce rapprochement a évidemment ses limites puisque jamais l’infernal Maréchal de France ne prétendit légitimer ses exactions par l’œuvre d’Aristote, comme le font, non sans une prétention souvent comique, un Sprenger ou un Institoris… L’édition critique du Formicarum de Nider, autre classique de cette littérature noire est annoncée, conçue par Nicole Jacques-Chaquin : gageons qu’elle apporte les mêmes garanties de sérieux universitaire que nous avions pu apprécier dans Les sorciers du carroi de Marlou, modèle de rigueur sans doute difficilement égalable dans la recomposition et l’interprétation d’un fait historique.
Le lecteur frileux jugera peut-être que lire et chérir de pareils ouvrages n’a strictement rien à voir avec une passion de collectionneur, ce bizarre engouement étant probablement la séquelle de quelque condamnable accointance avec les ténèbres : c’est d’abord, je l’ai dit, oublier un peu facilement quelle part secrète d’étrangeté, selon Walter Benjamin, façonne la manie du collectionneur et, ensuite et plus sérieusement, c’est penser que ces mêmes ouvrages ne nous sont d’aucune utilité, notre époque brillant d’une clarté intellectuelle qui, pense-t-on, saura durablement nous prémunir de tout danger démoniaque, c’est-à-dire de toute intrusion de la folie dans notre cabanon luxueusement ouaté de confort. C’est tout le contraire qui se réalise sous nos yeux et je ne crains pas d’affirmer que, à l’heure où notre rationalité malade ne cesse de produire de nouveaux monstres mille fois plus effrayants que les gnomes que peignait frénétiquement Goya devenu sourd, la lecture d’ouvrages traitant de démonologie ou de sorcellerie, comme le comprirent, malgré d’évidentes nuances, Michel Foucault ou, plus récemment, Michel de Certeau, peut être une réelle et dernière chance de saisir la platitude qui suit : c’est la Raison qui produit des cauchemars, elle seule et non pas son sommeil ou son absence. Ainsi, une véritable étude pourrait être menée consistant à répertorier la date de parution des multiples éditions d’un ouvrage tel que le Marteau des sorcières, ce classique de la littérature démonologique qui semble ne devoir jamais disparaître des réseaux souterrains de la mauvaise conscience occidentale. Il réapparaît comme un fantôme durant les périodes de crise ou de mutation de la société et exige que nous plongions dans les eaux troubles du miroir qu’il nous tend : de la même façon Gilles de Rais hanta les esprits de la fin du XIXe siècle, comme nous pouvons le voir dans Là-bas de Huysmans. Ce rapprochement a évidemment ses limites puisque jamais l’infernal Maréchal de France ne prétendit légitimer ses exactions par l’œuvre d’Aristote, comme le font, non sans une prétention souvent comique, un Sprenger ou un Institoris… L’édition critique du Formicarum de Nider, autre classique de cette littérature noire est annoncée, conçue par Nicole Jacques-Chaquin : gageons qu’elle apporte les mêmes garanties de sérieux universitaire que nous avions pu apprécier dans Les sorciers du carroi de Marlou, modèle de rigueur sans doute difficilement égalable dans la recomposition et l’interprétation d’un fait historique. Je dois à cette collection un autre plaisir, la découverte marquante que fut la lecture des Paroles de Dieu de ce grand écrivain oublié qu’est Ernest Hello, ami de Léon Bloy, auquel l’une des sommités littéraires du Monde, Patrick Kéchichian, a consacré une étude larmoyante intitulée Les usages de l’éternité. Je me permets de signaler à nos pusillanimes éditeurs ce qui me semble être un véritable scandale d’ignorance crasse à l’égard d’une œuvre, celle d’Ernest Hello, qui enthousiasma Henri Michaux au point que ce dernier pût se reconnaître deux pères spirituels autant que littéraires : Lautréamont et l’auteur de L’Homme. Les Paroles de Dieu constituent donc une espèce de rareté puisque cet ouvrage est pratiquement le seul de Hello disponible dans le commerce, avec sa «transposition» enflammée du Livre des visions et instructions de Foligno, dont une nouvelle traduction, sans aucun doute plus scientifique que celle d'Hello, a d’ailleurs été proposée par Jérôme Millon.
Je dois à cette collection un autre plaisir, la découverte marquante que fut la lecture des Paroles de Dieu de ce grand écrivain oublié qu’est Ernest Hello, ami de Léon Bloy, auquel l’une des sommités littéraires du Monde, Patrick Kéchichian, a consacré une étude larmoyante intitulée Les usages de l’éternité. Je me permets de signaler à nos pusillanimes éditeurs ce qui me semble être un véritable scandale d’ignorance crasse à l’égard d’une œuvre, celle d’Ernest Hello, qui enthousiasma Henri Michaux au point que ce dernier pût se reconnaître deux pères spirituels autant que littéraires : Lautréamont et l’auteur de L’Homme. Les Paroles de Dieu constituent donc une espèce de rareté puisque cet ouvrage est pratiquement le seul de Hello disponible dans le commerce, avec sa «transposition» enflammée du Livre des visions et instructions de Foligno, dont une nouvelle traduction, sans aucun doute plus scientifique que celle d'Hello, a d’ailleurs été proposée par Jérôme Millon. Je ne puis donc qu’encourager mon lecteur à soutenir cet éditeur atypique sinon atopique, dont je n’ai pu vanter l’extraordinaire richesse et la diversité des ouvrages qu’il propose, notamment en philosophie avec plusieurs titres de Jan Patočka et, en sciences humaines, avec une collection présentant les connaissances paléontologiques les plus récentes sur les plus anciens peuplements de l’Europe. L’avenir d’Atopia ? Sans doute passera-t-il par l’essor de la dernière-née de la maison grenobloise, baptisée La petite collection Atopia, qui compte déjà plus d’une trentaine d’ouvrages et par un réel succès auprès du public, peut-être avec les récentes traductions des ouvrages les plus remarquables de Pétrarque, comme La vie solitaire.
Je ne puis donc qu’encourager mon lecteur à soutenir cet éditeur atypique sinon atopique, dont je n’ai pu vanter l’extraordinaire richesse et la diversité des ouvrages qu’il propose, notamment en philosophie avec plusieurs titres de Jan Patočka et, en sciences humaines, avec une collection présentant les connaissances paléontologiques les plus récentes sur les plus anciens peuplements de l’Europe. L’avenir d’Atopia ? Sans doute passera-t-il par l’essor de la dernière-née de la maison grenobloise, baptisée La petite collection Atopia, qui compte déjà plus d’une trentaine d’ouvrages et par un réel succès auprès du public, peut-être avec les récentes traductions des ouvrages les plus remarquables de Pétrarque, comme La vie solitaire.
29/03/2005 | Lien permanent
Extension du domaine financier de Cécile Coulon : de l’ego et du commerce et rien d’autre que de l’ego et du commerce, p

Je la tiens pour une nullité dont l'unique talent, moins considérable qu'on ne le pense puisqu'il est utilement secondé par une agence chargée de faire la promotion de l'intéressée, est de savoir faire vendre sa production merdailleuse, aisément résumable en quelques éléments de langage ou wording comme univers féminins ou encore histoire fiévreuse et autre baratin habituel.
Petit rappel du démontage du système Coulon qui a toutes les chances de paisiblement naviguer sur l'océan sans la moindre vague qu'est devenue la littérature française, où barbotent quelques animalcules ayant pour profession, paraît-il, d'être des critiques littéraires.
 Lorsque Hello Kitty fait de la poésie, Cécile Coulon floue tous les couillons.
Lorsque Hello Kitty fait de la poésie, Cécile Coulon floue tous les couillons. Du succès en littérature contemporaine : le système bien rôdé de Cécile Coulon, par Gregory Mion.
Du succès en littérature contemporaine : le système bien rôdé de Cécile Coulon, par Gregory Mion.On apprend le 1er février 2019 que le produit Cécile Coulon vient d’être transféré aux Éditions de L’Iconoclaste. On l’apprend grâce au magazine Livres Hebdo, un torche-cul de première catégorie qui s’exprime avec le champ lexical du capitalisme, toujours empressé de nous informer des affaires d’argent et des intrigues du plus vaste et rentable Putanat de France, la République des Lettres bien sûr. Alors qu’un changement d’éditeur devrait signifier avant toute chose une nouvelle aventure esthétique ou une exploration encore plus désintéressée de l’acte créatif, il n’est, pour Cécile Coulon et tant d’autres vendeurs de came, qu’une circonstance financière supplétive. Pour un auteur ou ce que nous identifions comme tel de nos jours, le seul emploi du mot «transfert», d’ordinaire réservé aux contextes sportifs, nous montre séance tenante l’ampleur du désastre qui nous glace d’effroi : la littérature n’est plus qu’une économie de marché pour des rentiers mensualisés de la nullité suffisante. L’allégeance aux réseaux culturels et à toute la chaîne pourrie du livre est devenue aujourd’hui en France la seule possibilité d’émergence d’un texte. En outre, comme les individus qui s’adonnent à cette vassalité sont des natures totalement vénales, compatibles avec le système international des marchandises réputées compétitives, nous n’avons quasiment plus que des sous-textes écrits par des sous-pigistes, destinés à des sous-lecteurs présents et à venir. Ce pourrissement généralisé de la culture littéraire française est par ailleurs voué à s’accroître à cause des réformes successives de l’Éducation Nationale, dont la mission de former des esprits forts a basculé dans le devoir infâme de les déformer, de sorte à ce que des Cécile Coulon puissent s’imposer à la fois dans les centre commerciaux et les manuels de l’enseignement. On devine nécessairement les conséquences de cet accouplement contre-nature entre le marché et le savoir : la profanation définitive de l’intelligence des textes, qui va de pair avec l’immuable dégradation de la vie politique, elle-même productrice de discours sacrilèges.
Sauf catastrophes comparables au séisme de Lisbonne où à l’explosion des bombes atomiques au Japon, qui motivèrent dans les consciences lucides le désir de nouveaux paradigmes, Cécile Coulon va continuer de triompher dans le vice du temps, et la vulgarité de ses succès sera d’autant plus grande que les calamités des gens de vertu seront encore plus grandes. N’oublions jamais que Cécile Coulon existe dans le même siècle que Marien Defalvard. N’oublions jamais que la France a daigné attribuer un Prix Apollinaire à Cécile Coulon pour avoir chié le recueil poétique le plus nul de la nation, et que, parallèlement à cette imposture qui eût dû soulever la France si elle avait été autre chose qu’une putain subordonnée à la Putain de la Spéculation, Marien Defalvard, désormais, en est réduit à publier son œuvre, à tous égards restauratrice du sacré, sur Amazon.
Lorsque les faibles et les illégitimes sont à ce point révérés, semblables à des idoles qui remplacent les anciens fétiches d’une piété minimaliste, l’outrance ne connaît plus de limites et se répand absolument partout, à la faveur de cultes inédits et radicalement avilissants. L’outrance anticipe même la matière de ses futurs bénéfices, et tandis que la rentrée littéraire de janvier 2019 n’a pas tout à fait terminé de tapiner, Livres Hebdo nous fait déjà prendre date pour le 21 août 2019, jour J omnino incomparabili, jour du Débarquement de la daube coulonnesque dans les librairies concrètes et virtuelles (daube à l’écriture «fiévreuse» nous promet-on ridiculement), jour où les cadres supérieurs de L’Iconoclaste auront paradoxalement objectivé la confirmation ultime d’une idole contemporaine à la solde de toutes les passions mesquines victorieuses (le bruit de l'argent, le bruit de la célébrité, le bruit de Soi dans l’Occident philistin). Il fallait quand même le faire et L’Iconoclaste l’a fait : ruiner la volonté pure de briser les idoles en signant une idole de l’époque dépravée, ou, pour le dire plus méchamment, prétendre casser la racaille du folklore littéraire financier tout en étant soi-même une racaille de cette envergure. Une telle contradiction dans la philosophie d’une maison d’édition serait insoutenable si elle était l’unique de son espèce. On savait du reste depuis longtemps que L’Iconoclaste n’avait rien d’un briseur de statues. Les semaines passées, durant lesquelles l’écrivante Adeline Dieudonné a commis un Grand Chelem médiatique avec sa fadasse Vraie vie, ont justifié l’iconodulie de cette maison de perdition qui n’a même plus la dignité de sa sémantique fondatrice.
Les égouts de la littérature française ont par ailleurs une parfaite architecture, voire une parfaite isolation, ce qui permet l’écoulement tranquille et régulier des eaux usées, tant et si bien que quiconque ose en pénétrer avec courage les visqueuses galeries pourra s’apercevoir que ce monde puant répond à la logique du principe de raison suffisante, une merde romanesque étant toujours annonciatrice d’une autre merde romanesque à l’intérieur de ces réseaux où l’Intestin des Lettres Françaises se soulage de ses pets sans risquer d’incommoder un voisin. Cela pour préciser que la signature de Cécile Coulon chez L’Iconoclaste n’est clairement pas le fruit d’une décision arbitraire, ni la source d’un goût bénévole pour l’action artistique. En effet, sur la page Amazon de La Vraie Vie, le récent et négativement retentissant roman d’Adeline Dieudonné, on remarque une petite réclame de Cécile Coulon dans la présentation de l’éditeur, jetée là comme on aurait jeté un caca de nez par la fenêtre. Les naïfs donneraient le bon Dieu sans confession à Cécile Coulon et ils déclareraient ceci avec emphase : «Mais enfin, voyons, c’est très gentil à elle d’avoir soutenu Adeline, de lui avoir mis un peu le pied à l’étrier dans le dédale des servilités lucratives [pardon : cette remarque n’est pas naïve], de partager un peu le gâteau de la renommée.» Les naïfs ont peut-être raison, et, dans ce cas, c’est L’Iconoclaste qui a dû venir toquer à la porte de Cécile Coulon, façon de remercier la négociante professionnelle pour son «coup de pub» inopiné. Certes, c’est une possibilité, mais dans la mesure où Cécile Coulon cherchait activement un éditeur, dans la mesure où elle est aussi dorénavant représentée par l’agence Trames (selon les gazetiers de Livres Hebdo), il était probablement de bon ton de faire de la réclame à droite et à gauche, au centre et à la périphérie, dans l’attente, comme on dit, d’une réponse favorable. Et hors de toute naïveté, un don, dans la République des Lettres, n’est pas un don s’il n’est suivi d’un contre-don. Il n’y a aucune sorte de gratuité dans le parcours de Cécile Coulon – tout en elle procède de la respiration artificielle des intérêts mutualisés. Par conséquent, dans la mathesis universalis de l’entre-flatterie décomplexée, on verra bientôt Adeline Dieudonné renvoyer l’ascenseur à Cécile Coulon, et au milieu de toute cette vulgarité ostentatoire, L’Iconoclaste espère déjà capitaliser sur la publication annoncée de la cupide auvergnate, pariant, à un an d’intervalle, sur l’effet Dieudonné, souhaitant un succès encore plus fracassant pour Cécile Coulon (qui, elle, doit se frotter les mains avant l’échéance avec la certitude de ces ronflantes perspectives).
Si la réception d’une œuvre est par essence imprévisible, fût-elle une œuvre naine, les temps ont prodigieusement changé, la souplesse des lois esthétiques s’est curieusement rigidifiée, puisque Cécile Coulon est fondamentalement certaine d’avoir toute la presse dans son camp, avec, bien évidemment, toutes les bourriques enchaînées au système des compliments investisseurs, étant donné que passer la pommade à Coulon constitue maintenant un gage de publication, de promotion ou de bonne réputation (parfois les trois simultanément). C’est la raison pour laquelle Livres Hebdo évoque littéralement un «transfert», L’Iconoclaste ayant donc recruté une «attaquante», une marqueuse prolifique, une évidente Most Valuable Player de la rentrée littéraire de septembre 2019, qu’on nous sert sur le plateau sémillant du marché livresque, déposée par une main invisible de plus en plus visible (car de plus en plus outrageante). Ainsi Cécile Coulon a déjà remporté le match de septembre 2019 avant tous ses concurrents. Elle écrase, avec sept mois d’avance, les autres écuries pas encore tout à fait déclarées, comme elle a écrasé les candidats du Prix Apollinaire 2018, malheureux recalés qui du reste le méritaient amplement parce qu’ils ne se sont pas manifestés devant cette infamie, sans doute par envie d’obtenir le Prix Apollinaire dans un futur proche. C’est mathématique et c’est typique d’un pays qui se fabrique des idoles abusives, rappelons-le. Aussi, toute personne qui dira le moindre mal de Cécile Coulon sera dès lors dûment ostracisée de la République des Lettres, et même les membres sceptiques du jury Apollinaire, tel un trémulant Philippe Delaveau, se feront volontiers accuser de pusillanimité tant qu’ils pourront continuer à publier chez Gallimard de lourds tombereaux de rimes. Alors qu’il suffirait de quelques âmes guerrières pour définitivement nous débarrasser de la présence de Cécile Coulon dans les rayons de littérature et de poésie, nos résistants d’opérette préfèrent lui serrer la main, et ils ne le font pas du tout comme le philosophe habile de Pascal.
La longévité de ce Putanat industrialisé s’explique par ce que Montesquieu nommait «l’esprit du commerce» dans l’immense De l’esprit des lois. Le commerce a pour effet naturel de susciter la paix entre les hommes parce que ses régulations occasionnent une matrice rigoureuse d’interdépendance. Tel a besoin d’acheter et tel a besoin de vendre, it is what it is, et les libraires, à cet égard, s’entendent à merveille avec Cécile Coulon. On pourrait se satisfaire de ces relations pacifiques parce que les nations s’en portent admirablement, mais, en ce qui concerne la vérité des rapports privés, dans ce qui se déroule derrière les portes des particuliers, Montesquieu ajoute que les pays où règne exclusivement ce tempérament commercial sont affligés de graves malversations morales – tout y est accompli en fonction de l’argent, d’où la rançon que l’on paie dans les actions humaines où rien n’est véritablement réalisé en vue de l’humanité. D’un côté on gagne une forme de rectitude sociale qui facilite la perpétuation de la paix, mais, d’un autre côté, on perd la nuance de la vie qui ne s’aperçoit même plus qu’elle est placée dans le coma artificiel de la marchandisation intégrale. Il s’ensuit que la paix des nations implique la guerre silencieuse des intérêts, et que tous les succès de Cécile Coulon, outre qu’ils apportent par exemple un opium pour les peuples, font à côté de cela des ravages qui entraînent des séquelles irréversibles pour l’humanité de la France. C’est pourquoi Montesquieu nous dit que l’absence de commerce engendre forcément le «brigandage», mais que ces sociétés canailles possèdent en leur sein un esprit d’hospitalité qui n’existe que rarement dans les sociétés commerciales, par défaillance avérée d’un amour véridique d’autrui. Ainsi ne doit-on rien attendre de Cécile Coulon, à commencer par l’amabilité qui n’est chez elle que de façade ou de provision, à moins qu’il ne faille seulement attendre d’elle ce que Georges Bernanos eût appelé «l’assouvissement des médiocrités», dans un article qu’il fit paraître le 13 mars 1948 au travers des colonnes de L’Intransigeant. Ce que le Grand d’Espagne disait alors de la politique française d’après-guerre dans cet article, on peut le relire et le considérer à juste droit pour nos petits milieux littéraires débiles : «Jamais la plus basse et la plus vulgaire corruption n’a atteint ce degré, non de cynisme – où il y a encore quelque amer défi –, mais d’inconscience presque puérile, infantile, dans le marchandage des places, l’étouffement des scandales et l’étalage obscène des médiocrités assouvies.»
02/02/2019 | Lien permanent
Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 4, par Francis Moury

Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 1.
Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 2.
Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 3.
Les années 1970-1980
Elles sont l’occasion d’un renouveau du cinéma fantastique anglais et américain (États-Unis et Canada anglo-saxon inclus) qui demeure, quantitativement, le plus important du fait de la capacité d’Hollywood à investir lourdement, régulièrement et à stimuler la production indépendante à petit budget. Les unes nourrissant, à terme, les autres dans la mesure où le succès d’une production indépendante signifie automatiquement une série de «suites», variations obstinées parfois approfondies et passionnantes.
La Nuit des morts-vivants de George A. Romero est l’exemple d’un tel mécanisme : tourné en 1968 en toute indépendance, son succès mérité (en raison de son originalité et de sa rigueur, de son mélange subtil de science-fiction et de fantastique, de son indécision terrifiante et inédite, de sa critique mi-psychanalytique, mi-sociale aussi) lui permet d'approfondir le sujet, de constituer une œuvre cohérente traitant de l'apocalypse, en forme de cycle authentique approfondissant toujours davantage la donne initiale, dans le sens d'une réflexion sociologique et mythologique prolongeant celle du Richard Matheson de Je suis une légende : Dawn of the Dead [Zombies] (1978), Day of the Dead (1985), Land of the Dead (2005), Diary of the Dead (2007), Survival of the Dead (2009). Il faut noter que Romero, outre sa collaboration à de nombreux autres remakes et ersatz sans autre intérêt que financier, a réalisé non pas la variation mais la dérivation de son sujet initial : La Nuit des fous-vivants [The Crazies] (1972) fait basculer le film fantastique de 1968 dans la science-fiction par un simple déplacement thématique d’une part, une inversion de la structure dramatique et spatiale d’autre part.
Du côté anglais, la Hammer brille des années 1970 à 1975 de ses derniers feux, des feux baroques et pervers : Une Messe pour Dracula* [Taste the blood of Dracula] de Peter Sasdy, The Vampire Lovers et Dr. Jekyll & Sister Hyde de Roy Ward Baker qui introduit le lesbianisme explicitement puis l’hermaphrodisme et la transsexualité dans ces deux sujets, sans oublier le psychanalytique et brillant La Fille de Jack L’Éventreur [Hands of the Ripper] de Peter Sasdy. Un nouveau cinéaste tente de relabourer la terre fantastique anglaise : Gordon Hessler donne un décevant Cry of the Banshee mais un passionnant film de SF reprenant le thème du savant fou en l’étendant d’une manière diabolique : Lâchez les monstres ! [Scream and scream again !] avec Christopher Lee, Peter Cushing et Vincent Price réunis, dont Fritz Lang déclare tranquillement que c’est «le premier film adulte» de science-fiction qu’il voit. Hessler adapte également, d’une manière presque géniale par moments, Edgar Poe avec notamment le très impressionnant Le Cercueil vivant [The Oblong box]. Lorsque Hessler franchit ensuite l’Atlantique, l’inspiration est passée et il redevient un technicien honorable, donc l’idéal de l’Hollywood de série B ou C et de la télévision.
D’autres cinéastes anglais émergent, entre 1970 et 1980, le temps de quelques films indépendants comme Norman J. Warren qui donne d’intéressants films de SF (Le Zombie venu d’ailleurs [Prey] (1977) où deux belles lesbiennes sont troublées par un extra-terrestre cannibale et Inseminoïd) (1980), ainsi qu’un film fantastique, Terror [La Terreur des morts-vivants] (G.B., 1978) qu’il ne faut pas confondre avec Zombi Holocaust [La Terreur des zombies] (Ital., 1980) de «Frank Martin» alias Marino Girolami. Pete Walker tourne en 1973 l’admirable mais méconnu Flagellations [House of Whipcords] d’après un scénario original de l'intellectuel David McGillivray. Robert Fuest donne un Abominable Dr. Phibes et Douglas Hickcox un shakespearien Théâtre de sang qui offrent tous deux à la star Vincent Price deux de ses derniers très grands rôles vers 1971-1973.
Du côté français, deux courants très différents apparaissent : d’une part l’avant-garde expérimentale (elle existe depuis bien avant, mais ses plus beaux fruits nous semblent dater de cette période) avec, par exemple, les délires baroques et spiritualistes du Lit de la vierge (1969) de Philippe Garrel ou les délires plus charnels mais non moins baroques de Le Désirable et le Sublime (1969) de José Benazeraf, d’autre part un cinéma voulant au contraire renouer avec la tradition du cinéma muet de Louis Feuillade mais en bénéficiant du parlant et de la couleur sans oublier les filles hippies dénudées, avec les films de vampire de Jean Rollin (Le Frisson des vampires en 1970), qui introduit bientôt un érotisme graphique insistant, contraint et forcé par les producteurs-distributeurs parisiens qui veulent profiter de la vague érotique puis pornographique déferlante de 1970 à 1980 en France. Cette vague «contamine» et «contaminera» en France tous les autres genres cinématographique durant dix ans, mais leur permet aussi, à cause de sa taxation, d’exister financièrement. C’est dont très logiquement que Jean Rollin tourne un Phantasmes pornographiques (1975) qui est à la fois un film fantastique et un film pornographique. Jesus Franco, dans ses coproductions françaises régies par Robert de Nesle, subit alors les mêmes contraintes qu’il honore avec le même désir d’inspiration (exemple type dans sa filmographie : Plaisir à Trois – Les Inassouvies n°2).
Autre signe de renouveau, cette fois-ci aux États-Unis : le traitement de la sorcellerie et du satanisme (Incubus de Leslie Stevens, le seul film tourné en espéranto qu’il ne faut pas confondre avec le plus récent Incubus de John Hough, Rosemary’s Baby de Polanski en 1968) s’adapte à l’évolution sociale et intellectuelle, voire purement religieuse, des mentalités. William Friedkin adapte un livre écrit par un jésuite, William Peter Blatty qui dénonce, à partir de faits réels, l’insouciance hippie comme l’insouciance morale des classes dirigeantes aux États-Unis : L’Exorciste (1973) triomphe et des cinéastes aussi différents que Mario Bava ou Damiano Damiani en tourneront des variations, puisque l’Italie suit de près et reproduit à sa manière l’évolution américaine. Hollywood produit la série La Malédiction [The Omen], d’après une phrase de l’Apocalypse selon saint Jean et celle des Amityville d’après un fait réel ayant donné lieu à un récit circonstancié paru sous forme de livre.
Wes Craven, un universitaire intellectuel formé par les Jésuites et sachant parfaitement ce qu’il fait, s’intéresse à la régression et à la violence graphique : La Dernière maison sur la gauche, La Colline a des yeux. Tobe Hooper s’y intéresse aussi : The Texas Chain Saw Massacre, Le Crocodile de la mort [Death Trap / Eaten Alive], Massacre dans le train fantôme [The Funhouse]. Jack L’éventreur a peut-être un peu vieilli : on lui substitue Jason, et c’est la série obsédante des Vendredi 13 produite par un ami et collaborateur de Craven, Sean S. Cunningham. Elle reprend un des éléments fondamentaux du giallo italien : le meurtre à l’arme blanche, une obscure vengeance poursuivie jusqu’au bout mettant en évidence une culpabilité fondamentale, le simple fait d’exister ici et maintenant, face à une conscience puritaine protestante archaïque, celle des Pères fondateurs de la Nouvelle-Angleterre qu'on pourrait supposer chauffée à blanc, au point de prendre un saint plaisir à décapiter ou mutiler tout adolescent livré d'une manière précoce ou impudique aux plaisirs interdits de la chair. Nathaniel Hawthorne et sa Lettre écarlate, Dreyer et son Jour de colère [Dies Irae], Michael Reeves et son Grand inquisiteur [The Witchfinder General] parlaient de faits plus ou moins réels : Craven et son ami producteur Sean S. Cunningham innovent mais poursuivent le même propos, sous couvert d’une esthétique moderne. La série des Scream, à partir de 1995, constitue presque une mise en abyme réflexive des Vendredi 13. Craven s’intéresse aussi au thème psychanalytique du cauchemar et signe le premier Nightmare on Elm Street [Les Griffes de la nuit] dont le succès donne naissance à la série des «Freddy». Il synthétise peut-être l’ensemble de son inspiration dans le très beau, et un peu trop oublié, La Ferme de la terreur [Deadly Blessing].
David Cronenberg est canadien anglophone et s’intéresse au même thème qu’Inoshiro Honda ou Jack Arnold : la mutation, chez lui davantage biologique ou psychologique qu'atomique. Durant son âge d’or, il lui donne une dimension médicale para-freudienne (Chromosome 3 [The Brood]), louchant vers la science-fiction et le vampirisme à la fois (Frissons [Parasite Murders / Shivers] et Rage [Rabid], voire une très ambitieuse politique-fiction en forme de synthèse des films précédents [Scanners]. Cronenberg cède à la facilité occasionnellement (son remake inutile du génial La Mouche noire [The Fly] 1958 de Kurt Neumann) mais retrouve parfois son inspiration initiale à l’occasion d’adaptations littéraires (Crash d’après J.G. Ballard) ou de scénarios tenant compte de l’évolution technologique : ExistenZ est un film de science-fiction métaphysique austère mais parfaitement écrit sur les jeux vidéos, qui a retenu les leçons du Nightmares [En plein cauchemar] de Joseph Sargent. De son côté, le cinéaste canadien William Fruet introduit la démesure de la violence dans son Week-end sauvage [Death Week-end], signant un des premiers «survivals» féminins, avant La Colline a des yeux de Wes Craven, avant Survivance [Just Before Dawn] de Jeff Liebermann, avant le premier Vendredi 13. Un autre auteur complet voit le jour durant cette période, vivant un âge d’or lui aussi bref mais notable : John Carpenter. Intellectuel désinvolte, il transcende deux fois de suite un film au départ policier en film fantastique (Assault on Precinct 13 dont le remake sera, à rebours, strictement policier, et Halloween [La Nuit des masques]) puis il réfléchit sur le rapport culpabilisant-culpabilisé de l’histoire au mythe (The Fog), s'intéresse à la politique-fiction du futur proche dans New York 1997, hélas assez décevant, avant de signer une excellente variation d'un grand classique du genre avec The Thing en 1982. Le reste de sa filmographie est très inégal mais il peut encore réserver de belles surprises.
Les thèmes classiques sont régulièrement renouvelés : Maniac (1980) de William Lustig, si célèbre aujourd'hui en raison de sa cruauté graphique et de son délire visuel, redonne vie au criminel psychopathe d’une très brillante manière. Steven Spielberg doit au cinéma fantastique classique sa renommée et sa réputation : Duel est un téléfilm (par la suite exploité au cinéma) sur la criminalité psychopathologique très bien écrit par Richard Matheson tandis que Les Dents de la mer [Jaws] allie «film de monstre» et «film catastrophe» avec un impact maximal dû à la véracité potentielle du sujet, d’après un excellent roman de Peter Benchley. Byron Haskin avait donné son baroque Quand la Marabounda gronde [Naked Jungle] vingt ans avant le technologique et impressionnant Phase IV réalisé par Saul Bass, passé du design de génériques à la mise en scène. Dans la foulée du succès international de Jaws, Joe Dante tourne Piranhas, produit par Roger Corman sans oublier les copies italiennes-bis parfois savoureuses, depuis Enzo G. Castellari (La Mort au large) jusqu’à Plankton [Creatures From the Abyss] de A. Passeri et M. Cerchi (1994). Stanley Kubrick traite, à sa manière pessimiste et glacée, assez distante mais suffisamment efficace pour demeurer populaire, le thème classique de la possession et de la parapsychologie dans un plastiquement beau et impressionnant Shining.
Le renouveau des années 1970-1980 peut être aussi thématique : une nouvelle science-fiction fait son apparition, la science-fiction écologique. Soleil vert [Soylent Green] (1974) de Richard Fleischer, Terre brûlée [No Blade of Grass] de Cornel Wilde, Phase IV de Saul Bass, le graphiste qui avait dessiné les plus célèbres génériques des films américains de Alfred Hitchcock. Science-fiction et fantastique peuvent se rencontrer d’une manière approfondie dans un film original produit par William Castle : The Hephaestus Plague [Les Insectes de feu] (1975) de Jeannot Swarcz puisque les cafards monstrueux issus du tremblement de terre survenu durant la messe, ont peut-être été libérés par Dieu afin de punir les hommes et les supplanter : ils sont capables de penser et même d'écrire, durant une séquence géniale et toujours aussi stupéfiante de beauté plastique. On a réduit, en France, très injustement ce film à ses effets spéciaux. 2001 L’Odyssée de l’espace (1968) de Stanley Kubrick et Danger : planète inconnue (1969) de Robert Parrish sont des films de science-fiction à visée ouvertement métaphysique. Les enfants retiendront davantage La Guerre des étoiles et ses séquelles, avatars et clones divers.
L’ambivalence a la vie dure : John Frankenheimer signe vers 1979 un film fantastique mi-écologique, mi-SF avec Prophecy : le monstre qui reprend le thème très classique de la mutation qu’avaient déjà traité en leurs temps, trente ans plus tôt, des cinéastes comme Gordon Douglas (Des monstres attaquent la ville [Them !]) ou Jack Arnold (L’Étrange créature du lac noir) ou Nathan Juran (La Chose surgie des ténèbres [The Deadly Mantis]) mais il le traite d’une manière si sincère et si contemporaine, avec une technique si impressionnante qu’on y croit et qu’on a peur. Aux antipodes esthétiques de la grosse machine efficace de Frankenheimer, on peut opposer un assez curieux film indépendant américain, Messiah of Evil [Dead People] tourné vers 1970 par Willard Huyck, demeuré inédit en France mais récemment distribué par Artus Films en DVD zone 2 PAL, qui renouvelle assez bien le thème de l’invasion des morts-vivants en lui donnant une curieuse base “pré-prophétique” : le film est par ailleurs semé de recherches graphiques et plastiques un peu trop travaillées, qui desservent un peu le sujet… au lieu de le servir.
Note
* Voir la passionnante série de Francis Moury sur le personnage de Dracula dans le septième art.
10/08/2012 | Lien permanent
Le diable probablement... Entretien avec le père Charles Chossonnery, exorciste

Karl Kraus, Pro Domo et Mundo.
Après tout, j'aurais quelque malhonnêteté, puisque j'affirme qu'il faut rendre aux mots leur signification véritable, de ne pas appeler un chat un chat ou, moins prosaïquement, de prétendre que le Mal n'est rien de plus qu'une dommageable moisissure dont un simple désinfectant nous débarrassera à coup sûr, idée ridicule dans laquelle les apôtres du Progrès macèrent depuis des lustres, sans qu'aucun déchaînement d'horreur ne puisse venir, semble-t-il, à bout de leur optimisme béat. Dès lors, il faut bien donner à ce Mal une origine et éviter de prétendre, comme le font nos philosophes (et bien sûr beaucoup, de plus en plus de nos prêtres), qu'il n'est rien de plus qu'un défaut sur la toile provenant du fait que nous, pauvres observateurs, n'avons pas pris suffisamment de recul pour contempler le chef-d’œuvre dans son harmonie. Le problème, mais il est de taille, c'est que je suis de plus en plus certain que ceux-là mêmes qui devraient être assurés de l'existence d'une conscience surnaturellement et tout entière mauvaise ne sont absolument plus certains qu'elle existe, que le démon existe... Il est vrai que nombre de nos prélats auraient quelque difficulté à croire à Satan puisqu'ils ont depuis belle lurette admis que Dieu avait la figure d'un vieux grison pétri de culture démocratico-humanitaire...
Voici en tout cas un entretien que j'eus avec le Père Charles Chossonnery, alors exorciste du diocèse de Lyon, dont je ne sais aujourd'hui plus rien. Me hante encore son malicieux regard d'un bleu délavé qu'il me décochait quand, dans notre dialogue, je tentai de lui faire dire que, finalement, malgré ou peut-être à cause de tout ce qu'il avait vu de ses propres yeux, il ne croyait plus guère à l'ami qui, comme Bernanos l'écrit, ne reste jamais jusqu'à la fin...
Je ne cesse de penser, aussi, plutôt qu'au film de Friedkin où l'on voit tout de même un homme à la foi vacillante donner sa vie pour sauver l'innocente possédée, au mystérieux récit du grand Gustaw Herling sur le thème des voies retorses que le Mal emprunte pour châtier les prétentieux... Il faut d'ailleurs lire et relire, à ce sujet difficile, le remarquable entretien que Herling accorda à Edith de la Héronnière sur la question du Mal et de ses liens avec la littérature dans Variations sur les ténèbres...
Voici, donc, cet entretien.
«L'innommable du mal dessine à jamais le champ dans lequel la pensée ne pourra pas s'arrêter de penser.»
Yves Ledure, L'impossible figuration du Mal, in Le Mal et le Diable. Leurs figures à la fin du Moyen Age (Beauchesne, coll. Culture et Christianisme, n°4, 1997), p. 266.
Je publie ici les réponses à quelques questions auxquelles, naguère, le Père Chossonnery prit, avec une très grande amabilité et patience, le temps de répondre. Ayant égaré l'original de ces questions, elles ont toutes été réécrites de mémoire. Que le Père Chossonnery veuille excuser par avance, les inévitables différences qu'il constatera entre l'original du questionnaire qu'il a lu et cette version publiée; cependant, je pense que l'esprit de mes questions a été respecté, l'essentiel donc.
Juan Asensio
Et, tout d'abord, Père, dans cette première question qui concerne votre ministère, celui de l'exorcistat, — un parmi les quatre mineurs conférés aux prêtres —, un très rapide pointage historique. Les exorcismes, on le sait, ont d'abord été pratiqués par le Christ, certain épisode célèbre, comme celui des pourceaux de Gérasa (cf. Mc 5, 1-20; Mt 8, 28-34; Lc 8, 26-39) en témoigne; par les apôtres aussi, qui, tout comme le Christ, distinguent parfaitement les deux pouvoirs, celui de l'exorcisme et celui de la guérison des maladies — cette précision, pour les tenanciers d'une réduction du phénomène de possession à celui de maladie. Immédiatement, on comprend que l'exorcisme est avant tout une praxis plus qu'une connaissance purement théorique, peut-être non exempte de quelque complaisance intellectuelle. Très vite, l'exorcisme devient la marque de fabrique de la très jeune Église: Justin Martyr, au IIe siècle, écrit dans son Dialogue avec Tryphon (85, 3) que l'expulsion du Démon est pratiquée par la seule profération du nom du Christ, sous la forme de l'adjuration reprise du symbole de foi Au nom de Jésus-Christ crucifié sous ponce Pilate : Si vous adjurez [exorkizête] les démons au nom de n'importe lequel des rois [...], ils ne se soumettent pas. Si, au contraire, l'un de vous l'adjure au nom du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob, il se soumettra [...]. Saint Irénée (Adversus Haereses, 2, 6, 2), puis Tertullien (Apologeticum, 23, 4) attestent à leur tour cette puissance du Nom, tandis que le rituel de l'exorcisme s'enrichit de nouveaux gestes, comme celui de l'imposition des mains, de l'exsufflation ou de l'onction avec de l'huile. Très tôt également, on relève l'importance du jeûne. De plus, il ne faut pas oublier qu'à cette époque révolue, le baptême était déjà par lui-même un rituel d'exorcisme élaboré (cf. Cyrille de Jérusalem, Procatechesis, 9), alors que de nos jours celui-ci a presque totalement disparu, étant de plus considéré comme facultatif. A l'origine, le don d'exorcisme est parfaitement charismatique; il n'est ni une fonction, ni un titre, surtout pas une dignité ecclésiastique. Il faut attendre le concile de Laodicée (vers 360), pour qu'apparaisse le premier témoignage d'un statut spécifique des exorcistes. Ensuite, le Rituel Romain (1614) a codifié l'exercice très particulier et périlleux de l'exorcisme; resté tel quel jusqu'à une date récente, ce rituel a subi quelques petites modifications en 1926 et en 1952. Enfin, depuis 1990, un nouveau rituel est expérimenté, en toute discrétion, par les prêtres; il est appelé Rituel ad Interim. La tendance générale, nettement précipitée depuis le XIXe siècle, on le constate, est donc à la réduction du rituel de l'exorcisme. Quelle est votre position sur ce point, Père ?
Charles Chossonnery
Ce ministère a son sens, sa référence, sa légitimité en Jésus-Christ. Il importe de recadrer et d'interpréter ce ministère actuel. Il est inséré dans une tradition. Et toute tradition digne de ce nom n'est pas un fixisme répétitif mais une vitalité évolutive qui tisse une histoire. Le ministère actuel ne saurait donc être copie conforme des gestes du Christ mais il s'inspire et découle de l'action, de la parole d'autorité de Jésus-Christ et des pratiques des premiers chrétiens. Hier comme aujourd'hui, l'exorcisme est livré au Baptême. Au Baptême, solennellement, on fait profession de foi en Jésus-Christ, au Père, à l'Esprit Saint. On choisit. Donc aussi on élimine. C'est le mal et l'auteur du mal qui est éliminé, solennellement: d'où l'étymologie du mot exorcisme que vous soulignez à juste titre. Il s'agit bien d'une adjuration venant de l'autorité divine. Aux premiers temps de l'Église, cette pratique allait de soi. Les chrétiens, dans la foulée du premier Testament et surtout suite à la mort et à la Résurrection de Jésus-Christ, vainqueur du péché, du mal et de la mort, ont réussi à se démarquer des croyances polythéistes, superstitieuses, magiques, en condensant la victoire du Christ sur un seul opposant : Satan, le Diable. L'existence de Satan comme obstacle pervers à Dieu, à l'homme, au cosmos, allait de soi. Et cela est attesté par de nombreux textes. Mais tôt ou tard ce qui va de soi se retrouve mis en question par l'évolution de la vie et les influences et pressions extérieures.
C'est ainsi que l'Église a dû préciser et sa doctrine et ses pratiques. En dehors de l'Église l'on continuait à donner une trop grande place à Satan. C'est donc à l'occasion de déviances que l'Église redonne son identité: cette première intervention est relativement tardive, d'ailleurs, et locale, elle s'est faite au concile de Braga (Portugal) en 563. L'autre déclaration importante a été faite au IVe concile de Latran en 1215. Les ouvrages Satan de Georges Tavard (Desclée Novalis) et Le Diable, oui ou non de Pascal Thomas (Centurion) donnent ces indications.
Ces positions prises par l'Église sont motivées par la doctrine manichéiste qui faisait de Satan le symétrique de Dieu. Satan n'est pas principe, ni créateur, mais créature sur qui Dieu a pouvoir. Hélas, il existe toujours certains relents manichéistes !
Les rituels codifiés d'exorcisme, comme vous le signalez, arrivent donc bien après ces positions officielles. Et les rituels, l'histoire le dit — et Vatican II l'a bien montré — ne sont pas éternels. Le rituel en préparation, non encore publié officiellement, n'est pas une réduction des anciens rituels. Je le redis encore : une nouvelle formulation montre que la vie ne peut pas être un automatisme de répétition. On ne peut plus parler du transport comme au temps de la diligence. Attention aux arrière-pensées des fixistes ! Aujourd'hui, officiellement, il est demandé aux prêtres exorcistes d'être en contact avec la médecine et la pensée moderne. S'il en était autrement, que serait le DIALOGUE officiellement pratiqué ?
Juan Asensio
Nombre de nos lecteurs, j'en suis certain, ont à l'esprit certaine scènes éprouvantes de rituels d'exorcisme, tels qu'un film comme L'Exorciste, adapté du roman de William Peter Blatty, a pu les populariser. Il y a là, bien évidemment, une nette volonté de frapper les imaginations; cependant, la simple lecture de l'ouvrage que le Père Joseph Surin — qui fut l'exorciste officiel du célèbre couvent des Ursulines de Loudun, et plus particulièrement de Mère Jeanne des Anges — rédigea au soir de sa vie donne des frissons (Triomphe de l'Amour divin sur les puissances de l'Enfer, Jérôme Millon, coll. Atopia, 1990). Rappelons que le Père Surin, considéré par Malley comme l'homme peut-être le plus mystique du XVIIe siècle, sombra dans un déséquilibre mental, à la suite de ses exorcismes, qui jamais toutefois ne lui ôta l'usage de sa raison: il fut interné pendant vingt ans dans le cachot d'une infirmerie, au collège de Bordeaux. Avant que vous ne nous décriviez, mon Père, les modes d'infestation diabolique, détaillons pour nos lecteurs ce que dit le Rituel Romain sur la possession. Tout d'abord, la première consigne donnée à l'exorciste est qu'il ne croie pas facilement à la possession (In primis ne facile credat aliquem a daemonis obsessum esse); la deuxième, que l'exorciste sache quels signes distinguent le possédé de personnes tourmentées par la mélancolie, l'hystérie, l'épilepsie ou toutes autres formes de névroses (Nota habeat ea signa quibus obsessus dignoscitur ab iis qui vel atrabile, vel morbo aliquo laborant); la troisième, sans doute la plus connue du grand public, qui indique trois signes particuliers de la possession : signa autem obsidentis daemonis sunt : 1 — ignota lingua loqui pluribus verbis, vel loquentem intelligere; 2 — distantia et occulta patefacere; 3 — vires supra aetatis seu conditionis naturam ostendere. En bonne traduction française, ces trois signes sont donc : 1 — l'usage ou l'intelligence d'une langue inconnue; 2 — la connaissance de faits distants ou cachés; 3 — enfin, la manifestation d'une force physique dépassant l'âge ou la condition du sujet.
Charles Chossonnery
En union avec les exorcistes (car nous nous rencontrons et échangeons), je rencontre beaucoup de personnes qui se dirent possédées, donc privées de leur autonomie par Satan ou un mauvais esprit. Je dis: attention à la surenchère et au simplisme. Il convient d'examiner d'abord si celui qui se dit VICTIME est totalement INNOCENT... Ne peut-on pas ainsi, même si l'on est victime, devenir COMPLICE et même sympathisant du mal et des ses auteurs ? Ne peut-on pas encore, dans un genre de contre-attaque ou de vengeance, devenir AGENT et ACTEUR qui pense, projette, prémédite, exécute une riposte de même nature que celle du mal subi ?
Par analogie avec l'échelle de Richter, il convient de mesurer la gradation des dégâts:
— Ce mal attribué à un agent extra-terrestre, le démon de La Bible et de la Tradition chrétienne ou à un mauvais esprit, n'est-il pas la manifestation de la partie ténébreuse de moi-même ? Saint Paul (Épître aux Romains, 7, 14 et sq.) déplore ne pas pouvoir faire le bien qu'il veut et faire le mal qu'il ne veut pas.
— Ce mal qui m'aliène ne vient-il pas d'un proche, d'un voisin, d'un autre qui a bien les pieds sur terre, avec qui je suis en conflit, ayant mes propres torts ?
— Ce mal ne vient-il pas de l'influence acceptée (et non rejetée) d'un lobby, d'une mafia, d'un snobisme de bas-fonds ?
— Ce mal dépasse-t-il les limites de la perversion humaine connue ? Les tristes exemples d'auteurs de génocides, de tueurs à répétition, de tous ceux qui s'identifient aux législateurs absolus, capables de vouloir DÉCRÉER pour refaire un autre monde qu'ils veulent gérer font-ils tout ce mal d'eux-mêmes, ou se réfèrent-ils à Satan, tel que le désigne La Bible et la Tradition chrétienne ? La question se pose et se posera toujours.
En d'autres termes, termes, on peut dire que l'expression possédé(e) du démon, avant d'être employée avec prudence (parce qu'il met plusieurs réalités différentes à la même enseigne), exige de nombreuses distinctions. Affirmer que l'on n'est plus soi-même relève de différentes situations que l'on peut présenter ainsi:
A — L'Influence
En famille, en société, de par l'histoire et l'historicité, l'environnement, tout être humain subit des influences plus ou moins fortes, superficielles (la mode) ou profondes, état qui oriente plus ou moins vers l'idolâtrie.
B — La Séduction
Qui est toujours artificielle, mensongère, voire théâtrale. C'est le poisson qui mord à l'hameçon, au leurre, au mirage. On trompe par flatterie : Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau. On trompe par l'épouvante, par l'effarouchement qui fragilise, terrorise et diminue jusqu'à l'évacuation du goût et de la raison de vivre. Dire, avec le masque déformant d'une autorité abusive et non fondée : Tu n'es bon à rien. Tu échoueras. Je t'ai à l’œil, est une action assassine. Toute menace abusive et théâtrale est homicide.
On trompe avec le vrai: triste et suprême habilité qui consiste à suréclairer un aspect de la vérité et de laisser dans l'obscurité ses autres aspects. Ce procédé est attesté dans l'Évangile : le démon tente Jésus à partir de l'ÉCRITURE ! C'est ainsi que saint Paul pouvait dire que Satan est ange de lumière. Comme l'ambiguïté est une composante du réel, il est facile, par ruse, de trafiquer n'importe quoi.
C — L'Accaparement
L'occupation du champ de la conscience par un malaise, un manque, une défection, etc. Ceci conduit à l'obsession, à l'idée fixe, lancinante... et donc à la maladie.
D — L'Infestation
Qui est présence d'un virus d'ordre psychologique ou éthique : cet état est du ressort des habitudes, de l'habitus, du péché plus ou moins grave. C'est garder le ver dans le fruit.
E — L'état second
Constaté surtout suite à des expériences présomptueuses de spiritisme. Cet état qui part d'une avidité de faire des exploits ou des prouesses peut aller jusqu'à la volonté de franchir les limites du réel connu (par exemple, le dialogue avec les défunts) et conduire à la GNOSE : la connaissance ABSOLUE... Or, peut-on saisir l'insaisissable ? Une expérience d'état second, une modification d'état de conscience (drogue, manipulation mentale, lavage de cerveau) laissent traces et séquelles longues à se résorber.
F — L'Incorporation
... dont on parle beaucoup, et pas toujours selon la sagesse et la rigueur scientifiques ! Des auteurs sérieux (ainsi Anne Ancelin-Schützenberger dans Aïe mes aïeux ! parlant de fantômes, d'impression d'être habité par un autre) méritent une analyse: je cite, Ce ne sont pas les trépassés qui viennent nous hanter mais les lacunes laissées en nous par les secrets des autres (L'Écorce et le Noyau d'Abraham Nicolas et Török Marie, Aubier Flammarion, p. 429) Peut-être y a-t-il aussi dans cette prétendue incorporation un certain attrait pour la métamorphose...
G — La Possession
Qui elle aussi a son échelle de Richter :
— Il se peut qu'un jour de découragement (prières non exaucées), que quelqu'un, par dépit ou colère, se tourne vers Satan... comme l'on change de fournisseur lorsqu'il n'a pas donné satisfaction. Cette attitude peut engendre un trouble et une culpabilisation : pourquoi ? Parce que appeler et invoquer c'est, d'une certaine manière, donner une consistance, une impression de réalité. Comme le dit l'adage : Il suffit d'y croire pour que ce soit vrai... En réalité, le démon n'est pas venu pour autant, automatiquement. Mais l'appel déviant a créé dans la subjectivité une impression illusoire : il faut s'en dégager par le sacrement de réconciliation.
— Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si l'on fréquente un sujet pervers, si l'on mise d'une façon ou d'une autre sur les capacités de l'Ennemi de Dieu, il s'ensuit toujours un malaise.
— Vient après la cas où l'on vendrait son âme au Diable par un acte signé de son propre sang et où l'on participerait à une liturgie type messe noire, laquelle est la copie invertie et subvertie du culte chrétien, allant parfois jusqu'à comprendre un meurtre ou des transgressions sexuelles. Un tel degré de perversion relève de l'ÉTHIQUE, d'un orgueil absurde, au plus bas degré. Ce genre d'état est clandestin, dangereux. C'est la rivalité mimétique de l'autorité divine. Une telle perversion dont le lieu se situe dans l'esprit, dans ce qu'il a de plus noble, rejoint ce que disent les Écritures et la Tradition à propos de Satan. Comment en dire plus ? Le lien entre un esprit humain et une conscience extra-terrestre, ni divine ni humaine, ne supporte qu'une subjectivité approchée pour employer un terme de Bachelard. Ici, la foi, la confiance en Dieu qui est Vie, Bonheur, Bonté, Beauté, Bien, est plus important que le savoir scientifique, philosophique, qui est insaisissable. Veillez et priez, dit Jésus, ce qui en dit long !
Vous parlez de Loudun. Le P. de Cer
18/03/2004 | Lien permanent
L’Exorciste de William Friedkin : la densité du Mal, par Gregory Mion

 L'Exorciste de William Peter Blatty et Rosemary's baby d'Ira Levin.
L'Exorciste de William Peter Blatty et Rosemary's baby d'Ira Levin.
La démonologie dans la Zone.
«Une autre cicatrice sur ton menton – origine inconnue. Survenue très probablement dans la petite enfance, une lourde chute sur un trottoir ou sur une pierre t’ayant ouvert la chair et laissé sa marque, laquelle est encore visible chaque fois que tu te rases le matin. Aucune histoire n’accompagne cette cicatrice-là, ta mère ne t’en a jamais parlé (en tout cas tu ne t’en souviens pas), et il te semble bizarre, voire carrément déconcertant, que cette trace permanente ait été gravée sur ton menton par ce qu’on ne peut qualifier que de main invisible, que ton corps soit le site d’événements qui ont été effacés de l’histoire.»
Paul Auster, Chronique d’hiver.
«L’esprit commande à lui-même de faire un acte de volonté […], mais il ne veut pas totalement faire cette chose et par conséquent ses ordres ne sont pas totalement donnés. Il donne l’ordre simplement dans la mesure où il veut, et dans la mesure où il ne veut pas l’ordre n’est pas exécuté. Ce n’est pas [en outre] un phénomène étrange de vouloir partiellement faire quelque chose et partiellement ne pas vouloir le faire. C’est une maladie de l’esprit […]. Il y a ainsi deux volontés en nous, aucune n’est en elle-même la volonté totale, et chacune possède ce qui manque dans l’autre.»
Saint Augustin, Confessions, VIII, IX.
Au premier abord, cela peut sembler une épreuve de force que de revenir sur L’Exorciste, un film qui a fait l’objet de nombreuses exégèses, sans parler des fantasmes qui en résultèrent et qui contribuèrent, bon an mal an, à obscurcir la viabilité d’un discours esthétique. Mais du point de vue de l’analyse, il n’est guère de choses qui ont été formulées sur ce film et qui dépassent le simple constat d’une efficace de l’horreur. Rares ont par exemple été les critiques qui ont attaqué de front la question de la démonologie, tant et si bien que ces mêmes critiques n’ont même pas remarqué, ou alors trop peu, que le «diable», en tant que tel, incarne le plus diviseur des êtres – l’étymologie stipule en effet que le diable est celui qui divise. Replacé dans un contexte fictionnel, l’être du diable introduit dans le processus narratif des poches de décomposition où les personnages, en même temps que l’histoire, se fractionnent, produisant ainsi un réseau disparate d’existants qui sollicitent un rassemblement.
Notre vocation dans ce travail, toutefois, ne consiste pas à proposer une harmonisation du schéma narratif qui donne à L’Exorciste ses énergies renouvelables, encore que nous le ferons chaque fois que ce sera utile. Nous souhaitons plutôt examiner les différentes présences du Mal qui affleurent tout au long du film, ce qui devrait par ailleurs élucider quelques-uns des choix scénaristiques autrement que par l’intermédiaire des seuls critères de l’horreur. En d’autres termes, puisque nous laissons de côté la nature ostentatoire des horreurs, nous voulons essayer d’évoquer la notion de Mal en l’interprétant comme un motif qui parcourt l’œuvre de W. Friedkin de fond en comble. L’immanence du Mal se comporte souvent de deux manières au cinéma : d’une part comme une instance discrète qui justifie certaines préférences iconographiques; d’autre part comme un point de tension qui enrobe le processus de mise en intrigue (1). Par conséquent, le Mal apparaît sous les traits d’une revendication souterraine dont il faut comprendre la parole croissante. Plus qu’un motif, le Mal devient une expression qui dépasse le cadre du film, tout comme il procure un gain d’intensité lorsqu’on le met en situation de côtoyer un environnement quotidien.
Dans le cas de L’Exorciste, la calamité impliquée par le démon fonctionne à l’instar d’une réminiscence historique. L’œuvre rapatrie dans la banlieue de Washington DC une idée fidèle des ténèbres (2). Après quoi, le cinéaste fabrique un visage particulier du Mal à partir d’un ensemble de données générales. La reconstitution du démon interroge un des multiples visages du Mal à travers ce que Deleuze appellerait une «image-affection». Le Mal se déploie en une galerie de portraits qui oscillent entre la manifestation subliminale et la phénoménalisation abjecte, c’est-à-dire entre les apparitions fugitives de Pazuzu et le visage courbaturé de son patient. Ce sont deux figures qui pensent l’affection, mais l’une est dépositaire du Mal (Pazuzu) quand l’autre ne fait qu’endurer sa terrifiante juridiction (la jeune fille possédée). Ces visages de l’agent et du patient offrent une physionomie au Mal. Ce sont deux façons de penser au Mal; ce sont deux éminences qui nous permettent de ressentir un degré d’affection, voire un degré d’aberration (3).
En outre, et même si nous ne disons là qu’une banalité, il est impossible de cerner l’essence du Mal (4), pas plus qu’il n’est envisageable d’en approcher la vérité par le biais d’une analyse de L’Exorciste, aussi serrée soit-elle. Ce qui intéresse notre propos vis-à-vis de ce film, c’est de recenser les motifs du Mal, et peut-être donc ses motivations singulières en tant qu’elles sont rapportées à une histoire, à dessein non pas de présenter une série de vérités expertes, mais plutôt une suite de petites présomptions.
La séquence inaugurale nous montre une fenêtre. Les rideaux sont tirés. Une lumière s’éteint et la caméra entame un mouvement de retrait. Il s’agit d’une maison de Georgetown, louée par Chris McNeil, une actrice en déplacement dans le Maryland pour les besoins d’un tournage. Elle est divorcée. Sa fille Regan l’accompagne. Nous signalons tout de même ces détails bien qu’ils ne puissent être connus que rétrospectivement.
La scène se déroule en nocturne. À la fenêtre, la lumière qui s’éteint préfigure une première strate de ténèbres. L’extinction des feux plonge la maison dans une noirceur symbolique tandis que l’éclairage public, au dehors, continue sa besogne pratique. Dès le début, les frontières sont nettes entre ce qui va se passer à l’intérieur de la maison et ce qui subsistera à l’extérieur. Rien de ce qui arrivera chez les McNeil ne sera soluble dans la réalité extérieure, sinon par l’intermédiaire des personnages qui leur seront apparentés. Ce qui est annoncé, c’est un contraste à prendre au pied de la lettre : le noir des puissances occultes qui s’oppose au blanc artificiel de l’espace public. La fenêtre, dont les pourtours sont précis et servent la condition architecturale de la maison, annonce en quelque sorte la cible sur laquelle le démon va planter son dard.
Il est possible que la caméra soit d’ores et déjà une focalisation interne de l’œil du Mal – l’œil darde un regard désincarné sur les appartements de la famille McNeil. Avant même que les hostilités ne se territorialisent, le démon rôde.
La séquence suivante, considérée comme une authentique séquence d’ouverture, est celle que les spectateurs ont habituellement mémorisée. Dès le départ, la signature de cette séquence est excessivement religieuse : le chant du muezzin glorifie la grandeur d’Allah, juste après que nous avons aperçu, à la fin du prologue et sous forme de statue, le visage blanc d’une vierge Marie impeccable. C’est un moyen habile qui nous transfère d’un lieu à un autre. Tout à l’heure à Georgetown, nous sommes maintenant projetés sous la chaleur écrasante de l’Irak septentrional. D’autre part, l’Islam constitue un écho spirituel de la religion chrétienne. La multiplication des signes religieux, que ce soit aux États-Unis ou en Irak, confronte d’emblée les forces culturelles des hommes aux forces inconnaissables du démon. Religion orientale ou occidentale, peu importe. Ce qui se prépare est un affrontement singularisé entre les ressources de l’humanité et les anomalies de ce qui est proprement immonde, en l’occurrence tout à fait exogène au monde. Le Mal se définit dans cette perspective comme un motif absent et lancinant. Le Mal se saisit par le biais d’un pernicieux raccord où le religieux fait l’hypothèse d’une lointaine fraternité. La cité de Dieu, qu’on le veuille ou non, est toujours plus proche du Diable que ne peuvent l’être tous les endroits du monde terrestre. Quant au soleil rouge qui finit par crever l’écran pendant la rhapsodie du muezzin, il intronise pour ainsi dire la couleur du Diable dans l’espace diégétique.
Les images qui s’ensuivent nous exposent des fouilles archéologiques. Des puretés du ciel, nous descendons vers les abîmes. Des ouvriers et des archéologues creusent la terre. D’un registre léger, nous passons à un lexique de la pesanteur – bruit des outils, visages accablés de fatigue, gestes répétitifs, musique bourdonnante, etc. D’étranges trouvailles résultent de ces fouilles. Parmi elles, le père Merrin identifie une figurine du démon Pazuzu. Aussitôt remontée des décombres, la figurine emporte Merrin sur une route de contrariétés. Ce personnage est définitivement embrigadé par les desseins du malin. La caméra, en insistant sur les masses désertiques du paysage mais aussi en soulignant l’inquiétude de Merrin, matérialise un envoûtement de la causalité. Le motif démoniaque, une fois qu’il a pris corps au travers d’une figurine, devient la cause efficiente de toutes les confusions qui vont ponctuer le film.
Puisque le démon est la cause par excellence, on devine que les actions qui devront le combattre seront également imprégnées d’un coefficient ésotérique. Néanmoins, comme il n’est pas dans la nature des hommes de s’en remettre au magique avant d’avoir testé un grand nombre d’hypothèses, on préfèrera une construction cinématographique dont l’intrigue repose non pas tant sur les pouvoirs de l’horreur que sur une sémantique des preuves, seul instrument à même de justifier une mise en scène horrifique et d’homologuer l’horreur. Autrement dit, l’abjection inhérente à la présence du Mal s’accompagnera d’un esprit continuellement douteux de la part des protagonistes, lesquels accréditeront la réalité de l'horreur sitôt qu’ils auront passé cette dernière au crible du raisonnement logique. Sans cela, nous n’aurions qu’un démon banalisé qu’on s’empresserait d’éliminer sans réflexion aucune (5). Il en va du comportement des spectateurs : ce que l’on vise, c’est que le spectateur puisse consentir à suspendre son incrédulité, d’où les longs présages que nous décrivons à partir des séquences introductives.
Après la découverte de la figurine, Merrin entre dans une espèce d’hébétude. Il a l’intuition des persécutions à venir. Ce n’est pas seulement le poids du climat irakien qui l’écrase. Son accablement perçoit un danger d’autant plus nuisible qu’il est immatériel, partout et nulle part. Le Mal est sur lui comme le soleil l’éclaire d’une lumière de poursuite. Où qu’il aille à présent, Merrin sera pris par l’objectif du Mal. Le démon a un œil sur lui; le démon l’épie.
La séquence irakienne se termine par la déambulation de Merrin. Au-devant du prêtre, une statue surgit à contre-jour, comme une sombre remembrance de la vierge Marie du prologue. Ce contre-jour illustre une silhouette noire, peccamineuse et nécessairement hostile. Puis c’est le moment du face-à-face. Le plan est large, en contre-plongée : à gauche la statue, à droite Merrin, tels deux individus qui se préparent à un duel à l’instar d’une scène de western. La contre-plongée, si elle accentue la consistance de la statue, donne en revanche à Merrin une allure d’homme voûté, totalement dépassé par l’enjeu de cette rencontre fortuite. La statue est une sorte de Priape, elle possède un phallus énorme. La malveillance est donc virile, chargée d’astuces et de manigances, portée par une bande sonore des plus angoissantes. À notre droite, Merrin fait pâle figure. Il est l’incarnation de l’homme âgé, impuissant, violemment repoussé dans les cordes du cadre. C’est la puissance des ténèbres qui piétine la vulnérabilité de la race humaine sans qu’il n’y ait pourtant le moindre échange de coups. Tout a lieu dans la suspension de la rencontre. La retenue minérale de la statue et l’affliction du religieux sont un condensé des futures agressions mutuelles. Car si le démon attaquera en premier, on lui offrira du répondant. C’est la base d’un duel, voire le mot d’ordre d’une disputatio.
Puis c’est le retour à Georgetown. C’est là que tout doit réellement commencer. La banlieue de Washington DC va parachever les initiatives du Mal auxquelles nous avons assisté en Irak, que ce fût dans l’imaginaire figuré de Merrin ou par l’entremise des preuves tangibles d’une inquiétante présence. Le Mal se déplace aussi rapidement qu’un changement de plan. D’un continent à un autre, le saut de caméra induit un saut inexorable du démon sitôt que celui-ci s’invite dans l’arborescence d’un personnage. Merrin est l’homme par qui le Mal arrive. Puisque ce religieux qui s’est absenté en Irak possède des accointances dans le Maryland, il suit de là que le Mal va se rendre jusque sur la côte orientale des États-Unis en vue de poursuivre ses visitations. Un effet choral, d’ailleurs, ratifie le phénomène d’enchevêtrement volontaire du Mal. Nous voyons Chris McNeil en militante cabotine, actrice et mère de Regan, observée fugacement par un homme entièrement vêtu de noir. Il s’agit du père Karras. Il passait par là. On peut supposer que Damien Karras, lié au père Lankester Merrin, collabore ainsi à l’intrusion américaine du démon par la simple intercession d’un regard de passage. Du fait de ses vêtements noirs, il se personnifie en tant qu’agent chromatique du démon, c’est-à-dire en tant que passeur malgré lui des ambitions démoniaques. L’agentivité de Karras est par ailleurs judicieuse car il se trouve en situation de doute, balançant sur la force de sa croyance en Dieu.
Un peu plus tard, c’est l’inverse qui se produit. McNeil surprend à son tour Karras, en pleines confidences à propos de ses raisons religieuses. Cette scène conclut la fixation des destins. Mais le plus intéressant, c’est ce qui s’est révélé en amont de cette seconde rencontre inopinée entre Karras et McNeil. Pendant la marche sereine de McNeil, le fameux thème musical de L’Exorciste ébauche une agitation préparatoire au cœur d’un moment qui respire la tranquillité (15è minute) (6). La musique complète les variétés du Mal pris comme un motif forcément changeant. Le Mal est composé de multiples visages qui ne persistent jamais dans la durée, en quoi la figure de Regan, l’adolescente possédée, ne cessera de se modifier au fur et à mesure que le démon avancera dans l’exercice de son appropriation. La façon dont le Mal s’agrège aux êtres exacerbe moins sa nature profonde que l’intimité de tel ou tel possédé, lesquels n’ont pas d’autre choix que de subir une série d’attaques sournoises, se faisant les agents d’une parole mystificatrice. À la fois toujours le même dans son insaisissabilité et toujours autre dans sa phénoménalisation, le Mal travestit les caractères de l’humanité pour mieux contrefaire ses identités probables. C’est pourquoi notre examen du Mal tente d’énumérer un maximum de motifs au lieu de se concentrer sur les conséquences de l’horreur, sachant bien que les occasions du démon sont incommensurables à la description des séquelles qu’il engendre.
La malignité du Mal est de ce fait illimitée. Les deux bonnes sœurs que McNeil croise sur le chemin de sa marche sont à tout le moins un contrepoids insuffisant par rapport aux épreuves qui l’attendent. En sus, ces religieuses vont dans la direction opposée à celle qu’emprunte la mère de Regan. Ces femmes d’Église n’entrent pas dans les projets de Pazuzu. Du reste, il est acceptable de penser que ce contact fugitif avec les bonnes sœurs exprime un genre de hiérarchie ecclésiastique. Puisque les religieuses ne font que passer, puisqu’elles s’en retournent au confinement d’un ermitage, c’est qu’elles ne sont peut-être pas à la hauteur, peut-être pas tout à fait fortifiées vis-à-vis des combats avec le démon. Le mouvement des bonnes sœurs, interprété comme le contraire d’un Karras ou d’un Merrin davantage immobiles, sous-entend une frivolité qui ne ferait pas le poids en face d’un Pazuzu déterminé. Il en va de même du pas cadencé de McNeil : il augure une légèreté qui devra s’affermir car le Mal, dorénavant, est devenu partie prenante de son existence – le Mal, qui plus est, atterrit littéralement à Washington alors que nous entendons un bruit d’avion hors-champ (16è min.).
Tout ceci gagne en consistance lors de la séquence suivante, lorsque Regan, jouant avec sa mère, lui parle d’un certain «capitaine Howdy», selon toute vraisemblance un ami imaginaire, en somme un être que s’inventent parfois les enfants. Il n’y a pas de quoi s’alarmer, du moins quand on se place du point de vue de la mère. Mais du point de vue du spectateur, ce «capitaine Howdy» étend encore un peu plus la nature protéiforme du Mal. Par la suite, le capitaine Howdy souffle à Regan une information qui convient à l’adage suivant lequel «la vérité sort de la bouche des enfants». En effet, alors que Chris borde sa fille avant le coucher, Regan évoque Burke Dennings, un réalisateur avec qui sa mère a l’habitude de tourner. Regan insinue que sa mère en pince pour Burke. Après un démenti formel de Chris, on assiste à plusieurs gros plans sur le visage de l’adolescente. Ce sont les ultimes focales d’une figure salubre au fond de laquelle le démon achève d’emménager.
Voilà que le Mal a désormais porte ouverte sur le quotidien des McNeil. Un jeu de champ-contrechamp se réalise lorsque des grattements inhabituels se font entendre au grenier. Ce sont d’abord les bruits, après quoi succède le visage de Regan dans son lit, les yeux grands ouverts, puis enfin ce sont encore les mêmes sons caverneux (29è min.). Regan est la seule à mener une conversation intime avec le démon. Ces bruits de raclement, ils s’ordonnent à l’instar d’un visage sonore qui se construit pendant le champ-contrechamp. Les yeux de Regan regardent le Mal en face parce que ce dernier lui adresse la parole. C’est-à
02/05/2013 | Lien permanent
























































