Rechercher : Proust
Entretien avec Benoît Hocquet

Richard Millet, L'Opprobre. Essai de démonologie (Gallimard, 2008), p. 167.
Benoît Hocquet
Vous êtes ce qu'on peut appeler un écrivain catholique. Comment se définit le rapport entre ces deux qualités, à savoir écrivain et catholique ? Et à partir de là, est-ce que pour vous l'expérience littéraire est suffisante en elle-même ou ne se conçoit-elle nécessairement qu'avec la Foi, dans un rapport religieux ?
Juan Asensio
Un écrivain qui ne serait que cela : un écrivain catholique, serait un bien mauvais écrivain ou bien un écrivain seulement capable de faire frémir les vieilles filles des Procure. Je vous rappelle que ce genre de classification particulièrement sotte faisait éructer de mécontentement d’immenses écrivains tels que Claudel ou Bernanos, catholiques pour le moins intransigeants. Je reprends à mon compte l’idée de Harold Bloom selon laquelle tout écrivain digne de ce nom doit, lorsqu’il décide d’écrire, «ruiner les vérités sacrées», c’est-à-dire, tout en admirant ses prédécesseurs, faire comme si, avant lui, nul n’avait écrit. Si Hermann Broch n’était resté que respectueux de son modèle antique, jamais il n’aurait pu parvenir à achever son somptueux roman intitulé La mort de Virgile.
De la théorie à la pratique : je ne suis pas écrivain mais critique littéraire et essayiste, ne mélangeons pas les genres. Je dis cela non par dédain envers les écrivains ou dépit de n’en être point mais bien au contraire parce que j’éprouve à leur endroit un respect immense. Or, vous avez sans doute remarqué que n’importe qui, aujourd’hui, se prétend le digne héritier de Céline ou de Proust. Je laisse donc l’appellation d’écrivain, aussi sale qu’une putain centenaire qui n’aurait pas pris de douche, à des vieillards libidineux comme Philippe Sollers et à de prétentieuses bonnes femmes telles que Christine Angot que son nouvel éditeur, Le Seuil, sans la moindre honte, a achetée (comme s'il s'agissait d'une marchandise : c'est peut-être bien le cas, le marché est désarmant) pour une somme parfaitement indécente. Nous nous trouvons dans une époque, hélas, où le premier crétin ayant tagué deux rimes plates sur un mur de pissotière est digne de recevoir tous les honneurs. S’il favorise le «lien social», s’il évoque le délicat phrasé de la banlieue, s’il va même jusqu’à choquer le bon père de famille (en lui rappelant par exemple qu’une gamine de douze ans peut être diablement désirable) tout en restant dans les normes (il faut choquer jusqu’à un certain point mais pas au-delà) en prétendant que l'art se doit d'ignorer les tabous, alors dans ce cas, il peut directement prétendre à l’Académie française.
Benoît Hocquet
Vous évoquez en mal Christine Angot ou Philippe Sollers. Cependant, vous avez suivi depuis quelques années maintenant, avec ce qu'on pourrait nommer un grand zèle critique, l'œuvre de Maurice G. Dantec, dont vous ne lirez pas, comme vous l'annonciez dans une de vos notes, le dernier roman Artefact, paru cette rentrée. Maintenant, il semble que vous n'ayez plus rien à dire sur cet auteur. Pour autant, quel regard jetez-vous sur les nombreux textes critiques que vous lui avez consacrés jusqu'à maintenant ? Est-ce qu'il n'y a pas chez le critique un véritable risque de désaffection au terme d'un long travail, perspective que je trouve personnellement assez désespérante, après que vous l'avez défendu avec conviction pendant si longtemps ? Et pour en finir avec Dantec, ne trouvez-vous pas un peu louche l'esprit de secte qui semble animer toute la communauté de ses lecteurs, quand même le dernier tome de son journal maniait avec une autodérision certaine toutes ces considérations à propos d'une Apocalypse dont l'auteur ne cesse d'annoncer la venue, avec une certaine confusion d'ailleurs ?
Juan Asensio
Beaucoup de questions en une seule.
Je ne renie évidemment aucun de mes textes consacrés aux romans de Maurice G. Dantec, ce serait absurde même si, après ma critique de Villa Vortex qui annonçait (pour qui savait lire, je vous l’accorde) la conversion de son auteur au christianisme, effectivement, je me suis trouvé quelque peu… vidé ou plutôt désarçonné. Et puis, comme ce que j’avais écrit sur Villa Vortex me paraissait, et me paraît encore parfaitement valable pour les romans qui l’ont suivi (à l’exception d’Artefact, vous l’avez signalé, que je n’ai pas lu), à quoi bon réécrire le même texte avec moins de hargne pour défendre l’auteur, moins de vigueur et surtout, sans réellement y croire ?
Un écrivain, pardonnez-moi cette banalité, est une personne sachant écrire et l’on ne peut pas exactement parler de Dantec comme étant un styliste, un puriste de la langue française… Ce qui m’intéressait donc davantage chez cet auteur, c’étaient ses fulgurances, l’étendue de ses références (de Deleuze jusqu’aux Pères de l’Église en passant par beaucoup d’auteurs de science-fiction), le fait de citer, ce que quasiment plus personne ne fait aujourd’hui, par ignorance mais aussi par trouille, des auteurs tels que Georges Bernanos, Dominique de Roux, Pierre Boutang, Léon Bloy, George Steiner et même Ernest Hello (par exemple dans le dernier tome de son Journal)…
Il y a donc, oui, vous avez raison, un risque véritable de fatigue, de lassitude, de désaffection, position compliquée par le fait que je connaissais personnellement Maurice G. Dantec, du moins, jusqu’à ce que son agent littéraire, celui-là même qui l’a fait signer chez Albin Michel, décide que j’étais, subitement, devenu persona non grata, ayant trahi la sainte cause… Me voici une nouvelle fois promu Judas !
Soyons sérieux. Il y a donc, oui encore, un risque non plus simplement de simple désaffection mais de réel éloignement puisque, vous l’aurez compris, la pire calamité pouvant tomber sur un écrivain est la création d’une société des lecteurs, qui ne lisent rien ou de travers et se réclament de l’œuvre d’un romancier à des fins presque systématiquement uniquement, hélas, politiques, ce qui est le cas avec la majorité des lecteurs de Dantec, qui ont peut-être quelque mal à croire que Duns Scott est autre chose qu'un super-gentil de la revue Strange… À mon sens, les meilleurs lecteurs de l’œuvre du romancier sont également ceux qui s’en sont finalement assez rapidement éloignés : Olivier Noël, Bruno Gaultier, Germain Souchet, Jean-Baptiste Morizot et enfin moi-même.
Je ne vois personne d’autre susceptible de défendre intelligemment (Jean-Louis Kuffer peut-être...) les textes de Dantec qui, après tout, est un grand garçon et reste parfaitement libre de diriger sa carrière comme il l’entend.
Benoît Hocquet
C'est très intéressant en un sens puisque vous en revenez presque à l'avis de Richard Millet disant ne trouver dans les romans de Dantec aucune «écriture digne de ce nom». Vous y aviez fait référence dans une de vos notes, en invitant Richard Millet à s'intéresser d'un peu plus près à justement ces éclairs de beauté, ces fulgurances. Par ailleurs, vous évoquez surtout le cas de Dantec mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu passé la même chose avec George Steiner que vous teniez aux commencements pour «génial commentateur» alors que maintenant vous semblez plus le considérer comme un «habile vulgarisateur», comme si l'édifice critique que vous bâtissez patiemment menace à tout moment de s'affaisser comme un château de cartes. Je sais bien que l'infaillibilité critique est impossible mais cela dénote un réel risque.
Juan Asensio
Vous avez tout à fait raison et je n’ai pas l’habitude de me dédire. Attention tout de même : vous n’évoquez que des jugements, les miens (que je ne renie absolument pas) parus sur mon blog alors que j’ai été, vis-à-vis de Steiner comme de Dantec, toujours assez critique dans mes ouvrages. Il n’y a aucune infaillibilité de la critique, qui peut bien sûr se tromper. Or, je ne me suis pas trompé sur Dantec, m’étant contenté, lors de la parution de Villa Vortex, de dire, en somme : voici les raisons pour lesquelles ce romancier est diablement intéressant et voici de quelle façon, en suivant quelle voix, il le deviendra encore plus. La fonction d’un critique est d’accompagner l’auteur, de démêler à ses propres yeux ses ouvrages (comme Claude-Edmonde Magny le fit à propos de Monsieur Ouine de Georges Bernanos, lequel n’oublia pas de remercier la critique…), et non point, comme c’est hélas le cas aujourd’hui, d’en vendre les produits ou de déclarer qu’ils sont périmés, en les ayant, tout au plus, vaguement reniflés. Cela, c’est le métier d’un vendeur de saucisses, pas d’un critique littéraire. Il est vrai que les professions ont aujourd’hui tendance à se mélanger de fâcheuse manière.
Richard Millet, magnifique romancier, nul ne lui conteste ce titre, ferait d’ailleurs bien de revoir sa méthode herméneutique, pour le moins sujette à caution. Je le soupçonne de n’avoir lu aucun roman de Dantec parce que, s’il l’a effectivement lu et qu’il continue d’affirmer qu’il n’y a là pas d’écriture (aussi bancale qu’on le voudra mais, je le répète, charriant des fulgurances), alors cela signifie que cet homme est tout simplement un sot. C’est d’ailleurs un doute qui, dans mon esprit, ne cesse de grandir. Je vous renvoie à ma critique du bizarre Désenchantement de la littérature : d’excellentes choses sont écrites dans ce petit livre mais il y a un problème, et de belle taille, dans le fait que cet ouvrage est davantage qu’un pamphlet un traité de savoir-vivre à l’usage d’un écrivain en fin de course (selon ses propres dires). Nous verrons donc si Millet se tient à son impératif catégorique : le silence, le sien d’abord…
[Ajout du 18 mai : non, si j'en juge par le récent Opprobre].
Le cas de George Steiner est autrement plus complexe que celui de Dantec, d’abord parce qu’il nourrit un étrange rapport avec les auteurs qu’il commente (il sait ne pas leur arriver à la cheville, il souffre de ne point posséder leur talent ou leur génie, certain ami l’a même vu pleurer de rage devant l’évidence de ce fait, et pourtant, il juge ces mêmes auteurs qui le paralysent, il les critique parfois durement, ou ne les cite jamais, l’exemple le plus frappant de ce mutisme étant le cas du Grand d’Espagne, Georges Bernanos); ensuite parce qu’il nourrit un rapport plus que paradoxal avec le christianisme, qui le fascine et l’horripile. Il y a plus : j’ai rencontré l’homme et, ma foi, pour rester poli, je ne l’ai pas franchement trouvé à la hauteur de son œuvre. Dantec, au moins, qui est d’une gentillesse assez exceptionnelle, ne fait pas mentir son œuvre en se juchant sur un promontoire depuis lequel il distribue à ses admirateurs les bons et les mauvais points.
En règle générale, les sociétés de lecteurs, les cercles d’amis, les «happy few», bref, donnez-leur le nom que vous voudrez, qui s’érigent autour d’une œuvre et surtout de son auteur dont il s’agit d’analyser le moindre grattement de nez sont l’une des pires calamités digne de s’abattre sur la tête d’un écrivain : ainsi, pour ne vous citer qu’un seule exemple, la ridicule société des lecteurs de Renaud Camus est d’une insignifiance, d’une prétention et d’une vulgarité sans bornes. Il est vrai que Camus lui-même fait absolument tout ce qu’il est possible de faire pour distribuer, tous les jours, quelques miettes pour lesquelles ses poules et ses coqs seraient prêts à se dévorer les uns les autres.
Benoît Hocquet
Finissons-en donc, puisqu'il le faut. Une chose m'a toujours frappé à la lecture de votre blog, c'est la référence immédiate que vous faites à Andrei Tarkovski et à son chef-d'œuvre Stalker. Ne pensez-vous pas qu'avec des auteurs comme Bergman ou Tarkovski, le cinéma atteint une densité proprement littéraire, supplantant par là même la peinture par exemple ? Il vous est fréquemment arrivé d'évoquer des films et dans une note récente intitulée Synesthésies, vous déploriez l'incapacité de la littérature contemporaine à susciter des images comme elle pouvait le faire autrefois. Est-ce que «le désenchantement de la littérature» dont parle Richard Millet ne s'accompagne pas nécessairement de l'avènement du cinématographe en tant qu'art de la modernité, promis à une large diffusion ?
Juan Asensio
Peut-être mais n’oubliez pas la grande importance de la peinture dans les chefs-d’œuvre de Tarkovski. Certes, certaines des images que ces deux génies nous ont données sont destinées à hanter, je l’espère pour quelques siècles, notre imaginaire.
Votre second point : le cinématographe, s’il est de qualité (Tarr, Bresson, Rohmer, les deux que vous avez cités et une toute petite poignée de maîtres) ne me gêne pas. La télévision en revanche et la pornographie visuelle qu’elle implique, c’est là un autre sujet…
Ceci dit, attention, évitons de faire trop de généralités à propos de la technique qui, en elle-même, n’est ni bonne ni mauvaise : la Toile est ainsi le lieu où naissent (et parfois meurent) des sites ou des blogs d’une immense qualité tout comme celui où pullulent les désirs imbéciles de quelques millions d’anonymes crétins.
Quoi qu’il en soit, dans la note que vous avez l’amabilité de rappeler, je vous rappelle que j’affirmais également que l’Esprit souffle où il veut, puisque je rapprochais certaines des somptueuses images de Matrix des gravures de Doré pour L’Enfer de Dante !
21/05/2008 | Lien permanent
Quelques lectures du stalker - Gustave Thibon

12/06/2004 | Lien permanent
Alexandre Mathis visionnaire, par Francis Moury

 modeste logis, tout comme je n'ai pu lire son deuxième roman, Les condors de Montfaucon. Je répare donc, par ces lignes toujours précises de Francis Moury (le sous-titre de son article est : Surnaturalisme et réalisme dans la trilogie parisienne de Mathis), quelque peu de ma procrastination qui, aux yeux d'un auteur (je ne le sais que trop...!), paraît toujours coupable : quoi se dit-il, se peut-il qu'un lecteur ne se précipite pas immédiatement sur mon livre pour le dévorer ? Comment est-ce donc possible ? Oui, hélas, cela se peut, cela est parfaitement possible, cet oubli, cette distraction, ce refus de l'onction du baptême qu'est, en une image à peine exagérée, la lecture. Un livre qui n'est donc pas lu est d'une certaine façon un livre mort (ainsi considérée, ma bibliothèque, pourtant modeste, est déjà un vaste mausolée) ou, mieux, l'une de ces âmes enfantines qui erre plaintivement dans les limbes.
modeste logis, tout comme je n'ai pu lire son deuxième roman, Les condors de Montfaucon. Je répare donc, par ces lignes toujours précises de Francis Moury (le sous-titre de son article est : Surnaturalisme et réalisme dans la trilogie parisienne de Mathis), quelque peu de ma procrastination qui, aux yeux d'un auteur (je ne le sais que trop...!), paraît toujours coupable : quoi se dit-il, se peut-il qu'un lecteur ne se précipite pas immédiatement sur mon livre pour le dévorer ? Comment est-ce donc possible ? Oui, hélas, cela se peut, cela est parfaitement possible, cet oubli, cette distraction, ce refus de l'onction du baptême qu'est, en une image à peine exagérée, la lecture. Un livre qui n'est donc pas lu est d'une certaine façon un livre mort (ainsi considérée, ma bibliothèque, pourtant modeste, est déjà un vaste mausolée) ou, mieux, l'une de ces âmes enfantines qui erre plaintivement dans les limbes.(Nota bene : les droits sont réservés pour les photographies illustrant cet article, prises par Alexandre Mathis et reproduites dans Les condors de Montfaucon).
I Citations parallèles chronologiques en guise de préliminaire critique
«Évidemment, je l’admets, Damaïchos a besoin, pour se faire croire, de lecteurs de bonne composition; mais, si son récit est vrai, il réfute victorieusement l’assertion de ceux d’après lesquels il s’agit d’une pointe de rocher, arrachée au sommet d’une montagne par des vents et des ouragans, et qui, tournoyant comme les toupies, se mut dans les airs jusqu’au moment où le tourbillon se ralentit et cessa ; elle fut alors précipitée en bas et tomba.»
Plutarque, Vies Parallèles (trad. Bernard Latzarus, éd. Garnier Frères, coll. Classiques Garnier, tome V, 1955 – Sauf exception, la ville de publication est toujours Paris).
«Les mythes modernes sont encore moins compris que les mythes anciens, quoique nous soyons dévorés par les mythes. Les mythes nous pressent de toute part, ils servent à tout, ils expliquent tout.»
Honoré de Balzac, La Comédie humaine / La Vieille Fille (1836, éd. Club français du Livre, coll. Classiques – Œuvres de Balzac, vol. 11, 1950).
«J’ai maintes fois été étonné que la grande gloire de Balzac fût de passer pour un observateur; il m’avait toujours semblé que son principal mérite était d’être visionnaire, et visionnaire passionné. […]. De Maistre et Edgar Poe m’ont appris à raisonner.»
Charles Baudelaire, Œuvres complètes (éd. Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1975).
«Une des caractéristiques du Loup des steppes était d’être un homme nocturne. Il craignait le jour qui ne lui était pas propice, ne lui avait jamais apporté rien de bon. […] Il était entouré maintenant de l’air du solitaire, de cette atmosphère silencieuse, de ce dépouillement du monde environnant, de cette inaptitude aux relations humaines, contre lesquelles ne pouvaient lutter aucune volonté ni aucune nostalgie.»
Hermann Hesse, Le Loup des steppes (1927, éd. Calmann-Lévy, trad. de Juliette Pary, 1947).
 «L’histoire a dans tout ceci resserré le temps, comme l’espace s’est resserré sur cet endroit fatidique de la Beregonnegasse. Ainsi dans les archives de Hambourg, on parle d’atrocités qui se commirent pendant l’incendie par une bande de malfaiteurs mystérieux. Crimes inouïs, pillages, émeutes, hallucinations rouges des foules, tout cela est parfaitement exact. Or, ces troubles eurent lieu plusieurs jours avant le sinistre. Comprenez-vous la figure que je viens d’employer sur la contraction du temps et de l’espace ? […] Et ne doit-on pas, avec horreur et désespoir, admettre cette loi fantastique de contraction de Fitzgerald-Lorenz ? La contraction, monsieur, ah ! ce mot est lourd de choses !»
«L’histoire a dans tout ceci resserré le temps, comme l’espace s’est resserré sur cet endroit fatidique de la Beregonnegasse. Ainsi dans les archives de Hambourg, on parle d’atrocités qui se commirent pendant l’incendie par une bande de malfaiteurs mystérieux. Crimes inouïs, pillages, émeutes, hallucinations rouges des foules, tout cela est parfaitement exact. Or, ces troubles eurent lieu plusieurs jours avant le sinistre. Comprenez-vous la figure que je viens d’employer sur la contraction du temps et de l’espace ? […] Et ne doit-on pas, avec horreur et désespoir, admettre cette loi fantastique de contraction de Fitzgerald-Lorenz ? La contraction, monsieur, ah ! ce mot est lourd de choses !»Jean Ray, La ruelle ténébreuse (1932) in Les 25 meilleures histoires noires et fantastiques (éd. Gérard & Cie., Bibliothèque Marabout, série fantastique, Verviers 1961).
«Un des aspects les plus déroutants du problème des mythes est certainement le suivant : il est avéré que dans de nombreuses civilisations, les mythes ont répondu à des besoins humains assez essentiels pour qu’il soit dérisoire de supposer qu’ils ont disparu. Mais, dans la société moderne, on voit mal de quoi se satisfont ces besoins et par quoi la fonction du mythe est assumée.»
Roger Caillois, Le mythe et l’homme (1935), livre III, § 3 Paris, mythe moderne (Gallimard, coll. Idées, 1972).
 «Des arbres ? Elle ne se rappelait pas avoir vu une rangée d’arbres à cet endroit lorsqu’elle était passée par-là la fois précédente. Bien sûr, cela remontait à l’été dernier et elle était arrivée à Fairvale en plein jour, fraîche et dispose. Aujourd’hui, elle était épuisée parce qu’elle avait conduit dix-huit heures d’affilée ; néanmoins, elle se souvenait fort bien de la route et sentait confusément qu’elle s’était trompée. Se souvenir : ce mot déclenchait tout. Or, elle se souvenait vaguement avoir hésité il y avait une demi-heure environ en arrivant au carrefour. Oui, c’était bien cela : elle avait tourné dans la mauvaise direction. Et maintenant elle était perdue, Dieu sait où. La pluie tombait et tout était d’un noir d’encre alentour…»
«Des arbres ? Elle ne se rappelait pas avoir vu une rangée d’arbres à cet endroit lorsqu’elle était passée par-là la fois précédente. Bien sûr, cela remontait à l’été dernier et elle était arrivée à Fairvale en plein jour, fraîche et dispose. Aujourd’hui, elle était épuisée parce qu’elle avait conduit dix-huit heures d’affilée ; néanmoins, elle se souvenait fort bien de la route et sentait confusément qu’elle s’était trompée. Se souvenir : ce mot déclenchait tout. Or, elle se souvenait vaguement avoir hésité il y avait une demi-heure environ en arrivant au carrefour. Oui, c’était bien cela : elle avait tourné dans la mauvaise direction. Et maintenant elle était perdue, Dieu sait où. La pluie tombait et tout était d’un noir d’encre alentour…»Robert Bloch, Psychose (1959, trad.Odette Ferry éd. Gérard & Cie, Bibliothèque Marabout géant, Verviers, 1960).
 «Les secrets de l’art sont pour Freud de vrais secrets, inoculant à ceux qui les approchent le désir ardent de les déchiffrer tout en restant, à jamais, indéchiffrables.»
«Les secrets de l’art sont pour Freud de vrais secrets, inoculant à ceux qui les approchent le désir ardent de les déchiffrer tout en restant, à jamais, indéchiffrables.»Dr. Francis Pasche, La métapsychologie balzacienne (1968), revu et augmenté sous le titre La mort et la folie dans l’œuvre de Balzac in À partir de Freud, chapitre13 (éd. Payot, Bibliothèque scientifique, coll. Sciences de l’homme, 1969).
II La création littéraire chez Mathis
Le processus de la création littéraire romanesque de Mathis s’accélère : le résultat est ici non moins vertigineux que dans son premier roman. Albert Béguin avait étudié Balzac visionnaire (1946) : nous allons étudier Mathis visionnaire (2005).
Dimensions de la création romanesque chez Mathis : ampleur de la vision
 Qu’on en juge d’abord et tout prosaïquement par le rapport temps/quantité littéraire créée : un premier roman paru de Mathis, Maryan Lamour dans le béton (éd. I.d.é.e.s./Encrage, Les Belles Lettres, 1999) accouché d’abord de 1982 à 1990 puis repris en 1996 jusqu’à sa version définitive de 661 pages et 30 photographies. Aujourd’hui Mathis nous offre ce second roman, Les condors de Montfaucon (éd. E-dite, 2004) en gestation de 1998 à 2001, principalement rédigé de mars à septembre 2001 et comprenant pour sa part 619 pages et 20 photographies. On indique ces données pour l’histoire future de la littérature française qui nous remerciera de notre précision possible grâce à l’amitié de l’auteur. Face au génie, on n’est jamais trop précis. Il faut bien entailler le marbre par un endroit pour le faire sien et commencer à le travailler. Face à ces deux blocs de marbre pur que sont ces deux romans, le critique doit modestement faire son travail, d’abord chronologique et factuel.
Qu’on en juge d’abord et tout prosaïquement par le rapport temps/quantité littéraire créée : un premier roman paru de Mathis, Maryan Lamour dans le béton (éd. I.d.é.e.s./Encrage, Les Belles Lettres, 1999) accouché d’abord de 1982 à 1990 puis repris en 1996 jusqu’à sa version définitive de 661 pages et 30 photographies. Aujourd’hui Mathis nous offre ce second roman, Les condors de Montfaucon (éd. E-dite, 2004) en gestation de 1998 à 2001, principalement rédigé de mars à septembre 2001 et comprenant pour sa part 619 pages et 20 photographies. On indique ces données pour l’histoire future de la littérature française qui nous remerciera de notre précision possible grâce à l’amitié de l’auteur. Face au génie, on n’est jamais trop précis. Il faut bien entailler le marbre par un endroit pour le faire sien et commencer à le travailler. Face à ces deux blocs de marbre pur que sont ces deux romans, le critique doit modestement faire son travail, d’abord chronologique et factuel.Enfin ce troisième, Chambres de bonnes – Le succube du Temple. Conte fiévreux (éd. E-dite, Paris, octobre 2005) rédigé en 2003, comprenant 273 pages et de nombreuses illustrations, situé lui aussi à Paris et qui constitue le dernier volume de ces «errances parisiennes», dixit l’auteur. Ce dernier est moins ample quantitativement mais son espace-temps comme sujet est tout autant démesuré que celui des deux romans précédents.
Le style visionnaire de Mathis
 L’écriture maintient et même approfondit sa beauté déjà si particulière, celle d’un authentique diamant noir brut et contemporain, nourri de notre présent (bien des faits réels, autobiographiques ou non, y figurent) mais aussi riche de tout notre passé, parfois lourde de notre futur immédiat. De Maryan Lamour dans le béton à Chambres de bonnes en passant par Les condors de Montfaucon, mêmes caractéristiques fondamentales.
L’écriture maintient et même approfondit sa beauté déjà si particulière, celle d’un authentique diamant noir brut et contemporain, nourri de notre présent (bien des faits réels, autobiographiques ou non, y figurent) mais aussi riche de tout notre passé, parfois lourde de notre futur immédiat. De Maryan Lamour dans le béton à Chambres de bonnes en passant par Les condors de Montfaucon, mêmes caractéristiques fondamentales.Ce style nous met en présence d’un météore qu’on doit placer d’évidence dans le panthéon le plus pur de notre langue, le plus pur mais non le moins ardu : l’effort requis du lecteur est cependant apparent plus que réel. Une fois qu’on y est, qu’on a pris le pli, on se laisse porter dans le recoin le plus actuel comme le plus inactuel, le plus inattendu comme le plus ténébreux. Mathis est du côté de la poésie médiévale, du côté de la poésie urbaine d’un Balzac comme d’un Céline, parallèlement aux meilleurs écrivains de l’histoire de la littérature française, y compris celle reconnue comme marginale d’abord puis devenue aujourd’hui classique. Mathis décrit donc comme Robbe-Grillet et les auteurs du Nouveau roman des choses, des espaces, des itinéraires, des faits objectivement donnés. Mais il sait que Balzac en a décrit avant Robbe-Grillet : il est nourri aussi bien des deux et les a intégrés tous les deux. Il peut se souvenir du passé en longues phrases ciselées (10 lignes ne sont pas rares, semées d’incises mais rigoureuses) comme celles de Proust mais de telles phrases peuvent aussi servir à rendre un banal présent hallucinant, à prévoir un futur terrifiant, à enregistrer une faille psychique comme spatio-temporelle menant au fantastique voire à la terreur. Mathis marche dans Paris comme Céline, violent, lucide, moral absolument et peintre absolu de l’immoralité la plus atroce. Il marche aussi comme Ulysse de Joyce dans Dublin, parfois même comme Ulysse chez Homère : rusé (au sens qu’Hegel donnait à ce terme dans sa célèbre expression concernant la nature de la raison, bien sûr !), intelligent, saccadé, heurté, pointu, taraudant les espaces réels à peine ouverts à l’œil public pour les écarter d’une manière secrète, nouvelle, vers le noir et le rouge du cauchemar urbain. Ce faisant, Mathis s’élève régulièrement à la vision authentiquement apocalyptique et prophétique, à la poésie biblique, antique aussi, la plus noire. Mathis écrit comme les auteurs contemporains de la littérature policière et du roman noir anglo-saxon comme français. Et il écrit parfois comme un auteur de littérature fantastique américain ou européen.
Tout cela est brassé, intégré, restitué pour nous donner de l’absolument nouveau : pas si paradoxal ! Car le style c’est l’homme et il n’y a qu’un Mathis. Celui qui vit en observateur à Paris hic et nunc, en témoin libre, concerné, impliqué, aventurier. Le risque stylistique que prend Mathis est d’une essence différente de celui pris par ses prédécesseurs – qu’il va peut-être nous reprocher d’avoir cités en déniant vigoureusement certaines au moins de ces parentés ressenties par notre subjectivité comme évidente, mais pas du tout pour lui ? – car Mathis vit à Paris ici et maintenant. Il ne vit pas dans le désert antique, ni dans le Paris médiéval, ni dans celui de Balzac, ni dans celui des années 60 : il les a certes connus voire vécus. Mais il vit dans «notre» Paris : celui que nous reconnaissons nôtre parce que nous y vivons aussi. Et dans le temps qui est le nôtre parce que nous avons connu esthétiquement le Paris des années 1950-1960 par les films et les livres, puis vécu celui des années 1980, celui des années 1990, celui de cette transition 2000 qui arrive à nous en 2005 chargée du travail de la conscience créatrice, du travail de l’histoire du monde, d’une conscience dont nous sommes absolument, subjectivement comme objectivement, les éléments contemporains, les témoins aveugles trompés par les illusions et les apparences, jetant de temps en temps un œil vers la paroi de notre caverne parisienne multimédia dangereuse car multiforme, une caverne que Platon lui-même peut-être aurait du mal à reconnaître s’il revenait parmi nous.
 Différences cependant entre le premier et le second roman : dans Les condors de Montfaucon, moins de monologues pensés donnés ouvertement comme des «courants de conscience» – qui évoquaient directement Faulkner ou Joyce voire Sartre – que dans Maryan Lamour dans le béton. Ils sont encore là certes mais davantage dilués entre des identités qu’on saisit au vol avec souplesse et clarté, entrecoupés de remarques du narrateur, et d’une narration objective classique. Une construction d’ensemble encore plus sophistiquée, plus labyrinthique que dans Maryan Lamour dans le béton mais pourtant plus aisée à pénétrer, plus épurée et aérée : un personnage peut reparaître dix pages plus loin sans que le fil soit interrompu ni perdu tant la structure est solide et étudiée. Elle permet cette interaction démesurée d’une multitude de visions entre deux catégories principales de personnages – les démoniaques et les autres – tournant pour la deuxième fois autour d’une figure salvatrice féminine en danger, témoin pur(e) à abattre. Construction plus ample mais pourtant plus aérée que celle de Maryan Lamour dans le béton, celle des Condors de Montfaucon fait corps, nous a-t-il semblé, plus absolument comme plus naturellement avec son sujet. Elle coule plus aisément.
Différences cependant entre le premier et le second roman : dans Les condors de Montfaucon, moins de monologues pensés donnés ouvertement comme des «courants de conscience» – qui évoquaient directement Faulkner ou Joyce voire Sartre – que dans Maryan Lamour dans le béton. Ils sont encore là certes mais davantage dilués entre des identités qu’on saisit au vol avec souplesse et clarté, entrecoupés de remarques du narrateur, et d’une narration objective classique. Une construction d’ensemble encore plus sophistiquée, plus labyrinthique que dans Maryan Lamour dans le béton mais pourtant plus aisée à pénétrer, plus épurée et aérée : un personnage peut reparaître dix pages plus loin sans que le fil soit interrompu ni perdu tant la structure est solide et étudiée. Elle permet cette interaction démesurée d’une multitude de visions entre deux catégories principales de personnages – les démoniaques et les autres – tournant pour la deuxième fois autour d’une figure salvatrice féminine en danger, témoin pur(e) à abattre. Construction plus ample mais pourtant plus aérée que celle de Maryan Lamour dans le béton, celle des Condors de Montfaucon fait corps, nous a-t-il semblé, plus absolument comme plus naturellement avec son sujet. Elle coule plus aisément.Dans ce second roman comme dans le premier, on passe discrètement du romanesque à la poésie en prose, rappelant parfois celle toute baudelairienne du Spleen de Paris. Certaines phrases sont quotidiennes, d’autres sont «sur-quotidiennes», réflexives. De l’argot documentaire encore et toujours présent comme vulgarité presque poétique, nouvelle sauvagerie restituant son innocence perdue et barbare. Une forme capable de jouer avec l’espace et le temps internes comme externes, prenant la syntaxe comme élément dramaturgique novateur. D’une dynamique stylistique permettant à différents niveaux de langages de rivaliser en pertinence face à une réalité dont chacun saisit un fragment mais dont seul l’ensemble offre une totalité signifiante elle-même novatrice par son architecture. Tel est le reflet de la quête, du dédale par lequel l’écriture conçue comme témoignage inspiré doit passer pour trouver derrière le visible, l’invisible. Merleau-Ponty aurait aimé ce roman. Il aurait aimé aussi le roman précédent.
 Chambres de bonnes, le troisième roman, se distingue nettement des deux précédents par une phrase plus simple, moins longue mais sa narration utilise toujours le thème de l’entrelacement et des fils tendus constituant progressivement un réseau de consciences : réseau dont le centre ne cesse de se dérober à mesure que la dynamique de l’intrigue se noue, fait rebondir le lecteur d’une facette à l’autre, d’un fragment à l’autre d’une «vérité-réalité» cachée, n’apparaissant que par bribes.
Chambres de bonnes, le troisième roman, se distingue nettement des deux précédents par une phrase plus simple, moins longue mais sa narration utilise toujours le thème de l’entrelacement et des fils tendus constituant progressivement un réseau de consciences : réseau dont le centre ne cesse de se dérober à mesure que la dynamique de l’intrigue se noue, fait rebondir le lecteur d’une facette à l’autre, d’un fragment à l’autre d’une «vérité-réalité» cachée, n’apparaissant que par bribes.Dans les trois romans, le style permet à la perception de devenir phénoménologie et à la phénoménologie de devenir perception : les deux extrémités dialoguent de concert, en permanence. Interne et externe sont tournés et retournés : l’actif et le passif alternés. Ce style permet à différents endroits de décrire précisément la fracture par où le fantastique le plus pur – comme objet d’angoisse puis de terreur – peut s’introduire au sein de la fiction romanesque la plus réaliste et la plus cruellement observatrice. Une description objective pure de la vie végétale et animale du Parc des Buttes-Chaumont peut amener à une auto-analyse psychologique débouchant sur le surnaturel objectif. En un même paragraphe. La transparence absolue du style permet à sa matière de s’y exhiber comme ressource première : c’est un style travaillé pour qu’il permette à l’invisible d’y transparaître aisément au sein du visible décrit avec un réalisme strict et maximal. La contrariété n’est ici nullement contradiction mais matrice d’un accouchement absolument réussi d’une réalité analysée puis transfigurée par la rigueur analytique elle-même. Du réalisme au surnaturalisme, la conséquence stylistique est bonne chez Mathis. Elle est bonne, claire, simple, évidente par-delà son apparente complexité, constamment déjouée puis reconstruite puis déjouée de nouveau. Jusqu’au bout, jusqu’au moment où le jeu stylistique se heurte à sa propre matière qu’il ne peut dès lors plus que transcrire aussi fidèlement que possible. Unité retrouvée après les fractures. Pour combien de temps ? Chaque unité est grosse d’une fracture nouvelle. La liberté de l’esprit est ici la liberté du monde : infinie. Mathis nous avait confié qu’il considère la toile d’araignée comme le paradigme de son écriture. Dont acte filaire.
Les matières du style : thèmes visionnaires de Mathis
 Maintien et même approfondissement des thèmes bien résumés au verso du livre et leur énumération précise est exacte : il y a tout cela dans Les condors de Montfaucon. Un Paris contemporain (Marianne Lamour dans le béton, Les Condors de Montfaucon) ou un Paris moderne (Chambres de bonnes se situe dans le quartier du Temple à Paris vers 1950-1958) souvent satirique mais aussi souvent dangereux, vampirisé par un Paris oublié, une économie souterraine du crime que seuls quelques regards professionnels ou impliqués par hasard peuvent décrypter car ils savent rési
Maintien et même approfondissement des thèmes bien résumés au verso du livre et leur énumération précise est exacte : il y a tout cela dans Les condors de Montfaucon. Un Paris contemporain (Marianne Lamour dans le béton, Les Condors de Montfaucon) ou un Paris moderne (Chambres de bonnes se situe dans le quartier du Temple à Paris vers 1950-1958) souvent satirique mais aussi souvent dangereux, vampirisé par un Paris oublié, une économie souterraine du crime que seuls quelques regards professionnels ou impliqués par hasard peuvent décrypter car ils savent rési
28/02/2005 | Lien permanent
Les limites de la littérature sont celles mêmes de la critique

Jacques Ellul, Exégèse des nouveaux lieux communs
Dans un livre mémorable (le remarquable et peu connu du public français La persuasion et la rhétorique) qui, je crois pour chacun de ses lecteurs, a constitué un choc rien de moins que physique, Carlo Michelstaedter déclarait de son propre travail, aussi désespérément lucide que secrètement serein : «Moi je sais que je parle parce que je parle mais que je ne persuaderai personne ; et c’est une malhonnêteté […]. Et pourtant ce que je dis a été dit tant de fois et avec tant de vigueur qu’il semble impossible que le monde ait encore continué après qu’eurent résonné ces mots.»
C’est poser, pour celui qui se mêle d’écriture, une double nécessité, celle de se taire, pour écouter en soi le vrai langage, celui de la persuasion contre celui, sec et stérile, de la rhétorique ou langage technique («Avant d’atteindre le règne du silence chaque mot sera un [ornement de l’obscurité, Gorgias, 492c] : apparence absolue, efficacité immédiate d’un mot qui n’aura pour tout contenu que le plus infime et obscur instinct de vie.
Tous les mots seront des termes techniques lorsque l’obscurité sera voilée pour tous de la même façon, les hommes étant tous dressés de la même façon. Les mots se référeront à des relations déterminées pour tous selon un même mode»), et celle, contradictoire, d’écrire pourtant, coûte que coûte, le corps et l’esprit fatigués de mener une lutte intellectuelle et spirituelle plus dure que la bataille d’hommes.
Peu importe la nature même de l’écriture, poésie, roman ou commentaire : nulle part je crois Michelstaedter n’affirme qu’il tient en peu d’estime la critique, sauf si, bien sûr, se réduisant elle aussi à n’être que rhétorique, celle-ci s’assèche et se momifie doucement en pompant les eaux vives de la parole, l’œuvre prétendument pure que commente cette critique. «Vivre les choses pour soi-même et non présumer les avoir vécues du fait que l’on en parle, cela est le sérieux», déclare encore l’auteur dans une lettre à Nino Paternolli (datée du 21 février 1910, in Épistolaire), sans que nous ne puissions aussitôt penser à l’exemple, glosé jusqu’à la nausée, de Rimbaud crevant d’ennui et tiédi à petit feux bourgeois dans quelque désert de poussière où il a enfoui ses «rinçures».
Ici encore l’exigence poétique la plus haute, telle qu’elle est posée par Michelstaedter, affirme qu’il faut ne pas craindre de se détacher des mauvais rêves que tous nous bâtissons de nos mots trompeurs, de nos mains suintantes, de nos bouches torves. La vraie vie est certes absente, mais la vie rêvée ou écrite est, pour sa part, néant, contre l’avis même d’innombrables auteurs (comment éviter l’exemple, extrême, de Marcel Proust ?) ayant affirmé que la vie n’était rien si ne la transcendait le verbe par lequel ils lui ont conféré une dimension extraordinaire, réellement miraculeuse : en un adjectif, démiurgique.
Quoi qu’il en soit, une secrète parenté lie je crois ces deux textes qui se répondent à l’évidence : la persuasion ou langue pleine, de quelque poids, lourde de présence, est retrait et écoute, écoute puis retrait avant que ne se lève le grondement venu des profondeurs, qu’il s’agira bien de mettre en forme, d’exorciser, de chanter.
Cette écoute est silence qui commande la retraite, s’il est vrai que seul le silenciaire doit, s’il veut chanter, écouter ce qui le précède et dans lequel il baigne, la phrase presque inaudible et pourtant connue de tout un chacun pourvu qu’il ose se taire, à condition qu’il se taise et laisse en son âme chanter la mélopée immémoriale, retourne au bain de silence duquel la vie nous arrache brutalement. Dans ce silence se lisent des qualités qui, n’en doutons point, tendent à devenir aujourd’hui non pas le bagage minimum requis tel que l’exigent nos bahuts fonctionnarisés et polarisés par le tropisme de la réussite mais l’exploit de plus en plus rare de celui qui, en se retenant, en écoutant et en faisant silence, disparaît, se réduit, se contracte, réduit sa voix à une basse qui, modulée, travaillée, sans cesse accordée à l’autre voix, l’intérieure, la plénière, formera tôt ou tard une secrète mélodie d’où le chant futur, reconquis, rédimé, s’élancera pour mêler sa voix aux multitudes d’autres voix qui façonnent et sculptent notre monde non pas silencieux mais accablé de tristesse, donc frappé de mutisme, comme le remarquait, dans une de ses coutumières et géniales intuitions, Walter Benjamin.
Pour parler il faut se taire et pour écrire, il faut se taire aussi, apparent paradoxe qui est quotidiennement – l’expression chaque minute, voire seconde désignerait une temporalité maudite plus proche de notre réalité inexorablement accélérée – bafoué par nos médiatiques plumes et par celles, virtuelles mais déjà jouisseuses d’une célébrité de cour d’école, de nos ineptes chroniqueurs de la banalité.
Je ne puis ainsi comprendre, bien que je la respecte au demeurant, la position d’un Jean-Jacques Nuel qui tente, avec une belle lucidité, une lucidité rare, d’accompagner la parution de son roman, Le Nom, comme on couvre (quelque marathon ou événement sportif ?) de soins le nouveau-né et tente de le guider dans un monde qui, sans lui être férocement hostile, se moque toutefois de son innocente présence.
Mon étonnement est encore redoublé lorsque cet auteur nous déclare qu’il en va, dans cet accouchement difficile et les soins attendris qui le suivent – et le précèdent –, d’une expérience «vitale». Il me faut être parfaitement clair. Je ne dénigre en aucun cas le livre de Nuel, que je n’ai pas encore lu.
Je ne sais en outre rien de la somme, sans doute bien réelle, de souffrances qui s’est solidifiée dans cette œuvre vivante qu’est un livre, en tout cas un bon livre et les bizarres rêves et sordides cauchemars qui se sont pétrifiés, glacés par l’implacable charme de l’écriture. Il me semble toutefois que la métaphore de la parution considérée comme le bel art par excellence (sa réussite à vrai dire) de la parturiente confine, et ce depuis des lustres, au lieu commun.
Et que penser encore de cette bizarre défiance à l’endroit de la parole critique (ou de ce que tel philosophe un peu trop célèbre appelait des «langages seconds»), évidemment stérile, évidemment envieuse de l’autre, celle qui serait couronnée des palmes de la création, défiance qui était déjà, à l’époque où Gautier (dans sa Préface de Mademoiselle de Maupin) se croyait spirituel de la punaiser, une vilaine mouche des plus communes : «Je plains de tout cœur le pauvre eunuque obligé d’assister aux ébats du Grand Seigneur» ? Nuel écrit ainsi, se souvenant peut-être de certain agacement bien visible sous ma plume : «A la différence d’un critique littéraire qui publie le produit de son activité ou le recueil de ses articles, un créateur naît de ses propres œuvres. Un auteur est le père d’une œuvre, laquelle, devenue livre, le fait naître à son tour.» Fort bien mais il serait après tout assez facile d’opposer à la cacochyme image, devenue catachrèse à force de bégayer, une bonne douzaine de textes (sous les plumes pour le moins autorisées de Sainte-Beuve, Barbey, Du Bos, Béguin, Blin, Poulet, Steiner, etc.) affirmant qu’une œuvre critique, à la condition expresse bien évidemment, je le disai plus haut, qu’elle se soit dépouillée de toute vanité, touche parfois (disons même : rarement), à la condition apparemment fort enviée de l’œuvre d’art, faux pléonasme qu’il me faut bien écrire, au risque même d’en accroître le simulacre.
Une œuvre est effacement et ce, quelle que soit sa nature, littéraire ou critique, je veux dire sans même garder à l’esprit le commandement fameux de Lanson qui écrivait en 1895 dans ses Hommes et Livres : «Notre métier ne vaut que par l’effacement de notre personne» ou sans même encore craindre ce futur, à vrai dire ce présent, ce futur devenu présent, que pointait lucidement Anatole France dans un article du Temps : «La critique est la dernière en date de toutes les formes littéraires; elle finira peut-être par les absorber toutes».
Gardons-nous toutefois des généralités car, ayant écrit que l’œuvre réelle était effacement, je n’ai absolument pas dit qu’il fallait s’en défier ou l’abandonner à son sort. C'est même tout le contraire. Je n’ai ainsi pas eu l’impression, en écrivant mes articles de critique, d’avoir simplement évacué le «produit de [mon] activité» ni même d’avoir contrevenu aux règles, édictées plus haut, de discrétion. Non, j’ai offert un livre, dont les membres épars ont été rassemblés dans et par une préface, aussi imparfaite qu’on le voudra mais néanmoins gage d’un sens, donc d’une direction. Du reste, je ne ferai pas à mon contradicteur l’injure de lui soumettre l’évidence suivante : si je suis parvenu à lier ensemble, à fagoter toutes ces gerbes n’ayant ni la même texture ni le même âge, c’est bien que mon travail est ordonné par quelque sombre faisceau ou, plus prosaïquement, qu’il n’est pas si mal fagoté que cela. Simplement, et je pense que j’écrirai rigoureusement la même chose si j’étais romancier (dans le beau recueil de nouvelles érudites, Le plomb d'Arnaud Bordes, l'expérience de l'écriture, sous de multiples et fascinants masques borgésiens plus que décadents, confine à une disparition bien réelle de l'auteur, comme le montre la première nouvelle, intitulée Disjecta Membra), simplement je ne puis me considérer comme un auteur, alors même pourtant que mon travail critique n’a strictement rien d’une petite bluette universitaire (ainsi s’emporte-t-il contre le sacro-saint dogme de l’objectivité scientifique), pour la simple et bonne raison que me manque, pardon : que nous manque l’autorité. Sans autorité c’est-à-dire tuteur, modèle, est-ce folie de penser que la frêle tige d’une plante, aussi résistante soit-elle (et Dieu sait que les herbacées basques ont toujours offert aux sorcières quelques diaboliques cordiaux), est condamnée à se courber puis se faner misérablement ? Je ne le crois pas et ne cherche rien tant, probablement, qu’à assurer de quelque tuteur une écriture évidemment fragile, inquiète, modeste sous une livrée chatoyante qui ne trompe que les mauvais lecteurs.
Trop d’auteurs, trop de livres, trop d’œuvres alors que je ne vois que mauvais pères, claironnantes fanfreluches et enfants morts-nés pas mêmes capables d’agiter un bibelot d’inanité sonore.
Un peu de modestie ne nous ferait pas de mal je crois, de marches en altitude aussi, là où la végétation rabougrie, pour survivre, mêle sa parcimonieuse sève aux roches les plus dures. Un peu de cette sublime modestie qui était aussi, sous la plume de Claude-Edmonde Magny, la plus formidable et intrépide originalité qui n'avait ainsi pas craint, avant de reparaître timidement, d'explorer les gouffres du silence, en un mot, de s'oublier.
Voici ce qu’écrivait ainsi cet auteur bien peu connu dans son Essai sur les limites de la littérature (sous-titré Les sandales d'Empédocle) paru en 1945 : «C'est dans la mesure où notre progrès spirituel est jalonné d’œuvres imparfaitement transcendées que nous pouvons parler de celles-ci. Ainsi je n'entrevois pas encore distinctement la ou les vérités qu'il y a dans le Bruit et la Fureur de Faulkner, c'est que je ne suis pas encore pris et comme englué dans la trame temporelle du livre. Je puis espérer qu'un jour viendra où elles se découvriront à moi avec la simplicité de ligne d'un dessin d'Hokusaï, cet Hokusaï qui précisément espérait qu'à cent et quelques années le moindre trait issu de sa plume saurait cerner l'Absolu. Il y a d'autres livres, Ulysse, par exemple, où j'ai l'impression d'entrevoir des directions, des amorces de vérités; de ceux-là, je puis parler ou écrire. Mais quand je serai au terme de l'ascension vers la vérité, quand j'aurai repoussé du pied le livre comme l'escabeau du suicidé, alors la parole me quittera comme elle a quitté Lord Chandos, comme le dessin peut-être a quitté Hokusaï le jour où l'Absolu s'est révélé à lui sans médiation aucune [...]. Ce jour-là, je serai sorti de la littérature, et de la critique, pour entrer en un autre domaine ; et les quelques mots que je pourrai écrire pour exprimer ce que j'ai compris, je sais d'avance qu'ils ne seront que des allusions ésotériques à un secret indicible, coups frappés par le prisonnier aux murs de sa prison, que nul ne peut les comprendre de ceux qui n'ont pas, eux aussi, lu et assimilé Joyce et Faulkner, qui n'en sont pas au même point que moi. Ainsi, la critique, finalement, n'est utile à personne de ceux qui pourraient la comprendre et le gros livre que je viens d'écrire n'est rien que le témoignage de mon imperfection.»
Et le grand critique de conclure, répondant par avance à tous les égolâtres de la plume et accoucheurs d’œuvres, dans un beau paradoxe (rappelant, au passage, les textes cités de Michelstaedter) qu’ils méditeront utilement : «Les limites de la littérature sont celles mêmes de la critique.»
03/03/2005 | Lien permanent
L'unique pensée de Jules Lequier, par Francis Moury

 Le nom sous lequel nous connaissons Lequier est déjà un résultat de ce que désigne le titre de cet article : la liberté. Il s’est librement et tardivement renommé Lequier. Son nom pour l’état civil était Joseph Louis Jules Léquyer. Un tel résultat – passer de Jules Léquyer à Jules Lequier – n’épuise pas sa cause mais il participe déjà à la plus célèbre formule en laquelle on a souvent résumé sa philosophie : «Faire, non pas devenir mais faire et en faisant, se faire». Formule qui n’est qu’un autre résultat du même cheminement volontaire. Volontaire ? Dans le cas de l’adoption du nom nouveau, assurément oui. Dans celui du cheminement, la contingence la plus terrible a eu son mot à dire. Lequier est un philosophe de plus à verser au contingent de ceux dont la philosophie est inexplicable, voire incompréhensible si on ne connaît pas leur biographie.La vie du penseur et ses trois défaites
Le nom sous lequel nous connaissons Lequier est déjà un résultat de ce que désigne le titre de cet article : la liberté. Il s’est librement et tardivement renommé Lequier. Son nom pour l’état civil était Joseph Louis Jules Léquyer. Un tel résultat – passer de Jules Léquyer à Jules Lequier – n’épuise pas sa cause mais il participe déjà à la plus célèbre formule en laquelle on a souvent résumé sa philosophie : «Faire, non pas devenir mais faire et en faisant, se faire». Formule qui n’est qu’un autre résultat du même cheminement volontaire. Volontaire ? Dans le cas de l’adoption du nom nouveau, assurément oui. Dans celui du cheminement, la contingence la plus terrible a eu son mot à dire. Lequier est un philosophe de plus à verser au contingent de ceux dont la philosophie est inexplicable, voire incompréhensible si on ne connaît pas leur biographie.La vie du penseur et ses trois défaites Il faut donc d’emblée savoir que rien ne prédestinait en fin de compte ce jeune homme catholique breton renommé par lui-même «Jules Lequier» à la recherche philosophique d’une première vérité. Né à Quintin (Côtes du Nord) en 1814, polytechnicien de la même promotion que Charles Renouvier (le futur fondateur du «criticisme»), sous-lieutenant (décembre 1836), stagiaire pendant deux ans à l’École d’Application d’État-Major, il ne put obtenir d’y être versé. Ses années d’études et son avenir professionnel étaient sérieusement compromis. Il s’en plaignit en 1839 au Ministre de la Guerre, s’estimant victime d’une injustice. C’est à cette occasion qu’il fait appel à son cousin François Palasne de Champeaux qui était secrétaire de Lamartine. Le poète-politique influent écouta celui qui se nommait encore «Joseph Louis Jules Léquyer» et fut convaincu de plaider à son tour sa cause : en vain. Il se mit en demi-solde puis démissionna le 06 juin 1839 : première défaite. Deuxième défaite : il se présente aux élections en 1848 dans son département – une terre acquise à Lamartine et aux lamartiniens – mais ne sera pas élu. Et son état de santé psychique donne des inquiétudes à sa famille (tant qu’elle vit mais bien sûr, elle meurt…) et à ses amis. Renouvier fut ainsi le témoin de sa crise majeure. Troisième défaite : alors qu’il est déjà franchement pauvre et isolé, il tombe amoureux d’une demoiselle Deszille à qui il propose deux fois le mariage à quelques années d’intervalle, sans succès. Le 11 février 1862, il marche vers la mer de Saint Brieuc (Plérin-sur-Mer) et y nage en direction du large jusqu’à épuisement. Comme il était, paraît-il, bon nageur rompu à nager même l’hiver, on discute pour savoir si sa mort est accidentelle ou suicidaire et cette discussion est importante quand on la rapporte à sa pensée : nous y reviendrons. C’est Renouvier qui publia en 1865 les premières pages connues et essentielles de Lequier qui n’a rien publié de son vivant mais montrait parfois ses écrits à ceux qu’il en jugeait dignes.Le point commun entre deux penseursLa biographie de Lequier comporte un point commun frappant avec celle d’Auguste Comte : tous deux auront passé quelques temps dans un asile d’aliénés dont l’activité thérapeutique couvre aussi bien, à l’époque, les troubles psychiques que les troubles neurologiques ou mentaux. Comte en sortit, comme on sait, avec la mention «non guéri» signée par son médecin Esquirol tandis que la rapidité de rétablissement de Lequier surprit agréablement ses médecins qui le jugèrent probablement guéri. Dans les deux cas, ces crises psychiques furent concomitantes avec l’inspiration philosophique, si on étudie la chronologie de leurs écrits en relation avec leurs biographies respectives. Mais Comte fonde d’abord une philosophie positiviste puis une Religion de l’Humanité qui la coiffait organiquement ou la défigurait (selon les héritiers divers) tandis que Lequier trouve sa première vérité qu’il cherchait sans pour autant fonder le moindre système dessus. Ses écrits sont ensuite un travail de questionnement non moins constant. Quelle est-elle, au fait, cette première vérité ?La pensée et les pensées sur la pensée… puis retourTout le monde l’a remarqué explicitement ou implicitement (Renouvier, Delbos, Bréhier, Wahl, Grenier, et les commentateurs postérieurs à eux) la démarche de Lequier est métaphysiquement cartésienne : c’est une méditation cartésienne en apparence qui aboutit d’ailleurs positivement à l’un des fondements du cartésianisme. Résumée en son résultat immédiat et tangible, La recherche d’une première vérité semble simple : si je ne me contente pas des préjugés et que l’inquiétude philosophique la plus pure m’amène à rechercher une première vérité, c’est que je suis libre absolument d’effectuer cette recherche. En la cherchant – alors que je jugeais insuffisants toutes les réponses et tous les socles sur lesquels m’appuyer à mesure que ma recherche progressait – je l’ai donc finalement trouvée : c’est ma liberté.Bien. Effectivement, il suffisait de faire, et en faisant, on découvrait qu’on se faisait. Du même coup on découvrait qu’on n’était pas soumis à un devenir déterminé mais renvoyé à la contingence. Car l’angoisse première née de la célèbre Feuille de charmille est une angoisse absolue qui s’élève à une métaphysique de la contingence. Comme le sera celle de l’arbre noir à demi-mort dont coule la résine lumineuse dans un de ses ultimes textes les plus franchement hallucinés et qu’il faudrait comparer avec la future nausée sartrienne éprouvée devant la racine d’un arbre. Donc faire et, en faisant non pas devenir ou demeurer un élément passif du devenir et d’une interaction aberrante mais se faire. Immédiatement, naît un second problème inévitable car toujours déjà là.Autant de libertés interactives existent que d’êtres humains : comment envisager le monde et l’idée de Dieu compte tenu de cela ? Dieu lui-même se fait-il dans le temps par sa créature ? À mesure qu’on lit ces textes d’une étrange beauté, très inconfortable en dépit de la perfection de sa syntaxe qui se souvient de la rigueur d’un Maine de Biran et qui annonce la profondeur d’un Proust, on constate que Lequier, dès le départ de sa méditation qu’il a baptisée recherche et non pas méditation, nous a fait glisser dans une dimension étrange pour l’époque qui le rattache autant à saint Augustin qu’à F. W. Schelling, autant à Kierkegaard et Nietzsche (le fragment sur l’interaction infinie des actes au sein du cosmos dans Humain trop humain) qu’à Freud («là où ça était, je dois devenir») mais en fait, lui Jules Lequier, un parfait météore, non moins chu qu’Edgar A. Poe d’un désastre obscur.Certes, théoriquement, on peut dérouler la pelote du fil rouge qui relie Lequier à ses prédécesseurs : son angoisse est d’essence augustinienne. D’Augustin à Descartes puis Maine de Biran à Lequier, la conséquence est bonne : à partir de la liberté donnée enfin à la conscience comme fait inexplicable mais assuré, contingent mais certain, il s’agit de construire une anthropologie comme philosophie religieuse qui prenne en compte la situation de l’homme dans le monde, situation tragique par essence. Pourtant ce qui est remarquable en fin de compte, c’est que Lequier ait exprimé le premier d’une manière moderne l’angoisse métaphysique, la déréliction, la peur (au sens où Hobbes disait : «la grande passion de ma vie aura été la peur») qui présidaient déjà intimement aux intuitions géniales de ses prédécesseurs et l’ait fait à ce point précis de la chronologie philosophique française. Ces intuitions donnaient naissance ailleurs qu’en France à des pensées comme celles de Schopenhauer, de Nietzsche et de Kierkegaard qui pensent déjà l’angoisse elle-même comme facteur absolument positif, concret absolu. Le problème vital de Lequier est qu’il ne domine pas ce fil rouge : il l’appréhende, davantage que comme nœud gordien, comme une circularité oppressante qu’il faudrait théoriquement rompre et qu'il est pourtant absolument impossible de rompre. Il développe un aspect nouveau en France d’une intuition métaphysique aux facettes anciennes.Le déterminisme scientiste para-comtien et post-comtien, cette dégénérescence annoncée dès l’antiquité du positivisme, ne lui pose pas de problème particulier. Son compte est réglé depuis longtemps : il est réglé et bien réglé, à sa juste place, celle de la cuisine dont le XVIIIe siècle l’a fait émerger un moment. Oui il y a des lois, commodes et fonctionnant apparemment assez régulièrement pour que l’homme puisse dominer relativement la nature matérielle, biologique un peu moins, morale, sociale, économique et religieuse pas du tout. Mais elles n’expliquent rien. Auguste Comte lui-même, aussi ex-polytechnicien pauvre, radié lui aussi des cadres, répétiteur une année ou deux puis vivant de cours particuliers et enfin du fameux «subside positiviste» ne cesse de le répéter dans ses Cours de philosophie positive qui sont l’alpha et l’oméga de la France pensante de l’époque. Les positivistes comme Littré et Renan, les positivistes spiritualistes et les critiques de la science (Ravaisson, Boutroux, Lachelier, Poincaré, Le Roy, Duhem, Bergson, Meyerson) enfonceront le clou : l’idéalisme allemand kantien et post-kantien est connu et apprécié d’eux en raison, d’abord et surtout, de cet argument que le déterminisme de la science fonctionne mais qu’il ne sera jamais fondé. En matière de fondement, il faut trouver autre chose. Lequier le sait très bien. Il sait aussi, comme un Léon Chestov ou plus tard un Heidegger, qu’on a trouvé dans l’antiquité classique et au moyen-âge des fondements bien plus intéressants. Et il sait – d’une connaissance philosophique – comme eux qu’entre l’antiquité et le moyen-âge, il s’est produit un phénomène historique inédit après lequel rien ne saurait être comme avant et qu’il n’est pas sérieux de prétendre penser sans vouloir se risquer à le penser lui aussi. Surtout quand on a été élevé en Bretagne au début du XIXe siècle : il suffit de lire les Souvenirs d’enfance et de jeunesse de Renan pour en être convaincu !La recherche lequierienne de Dieu, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, n’est pourtant nullement assurée de trouver un terme défini métaphysiquement d’une manière satisfaisante: la créature posée libre, reste le problème du créateur et Lequier envisage, contemple, tourne autour des différents problèmes classiques de la théologie sans pouvoir trancher. D’où le ton authentiquement impressionnant de ses textes : une inquiétude individuelle exacerbée, une angoisse cosmique toute pascalienne face à l’aporie de la temporalité de la liberté qui pourrait aller jusqu’à introduire une temporalité dans Dieu lui-même en considérant le problème de la succession contingente des actions humaines sous le point de vue de l’éternité. Lequier esquisse régulièrement une admirable théologie dialectique qui retrouve certes saint Augustin et Pascal mais annonce non moins régulièrement l’existentialisme catholique moderne et sa vision tragique de la condition humaine. Il y a aussi chez lui des traces annexes de pragmatisme volontariste, de néo-criticisme, mais elles sont secondaires en valeur comme en importance théorique. Lequier regarde la ligne d’horizon du XXe siècle avec des yeux venus du passé le plus lointain et le plus originaire : il a d’ailleurs fallu attendre 1952 pour que les œuvres complètes de ce «Descartes tragique», révélées fragmentairement en 1865, soient éditées. Et leur édition confirme que le fragment (même étendu aux dimensions d’un livre) est bien la dimension naturelle, anti-systématique de sa pensée.La mort du penseur ou bien le suicide du penseur ?On mesure donc seulement après avoir lu ce qui précède l’importance de la signification de son geste final : un de ses proches pense qu’il ne se suicida nullement mais nagea en espérant un miracle (qui ne vint pas) et qu’il est donc mort accidentellement. D’autres la rabaissent au suicide athée. Cette ambivalence dialectique et existentielle de sa «mort-suicide» impossible à trancher qui demeure telle une contradiction possible, un acte manqué ou bien pleinement assumé, n’est-ce pas un saisissant résumé de ce qui fut, peut-être, l’unique pensée de Jules Lequier ?NB : on a jugé inutile de fournir une bibliographie, tant de Jules Lequier lui-même que des études partielles ou totales de sa vie et de sa pensée parues en France et à l’étranger, sur papier comme sur Internet : le lecteur en trouvera sans peine, ne serait-ce que par la grâce des moteurs de recherches. Qu’il se méfie simplement de la précision parfois vraie mais parfois absolument erronée de ce qu’il y verra du premier coup d’œil et veuille bien d’abord se référer aux meilleurs historiens de la philosophie, rompus aux méthodes de cette histoire et à sa rigueur. On en a cité supra qui n’épuisent pas la liste mais fournissent d’excellents points de départ. Ajoutons simplement que notre crainte (la crainte du vaillant varan Juan Asensio, qui fut ensuite seulement la mienne exprimée-reprise sur son beau site Internet, Stalker, deux craintes traçables dans son billet préfaçant ma critique cinématographique de Miracle en Alabama) que la mémoire de Lequier ne fût perdue s’avère heureusement et tout compte fait sans objet. À défaut d’être connue ou même reconnue largement du grand public, elle persiste encore récemment dans le cercle naturel qui est le sien, celui des travaux d’histoire de la philosophie.J'ajoute que plusieurs ouvrages de Jules Lequier sont en cours de numérisation par les éditions de
Il faut donc d’emblée savoir que rien ne prédestinait en fin de compte ce jeune homme catholique breton renommé par lui-même «Jules Lequier» à la recherche philosophique d’une première vérité. Né à Quintin (Côtes du Nord) en 1814, polytechnicien de la même promotion que Charles Renouvier (le futur fondateur du «criticisme»), sous-lieutenant (décembre 1836), stagiaire pendant deux ans à l’École d’Application d’État-Major, il ne put obtenir d’y être versé. Ses années d’études et son avenir professionnel étaient sérieusement compromis. Il s’en plaignit en 1839 au Ministre de la Guerre, s’estimant victime d’une injustice. C’est à cette occasion qu’il fait appel à son cousin François Palasne de Champeaux qui était secrétaire de Lamartine. Le poète-politique influent écouta celui qui se nommait encore «Joseph Louis Jules Léquyer» et fut convaincu de plaider à son tour sa cause : en vain. Il se mit en demi-solde puis démissionna le 06 juin 1839 : première défaite. Deuxième défaite : il se présente aux élections en 1848 dans son département – une terre acquise à Lamartine et aux lamartiniens – mais ne sera pas élu. Et son état de santé psychique donne des inquiétudes à sa famille (tant qu’elle vit mais bien sûr, elle meurt…) et à ses amis. Renouvier fut ainsi le témoin de sa crise majeure. Troisième défaite : alors qu’il est déjà franchement pauvre et isolé, il tombe amoureux d’une demoiselle Deszille à qui il propose deux fois le mariage à quelques années d’intervalle, sans succès. Le 11 février 1862, il marche vers la mer de Saint Brieuc (Plérin-sur-Mer) et y nage en direction du large jusqu’à épuisement. Comme il était, paraît-il, bon nageur rompu à nager même l’hiver, on discute pour savoir si sa mort est accidentelle ou suicidaire et cette discussion est importante quand on la rapporte à sa pensée : nous y reviendrons. C’est Renouvier qui publia en 1865 les premières pages connues et essentielles de Lequier qui n’a rien publié de son vivant mais montrait parfois ses écrits à ceux qu’il en jugeait dignes.Le point commun entre deux penseursLa biographie de Lequier comporte un point commun frappant avec celle d’Auguste Comte : tous deux auront passé quelques temps dans un asile d’aliénés dont l’activité thérapeutique couvre aussi bien, à l’époque, les troubles psychiques que les troubles neurologiques ou mentaux. Comte en sortit, comme on sait, avec la mention «non guéri» signée par son médecin Esquirol tandis que la rapidité de rétablissement de Lequier surprit agréablement ses médecins qui le jugèrent probablement guéri. Dans les deux cas, ces crises psychiques furent concomitantes avec l’inspiration philosophique, si on étudie la chronologie de leurs écrits en relation avec leurs biographies respectives. Mais Comte fonde d’abord une philosophie positiviste puis une Religion de l’Humanité qui la coiffait organiquement ou la défigurait (selon les héritiers divers) tandis que Lequier trouve sa première vérité qu’il cherchait sans pour autant fonder le moindre système dessus. Ses écrits sont ensuite un travail de questionnement non moins constant. Quelle est-elle, au fait, cette première vérité ?La pensée et les pensées sur la pensée… puis retourTout le monde l’a remarqué explicitement ou implicitement (Renouvier, Delbos, Bréhier, Wahl, Grenier, et les commentateurs postérieurs à eux) la démarche de Lequier est métaphysiquement cartésienne : c’est une méditation cartésienne en apparence qui aboutit d’ailleurs positivement à l’un des fondements du cartésianisme. Résumée en son résultat immédiat et tangible, La recherche d’une première vérité semble simple : si je ne me contente pas des préjugés et que l’inquiétude philosophique la plus pure m’amène à rechercher une première vérité, c’est que je suis libre absolument d’effectuer cette recherche. En la cherchant – alors que je jugeais insuffisants toutes les réponses et tous les socles sur lesquels m’appuyer à mesure que ma recherche progressait – je l’ai donc finalement trouvée : c’est ma liberté.Bien. Effectivement, il suffisait de faire, et en faisant, on découvrait qu’on se faisait. Du même coup on découvrait qu’on n’était pas soumis à un devenir déterminé mais renvoyé à la contingence. Car l’angoisse première née de la célèbre Feuille de charmille est une angoisse absolue qui s’élève à une métaphysique de la contingence. Comme le sera celle de l’arbre noir à demi-mort dont coule la résine lumineuse dans un de ses ultimes textes les plus franchement hallucinés et qu’il faudrait comparer avec la future nausée sartrienne éprouvée devant la racine d’un arbre. Donc faire et, en faisant non pas devenir ou demeurer un élément passif du devenir et d’une interaction aberrante mais se faire. Immédiatement, naît un second problème inévitable car toujours déjà là.Autant de libertés interactives existent que d’êtres humains : comment envisager le monde et l’idée de Dieu compte tenu de cela ? Dieu lui-même se fait-il dans le temps par sa créature ? À mesure qu’on lit ces textes d’une étrange beauté, très inconfortable en dépit de la perfection de sa syntaxe qui se souvient de la rigueur d’un Maine de Biran et qui annonce la profondeur d’un Proust, on constate que Lequier, dès le départ de sa méditation qu’il a baptisée recherche et non pas méditation, nous a fait glisser dans une dimension étrange pour l’époque qui le rattache autant à saint Augustin qu’à F. W. Schelling, autant à Kierkegaard et Nietzsche (le fragment sur l’interaction infinie des actes au sein du cosmos dans Humain trop humain) qu’à Freud («là où ça était, je dois devenir») mais en fait, lui Jules Lequier, un parfait météore, non moins chu qu’Edgar A. Poe d’un désastre obscur.Certes, théoriquement, on peut dérouler la pelote du fil rouge qui relie Lequier à ses prédécesseurs : son angoisse est d’essence augustinienne. D’Augustin à Descartes puis Maine de Biran à Lequier, la conséquence est bonne : à partir de la liberté donnée enfin à la conscience comme fait inexplicable mais assuré, contingent mais certain, il s’agit de construire une anthropologie comme philosophie religieuse qui prenne en compte la situation de l’homme dans le monde, situation tragique par essence. Pourtant ce qui est remarquable en fin de compte, c’est que Lequier ait exprimé le premier d’une manière moderne l’angoisse métaphysique, la déréliction, la peur (au sens où Hobbes disait : «la grande passion de ma vie aura été la peur») qui présidaient déjà intimement aux intuitions géniales de ses prédécesseurs et l’ait fait à ce point précis de la chronologie philosophique française. Ces intuitions donnaient naissance ailleurs qu’en France à des pensées comme celles de Schopenhauer, de Nietzsche et de Kierkegaard qui pensent déjà l’angoisse elle-même comme facteur absolument positif, concret absolu. Le problème vital de Lequier est qu’il ne domine pas ce fil rouge : il l’appréhende, davantage que comme nœud gordien, comme une circularité oppressante qu’il faudrait théoriquement rompre et qu'il est pourtant absolument impossible de rompre. Il développe un aspect nouveau en France d’une intuition métaphysique aux facettes anciennes.Le déterminisme scientiste para-comtien et post-comtien, cette dégénérescence annoncée dès l’antiquité du positivisme, ne lui pose pas de problème particulier. Son compte est réglé depuis longtemps : il est réglé et bien réglé, à sa juste place, celle de la cuisine dont le XVIIIe siècle l’a fait émerger un moment. Oui il y a des lois, commodes et fonctionnant apparemment assez régulièrement pour que l’homme puisse dominer relativement la nature matérielle, biologique un peu moins, morale, sociale, économique et religieuse pas du tout. Mais elles n’expliquent rien. Auguste Comte lui-même, aussi ex-polytechnicien pauvre, radié lui aussi des cadres, répétiteur une année ou deux puis vivant de cours particuliers et enfin du fameux «subside positiviste» ne cesse de le répéter dans ses Cours de philosophie positive qui sont l’alpha et l’oméga de la France pensante de l’époque. Les positivistes comme Littré et Renan, les positivistes spiritualistes et les critiques de la science (Ravaisson, Boutroux, Lachelier, Poincaré, Le Roy, Duhem, Bergson, Meyerson) enfonceront le clou : l’idéalisme allemand kantien et post-kantien est connu et apprécié d’eux en raison, d’abord et surtout, de cet argument que le déterminisme de la science fonctionne mais qu’il ne sera jamais fondé. En matière de fondement, il faut trouver autre chose. Lequier le sait très bien. Il sait aussi, comme un Léon Chestov ou plus tard un Heidegger, qu’on a trouvé dans l’antiquité classique et au moyen-âge des fondements bien plus intéressants. Et il sait – d’une connaissance philosophique – comme eux qu’entre l’antiquité et le moyen-âge, il s’est produit un phénomène historique inédit après lequel rien ne saurait être comme avant et qu’il n’est pas sérieux de prétendre penser sans vouloir se risquer à le penser lui aussi. Surtout quand on a été élevé en Bretagne au début du XIXe siècle : il suffit de lire les Souvenirs d’enfance et de jeunesse de Renan pour en être convaincu !La recherche lequierienne de Dieu, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, n’est pourtant nullement assurée de trouver un terme défini métaphysiquement d’une manière satisfaisante: la créature posée libre, reste le problème du créateur et Lequier envisage, contemple, tourne autour des différents problèmes classiques de la théologie sans pouvoir trancher. D’où le ton authentiquement impressionnant de ses textes : une inquiétude individuelle exacerbée, une angoisse cosmique toute pascalienne face à l’aporie de la temporalité de la liberté qui pourrait aller jusqu’à introduire une temporalité dans Dieu lui-même en considérant le problème de la succession contingente des actions humaines sous le point de vue de l’éternité. Lequier esquisse régulièrement une admirable théologie dialectique qui retrouve certes saint Augustin et Pascal mais annonce non moins régulièrement l’existentialisme catholique moderne et sa vision tragique de la condition humaine. Il y a aussi chez lui des traces annexes de pragmatisme volontariste, de néo-criticisme, mais elles sont secondaires en valeur comme en importance théorique. Lequier regarde la ligne d’horizon du XXe siècle avec des yeux venus du passé le plus lointain et le plus originaire : il a d’ailleurs fallu attendre 1952 pour que les œuvres complètes de ce «Descartes tragique», révélées fragmentairement en 1865, soient éditées. Et leur édition confirme que le fragment (même étendu aux dimensions d’un livre) est bien la dimension naturelle, anti-systématique de sa pensée.La mort du penseur ou bien le suicide du penseur ?On mesure donc seulement après avoir lu ce qui précède l’importance de la signification de son geste final : un de ses proches pense qu’il ne se suicida nullement mais nagea en espérant un miracle (qui ne vint pas) et qu’il est donc mort accidentellement. D’autres la rabaissent au suicide athée. Cette ambivalence dialectique et existentielle de sa «mort-suicide» impossible à trancher qui demeure telle une contradiction possible, un acte manqué ou bien pleinement assumé, n’est-ce pas un saisissant résumé de ce qui fut, peut-être, l’unique pensée de Jules Lequier ?NB : on a jugé inutile de fournir une bibliographie, tant de Jules Lequier lui-même que des études partielles ou totales de sa vie et de sa pensée parues en France et à l’étranger, sur papier comme sur Internet : le lecteur en trouvera sans peine, ne serait-ce que par la grâce des moteurs de recherches. Qu’il se méfie simplement de la précision parfois vraie mais parfois absolument erronée de ce qu’il y verra du premier coup d’œil et veuille bien d’abord se référer aux meilleurs historiens de la philosophie, rompus aux méthodes de cette histoire et à sa rigueur. On en a cité supra qui n’épuisent pas la liste mais fournissent d’excellents points de départ. Ajoutons simplement que notre crainte (la crainte du vaillant varan Juan Asensio, qui fut ensuite seulement la mienne exprimée-reprise sur son beau site Internet, Stalker, deux craintes traçables dans son billet préfaçant ma critique cinématographique de Miracle en Alabama) que la mémoire de Lequier ne fût perdue s’avère heureusement et tout compte fait sans objet. À défaut d’être connue ou même reconnue largement du grand public, elle persiste encore récemment dans le cercle naturel qui est le sien, celui des travaux d’histoire de la philosophie.J'ajoute que plusieurs ouvrages de Jules Lequier sont en cours de numérisation par les éditions de
07/02/2010 | Lien permanent
Par-delà le crime et le châtiment de Jean Améry

 À propos de Jean Améry, Par-delà le crime et le châtiment (Actes Sud, coll. Babel, 2005).
À propos de Jean Améry, Par-delà le crime et le châtiment (Actes Sud, coll. Babel, 2005).Sous-titré Essai pour surmonter l'insurmontable, l'ouvrage de Jean Améry a été publié en 1966. Il s'agit d'un recueil composé de plusieurs textes dont le plus saisissant est sans doute celui qui s'intitule La torture et qui est donc consacré à l'expérience que subit l'auteur non seulement de l'emprisonnement dans le fort Breendonk, mais de la torture infligée par des soldats nazis à un homme qui, ne sachant rien, ne put rien leur avouer.
Expérience brève, intense, atroce, décrite avec une sobriété de moyens qui fait songer à l'écriture sèche (en apparence tout du moins) d'un Sebald, expérience cependant moins atroce que celle d'autres détenus, de l'aveu même d'Améry, expérience pourtant inoubliable, la torture étant définie, pour le moins banalement, comme «l'événement le plus effroyable qu'un homme puisse garder au fond de soi» (p. 61) et aussi comme celui qu'il est rigoureusement impossible d'évoquer à celles et ceux qui ne l'ont point enduré dans leur chair et leur esprit, tant la douleur extrême infligée à un homme par un autre homme est une expérience rétive au pouvoir du langage : «Celui qui voudrait faire comprendre à autrui ce que fut sa souffrance physique en serait réduit à la lui infliger et à se changer lui-même en tortionnaire» (p. 82), magnifique paradoxe que la littérature répétitive tout entière et passablement ennuyeuse d'un Sade a peut-être tenté d'illustrer métaphoriquement.
En fait, la torture, en tant que réalité qui «pose une revendication totale», éteint la parole, Jean Améry confiant que, pour lui, «elle s'est éteinte depuis longtemps» (p. 58) de toute façon, parce qu'elle confine l'esprit dans un cachot duquel il ne peut s'échapper et révèle son «incompétence» (p. 55). La langue elle-même n'a rien à dire sur l'expérience de la torture, tout simplement parce qu'elle ne peut rien dire, pour la raison que la réalité insurpassable de la douleur infligée par le bourreau au supplicié excède ce tout dans lequel, selon l'auteur, doit s'intégrer une langue, un tout sur lequel il faut «avoir un véritable droit possessoire» (p. 122), le torturé n'ayant bien évidemment par définition aucun pouvoir sur la torture que le bourreau pratique sur son corps.
C'est peut-être parce que la torture nous donne l'expérience directe de la douleur et que cette dernière paralyse l'esprit par la fulgurance de la mort, admise sans autre forme de procès et même appelée, comme soulagement des souffrances, que la torture peut être considérée comme une espèce de court-circuit de la pensée logique. Ainsi, aucune «route empruntée par la logique, écrit Jean Améry (1), ne peut nous conduire à la mort, mais il est permis de penser que la douleur puisse frayer jusqu'à elle une voie intuitive», la torture allant même jusqu'à abolir «la contradiction de la mort», puisqu'elle «nous fait vivre notre propre mort» (p. 83) et, bien pire, oserait-on dire, que cela, bien pire que la mort, l'expérience de notre animalité souffrante, hurlante sous la douleur incessante, contre laquelle nous ne pouvons rien faire : «Une simple petite pression de la main prolongée par son instrument suffit pour transformer l'autre – y compris sa tête qui peut abriter ou non Kant et Hegel et toutes les neuf symphonies et le monde comme volonté et comme représentation – en goret qui s'égosille sur le chemin de l'abattoir» (p. 86).
La torture, y compris même lorsque les stigmates infligés par le bourreau à son prisonnier ont cessé d'être physiquement visibles, constitue, comme le dit Améry, «l'outrage de l'anéantissement» qui est «indélébile» (p. 95), car celui «qui a été martyrisé est livré sans défense à l'angoisse» (idem.). L'homme qui a été torturé, d'un seul coup, a retiré sa confiance du monde.
Un autre point est intéressant, qui conduit Jean Améry à s'opposer à la thèse, si fameuse et critiquée par exemple par un Gershom Scholem, sur la banalité du mal telle que la posa Hannah Arendt. Pour l'auteur de Lefeu ou la démolition, la découverte du mal extrême représente une expérience limite, un apex de souffrance mais aussi de conscience qui nous confronte à la réalité la plus crue, qui par essence n'est pas la banalité de la vie quotidienne, confondue avec une «abstraction chiffrée» (p. 68). À Auschwitz, de même que les livres constituent des objets à peine concevables «pour le commun des détenus» (p. 31), la poésie n'a aucune place et moins que cela même, le souvenir de la poésie, comme tels vers d'Hölderlin, le poème étant incapable, pour Améry, de transcender la réalité atroce (cf. p. 33). Proust, en somme, ne peut absolument rien contre la déchéance.
Or, le mal détruit toute forme de représentation, celle par exemple qu'une Hannah Arendt, qui «ne connaissait l'ennemi de l'homme que par ouï-dire et ne le voyait que dans sa cage de verre» (p. 67; il s'agit, bien évidemment, d'Eichmann), a cru être la plus apte à décrire la monstruosité de l'homme des foules, et nous fait donc comprendre que «les visages insignifiants finissent quand même par devenir des visages de la Gestapo et que le mal se superpose à la banalité et en quelque sorte la surélève» (idem.).
Étrange trouée dans le monde des ténèbres, étrange forme d'appropriation d'une expérience pourtant décrite comme abominable, maladive volonté d'exhiber un martyre qu'un intellectuel, qui ne l'a pas expérimenté au plus intime de sa chair, ne peut bien évidemment pas même s'imaginer, et qui nous laisse soupçonner qu'Améry, bien qu'incroyant comme il le déclare dans son premier texte (Aux frontières de l'esprit), procède à une essentialisation du mal, comme un autre athée, qu'il cite d'ailleurs, Georges Bataille. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Jean Améry, dans la seconde préface, datant de 1977, à son ouvrage, affirme que toutes «les tentatives d'explications monocausales ont ridiculement échoué» (p. 12) à expliquer Auschwitz, un propos qu'il étend, un peu plus loin, au «mal radical» : «Étant donné que d'une part aucune lumière véritable n'est faite sur l'éruption du mal radical en Allemagne et que d'autre part ce mal [...] est en effet singulier et irréductible dans la totalité de sa logique interne et de sa rationalité maudite, l'énigme reste entière» (pp. 13-4).
Et Améry de reconnaître sans la moindre ambiguïté la supériorité, face au mal, de la conscience religieuse ou politique : «Ce que j'ai cru comprendre m'est apparu de plus en plus comme une certitude : l'homme croyant au sens le plus large du terme, que la foi qui l'anime soit métaphysique ou fondée sur une immanence, se dépasse lui-même. Il n'est pas prisonnier de son individualité, il fait partie d'un continuum spirituel que rien n'interrompt, même à Auschwitz» (p. 45).
Une image, peut-être, pourrait rendre compte de l'horreur, appartenant au registre de l'apophatisme ou, plus étonnamment, à celui de l'image inversée, si souvent employée (et commentée) par un Léon Bloy : «Nous autres [les Juifs], nous sommes habitués à ce genre de choses. On a pu voir comment le verbe s'est fait chair et comme le verbe devenu chair a finalement formé une montage de cadavres» (p. 18). George Steiner ne semble avoir répété que cette noire évidence, qui lie l'extermination des Juifs au christianisme, du moins à une espèce de christianisme devenu fou.
L'énigme posée par Jean Améry reste aussi cruelle qu'entière : comme un homme qui ne croit pas en Dieu, pourtant, selon ses propres dires, seul rempart susceptible de contenir (vaincre ? Non : contenir) la barbarie des camps d'extermination, a-t-il pu endosser le terrible fardeau de la condition de Juif rescapé des camps de la mort sans sombrer non seulement dans le ressentiment auquel il consacre de très belles pages, mais dans le désespoir dont l'issue ne peut signifier qu'une seule chose, le suicide ? Il s'agit donc, pour cet homme, de tenter de transformer son expérience de la monstruosité en une donnée socialo-historique qui pourra, espérons-le du moins, influencer la société allemande telle qu'elle se bâtit après la Seconde Guerre mondiale.
L'avant-dernier texte du recueil, intitulé Ressentiments, est peut-être le plus personnel qu'a écrit Jean Améry, dans lequel il tente d'établir le rôle historique, à l'exclusion d'un possible rôle théologique dont il ne veut pas (2), de l'homme qui n'accepte pas aussi facilement que cela, qui ne peut accepter non seulement Auschwitz, mais le discours des nouvelles générations allemandes qui prétendraient que l'on en fait trop, justement, avec Auschwitz, et qu'elles ne sauraient être éternellement tenues pour responsables de la faute, certes énorme mais, disent-ils, compréhensible, donc excusable à plus ou moins brève échéance et si l'on tient compte d'une multitude de facteurs explicatifs, commise par leurs pères et leurs grands-pères.
C'est dans ce texte que Jean Améry explique la nécessité de conserver non seulement l'unicité mais la valeur paradigmatique absolue d'Auschwitz, en rappelant quelques vérités sobres que j'aurais aimé rappeler, si j'en avais eu le temps, à Renaud Camus lors de notre passage commun sur le plateau de l'émission Ce soir où jamais, le 13 novembre 2012.
Il est intéressant de se souvenir de la réponse, pour le moins confuse, que Renaud Camus me fit (à partir de 10 minutes 06), que je résume dans son esprit : Auschwitz, un événement certes horrible, aura servi comme argument majeur aux tenants de l'antiracisme pour occulter le Grand Remplacement (ou Renversement) en cours en Europe.
Je n'ai cessé de réfléchir, depuis ce soir-là, à cette réponse camusienne, donc prétendument bathmologique qui, pour le coup, constitue une aporie dans sa manière de court-circuiter toute forme de débat. Il est ainsi fort amusant de constater que le pauvre Renaud Camus, qui selon tel échotier pornographe (3), aurait été confronté à une meute sanguinaire incarnant l'Empire du Bien l'ayant empêché de s'exprimer, a au contraire, en mélangeant la référence à Auschwitz avec le discours prétendu de l'antiracisme, opéré une réduction ad absurdum. Il n'est pas moins évident que Renaud Camus, qui commence à roder son discours politique, a été pour le moins malin, ou simplement prudent, en taisant lui-même, devant les invités du plateau mais surtout devant les caméras, ce dont il s'agit réellement : Auschwitz ne peut tout simplement plus être enseigné, parce que la présence, de plus en plus nombreuse et problématique selon l'auteur de Du sens, d'enfants d'origine maghrébine dans les écoles françaises, empêche tout simplement la référence à l'extermination de 6 millions de Juifs et, plus largement, à Israël. Ainsi Renaud Camus peut-il à bon compter trouver pesante la référence constante à Auschwitz et remercier les envahisseurs d'évacuer, par les cheminées d'une société de plus en plus menacée par l'Islam, ce si vilain décor qui de toute façon s'effrite, planté au cœur même de l'Europe : qu'on l'évacue donc, puisqu'elle ne peut plus être évoquée, l'image des tombes de fumée des exterminés !
Il est évident que je ne saurais reprendre à mon compte le ressentiment que Jean Améry déclare éprouver à l'égard de ses bourreaux et, tout autant dirait-on, pour ceux qui, innombrables, n'ont osé ou voulu défendre des Juifs traités d'une façon sous-humaine et même, sous-animale. C'est dans le long passage qui suit que l'auteur évoque l'utilité historique du ressentiment mais encore la noire évidence que constitue Auschwitz à mes yeux, et que Renaud Camus, s'il me lit, ferait bien de méditer, plutôt que de ne s'intéresser qu'au diamètre de son nombril (4), noire réalité que je lui aurais rappelée avec grand plaisir, si j'en avais eu le temps comme je l'ai dit, durant cette émission du 13 novembre 2012, qui m'a valu tant de crachats et d'accusations grotesques de trahison, comme si le fait d'avoir consacré quelques notes, plutôt positives, à certains ouvrages de Renaud Camus avait subitement dû me dépouiller de ma capacité à reconnaître, presque immédiatement, l'homme, petit et veule, sous le littérateur passable : «Aiguillonné par les coups d'éperon de notre ressentiment – et non par une volonté de conciliation souvent douteuse subjectivement et objectivement hostile à l'histoire –, le peuple allemand resterait alors sensible au fait qu'il ne peut laisser neutraliser par le temps une partie de son histoire nationale, mais qu'il faut au contraire qu'il l'intègre. Auschwitz est le passé, le présent et l'avenir de l'Allemagne : si je me souviens bien, cette affirmation est due à Hans Magnus Enzensberger, qui n'a malheureusement pas voix au chapitre puisque lui et ses pairs moraux ne sont pas le peuple. Mais si notre ressentiment brandissait l'index en silence à la face du monde, alors l'Allemagne tout entière garderait à l'esprit, pour elle et pour les générations futures, cette grande vérité : que ce ne sont pas des Allemands qui ont aboli le règne de l'infamie» (p. 167).
Et Jean Améry d'adopter la posture, ô combien intolérable et qui ne pouvait trouver son issue, peut-être, que dans la mort que se donna l'auteur, du survivant qui doit tenter d'enkyster ses ressentiments (cf. p. 172) et qui finira néanmoins, il le sait, par disparaître, même s'il implore ironiquement «la patience envers ceux dont le repos est encore perturbé par la rancune» (p. 173), lui qui jamais ne pardonnera à ses bourreaux, lui qui admet que, en tant qu'homme blessé, tout ce qu'il doit faire consiste à désinfecter et bander sa blessure, «et non pas réfléchir à la raison pour laquelle le bourreau a levé sa hache, et finir sans doute par le disculper en découvrant cette raison» (p. 194), même s'il semble redouter la «possibilité d'une nouvelle destruction massive des juifs [qui] ne peut être exclue» (p. 207), même s'il a été, est et restera à tout jamais, à cause d'Auschwitz et de personnes qui aujourd'hui, comme Renaud Camus, estiment qu'Auschwitz ne sert qu'à masquer la réalité d'un problème autrement plus important que l'extermination de 6 millions de Juifs, à savoir, disons-le clairement, sans l'ombre d'une de ces bathmologies si pratiques pour les trouillards, le remplacement des Français, voire des Européens par des Arabes et des Noirs, un homme marqué par l’infamie, même si Jean Améry est un homme qui, sans «le sentiment d'appartenance à la communauté des menacés», ne serait «plus qu'un homme qui laisse tomber les bras et qui fuit la réalité» (p. 206).
C'est du côté d'un tel homme que nous sommes, sur l'avant-bras gauche duquel est tatoué «le numéro d'Auschwitz; il se lit plus vite que le Pentateuque ou que le Talmud mais l'information qu'il livre est plus éloquente» (p. 197).
C'est, toujours, du côté des humiliés et des offensés que nous sommes, pas des petits seigneurs réfugiés dans leur tour d'ivoire, enkystés, pour le coup, dans la haine, le mépris et le ressentiment, dans la peur aussi, si mauvaise conseillère, que cette ombre bavarde qu'est Renaud Camus ne cesse de conjurer en multipliant, par exemple, la capture, seconde après seconde dirait-on, du temps qui fuit.
Ce n'est pas, ce ne sera jamais du côté de Renaud Camus que nous serons.
Notes
(1) Ce propos de l'auteur semble contredire ce qu'il a écrit dans le premier texte composant son livre : «Plus essentielle est la pensée analytique : c'est d'elle que l'on peut attendre qu'elle soit à la fois un soutien et un guide sur les chemins de l'horreur» (p. 37). Dans un autre texte intitulé Dans quelle mesure a-t-on besoin de sa terre natale ?, Améry, de nouveau, utilise cette image lorsqu'il écrit : «Il faut avoir une terre à soi pour ne pas en avoir besoin, de la même manière que la pensée doit posséder les structures de la logique formelle pour en franchir les limites et accéder aux domaines plus fertiles de l'esprit» (p. 107).
(2) «Il ne peut être question ni de vengeance d'un côté, ni de l'autre d'une expiation problématique qui n'aurait de sens que dans le contexte théologique et ne me concernerait donc absolument pas, et bien sûr il ne peut s'agir non plus d'un apurement, d'ailleurs historiquement inconcevable, par la force brutale» (p. 166). Ailleurs, Jean Améry affirme : «L'affliction métaphysique est un souci élégant, de très haut standing. Qu'elle reste l'affaire de ceux qui savent depuis toujours qui ils sont et ce qu'ils sont, pourquoi ils le sont et qu'ils peuvent le rester. Je la leur concède volontiers – et je ne m'en sens pas plus misérable devant eux» (p. 210).
(3) Il n'est pas plus étonnant qu'un xénophobe et un raciste cachant sous un pseudonyme ses idées nauséabondes comme Ygor Yanka (et le choix de ce patronyme fantaisiste est bien évidemment fort commode, lorsque l'on n'ose pas signer ses textes les plus virulents, disons les plus souchiens, de ses prénom et nom), il n'est pas étonnant qu'un tel personnage exsudant la haine, la peur déguisée en résistance guerrière, la vulgarité et le ratage à prétention hautement introspective, utilise à peu près le même pseudo-argument que le cacographe Pierre-Antoine Rey (auquel je fis cette longue réponse), lorsqu'il écrit dans telle note bavarde et solipsiste : «Je ne suis pas camusien ni camusolâtre, mais je donne raison à Camus sur le Grand Remplacement. Sur la Shoah, vous [moi-même, donc] aviez aussi raison, évidemment, sauf que votre intervention a semblé n'avoir pour but que de faire passer Camus pour l'antisémite qu'il n'est pas. Et il s'est fort clairement exprimé là-dessus ensuite».
Je ne sais si Camus est ou n'est pas antisémite, ni encore s'il est ou pas raciste. À la limite, je m'en fiche car, pour reprendre les termes de Jean Améry, l'antisémitisme est l'affaire des antisémites : «c'est leur infamie ou leur maladie. C'est aux antisémites de surmonter le problème, pas à nous» (pp. 193-4, l'auteur souligne). Ygor Yanka, aussi remarqu
29/01/2013 | Lien permanent
Littérature et critique : de l’exigence de Jean-Paul Sartre à la déchéance actuelle, 2, par Gregory Mion

 Gregory Mion dans la Zone.
Gregory Mion dans la Zone. Littérature et critique : de l’exigence de Jean-Paul Sartre à la déchéance actuelle, 1.
Littérature et critique : de l’exigence de Jean-Paul Sartre à la déchéance actuelle, 1.La folle exigence de Jean-Paul Sartre : les prescriptions idéales
Plus la maladie est coriace, plus les médicaments doivent être offensifs, et l’état de délabrement de la littérature française actuelle nous oblige à remonter dans le temps, à potasser dans quelque ordonnance de médecin sourcilleux, pour examiner justement ce que pensait l’un de ses meilleurs représentants. Il est inutile de revenir sur les défauts de Sartre, sur le caractère ténébreux de certains de ses engagements que l’on a tant de fois ressassés, ne serait-ce déjà que parce que les différents reproches qu’on pourrait lui adresser sont compensés par quantité de travaux remarquables et audacieux à plus d’un titre, à commencer bien sûr par ses écrits sur la littérature. Au regard de ce que nous avons aujourd’hui en termes de critique et de théorie littéraires, on ne peut que regretter Sartre, lui qui voulut aussi bien conquérir l’Himalaya de Flaubert (cf. L’Idiot de la famille) que prescrire un programme aux auteurs de sa génération (cf. Qu’est-ce que la littérature ?), sans parler des volumes de Situations qui regorgent d’analyses et d’intuitions avisées sur la question. À vrai dire, il n’est que de comparer ce travail de mastodonte avec celui d’un Arnaud Viviant pour s’éviter des commentaires déplacés sur Sartre. En publiant La vie critique (1), Viviant a au moins eu cette utilité de se discréditer d’emblée tant le contenu de son livre traite de tout sauf de critique littéraire digne de ce nom. Que Viviant cependant ne s’offusque point d’être ainsi placé sur la même balance que Sartre et de constater que son plateau penche dangereusement du côté de la légèreté, il n’est pas isolé, loin de là, puisque tous ses camarades de la presse littéraire rémunérée sont éligibles sur ce plateau de frivolité – et à eux tous ils ne feraient pas le moindre contrepoids par rapport à Sartre.
À la limite, le problème qui se pose est celui-ci : comment ces gens-là peuvent encore prétendre écrire ou s’exprimer sur la littérature alors même qu’ils incarnent la plus parfaite misère intellectuelle sur le sujet ? Car on n’attend pas d’un critique qu’il nous fasse une vulgaire récapitulation des sous-intrigues d’une Christine Angot ou des bourrasques individualistes d’un Yann Moix; à la place de ces éléments négligeables, on attendrait plutôt du critique qu’il produise une étude sérieuse sur les auteurs qui prennent la littérature au sérieux, qu’il nous fasse par exemple entrer dans les tourments épistolaires d’un Vincent La Soudière ou qu’il aille fouiller du côté des malades mentaux du roman tels que Roberto Bolaño, Thomas Mann, Hermann Broch, William Gass et tant d’autres. Pour relever un tant soit peu le niveau du lectorat, il convient, surtout quand on en a la charge, de lui soumettre des références esthétiquement inépuisables. Les écrivains médiocres n’ont en outre pas besoin qu’on disserte sur leurs basses œuvres – ils ont déjà tous les médiocres virtuels qui le font eu égard aux stratagèmes que nous avons discutés tantôt. Ce n’est donc pas à nous qu’il devrait revenir au premier chef de perpétuer la mémoire des auteurs consistants, mais bel et bien à la critique littéraire de profession, celle qui jouit de plusieurs colonnes dans des quotidiens, des hebdomadaires ou des mensuels qui sont beaucoup plus consultés que Stalker, ceci en dépit du fait qu’ils soient payants. Pourquoi cela n’est-il du reste guère envisageable ? Parce que nous sommes prisonniers d’une littérature du marché et que pour vendre une camelote journalistique, il faut d’une part des analphabètes journaleux qui partagent la même langue que leurs lecteurs, et d’autre part ne peuvent convenir à ces analphabètes dilettantes que des livres écrits par des analphabètes, des livres qui se lisent au bord de la piscine ou au comptoir d’un bistrot chic. Il semble ainsi qu’un très bizarre poujadisme se soit emparé des milieux littéraires français – il y règne un corporatisme licencieux qui ne persévère qu’à la seule fin de se transmettre des moyens de subsistance relativement avantageux, le tout en sombrant dans une fainéantise qui a de moins en moins honte de s’exhiber au grand jour. Triste époque en effet que celle des mondains littéraires qui font des compétitions de vacances et de bien-être sur les réseaux sociaux, lors même qu’ils devraient être en train de se tuer à la lecture, de se consumer dans les annotations et l’appétit de servir le génie, au lieu que de se servir des ressources de la médiocrité pour parachever la leur. Il fut cependant un temps pas si lointain où la critique littéraire était menée par des gens comme Proust et Barbey d’Aurevilly.
Par contraste avec ce tragique diagnostic, les mots de Sartre sur ce que devrait faire un critique littéraire nous paraissent sinon complètement anachroniques, du moins follement exigeants (2). Selon lui, toute critique ne devrait être qu’un dialogue permanent entre Montaigne et Pascal (argument intéressant), mais lesquels de nos journalistes du moment ont réellement une connaissance suffisante de ces auteurs ? On pourrait presque parier qu’ils ne les ont jamais lus in extenso, voire qu’ils ne les ont pas lus tout court. En affirmant une telle exigence, Sartre suppose à bon droit que tous les romans détiennent quelque chose qui nous ramène inexorablement à Montaigne et Pascal, sans doute à la mort et à l’espérance, parce que n’importe quel roman approfondi n’échappe pas aux thèmes mêlés de la finitude et de la confiance en une région ou une entité transcendante. Chaque grand roman est attiré par le cimetière sur lequel il a pris son élan et par une présence difficilement restituable auprès de laquelle il aimerait terminer sa course. Toute littérature qui n’a pas le souci de la terre qui ensevelit les morts et du ciel qui accueille les âmes n’est qu’une plaisanterie de mauvais goût. Malheureusement, nous n’avons pas les hommes de carrure pour nous positionner au niveau d’une pareille critique, tout comme nous avons de moins en moins les écrivains pour l’irriguer (3). À présent l’exigence n’est plus de contenu, elle est de forme; l’injonction du temps raccourci et perverti a pris le dessus sur le temps long d’un livre largement cogité. Autrement dit, l’écrivain actuel qui profite d’un succès n’est qu’un dandy susceptible de faire une télévision et de renseigner le client potentiel en quelques minables secondes, entrecoupées de minables réflexions émises par des chroniqueurs prostitués. On ne le rappellera jamais assez non plus, mais l’image extérieure est consubstantielle au concept de télévision; pour vendre et pour être vu, il est préférable d’être beau, ou alors il faut que la laideur se conceptualise commercialement, qu’elle devienne une façon commode de tracer un parallèle entre une face esquintée et une littérature désenchantée qui ferait le bilan fidèle de notre début de siècle à bout de forces. N’a-t-on d’ailleurs pas l’impression que c’est exactement ce qui justifie les invitations de Michel Houellebecq à droite et à gauche, au prime time du journal télévisé comme dans les feuilles insignifiantes des Inrocks ? En prenant peu à peu le visage de ses livres, Houellebecq correspond exactement aux expectatives des patrons médiatiques, et lui-même soigne peut-être ses apparences publiques de sorte à ce qu’elles soient conformes aux attentes. Dans cette perspective, il est vraiment possible de postuler une physiognomonie des romanciers qui fonctionnent : ils ont fréquemment le faciès de leurs ouvrages, si bien qu’une courtisane ne trompe presque plus personne, car dès que nous voyons sa bouche s’activer en paroles miteuses, on devine instantanément ce que cette bouche a dû contenir pour que le livre soit en si favorable publicité.
Parallèlement aux impératifs que Sartre revendique pour la critique littéraire, il demande aux romanciers de prendre leur rôle au plus extrême sérieux, ce qui, de nouveau, tranche avec les procédés de vulgarité qui sévissent aujourd’hui (souvenons-nous à cet égard de la publicité de la firme Citroën, où Joël Dicker apparaît en auteur inspiré par la voiture et son standing inhérent). Pour Sartre, l’écrivain n’est pas un préposé à la contemplation ou à toute autre manifestation de la rêverie concertée. L’écrivain est un travailleur acharné des mots, et il doit avoir conscience que chacune de ses phrases contient toujours une action en puissance – l’écriture est ici pleinement performative dans la mesure où raconter une histoire, c’est bousculer un lecteur en faisant advenir une émotion que sa vie aura jusqu’alors plus ou moins camouflée. Écrire, ce n’est donc pas contempler, c’est communiquer, sachant que tout ce qui est nommé par le romancier perd aussitôt son innocence d’objet déterminé par une vision essentialiste et prophylactique du monde. On est ici en présence d’une image turbulente du romancier, figure d’effervescence et principe de témérité, chargé de défaire les nœuds coulants de toutes les cordes auxquelles sont suspendues les têtes qui ont oublié que les actes et les fortes volontés doivent précéder les définitions paralysantes qui n’ont que trop duré. En écrivant, le romancier redéfinit les choses en les dénudant de tout leur appareil normatif; il les sort de leur isolement, de leur muséification sociale, et il nous les présente crûment à dessein de nous en faire prendre l’entière responsabilité. Compris sous les auspices de cette fonction éminemment active, voire inchoative, le roman en deviendrait presque désagréable tant il sape nos certitudes et notre tranquillité. Cette injonction qui consiste à nous présenter le monde non plus comme un espace de promenade, mais comme un territoire supposément à notre charge, disqualifie d’office toute littérature à la solde d’un establishment ou d’un registre consolateur. L’espèce de tendance feel-good-story qui ne laisse de polluer les rayonnages des librairies et de satisfaire les gobe-mouches doit en ce sens être mise hors d’état de nuire. Que Katherine Pancol se taise à jamais, et qu’elle emporte avec elle ses répliques comme Agnès Martin-Lugand, Romain Puértolas et autres Laurent Gounelle, fournisseurs industriels de navets trafiqués, piteusement appréciés par cette presse dégueulasse qui voudra se justifier en disant que ces auteurs permettent aux plus jeunes et aux plus démunis culturellement de se familiariser avec la lecture. Soyons deux minutes honnêtes et avouons que pas un adolescent n’aura gagné son temps en lisant de telles platitudes; peut-être même qu’il se sera endommagé les facultés cérébrales. Tout cela n’est bon qu’à séduire une lolita adepte de la no-brain-zone ou à boucler une fin de mois pour un journaliste littéraire tire-au-flanc (pléonasme).
Ce que Sartre veut absolument, c’est que le romancier soit engagé, que sa parole soit d’emblée recouverte des chairs puissantes de l’action, que toute conscience de la parole soit en même temps conscience de ce qu’elle peut susciter. Pour renforcer son point de vue, Sartre rappelle une belle citation de Brice Parain, qui dit que les mots sont des «pistolets chargés». D’une certaine manière, l’écrivain est un individu qui met le monde en joue et ses balles ne sont pas à blanc. Qu’il dégaine en rafales ou qu’il conserve son arme dans son étui de revolver, l’écrivain est lucide quant aux possibilités qui lui sont données par la littérature. Le silence de l’écrivain peut ainsi avoir des répercussions plus efficaces que son écriture proprement dite. Dire ou se taire, c’est au fond continuer de parler dans les deux cas, et le vieux rusé Karmazinov, dans Les Démons de Dostoïevski, le sait pertinemment, lui qui choisit de faire ses adieux publics à la littérature lors d’une fête politiquement connotée. Par comparaison, on peut estimer que la récente retraite littéraire de Philip Roth fut un moyen pour lui de poursuivre son œuvre, comme si les lecteurs, en étant désormais tentés de le relire, se mettaient dans la position de se refaire tirer dessus en connaissant le respectable calibre des armes employées, à ceci près que les zones touchées par les munitions de Roth ont cette fois de bonnes chances d’être différentes, toute relecture impliquant une reformulation des affects et des idées mobilisés en première instance. Par ailleurs, silencieux depuis longtemps, économe de lui-même et fou de littérature, le romancier Thomas Pynchon, au regard des instructions sartriennes, nous apparaît bien plus engagé que n’importe quel quidam venant parader à la télévision ou sur tel réseau social, les deux attitudes étant généralement complémentaires. Les zélateurs de Busnel l’Affairiste et des réseaux en tout genre ne sont pas engagés au sens de Sartre, ils ne sont engagés que pour eux-mêmes, envers eux-mêmes, dans un inquiétant mouvement centripète qui risque à tout moment de les faire exploser en plein vol.
L’engagement authentique de l’écrivain se vérifie dans une œuvre qui est «pure exigence d’exister». Appelé par son œuvre, saisi par le sentiment de mener une mission, l’écrivain engagé, dès les premiers mots, ne peut et ne doit viser que la liberté, seul sujet qui soit pour Jean-Paul Sartre. Entendons d’abord par là que l’écriture ne se fait pas pour des esclaves, elle est au contraire un agent d’émancipation, un dispositif de délivrance qui sécrète un néant pour éconduire tout ce qui nous incite à être au lieu d’exister. La littérature engagée est donc ce par quoi le lecteur anéantit les conditions éventuelles de sa rigidité existentielle, de la même façon qu’elle est ce par quoi l’ordre établi ne peut subsister indéfiniment. Elle est aussi une transmission de la générosité de l’auteur, générosité que le lecteur reprend à son compte et qui lui permet ensuite de ressaisir un monde dévoilé, débarrassé de ses harnais et de ses uniformes, un monde qui devient par conséquent notre affaire personnelle, notre tâche la plus chère. Finalement, c’est le lecteur qui achève l’œuvre; c’est lui qui reçoit le message de l’écrivain et qui le fait exister totalement dans ses actes. Sartre précise d’ailleurs que le romancier se livre sans forcément en avoir l’air, parce que le message est contenu dans un style qui sait passer inaperçu, et surtout parce que la pure littérature est «une subjectivité qui se livre sous les espèces de l’objectif». Le livre est là, il est dans mes mains et j’en perçois la charge objective, toutefois il est «pure présentation» en ce qu’il ne fait pas apparaître le message sur de grands chevaux dociles qu’il suffirait de monter et de faire courir un peu partout. C’est à moi, lecteur, de savoir dignement recevoir le «don» de l’auteur et d’éprouver la liberté qui s’en déduit, de m’en saisir et de la porter à son plus haut degré d’accomplissement, sans me dire que ce sera du tout cuit. Sartre fait de cette reconnaissance de la liberté transmise par la littérature le motif unique de la joie esthétique. Par extension, dès qu’il est engagé, l’art est une «cérémonie du don» : il nous fait voir, séance tenante, un monde dépouillé de ses excédents et de ses lourdeurs. Ce que l’art en général nous donne et ce que la littérature en particulier nous découvre, c’est un monde libre et agissant, par opposition à un monde captif et agi, empêtré dans les fers de l’Histoire officielle. Mais ce n’est bien sûr que la fiction qui nous présente cette configuration de l’univers, aussi est-il tout à fait nécessaire que les lecteurs fassent objectivement advenir les promesses romanesques de cette liberté (4). L’écriture se transforme ici en une main solidement tendue pour le lecteur : elle pactise généreusement avec un lectorat sensible et elle le crédite simultanément d’une prodigieuse capacité d’indépendance.
Ce plaidoyer pour la liberté pourrait sembler ordinaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, date à laquelle Sartre publie ses réflexions sur la littérature, cependant chacun est à même de comprendre que la liberté visée par le philosophe ne concerne pas spécifiquement une liberté politique où le peuple est souverain et existe en fonction de lois qui personnifient la volonté générale; la liberté dont il est ici question implique davantage d’énergie parce qu’elle énonce un pouvoir de choisir et de se choisir, un pouvoir de nier la détermination historico-naturelle et de proclamer une forme d’auto-détermination fictionnelle par le choix des grands livres, par l’acte de préférer une littérature grandiose qui m’indique comment enrichir ma perception du monde et comment enrichir par ce même biais la vie de ceux que je côtoie. En octroyant à la littérature un pouvoir plus fort que celui de la nature et de l’Histoire, Sartre entreprend de penser un monde entièrement neuf, un monde dans lequel nous aimerions véritablement comme des Del Dongo ou des Solal, c’est-à-dire à la folie pure, sans marguerite à effeuiller ou sans ce je-ne-sais-quoi qui dépose l’amour dans un carcan affreux, un monde aussi dans lequel la guerre deviendrait une catastrophe réelle, parce que nul roman qui prend la liberté pour sujet ne pourrait dépeindre une guerre qui ne serait qu’un alibi d’écriture, une sorte d’exercice de style fantaisiste qui se divertirait en testant son champ lexical de l’horreur dans le seul but de créer de l’horreur pour l’horreur. À cet égard, que de mauvais romans feignent d’être utiles alors même qu’ils ont choisi un thème pratique pour s’épancher et avoir quelque chose de superficiel à dire, sans quoi ils eussent manqué d’imagination ! Ainsi voit-on Astrid Manfredi écrire La petite barbare, indigeste mignardise qui croit nous exposer une vision profonde de la barbarie; ainsi




























































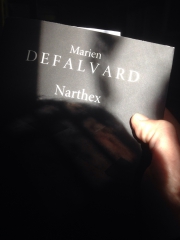 Je n’ai jamais su comment aborder un recueil de poèmes. Je ne sais pas l’attraper, quoi en faire, tourner les pages, pourquoi, jusqu’où. J’ignore s’il faut lire ou non le sommaire. Et la lumière, dites moi : quelle lumière faut-il ? L’ampoule ou la bougie, la braise, le radiateur ? Faut-il avoir froid ? Je sais lire un poème, naturellement, et si la modestie n’était pas de mise je me vanterais d’être un des meilleurs lecteurs de poème de ma région; mais je ne sais pas en lire plusieurs attachés ensemble, et si je ne sais pas faire cela c’est précisément parce que j’excelle en ceci. On ne peut pas avoir entre les mains plusieurs fois l’infini. Une seule ode de Claudel me suffit pour les cinq. Il y a dix millions d’odes de toute façon dans chacune et j’ai vécu grâce à elles environ cinq milliard d’années. La chair est triste, hélas ? Tant pis ! Lorsque je lis Le bateau ivre, tout se tait en moi. «Les cordes profondes», les appelait Novalis, s’unissent en silence, c’est à-dire que l’unité dans mon for intérieur a soudain lieu sans confusion. Et c’est cela la poésie, oui c’est exactement cela : du silence, autrement dit l’art «sous tout ce qui se dit, de tout ce qui se tait» (cet alexandrin, faut-il le préciser, vient de Péguy). Parfois, je n’arrive même pas à aller au bout du poème, le transport est trop grand, et je suis épuisé, détruit, défait. La chanson du Mal aimé, par exemple, dont il a fallu m’évacuer comme d’un champ de bataille. Bref, les recueils ne sont pas pour moi. Explosifs, trop dangereux. Editeurs, il me faudrait un livre de deux cent pages pour chaque sonnet de Shakespeare : le sonnet sur une page, mettons la dixième, un verso évidemment, et le reste pour éponger le sang, moucher la bête, sécher sur le tison les larmes et la semence. Si j’étais ministre de l’intérieur, je proposerais sans attendre que les pages blanches soient financées par le contribuable comme ces thérapies dont l’Etat gratifie les otages une fois libérés. N’est ce pas cela dont il s’agit : un enlèvement ? Hélas, j’ai bien peur que le recueil broché continue à être privilégié parce qu’il est plus intéressant du point de vue commercial. On rationnalise, sans doute parce qu’on n’a pas tout à fait oublié le déluge.
Je n’ai jamais su comment aborder un recueil de poèmes. Je ne sais pas l’attraper, quoi en faire, tourner les pages, pourquoi, jusqu’où. J’ignore s’il faut lire ou non le sommaire. Et la lumière, dites moi : quelle lumière faut-il ? L’ampoule ou la bougie, la braise, le radiateur ? Faut-il avoir froid ? Je sais lire un poème, naturellement, et si la modestie n’était pas de mise je me vanterais d’être un des meilleurs lecteurs de poème de ma région; mais je ne sais pas en lire plusieurs attachés ensemble, et si je ne sais pas faire cela c’est précisément parce que j’excelle en ceci. On ne peut pas avoir entre les mains plusieurs fois l’infini. Une seule ode de Claudel me suffit pour les cinq. Il y a dix millions d’odes de toute façon dans chacune et j’ai vécu grâce à elles environ cinq milliard d’années. La chair est triste, hélas ? Tant pis ! Lorsque je lis Le bateau ivre, tout se tait en moi. «Les cordes profondes», les appelait Novalis, s’unissent en silence, c’est à-dire que l’unité dans mon for intérieur a soudain lieu sans confusion. Et c’est cela la poésie, oui c’est exactement cela : du silence, autrement dit l’art «sous tout ce qui se dit, de tout ce qui se tait» (cet alexandrin, faut-il le préciser, vient de Péguy). Parfois, je n’arrive même pas à aller au bout du poème, le transport est trop grand, et je suis épuisé, détruit, défait. La chanson du Mal aimé, par exemple, dont il a fallu m’évacuer comme d’un champ de bataille. Bref, les recueils ne sont pas pour moi. Explosifs, trop dangereux. Editeurs, il me faudrait un livre de deux cent pages pour chaque sonnet de Shakespeare : le sonnet sur une page, mettons la dixième, un verso évidemment, et le reste pour éponger le sang, moucher la bête, sécher sur le tison les larmes et la semence. Si j’étais ministre de l’intérieur, je proposerais sans attendre que les pages blanches soient financées par le contribuable comme ces thérapies dont l’Etat gratifie les otages une fois libérés. N’est ce pas cela dont il s’agit : un enlèvement ? Hélas, j’ai bien peur que le recueil broché continue à être privilégié parce qu’il est plus intéressant du point de vue commercial. On rationnalise, sans doute parce qu’on n’a pas tout à fait oublié le déluge. 





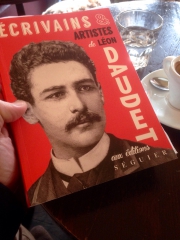 Acheter
Acheter 

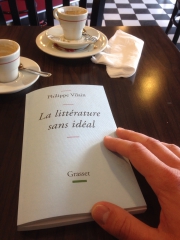 Acheter
Acheter 