Rechercher : francis moury george romero
Requiem pro Europa ?, par Francis Moury

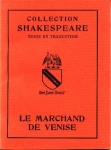 «PORTIA : Eh bien donc, l’échéanceDu billet est passée ; et par ce dit billetLe juif peut exiger, d’accord avec la loi,Une livre de chair qui doit être coupéePar lui tout près du cœur du marchand. Sois clément, Prends trois fois ton argent, et dis-moi de détruireCe billet.SHYLOCK : Pas avant qu’il soit payé selon sa teneur.»William Shakespeare, Le Marchand de Venise (1600), Acte IV, scène I, v. 230-235 trad. de Mme B. Lebrun-Sudry, Les Belles-Lettres, coll Shakespeare texte et traduction, 1931).
«PORTIA : Eh bien donc, l’échéanceDu billet est passée ; et par ce dit billetLe juif peut exiger, d’accord avec la loi,Une livre de chair qui doit être coupéePar lui tout près du cœur du marchand. Sois clément, Prends trois fois ton argent, et dis-moi de détruireCe billet.SHYLOCK : Pas avant qu’il soit payé selon sa teneur.»William Shakespeare, Le Marchand de Venise (1600), Acte IV, scène I, v. 230-235 trad. de Mme B. Lebrun-Sudry, Les Belles-Lettres, coll Shakespeare texte et traduction, 1931). «La vérité est le fondement et la raison de la perfection et de la beauté. Une chose, de quelque nature que ce soit, ne saurait être belle et parfaite, si elle n’est véritablement tout ce qu’elle doit être, et si elle n’a pas tout ce qu’elle doit avoir.Il y a de belles choses qui ont plus d’éclat quand elles demeurent imparfaites que quand elles sont achevées.»François VI, duc de la Rochefoucauld, prince de Marcillac, Pensées n°85 & 86 in Maximes et réflexions diverses (1678) (éd. de Mme Vigneron, Librairie Hatier, coll. Les classiques pour tous, 1938).
«La vérité est le fondement et la raison de la perfection et de la beauté. Une chose, de quelque nature que ce soit, ne saurait être belle et parfaite, si elle n’est véritablement tout ce qu’elle doit être, et si elle n’a pas tout ce qu’elle doit avoir.Il y a de belles choses qui ont plus d’éclat quand elles demeurent imparfaites que quand elles sont achevées.»François VI, duc de la Rochefoucauld, prince de Marcillac, Pensées n°85 & 86 in Maximes et réflexions diverses (1678) (éd. de Mme Vigneron, Librairie Hatier, coll. Les classiques pour tous, 1938). «Une des conséquences de ce que nous venons de dire, c’est qu’il est très important à un très grand prince de bien choisir le siège de son empire. Celui qui le placera au midi risque de perdre le nord ; et celui qui le placera au nord conservera aisément le midi. Je ne parle pas des cas particuliers : la mécanique a bien ses frottements qui souvent changent ou arrêtent les effets de la théorie : la politique a aussi les siens.»Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, De l’esprit des lois (1748), XVII, 8 (éd. de R. Derathé, tome I, éd. Garnier Frères, coll. Classiques Garnier, 1973).
«Une des conséquences de ce que nous venons de dire, c’est qu’il est très important à un très grand prince de bien choisir le siège de son empire. Celui qui le placera au midi risque de perdre le nord ; et celui qui le placera au nord conservera aisément le midi. Je ne parle pas des cas particuliers : la mécanique a bien ses frottements qui souvent changent ou arrêtent les effets de la théorie : la politique a aussi les siens.»Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, De l’esprit des lois (1748), XVII, 8 (éd. de R. Derathé, tome I, éd. Garnier Frères, coll. Classiques Garnier, 1973). «L’affirmation de Strabon que, chez une tribu arabe, on donne 10 livres d’or pour une livre de fer et 2 livres d’or pour 1 livre d’argent ne paraît pas du tout incroyable […].»Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique (1859), trad. J. Molitor (éd. Alfred Costes, 1954).
«L’affirmation de Strabon que, chez une tribu arabe, on donne 10 livres d’or pour une livre de fer et 2 livres d’or pour 1 livre d’argent ne paraît pas du tout incroyable […].»Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique (1859), trad. J. Molitor (éd. Alfred Costes, 1954).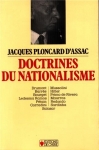 «L’âme française est toute différente de celle des personnages de salon […]. Le Français est très sérieux, très loyal, très délicat dans les questions de sentiment ; c’est le pays où les ouvrières se suicident le plus pour ne pas survivre à un abandon, le pays des affections profondes et des fidélités durables. C’est le seul pays où l’on ait vu, sous tous les régimes, des hommes dans la force de l’âge renoncer aux emplois publiques pour demeurer fidèles à un vague principe, à un sentiment plutôt. Sous la Restauration, de vieux soldats attendaient encore le retour de Napoléon, alors qu’il était mort depuis longtemps. Ils n’en avaient rien reçu pour la plupart et beaucoup l’avaient à peine entrevu cinq ou six fois dans leur vie, quand un jour de bataille, il galopait devant le front de ses troupes, à la tête de son état-major. Sous Louis-Philippe, beaucoup de gentilshommes qui n’avaient jamais mis les pieds à la Cour brisèrent leur épée plutôt que de servir l’usurpateur. Pendant dix-huit ans, des Républicains, comme j’en rencontrais parfois chez mon père, restèrent immuables dans leur haine contre «Monsieur Bonaparte», comme disait Victor Hugo […].»«Les Français sont effrayés de la puissance formidable de l’argent, et ils se rendent exactement compte de l’étendue de cette puissance. Ils voient qu’elle ne constitue pas seulement le fait d’hommes isolés, mais un système, un régime tout entier, qui, comme tous les régimes, ne peut maintenir l’appareil nécessaire à son fonctionnement que s’il met la main sur tous les ressorts sociaux.C’est sous une forme nouvelle, ce qui s’est fait au Moyen Age. Parcourez les pays où le régime féodal s’est fait place, vous verrez partout des donjons, des châteaux, des lois qui soumettaient au suzerain le vassal. Partout et sans cesse, l’homme se heurtait à une force toujours organisée. C’était la force du fer. Aujourd’hui, c’est la force de l’argent […].»Édouard Drumont (1844-1917), fragments cités par Jacques Ploncard d’Assac, Doctrines du nationalisme, § I Édouard Drumont ou la fin d’un monde (troisième éd. revue par l’auteur, Chiré en Montreuil, éd. de Chiré, 1978).«Je comprends les doutes et les hésitations. Nous vivons un moment critique de l’histoire du monde. Tout est en crise ou sujet à critique : la morale, la religion, la liberté des hommes, l’organisation sociale, l’étendue de l’intervention de l’État, les régimes économiques, la Nation elle-même et les avantages de son indépendance ou de son intégration avec d’autres pour la formation de grands espaces économiques et politiques. On discute en Europe la notion même de patrie […]. Les esprits les plus purs s’inquiètent, se troublent, ne savent pas comment s’orienter, et répètent avec angoisse la question de Pilate au Christ : «Où est la vérité ?».Antonio de Oliveira Salazar (prononcé le 28 mai 1966), cité par Jacques Ploncard d’Assac, op. cit. supra, § XV Antonio de Oliveira Salazar ou un homme libre.
«L’âme française est toute différente de celle des personnages de salon […]. Le Français est très sérieux, très loyal, très délicat dans les questions de sentiment ; c’est le pays où les ouvrières se suicident le plus pour ne pas survivre à un abandon, le pays des affections profondes et des fidélités durables. C’est le seul pays où l’on ait vu, sous tous les régimes, des hommes dans la force de l’âge renoncer aux emplois publiques pour demeurer fidèles à un vague principe, à un sentiment plutôt. Sous la Restauration, de vieux soldats attendaient encore le retour de Napoléon, alors qu’il était mort depuis longtemps. Ils n’en avaient rien reçu pour la plupart et beaucoup l’avaient à peine entrevu cinq ou six fois dans leur vie, quand un jour de bataille, il galopait devant le front de ses troupes, à la tête de son état-major. Sous Louis-Philippe, beaucoup de gentilshommes qui n’avaient jamais mis les pieds à la Cour brisèrent leur épée plutôt que de servir l’usurpateur. Pendant dix-huit ans, des Républicains, comme j’en rencontrais parfois chez mon père, restèrent immuables dans leur haine contre «Monsieur Bonaparte», comme disait Victor Hugo […].»«Les Français sont effrayés de la puissance formidable de l’argent, et ils se rendent exactement compte de l’étendue de cette puissance. Ils voient qu’elle ne constitue pas seulement le fait d’hommes isolés, mais un système, un régime tout entier, qui, comme tous les régimes, ne peut maintenir l’appareil nécessaire à son fonctionnement que s’il met la main sur tous les ressorts sociaux.C’est sous une forme nouvelle, ce qui s’est fait au Moyen Age. Parcourez les pays où le régime féodal s’est fait place, vous verrez partout des donjons, des châteaux, des lois qui soumettaient au suzerain le vassal. Partout et sans cesse, l’homme se heurtait à une force toujours organisée. C’était la force du fer. Aujourd’hui, c’est la force de l’argent […].»Édouard Drumont (1844-1917), fragments cités par Jacques Ploncard d’Assac, Doctrines du nationalisme, § I Édouard Drumont ou la fin d’un monde (troisième éd. revue par l’auteur, Chiré en Montreuil, éd. de Chiré, 1978).«Je comprends les doutes et les hésitations. Nous vivons un moment critique de l’histoire du monde. Tout est en crise ou sujet à critique : la morale, la religion, la liberté des hommes, l’organisation sociale, l’étendue de l’intervention de l’État, les régimes économiques, la Nation elle-même et les avantages de son indépendance ou de son intégration avec d’autres pour la formation de grands espaces économiques et politiques. On discute en Europe la notion même de patrie […]. Les esprits les plus purs s’inquiètent, se troublent, ne savent pas comment s’orienter, et répètent avec angoisse la question de Pilate au Christ : «Où est la vérité ?».Antonio de Oliveira Salazar (prononcé le 28 mai 1966), cité par Jacques Ploncard d’Assac, op. cit. supra, § XV Antonio de Oliveira Salazar ou un homme libre. «J’ai déclaré la guerre aux Partis. Je me garde bien de déclarer la guerre aux chefs des Partis. Les Partis sont irrécupérables. Mais les chefs de Partis ne demandent qu’à être récupérés… il leur suffit de récupérer un portefeuille.»Général Charles de Gaulle, cité par Jean Mathiex et Gérard Vincent, Aujourd’hui (depuis 1945), Tome 1 §6 La vie politique française sous la IVe République (éd. Masson, 1981).Il est naturel que j’intervienne après le résultat négatif du référendum français sur le traité établissant une nouvelle constitution européenne car je l’avais défendu par trois fois.Pierre dont j’ai lu l’intéressant premier billet (et dont je salue l’excellente exégèse en forme de dialogue à propos du film de Gibson) a perdu la partie contre Juan, j’en conviens depuis que j’ai lu ses réponses. Mais pas pour les raisons qui plaisent à notre ami Serge. Pour d’autres, me semble-t-il, que je veux inspecter. Et d’abord pour son incompréhension à l’égard de Drumont et de Maurras qu’il met en parallèle avec Marx. Tous trois méprisaient l’argent : ils ne sont donc pas haïssables, cher Pierre, mais admirables pour cette raison. Je conviens cependant que le parallèle ne peut être mené plus loin mais il faut le mener au moins à ce point précis où vous n’êtes justement pas arrivé dans votre premier billet. Et si aucun de nos hommes politiques actuel n’est capable de mépriser suffisamment l’argent, l’obscure puissance de la haute-finance, il convient de souhaiter un sauveur, un homme providentiel : Juan a raison. Qu’il s’agisse d’un sauveur terrestre suffira car pour la cité céleste, nous savons que nous avons déjà un sauveur et il nous suffit bien. Mais pour la cité terrestre, il faut décidément s’en préoccuper sérieusement. Enfin ici il s’agit de la cité européenne où la France a repris par la négative une place qu’elle pouvait obtenir plus simplement par la positive. Eh bien puisque le destin et l’histoire font ainsi entrer la dialectique augustinienne et hégélienne de concert, en sourdine, derrière les débats menés par les arriérés-mentaux (et mentales) habituels (elles), c’est la volonté divine. Donc oui, philosophiquement, à défaut de politiquement, on peut parler de divine surprise. La France est devenue le pays qui toujours nie. Elle s’est appropriée Faust depuis quelques années : elle se germanise alors que les Allemands peinent à se réunifier et se francisent. Savoureux…J’imaginai un résultat misérable : 50,02% ou 49,9% contre l’autre pourcentage restant, par exemple. Mais non : c’est un peu mieux. On est sorti du même et du même : en effet le peuple s’est réapproprié la volonté politique. Les extrêmes progressent, les partis démocratiques traditionnels perdent encore un peu plus leur influence, tous redoutent à présent la rue. Nos pères sont déçus. Qu’ils se réjouissent tout au contraire : le temps de la véritable politique va bientôt revenir. Celui de l’action aussi : le sang des pauvres crie désormais par trop vengeance à force d’avoir coulé en vain dans la nuit. Vers qui ira sa nouvelle fidélité ? Pas vers celui qui lui promettra un peu plus d’argent car ils savent désormais que c’est un mensonge. Vers celui qui leur redonnera honneur et fidélité, les fera se sentir réconciliés avec l’universel concret, les fera se sentir chez eux. Sentiment qui n’est plus éprouvé depuis 30 ans et dont on a soif.Le refus français et ses causes avérées font rater formellement la ratification européenne mais entérinent spirituellement sa finalité profonde. J’écris à dessein «profonde» car cet adjectif signifie naturellement qu’il faut chercher la finalité de la constitution de l’Europe au-delà des formes juridiques. J’écris «entérinent» car ce verbe signifie que le refus français est paradoxalement une occasion inattendue pour que la France insuffle un souffle cette fois-ci non plus politique mais profondément spirituel en Europe. Une «occasion» plutôt qu’une chance comme le pensaient ceux qui ont voté «non» car politiquement, il était plus efficace d’être dedans pour l’influencer. Mais enfin puisque le destin, l’histoire, Dieu, le hasard ont décidé que ce serait de l’extérieur, il faut donc que ce soit par le haut.Le clivage est, de toute évidence, clairement passé, au sein de l’Europe, entre l’Europe de l’Ouest riche financièrement mais pauvre socialement de millions de chômeurs d’une part, et l’Europe de l’Est pauvre financièrement mais dont les actifs pauvres (en regard de nos critères à l’Ouest) rêvent d’émigrer chez nous. Au sein de la France, le clivage ne s’est en revanche pas déplacé : il s’est confirmé. Les élites analysent les causes de la pauvreté sans y trouver de remède tandis que les pauvres meurent de faim dans nos rues. Les élites analysent les causes de guerres civiles larvées des diverses communautés qui composent désormais la République française (Perpignan) ou de la Guerre civile qui oppose de toute éternité les barbares criminels de nos rues aux honnêtes citoyens pauvres ou riches de ces mêmes rues. Il est connu à l’étranger qu’on peut se faire tuer aisément dans les rues de Paris : ni la sécurité, ni l’emploi, ni même la garantie minimale d’un niveau de vie décent pour ceux qui n’ont pas ou plus de travail n’ont été rétablis. Toutes les circonstances d’une situation pré-révolutionnaire sont objectivement réunies en France pour la première fois depuis plus de 100 ans. On imagine déjà la rue livrée aux émeutiers de la Ligue Communiste Révolutionnaire et à ceux du Front National : tous deux méprisant la démocratie (avec raison car c’est un régime profondément méprisable) : il serait logique qu’on en arrive là.Pourquoi ?Parce que les idées gouvernent le monde et qu’elles n’aiment pas se heurter à l’argent.C’est là tout le clivage qui existe résumé mais au niveau mondial cette fois-ci.Je voyais un Chinois riche hier soir qui a fait bâtir une réplique d’un château français dans la banlieue de Pékin en guise de résidence secondaire : ironie du destin. Ce pauvre Alain Peyrefitte ne s’attendait tout de même pas à ça lorsqu’il écrivait Quand la Chine s’éveillera» il y a trente ans ! C’était l’un des rares livres connus par les Français les plus incultes : on vous le citait à tout bout de champ. Nous y sommes ! La Chine s’est éveillée. Et alors ? Tant mieux pour elle : elle sera bientôt confrontée à une guerre civile entre riches et pauvres à moins que le régime militaire ne la tienne d’une poigne de fer qui ira grandissante. La Chine sera bientôt une méga-Birmanie. Le Japon est plus intelligent que ses voisins mais il baisse mécaniquement lorsqu’ils montent : les tensions historiques de l’Asie repartent.Quant aux limbes de l’Empire européen (sans empereur pour le moment), ses franges africaines et arabes aimeraient qu’on les agrège d’un peu plus près mais le corps résiste : il n’arrive plus à s’agréger lui-même alors agréger les autres…Si la démocratie ne parvient plus à se réguler, à nous assurer une sécurité élémentaire au niveau intérieur, extérieur, mondial à nous Français, et si nous rejetons l’Europe à la suite de ce constat par erreur de perspective, il est temps de songer à autre chose. Mais à quoi ? Intéressante question.Le capitalisme comme le communisme et le socialisme n’ont jamais pu s’implanter intellectuellement en France : il est normal qu’ils aient échoué. La France est un pays qui aime la liberté et la générosité : elle répugne naturellement à des doctrines inventées respectivement par des Protestants et des Juifs et elle répugne au formalisme juridique. Elle l’estime profondément avilissant : l’honneur d’un Français n’a jamais été le code (qui achète des déterminations appelées lois contre d’autres déterminations appelées peines en fonction d’un marché dont il tient le compte immonde) ni le contrat. L’honneur d’un Français est celui du sang versé, du principe intangible de la foi en la justice divine. La démocratie et les bulletins de vote nous ont amenés au triomphe du capitalisme et du socialisme, les deux intimement mélangés en un très savant mélange présidentiel dont la France n’a pas le monopole mais qu’elle a affiné par son jacobinisme et son girondisme. Tout cela appartient à l’histoire : c’est depuis dimanche dernier très clair.La France a brutalement pris l’initiative de guider l’Europe vers un pacte anti-capitaliste, anti-communiste et anti-socialiste aussi. Elle a été trompée par tous. Elle est redevenue une terre de liberté et de générosité volontariste mais elle a cessé d’être un «animal politique» au sein du conglomérat. Je dis en réaliste : «profitons-en !». Toutes les opportunités sont ouvertes à présent. Le résultat finalement m’enchante et il ne s’oppose fondamentalement pas à l’idée européenne, au contraire, en fin de compte. Je m’en aperçois depuis dimanche soir et les soirs suivants m’ont confirmé cette impression. Il y a tout à attendre de ce début de siècle qui s’annonce riche pour les pauvres, pauvre pour les riches, enseignant pour les ignorants, remémorisant pour les amnésiques. Il n’y aura que le directeur de l’École des Hautes Études en Sciences sociales pour s’en plaindre : tant pis, son temps est largement passé. Qu’il songe à remplir sa lampe d’huile car bientôt il fera nuit…
«J’ai déclaré la guerre aux Partis. Je me garde bien de déclarer la guerre aux chefs des Partis. Les Partis sont irrécupérables. Mais les chefs de Partis ne demandent qu’à être récupérés… il leur suffit de récupérer un portefeuille.»Général Charles de Gaulle, cité par Jean Mathiex et Gérard Vincent, Aujourd’hui (depuis 1945), Tome 1 §6 La vie politique française sous la IVe République (éd. Masson, 1981).Il est naturel que j’intervienne après le résultat négatif du référendum français sur le traité établissant une nouvelle constitution européenne car je l’avais défendu par trois fois.Pierre dont j’ai lu l’intéressant premier billet (et dont je salue l’excellente exégèse en forme de dialogue à propos du film de Gibson) a perdu la partie contre Juan, j’en conviens depuis que j’ai lu ses réponses. Mais pas pour les raisons qui plaisent à notre ami Serge. Pour d’autres, me semble-t-il, que je veux inspecter. Et d’abord pour son incompréhension à l’égard de Drumont et de Maurras qu’il met en parallèle avec Marx. Tous trois méprisaient l’argent : ils ne sont donc pas haïssables, cher Pierre, mais admirables pour cette raison. Je conviens cependant que le parallèle ne peut être mené plus loin mais il faut le mener au moins à ce point précis où vous n’êtes justement pas arrivé dans votre premier billet. Et si aucun de nos hommes politiques actuel n’est capable de mépriser suffisamment l’argent, l’obscure puissance de la haute-finance, il convient de souhaiter un sauveur, un homme providentiel : Juan a raison. Qu’il s’agisse d’un sauveur terrestre suffira car pour la cité céleste, nous savons que nous avons déjà un sauveur et il nous suffit bien. Mais pour la cité terrestre, il faut décidément s’en préoccuper sérieusement. Enfin ici il s’agit de la cité européenne où la France a repris par la négative une place qu’elle pouvait obtenir plus simplement par la positive. Eh bien puisque le destin et l’histoire font ainsi entrer la dialectique augustinienne et hégélienne de concert, en sourdine, derrière les débats menés par les arriérés-mentaux (et mentales) habituels (elles), c’est la volonté divine. Donc oui, philosophiquement, à défaut de politiquement, on peut parler de divine surprise. La France est devenue le pays qui toujours nie. Elle s’est appropriée Faust depuis quelques années : elle se germanise alors que les Allemands peinent à se réunifier et se francisent. Savoureux…J’imaginai un résultat misérable : 50,02% ou 49,9% contre l’autre pourcentage restant, par exemple. Mais non : c’est un peu mieux. On est sorti du même et du même : en effet le peuple s’est réapproprié la volonté politique. Les extrêmes progressent, les partis démocratiques traditionnels perdent encore un peu plus leur influence, tous redoutent à présent la rue. Nos pères sont déçus. Qu’ils se réjouissent tout au contraire : le temps de la véritable politique va bientôt revenir. Celui de l’action aussi : le sang des pauvres crie désormais par trop vengeance à force d’avoir coulé en vain dans la nuit. Vers qui ira sa nouvelle fidélité ? Pas vers celui qui lui promettra un peu plus d’argent car ils savent désormais que c’est un mensonge. Vers celui qui leur redonnera honneur et fidélité, les fera se sentir réconciliés avec l’universel concret, les fera se sentir chez eux. Sentiment qui n’est plus éprouvé depuis 30 ans et dont on a soif.Le refus français et ses causes avérées font rater formellement la ratification européenne mais entérinent spirituellement sa finalité profonde. J’écris à dessein «profonde» car cet adjectif signifie naturellement qu’il faut chercher la finalité de la constitution de l’Europe au-delà des formes juridiques. J’écris «entérinent» car ce verbe signifie que le refus français est paradoxalement une occasion inattendue pour que la France insuffle un souffle cette fois-ci non plus politique mais profondément spirituel en Europe. Une «occasion» plutôt qu’une chance comme le pensaient ceux qui ont voté «non» car politiquement, il était plus efficace d’être dedans pour l’influencer. Mais enfin puisque le destin, l’histoire, Dieu, le hasard ont décidé que ce serait de l’extérieur, il faut donc que ce soit par le haut.Le clivage est, de toute évidence, clairement passé, au sein de l’Europe, entre l’Europe de l’Ouest riche financièrement mais pauvre socialement de millions de chômeurs d’une part, et l’Europe de l’Est pauvre financièrement mais dont les actifs pauvres (en regard de nos critères à l’Ouest) rêvent d’émigrer chez nous. Au sein de la France, le clivage ne s’est en revanche pas déplacé : il s’est confirmé. Les élites analysent les causes de la pauvreté sans y trouver de remède tandis que les pauvres meurent de faim dans nos rues. Les élites analysent les causes de guerres civiles larvées des diverses communautés qui composent désormais la République française (Perpignan) ou de la Guerre civile qui oppose de toute éternité les barbares criminels de nos rues aux honnêtes citoyens pauvres ou riches de ces mêmes rues. Il est connu à l’étranger qu’on peut se faire tuer aisément dans les rues de Paris : ni la sécurité, ni l’emploi, ni même la garantie minimale d’un niveau de vie décent pour ceux qui n’ont pas ou plus de travail n’ont été rétablis. Toutes les circonstances d’une situation pré-révolutionnaire sont objectivement réunies en France pour la première fois depuis plus de 100 ans. On imagine déjà la rue livrée aux émeutiers de la Ligue Communiste Révolutionnaire et à ceux du Front National : tous deux méprisant la démocratie (avec raison car c’est un régime profondément méprisable) : il serait logique qu’on en arrive là.Pourquoi ?Parce que les idées gouvernent le monde et qu’elles n’aiment pas se heurter à l’argent.C’est là tout le clivage qui existe résumé mais au niveau mondial cette fois-ci.Je voyais un Chinois riche hier soir qui a fait bâtir une réplique d’un château français dans la banlieue de Pékin en guise de résidence secondaire : ironie du destin. Ce pauvre Alain Peyrefitte ne s’attendait tout de même pas à ça lorsqu’il écrivait Quand la Chine s’éveillera» il y a trente ans ! C’était l’un des rares livres connus par les Français les plus incultes : on vous le citait à tout bout de champ. Nous y sommes ! La Chine s’est éveillée. Et alors ? Tant mieux pour elle : elle sera bientôt confrontée à une guerre civile entre riches et pauvres à moins que le régime militaire ne la tienne d’une poigne de fer qui ira grandissante. La Chine sera bientôt une méga-Birmanie. Le Japon est plus intelligent que ses voisins mais il baisse mécaniquement lorsqu’ils montent : les tensions historiques de l’Asie repartent.Quant aux limbes de l’Empire européen (sans empereur pour le moment), ses franges africaines et arabes aimeraient qu’on les agrège d’un peu plus près mais le corps résiste : il n’arrive plus à s’agréger lui-même alors agréger les autres…Si la démocratie ne parvient plus à se réguler, à nous assurer une sécurité élémentaire au niveau intérieur, extérieur, mondial à nous Français, et si nous rejetons l’Europe à la suite de ce constat par erreur de perspective, il est temps de songer à autre chose. Mais à quoi ? Intéressante question.Le capitalisme comme le communisme et le socialisme n’ont jamais pu s’implanter intellectuellement en France : il est normal qu’ils aient échoué. La France est un pays qui aime la liberté et la générosité : elle répugne naturellement à des doctrines inventées respectivement par des Protestants et des Juifs et elle répugne au formalisme juridique. Elle l’estime profondément avilissant : l’honneur d’un Français n’a jamais été le code (qui achète des déterminations appelées lois contre d’autres déterminations appelées peines en fonction d’un marché dont il tient le compte immonde) ni le contrat. L’honneur d’un Français est celui du sang versé, du principe intangible de la foi en la justice divine. La démocratie et les bulletins de vote nous ont amenés au triomphe du capitalisme et du socialisme, les deux intimement mélangés en un très savant mélange présidentiel dont la France n’a pas le monopole mais qu’elle a affiné par son jacobinisme et son girondisme. Tout cela appartient à l’histoire : c’est depuis dimanche dernier très clair.La France a brutalement pris l’initiative de guider l’Europe vers un pacte anti-capitaliste, anti-communiste et anti-socialiste aussi. Elle a été trompée par tous. Elle est redevenue une terre de liberté et de générosité volontariste mais elle a cessé d’être un «animal politique» au sein du conglomérat. Je dis en réaliste : «profitons-en !». Toutes les opportunités sont ouvertes à présent. Le résultat finalement m’enchante et il ne s’oppose fondamentalement pas à l’idée européenne, au contraire, en fin de compte. Je m’en aperçois depuis dimanche soir et les soirs suivants m’ont confirmé cette impression. Il y a tout à attendre de ce début de siècle qui s’annonce riche pour les pauvres, pauvre pour les riches, enseignant pour les ignorants, remémorisant pour les amnésiques. Il n’y aura que le directeur de l’École des Hautes Études en Sciences sociales pour s’en plaindre : tant pis, son temps est largement passé. Qu’il songe à remplir sa lampe d’huile car bientôt il fera nuit…
02/06/2005 | Lien permanent
Stalker de Tarkovski, par Francis Moury

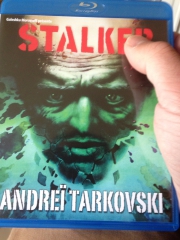 Acheter Stalker en bluray sur Amazon.
Acheter Stalker en bluray sur Amazon.Note technique sur le bluray français de Films sans frontière, sorti le 25 avril 2016.
Bluray multirégions A+B+C, durée vidéo totale du film : 163 min à 24 images / sec., ce qui explique la différence de durée par rapport aux anciens DVD PAL qui tournaient à 25 images / sec. - Image : format 1.37 N&B + couleurs compatible 16/9 en 1080p Haute Définition – son PCM mono 2.0, VOSTF en français ou en anglais, au choix. Premier grand avantage de cette édition bluray : Stalker tient dorénavant sur un seul disque. Second grand avantage : la définition très supérieure de l'image. Ce n'est pas tant le son PCM mono qui fait la différence que l'image HD, par rapport aux anciennes éditions DVD européennes parfois dotées d'un son 5.1. telle que l'ancienne édition MK2. L'image chimique utilisée est aussi propre, sur une longue durée, que celle utilisée à l'époque des DVD mais la définition vidéo HD de ce bluray (1920 x 1080) est nettement supérieure à l'ancienne définition SD (640 x 480) des anciens DVD. En revanche, aucun supplément annexé au film qui demeure, de toute évidence, l'essentiel.
Casting succinct
Alexandre Kaïdanovski (Stalker), Anatoli Solonitsyne (l’écrivain), Nikolaï Grinko (le physicien), Alissa Freundlich, Ivan Lapikov, etc.
Résumé du scénario
À la suite de la chute d’un météore, une Zone étrange et dangereuse pour l’homme s’est formée. On chuchote entre initiés qu’il s’y trouve une chambre exauçant les désirs. Un passeur marginal et fruste – qu’on nomme un «Stalker» – accepte d’y amener clandestinement un physicien et un écrivain. Pourront-ils pénétrer tous trois dans la Zone ? Et si oui, oseront-ils franchir le seuil de sa Chambre ?
«Dans Stalker, je ne voulais pas, c'était un principe, distraire ou étonner le public par des changements inattendus de la scène, de la géographie de l'action, du sujet de l'intrigue. Je n'aspirais qu'à la simplicité et à la discrétion de toute l'architectonique du film. J'ai essayé, de manière encore plus conséquente, de faire comprendre au spectateur que le cinéma, en tant qu'instrument de l'art, possède, autant que la littérature, des possibilités qui lui sont propres. J'ai voulu lui démontrer la capacité du cinéma à observer la vie, sans ingérence évidente ou grossière dans son écoulement. Car c'est là que réside, à mon avis, la véritable essence poétique du cinéma.»
Andrei Tarkovski, Le Temps scellé : de «L'Enfance d'Ivan» au «Sacrifice» (traduit par Anne Kichilov et Charles H. de Brantes, éditions Les Cahiers du cinéma, 2004).
Critique
Stalker (URSS, 1979) d’Andreï Tarkovski a reçu le Prix Spécial du Jury du Festival de Cannes 1980 et le Prix Luchino Visconti 1980. Sorti à Paris le 18 novembre 1981, il est au fil des temps devenu le film le plus mythique du cinéaste auprès des cinéphiles comme des intellectuels s’intéressant au cinéma. Et cela se comprend très facilement une fois qu’on l’a visionné.
La première partie nous installe dans un univers soviétique futuriste brièvement décrit à partir d’un argument de science-fiction. Cette zone interdite crée par la chute d’un météore au sein de laquelle trois hommes s’aventurent répond initialement à un thème classique de la littérature et du cinéma de science-fiction. Mais Tarkovski donne à cette zone un certain nombre de caractéristique qui en font très vite un équivalent du Sacré tel qu’il est décrit par les sociologues des religions : tabou, risqué, réservé à un guide élu ou chaman en contact direct avec lui, pouvant être source de mort comme d’une vie supérieure. Tous les signes du «sacré de respect» énumérés par Durkheim, Roger Caillois, Mircea Eliade et tant d’autres phénoménologues des religions sont ici présents. En outre, si la personnalité du Stalker lui-même est d’une certaine manière traditionnelle au sein des univers mythiques primitifs dans la mesure où il est un marginal, en-deçà ou au-delà de la société à laquelle il appartient, le fait que les deux autres aventuriers de la Zone soient un écrivain à succès d’une part, un physicien émérite de l’autre font passer le film sur le terrain de la fable philosophique la plus évidente. Ni l’art, ni la science rationnelle ne suffisant à satisfaire l’homme, reste à tenter l’expérience ultime : celle de la découverte transgressive de l’altérité absolue du «Tremendum» et du «Fascinans». Bien sûr, un tel début de scénario tourné en U.R.S.S. en 1979 a une valeur politique immédiate : c’est un appel subversif à un retour au religieux et un témoignage de la faillite morale et philosophique du régime marxiste-léniniste. Mais c’est aujourd’hui moins cet aspect subversif contingent que l’aspect purement esthétique et fantastique qui nous séduisent. Car en somme, URSS ou pas, le propos de Tarkovski est universel et la fable recevable par tous les types de sociétés industrielles contemporaines. Raison pour laquelle on trouve ces plans obsédants d’un urbanisme en décrépitude, rongé par la dégradation ou la nature : ce n’est même pas tel ou tel régime politique qui est ici dénoncé, c’est finalement toute la civilisation moderne, incapable de combler les aspirations humaines. Raison aussi pour laquelle, une fois arrivé dans la zone, on passe symboliquement du N&B à la couleur : on a franchi un degré supérieur de réalité, on s’est réconcilié d’un cran avec la vérité du réel à mesure qu’on quittait les apparences urbaines thanatophores. Voilà tout ce qu’il faut percevoir dans cette première partie.
La seconde partie est une déception relative car le suspense s’y transforme : il change de nature et devient strictement philosophique et discursif (confirmant par la parole ce qui était déjà donné dans la première partie, mais l’approfondissant en détails très bien écrits : c’est un «trilogue» magnifique auquel il n’y a pas grand chose à ajouter) à quelques exceptions près : jusqu’au dernier moment on ignore qui va franchir le seuil de la Chambre ; d’autre part un chien s’agrège au groupe d’hommes tel un obscur messager muet, enfin la Zone est discrètement mais régulièrement vivante et hétérogène à l’humain, même si accueillante avec réserve – et quelle réserve : une suite de pièges mortels et d’illusions !
Le final est en revanche rassérénant et cohérent avec le thème profond du film. Le retour cruel au réel est comme transfiguré de l’intérieur, résultat charnel de ce qui a été une méditation en acte. Et c’est le Stalker puis son enfant qui en sont les vecteurs, les témoins. Une théologie eschatologique symbolique en somme : les éléments naturels et matériels y sont décomposés par l’énergie du sacré avant d’être conservés mais augmentés d’une connaissance humaine qui leur faisaient défaut. Ils existent davantage et plus véritablement ensuite. C’est tout ce mouvement qui intéresse Tarkovski et c’est parce que le passeur le mène à bien, par pure charité, que le nom de sa fonction – ce surnom mystérieux que seuls connaissent ceux qui s’intéressent à la possibilité qu’il incarne – donne son titre au film.
25/07/2005 | Lien permanent
Le Miroir de Tarkovski, par Francis Moury

19/07/2005 | Lien permanent
Éric Rohmer dans la Zone, par Francis Moury

 Acheter Le Paradis français d’Éric Rohmer sur Amazon.
Acheter Le Paradis français d’Éric Rohmer sur Amazon.Les Contes moraux :
 La boulangère de Monceau et La carrière de Suzanne (1962 et 1964).
La boulangère de Monceau et La carrière de Suzanne (1962 et 1964). La collectionneuse (1966).
La collectionneuse (1966).  Ma nuit chez Maud (1969).
Ma nuit chez Maud (1969).  Le genou de Claire (1970).
Le genou de Claire (1970).  L'amour l'après-midi (1972).
L'amour l'après-midi (1972). Les Comédies et proverbes :
 La Femme de l'aviateur (1981).
La Femme de l'aviateur (1981).  Le Beau mariage (1982).
Le Beau mariage (1982).  Pauline à la plage (1983).
Pauline à la plage (1983).  Les nuits de la pleine lune (1983).
Les nuits de la pleine lune (1983).  Le rayon vert (1986).
Le rayon vert (1986).  L'ami de mon amie (1987).
L'ami de mon amie (1987).
21/02/2010 | Lien permanent
Orson Welles et Shakespeare, par Francis Moury

Sur Macbeth.
 Fair is foul, and foul is fair : Macbeth ou l'ontologie noire.
Fair is foul, and foul is fair : Macbeth ou l'ontologie noire. Sur le heurt à la porte dans Macbeth de Thomas De Quincey.
Sur le heurt à la porte dans Macbeth de Thomas De Quincey. Macbeth et le Mal de Stéphane Patrice.
Macbeth et le Mal de Stéphane Patrice. Macbeth est, en 1948, la première adaptation cinématographique shakespearienne du cinéaste et acteur Orson Welles (Citizen Kane, La Splendeur des Amberson, La Soif du mal). Quatre ans avant son Othello, il prouvait déjà qu’il était bien l’adaptateur le plus authentique du dramaturge britannique, restituant une violence à la fois baroque et expressionniste à la pièce tout en lui maintenant une théâtralité revendiquée. Le cinéaste Laurence Olivier adaptait Hamlet vers la même époque d’une manière bien plus sage et esthétiquement bien plus classique. Tourné en seulement 21 jours, Macbeth avait été l’occasion d’une «bataille d’Hernani» entre les critiques cinématographiques français et avait déplu à André Gide, ainsi que le rappelle Antoine de Baecque dans sa préface. Pourtant, par une certaine ironie du sort, la version Welles apparaît aujourd’hui – au moment où nous sommes habitués et presque abrutis par tous les excès esthétiques possibles – comme une version quasiment classique, tenant la balance égale entre l’exotisme de celle d’Akira Kurosawa (Le Château de l’araignée, Kumonosu-jô / Throne of Blood, 1957) qui alliait en noir et blanc le théâtre japonais et le théâtre anglais d’une manière insolite voire fantastique, et le réalisme violent de celle de Roman Polanski (Macbeth, 1971), tournée en écran large et Panavision couleurs en extérieurs naturels. Carlotta Films édite en exclusivité Macbeth dans ses deux versions (la version exploitée au cinéma en 1950 et la version longue inédite de 1948) restaurées en Haute Définition. Malgré (ou à cause de… car Welles trouvait dans l’obstacle une source d’inspiration) un tournage semé d’embûches, son Othello (sa seconde adaptation shakespearienne) est une transposition stupéfiante de la tragédie originelle. Othello fut réalisé par Welles en Europe du Sud et au Maroc dans des conditions marginales, en extérieurs naturels impressionnants tels ceux de Mogador. Il fut récompensé par un Prix au Festival de Cannes de 1952. Porté par un trio d’acteurs époustouflant (Orson Welles, Micheál Mac Liammóir et Suzanne Cloutier), Othello est un chef-d’œuvre à l’esthétique cette fois-ci davantage baroque qu’expressionniste, disponible pour la première fois dans sa version restaurée «officielle» de 1992, en dvd et en blu-ray haute définition niveau 2K. Les deux films sont proposés à l’unité ou rassemblés dans un coffret collector. Les suppléments sont colossaux, contenant notamment des moyens métrages rarissimes de Welles et de nombreux témoignages de première main sur la production.
Macbeth est, en 1948, la première adaptation cinématographique shakespearienne du cinéaste et acteur Orson Welles (Citizen Kane, La Splendeur des Amberson, La Soif du mal). Quatre ans avant son Othello, il prouvait déjà qu’il était bien l’adaptateur le plus authentique du dramaturge britannique, restituant une violence à la fois baroque et expressionniste à la pièce tout en lui maintenant une théâtralité revendiquée. Le cinéaste Laurence Olivier adaptait Hamlet vers la même époque d’une manière bien plus sage et esthétiquement bien plus classique. Tourné en seulement 21 jours, Macbeth avait été l’occasion d’une «bataille d’Hernani» entre les critiques cinématographiques français et avait déplu à André Gide, ainsi que le rappelle Antoine de Baecque dans sa préface. Pourtant, par une certaine ironie du sort, la version Welles apparaît aujourd’hui – au moment où nous sommes habitués et presque abrutis par tous les excès esthétiques possibles – comme une version quasiment classique, tenant la balance égale entre l’exotisme de celle d’Akira Kurosawa (Le Château de l’araignée, Kumonosu-jô / Throne of Blood, 1957) qui alliait en noir et blanc le théâtre japonais et le théâtre anglais d’une manière insolite voire fantastique, et le réalisme violent de celle de Roman Polanski (Macbeth, 1971), tournée en écran large et Panavision couleurs en extérieurs naturels. Carlotta Films édite en exclusivité Macbeth dans ses deux versions (la version exploitée au cinéma en 1950 et la version longue inédite de 1948) restaurées en Haute Définition. Malgré (ou à cause de… car Welles trouvait dans l’obstacle une source d’inspiration) un tournage semé d’embûches, son Othello (sa seconde adaptation shakespearienne) est une transposition stupéfiante de la tragédie originelle. Othello fut réalisé par Welles en Europe du Sud et au Maroc dans des conditions marginales, en extérieurs naturels impressionnants tels ceux de Mogador. Il fut récompensé par un Prix au Festival de Cannes de 1952. Porté par un trio d’acteurs époustouflant (Orson Welles, Micheál Mac Liammóir et Suzanne Cloutier), Othello est un chef-d’œuvre à l’esthétique cette fois-ci davantage baroque qu’expressionniste, disponible pour la première fois dans sa version restaurée «officielle» de 1992, en dvd et en blu-ray haute définition niveau 2K. Les deux films sont proposés à l’unité ou rassemblés dans un coffret collector. Les suppléments sont colossaux, contenant notamment des moyens métrages rarissimes de Welles et de nombreux témoignages de première main sur la production.Ces deux films peuvent être l’occasion de relire Shakespeare dans une nouvelle traduction dont l’édition constitue une première pour Carlotta Films, livre luxueux illustré par de belles photos (techniquement, elles sont de trois catégories : photos d’exploitation, photos de plateau et photogrammes ainsi que, peut-être, quelques photos d’exploitation détourées) des deux films de Welles. C’est à l’occasion des célébrations du 450e anniversaire de la naissance de Shakespeare que Patrick Reumaux, poète (Prix Max Jacob), traducteur de poètes et d’écrivains américains, anglais, gallois, irlandais ou écossais tels que Edgard Lee Masters, Emily Dickinson, John Updike, John Steinbeck, D. H. Lawrence, les frères Powys, Dylan Thomas, Flann O’Brien, R. L. Stevenson, etc., s’est employé à traduire Macbeth et Othello, pour accompagner ce renouveau numérique des images d’Orson Welles.
Sur sa nouvelle traduction de Macbeth, Reumaux déclare ceci : «[…] J’ai suivi le texte du New Shakespeare publié par les Presses Universitaires de Cambridge sous la direction de Dover Wilson tel qu’il est donné dans l’édition bilingue publiée en France sous la direction de Pierre Leyris et Henri Evans en maintenant dans les grandes lignes les signaux de scansion tels qu’ils sont donnés dans le texte anglais : une virgule (,) indique une pause, un point-virgule (;) une pause un peu plus longue, deux points (..), trois points de suspension (…) ou un tiret (-) une pause prolongée avant la reprise du souffle. Les parenthèses simples signalent un aparté. On lira, dans la Bibliothèque de la Pléiade (2002), la notice signée Yves Peyré, très documentée, particulièrement sur les sources, l’historique des représentations et les «lectures de la pièce». […] Sur Macbeth, on consultera, si affinités, chez De Quincey, Le Heurt à la porte dans Macbeth et le Macbeth des carnets de travail de Dame Edith Sitwell (Edith Sitwell, A notebook on William Shakespeare, 1948, Macmillan & co, Londres), où l’on trouvera une musique un peu différente de celle que l’on connaît chez les grands érudits ordinaires («Ordinario» est le qualificatif employé en italien pour désigner les «vrais» professeurs d’Université et les démarquer des faux (qui sont légions), ceux du Dimanche et des autres jours, les Bradley, Brunel, Charlton, Curry, Wilson Knight, Mayoux, Muir, d’autres, le film se termine il est l’heure : «Arrêtez les suspects habituels».
Si la traduction de Leyris parue dans la collection bilingue éditée chez Aubier Montaigne est encore considérée comme une référence par Reumaux, celle de Jules Derocquigny (La Tragédie de Macbeth) parue en 1927 dans la collection Shakespeare des Belles lettres qui fut sa noble ancêtre n’est jamais citée ni mentionnée. Idem pour La Tragédie de Othello, traduite par le même Derocquigny en 1928. Il faudrait peut-être, à la réflexion, que les Belles Lettres songent à réimprimer une fois de plus, en ce début de XXIe siècle, cette magnifique collection, en prenant évidemment soin de toujours bien respecter , par l’emploi de la reproduction photomécanique en fac-similé, son agréable format in-16 d’origine. En pratique, voici quelques comparaisons intéressantes établies par Reumaux lui-même entre sa récente traduction et celles de certains de ses plus illustres prédécesseurs :
Texte original de Macbeth (Gallimard, coll. La Pléiade, 2002, pp. 482 et 484).
Seton
The queen, my lord, is dead.
Macbeth
She should have died hereafter.
There would have been a time for such a word:
Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle,
Life's but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.
Traduction de François-Victor Hugo (Flammarion, 1964, pp. 312-313), non en vers mais en prose, phrases à la suite sans retour à la ligne et ponctuation propre au traducteur :
Seyton. – La reine est morte, monseigneur.
Macbeth. – Elle aurait dû mourir plus tard. Le moment serait toujours venu de dire ce mot-là!...Demain, puis demain, puis demain glisse à petits pas de jour en jour jusqu’à la dernière syllabe du registre des temps ; et tous nos hiers n’ont fait qu’éclairer pour des fous le chemin de la mort poudreuse. Éteins-toi, éteins-toi, court flambeau ! La vie n’est qu’un fantôme errant, un pauvre comédien qui se pavane et s’agite durant son heure sur la scène et qu’ensuite on n’entend plus ; c’est une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et de furie, et qui ne signifie rien…
Traduction d’Yves Bonnefoy (Gallimard, coll. Folio Classique, 1985 puis 2001 pour la traduction, hors préface et dossier de 2010 ; première édition en 1983, Mercure de France, p. 141) :
Seyton
La reine, monseigneur ! Elle est morte.
Macbeth
Elle aurait dû mourir en un autre temps,
Un où pour ce grand mot, la mort il y aurait place.
Hélas, demain, demain, demain, demain
Se faufile à pas de souris de jour en jour
Jusqu’aux derniers échos de la mémoire
Et tous nos «hiers» n’ont fait qu’éclairer les fous
Sur le chemin de l’ultime poussière.
Éteins-toi, brève lampe !
La vie n’est qu’une ombre qui passe, un pauvre acteur
Qui s’agite et parade une heure, sur la scène,
Puis on ne l’entend plus. C’est un récit
Plein de bruit, de fureur, qu’un idiot raconte
Et qui n’a pas de sens.
Traduction de Patrick Reumaux :
Seton
La reine, monseigneur, est morte.
Macbeth
Elle aurait dû mourir plus tard,
À un moment où l'on peut prononcer ce mot,
Demain, et demain et demain
Se glisse à pas feutrés, de jour en jour
Jusqu’à l'ultime syllabe de la dernière heure
Et tous nos hiers ont éclairé les dupes
Sur le chemin qui mène à la poussière. Meurs, petite chandelle !
La vie n’est qu’une ombre qui chemine, un pauvre acteur
Qui fait la roue et se roule une heure sur la scène
Avant de sombrer dans l'oubli, un racontar d’idiot
Plein de bruit et de fureur,
Qui ne signifie rien.
Sur sa nouvelle traduction d’Othello, Reumaux déclare ceci : «Othello est une histoire vénitienne dont le héros – il faut oser dire que c’est Iago – excite la jalousie d’Othello en essayant de lui prouver l’infidélité de Desdemona, qui sera d’autant plus sensible que les images mises sous les yeux du Maure seront des métaphores, et des métaphores obscènes, de cette obscénité (teinte ou non d’humour) que l’on trouve chez les conteurs galants de la Renaissance Italienne. Cela permet au texte français d’entrer en résonance avec ces obscénités Shakespeariennes, qui faisaient le désespoir d’Oscar Wilde. On dira que c’est forcer le trait. Il faudrait plutôt dire que c’est retrouver le naturel en poussant l’artifice jusqu’au bout. Être, en somme, aussi Shakespearien que Shakespeare (les mauvaises langues diraient plus royaliste que le roi.)»
En pratique, voici de nouvelles comparaisons, toujours établies par Reumaux lui-même, entre lui-même et ses prédécesseurs :
Texte original de Othello
Acte I, Scène 3 (tirade de Iago)
And it is thought abroad that ‘twixt my sheets
He has done my office.
On croit de par le monde, qu’il a entre mes draps rempli mon office d’époux.
François-Victor Hugo, 1859.
De par le monde on pense qu’en mon lit, entre mes draps,
Il a fait ma besogne.
Armand Robin, 1959.
Et on pense de par le monde qu’entre mes draps,
Il a rempli ma charge.
Jean-Michel Déprats, 2002.
Et l’on pense partout que c’est à ma place et entre mes draps
Qu’il a égoutté son pressoir.
Patrick Reumaux, 2014.
Texte original de Othello
Acte II, Scène 2 (tirade de Iago)
Now, I do love her too,
Not out of absolute lust – though peradventure
I stand accountant for as great a sin.
Et moi aussi je l’aime ! Non pas absolument par convoitise (quoique par aventure, je puisse être coupable d’un si gros péché).
François-Victor Hugo, 1859.
Mais moi aussi j’aime la fille,
Pas d’un désir absolu (bien que le cas échéant
Je pourrais étre coupable d’un aussi gros péché).
Armand Robin ,1959.
Mais moi aussi je l’aime,
Non par luxure, bien qu’à l’occasion
Je puisse être comptable d’un aussi grand péché.
Jean-Michel Déprats, 2002
… Elle, je l’avoue volontiers
Ne m’est pas indifférente et parle à mon engin
Au point qu’avec elle je pourrais faire entrer le Pape dans Rome.
Patrick Reumaux, 2014.
Je précise que les notes additionnelles du traducteur justifient parfois, mais pas toujours ces curieuses, voire troublantes, innovations.
Ce dialogue matérialisé, sous la belle forme d’un livre, entre théâtre et cinéma aurait, tel quel et de toute manière, certainement intéressé le grand Henri Gouhier qui, on s’en souvient mal aujourd’hui, avait étudié non seulement Descartes, Malebranche et Auguste Comte mais encore l’essence du théâtre.
Un autre lien méconnu, peut-être involontairement apporté par le hasard ou le destin qui font souvent bien les choses, entre Welles et Shakespeare. Son dernier grand film noir américai, Touch of Evil, fut distribué en France sous le beau titre La Soif du mal. Beau et, sans le savoir peut-être, shakespearien, car on lit dans Mesure pour Mesure (I, 2, 130-134) les vers suivants : «Tels des rats se ruant sur leur poison, notre nature poursuit le mal dont elle a soif, et quand nous buvons, nous sommes morts» (traduction de François-Victor Hugo revue par Jean Paris, Shakespeare par lui-même, éditions du Seuil, collection Microcosme, publié 1954 et augmenté en 1971, p.148).
Le fait que le héros maudit et tragique du film soit un policier obèse et alcoolique et criminel, criminel que son crime conduira à la mort, interprété d'une manière shakespearienne par Welles lui-même, augmente encore la pertinence shakespearienne de ce titre français d'exploitation.
16/12/2014 | Lien permanent
Les Hésitations de Husserl, par Francis Moury
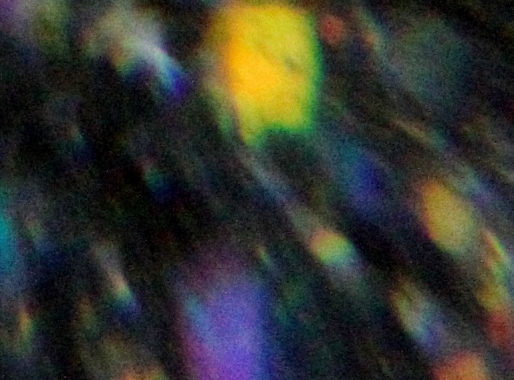
Jules Lachelier, Œuvres, tome II (Éditions Félix Alcan, 1933), p. 189 ou contribution de Lachelier à l'article Idée in André Lalande et société française de philosophie, Vocabulaire technique et critique de la philosophie (Éditions PUF, 1902-1923).
«Mais il faudrait presser encore une fois selon sa forme le mythe de la caverne qui est le mythe des mythes, enfin l'imagination non plus réglée mais réglante. Nous sommes tous en cette caverne; nous ne voyons et ne verrons jamais que des ombres. (...) Les ombres sont toutes vraies, comme elles paraissent. Toutes les ombres d'un homme expliquent la forme de l'homme, et en même temps la caverne, le feu, et la place même de l'homme enchaîné.»
Alain, Les Idées et les âges, tome II (Éditions Gallimard-NRF, 1927), pp. 210-213.
«Imaginez à présent une suite liée d'éclatements qui nous arrachent à nous-mêmes, qui ne laissent même pas à un «nous-mêmes» le loisir de se former derrière eux, mais qui nous jettent au contraire au-delà d'eux, dans la poussière sèche du monde, sur la terre rude, parmi les choses; imaginez que nous sommes ainsi rejetés, délaissés par notre nature même dans un monde indifférent, hostile et rétif : vous aurez saisi le sens profond de la découverte que Husserl exprime dans cette fameuse phrase : toute conscience est conscience de quelque chose.»
Jean-Paul Sartre, Situations, tome I, (Éditions Gallimard-NRF, 1947), p 32.
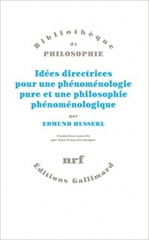 Acheter les Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique sur Amazon.
Acheter les Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique sur Amazon.Voici une nouvelle traduction en un fort volume par Jean-François Lavigne de ces célèbres Ideen (livre I paru en 1913) de Edmund Husserl (1859-1938), effectuée à partir du tome III en deux volumes (1976) de la seconde édition critique allemande parue dans les oeuvres complètes de Husserl ou Husserliana. La disposition en un volume de cette traduction 2018 est bien plus commode et intelligente que celle de l'édition allemande de 1976. Elle ajoute au texte de 1913 la traduction complémentaire des manuscrits inédits préparatoires et elle restitue les notes marginales, les corrections, les interrogations inscrites de 1913 à 1929 par Husserl sur ses exemplaires personnels de l'édition originale et des rééditions. Elle fournit en outre deux glossaires (français-allemand et allemand-français), une traduction du célèbre Index analytique des matières (pp. 676 à 701) établi en 1928 par Ludwig Landgrebe (1), des remarques sur la traduction de certains termes (par exemple la différence entre «réal», «réel», «effectif»), un index des noms propres cités (2) par Husserl. Du fait de ces additions et de leur rassemblement en un seul volume, cette nouvelle édition française culmine aux environs des 750 pages. Ce n'est pas pour autant que la traduction de Paul Ricoeur devient totalement inutile. Elle était souvent mieux écrite, plus agréable à lire et plus claire (façon de parler car la pensée de Husserl est tout sauf claire) que celle de Jean-François Lavigne qui sacrifie l'élégance à la précision scientifique la plus exigeante. Car Jean-François Lavigne met rigoureusement le lecteur français face à sa traduction dans la situation du lecteur allemand face au texte original allemand : c'est ce qu'il faut. Surtout, sa traduction corrige des erreurs, des lacunes, des contresens voire même des interprétations douteuses ou fautives qui rendent (sic transit gloria librorum) définitivement caduque celle de Paul Ricoeur. Mieux, elle corrige même des erreurs et des coquilles de l'édition critique allemande de 1976 lorsque cette dernière s'avère fautive et qu'on doit lui préférer une édition allemande antérieure, par exemple l'édition Niemeyer de 1922 (cf. pp. 231 et 318).
Les Husserliana sont aujourd'hui constituées par une quarantaine de volumes environ, éditant progressivement l'essentiel des 30 000 pages sténographiées (j'écris bien 30 000 et non pas le fautif «300 000» parfois indiqué par erreur dans les notices les plus hâtivement rédigées sur Husserl) composant ses livres, cours d'université, conférences, articles tels qu'ils sont recueillies par les Archives de l'Université catholique de Louvain, pour l'essentiel éditées par les éditions Martinus Nijhoff à la Haye. Certes Emmanuel Levinas, Paul Ricœur, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty lisaient l'allemand mais le temps fait son œuvre : nous connaissons forcément mieux Husserl aujourd'hui qu'à leur époque même si Maurice Merleau-Ponty pensait en allemand husserlien d'une manière si technique et à un tel point, les dernières années de sa vie, que j'ai cherché, dans les glossaires établis par Jean-François Lavigne, certains des termes allemands utilisés par Merleau-Ponty dans Le Visible et l'invisible (édition posthume Gallimard, NRF-Bibliothèque de philosophie, 1964) sans les y trouver. Mais il est cependant non moins probable que Merleau-Ponty, faute d'avoir vécu assez longtemps pour lire un certain nombre de textes husserliens édités puis traduits de 1950 à 2018, en ignorait partiellement «l'élaboration progressive» selon la formule de Lavigne. On mesure bien, lorsqu'on compare les Textes complémentaires (in seconde section) au texte original de ce tome I des Ideen de 1913 (in première section), à quel point cette formule est adaptée au cas philosophique de Husserl qui n'a cessé de se relire, de se ré-écrire sa vie durant. D'ailleurs en vain car ses corrections n'améliorent que rarement les éléments corrigés; ce sont surtout ses annotations marginales autocritiques qui valent la peine d'être découvertes.
Sur le fond, ce texte de 1913 (et les notes écrites de Husserl en marge de 1913 à 1929) permet d'observer, selon la formule de Lothar Kelkel et René Schérer (3) le cheminement qui conduit Husserl, comme sous l'empire d'une impérieuse nécessité, de la phénoménologie descriptive à l'idéalisme transcendantal (para-kantien, donc). Qu'on n'aille pas croire que les questions qu'il pose sont originales, contrairement à ce que Husserl assure. Il suffit de lire le célèbre article de Jules Lachelier, Psychologie et métaphysique (1885) pour les y trouver déjà formulées d'une manière bien plus claire et bien plus rigoureuse (4). Quant à l'idée d'une description nue du réel, nihil novi sub sole dans l'histoire de la philosophie, ni dans l'histoire littéraire. C'était déjà, par exemple, à l'occasion, celle d'écrivains du calibre de Stendhal (5). Ce projet de Husserl, en outre, hésite constamment. Il vise une région indéterminée entre psychologie et logique, ontologie métaphysique et science positive, aristotélisme et platonisme, kantisme et néo-kantisme. Il picore même à l'occasion un peu de malebranchisme et d'immatérialisme berkelyen. Enfin il est rationaliste mais de la manière la plus plate et la moins profonde : celle du logicisme mathématique. Un rationalisme certes adossé aussi bien à l'ontologie et à la logique aristotéliciennes telles que son maître Franz Brentano les lui enseigna) qu'aux Recherches logiques (1900-1901) et mathématiques ou aux Méditation cartésiennes (1929) de Husserl lui-même. Il faut historiquement bien mesurer que Husserl ne fut pas suivi par tous ses étudiants dans cette direction. Le concret et la «chose même» que certains d'entre eux avaient en vue n'était pas forcément ce que Husserl visait dans ces Ideen (6) qui aboutissent, pour leur part, à une sorte de mixte hésitant d'idéalisme et de réalisme, voire même, comme l'assure Jean-François Lavigne dans son avant-propos, à un idéalisme pur. Parmi les rédacteurs du volume 1 des Annales de philosophie et de recherche phénoménologique, paru en avril 1913 et dont ce livre I des Ideen constitue la contribution majeure, on trouve ainsi Max Scheler qui ne fut nullement idéaliste. Parmi les phénoménologues de la première heure, ceux du cercle de Göttingen, on trouve aussi le réaliste «essentialiste» Jean Hering (le contradicteur de Léon Chestov dont le débat est restitué dans la dernière section de l'édition originale de la Potestas Clavium de Chestov).
Ceux qui rêvaient de Husserl, en lisant les réactions, les interprétations, les prolongements (Emmanuel Levinas par exemple) qu'il suscita en France au vingtième siècle seront, à n'en pas douter, fondamentalement déçus par le fond de la pensée autant que par la forme de ce traité : des phrases interminables, parfois littéralement illisibles, en permanence semées d'incises contradictoires et dont les raisonnements ne cessent de s'annuler à mesure qu'ils tentent de se préciser. En guise de consolation, cette nouvelle édition Lavigne a le grand mérite de montrer que Husserl lui-même n'en était nullement satisfait. Il n'a cessé, en effet, sa vie durant, de critiquer, de raturer, de mettre entre guillemets ou entre parenthèses (au sens premier, pas au sens phénoménologique) des mots, des groupes de mots, des propositions, des paragraphes, voire même des pages entières de ce traité interminable, répétitif et qui n'aboutit à rien, tournant sempiternellement en rond à partir d'une intuition jamais transformée en philosophie réelle. C'est davantage pour la visée husserlienne (visée qui était déjà celle des Présocratiques et qui n'est donc pas particulièrement neuve : revenir aux choses elles-mêmes par-delà les préjugés et les dogmes) que pour la philosophie husserlienne, à peine constituable et encore moins constituée, qu'il faut, en somme, malgré tout, lire Husserl. Ce traité n'en est d'ailleurs pas un au sens universitaire du terme car ni sa méthodologie ni même sa terminologie ne sont fixées, ce qui eût été, qu'on nous accorde au moins cela, la moindre des choses ! On peut pourtant encore aujourd'hui s'immerger dans ce capharnaüm qui prétend déboucher sur une psychologie rationnelle (presque trois cents ans après la critique par Kant de celle de Wolff) dont le modèle principal serait... la théorie logico-mathématique des ensembles de G. Cantor (que Husserl considère, in §94, à la note 1 des pp. 289-290, comme étant le premier phénoménologue connu), dont les mathématiques modernes qu'on nous enseignait en classe de cinquième dans les années 1970, donnent une idée précise. Car l'évidence est bien là : c'est à cela que rêvait Husserl en créant ses néologismes inutiles et redondants (noèmes, noèses, eidétique, etc.) qui pourraient faire croire qu'il s'intéresse à la métaphysique alors qu'il ne s'intéresse qu'au fondement logique de la géométrie et des mathématiques. Cruelle déception pour les poètes nostalgiques des Idées platoniciennes ou bien simplement amoureux de la Diotime de Mantinée dans le Banquet de Platon !
Autre signe qui ne trompe pas : Husserl est redevable de l'ampleur historique du terme «phénoménologie» à G.W.F. Hegel qui n'est pas cité une seule fois dans ce traité de 1913. Cette désinvolture historique et philosophique est trop flagrante pour ne pas être signalée, ce que ne font d'ailleurs ni Husserl ni J.-F. Lavigne. Elle indique clairement que Husserl, par lui-même, ne fut pas rigoureux en dépit de son usage assez fréquent de ce dernier terme. La raison en est peut-être qu'il privilégiait le premier terme du titre hégélien Phénoménologie de l'esprit (1807) alors que, ainsi que le soulignait justement Bernard Bourgeois (7) en 1969, «La phénoménologie de l'esprit est la science du phénomène, de la manifestation, ob-jectivation, opposition, scission en soi-même de l'esprit qui se vit ainsi comme rencontre de l'Autre, c'est-à-dire comme conscience ou expérience. Cette expérience s'analyse d'abord selon ses moments abstraits, dont aucun, pris pour lui-même, n'existe réellement : (...) leur fondement réel, c'est toujours l'esprit, au sens plus précis que ce terme reçoit au chapitre VI, intitulé L'Esprit, et qui est bien le chapitre central de la Phénoménologie de l'esprit (...) ». Pour Husserl, au contraire, l'absolu pourrait bien être au commencement, dans la phénoménologie de la perception et non pas dans celle de l'Esprit au sens hégélien de ce dernier terme. Sans oublier non plus que, selon les Ideen I, §55 (p. 171), une réalité absolue serait équivalente à l'idée d'un carré rond alors que, tout au contraire, pour Hegel l'absolu est l'Esprit total synthétisant l'ensemble de ses manifestations phénoménologiques. Sur la pensée de l'absolu dans le système de Hegel, je recommande la lecture des cours (1930-1931) et séminaires (1938 et 1942) de Heidegger consacrés à G.W.F. Hegel, déjà disponibles en traduction chez Gallimard dans la collection des Oeuvres de Martin Heidegger éditée par la Bibliothèque de philosophie de la NRF.
Un exemple du manque de rigueur de Husserl, parmi des dizaines d'autres aisément relevables, est fourni, dans les Textes complémentaires, par l'appendice 30 sur substrat et essence, rédigé en 1918 (pp. 580-82 de l'édition originale allemande = pp. 549-53 de la traduction). Il est typique de la manière dont Husserl dissout la réalité sans être ensuite capable de la recomposer, encore moins de l'unifier. Husserl, pour cette raison, tourne sans cesse en rond dans une région qu'il nomme «ontologie formelle» et qui mélange d'une manière curieuse certaines notions d'ontologie à certaines notions de logique et de psychologie. C'est la même impression d'incomplétude que laissent les exemples concrets donnés par Husserl lui-même à l'appui de ses raisonnements. Ils hésitent constamment entre les diverses strates de la réalité sans pouvoir jamais les unifier : celui du pommier et du gazon (p. 272), celui de la galerie d'art de Dresde (en dépit du fait qu'il soit le seul réellement intéressant, p. 309), celui du Centaure (repris plusieurs fois et notamment p. 440), celui de la table (célèbre mais pourtant l'un des plus faibles du traité, p. 494), celui éminemment psychologique du souci (p. 507). Je dois ajouter que je partage globalement, après avoir lu les 750 pages de ce livre, l'avis de Wilhelm Wundt sur la philosophie de Husserl, cité avec regret par Husserl lui-même en note de la p. 417 : Husserl ne me semble pas, en tout cas ici (ce «ici» qui désigne tout de même son traité fondamental auquel il ne cessa de travailler sa vie durant), en dépit des apparences de rigueur qu'il se donne constamment la peine de revendiquer, à la hauteur de son ambition.
Ses héritiers allemands, au premier chef desquels Martin Heidegger et Max Scheler, et ses héritiers français, au premier chef desquels Jean-Paul Sartre (8) et Maurice Merleau-Ponty, me semblent, en somme, valoir nettement mieux que lui tant sur le fond que sur la forme. Ils furent capables de constituer des systèmes clairs (Heidegger, Scheler, Sartre) ou de questionner rigoureusement et clairement (comme Merleau-Ponty), ce dont Husserl s'avère pathétiquement incapable d'un bout à l'autre de ce traité. Ils ne trouvèrent d'ailleurs vraiment dans la phénoménologie de Husserl que ce qu'ils y apportèrent eux-mêmes ; cette dernière ne tint, relativement à leurs propres systèmes, que le rôle d'une sorte de liquide amniotique philosophique, si j'ose risquer l'image. Il faut cependant, ne serait-ce que pour mieux les lire génétiquement et historiquement, s'y retremper au moins une fois dans sa vie.
Notes
(1) Husserl n'était pas satisfait, précise en note Jean-François Lavigne, de celui établi par son étudiante Gerda Walther à l'occasion de la réédition de 1923. A l'occasion de la réédition de 1928, il confia donc ce soin à son assistant universitaire Ludwig Landgrebe. L'article de Rudolph Boehm, Husserl et l'idéalisme classique, in Revue philosophique de Louvain (tome 57 de août 1959, pp. 357-358) apporte l'information permettant de comprendre pourquoi Husserl n'en était pas satisfait (information que ne fournit pas Lavigne dans sa note) : Gerda Walther y avait constitué une entrée «idéalisme» et une entrée «idéalisme phénoménologique». Cette dernière était, à son tour, divisée en deux sections qui permettaient de comparer les passages plaidant pro ou contra une interprétation idéaliste du livre I des Ideen. C'est cela qui avait expressément déplu à Husserl. Je regrette donc l'absence, ici, de l'index de Gerda Walther qui demeure un document d'histoire de la philosophie qu'il faudrait pouvoir consulter en parallèle avec celui de Ludwig Landgrebe. Il faut en rendre au premier chef responsable l'éditeur allemand de la réédition critique de 1976 puisqu'elle constitue la base scientifique de cette traduction 2018.
(2) Jean-François Lavigne a limité l'index des noms cités au texte principal du livre I des Ideen. Je crois utile, afin que le lecteur prenne mieux la mesure de l'ensemble, d'ajouter ici un petit complément (non exhaustif) regroupant des citations réparties dans l'Avant-propos du traducteur (pp. I à XXXII), dans les Textes complémentaires et dans les Annexes (pp. 461 à 716) : Avenarius : XV, Aristote : 494-495 (en note), 500, 554-555, 654, 656, Berkeley : 634, Brentano : IX, XIX, 617, Comte : 57, Cohen (Hermann) : 489, Descartes : 143, Frege : 367 (en note), Freud : 257, Heidegger : 85, Hering (Jean) : 500, 656, Hume : 480, 515, Kant : 283, 438, 441, 489, 519, Locke : 633, Lotze : 517 (en note), Natorp : VI, XIII, 489, Platon : 473, Pseudo-Denys : 359, Pyrrhon : 70, Sextus Empiricus : 70, Stein (Edith) : I, XX, 451 (en note), Stuart Mill (John) : 70,
(3) Lothar Kelkel et René Schérer, Husserl (Éditions P.U.F., collection «Philosophes» fondée par Émile Bréhier, 1964), p. 7.
(4) Cf. Jules Lachelier, Psychologie et métaphysique (1885), in Jules Lachelier, Oeuvres, tome 1 (Éditions Félix Alcan, 1933), pp. 191-203 : «Mais comment la sensation peut-elle être à la fois le sujet et l'objet de la conscience ? Etc. (...)». Ces pages constituent d'avance une phénoménologie de la perception qui , tout comme celle de Husserl mais avec trente ans d'avance sur elle, s'appuient conjointement sur Aristote et Kant. La différence
22/05/2018 | Lien permanent
Souvenirs sur Francis Pasche : Pasche et la philosophie par Francis Moury

Dès 1953, on trouve dans les premières pages de L’Angoisse et la théorie freudienne des instincts un dialogue théorique serré entre Kierkegaard (Pasche avait lu et annoté in extenso l’édition originale des Études kierkegaardiennes de Jean Wahl) et Freud. Par la suite, c’est aussi Platon et Aristote (Le Vase d’étain), Jacob Böhm (Le Vase d’étain, encore), Descartes (Métaphysique et inconscient), Spinoza (L’Angoisse niée), Kant, Hegel, Maine de Biran, Auguste Comte, Nietzsche et bien d’autres qui furent convoqués – ponctuellement ou en profondeur – dans divers articles.
Au point qu’il me semble que l’on en pourrait éditer un jour un recueil intitulé : Études de psychanalyse appliquée à l’histoire de la philosophie ou bien encore Études psychanalytiques d’histoire de la philosophie. Car Francis Pasche, avant de découvrir Freud et d’entreprendre ses études de médecine et de pharmacie afin d’être psychanalyste, avait étudié à la Sorbonne la philosophie sous la direction des maîtres les plus prestigieux de l’époque.
Je ne reviens pas sur sa passion initiale pour l’esthétique. Il est connu qu’il souhaitait soutenir une thèse sur Proust, qu’il avait été voir Charles Lalo à cet effet, que ce dernier lui aurait répondu : «Proust passera, comme le café. Faites donc une thèse sur Théodore de Banville !».
Autre aberration : alors qu’il n’était pas germaniste, on lui avait demandé de travailler sur Brentano dont presque rien n’était alors traduit en français : j’ai un net souvenir de cela bien que je ne me rappelle plus qui était le directeur en question ni s’il s’agissait de la période des études de philosophie ou de médecine. L’hésitation est d’autant plus permise que l’œuvre de Brentano est, pour partie, psychologique. Toujours est-il que de cette période philosophique, antérieure puis contemporaine de sa découverte de La Science des rêves qui détermina sa passion pour la psychanalyse, il fut marqué à jamais de plusieurs manières.
Sa bibliothèque contenait certains grands classiques de l’histoire de la philosophie comme : Victor Basch, Essai critique sur l’esthétique de Kant, Victor Brochard, Études d’histoire de philosophie ancienne et moderne, John Burnet, L’Aurore de la philosophie grecque, Theodor Gomperz, Les Penseurs de la Grèce, sans oublier celles d’Émile Boutroux, d’Étienne Gilson, de Claude Tresmontant, de Jean Hyppolite et bien d’autres volumes que nous commentions parfois ensemble. À sa mort, j’ai hérité de certains d’entre eux et j’ai relevé scrupuleusement les annotations manuscrites marginales de sa main dans une série de textes dotés de présentations et d’un apparat critique, que j’ai intitulés Francis Pasche, Marginalia, §1 à 8 : ils sont désormais versés et consultables sous forme d’imprimés laser A4 à la Bibliothèque Francis Pasche. J’ai parfois cru bon de recopier également ses annotations à certains textes classiques de psychanalyse théorique et clinique.
Les réceptions lors desquelles nous nous rencontrions, étaient, inévitablement, l’occasion de nous offrir parfois des livres : il m’avait offert du Pierre Grimal (Dictionnaire de mythologie grecque et romaine), du Meyerson (La Déduction relativiste qu’il était allé personnellement m’acheter chez Vrin alors que j’écrivais mon mémoire de maîtrise), sans oublier, bien sûr, du Freud (la nouvelle traduction revue par Denise Berger du classique L’Interprétation des rêves). De mon côté, je lui avais retrouvé un exemplaire de Kostas Axelos, Héraclite et la philosophie, qui fut le dernier volume que je me souviens nettement lui avoir offert. Je prenais parfois des initiatives : je lui avais fait lire Arnold Reymond, Les Principes de la logique et la critique contemporaine qui l’avait beaucoup intéressé bien qu’il ait avoué en souriant à mon père (mathématicien de formation) ne pas comprendre certains exemples de logistique ou logique mathématique. Je me souviens de leur savoureuse conversation nocturne, dans le salon ovale de la rue de Prony, car mon père assurait qu’il les comprenait parfaitement ! J’ajoute que, malheureusement, je n’ai aujourd’hui aucun souvenir précis des exemples dont il était question.
Il avait été passionné par Auguste Comte à l’époque (1983-1985) où je rédigeai ma thèse sur ce dernier : il avait acheté La Vie d’Auguste Comte d’Henri Gouhier pour en avoir une idée plus exacte. Il était enchanté par le style fleuri de Gouhier, par son érudition. Il m’avait conseillé de lire Sarah Kofman dont il critiquait L’Enfance de l’art (je renvoie ici le lecteur au début de l’admirable conférence de Pasche sur L’Art et le syndrome) mais dont il appréciait Aberrations, le devenir-femme d’Auguste Comte.
Francis Pasche fréquenta personnellement certains philosophes : Jean-Paul Sartre et Maurice Merleau-Ponty, Pierre Boutang, Cornélius Castoriadis, Jean Granier et bien d’autres encore.
Une précision historique concernant les deux premiers noms de cette liste : Francis Pasche contribua à certains numéros des Temps modernes par des articles intitulés : Le Psychanalyste sans magie (réponse cinglante à un article de Lévi-Strauss qui assimilait abusivement le psychanalyste au chaman des sociétés primitives), La Sublimation, La Passion de la violence qui ne furent, hélas, repris ni dans les deux recueils parus de son vivant (À partir de Freud, éditions Payot, Bibliothèque scientifique, 1969 et Le Sens de la psychanalyse, éditions PUF, Le Fil rouge, 1988) ni dans celui posthume intitulé Le Passé recomposé (éditions PUF, Le Fil rouge, 1999). Cette dernière édition dirigée par Didier Anzieu alors que ce dernier était lui-même en train de mourir, d’où quelques coquilles fâcheuses qu’une relecture attentive eût évité, ainsi qu’une discutable répartition. Par la suite, constatant que Sartre se radicalisait, il prit ses distances avec lui et cessa de contribuer aux Temps modernes. Il considérait La Nausée comme ce que Sartre avait écrit de meilleur, jugeant ce roman supérieur à L’Être et le néant qu’il tenait pour un assemblage de dissertations. Sur Merleau-Ponty, son jugement était assez réservé philosophiquement : il pensait, comme moi, que ce dernier hésitait entre l’idéalisme et le réalisme sans parvenir à trancher. Il ne pensait pas que cette hésitation constante fût une stimulation réelle de l’intelligence philosophique. Elle lui semblait, au demeurant, caractériser tout le mouvement de la phénoménologie contemporaine depuis Husserl, mis à part Heidegger qui constituait un cas à part qu’il connaissait par l’étude classique d’Alphonse de Waelhens parue à Louvain en 1942. Sur son exemplaire de la Phénoménologie de la perception, dédicacé en 1945 par Merleau-Ponty, ce dernier avait conclu sa dédicace à Pasche en ajoutant (je cite de mémoire car j’ai aussi fait don de ce volume à la Bibliothèque Francis Pasche) : «…et avec l’espoir d’une prochaine discussion sur l’hallucination». C’était l’époque où Sartre comme Merleau-Ponty s’intéressaient à la psychologie de la forme, à la psychopathologie, avec lesquelles les avaient déjà un peu familiarisé leurs études de philosophie allemande contemporaine.
Sur Pasche et Boutang, j’ai raconté mes souvenirs dans mon article Pierre Boutang ex cathedra et je n’y reviendrai donc pas ici : ils avaient passé en voisin des vacances sur une île grecque et je connaissais leur mutuelle estime intellectuelle.
À partir de 1989, j’opérais parfois la saisie informatique et l’impression de ses manuscrits sur mon ordinateur HP150 (j’ai fait don de tout cela à la Bibliothèque Francis Pasche vers 2012) car Pasche refusait d’écrire à l’aide d’une machine, encore moins à l’aide d’un ordinateur qui était encore une machine peu répandue et d’un usage assez difficile. Il justifiait malicieusement son refus en le comparant à celui d’Octave Hamelin qui refusait qu’on lui installât l’électricité, considérant qu’il pouvait parfaitement écrire ses cours de l’E.N.S. à la bougie, je veux parler ici non seulement de ses fameux cours sur Descartes mais surtout de ceux sur Aristote (ces derniers rassemblés par Léon Robin mais qui contenaient, jusqu’à leur troisième édition de 1976 incluse, une fâcheuse lacune que j’avais corrigée et signalée à Vrin).
Lorsque j’étais invité à déjeuner ou à dîner à son appartement parisien de la rue de Prony, nous parlions inlassablement des Grecs, de la patristique, des gnostiques, de l’idéalisme allemand, des positivistes spiritualistes français, de Nietzsche («Ce cher Nietzsche !» s’était-il un soir exclamé, en réponse à une de mes questions historiques ou philosophiques, effrayant ma mère catholique pratiquante que le seul nom de Nietzsche inquiétait passablement), des structuralistes français qu’il considérait comme des sophistes.
Francis Pasche m’avait avoué que l’un de ses grands regrets était que la psychanalyse fût tenue en suspicion par la majorité des professeurs de philosophie ou, pire encore, incomprise par la plupart de ceux qui s’y intéressaient. Il s’attachait, pour sa part, à découvrir les prémisses des grands thèmes freudiens parmi les grands philosophes, à classer ceux-ci en fonction des résultats de la théorie et de la clinique psychanalytique. Ces deux tares de la philosophie française, étaient encore bien réelles peu de temps après sa mort. En 1997-1998, j’avais prêté à deux professeurs de la Sorbonne (dont je tairai ici le nom par discrétion) son article sur Spinoza (qui était au programme de l’agrégation cette année-là) et son article sur Descartes. Dans les deux cas, je n’obtins que des commentaires insignifiants, précautionneux, polis, glacés, distants.
Venons-en à présent au cœur de notre sujet. Francis Pasche pensait, si on souhaite un résumé commode de son axiologie en la matière, qu’il y a deux catégories de philosophes pouvant être distinguées dans l’histoire de la philosophie : ceux pour qui la réalité est réductible à la pensée et ceux qui reconnaissent à celle-là un caractère irréductible d’une part, souvent aporétique d’autre part. D’où son hostilité prononcée à l’encontre de Platon, Plotin et Hegel, à l’encontre aussi des structuralistes et de Lacan dont il m’avait confié n’apprécier, en fin de compte, que son De la psychose paranoïaque. D’où son admiration pour les penseurs de la contingence et de l’aporie : Aristote, saint Augustin, Duns Scot, Descartes, Pascal, Hume, Kant, Maine de Biran, Kierkegaard, Félix Ravaisson, Jules Lachelier, Émile Boutroux, Nietzsche, C.S. Peirce, Bergson, Wittgenstein.
On ne s’étonnera plus, après avoir lu ce qui précède, que l’auteur du Génie de Freud m’ait un jour dit que, s’il n’avait pas été psychanalyste, il eût probablement été metteur en scène de cinéma ou professeur de philosophie, ces trois métiers étant, selon lui, les plus beaux. Lorsqu’il employait ce dernier terme, je pense qu’il l’employait au sens antique grec, sens qui ne sépare jamais totalement l’élément plastique ou physique de l’élément moral ni de l’élément religieux. Les dichotomies introduites par la suite entre ces trois points de vue par le rationalisme occidental, n’existaient pas encore pour l’esprit antique.
25/02/2018 | Lien permanent
Dracula, 4 : La maison de Dracula d’Erle C. Kenton, par Francis Moury

 House of Dracula [La maison de Dracula] (É.-U., 1945) d’Erle C. Kenton est le dernier chef-d’œuvre décadent postérieur à l’âge d’or de 1931-1939 et aussi le dernier grand film fantastique de Kenton parvenu jusqu’à nous à l’époque en salles puisqu’on ignore tout de The Cat Creeps [inédit] (É.-U., 1946). Mais on se demande tout compte fait, avec le recul et tant Kenton a de talent, s’il ne faudrait pas englober dans ledit âge d’or sa période décadente et lui donner décidément les bornes 1931-1945 ! On ne le peut pas historiquement, c’est entendu mais esthétiquement, en revanche, il nous semble qu’on le peut largement ! On remercie Universal de nous présenter aussi ces passionnantes fleurs issues 15 ans plus tard des nobles racines qu’elle avait si bien plantées !Kenton reprend à peu près la structure (un savant fou comme moteur du rassemblement) de son précédent House of Frankenstein [La maison de Frankenstein] (É.-U., 1944) mais en inverse la dynamique narrative dans la mesure où toutes les pérégrinations et voyages divers en sont absents : les personnages mythiques viennent au médecin, ce n’est pas lui qui vient à eux. Et encore une fois le but est de les faire se rencontrer (= combattre) en un même lieu final les regroupant tous à la faveur d’un scénario démentiel et savoureux : le casting est non moins hallucinant et la brièveté du film, loin de le desservir, renforce naturellement son impact dramatique, sa nervosité fiévreuse, sa richesse gothique et surréaliste de tous les instants. À noter la fureur bestiale des foules dirigées par un voyou défiguré terrifiant et Lionel Atwill en chef de la police désabusé mais brutal à l’uniforme strict, règnant sur des bourgeois imbéciles et des brutes épaisses. À noter aussi la performance de l’actrice Janes Adams interprétant l’infirmière bossue, rangée au rang des autres monstres par la cruelle bande-annonce et celle d’Onslow Stevens en savant fou dont le physique évoque parfois celui d’ Antoine Balpêtré ! À noter enfin que certains plans de rêve proviennent de The Bride of Frankenstein [La fiancée de Frankenstein] (É.-U., 1935) de James Whale et que certains autres dans l’incendie final proviennent de The Ghost of Frankenstein [Le spectre de Frankenstein] (É.-U., 1942) d’Erle C. Kenton dans lequel c’est Chaney Jr. qui interprétait le monste et non pas Glenn Strange. Carradine et Chaney Jr. étonnants tous deux en personnages mythiques se considérant comme «malades» mais par nature «incurables» – sous réserve de l’indication fournie dans notre résumé, évidemment, concernant Carradine qui démentira cette présentation, en revanche habituelle concernant Talbot ! Et Glenn Strange aussi nerveux que dans le Kenton précédent, animant sournoisement ou humainement un être dont le maquillage est moins humain que celui de Karloff en 1931-1939. Disons-le franchement : House of Dracula peut bel et bien être considéré comme un aboutissement : il est davantage une réflexion ironique et cruelle, voire tragique, qu’un pastiche. Le film s’avance majestueusement vers la mort de (presque) tous et la destruction totale avec un certain romantisme à la fois glacé et brûlant, très original, une amertume et une noblesse sous-jacente, une violence graphique plus âpre aussi. Sa beauté transcende une fois encore son budget et le travail de l’équipe technique de Kenton est parfait une fois de plus. Le dernier véritable feu d’artifices produits par Universal.
House of Dracula [La maison de Dracula] (É.-U., 1945) d’Erle C. Kenton est le dernier chef-d’œuvre décadent postérieur à l’âge d’or de 1931-1939 et aussi le dernier grand film fantastique de Kenton parvenu jusqu’à nous à l’époque en salles puisqu’on ignore tout de The Cat Creeps [inédit] (É.-U., 1946). Mais on se demande tout compte fait, avec le recul et tant Kenton a de talent, s’il ne faudrait pas englober dans ledit âge d’or sa période décadente et lui donner décidément les bornes 1931-1945 ! On ne le peut pas historiquement, c’est entendu mais esthétiquement, en revanche, il nous semble qu’on le peut largement ! On remercie Universal de nous présenter aussi ces passionnantes fleurs issues 15 ans plus tard des nobles racines qu’elle avait si bien plantées !Kenton reprend à peu près la structure (un savant fou comme moteur du rassemblement) de son précédent House of Frankenstein [La maison de Frankenstein] (É.-U., 1944) mais en inverse la dynamique narrative dans la mesure où toutes les pérégrinations et voyages divers en sont absents : les personnages mythiques viennent au médecin, ce n’est pas lui qui vient à eux. Et encore une fois le but est de les faire se rencontrer (= combattre) en un même lieu final les regroupant tous à la faveur d’un scénario démentiel et savoureux : le casting est non moins hallucinant et la brièveté du film, loin de le desservir, renforce naturellement son impact dramatique, sa nervosité fiévreuse, sa richesse gothique et surréaliste de tous les instants. À noter la fureur bestiale des foules dirigées par un voyou défiguré terrifiant et Lionel Atwill en chef de la police désabusé mais brutal à l’uniforme strict, règnant sur des bourgeois imbéciles et des brutes épaisses. À noter aussi la performance de l’actrice Janes Adams interprétant l’infirmière bossue, rangée au rang des autres monstres par la cruelle bande-annonce et celle d’Onslow Stevens en savant fou dont le physique évoque parfois celui d’ Antoine Balpêtré ! À noter enfin que certains plans de rêve proviennent de The Bride of Frankenstein [La fiancée de Frankenstein] (É.-U., 1935) de James Whale et que certains autres dans l’incendie final proviennent de The Ghost of Frankenstein [Le spectre de Frankenstein] (É.-U., 1942) d’Erle C. Kenton dans lequel c’est Chaney Jr. qui interprétait le monste et non pas Glenn Strange. Carradine et Chaney Jr. étonnants tous deux en personnages mythiques se considérant comme «malades» mais par nature «incurables» – sous réserve de l’indication fournie dans notre résumé, évidemment, concernant Carradine qui démentira cette présentation, en revanche habituelle concernant Talbot ! Et Glenn Strange aussi nerveux que dans le Kenton précédent, animant sournoisement ou humainement un être dont le maquillage est moins humain que celui de Karloff en 1931-1939. Disons-le franchement : House of Dracula peut bel et bien être considéré comme un aboutissement : il est davantage une réflexion ironique et cruelle, voire tragique, qu’un pastiche. Le film s’avance majestueusement vers la mort de (presque) tous et la destruction totale avec un certain romantisme à la fois glacé et brûlant, très original, une amertume et une noblesse sous-jacente, une violence graphique plus âpre aussi. Sa beauté transcende une fois encore son budget et le travail de l’équipe technique de Kenton est parfait une fois de plus. Le dernier véritable feu d’artifices produits par Universal.
10/03/2010 | Lien permanent
Bibliographie stalkérienne de Francis Moury : études d’histoire et d’esthétique du cinéma

 1. Der Golem, wie er in die Welt kam [Le Golem] (All., 1920) de Paul Wegener et Carl Boese.
1. Der Golem, wie er in die Welt kam [Le Golem] (All., 1920) de Paul Wegener et Carl Boese. 2. Nosferatu, eine symphonie des grauens [Nosferatu le vampire] (All., 1922) de F. W. Murnau.
2. Nosferatu, eine symphonie des grauens [Nosferatu le vampire] (All., 1922) de F. W. Murnau. 3. Phantom de F. W. Murnau (All., 1922).
3. Phantom de F. W. Murnau (All., 1922). 4. Faust de F. W. Murnau (All., 1926).
4. Faust de F. W. Murnau (All., 1926). 5. Metropolis (All., 1927) de Fritz Lang.
5. Metropolis (All., 1927) de Fritz Lang.1930 – 1940
 6. M le maudit [M] de Fritz Lang (All., 1931).
6. M le maudit [M] de Fritz Lang (All., 1931). 7. Dracula (É.-U., 1931) de Tod Browning plus version espagnole (É.-U., 1931) de George Melford.
7. Dracula (É.-U., 1931) de Tod Browning plus version espagnole (É.-U., 1931) de George Melford. 8. Dracula’s Daughter [La Fille de Dracula] (É.-U., 1936) de Lambert Hillyer.
8. Dracula’s Daughter [La Fille de Dracula] (É.-U., 1936) de Lambert Hillyer. 9. Coffret Detlef Sierk 1935-1937 in Le romantisme allemand de Douglas Sirk.
9. Coffret Detlef Sierk 1935-1937 in Le romantisme allemand de Douglas Sirk.1940 – 1950
 10. Son of Dracula [Le Fils de Dracula] (É.-U., 1943) de Robert Siodmak.
10. Son of Dracula [Le Fils de Dracula] (É.-U., 1943) de Robert Siodmak. 11. House of Dracula [La Maison de Dracula] (É.-U., 1945) d’Erle C. Kenton.
11. House of Dracula [La Maison de Dracula] (É.-U., 1945) d’Erle C. Kenton.1950 – 1960
 12. Coffrets Douglas Sirk période américaine 1953-1959 in Le romantisme allemand de Douglas Sirk.
12. Coffrets Douglas Sirk période américaine 1953-1959 in Le romantisme allemand de Douglas Sirk. 13. La Nuit du chasseur [Night of the Hunter] (É.-U., 1955) de Charles Laughton.
13. La Nuit du chasseur [Night of the Hunter] (É.-U., 1955) de Charles Laughton. 14. Kiss Me Deadly [En quatrième vitesse] (É.-U., 1955) de Robert Aldrich.
14. Kiss Me Deadly [En quatrième vitesse] (É.-U., 1955) de Robert Aldrich. 15. L'Ultime dyptique américain de Fritz Lang : La Cinquième victime [While the City Sleeps] (É.-U., 1956) de Fritz Lang et Invraisemblable vérité [Beyond a Reasonnable Doubt] (É.-U., 1956) de Fritz Lang.
15. L'Ultime dyptique américain de Fritz Lang : La Cinquième victime [While the City Sleeps] (É.-U., 1956) de Fritz Lang et Invraisemblable vérité [Beyond a Reasonnable Doubt] (É.-U., 1956) de Fritz Lang. 16. Nightfall (É.-U., 1956) de Jacques Tourneur.
16. Nightfall (É.-U., 1956) de Jacques Tourneur. 17. Night of the Demon / Curse of the Demon [Rendez-vous avec la peur] (G.-B., 1957) de Jacques Tourneur.
17. Night of the Demon / Curse of the Demon [Rendez-vous avec la peur] (G.-B., 1957) de Jacques Tourneur. 18. Les Sentiers de la gloire [Path of Glory] (É.-U., 1957) de Stanley Kubrick.
18. Les Sentiers de la gloire [Path of Glory] (É.-U., 1957) de Stanley Kubrick. 19. The Two Faces of Dr. Jekyll [Les deux visages du Dr. Jekyll] (G.-B., 1959) de Terence Fisher.
19. The Two Faces of Dr. Jekyll [Les deux visages du Dr. Jekyll] (G.-B., 1959) de Terence Fisher. 20. Odds against Tomorrow [Le Coup de l’escalier] (É.-U., 1959) de Robert Wise.
20. Odds against Tomorrow [Le Coup de l’escalier] (É.-U., 1959) de Robert Wise. 21. El vampiro [Les proies du vampire] (Mexique, 1957) de Fernando Méndez.
21. El vampiro [Les proies du vampire] (Mexique, 1957) de Fernando Méndez. 22. Dracula / Horror of Dracula [Le cauchemar de Dracula] (G.-B., 1958) de Terence Fisher.
22. Dracula / Horror of Dracula [Le cauchemar de Dracula] (G.-B., 1958) de Terence Fisher.1960 – 1970
 23. The Brides of Dracula [Les Maîtresses de Dracula] (G.-B., 1960) de Terence Fisher.
23. The Brides of Dracula [Les Maîtresses de Dracula] (G.-B., 1960) de Terence Fisher. 24. Pit and the Pendulum [La Chambre des tortures] (É.-U., 1961) de Roger Corman.
24. Pit and the Pendulum [La Chambre des tortures] (É.-U., 1961) de Roger Corman. 25. The Miracle Worker [Miracle en Alabama] (É.-U., 1962) d’Arthur Penn.
25. The Miracle Worker [Miracle en Alabama] (É.-U., 1962) d’Arthur Penn. 26. Ivanovo detstvo [L’Enfance d’Ivan] (U.R.S.S., 1962) d’Andreï Tarkovski.
26. Ivanovo detstvo [L’Enfance d’Ivan] (U.R.S.S., 1962) d’Andreï Tarkovski. 27. La Boulangère de Monceau (FR, 1962) et La Carrière de Suzanne (FR, 1964) d’Éric Rohmer.
27. La Boulangère de Monceau (FR, 1962) et La Carrière de Suzanne (FR, 1964) d’Éric Rohmer. 28. Lord of the Flies [Sa Majesté des mouches / Le Seigneur des mouches] (G.-B., 1963) de Peter Brook.
28. Lord of the Flies [Sa Majesté des mouches / Le Seigneur des mouches] (G.-B., 1963) de Peter Brook. 29. Danza macabra [Danse macabre] (Ital.-Fr., 1963) d’Antonio Margheriti.
29. Danza macabra [Danse macabre] (Ital.-Fr., 1963) d’Antonio Margheriti. 30. Dracula Prince of Darkness [Dracula prince des ténèbres] (G.-B., 1965) de Terence Fisher.
30. Dracula Prince of Darkness [Dracula prince des ténèbres] (G.-B., 1965) de Terence Fisher. 31. Andrey Ryoublov [Andreï Roublev] (U.R.S.S., 1966) d’Andreï Tarkovski.
31. Andrey Ryoublov [Andreï Roublev] (U.R.S.S., 1966) d’Andreï Tarkovski. 32. Blow Up [Blow-Up / Blowup] (Ital.-É.-U., 1966) de Michelangelo Antonioni.
32. Blow Up [Blow-Up / Blowup] (Ital.-É.-U., 1966) de Michelangelo Antonioni. 33. La collectionneuse d’Éric Rohmer (FR, 1966).
33. La collectionneuse d’Éric Rohmer (FR, 1966). 34. The Devil Rides Out / The Devil’s Bride [Les Vierges de Satan] (G.-B., 1967) de Terence Fisher.
34. The Devil Rides Out / The Devil’s Bride [Les Vierges de Satan] (G.-B., 1967) de Terence Fisher. 35. Dracula Has Risen from the Grave [Dracula et les femmes] (G.-B., 1968) de Freddie Francis.
35. Dracula Has Risen from the Grave [Dracula et les femmes] (G.-B., 1968) de Freddie Francis. 36. 2001 : l'odyssée de l'espace (É.-U., 1968) de Stanley Kubrick.
36. 2001 : l'odyssée de l'espace (É.-U., 1968) de Stanley Kubrick. 37. Ma nuit chez Maud (Fr., 1969) d’Éric Rohmer.
37. Ma nuit chez Maud (Fr., 1969) d’Éric Rohmer. 38. Journey to the Far Side of the Sun / Doppelganger [Danger : planète inconnue] (É.-U., 1969) de Robert Parrish.
38. Journey to the Far Side of the Sun / Doppelganger [Danger : planète inconnue] (É.-U., 1969) de Robert Parrish. 39. Taste the Blood of Dracula [Une Messe pour Dracula] (G.-B., 1969) de Peter Sasdy.
39. Taste the Blood of Dracula [Une Messe pour Dracula] (G.-B., 1969) de Peter Sasdy.1970 – 1980
 40. The Vampire Lovers (G.-B., 1970) de Roy Ward Baker.
40. The Vampire Lovers (G.-B., 1970) de Roy Ward Baker. 41. Les Sévices de Dracula [Twins of Evil] (G.-B., 1971) de John Hough.
41. Les Sévices de Dracula [Twins of Evil] (G.-B., 1971) de John Hough. 42. Cinéma et ontologie selon Roberto Rossellini : Augustin d’Hippone, Blaise Pascal, René Descartes, Cosme de Médicis (Ital., 1972-1973).
42. Cinéma et ontologie selon Roberto Rossellini : Augustin d’Hippone, Blaise Pascal, René Descartes, Cosme de Médicis (Ital., 1972-1973). 43. Le Genou de Claire (Fr., 1970) d’Éric Rohmer.
43. Le Genou de Claire (Fr., 1970) d’Éric Rohmer. 44. Solaris (U.R.S.S., 1972) d’Andreï Tarkovski.
44. Solaris (U.R.S.S., 1972) d’Andreï Tarkovski. 45.
45. 22/10/2011 | Lien permanent
Heidegger contre les robots. Sur Heidegger et la question du management de Baptiste Rappin, par Francis Moury

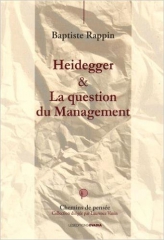 Acheter Heidegger et la question du management de Baptiste Rappin sur Amazon.
Acheter Heidegger et la question du management de Baptiste Rappin sur Amazon.«Un monde dominé par la Force est un monde abominable, mais le monde dominé par le Nombre est ignoble.»
Georges Bernanos, La France contre les robots (1946), in Essais et écrits de combat (Éditions Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade-NRF, 1995, tome 2), p. 1042.
«Il n'est pas besoin d'être prophète pour reconnaître que les sciences modernes dans leur travail d'installation ne vont pas tarder à être déterminées et pilotées par la nouvelle science de base, la cybernétique. [...] Cette science correspond à la détermination de l'homme comme être dont l'essence est l'activité en milieu social. [...] La fin de la philosophie se dessine comme le triomphe de l'équipement d'un monde en tant que soumis aux commandes d'une science technicisée et de l'ordre social qui répond à ce monde. [...] Fin de la philosophie signifie : début de la civilisation mondiale en tant qu'elle prend base dans la pensée de l'Occident européen.»
Martin Heidegger, La Fin de la philosophie et la tâche de la pensée (1964), conférence traduite et prononcée par Jean Beaufret en 1964 durant un colloque organisé à Paris par l'Unesco, éditée in Question IV en 1977, reproduite in Questions III + IV (Édition Gallimard, collection Tel, 1990), pp. 284 à 286.
 «Et si le management était à Heidegger ce que les Sophistes furent à Platon ?» Inattendue et savoureuse question. Le sous-titre Cybernétique, information et organisation à l'époque de la planétarisation précise l'ampleur philosophique, sociologique et politique de l'enjeu du livre. Avouons qu'à l'âge du transhumanisme, ils éveillent la curiosité la plus métaphysique comme la plus heideggerienne. Baptiste Rappin s'est appuyé, pour y répondre, sur trente-six livres et articles de Heidegger, rédigés de 1923 (Ontologie – Herméneutique de la factivité) à sa mort, y compris sur les Correspondances, par exemple celles avec Hanna Arendt et Karl Jaspers.
«Et si le management était à Heidegger ce que les Sophistes furent à Platon ?» Inattendue et savoureuse question. Le sous-titre Cybernétique, information et organisation à l'époque de la planétarisation précise l'ampleur philosophique, sociologique et politique de l'enjeu du livre. Avouons qu'à l'âge du transhumanisme, ils éveillent la curiosité la plus métaphysique comme la plus heideggerienne. Baptiste Rappin s'est appuyé, pour y répondre, sur trente-six livres et articles de Heidegger, rédigés de 1923 (Ontologie – Herméneutique de la factivité) à sa mort, y compris sur les Correspondances, par exemple celles avec Hanna Arendt et Karl Jaspers. On accède aux révélations espérées d'abord par une bibliographie sélective des œuvres citées de Heidegger puis par une division d'essence musicale des matières, revendiquée comme telle, placée sous les auspices cosmologiques de Pythagore et de sa célèbre harmonie des sphères. Elle comporte un Prélude dans lequel certaines thèses de Jean-François Mattéi sur l'histoire de la philosophie sont résumées et approuvées. Jean-François Mattéi qui est d'ailleurs régulièrement cité et, boucle bouclée, à nouveau convoqué au dernier chapitre. Les citations disséminées de ce dernier ne sont pas vraiment ad usum delphini : il faut, pour en tirer la substantifique moelle, les remettre en situation dans l'histoire de l'histoire de la philosophie (1). Sur les rapports entre les présocratiques, Platon, Aristote, Plotin et les gnostiques, on se doute que tout ne peut pas être résumé en une figure – fût-elle «pentadique» (voir p. 24) et quelques citations. Même remarque pour l'histoire de la logique formelle, qui ne peut pas être résumée en quelques pages. De tels résumés sont certes clairs et commodes (sauf exception : la définition du syllogisme à la p. 193 est incompréhensible) mais ils ne dispenseront pas le lecteur de recourir aux ouvrages classiques s'ils veulent les dominer. Ce prélude correspond donc bien à sa définition : il est riche de potentialités et on y sent déjà souffler l'esprit du philosophe de la Forêt noire, ce qui, en ce qui me concerne, est essentiel sinon même, aujourd'hui, l'essentiel.
C'est à partir du second chapitre (Présence de la cybernétique dans l'œuvre de Heidegger, pp. 63 et suivantes) de la seconde partie que l'étude prend réellement son envol et devient passionnante. Baptiste Rappin analyse la manière dont la cybernétique et le management sont critiqués par Heidegger en étudiant cinq de ses conférences des années 1960-1970. Dès lors, on mesure, presque en temps réel, en quoi Heidegger fut le digne héritier de G.W.F. Hegel et de Friedrich Nietzsche : c’est une même capacité à interpréter la dynamique du présent à la lumière dialectique du commencement grec qui les réunit pour l'éternité.
Au carrefour du capitalisme, du marxisme, du structuralisme, la grande affaire scientifique de l'après-guerre à partir de 1945 fut bien celle de la révolution informatique des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle, de la cybernétique de Norbert Wiener (1948) récupérée par la généralisation sociologique des instruments du «management» mis au point par l'américain Frederick Winslow Taylor vers 1910. Sa définition est, ici, celle donnée en 1970 par Henri Fayol : prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler (2). Cette révolution cybernétique, informatique et scientifique visait par essence l'universalité et fascina logiquement autant le monde libre que le bloc communiste marxiste : les philosophes, les ingénieurs informaticiens, les linguistes, les organisateurs industriels et scientifiques des deux blocs furent mobilisés pour organiser les sociétés sous l'angle de la gestion globale, interactive. Trouver des ponts philosophiques et techniques entre l'homme et la machine, concilier sous de nouveaux angles le capital et le travail, augmenter la puissance technique du calcul, augmenter celle des organisations sur les individus, étaient des éléments du programme cybernétique de management du réel industriel, civil, scientifique, financier et militaire. Lorsque Heidegger critique la cybernétique, il tient philosophiquement compte de cette visée mondiale, par-delà la scission contingente de la bipolarité politique dans laquelle il vivait. Rechercher la cause métaphysique de la décadence du «logos» en calcul : c'est un des aspects du projet métaphysique de Martin Heidegger dès la fin de la Première Guerre mondiale. L'intérêt du livre de Baptiste Rapin est de montrer en quoi cette enquête heideggerienne fut aussi déterminante dans la constitution de son ontologie phénoménologique que ses recherches purement métaphysiques et phénoménologiques.
Ces cinq conférences de Heidegger constituent la matière disséquée dans la troisième partie du livre de Baptiste Rappin. En voici la bibliographie chronologique par date de rédaction :
– Langue de tradition et langue technique (conférence de 1962)
– La Fin de la philosophie et la tâche de la pensée (conférence de 1964)
– L'Affaire de la pensée (conférence de 1965)
– Entretien accordé au journal allemand Der Spiegel (1966)
– La Provenance de l'art et la destination de la pensée (1967)
Quelle définition peut-on donner de la cybernétique ? On peut dire qu'elle est l'héritière de la sophistique, ce qui placerait Heidegger par rapport à elle, selon Baptiste Rappin, dans la situation où fut Platon par rapport aux Sophistes : «La cybernétique, loin du fracas tonitruant des bombes atomiques, opère en silence la réduction des bruits dans la tranquillité circulaire des boucles de rétroaction. Elle prépare le monde paisible de la gouvernance qui succédera à la belligérance des États souverains. Héritière, par la maîtrise des codes, des effets rhétoriques de la sophistique; par l'attention aux inputs, de la philosophie sensualiste; par la planification des finalités, de la technoscience moderne, la cybernétique représente le double de la philosophie à l'époque de la fin de la philosophie» (p. 99).
Heidegger considère la cybernétique comme la conséquence de l'erreur métaphysique occidentale. Conséquence placée au même niveau et mise sur le même plan que ces autres conséquences qu'étaient l'oubli de l'être au profit de l'étant, la contagion démocratique, le mercantilisme et le règne de l'argent, la prédominance de la technique sur l'art, le remplacement du langage faisant sens par celui véhiculant de l'information, celui du calcul logistique (puis logique mathématique) sur la philosophie (3).
De ce point de vue, la cybernétique fait cause commune avec la linguistique dans sa tentative de détruire le monde originaire de la philosophie en remplaçant la langue par une métalangue. Baptiste Rappin, après avoir démontré que les théories cybernétiques de l'information constituent, selon les termes mêmes de Heidegger en 1962, «l'agression la plus violente et la plus dangereuse contre le logos», cite (p. 220) cet extrait d’Acheminement vers la parole : «la métalinguistique est la métaphysique de la technicisation universelle de toutes les langues en un seul instrument, l'instrument unique d'information, fonctionnel et interplanétaire». En transformant la parole en instrument de transmission de messages binaires issus de la logique mathématique, la cybernétique informatique tend à modifier l'essence même de l'homme. Poussant la thèse un peu plus loin, Heidegger considère (dans son cours sur Parménide, en 1942-1943) que seule l'écriture manuelle est ontologiquement personnelle et humaine : à partir du moment où la machine à écrire se substitue à la main, une certaine impersonnalité s'empare, nolens volens, du locuteur. (4)
Quant au «management» (à ne surtout pas confondre avec l'administration d'une entreprise, car Baptiste Rappin soutient que ces deux termes distincts recouvrent aussi des finalités opposées), il constituerait, en somme, l'application pratique, le passage à l'acte du modèle promu par la cybernétique. Son histoire et sa critique sont nourries, détaillées, intéressantes : si on souhaitait un équivalent moderne de la sophistique, alors, assurément, le management en serait un, et de taille puisqu'il vise par essence à dominer, à contrôler et à augmenter son emprise, du fait même de sa visée pratique première : créer une organisation (qu'elle soit économique ou non) et augmenter sa puissance, dans un contexte de flux permanent, de différenciation constante, de catastrophe entropique. Montrer en quoi le platonisme, le néoplatonisme, le gnosticisme (tous les trois clairement bien que succinctement résumés) peuvent être utilisés pour ou contre ce mouvement postmoderne (Deleuze, Derrida, Lyotard sont aussi convoqués) et en quoi Heidegger se situe par rapport à eux tous, est un des aspects les plus inattendus de cette seconde section de la troisième partie. Une pensée de la technique, de l'organisation, du travail, du système réactif tel que Norbert Wiener l'avait conçue, me semblerait cependant convoquer deux noms ici presque absents : ceux de Spinoza (à cause du conatus) et de Hegel (à cause du travail comme négativité). Je remarque, à ce propos, que les études de Heidegger sur Hegel ne font pas partie de la bibliographie utilisée. Dommage, car il y aurait eu matière à quelques remarques intéressantes. Baptiste Rappin a utilisé le monumental traité (volontairement inédit du vivant de l'auteur, écrit en 1936-1938, traduit par François Fédier en 2013 pour Gallimard et la Bibliothèque de philosophie-NRF) intitulé Apports à la philosophie dans lequel l'organisation est un thème majeur. Mais Heidegger analyse d'une manière très variable le sujet dans ce traité : la technique des extraits cités, largement employée par Baptiste Rappin, trouve ici une limite car rien d'unifié ne peut s'en dégager. Heidegger n'est pas, contrairement à l'image entretenue depuis longtemps par certains de ses exégètes, ennemi de l'organisation ni hostile à la technique : simplement, il met en garde contre la possibilité d'une dérive philosophique manifestée par leur mauvais usage. Et il est assez fasciné par leur succès, annonçant les ambitions transhumanistes qu'il a clairement entrevues.
Nous pouvons considérer que ce livre de Baptiste Rappin, traitant en apparence d'un simple aspect de la pensée de Heidegger et bien que ce ne fût donc pas son objet premier, y introduit assez bien.
Est-ce à dire que nous pourrions négliger les introductions historiques de Georges Gurvitch (1930), Alphonse de Waelhens (1942), de Jean-Paul Sartre (1943), du père Maurice Corvez (1961), de Jean Beaufret (de 1946 à 1982) qui reposaient sur un plus petit corpus de textes heideggeriens ? Non, car ces textes qu'ils connurent, ils surent les lire et les étudier avec une pénétration indéniable. Dans le cas de Heidegger, il faut faire justement ce que fait Baptiste Rappin : revenir aux textes mêmes ou y venir à mesure qu'ils sont accessibles. Tant que l'édition des œuvres complètes n'est pas achevée ni totalement traduite, l'étude des textes de Martin Heidegger, des plus amples aux plus brefs, des plus célèbres aux plus méconnus, est encore devant nous comme tâche. Nous ne saurons vraiment quelle place et quel rang exacts peuvent être attribués à chaque texte qu'une fois que l'ensemble sera connu, pas avant. Toutes les études parues depuis la mort de Heidegger à nos jours sont des éléments utiles, analytiques, mais il n’n reste pas moins que e temps de la synthèse est prématuré, en dépit des nombreuses tentatives déjà effectuées.
Baptiste Rappin indique (dans sa très utile note n°201 de la p. 94) que l'édition allemande des œuvres complètes de Martin Heidegger est organisée d'une manière tétralogique :
–La première section rassemble les textes publiés du vivant de l'auteur,
–La deuxième section édite ses cours professés, rédigés ou préparés et les rédactions des auditeurs,
–La troisième section publie des textes volontairement ou non inédits du vivant de l'auteur,
–La quatrième section comportera des fragments et des notes.
Ni l'Allemagne ni la France ne disposant encore d'une édition achevée des œuvres complètes, il est donc, je le répète, absolument prématuré de vouloir en élaborer une interprétation d'ensemble. Nous ne pouvons que lui poser des questions ponctuelles, soigneusement circonscrites, relatives aux volumes déjà publiés et traduits. Le livre définitif sur le système de Martin Heidegger et son évolution existera peut-être un jour mais il est actuellement impossible de l'écrire : c'est un livre à venir. Quant à la division tétralogique allemande qui semble pertinente, elle ne pourrait avoir de réelle utilité que si, à l'intérieur de chaque section, l'ordre chronologique de rédaction était adopté comme critère de classement et de numérotation des tomes. Une édition critique doit, en effet, permettre au lecteur de savoir, à vue d'œil, à quelle période de rédaction appartient un texte publié, un cours, un texte inédit, un fragment ou une note. Il faut qu'elle permette de l'apercevoir physiquement sans effort excessif de recherche du volume rangé dans une bibliothèque. Raison pour laquelle je préconise qu'on classe systématiquement, dans une bibliothèque physique, selon l'ordre chronologique de rédaction par Heidegger les volumes traduits en français de ses Œuvres à mesure qu'ils sont publiés pour la Bibliothèque de philosophie éditée par la NRF qui n'a pas, pour sa part, adopté cette division tétralogique, ce qui, en somme, facilite l'opération préconisée.
Passons à présent aux quelques remarques d'usage sur la présentation matérielle de ce volume. Les mots allemands, grecs et latins sont systématiquement traduits lorsqu'ils sont employés : ce livre est donc un outil précis pouvant servir d'initiation sémantique au vocabulaire philosophique couramment employé par Heidegger. Les références bibliographiques aux œuvres de Heidegger (notamment à celles publiées par la Bibliothèque de Philosophie-NRF des éditions Gallimard) sont présentées au début du livre dans leur ordre chronologique de rédaction, ce qui est très bien. Leurs titres sont abrégés en sigles constitués d'une, deux ou trois lettres, ce qui l'est moins. Si le lecteur n'a pas encore trop de mal à se souvenir que «P» = cours universitaire de Heidegger sur Parménide (1942-1943), il en aura peut-être davantage pour mémoriser que «AFP» = L'Affaire de la pensée (une conférence de 1965) mais, à mesure que la lecture progresse, on finit par retenir les sigles les plus fréquemment cités. Les quatre volumes des Questions ne sont pas datés comme les autres. Il était pourtant possible de dater chaque tome (même si l'édition Gallimard récente groupe deux tomes par volume) en indiquant, entre parenthèses, après la mention de chaque tome, la date de l'article le plus ancien en ouverture, celle du plus récent en fermeture, séparées par un trait d'union. Ce sont les traductions françaises les plus récentes qui sont citées et utilisées : nous sommes donc en présence d'un commode outil pédagogique. Bien qu'il ne couvre pas l'ensemble du corpus heideggerien, il en cite de nombreux extraits. Les références bibliographiques aux auteurs antiques, modernes et contemporains, sont, quant à elles, disséminées dans les notes. Une table des matières existe, mais aucun index des noms cités n’a été inclus, ce qui est toujours regrettable. Quelques relâchements de langue sont à signaler : «...le destin des deux catégories ne saurait être pris en vue qu'à travers leur intime proximité...» (en haut de la p. 94). Ce bizarre «pris en vue» (dont on se doute qu'il provient d'une traduction plus ou moins littérale de Heidegger) évoque une prise de vue photographique, mais pouvait être avantageusement remplacé par le simple participe passé «envisagé». Des coquilles disséminées, parfois même dans les citations : «...Cette section ne fit pas publiée...» (en haut de la p. 93) au lieu de «ne fut pas». Passons cependant sur ces défauts stylistiques et ces problèmes matériels mineurs tant l'intérêt du livre est évident. Dans le tableau n°3, enfin, intitulé Quelques lois de la logique symbolique à la p. 195, il faudrait rajouter mentalement entre crochets la négation [non pas] pour bien lire l'équivalence posée entre la formule de logique mathématique : z(x - y) = (zx – zy) et sa traduction exemplaire en langage normal : «Les Européens (les hommes mais non les femmes) = les Européens hommes mais [non pas] les Européens femmes».
Notes
(1) Exemple : p. 169, à propos de la théorie de la causalité chez Aristote, Baptiste Rappin cite un article de Jean-François Mattéi, Les Deux souches de la métaphysique chez Aristote et Platon (paru en 2000) dans lequel ce dernier affirme que : «au bout du
08/04/2016 | Lien permanent

























































