Rechercher : pommier girard
Nazisme et Révolution de Fabrice Bouthillon, par Jean-Luc Evard

 À propos de Fabrice Bouthillon, Nazisme et Révolution. Histoire théologique du national-socialisme. 1789-1989 (Fayard, coll. Commentaire, 2011).
À propos de Fabrice Bouthillon, Nazisme et Révolution. Histoire théologique du national-socialisme. 1789-1989 (Fayard, coll. Commentaire, 2011).06/02/2011 | Lien permanent
Bref séjour de Moury à Jérusalem

11/02/2005 | Lien permanent
Les Hésitations de Husserl, par Francis Moury
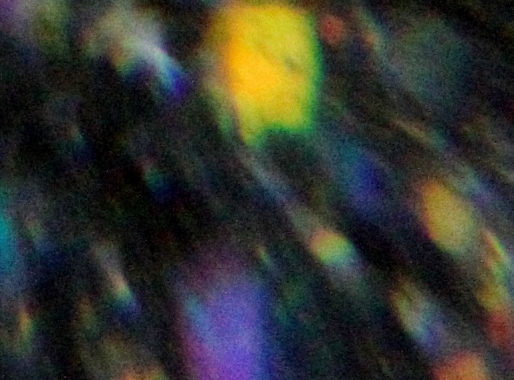
Jules Lachelier, Œuvres, tome II (Éditions Félix Alcan, 1933), p. 189 ou contribution de Lachelier à l'article Idée in André Lalande et société française de philosophie, Vocabulaire technique et critique de la philosophie (Éditions PUF, 1902-1923).
«Mais il faudrait presser encore une fois selon sa forme le mythe de la caverne qui est le mythe des mythes, enfin l'imagination non plus réglée mais réglante. Nous sommes tous en cette caverne; nous ne voyons et ne verrons jamais que des ombres. (...) Les ombres sont toutes vraies, comme elles paraissent. Toutes les ombres d'un homme expliquent la forme de l'homme, et en même temps la caverne, le feu, et la place même de l'homme enchaîné.»
Alain, Les Idées et les âges, tome II (Éditions Gallimard-NRF, 1927), pp. 210-213.
«Imaginez à présent une suite liée d'éclatements qui nous arrachent à nous-mêmes, qui ne laissent même pas à un «nous-mêmes» le loisir de se former derrière eux, mais qui nous jettent au contraire au-delà d'eux, dans la poussière sèche du monde, sur la terre rude, parmi les choses; imaginez que nous sommes ainsi rejetés, délaissés par notre nature même dans un monde indifférent, hostile et rétif : vous aurez saisi le sens profond de la découverte que Husserl exprime dans cette fameuse phrase : toute conscience est conscience de quelque chose.»
Jean-Paul Sartre, Situations, tome I, (Éditions Gallimard-NRF, 1947), p 32.
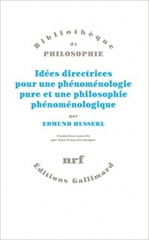 Acheter les Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique sur Amazon.
Acheter les Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique sur Amazon.Voici une nouvelle traduction en un fort volume par Jean-François Lavigne de ces célèbres Ideen (livre I paru en 1913) de Edmund Husserl (1859-1938), effectuée à partir du tome III en deux volumes (1976) de la seconde édition critique allemande parue dans les oeuvres complètes de Husserl ou Husserliana. La disposition en un volume de cette traduction 2018 est bien plus commode et intelligente que celle de l'édition allemande de 1976. Elle ajoute au texte de 1913 la traduction complémentaire des manuscrits inédits préparatoires et elle restitue les notes marginales, les corrections, les interrogations inscrites de 1913 à 1929 par Husserl sur ses exemplaires personnels de l'édition originale et des rééditions. Elle fournit en outre deux glossaires (français-allemand et allemand-français), une traduction du célèbre Index analytique des matières (pp. 676 à 701) établi en 1928 par Ludwig Landgrebe (1), des remarques sur la traduction de certains termes (par exemple la différence entre «réal», «réel», «effectif»), un index des noms propres cités (2) par Husserl. Du fait de ces additions et de leur rassemblement en un seul volume, cette nouvelle édition française culmine aux environs des 750 pages. Ce n'est pas pour autant que la traduction de Paul Ricoeur devient totalement inutile. Elle était souvent mieux écrite, plus agréable à lire et plus claire (façon de parler car la pensée de Husserl est tout sauf claire) que celle de Jean-François Lavigne qui sacrifie l'élégance à la précision scientifique la plus exigeante. Car Jean-François Lavigne met rigoureusement le lecteur français face à sa traduction dans la situation du lecteur allemand face au texte original allemand : c'est ce qu'il faut. Surtout, sa traduction corrige des erreurs, des lacunes, des contresens voire même des interprétations douteuses ou fautives qui rendent (sic transit gloria librorum) définitivement caduque celle de Paul Ricoeur. Mieux, elle corrige même des erreurs et des coquilles de l'édition critique allemande de 1976 lorsque cette dernière s'avère fautive et qu'on doit lui préférer une édition allemande antérieure, par exemple l'édition Niemeyer de 1922 (cf. pp. 231 et 318).
Les Husserliana sont aujourd'hui constituées par une quarantaine de volumes environ, éditant progressivement l'essentiel des 30 000 pages sténographiées (j'écris bien 30 000 et non pas le fautif «300 000» parfois indiqué par erreur dans les notices les plus hâtivement rédigées sur Husserl) composant ses livres, cours d'université, conférences, articles tels qu'ils sont recueillies par les Archives de l'Université catholique de Louvain, pour l'essentiel éditées par les éditions Martinus Nijhoff à la Haye. Certes Emmanuel Levinas, Paul Ricœur, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty lisaient l'allemand mais le temps fait son œuvre : nous connaissons forcément mieux Husserl aujourd'hui qu'à leur époque même si Maurice Merleau-Ponty pensait en allemand husserlien d'une manière si technique et à un tel point, les dernières années de sa vie, que j'ai cherché, dans les glossaires établis par Jean-François Lavigne, certains des termes allemands utilisés par Merleau-Ponty dans Le Visible et l'invisible (édition posthume Gallimard, NRF-Bibliothèque de philosophie, 1964) sans les y trouver. Mais il est cependant non moins probable que Merleau-Ponty, faute d'avoir vécu assez longtemps pour lire un certain nombre de textes husserliens édités puis traduits de 1950 à 2018, en ignorait partiellement «l'élaboration progressive» selon la formule de Lavigne. On mesure bien, lorsqu'on compare les Textes complémentaires (in seconde section) au texte original de ce tome I des Ideen de 1913 (in première section), à quel point cette formule est adaptée au cas philosophique de Husserl qui n'a cessé de se relire, de se ré-écrire sa vie durant. D'ailleurs en vain car ses corrections n'améliorent que rarement les éléments corrigés; ce sont surtout ses annotations marginales autocritiques qui valent la peine d'être découvertes.
Sur le fond, ce texte de 1913 (et les notes écrites de Husserl en marge de 1913 à 1929) permet d'observer, selon la formule de Lothar Kelkel et René Schérer (3) le cheminement qui conduit Husserl, comme sous l'empire d'une impérieuse nécessité, de la phénoménologie descriptive à l'idéalisme transcendantal (para-kantien, donc). Qu'on n'aille pas croire que les questions qu'il pose sont originales, contrairement à ce que Husserl assure. Il suffit de lire le célèbre article de Jules Lachelier, Psychologie et métaphysique (1885) pour les y trouver déjà formulées d'une manière bien plus claire et bien plus rigoureuse (4). Quant à l'idée d'une description nue du réel, nihil novi sub sole dans l'histoire de la philosophie, ni dans l'histoire littéraire. C'était déjà, par exemple, à l'occasion, celle d'écrivains du calibre de Stendhal (5). Ce projet de Husserl, en outre, hésite constamment. Il vise une région indéterminée entre psychologie et logique, ontologie métaphysique et science positive, aristotélisme et platonisme, kantisme et néo-kantisme. Il picore même à l'occasion un peu de malebranchisme et d'immatérialisme berkelyen. Enfin il est rationaliste mais de la manière la plus plate et la moins profonde : celle du logicisme mathématique. Un rationalisme certes adossé aussi bien à l'ontologie et à la logique aristotéliciennes telles que son maître Franz Brentano les lui enseigna) qu'aux Recherches logiques (1900-1901) et mathématiques ou aux Méditation cartésiennes (1929) de Husserl lui-même. Il faut historiquement bien mesurer que Husserl ne fut pas suivi par tous ses étudiants dans cette direction. Le concret et la «chose même» que certains d'entre eux avaient en vue n'était pas forcément ce que Husserl visait dans ces Ideen (6) qui aboutissent, pour leur part, à une sorte de mixte hésitant d'idéalisme et de réalisme, voire même, comme l'assure Jean-François Lavigne dans son avant-propos, à un idéalisme pur. Parmi les rédacteurs du volume 1 des Annales de philosophie et de recherche phénoménologique, paru en avril 1913 et dont ce livre I des Ideen constitue la contribution majeure, on trouve ainsi Max Scheler qui ne fut nullement idéaliste. Parmi les phénoménologues de la première heure, ceux du cercle de Göttingen, on trouve aussi le réaliste «essentialiste» Jean Hering (le contradicteur de Léon Chestov dont le débat est restitué dans la dernière section de l'édition originale de la Potestas Clavium de Chestov).
Ceux qui rêvaient de Husserl, en lisant les réactions, les interprétations, les prolongements (Emmanuel Levinas par exemple) qu'il suscita en France au vingtième siècle seront, à n'en pas douter, fondamentalement déçus par le fond de la pensée autant que par la forme de ce traité : des phrases interminables, parfois littéralement illisibles, en permanence semées d'incises contradictoires et dont les raisonnements ne cessent de s'annuler à mesure qu'ils tentent de se préciser. En guise de consolation, cette nouvelle édition Lavigne a le grand mérite de montrer que Husserl lui-même n'en était nullement satisfait. Il n'a cessé, en effet, sa vie durant, de critiquer, de raturer, de mettre entre guillemets ou entre parenthèses (au sens premier, pas au sens phénoménologique) des mots, des groupes de mots, des propositions, des paragraphes, voire même des pages entières de ce traité interminable, répétitif et qui n'aboutit à rien, tournant sempiternellement en rond à partir d'une intuition jamais transformée en philosophie réelle. C'est davantage pour la visée husserlienne (visée qui était déjà celle des Présocratiques et qui n'est donc pas particulièrement neuve : revenir aux choses elles-mêmes par-delà les préjugés et les dogmes) que pour la philosophie husserlienne, à peine constituable et encore moins constituée, qu'il faut, en somme, malgré tout, lire Husserl. Ce traité n'en est d'ailleurs pas un au sens universitaire du terme car ni sa méthodologie ni même sa terminologie ne sont fixées, ce qui eût été, qu'on nous accorde au moins cela, la moindre des choses ! On peut pourtant encore aujourd'hui s'immerger dans ce capharnaüm qui prétend déboucher sur une psychologie rationnelle (presque trois cents ans après la critique par Kant de celle de Wolff) dont le modèle principal serait... la théorie logico-mathématique des ensembles de G. Cantor (que Husserl considère, in §94, à la note 1 des pp. 289-290, comme étant le premier phénoménologue connu), dont les mathématiques modernes qu'on nous enseignait en classe de cinquième dans les années 1970, donnent une idée précise. Car l'évidence est bien là : c'est à cela que rêvait Husserl en créant ses néologismes inutiles et redondants (noèmes, noèses, eidétique, etc.) qui pourraient faire croire qu'il s'intéresse à la métaphysique alors qu'il ne s'intéresse qu'au fondement logique de la géométrie et des mathématiques. Cruelle déception pour les poètes nostalgiques des Idées platoniciennes ou bien simplement amoureux de la Diotime de Mantinée dans le Banquet de Platon !
Autre signe qui ne trompe pas : Husserl est redevable de l'ampleur historique du terme «phénoménologie» à G.W.F. Hegel qui n'est pas cité une seule fois dans ce traité de 1913. Cette désinvolture historique et philosophique est trop flagrante pour ne pas être signalée, ce que ne font d'ailleurs ni Husserl ni J.-F. Lavigne. Elle indique clairement que Husserl, par lui-même, ne fut pas rigoureux en dépit de son usage assez fréquent de ce dernier terme. La raison en est peut-être qu'il privilégiait le premier terme du titre hégélien Phénoménologie de l'esprit (1807) alors que, ainsi que le soulignait justement Bernard Bourgeois (7) en 1969, «La phénoménologie de l'esprit est la science du phénomène, de la manifestation, ob-jectivation, opposition, scission en soi-même de l'esprit qui se vit ainsi comme rencontre de l'Autre, c'est-à-dire comme conscience ou expérience. Cette expérience s'analyse d'abord selon ses moments abstraits, dont aucun, pris pour lui-même, n'existe réellement : (...) leur fondement réel, c'est toujours l'esprit, au sens plus précis que ce terme reçoit au chapitre VI, intitulé L'Esprit, et qui est bien le chapitre central de la Phénoménologie de l'esprit (...) ». Pour Husserl, au contraire, l'absolu pourrait bien être au commencement, dans la phénoménologie de la perception et non pas dans celle de l'Esprit au sens hégélien de ce dernier terme. Sans oublier non plus que, selon les Ideen I, §55 (p. 171), une réalité absolue serait équivalente à l'idée d'un carré rond alors que, tout au contraire, pour Hegel l'absolu est l'Esprit total synthétisant l'ensemble de ses manifestations phénoménologiques. Sur la pensée de l'absolu dans le système de Hegel, je recommande la lecture des cours (1930-1931) et séminaires (1938 et 1942) de Heidegger consacrés à G.W.F. Hegel, déjà disponibles en traduction chez Gallimard dans la collection des Oeuvres de Martin Heidegger éditée par la Bibliothèque de philosophie de la NRF.
Un exemple du manque de rigueur de Husserl, parmi des dizaines d'autres aisément relevables, est fourni, dans les Textes complémentaires, par l'appendice 30 sur substrat et essence, rédigé en 1918 (pp. 580-82 de l'édition originale allemande = pp. 549-53 de la traduction). Il est typique de la manière dont Husserl dissout la réalité sans être ensuite capable de la recomposer, encore moins de l'unifier. Husserl, pour cette raison, tourne sans cesse en rond dans une région qu'il nomme «ontologie formelle» et qui mélange d'une manière curieuse certaines notions d'ontologie à certaines notions de logique et de psychologie. C'est la même impression d'incomplétude que laissent les exemples concrets donnés par Husserl lui-même à l'appui de ses raisonnements. Ils hésitent constamment entre les diverses strates de la réalité sans pouvoir jamais les unifier : celui du pommier et du gazon (p. 272), celui de la galerie d'art de Dresde (en dépit du fait qu'il soit le seul réellement intéressant, p. 309), celui du Centaure (repris plusieurs fois et notamment p. 440), celui de la table (célèbre mais pourtant l'un des plus faibles du traité, p. 494), celui éminemment psychologique du souci (p. 507). Je dois ajouter que je partage globalement, après avoir lu les 750 pages de ce livre, l'avis de Wilhelm Wundt sur la philosophie de Husserl, cité avec regret par Husserl lui-même en note de la p. 417 : Husserl ne me semble pas, en tout cas ici (ce «ici» qui désigne tout de même son traité fondamental auquel il ne cessa de travailler sa vie durant), en dépit des apparences de rigueur qu'il se donne constamment la peine de revendiquer, à la hauteur de son ambition.
Ses héritiers allemands, au premier chef desquels Martin Heidegger et Max Scheler, et ses héritiers français, au premier chef desquels Jean-Paul Sartre (8) et Maurice Merleau-Ponty, me semblent, en somme, valoir nettement mieux que lui tant sur le fond que sur la forme. Ils furent capables de constituer des systèmes clairs (Heidegger, Scheler, Sartre) ou de questionner rigoureusement et clairement (comme Merleau-Ponty), ce dont Husserl s'avère pathétiquement incapable d'un bout à l'autre de ce traité. Ils ne trouvèrent d'ailleurs vraiment dans la phénoménologie de Husserl que ce qu'ils y apportèrent eux-mêmes ; cette dernière ne tint, relativement à leurs propres systèmes, que le rôle d'une sorte de liquide amniotique philosophique, si j'ose risquer l'image. Il faut cependant, ne serait-ce que pour mieux les lire génétiquement et historiquement, s'y retremper au moins une fois dans sa vie.
Notes
(1) Husserl n'était pas satisfait, précise en note Jean-François Lavigne, de celui établi par son étudiante Gerda Walther à l'occasion de la réédition de 1923. A l'occasion de la réédition de 1928, il confia donc ce soin à son assistant universitaire Ludwig Landgrebe. L'article de Rudolph Boehm, Husserl et l'idéalisme classique, in Revue philosophique de Louvain (tome 57 de août 1959, pp. 357-358) apporte l'information permettant de comprendre pourquoi Husserl n'en était pas satisfait (information que ne fournit pas Lavigne dans sa note) : Gerda Walther y avait constitué une entrée «idéalisme» et une entrée «idéalisme phénoménologique». Cette dernière était, à son tour, divisée en deux sections qui permettaient de comparer les passages plaidant pro ou contra une interprétation idéaliste du livre I des Ideen. C'est cela qui avait expressément déplu à Husserl. Je regrette donc l'absence, ici, de l'index de Gerda Walther qui demeure un document d'histoire de la philosophie qu'il faudrait pouvoir consulter en parallèle avec celui de Ludwig Landgrebe. Il faut en rendre au premier chef responsable l'éditeur allemand de la réédition critique de 1976 puisqu'elle constitue la base scientifique de cette traduction 2018.
(2) Jean-François Lavigne a limité l'index des noms cités au texte principal du livre I des Ideen. Je crois utile, afin que le lecteur prenne mieux la mesure de l'ensemble, d'ajouter ici un petit complément (non exhaustif) regroupant des citations réparties dans l'Avant-propos du traducteur (pp. I à XXXII), dans les Textes complémentaires et dans les Annexes (pp. 461 à 716) : Avenarius : XV, Aristote : 494-495 (en note), 500, 554-555, 654, 656, Berkeley : 634, Brentano : IX, XIX, 617, Comte : 57, Cohen (Hermann) : 489, Descartes : 143, Frege : 367 (en note), Freud : 257, Heidegger : 85, Hering (Jean) : 500, 656, Hume : 480, 515, Kant : 283, 438, 441, 489, 519, Locke : 633, Lotze : 517 (en note), Natorp : VI, XIII, 489, Platon : 473, Pseudo-Denys : 359, Pyrrhon : 70, Sextus Empiricus : 70, Stein (Edith) : I, XX, 451 (en note), Stuart Mill (John) : 70,
(3) Lothar Kelkel et René Schérer, Husserl (Éditions P.U.F., collection «Philosophes» fondée par Émile Bréhier, 1964), p. 7.
(4) Cf. Jules Lachelier, Psychologie et métaphysique (1885), in Jules Lachelier, Oeuvres, tome 1 (Éditions Félix Alcan, 1933), pp. 191-203 : «Mais comment la sensation peut-elle être à la fois le sujet et l'objet de la conscience ? Etc. (...)». Ces pages constituent d'avance une phénoménologie de la perception qui , tout comme celle de Husserl mais avec trente ans d'avance sur elle, s'appuient conjointement sur Aristote et Kant. La différence
22/05/2018 | Lien permanent
L'anarchisme chrétien de Jacques de Guillebon et Falk van Gaver

 À propos de Jacques de Guillebon et Falk van Gaver, L'anarchisme chrétien (L'Œuvre Éditions, 2012, puis DDB sous le titre Une histoire de l'anarchisme chrétien, avec une préface de Jean-Claude Guillebaud).
À propos de Jacques de Guillebon et Falk van Gaver, L'anarchisme chrétien (L'Œuvre Éditions, 2012, puis DDB sous le titre Une histoire de l'anarchisme chrétien, avec une préface de Jean-Claude Guillebaud).«Alf de Vileçon et Falk Glandaglaire : deux exemples de chancre commun qui partagent assurément toute médiocrité sans jamais trouver ensemble la moindre lumière de pensée. Aussi font-ils au plagiat bon accueil et vont-ils tenter de ravager de leurs lourdeurs la beauté qu'ils voient jaillir aux doctrines des penseurs fondamentaux. Prenez garde à ces grands gorilles lâchés dans leurs propres brumes, ils abâtardissent tout ce qu'ils approchent. Et lorsqu'ils parlent, parfois, d'anarchisme de droit divin, Vileçon et Glandaglaire pillent, déforment, scarifient, bistournent et corrompent la profondeur d'une pensée dont ils ne sont pas capables, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils insultent, tout en s'enfonçant psychotiquement, contre tous les faits, dans la certitude qu'ils sont inventeurs de ce qu'ils ont entendu, car il leur est une jouissance de compromettre la grandeur en la mêlant à la corruption de leur congénitale paresseuse cochonceté.»
Maxence Caron, L'Insolent (Nil Éditions, 2012), p. 538.*
Nous aurons utilement résumé le gros livre indigeste, ridicule (1), approximatif (2), littéralement truffé de fautes (3), comiquement romantique (voire ses toutes dernières lignes, page 398) et ne relevant pas, nous l'avions bien remarqué, de «cette objectivité vilaine qui tue la vie partout où elle sévit» (p. 357), livre en outre qualifié, sans honte, par leur ami Romaric Sangars pour Chonic'art [l'URL n'est plus valide, mais Jacques de Guillebon l'a repris sur son propre blog, comme il se doit] de «première «bible» de référence pour les mystiques et révolutionnaires radicaux du XXIe siècle», une bible donc qui leur a été inspirée, nous y reviendrons en note, par des voies ou des voix qui ne sont point seulement celles du Saint Esprit, de Messieurs Jacques de Guillebon, cacographe apocalyptologue de son état qui n'a toujours pas retrouvé son père malgré une multitude de tests ADN, quelques déterrements de figures paternelles de substitution comme celle de Philippe Muray et la bonne volonté touchante de sa maman d'adoption Chantal Delsol, Jacques de Guillebon donc, ce catholique furieusement christique et dont le moindre atome que dis-je, quark, mais surtout l'inimitable brushing, sont rebelles, qui s'imagine fréquenter Serge Netchaïev lorsqu'il trinque avec le salonnard polygraphe et communiste à l'orthodoxie extensible (puisqu'elle s'étend de L'Humanité à Valeurs actuelles) Jérôme Leroy, Jaques de Guillebon que nous n'osons plus présenter et Falk van Gaver fort heureusement moins connu que son frère siamois mais pas plus sérieux d'un point de vue intellectuel, auxquels La Nef donne du Jacques et du Falk à tour d'éditorial et qu'un plumitif tel que Philippe Verdin n'hésite pas à qualifier d'«archéologues de la révolte», bref, nous aurons fort utilement condensé notre propos et surtout celui de nos deux salonnards fols en Christ, prônant le bel idéal anarchiste alors qu'ils sont eux-mêmes des cerclistes, des raoutistes, des réseautistes et de coteristes émérites, en affirmant qu'il n'aurait jamais dû être écrit, ce gros livre, ce «recueil explosif» (p. 30) paraît-il, sauf, bien évidemment, en raison de l'impérieuse nécessité journalistique qui commande à nos deux anarchistes peut-être chrétiens, en tout cas à très fort tropisme publicitaire, de répandre leurs copiés-collés entrecoupés de consternantes banalités jusque dans les recoins les plus oubliés de la Chrétienté, et assurément dans les plus belles devantures des Procure où, paraît-il, ils donnent et même procurent quelques frissons à de vieilles bigotes ménopausées et, nous l'avons remarqué, à quelques vagues scribouillards qui leur lèchent complaisamment les sandales ou, comme Romaric Sangars, jouent à se prendre pour des Cosaques, beaucoup plus à l'aise avec la chopine qu'avec le sabre lorsqu'ils fomentent le renversement de l'État et même du Grand Ordre Mondial néo-libéral et esclavagiste chez Barak (29, rue Sambre et Meuse, dans le Xe arrondissement de Paris).
Jacques de Guillebon et Falk van Gaver, spécialistes auto-proclamés de l'anarchie et qui, n'en doutons pas un seul instant, l'ont illustrée courageusement d'une tout autre façon qu'en gribouillant, un soir de sortie bruyante de bar, un sigle rageur sur une façade de rue déserte, me font songer à l'exemple de Jack London (que nos deux benêts citent avec des trémolos à la page 361) s'immergeant dans la vie puante du peuple d'en bas tout en n'oubliant jamais, le moment venu de retrouver son intérieur confortable, de prendre une très longue douche.
Enfin !, se disent nos évangéliques rombières, enfin !, et comme je les comprends nos pauvres viragos !, comme j'aime leur exaltation de saintes pucelles à moustache ! Après nos chers Barbey, Hello (dont le portrait s'appuie sur les placides fumigations de Patrick Kéchichian), Bloy (un de ces «apocalyptiques bilieux», p. 110), Péguy (à peine abordé dans un chapitre qui lui est pourtant consacré, cf. pp. 112-22), Claudel (qui, apprenons-nous avec stupéfaction, «n'admettra la démocratie qu'en 1945 quand aura été élaborée à ses yeux une doctrine de production acceptable, celle de la coopérative, point nodal de l'anarchie», p. 112), Bernanos comiquement caractérisé comme étant un «guetteur de l'aube» (p. 126) (Bernanos encore qui, le pauvre, n'a été capable de créer en tant que romancier qu'un «seul habitant, un seul personnage, un seul médiateur : un seul personnage parce qu'un seul Médiateur», p. 125), Thoreau et son épigone hollywoodien Chris McCandless (p. 302), Jünger, «chevalier errant, mettant son épée et sa plume au service des causes justes ou perdues» (p. 303), Mounier qui, une fois qu'il ne plaît plus à nos deux anarques, est prié de déguerpir (et de quelle façon ! : «Peut-être eut-il (sic) mieux valu, pour la pensée bien entendu et seulement, que le jeune chef d'Esprit (sic) disparut (sic) pendant la guerre», p. 328), Ellul comparé à Corto Maltese (cf. p. 330), Georges (sic) Orwell (cf. p. 359), sorte de «critique écologiste avant la lettre du monde moderne» (p. 360), qui vous voudrez et surtout les sublimes Mirmidons de la Décroissance et du Partage Christique de la Grosse Galette, les moinillons-soldats d'Immédiatement menant la charge contre l'État policier (cf. pp. 391 et sq.), tante Marie-Enguerrande qui de sa vie n'a jamais manqué une seule communion et même Fabrice Hadjadj qui veut désormais toutes les enchaîner, voici, enfin, il était temps tout de même !, le nouveau sang catholique propulsé par un cœur à biturbine mariale, voici le nouveau cerveau de choc à double couche de cilice, taillé pour toutes les joutes verbales et auxquelles les plus fines subtilités aquinates ne résistent pas une seconde, Messieurs Jacques de Guillebon et Falk van Gaver, sortes de Bouvard et Pécuchet du catholicisme journalistique contemporain, Mordillat et Prieur qui n'attendent que vous, vous, mes amis, vous, pauvres badauds qui par milliers vous ruerez sur leurs livres ineptes, pour dépasser en gloire et surtout en ventes leurs illustres parrains, et qui jamais ne peuvent s'empêcher de répéter la plus consternante banalité pourvu qu'ils l'aient préalablement arrosée d'eau bénite et de quelques autres liquides moins rigoureusement homologués !
Et quel festival d'affirmations jamais étayées, de jolies phrases définitives s'appuyant sur des béquilles en caramel et tutoyant l'Empyrée ! : ainsi le XXe siècle pictural est «né là, dans cette recherche d'un idéal médiéval» (p. 213); Dada est dépeint si commodément comme une «entreprise d'anéantissement du néant» (p. 235); Gandhi est devenu par le miracle du baptême forcé «Christ indien et demi-nu», un «prophète, un saint, un martyr» (p. 239) et même, rendez-vous compte, un «décroissant avant l'heure» (p. 250); René Girard, la meilleure, à vrai dire l'unique citation de tous les cancres, évidemment pousse la chansonnette de la «rivalité mimétique» (p. 248; encore, p. 387, cette fois pour la pseudo-théorie du bouc émissaire); c'est encore le «Nazaréen» qui est devenu, allez savoir par quel mécanisme que les plus savants théologiens n'ont pas complètement identifié, un «prototype au centre» de «tous les prophètes et martyrs de l'ancienne comme de la nouvelle Alliance» (p. 252); c'est la «non-violence» qui «peut dire avec Jésus» qu'elle n'est pas venue apporter la paix, mais l'épée, et qui est dès lors et sans manières qualifiée de «révolution conservatrice selon Gandhi» (p. 262); c'est Vinoba confondu avec le Christ, ou bien le Christ se promenant en Inde, «en route par les chemins, souverain sans couronne et sans trône, sans capitale et sans armée, et même sans feu ni lieu, ainsi va le Roi des Pauvres» (p. 271); c'est la Tour Eiffel qualifiée de «Babel creuse et pointue [qui] est le chiffre du siècle qu'elle inaugure un jour de foire [...], sa prophétie, sa préfiguration jusqu'au palier nul et final, tous convergeant à la cime du rien. C'est l'anti-cathédrale, l'ouvrage de Satan, son échelle, pour sa chute finale...» (p. 274); c'est l'anarchie, sans blague, qui «ne se réduit pas à un slogan, ni la liberté à l'anarchie» : «Nous sentons bien, en croisant Lanza comme tant d'autres, que le terme anarchisme est réducteur, donc (sic) ils ne se réclamaient pas» (p. 281), etc. Car je pourrais à l'évidence multiplier par 100 les exemples de ces bêtises sentencieuses et empiler les unes sur les autres ces iréniques fumisteries que nos Sabines éternellement ravies continueraient de goûter la prose eunuque de Guillebon et Van Gaver, leur incroyable amateurisme, leur coupable imprécision, leur lamentable impressionnisme journalistique, en fin de compte leur unique talent, qui est celui de parvenir, un temps du moins, à sidérer les imbéciles, qu'ils gobent comme de petites souris à cerveau aussi hypothéqué que l'est le sexe des anges.
Ce gros livre de plus de 400 pages bouffé par les fautes comme la bure de Savonarole l'était par la fureur du penitentiam agite de la fin des Temps, si peu pensé qu'il en devient touchant, mal écrit, mal ou pas relu du tout, qui mélange tout et ne définit clairement rien du tout sinon la crasse inculture de ses auteurs, m'aura permis d'écrire, et ce sera espérons-le sa seule façon de passer à la postérité des cacographes où les places ne sont certes jamais comptées, l'une de mes critiques les plus courtes (notes non comprises, je dois bien me rattraper !), une longue phrase se décomposant en deux propositions l'une et l'autre négatives, que je m'empresse de vous exposer : tout d'abord, non, le christianisme n'est pas toute l'histoire de l'anarchisme (ou l'inverse, cf. p. 203 : «l'anarchie doit tout au catholicisme, comme l'un de ces innombrables libertins élevés dans leurs collèges devra aux Jésuites»), un anarchisme défini, génialement c'est sûr, comme une «tension vers l'anarchie» (p. 397), même si, malgré ses outrances d'inspiration athée, un Proudhon a pu affirmer que l'enseignement de Jésus était tout social, ni politique, ni théologique, même si un Félix Ortt a pu publier en 1903 un Manifeste anarchiste chrétien qui sent bon l’œcuménisme le plus dégoulinant; puisque cet anarchisme peut trouver, rappelons-le quand même, sa source pour le moins datée historiquement dans L'Unique et sa propriété (1845) de Max Stirner qui, apprenons-le à nos béotiens, exalte l'individu dans la récusation non seulement catégorique mais dûment étayée de toute conscience religieuse, morale, juridique ou politique, même si Stirner a pu prétendre, bizarrement, qu'il conformait son attitude à celle de Jésus dépassant l'État en l'ignorant; puisque cet anarchisme a trouvé son prolongement philosophique dans la lignée de l'athéisme de Feuerbach, sa mise en scène romanesque sous la plume de Tolstoï, sa traduction pour le moins violente, communiste, dans la carrière de Mikhaïl Bakounine qui servit de guide à Netchaïev et exalta son «amoralisme effrayant» (selon l'expression d'Henri Arvon) ainsi que nombre d'actes terroristes comme l'assassinat du tsar Alexandre II (1881) après plusieurs attentats manqués, du président de la République française Sadi Carnot (1894), du roi Umberto Ier d'Italie (1900) et du président des États-Unis d'Amérique William McKinley (1901), jusqu'aux sinistres agissements de la bande à Bonnot (1911-1913), et enfin son affadissement en littérature avec le fameux acte gratuit de Lafcadio tel que Gide en a peint les plates et ennuyeuses aventures dans Les caves du Vatican (1914) et, seconde et dernière réfutation, non, ce n'est pas en faisant de pratiquement tous les auteurs, anonymes ou pas qui, depuis l'invention de la peinture pariétale, ont tracé un signe et, pour les plus acharnés, écrit une demi-syllabe sur un bout d'os rongé, des anarchistes chrétiens voire catholiques, que messieurs Jack et Falk parviendront à rendre soluble dans l'eau plate du journalisme universalisant le plus commun et consternant l'irréductible singularité de certains des écrivains que, par leur bavardage consensuel, leurs images journalistiques d'un comique échevelé et leurs facilités adolescentes (4) aussi incongrues et vulgaires que des cagoles contemplant une carme déchaussée en pleine prière et tout juste dignes de relever les dialogues de quelque Martine chez les curés, ils abaissent et même auxquels ils prétendent faire courber l'échine pour venir laper la mélasse de l'écuelle commune, pour le coup marchande (car n'ayons aucun doute : ce genre de torchon trouve toujours sa place dans les cuisines des bigotes), où lions, gazelles, phacochères et même caniches permanentés sont confondus dans une joyeuse ménagerie de cirque.
Ma phrase était longue quoique claire, mais moins longue tout de même que l'unique phrase (5) s'étendant sur plusieurs centaines de pages et écrite à quatre mains (enfin, à plus de quatre mains, visiblement... (6)) ou plutôt pieds de messieurs Jacques de Guillebon et Falk van Gaver, commodément condensée de la façon suivante : la sottise et la prétention de l'imposteur n'ont aucune borne autre que matérielle ce qui, à tout le moins, est une limitation purement factuelle bien que fort utile.
Notes
* Pour la petite histoire, ouvrant ce soir, vendredi 20 juillet, mon exemplaire de ce livre, au hasard, comme on raconte que les Anciens ouvraient au hasard l'Énéide et y lisaient leur avenir, je suis tombé sur ces quelques lignes qui me choquent profondément, car c'est faire trop d'honneur à nos deux plagieurs que de les comparer à des gorilles.
(1) Pour s'en convaincre, je demande au lecteur de réaliser l'utile exercice consistant à lire à haute voix l'introduction de l'ouvrage, laquelle parvient à réaliser l'impeccable fusion de la sottise et de la prétention : «Nous n'avons reculé devant rien pour bâtir notre propos : nous avons usé de tous les moyens, même légaux, comme l'annexion, la reprise, le mélange, l'inspiration, l'effusion ou le détournement, pour parvenir à nos fins, en essayant, autant que possible, de rendre à chacun son dû», Jacques de Guillebon et Falk van Gaver, L'anarchisme chrétien (Éditions de l'Œuvre, 2012), p. 10. Nous constaterons plus bas que nos deux théologiens de la photocopieuse et de la coopérative christico-distributiste n'ont en effet reculé devant rien pour bâtir (drôle de construction toute bancroche) leur propos filandreux.
(2) Il est ainsi pour le moins révélateur que, pas une seule fois, Jack et Falk ne donnent la plus petite référence précise aux pages des ouvrages consultés, dont ils reproduisent de si larges extraits grâce aux vertus de quelque scan pour le moins défectueux (voir, page 64, les «delà» mis en place de «de la» ou, page 66, l'étrange «sueurs aînées»), qu'ils en constituent la bonne moitié du livre en question. Amusons-nous encore du fait que la même page présente, l'un sous l'autre, deux extraits de texte rigoureusement identiques (cf. p. 84).
(3) Je tiens à la disposition de nos Goliath qui depuis leur plus tendre jeunesse ont tondu, de leurs propres dents il est vrai fort longues, les moutons les plus intraitables ayant brouté l'herbe apocalyptique de l'île de Patmos, mon exemplaire de leur livre, tellement griffonné de rouge qu'il semble ruisseler du sang de tous les martyrs versé, au moins, depuis celui du tendre Abel.
(4) Les relever toutes et surtout les analyser me forcerait à écrire un livre en réponse à celui de nos deux derniers Mohicans millénaristes. Tout de même, dans l'ordre et le désordre provoqués par mon hilarité, voici quelques perles du pieux bavardage : «L'anarchie procède d'un sentiment que l'on pourrait dire océanique, c'est-à-dire qu'elle est tributaire de forces parfois inconscientes, parfois non mises au jour, que meut pourtant toujours un désir de s'extraire de la fausse contradiction moderne imposée par la domination des ethos socialistes et libéraux» (p. 12), où le sentiment océanique est surtout celui, visiblement, dans lequel se sont noyés nos deux apostoliques témoins qui ne s'embarrassent jamais, comme c'est commode tout de même, de définitions, préférant nous offrir quelque roborative illustration de leur absolue nullité stylistique, pour preuve : «Anarchie. Anarchisme. À un mot qui souffle aux esprits libres le grand vent de la liberté et de l'aventure, nous ne donnerons pas une définition doctrinale, une restriction théorique, mais nous l'embrasserons pleinement, à bras le corps et à pleine bouche, et nous nous laisserons emporter par lui, folle cavalcade, par des sentiers invus et des chants inouïs» (p. 23).
Nous frémissons lorsque, à mots couverts, nos buveurs de saint chrême affirment que le martyre, finalement
19/07/2012 | Lien permanent
Nazisme et Révolution de Fabrice Bouthillon

 À propos de Fabrice Bouthillon, Nazisme et Révolution. Histoire théologique du national-socialisme. 1789-1989 (Fayard, coll. Commentaire, 2011).
À propos de Fabrice Bouthillon, Nazisme et Révolution. Histoire théologique du national-socialisme. 1789-1989 (Fayard, coll. Commentaire, 2011). (1) Sur le salut nazi, Fabrice Bouthillon affirme : «Ce geste fasciste par excellence, qu’est le salut de la main tendue, n’est-il pas au fond né à Gauche ? N’a-t-il pas procédé d’abord de ces votes à main levée dans les réunions politiques du parti, avant d’être militarisé ensuite par le raidissement du corps et le claquement des talons – militarisé et donc, par là, droitisé, devenant de la sorte le symbole le plus parfait de la capacité nazie à faire fusionner, autour de Hitler, valeurs de la Gauche et valeurs de la Droite ? Car il y a bien une autre origine possible à ce geste, qui est la prestation de serment le bras tendu; mais elle aussi est, en politique, éminemment de Gauche, puisque le serment prêté pour refonder, sur l’accord des volontés individuelles, une unité politique dissoute, appartient au premier chef à la liste des figures révolutionnaires obligées, dans la mesure même où la dissolution du corps politique, afin d’en procurer la restitution ultérieure, par l’engagement unanime des ex-membres de la société ancienne, est l’acte inaugural de toute révolution. Ainsi s’explique que la prestation du serment, les mains tendues, ait fourni la matière de l’une des scènes les plus topiques de la révolution française – et donc aussi, qu’on voie se dessiner, derrière le tableau par Hitler du meeting de fondation du parti nazi, celui, par David, du Serment du Jeu de Paume» (p. 171).(2) «À partir de 1918, il n’est donc plus contestable qu’une voie particulière s’ouvre dans l’histoire de l’Europe pour l’une des nations qui la composent. Mais c’est la voie française. Parce que, sur le continent, pour la France, et pour la France seulement, la victoire pérennise alors la réconciliation de la Gauche et de la Droite qui s’était opérée dans l’Union sacrée, le clairon du 11 novembre ferme pour elle l’époque qui s’était ouverte avec la Révolution, et la République devient aussi légitime à Paris que la monarchie avait pu l’être avant 1789. Mais partout ailleurs sur le continent, c’est la défaite, dès 1917 pour la Russie, en 1918 pour l’Allemagne, en 1919, autour du tapis vert, pour l’Italie» (p. 107). Cet autre passage éclaire notre propos : «La période qui va de 1789 à 1914 avait été dominée par la séparation de la Gauche et de la Droite provoquée par la révolution française, et l’Allemagne avait perdu la chance que l’union sacrée lui avait donnée de refermer cette brèche. Du coup, la logique de la situation créée par la Révolution perdure, s’amplifie, se durcit : à Droite, la brutalisation exacerbe les nationalismes, à Gauche, elle surexcite l’universalisme, jusqu’à en tirer le bolchevisme. Moyennant quoi, la nécessité de mettre un terme à cette fracture se fait, au même rythme, plus impérieuse» (p. 197).(3) «Rétablir l’Empire, réunir l’extrême Gauche et l’extrême Droite : Hitler aussi s’est donné ces deux objectifs, et la parenté de son entreprise avec celle de Napoléon ne doit donc rien au hasard. Elle vient de ce que le nazisme est né de l’effondrement révolutionnaire du katekhon aussi directement que le bonapartisme en est sorti. Comme ce qui se passe en Allemagne en 1933 vise à combler le gouffre, un moment refermé en 1914, mais rouvert dès 1918, qui béait sous la politique européenne depuis qu’en 1789, la Révolution avait mis un terme au prolongement que, durant près de quatorze siècles, le régime de Chrétienté avait procuré à l’Empire romain, la dimension antichristique du nazisme en découle immédiatement, faite d’opposition radicale au christianisme et de ressemblance avec lui, de ressemblance avec lui pour cause d’opposition radicale à lui» (pp. 262-3). Auparavant, l'auteur aura évoqué, tirant profit des thèses bien connues de René Girard (cf. p. 198) sur la violence mimétique, la volonté (et son exécution) d'exterminer les Juifs par une analyse du gouffre en question et des façons pour le moins radicales de le combler : «La Droite continentale tient qu’on ne peut quitter le contrat ancien, qu’il est en fait impossible de déchirer définitivement; la Droite insulaire [avec Burke], elle, démontre qu’on ne peut parvenir à un contrat nouveau. Or la Révolution s’étant pourtant bel et bien produite, il en résulte qu’on se trouve dans un état limbaire, intermédiaire entre ces deux vérités. On est entre l’Ancien Régime, chrétien, où la Victime, sur le sacrifice de laquelle reposait en dernière analyse tout l’ordre social, depuis la mise en place de l’augustinisme politique, était le Christ, régime qu’on ne peut totalement oublier – et le nouveau contrat social, qui, par hypothèse, ne devra plus rien au christianisme, mais auquel on ne peut atteindre. Eh bien, la solution intermédiaire est de refonder l’unité sur la haine du Juif : ce n’est plus le régime ancien, ça tient donc du nouveau; mais ce n’est pas un régime absolument nouveau, et ça tient donc de l’ancien : puisque dans l’ancien, en la personne du Christ, déjà la victime était juive» (p. 199).(4) Ainsi du rapprochement opéré par l'auteur entre Eva Braun / Adolf Hitler et Ève / Adam, cf. p. 251-2.(5) «En dictant son testament politique, Hitler visait à s’ériger en une espèce de dieu; faire de lui le Diable, comme y concourent avec ensemble de nos jours les médias, politiques et institutions d’enseignement, c’est l’aider à atteindre son but. S’il y avait cependant une leçon à retenir de la théologie de l’Antéchrist, ce serait pourtant que du mal, il n’a été qu’une des figures, et qu’il y aura pire – un pire que peu fort bien servir cette espèce de sacralisation perverse dont notre époque le fait jouir, grosse d’effets en retour au bout desquels nous ne sommes probablement pas rendus» (p. 268).
(1) Sur le salut nazi, Fabrice Bouthillon affirme : «Ce geste fasciste par excellence, qu’est le salut de la main tendue, n’est-il pas au fond né à Gauche ? N’a-t-il pas procédé d’abord de ces votes à main levée dans les réunions politiques du parti, avant d’être militarisé ensuite par le raidissement du corps et le claquement des talons – militarisé et donc, par là, droitisé, devenant de la sorte le symbole le plus parfait de la capacité nazie à faire fusionner, autour de Hitler, valeurs de la Gauche et valeurs de la Droite ? Car il y a bien une autre origine possible à ce geste, qui est la prestation de serment le bras tendu; mais elle aussi est, en politique, éminemment de Gauche, puisque le serment prêté pour refonder, sur l’accord des volontés individuelles, une unité politique dissoute, appartient au premier chef à la liste des figures révolutionnaires obligées, dans la mesure même où la dissolution du corps politique, afin d’en procurer la restitution ultérieure, par l’engagement unanime des ex-membres de la société ancienne, est l’acte inaugural de toute révolution. Ainsi s’explique que la prestation du serment, les mains tendues, ait fourni la matière de l’une des scènes les plus topiques de la révolution française – et donc aussi, qu’on voie se dessiner, derrière le tableau par Hitler du meeting de fondation du parti nazi, celui, par David, du Serment du Jeu de Paume» (p. 171).(2) «À partir de 1918, il n’est donc plus contestable qu’une voie particulière s’ouvre dans l’histoire de l’Europe pour l’une des nations qui la composent. Mais c’est la voie française. Parce que, sur le continent, pour la France, et pour la France seulement, la victoire pérennise alors la réconciliation de la Gauche et de la Droite qui s’était opérée dans l’Union sacrée, le clairon du 11 novembre ferme pour elle l’époque qui s’était ouverte avec la Révolution, et la République devient aussi légitime à Paris que la monarchie avait pu l’être avant 1789. Mais partout ailleurs sur le continent, c’est la défaite, dès 1917 pour la Russie, en 1918 pour l’Allemagne, en 1919, autour du tapis vert, pour l’Italie» (p. 107). Cet autre passage éclaire notre propos : «La période qui va de 1789 à 1914 avait été dominée par la séparation de la Gauche et de la Droite provoquée par la révolution française, et l’Allemagne avait perdu la chance que l’union sacrée lui avait donnée de refermer cette brèche. Du coup, la logique de la situation créée par la Révolution perdure, s’amplifie, se durcit : à Droite, la brutalisation exacerbe les nationalismes, à Gauche, elle surexcite l’universalisme, jusqu’à en tirer le bolchevisme. Moyennant quoi, la nécessité de mettre un terme à cette fracture se fait, au même rythme, plus impérieuse» (p. 197).(3) «Rétablir l’Empire, réunir l’extrême Gauche et l’extrême Droite : Hitler aussi s’est donné ces deux objectifs, et la parenté de son entreprise avec celle de Napoléon ne doit donc rien au hasard. Elle vient de ce que le nazisme est né de l’effondrement révolutionnaire du katekhon aussi directement que le bonapartisme en est sorti. Comme ce qui se passe en Allemagne en 1933 vise à combler le gouffre, un moment refermé en 1914, mais rouvert dès 1918, qui béait sous la politique européenne depuis qu’en 1789, la Révolution avait mis un terme au prolongement que, durant près de quatorze siècles, le régime de Chrétienté avait procuré à l’Empire romain, la dimension antichristique du nazisme en découle immédiatement, faite d’opposition radicale au christianisme et de ressemblance avec lui, de ressemblance avec lui pour cause d’opposition radicale à lui» (pp. 262-3). Auparavant, l'auteur aura évoqué, tirant profit des thèses bien connues de René Girard (cf. p. 198) sur la violence mimétique, la volonté (et son exécution) d'exterminer les Juifs par une analyse du gouffre en question et des façons pour le moins radicales de le combler : «La Droite continentale tient qu’on ne peut quitter le contrat ancien, qu’il est en fait impossible de déchirer définitivement; la Droite insulaire [avec Burke], elle, démontre qu’on ne peut parvenir à un contrat nouveau. Or la Révolution s’étant pourtant bel et bien produite, il en résulte qu’on se trouve dans un état limbaire, intermédiaire entre ces deux vérités. On est entre l’Ancien Régime, chrétien, où la Victime, sur le sacrifice de laquelle reposait en dernière analyse tout l’ordre social, depuis la mise en place de l’augustinisme politique, était le Christ, régime qu’on ne peut totalement oublier – et le nouveau contrat social, qui, par hypothèse, ne devra plus rien au christianisme, mais auquel on ne peut atteindre. Eh bien, la solution intermédiaire est de refonder l’unité sur la haine du Juif : ce n’est plus le régime ancien, ça tient donc du nouveau; mais ce n’est pas un régime absolument nouveau, et ça tient donc de l’ancien : puisque dans l’ancien, en la personne du Christ, déjà la victime était juive» (p. 199).(4) Ainsi du rapprochement opéré par l'auteur entre Eva Braun / Adolf Hitler et Ève / Adam, cf. p. 251-2.(5) «En dictant son testament politique, Hitler visait à s’ériger en une espèce de dieu; faire de lui le Diable, comme y concourent avec ensemble de nos jours les médias, politiques et institutions d’enseignement, c’est l’aider à atteindre son but. S’il y avait cependant une leçon à retenir de la théologie de l’Antéchrist, ce serait pourtant que du mal, il n’a été qu’une des figures, et qu’il y aura pire – un pire que peu fort bien servir cette espèce de sacralisation perverse dont notre époque le fait jouir, grosse d’effets en retour au bout desquels nous ne sommes probablement pas rendus» (p. 268).
05/02/2011 | Lien permanent
De l'art retrouvé de l'apologétique, par Francis Moury

«[…] Denique quid de tabella recitatis illum christianum ? cur non et homicidam, si homicida christianus ? cur non et incestum vel quodcumque aliud esse nos creditis ? In nobis solis pudet aut piget ipsis nominibus scelerum pronuntiare ? Christianus si nullius criminis nomen est, valde ineptum si solius nominis crimen est.»
Tertullien, Apologeticum / Apologétique, II, 20, cité par R. Morisset et G. Thévenot, Les Lettres latines (partie 3 : Période impériale, éd. Magnard, Paris 1950-1962), p. 1205.
«Souvent tu m’as demandé, mon très cher Innocent, de ne pas garder le silence à propos de cet événement merveilleux survenu de notre temps. Pour moi, je m’y refusais par souci de modestie, mais aussi de sincérité – Je m’en rends compte aujourd’hui ! Je n’avais guère confiance d’y pouvoir réussir, soit parce que tout langage humain serait trop faible pour la louange céleste, soit parce que l’oisiveté, telle une rouille de l’esprit, a pu dessécher en moi certain petit don littéraire de jadis. Toi, au contraire, tu affirmais que, dans les choses de Dieu, ce ne sont pas les moyens qu’il faut considérer, mais le courage, et que le verbe ne saurait faire défaut à qui a foi dans le Verbe.»
Saint Jérôme, Epistulae / Lettres I, 1, 5-15, texte latin établi et traduit par Jérôme Labourt (éd. Les Belles-lettres, coll. Universités de France publiée sous les auspices de l’Association Guillaume Budé, Paris, 1949), p. 2.
 Le titre du livre de Falk van Gaver est gentiment trompeur. On pense immédiatement à quelques illustres prédécesseurs tels que L’Homme et le sacré de Roger Caillois, La Violence et le sacré de René Girard. On pense aussi, à propos de la première moitié du titre, au Le Politique de Platon plutôt qu’à La Politique d’Aristote même si ce dernier, selon l’excellent Jean Aubonnet, se traduisait dès l’antiquité par Les Politiques tout aussi bien. On pense éventuellement aussi à un énième essai sur les rapports entre fondamentalisme islamique et société moderne puisque c’est un sujet dans l’air du temps, dans la cendre des décombres, plutôt. On voit deux yeux assez malins sur la couverture qui ont l’air de nous dire : «Vous allez voir… je vais vous décrypter tout ça tranquillement et brillamment» et on a envie de répondre : «Merci on a déjà donné !».
Le titre du livre de Falk van Gaver est gentiment trompeur. On pense immédiatement à quelques illustres prédécesseurs tels que L’Homme et le sacré de Roger Caillois, La Violence et le sacré de René Girard. On pense aussi, à propos de la première moitié du titre, au Le Politique de Platon plutôt qu’à La Politique d’Aristote même si ce dernier, selon l’excellent Jean Aubonnet, se traduisait dès l’antiquité par Les Politiques tout aussi bien. On pense éventuellement aussi à un énième essai sur les rapports entre fondamentalisme islamique et société moderne puisque c’est un sujet dans l’air du temps, dans la cendre des décombres, plutôt. On voit deux yeux assez malins sur la couverture qui ont l’air de nous dire : «Vous allez voir… je vais vous décrypter tout ça tranquillement et brillamment» et on a envie de répondre : «Merci on a déjà donné !».Eh bien… pas du tout ! Ce n’est rien de tout cela. C’est autre chose.
On le comprend dès l’introduction placée sous les auspices du défunt pape Jean-Paul II et de saint Augustin, aussi dès la préface de Monseigneur Dominique Rey.
On le comprend encore mieux lorsqu’on a jeté un œil sur la quatrième de couverture qui nous précise que Gaver a vingt-cinq ans, qu’il dirige actuellement la revue Immédiatement (dont notre cher varan Juan Asensio connaît l’histoire mieux que nous : il l’a résumée déjà ici-même à plusieurs reprises en signalant aussi l’évolution de sa propre position par rapport à elle) et enfin qu’il est «spécialiste de la médiation interculturelle et interreligieuse» (cela existe donc, ce métier ?), ce qui l’a conduit à «effectuer de nombreuses missions à l’étranger, en Asie centrale, en Inde, en Chine, au Tibet» notamment. De «Sciences-po» au Tibet en passant par Immédiatement : il y a des parcours plus anodins et moins précoces.
Le livre de Gaver est donc un simple, un «pur et dur» traité apologétique catholique de 285 pages, très claires et très riches, parfaitement adapté d’ailleurs à la sensibilité contemporaine et à ses tourments, du moins à ceux partagés par l’élite pensante et souffrante : on y traite de l’écologie, du matérialisme, du capitalisme et de la pauvreté, du nihilisme et de bien d’autres choses encore.
Le niveau est régulièrement élevé : certains points de théologie et de métaphysique catholiques classiques y sont expliqués et mis en parallèle avec les problèmes qui leur correspondent dans l’histoire de la philosophie antique, moderne et contemporaine, avec les problèmes qui nous correspondent hic et nunc tout aussi bien. Problèmes d’hier qui sont nos problèmes d’aujourd’hui : le sage le sait; c’est celui qui ne l’est pas encore qu’il faut en convaincre.
Gaver se situe donc, encore une fois, dans cette tradition authentiquement apologétique concernant laquelle nous ne pouvons mieux faire que renvoyer le lecteur à l’article «apologétique» du Dictionnaire de théologie catholique dirigé par A. Vacant et E. Mangenot (éd. Letouzey et Ané, Paris, circa 1902). Nous recommandons d'une manière générale ce monumental Dictionnaire qui n’a pour l’instant pas été surpassé à notre connaissance en bien des points.
Paru en janvier 2005 aux Presses de la Renaissance, nous ne rendons compte qu’aujourd’hui 29 décembre 2005 de cet «aide-mémoire» catholique ajusté à notre monde actuel : que l’auteur veuille bien nous en excuser ! Mais après tout, lire un tel livre en pleine période de Noël est tout indiqué. Quelle saine lecture et combien rafraîchissante, apaisante – inquiétante aussi, de la plus saine manière – pour l’âme, enrichissante pour l’esprit !
Le littéraire y trouvera de belles citations de Virgile, Dante, Boccace, Raymond Sebon, Paul Claudel et Charles Péguy; le philosophe des remarques sur Nietzsche et Aristote; le connaisseur raffiné enfin retrouvera Pierre de Bérulle, Jacques Maritain et Simone Weil. Programme connu.
La surprise pour le lecteur, honnête homme cultivé (celui qui a lu mais n’a pas relu depuis longtemps les œuvres complètes d’Étienne Gilson) vient d’ailleurs : au fil des pages, lui est proposé un incroyable et démesuré «compendium» de citations de saints très divers ! Citations commentées, étudiées, discutées et organisées à la perfection pour charpenter les divers sujets traités. On vous avoue qu’on a d’ailleurs découvert certains saints à cette occasion ! Nous connaissions certes assez bien les classiques saint Augustin, saint Thomas d’Aquin, saint Bonaventure, tous les Pères grecs et latins classiques comme Origène ou Tertullien, sans oublier les Pères médiévaux un peu moins connus du grand public mais familiers au philosophe universitaire. Avouons bien volontiers qu’on ne connaissait pourtant pas saint Maxime le Confesseur, saint Méthode d’Olympe, saint Ignace d’Antioche, saint Maxime de Turin, saint Anastase le Sinaïte et tant d’autres dont les noms sonnent aujourd’hui comme autant de parfums rares et enivrants ! Lire ce livre, c’est aussi un plaisir d’esthète décadent : ce n’était pas le but recherché par l’auteur, bien sûr, mais on signale ce coupable plaisir tout de même. Huysmans le faisait éprouver à Des Esseintes et il mérite d’être éprouvé encore aujourd’hui ! Non seulement la forme est poétique (les noms de ces saints) mais le fond est riche (leurs citations) : plus qu’une apologétique, c’est parfois une véritable symphonie théologique, bien orchestrée et bien dirigée.
On déplore d’ailleurs que par paresse, manque de temps ou économie, ni l’auteur ni l’éditeur n’aient songé à établir un Index nomini avec correspondances établies entres noms cités et pages : on avait bien commencé à l’établir nous-même au crayon sur la dernière page mais la place nous aurait manqué de toute manière. Certaines pages (comme la p. 119), sont pratiquement entièrement constituées de citations en enfilade.
La bibliographie des ouvrages cités est pour sa part modeste mais honnête : entre Henri de Lubac et Rémi Soulié (sa belle biographie du Curé d’Ars parue en 2003 chez Pygmalion est judicieusement citée et commentée), on est de toute manière en bonne compagnie !
Reste la pensée personnelle du jeune Gaver : elle est précisément impersonnelle au meilleur sens du terme. Gaver s’est voulu miroir actuel, dépositaire actif de la sagesse catholique, du mysticisme catholique, de la politique catholique. Il ne s’est voulu que cela et rien de plus ou rien d’autre : il nous restitue une tradition et lui fait dire ce qu’il croit être le vrai sur nos problèmes actuels par un choix argumenté et une mise en perspective rigoureuse. Son ton est souvent pressant, souvent rationnel et analytique, souvent clair et méthodique mais on trouve aussi très régulièrement un certain lyrisme prophétique assez romantique qui plaira aux jeunes gens actuels, c’est certain. Eschatologie et sotériologie, quand vous nous tenez… vous nous envoûtez ! Ce lyrisme nous consolait déjà lorsque nous avions vingt ans en 1980 : la situation actuelle de 2005 le rend encore plus consolant, il faut bien le dire !
On n’y trouvera pas d’exégèse analytique un peu trop sèche et scientifique (même si hautement recommandable à qui veut étudier sérieusement l’Ancien comme le Nouveau Testament) telle que la pratiquent en virtuoses les Renaud, Vuilleumier et autres commentateurs philologiques agréés par l’Université. Pour savoir ce que peut donner une telle exégèse, nous renvoyons à l’incroyable passage du procès de Dieu dans le Livre de Michée 6, 1-8 si brillamment et sérieusement étudié par notre chère et studieuse Véronique Faron dans son Exégèse de Mi 6, 1-8 soutenue en 2005 à la Faculté de théologie catholique de l’Université Marc Bloch. Lire l’exégèse de Véronique Faron en même temps que le livre de Falk van Gaver est d’ailleurs un exercice très stimulant pour l’esprit comme pour l’âme : deux versants d’un même sentier menant au sommet d’une même montagne, au sommet de laquelle le Christ nous attend, sont perçus alternativement. Ils se complètent bien. On peut aussi aller gravir un troisième sentier tout différent : celui de la Causa Dei de Leibniz (in Opuscules philosophiques choisis, texte latin et trad. française disponibles à la librairie philosophique Vrin).
Un point gênant tout de même : il faut bien en trouver un sinon une critique n’est plus une critique mais une publicité ! Le titre du dernier chapitre emploie le terme «Antichrist» en s’appuyant sur une citation de saint Cyrille de Jérusalem et sur les Sermons plus récents du cardinal américain J.H. Newman. Très bien, on a compris que cela est équivalent à «Antéchrist» et les analyses de Gaver sont très claires et bonnes de toute manière ! Mais enfin n’est-ce pas une coquetterie inutile de substituer un nouveau terme dans le titre d’un chapitre – au risque de surprendre le lecteur – à un terme parfaitement connu et identifiable depuis bien longtemps ?
La preuve : lorsqu’un distributeur français exploita le film L’Antichristo / The Antichrist [L’Antéchrist] (Ital., 1974) d’Alberto de Martino, c’est bien L’Antéchrist qui fut choisi comme titre et non pas «L’Antichrist». On précise au lecteur qu’il s’agit d’un des nombreux films fantastiques s’inscrivant dans la lignée directe du célèbre et admirable The Exorcist [L’ Exorciste] (USA, 1973) de William Friedkin d’après le livre homonyme écrit par William Peter Blatty, paru chez Robert Laffont dans une excellente traduction. Bref : cette conservation était le signe évident que le titre d’exploitation français était parfaitement compréhensible et bien «parlant» pour un public populaire, parfois peu versé en histoire des religions comme en théologie mais qui connaissait majoritairement ce terme et son sens. «Antéchrist» a au demeurant un sens bien précis dans l’Apocalypse de saint Jean : il désigne l’être malfaisant qui doit semer la mort et le mal sur la terre peu avant le retour du Christ. Il n’est donc pas seulement celui qui est «contre» le Christ. On en profite pour signaler une autre référence filmique : Holocaust 2000 (G.B.-Ital., 1977) d’Alberto de Martino (encore lui). Celui-là était inspiré par saint Jean directement tout comme son prédécesseur The Omen [La Malédiction] (G.B.-U.S.A., 1976) de Richard Donner dont le titre de reprise aux U.S.A. fut d’ailleurs The Omen : the Antichrist. Mais ce second titre de reprise ne fut jamais, lui non plus, utilisé en France. En somme, même si le brave Ernest Renan a cru possible d’identifier historiquement l’Antéchrist à l’empereur Néron, le «signifié» auquel renvoie ce terme ne nous est donc pas encore apparu : saint Jean en a eu la vision et le cinéma occidental s’en est inspiré pour la représenter dans d’impressionnantes fictions. Il faut conserver l’ambivalence, l’amphibologie sémiologique française et ne pas lui substituer le terme mono-sémantique anglais francisé.
C’est un détail, nous dira-t-on, en ajoutant qu’il faut bien mettre les points sur les «i» car le public actuel n’est plus celui des années 1975 et que «Antichrist» est, peut-être, davantage «parlant» à des oreilles de 2005 que «Antéchrist» ? C’est possible mais nous sommes foncièrement réactionnaires à de telles innovations, si justifiées soient-elles. Ce détail nous produit un peu la même impression que lorsqu’on décida de rompre avec une tradition bimillénaire dénommant l’œuvre majeure de Lucain La Pharsale et de la rebaptiser La Guerre civile [la Pharsale]. Ce qui induit d’ailleurs à présent une confusion inévitable dans l’esprit des ignares avec l’ouvrage homonyme et assez antérieur de César car ils s’en tiennent au français et ne vont pas voir le latin qui distingue Bellum civile de César et Belli civilis libri (Pharsalia) de Lucain. A. Bourgery réglait certes philologiquement le problème en un court et efficace paragraphe de son introduction à son édition de 1927 (p. VIII, éd. Belles-lettres/Budé, Paris cinquième tirage, 1976) mais un paragraphe suffit-il à effacer une tradition qui, Bourgery le précisait bien honnêtement, était tout de même celle de «presque toutes les éditions et de quelques manuscrits très récents» ? De saint Jean à Newman… et retour obligatoire; donc !
04/01/2006 | Lien permanent
L’Amérique en guerre (4) : La peau de Curzio Malaparte, che vergogna !, par Gregory Mion

 L’Amérique en guerre, 1 : À propos de courage, le Vietnam de Tim O’Brien.
L’Amérique en guerre, 1 : À propos de courage, le Vietnam de Tim O’Brien. L'Amérique en guerre, 2 : l'Irak de Phil Klay dans Fin de mission.
L'Amérique en guerre, 2 : l'Irak de Phil Klay dans Fin de mission. L’Amérique en guerre, 3 : Chronique des jours de cendre de Louise Caron.
L’Amérique en guerre, 3 : Chronique des jours de cendre de Louise Caron. Gregory Mion dans la Zone.
Gregory Mion dans la Zone.«Si donc tu dois bien employer la bête, il te faut choisir le renard et le lion; car le lion ne sait se défendre des lacets, ni le renard des loups. Tu seras renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups.»
Machiavel, Le Prince.
«Infâme à qui je suis lié
comme aux vermines la charogne.»
Baudelaire, Les fleurs du mal.
Une peste spirituelle : l’Amérique envahissante
Le silence dans lequel reposent les œuvres de Curzio Malaparte aujourd’hui est probablement dû à la nature déplaisante, peut-être même agaçante, de l’homme qui écrivit le monumental Kaputt et qui dévisagea dans ce livre la plus ignoble et la plus vérace gueule du nazisme. On a reproché quantité de choses à Malaparte, parmi lesquelles on recense un goût avéré pour le grand-guignolesque, un appétit pour les spectacles excessifs où le roman devient un lieu de prédilection pour détailler la laideur et l’abjection de l’humanité. Combien de pages, dans l’œuvre de Malaparte, contiennent des plaies ouvertes qui confèrent à l’obscénité généralisée ? Cette disposition à l’enflure du dolorisme reflète sans doute une part de la frénésie mégalomaniaque de l’auteur, à qui l’on reprocha encore la construction de sa villa sur un rocher de Capri, sorte de bâtisse futuriste qui piétine les anciens jours malheureux et qui regarde à l’horizon, comme la proue d’un navire insurgé fend une mer de panache et d’espérance. Haut perché dans ses intentions et ses engagements, Malaparte fut certes un homme de contradictions (mais quel grand écrivain ne l’est pas ?), un fasciste occasionnel qui finit par être du côté des Alliés dans ses romans (encore que), cependant on ne peut lui confisquer le courage d’avoir combattu dans les tranchées de 14 alors qu’il n’avait que seize ans. Est-ce de l’inconscience juvénile ou un désir précoce de s’inscrire dans le cours de l’Histoire ? Toutes les hypothèses sont recevables avec ce Malaparte par deux fois venu au monde, d’abord sous une identité allemande, celle de Kurt-Erich Suckert, né d’un père de nationalité germanique mais déjà culturellement italianisé, puis accouché de nouveau, cette fois dans un berceau de sa confection propre, se baptisant Malaparte parce qu’il fallait bien faire mieux que Bonaparte, et parce qu’il fallait bien aussi accepter de se placer sous la juridiction du Mal après avoir connu quelques-unes de ses places fortes. Cette reconstruction de soi inspire d’emblée le respect. Malaparte n’est pas un transfuge banal; c’est un renégat sublime qui modifie l’idée même de sa paternité, déjouant le premier sang, se vidant de sa substance pour se remplir d’une origine plus coriace et plus franche du collier (1).
Que certains aient pu voir chez Malaparte une personnalité en clair-obscur se justifie par la constante réappropriation de soi de l’auteur, toutefois ce jeu de vérités/contre-vérités n’a pas empêché la composition de romans dont le propos ne souffre aucune ambiguïté. Kaputt exposait une Europe lessivée par la saloperie nazie; La Peau est un texte autobiographique dans lequel Malaparte décrit pour l’essentiel la ville de Naples après la libération de l’automne 1943. Les Américains ont effectivement commencé à guérir une partie de l’Europe de ses maladies, mais il n’en reste pas moins qu’ils apportent avec eux un nouvel aspect de la violence, à savoir la violence des vainqueurs qui font des tartarinades auprès des vaincus, se sentant investis d’un pouvoir socio-culturel de facto et de jure. Au fond c’est une idée vieille comme le monde et que Montesquieu avait formalisée dans De l’esprit des lois : quel que soit le pouvoir qui appartient à tel ou tel individu, ce dernier sera tenté d’en abuser, ainsi doit-on s’efforcer de remettre en question même les hommes de pouvoir qui semblent habités des meilleures intentions. Dans l’opinion publique, il ne fait pas bon de douter des Américains débarqués sur le sol européen, pourtant Malaparte se montre farouchement et ironiquement anti-américain dans La Peau. La figure messianique des Américains est écorchée par l’intuition que l’Europe a autant souffert de ses bourreaux fascistes que de ses sauveurs démocrates. L’homo sapiens démocratique n’est pas exempt d’un double maléfique où l’on repère le visage détraqué d’un homo demens. On ne peut donc pas parler d’une guérison de l’Europe, mais plutôt du remplacement d’une épidémie par une autre, les envahisseurs à la langue gutturale ayant cédé leur place aux conquérants prétendument raffinés. Le caractère antiseptique de la libération a engendré un monstre collatéral, un rejeton de l’hygiène morale qui ne ruine pas les corps mais les esprits. C’est le sens que prend le terme de «peste» dès le premier chapitre de La Peau. La peste indique ici des pourrissements intérieurs. Entre autres de ses apparences, cette peste réside dans la pitié des Américains pour les vaincus (cf. p. 51) (2). Elle révèle un commerce malsain de la liberté, comme si les Italiens s’étaient résignés à acheter leur délivrance en pleurant sur les pieds du «land of the free». Par conséquent, ce qui induit un avilissement de l’âme, ce n’est autre que la possibilité d’avoir négocié la liberté avec ces marchands de tapis volants (3).
Il n’y a que les peuples de vendus qui font de la liberté une opportunité de braderie. Sous la plume acérée de Malaparte, les mots pour exprimer cette vente prennent une tournure insultante, transcendant toute évocation de pourparlers entre l’Italie et l’Amérique : «[…] le nom Italie puait dans ma bouche comme un morceau de viande pourrie» (p. 22). À côté de cette condamnation monochrome qui suffirait à fonder une définition ultime et précipitée de l’Italie, le personnage du colonel Jack Hamilton apporte une nuance. Il qualifie les Italiens de «bastard, dirty, wonderful people» (p. 22), comme si l’impureté identitaire, à son plus fort degré de contamination, devait se recouvrir d’une espèce de beauté paradoxale sur laquelle affleure la marque d’un déchaînement de forces quasiment insurmontables, étrangères à toute intelligence, ni plus ni moins que la nature historique d’un peuple ayant subitement pris les contours d’une nature incertaine, à la fois rangée et enragée.
L’humiliation du vaincu se mue ainsi en intensité formidable – sous les crânes de ces Napolitains couvent des tempêtes perceptibles et d’une beauté curieuse. En effet, ce n’est pas vraiment du Beau que l’adjectif «wonderful» désigne lorsqu’il se réfère aux Italiens, mais plutôt ce que Kant installerait dans la catégorie du sublime dynamique, un objet incalculable qui suscite d’abord la terreur et que notre raison ne peut s’aventurer à comprendre toute seule (4). En voyant ces Italiens à la fois magnifiques et abâtardis, nous sommes tétanisés, figés devant le contraste qui sépare la grandeur d’âme des vaincus de la bassesse énorme des perdants. On dirait là un mélange terrible, une concoction écœurante, un œil du cyclone où se préparent de nouveaux orages d’acier. Il y a par ailleurs une opposition presque incommensurable entre ces êtres bouillants (les Italiens) et la situation tiède de ceux qui les contemplent depuis leurs forteresses mentales (les libérateurs). Cet écart incompréhensible ne peut être réduit que par le réveil de la force morale, la seule à même de se mesurer à la force de la nature déchaînée et de ressentir l’humilité devant ce qui nous rend insignifiants. Par l’observation des ouragans qui se jouent dans les vies de ces Napolitains défaits mais qui se comportent comme de fiers Artaban, on ressent la qualité de notre âme, l’élan spirituel, la découverte en nous d’une faculté de résistance et de compréhension envers ce qui pourrait nous écraser à tout instant, envers ce qui nous dépasse de la tête et des épaules. Parce que le colonel Hamilton est en sécurité par rapport à ces Italiens sublimes, qu’il regarde comme on regarderait de notre maison un amoncellement de nuages noirs prêts à exploser, il peut reconnaître dans cette immense fureur de l’Italie en déconfiture la force de son âme d’Américain, tout comme il peut concomitamment se réclamer d’une pudeur fondamentale en saisissant la véhémence de cette Europe qui avance à l’instar d’un typhon dévastateur, qui veut rester debout malgré ses millions d’allongés. L’Europe est sublime, disloquée, fiévreuse, alors que l’Amérique n’est que rectiligne, stable et mathématiquement envahissante.
En apparaissant comme une entité quasi surnaturelle, Naples fait s’effondrer les fondations cartésiennes d’Hamilton (cf. pp. 53-8). Il se confronte à l’autre de l’Europe, à son versant qui n’a jamais vu le soleil, à son mystère, et voilà ce qu’on lui dit : «[…] Hitler aussi est un élément du mystère de l’Europe, […] Hitler aussi appartient à cette autre Europe, que la raison cartésienne ne peut pas pénétrer. Crois-tu donc pouvoir expliquer Hitler avec le seul secours de Descartes ?» (p. 58). Bien que le colonel Hamilton nie en bloc son incapacité à produire un raisonnement sur cette Europe décimée par les fascismes, la pudeur dont il a fait preuve en amont nous permet de poser que sa passion de Descartes n’est plus qu’une couverture, une sorte de boîte à outils qui ne peut que réparer une partie de la machine-Europe.
En outre, la conception cartésienne d’une nature continuellement créée par Dieu est incompatible avec les sentiments éprouvés de concert par Hamilton et Malaparte (5). Tous les deux, après avoir admiré le Vésuve éclairé par la lune, admettent l’absence de bonté dans la nature, ce qui revient à présumer un fort coefficient de méchanceté dans les éléments naturels (cf. p. 54). Ils font de cette nature une entité non chrétienne, le lieu de l’absence absolue de Dieu. On pourrait cependant alléguer que l’attitude d’Hamilton devant le Vésuve ne fait qu’accentuer l’idée que la nature spécifique de l’Europe serait mécréante et impure, tandis que la nature américaine serait encore préservée et sous le contrôle de Dieu. Si ce n’était pas le cas, comment est-ce que les Américains auraient pu venir libérer les Napolitains de leur prison idéologique ? Bien que cette hypothèse soit intéressante, elle nous apparaît insuffisante eu égard aux performances intellectuelles du colonel Hamilton. Il est présenté comme un penseur, un polyglotte et un adorateur de l’Europe, aussi doit-on se garder de lui prêter des jugements bâclés ou condescendants. En d’autres termes, le fait qu’il persiste à pouvoir expliquer Hitler par l’intermédiaire de Descartes n’est probablement que la parole d’un homme qui connaît la valeur du doute et la difficulté de conquérir la vérité.
Par antinomie avec le tempérament cérébral d’Hamilton, les Américains ne sont pas à la fête au cours de ce premier chapitre décisif. La venue ou la survenue des Américains sur le territoire semble avoir entraîné un marché de la chair (cf. pp. 25-6 et 34-9). On évoque la possibilité de se procurer une petite fille pour trois dollars, et dans le même temps on déplore une inflation de la chair nègre. Dans la «jungle de Naples», le trafic des nègres bat son plein. Chacun paraît touché par ce désir mimétique qui a tant inquiété René Girard : puisque tout le monde veut posséder son nègre, le désir du nègre s’accroît et produit des compétitions férocement ignobles, et plus ce désir est exploité par l’écriture licencieuse de Malaparte, plus la ville de Naples se découvre sous des perspectives louches, cité catalysée par des transactions immondes et prenant la forme d’une circonscription du Mal. Tout corps est devenu l’objet d’un trafic des charmes.
À la date exacte du 1er octobre 1943, Naples libérée a contracté sa «peste» et par extension d’assonance sa perte (cf. p. 47). La rumeur qui circule défend la théorie d’une peste importée par les Américains, certainement présente dans le corps même de ces soldats libérateurs. Ils sont comme des bubons qui viennent grossir les tumeurs déjà conséquentes de l’Europe. Ce sont des géants qui détruisent ce que les fascismes n’ont pas réussi à atteindre. Avec l’arrivée de l’Amérique du Nord sur les terres européennes se profile le pressentiment d’un nouveau totalitarisme : la démocratie américaine et son cortège capitaliste vont peu à peu instaurer le «despotisme mou» que Tocqueville redoutait (6). Après 1917, 1943 et bientôt les débarquements de 1944, les États-Unis confirment leur alliance avec une certaine Europe. Comment ne pas succomber au paradigme économique de nos plus fervents protecteurs ? Il ne serait pas convenable de rejeter unanimement ce que les Américains ont emmené dans leurs bagages. De toute façon, il s’agit d’une peste qui s’en prend aux âmes, et ce type d’affection ne trouve guère son antidote que dans les caractères désobéissants, en l’occurrence des caractères qui tendent à se raréfier à mesure que le capitalisme gagne en puissance. Souvenons-nous que la force particulière du despotisme redouté par Tocqueville, c’est le fait que le peuple assimile son dirigeant à une présence bienveillante. Cette strangulation douce est bien plus efficace que «le cercle de fer de la terreur totale», expression choisie par Hannah Arendt pour qualifier les totalitarismes hitlérien et stalinien (7). Alors que le totalitarisme pour ainsi dire topique étouffe la vie publique et la vie privée de son poids colossal, le totalitarisme du capital hypertrophie le champ des possibles tout en réduisant l’esprit d’initiative à sa plus faible envergure. Comment élaborer une résistance contre un processus qui ne donne pas l’impression d’être oppressant ? Voici peut-être les effets à long terme de la peste dénoncée par Malaparte.
Conformément à ce qui précède, la sensation d’une Europe prostituée n’est pas loin. Le passage du quartier des naines, le Pendino di Santa Barbara (cf. pp. 41-45), est éloquent à plus d’un titre. Le romancier donne à voir un arrondissement de la monstruosité napolitaine, tant physique que morale. Telles des ménines à la petite semaine, les naines du Pendino copulent avec les molosses de l’Amérique. On imagine les membres gargantuesques de ces titans virils pénétrer les orifices étriqués de ces gnomes féminins, jetant dans ces physionomies difformes une semence purifiante qui pourra faire grandir l’Europe après ses rabougrissements meurtriers. C’est un tableau qui devrait nous faire honte que cette hypothétique toile qui s’intitulerait Les Américains guidant l’Europe, mais nous en avons accepté toutes les couleurs et toutes les allégories. La peste américaine a mis l’Europe en quarantaine économique et culturelle. Qui pourra dire après cela que Malaparte n’a pas rédigé un texte viscéralement anti-américain ? Pire encore, de ce dont il est question dans ce livre hors-la-loi de la vertu, on pourrait le rapprocher de ce dont il a été question dans toutes les expéditions de guerre américaines depuis 1939-1945 : la guerre n’a peut-être jamais autant été la continuation de la politique par d’autres moyens (8). Dès qu’elle entre en guerre, l’Amérique empeste, elle est pestis, maladie épidémique, très contagieuse et qui se ne répand qu’une fois les derniers obus éclatés. Les pathologies de la politique impérialiste impliquent une détérioration qui suscite des pestes noires démesurées et cent fois plus meurtrières que la guerre en elle-même. La pestis que Malaparte vise intervient après-coup, après-guerre : elle termine le travail en privant les hommes de leur dignité.
L’incubation honteuse
C’est pourquoi il n’est pas absurde de lire que le narrateur-Malaparte «préférai[t] la guerre à la peste» (pp. 63 et 65). La réalité de la guerre oblige à la dignité du combat. À l’inverse, l’après-guerre de la peste morale constitue l’instance d’un dépérissement des âmes qui balance les ultimes vigueurs de l’humanité au rebut. Cette peste est une dénaturation de l’homme, une dévalorisation intolérable de ce qui pouvait faire la grandeur de la culture humaine. Peu à peu incubée, la maladie enfante des monstruosités qui feraient honte au plus vilain des hommes. Ainsi en est-il de cette fille que l’on présente comme une vierge de Naples (cf. pp. 67-70), qui, pour la misérable somme d’un dollar, ouvre ses cuisses pour exhiber, telle une langouste, «les tenailles roses et noires de ses chairs» (p. 69). Dans ce mouvement dégradant d’extimité, cette vierge s’affiche en fille vaincue, elle se donne aux hommes qui viennent vérifier son pucelage, et il y a même un nègre qui la fend d’un de ses doigts vérificateurs pour s’assurer du bien-fondé de la marchandise vendue. C’est la société du spectacle qui est quelque peu en avance par rapport à l’heure où Guy Debord a pu s’en alarmer. La fille aux cuisses écartées dans laquelle on éparpille des doigts outranciers n’est qu’une partie du spectacle que les vainqueurs ont besoin de consommer. Pour elle, en outre, c’est toujours un dollar de gagné par visiteur. La guerre lui permettait de rester digne en se battant pour ne pas mourir; la peste la fait mourir moralement et l’engage dans le registre de la survie infamante.
Dans un même ordre d’idées, conforme au contexte d’une sexualité dégradée, Malaparte est le témoi
13/12/2015 | Lien permanent
Guerilla de Laurent Obertone

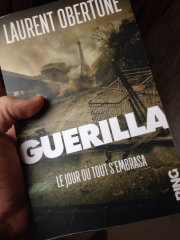 Acheter Guerilla sur Amazon.
Acheter Guerilla sur Amazon. Utøya.
Utøya. La France Orange mécanique.
La France Orange mécanique. Chroniques d'une dhimmitude annoncée.
Chroniques d'une dhimmitude annoncée.Nous considérerons comme un imbécile d'illustre lignage et, s'il se reproduisait hélas, de mirifique descendance, tout lecteur qui accordera la plus petite attention à la réclame que les éditions Ring, qui semblent confondre la promotion publicitaire la plus caractérisée avec le décachetage du septième sceau, ont organisée autour du dernier ouvrage de Laurent Obertone, qu'elles tentent de faire précéder, comme toujours ou presque, d'une réputation de chef-d’œuvre. Amusons-nous ainsi d'apprendre que «les événements décrits dans Guerilla reposent sur le travail d'écoute, de détection et les prévisions du renseignement français», alors que le visionnage de quelques scènes d'exécution commises par Daech, disponibles sur la Toile, aura suffi à Laurent Obertone pour servir d'utile support à telle ou telle de ses descriptions les plus macabres (1), ainsi que de probable bagage immersif auprès des discrets services de renseignements français.
Sans honte encore, puisqu'un représentant commercial ne connaît point la honte, notre vendeur de chefs-d’œuvre ne craint pas d'affirmer que c'est «après deux ans d'immersion au contact d'agents de services spéciaux et de spécialistes de la terreur et des catastrophes» que Laurent Obertone, que nous savons être «l'auteur du chef-d’œuvre» sur l'affaire Breivik et de «l'enquête phénomène» qu'est La France Orange Mécanique, nous livre enfin un «roman météore». Nous avons de la chance que le Dieu du Désert en personne ne vienne nous annoncer, dans un déchirement prodigieux des cieux, qu'il a Lui-même inspiré Laurent Obertone pour écrire, sous sa dictée, les Tables des Lois nécessaires à la rédaction de tout bon roman de gare.
Plusieurs questions se posent néanmoins en lisant cette réclame (et même, en la subissant visuellement, via des films publicitaires), sans tenir compte, notre intrépide VRP me remerciera pour cette douceur, de l'habituel et comique baratin grâce auquel les vendeurs emballent leurs poissons plus vraiment de première fraîcheur pour s'en débarrasser avant qu'ils ne sentent trop mauvais. Nous pourrions ainsi être en droit de nous demander pour quelle drôle de raison Laurent Obertone a, ou aurait eu apparemment besoin de s'immerger «au contact d'agents de services spéciaux et de spécialistes de la terreur et des catastrophes» (question subsidiaire : qu'est-ce donc qu'un spécialiste de la terreur et des catastrophes ? Laurent Obertone a-t-il déjeuné avec Paco Rabanne ?) quand la littérature la plus facilement dénichable, y compris Le Nouveau Détective, y compris tout de même celle de plus haute tenue, dont nous avons patiemment énuméré bien des exemples dans deux séries de notes, Chroniques d'une dhimmitude annoncée et Au-delà de l'effondrement, regorge de scénarios parfois infiniment plus élaborés que la trame ultra simpliste (bien davantage qu'ultra réaliste, comme l'affirme encore la réclame de notre livre) de Guerilla.
 Ces précautions prises, Guerilla, comme le reste de la production de Laurent Obertone, dont nous avons par deux fois rendu compte, est évidemment un texte qui se lit d'une traite, en quelques heures, tant il ne s'encombre pas de discours qui ralentiraient l'unique principe moteur, et même Dieu de Vengeance, devant lequel notre habile faiseur plie genoux : l'action et, plus précisément, le film de l'action, c'est-à-dire un scénario digne ou indigne c'est selon d'un uppercut (zut, j'écris comme l'éditeur d'Obertone !) bien davantage qu'un roman proprement dit. Guerilla, plus qu'un roman, titre auquel du reste il ne prétend même pas et nous saluons cette modestie, est tout entier conçu pour son adaptation cinématographique, que l'on imagine réalisable par quelque improbable clone d'un Luc Besson de droite, la réduction minimaliste du scénario et de toute forme d'intelligence alors mise au service d'un efficace déroulé (action resserrée en trois journées, chapitres et phrases courts, horaires et lieux de l'action précisés, exergues apportant une espèce de caution littéraire sinon humaniste, un ancrage de l'horreur dans la mémoire des lettres), de préférence ultra-violent, retournant les caricatures de personnages (des policiers par exemple, comme c'est une constante dans les films de Besson et de ses clones) contre ce petit milieu médiatique honni et tout aussi caricatural, quoique du bon côté de la barrière dégoulinante de moraline.
Ces précautions prises, Guerilla, comme le reste de la production de Laurent Obertone, dont nous avons par deux fois rendu compte, est évidemment un texte qui se lit d'une traite, en quelques heures, tant il ne s'encombre pas de discours qui ralentiraient l'unique principe moteur, et même Dieu de Vengeance, devant lequel notre habile faiseur plie genoux : l'action et, plus précisément, le film de l'action, c'est-à-dire un scénario digne ou indigne c'est selon d'un uppercut (zut, j'écris comme l'éditeur d'Obertone !) bien davantage qu'un roman proprement dit. Guerilla, plus qu'un roman, titre auquel du reste il ne prétend même pas et nous saluons cette modestie, est tout entier conçu pour son adaptation cinématographique, que l'on imagine réalisable par quelque improbable clone d'un Luc Besson de droite, la réduction minimaliste du scénario et de toute forme d'intelligence alors mise au service d'un efficace déroulé (action resserrée en trois journées, chapitres et phrases courts, horaires et lieux de l'action précisés, exergues apportant une espèce de caution littéraire sinon humaniste, un ancrage de l'horreur dans la mémoire des lettres), de préférence ultra-violent, retournant les caricatures de personnages (des policiers par exemple, comme c'est une constante dans les films de Besson et de ses clones) contre ce petit milieu médiatique honni et tout aussi caricatural, quoique du bon côté de la barrière dégoulinante de moraline.Cette efficacité ne me gêne absolument pas et même, tant qu'à faire, je la goûte davantage que la pseudo-intellectualité de mirliflore parisien servant de squelette mou à tant de navrants navets bavards qui, bien que ne possédant aucun organe de reproduction visible, ne cessent de se reproduire. Je préfère ainsi, et je le dis bien franchement, un livre de Laurent Obertone aux œuvres complètes, hélas à venir aux éditions du soudainement très milletien Léo Scheer, de l'impeccablement manucuré et déconstructivement coiffé Romaric Sangars. Du reste, il est frappant de constater que Guerilla donne finalement un corps testostéroné à la révolution d'eunuque minaudier, amateur de raouts où quelques bourgeois lassés de tout s'inventent des frissons en invoquant des Cosaques montés sur des poneys, que Romaric Sangars a figurée dans ses avachis et dolents Verticaux, ou bien que Jean Rolin a déroulée mollement dans ses euphémistiques et affligeants d'ennui Événements tout remplis de bruit et de fureur, mais surtout de descriptions de versicolores volatiles.
Cette efficacité, assez souvent tout de même, se dévalue en simplisme plutôt qu'en simplicité, même si Laurent Obertone semble avoir quelque peu, quelque peu seulement hélas (2), muselé son étrange compulsion au métaphorisme animalier, grossier, malgré quelques embardées que notre adepte de darwinisme social pour les nuls n'a visiblement pas pu maîtriser, faute peut-être d'une laisse suffisamment solide pour tenir son animal intime assis sagement plutôt qu'aboyant. Finalement, pour reprendre un des procédés qu'il figure dans son texte, c'est assez souvent que la (ou sa) bête intérieure s'empare de Laurent Obertone. C'est ainsi fort classiquement que la toute première scène du texte obertonien nous présente des policiers aux prises avec ce que les médias, AFP en tête logiquement puisque c'est le centre de commandement du novlangue français, continuent, pudiquement, mensongèrement, criminellement, d'appeler des jeunes et qui sont, nous dit Obertone, des salopards, des chiens, des monstres, des criminels en puissance sinon en acte(s) : «Ces gars-là n'étaient pas faits du même bois», car «Ils étaient animaux, blocs de pulsions et de haine, des chiens d'attaque prêts à rompre leurs laisses, et à broyer des visages» (p. 14). Cette bête réapparaîtra bien des fois, y compris dans ces quelques lignes qui suivent («La bête des entrailles préparait son putsch» puis «Alors la bête des entrailles avait parlé», p. 15), parfois de manière directe (avec la belle scène de l'éléphant errant dans les rues de Paris), mais elle possède un sens évident, quoi qu'il puisse assez équitablement être réparti entre criminels et représentants de l'ordre (s'il en reste) : l'intrusion de l'animalité est toujours, pour Laurent Obertone, retour à ce qu'un autre a appelé la verte primitivité, laquelle est probablement la dernière chance de réveiller le Français, sans doute l'Occidental, de sa prodigieuse léthargie. C'est toujours en fait le déclassé, celui qui trop longtemps a contenu sa rage, comme le policier abattant plusieurs jeunes, le psychopathe à la gâchette facile ou bien celui qui est un clochard (cf. p. 21), qui peut se laisser submerger par la bête : déchaînement de violence assuré mais, si j'ai bien lu Laurent Obertone, celui-ci vaut toujours mieux que la noria monotone des discours iréniques et l'inaction, dont vont périr bien des personnages du livre.
Une autre métaphore est goûtée par Laurent Obertone, et c'est à peu près la seule prise vaguement littéraire que cet expéditif scénariste a rapportée dans son filet à très amples mailles baleinières, métaphore qui évoque, pour le dénigrer, tel ou tel dieu auquel se réfèrent ses personnages. Lorsqu'il s'agit de la caricaturale Zoé, imbécile et même, ne craignons pas de l'écrire en nous faisant le souffleur de l'auteur, pauvre conne qui mourra d'aimer par-dessus tout les sauvages qui la détestent, Laurent Obertone raillera ainsi son dieu du «Lien Social» (p. 143) qui, curieusement, a abandonné son irénique ouaille. Le «Dieu du Lien Social» auquel croit, comme son amie Zoé, Noah, est tout bonnement déchu, ce pauvre Noah parlant «une langue morte et ses valeurs [n'étant] plus que les fables d'une époque disparue» (p. 279) Ailleurs, «les gens encerclant les commissariats donnaient l'impression de se recueillir, comme possédés par une révélation religieuse» (p. 212), remarque dont Laurent Obertone ne fait strictement rien, alors que tout idiot sur terre est capable de dégainer son petit précis de René Girard en moins d'une seconde.
Je pense que nous avons ramassé là tout ce que nous pouvions en guise de procédés métaphoriques, mais je crois que Laurent Obertone se contrefiche de savoir écrire lui qui, lorsqu'il se laisse aller à obéir à son propre «démon intérieur» (p. 60), qui est peut-être celui qui lui susurre qu'il est un écrivain, nous afflige de trouvailles pas mêmes dignes d'un volume de SAS, parlant par exemple des «yeux noirs de la zone grise» (p. 16) ou encore, envolée lyrique dont nous goûterons l'irrécusable profondeur, et qui eût il me semble parfaitement convenu à l'un des jeux de la série Assassin's Creed : «Les deux côtés de la rue semblaient donner sur la fin du monde. Il faisait noir comme chez les loups, et la nuit était pleine d'assassins» (p. 332).
Pourtant, en dépit même de ces facilités et enfantillages inouïs, sans même tenir compte des personnages qui, tous, sont des caricatures, qu'il s'agisse de militants qui, au moment même où ils vont mourir, continuent de saluer leurs meurtriers, d'un tueur psychopathe (Anders Breivik, sors de ce corps de papier !) éliminant les hommes qu'il tient directement pour responsables du chaos dans lequel la France a sombré, ou encore d'un vieux médecin réactionnaire flanqué d'une imbécile indécrottablement progressiste elle-même femme d'une irénique pourriture, Guerilla doit être considéré à sa juste valeur, qui n'est pas mince, et que nous pourrions définir comme étant la remise au goût du jour d'un roman assez médiocre, bien que supérieur à celui de Laurent Obertone, je veux bien évidemment parler du Camp des saints de Jean Raspail, chroniqué dans la Zone.
Cette remise au goût du jour, aussi vulgaire et grossière, simpliste disais-je, qu'on le voudra, nous permet néanmoins de comprendre quelle est la cible réelle et, du coup, l'intérêt, du roman de Laurent Obertone. Guerilla n'est pas vraiment un livre sur la guerre civile qui vient, nous disent les mauvais augures, sur l'ultra-violence qui, pour s'exprimer, n'a même plus besoin de la géniale invention verbale à laquelle Anthony Burgess avait eu recours dans son remarquable Orange mécanique. Guerilla pas davantage n'est un livre sur le Grand Remplacement cher à Renaud Camus, mais un roman sur une France qui, contre les apparences trompeuses, s'est en fait déjà effondrée et c'est à ce titre que nous pourrions réaffirmer ce que j'ai écrit sur le roman de Jean Raspail : «Le Camp des Saints est un roman pré-apocalyptique, au sens où il affirme et démontre, d'une façon assez convaincante, que l'effondrement de la France est moins la conséquence de l'afflux prodigieux de mendiants et de va-nu-pieds sur son sol, que le résultat d'une longue et méthodique propagande bien-pensante, «terrorisme verbal» et «vérole contemporaine galopante», «gaz délétères de la pensée contemporaine», ennemi intérieur en tous les cas, rats de la nuit sortant au moment idoine de leurs trous puants comme dans La Peste écarlate de Jack London, sous-langage de la propagande diffusé sur les ondes, dans les journaux, lors de simples conversations, propagande qui a sapé les dernières forces qu'il restait à notre pays, miné le moral de ses troupes, détourné la mission de ses prêtres, pollué la cervelle de ses habitants, surtout ceux de Marcel et Josiane : «[...] il faut une fois encore en conclure qu'au-delà du manichéisme d'élite, dans quelque sens qu'on le prenne, l'histoire du monde blanc n'était plus qu'affaire de millions de moutons», et c'est bien là l'unique évangile auquel Laurent Obertone semble souscrire sans réserve.
Comment s'étonner, dès lors, que nul de nos médias officiels, sauf erreur de ma part, n'ait évoqué ce roman, puisque c'est bel et bien contre eux qu'il a été écrit, offrant ainsi une version romancée de la thèse développée dans La France Big Brother ? C'est d'ailleurs lorsqu'il moque férocement tous les éléments de langage de nos édiles et de nos journalistes perpétuellement honteux et craignant, davantage que d'écraser malencontreusement un piéton, de commettre une bourde linguistique inexcusable (par exemple, donner du meurtrier en lieu et place du jeune ou du crétin profondément inculte au lieu du jeune issu de la diversité et cherchant à s'exprimer par ce nouvel art hautement figuratif qu'est le rap), que Laurent Obertone est le plus efficace et même, parfois, outrancièrement drôle : «On parla ensuite du bien vivre ensemble, de symboles forts, d'ascenseur social, de jeunes sans histoire, de dialogue qui passe mal, de quartiers déshérités, de cette honte à la française» (p. 47) ou encore, morceau de bravoure vivre-ensembliste prononcé par le Président de cette France plus vraie que nature, Jacques Chalarose, qui ma foi me semble n'être qu'un trait à peine forcé du baratin tiers-mondiste qui nous est servi sans rougir depuis quelques lustres, de ce «Grand Enrichissement» (p. 54) que constitue ce que le vieil hibou solipsiste du Gers, Renaud Camus, nomme «Grand Remplacement», ou encore de ces «stationnaires» que nous sommes en face des «itinérants» qui ne sont riches que d'un seul trésor, «leur mal-amusement» ou bien «leur mal-insertion», voire «leur mal-vivre» (p. 56), autant de termes monstrueux, d'une laideur de barre de quartier, qu'une Anne Hidalgo ou ses communicants décérébrés, trente fois par jour au moins mais toute leçon s'apprend par la répétition, répètent sur le compte Twitter de cette démagogue d'une prétention stratosphérique. Songeons encore, car nous n'en sommes peut-être plus très loin, à cette «loi d'incritiquabilité du très-bien-vivre-ensemble» à laquelle une Anastasia Colosimo consacrera peut-être l'un de ses prochains essais. C'est affirmer, certes grossièrement, que la France est devenue la patrie du novlangue (voir encore le chapitre 30) inventé par George Orwell et qu'il faudrait en somme parvenir à se sevrer de cette drogue, comme le montre le film Equilibrium pour enfin ouvrir les yeux et constater de quoi il en retourne vraiment, là, tout près de chez moi, sous mes yeux à vrai dire, dans ma propre rue et non pas à l'abri derrière un beau bureau républicain ou de direction de quotidien national. Comme il le peut, avec ses moyens qui ne sont tout de même pas bien grands, Laurent Obertone illustre ce que j'ai appelé les langages viciés. Bien sûr, il serait cruel de faire remarquer à l'auteur que son écriture elle-même, qui n'est pas franchement la plus haute manifestation du génie français, est à sa façon expéditive un langage vicié.
Du coup, c'est bien une espèce de conversion que décrit Laurent Obertone, mais une conversion paradoxale, comme entravée, car aucun de ses personnages, à l'exception de ceux que nous avons cités, de quelques militaires de la 1ère compagnie du 2e REP, d'un colonel atrabilaire et du Breivik français, Vincent Gite, ne semblent être en état, ni même désirer comprendre que la réalité
14/11/2016 | Lien permanent
Le grenier de Bolton Lovehart de Robert Penn Warren
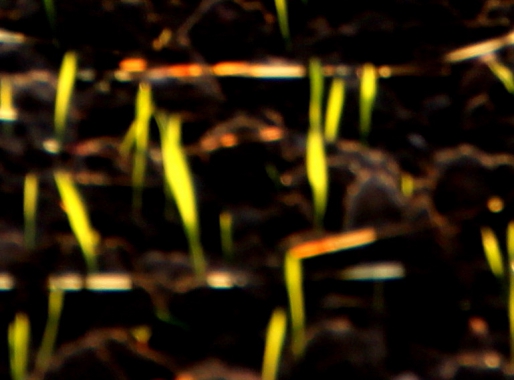
 Robert Penn Warren dans la Zone.
Robert Penn Warren dans la Zone.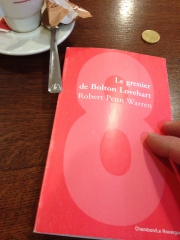 Le Grenier de Bolton Lovehart sur Amazon.
Le Grenier de Bolton Lovehart sur Amazon.Le grenier de Bolton Lovehart (1), intitulé dans sa langue d'origine The Circus in the Attic fait partie d'un recueil de nouvelles (The Circus in the Attic, and Other Stories) qui n'a pas été traduit dans son intégralité en France. Inutile de répéter ce que j'ai écrit sur le scandale que représente la rareté, chez les éditeurs, des grands romans de Robert Penn Warren.
L'ouverture de cette très belle nouvelle m'a fait penser à celle d'un texte de Malcolm Lowry, Écoute notre voix, ô Seigneur, ainsi qu'aux premières pages de Nostromo de Joseph Conrad. L'élan qui anime ces pages lui, fait irrésistiblement songer aux visions tumultueuses de Thomas Wolfe ou plutôt, à la succession incoercible de visions qui sont charriées ce géant, pressé d'englober de son regard, de ses bras, de son écriture, l'ensemble de la création se ruant vers une destination inconnue.
 Le passé est l'époque dans laquelle Bolton Lovehart vit comme, dirait-on, tous les personnages évoqués par Penn Warren dans ce très beau texte énigmatique et, sous un style froid, d'une sensibilité jamais mièvre qui est la marque des plus grands. Le monde a changé, nul ne peut le nier : il suffit de traverser le paysage (les premières pages, brûlées de lumière et de chaleur) qui mènent jusqu'à Bardsville pour s'en rendre compte. Le progrès, comme partout ailleurs, fait rage, nous ne connaissons bien sûr désormais plus qu'une époque pressée pleine des ruines du passé (combien de temps encore tiendront-elles debout ?), ne savons plus rien d'une époque pourtant proche où un homme «vivait dans la maison de rondins avec sa femme et deux enfants, et l'endroit lui appartenait, et c'était tout l'univers» (p. 14), et tel coin perdu comme Bardsville, «siège du comté de Carruthers» (p. 7), a lui aussi changé imperceptiblement, tout comme le vaste monde dans lequel certains s'élancent ainsi que Jasper Parton, mais pas Bolton Lovehart, lui, qui malgré une fugue qui lui fera découvrir, de façon éphémère puisqu'il est dit que Bolton Lovehart ne peut vivre ailleurs que dans son grenier, la vie dans sa commune et sordide brutalité, restera un sédentaire que rien ne distinguera de ses congénères, pas même ses rêves.
Le passé est l'époque dans laquelle Bolton Lovehart vit comme, dirait-on, tous les personnages évoqués par Penn Warren dans ce très beau texte énigmatique et, sous un style froid, d'une sensibilité jamais mièvre qui est la marque des plus grands. Le monde a changé, nul ne peut le nier : il suffit de traverser le paysage (les premières pages, brûlées de lumière et de chaleur) qui mènent jusqu'à Bardsville pour s'en rendre compte. Le progrès, comme partout ailleurs, fait rage, nous ne connaissons bien sûr désormais plus qu'une époque pressée pleine des ruines du passé (combien de temps encore tiendront-elles debout ?), ne savons plus rien d'une époque pourtant proche où un homme «vivait dans la maison de rondins avec sa femme et deux enfants, et l'endroit lui appartenait, et c'était tout l'univers» (p. 14), et tel coin perdu comme Bardsville, «siège du comté de Carruthers» (p. 7), a lui aussi changé imperceptiblement, tout comme le vaste monde dans lequel certains s'élancent ainsi que Jasper Parton, mais pas Bolton Lovehart, lui, qui malgré une fugue qui lui fera découvrir, de façon éphémère puisqu'il est dit que Bolton Lovehart ne peut vivre ailleurs que dans son grenier, la vie dans sa commune et sordide brutalité, restera un sédentaire que rien ne distinguera de ses congénères, pas même ses rêves.Bolton Lovehart vit sans vivre, écrit sans écrire («Il écrivait un livre. Ou plutôt, se préparait à écrire un livre», p. 49) comme Bartleby le scribe, et sa vie insignifiante et étrange «vous renvoie un éclat de soleil comme un héliographe dont vous n'auriez pas le code» (p. 7), mais il ne vit pas moins que d'autres, en apparence seulement plus vivants que lui, héros involontaires (2) comme Seth Sykes, l'ivrogne Cash Perkins ou encore comme l'ancêtre de Bolton, Lem Lovehart qui «avait fini par atteindre les grandes vallées au-delà des montagnes, poussé par un tempérament insatiable et une force obscure qu'il n'aurait pas su nommer» (p. 21). Peut-être est-ce l'image de la perfection qui le hante (cf. p 65) et, en le hantant, le paralyse.
Tous ces hommes, toutes ces femmes (qui finalement semblent bien plus vivantes que leurs compagnons) vivent cependant moins dans le passé que dans le flot d'un temps qui jamais ne s'arrête, comme des particules élémentaires livrées à elles-mêmes qui ne comprennent pas ce qu'elles font (3), et pourtant s'interrogent ou même, comme la mère de Bolton Lovehart au moment de mourir, s'indignent de partir alors qu'il leur restait tant à accomplir. Bolton Lovehart «ne se rappelait rien à cet instant, et ne pensait à rien» (p. 22), remarque ponctuelle qui vaut pour l'ensemble de son existence, alors que d'autres, au moins, comme le «redoutable lascar connu pour ses exploits à la bouteille, au couteau et à cheval» (p. 23) Tolliver Skaggs, peuvent affirmer, crânement : «Je suis arrivé ici très tôt, je suis arrivé dans les premiers. J'ai scalpé le premier Indien. J'ai abattu le dernier ours. J'ai sifflé le premier pichet de whisky, j'ai fumé le dernier ballot de tabac, et j'estime, par Dieu, que j'ai apporté la civilisation dans le comté de Carruthers !» (pp. 23-4).
L'écoulement du temps est remarquablement mimé par le rythme de l'écriture de Robert Penn Warren, qui en quelques pages parvient à faire revivre un petit coin de terre auquel il prête une signification universelle, symbolique, fascinante et inquiétante : telle chienne qui se met à suivre le jeune Bolton qui, énervé, lui lance des pierres, devient «une image de famine moyenâgeuse, d'humilité scabreuse et de mélancolique, d'infinie mansuétude» (pp. 31-2). Cet écoulement est aussi signifié par la modification d'un nom de lieu au fil des ans : «Il arrivait, dans les années quarante et cinquante, quand la structure sociale de Bardsville commençait à se durcir, que les gens qui vivaient alentour appellent la butte «Aristocrat Hill», avec un mélange d'envie et d'ironie. Et le nom, dans la bouche de ceux qui habitaient, non pas près de la place, mais tout en bas le long de la rivière, devint «Ristycrat Hill», puis, sans envie ni ironie, mais à force de passer à travers des dents jaunies et rendues à l'état de chicots dans de gros éclats de rire moustachus, «Rusty-Butt Hill». Et c'était resté «Rusty-Butt Hill» pour tout le monde sauf pour les marchands de biens et les dames qui résidaient dans les anciennes maisons de brique et accompagnaient chaque matin jusqu'au seuil leur époux en partance pour son cabinet d'assurance, son usine, son bureau, sa banque, son entrepôt ou son magasin» (pp. 24-5).
Tous, braves réels ou d'occasion, employés de banques ou, comme Bolton Lovehart, artisans amateurs créant des figurines de bois représentant le monde du cirque qu'il a découvert lors de sa fugue, tous sont pris dans le temps comme s'ils étaient tombés dans le courant puissant d'un fleuve. Ainsi, à les revoir «soixante ans plus tard, on n'a guère l'impression qu'ils se déplacent, mais plutôt qu'ils sont figés dans une photographie sur la page d'un album pour prouver quelque chose de tendre et de certain concernant le passé», et cette même immersion totale dans le temps qui fait prendre conscience à Simon Lovehart, le père de Bolton, du «réseau de vie puissant, vibrant, omniprésent qui relie la femme et l'enfant [sa femme et son fils, donc], vainqueur et victime» et quand il perçoit, poursuit Penn Warren, «la présence de ce réseau et la palpitation du million de sombres tentacules, il se sent comme au bout de quelque chose, debout sur un promontoire, perdu, tandis qu'un vent lointain se lève quelque part dans la nuit derrière lui. Il n'a plus de regrets quand il est là. Il est au-delà des regrets. Si le vent venait à souffler sur lui, il refermerait son manteau et le boutonnerait. Quand il effleure, accidentellement, dans la maison, un seul fil de ce réseau, il se fige et frissonne de tous ses nerfs» (p. 27).
C'est du reste peut-être parce que Simon Lovehart détient la vérité, une balle jamais extraite d'une de ses cuisses, «balle minuscule, pas plus grande et de même forme que l'ongle du pouce, depuis longtemps lavée et rendue comme neuve par son sang», balle qui «repose, précieuse et lourde au chaud et au secret dans l'intimité de sa chair comme un talisman ou un joyaux, et lui dit ce qu'il a besoin de savoir», c'est peut-être parce que Simon Lovehart fait ainsi partie «des bienheureux qui portent en eux l'explication de toute chose», qu'il «peut vivre loin de toutes les passions» (p. 28), comme son fils, Bolton Lovehart, qui fixe sans le comprendre le visage ou plutôt le masque du destin et qui est même peut-être, à sa façon tranquille et énigmatique, une des incarnations de ce même destin aux millions de visages impénétrables.
Lorsque Robert Penn Warren tente de nous indiquer quelle importance peut avoir sa fugue dans l'esprit d'un être tel que Bolton, sa réponse est saisissante : «Si sa fugue avait été bien préparée, il y avait toutefois derrière cette préparation une nécessité aussi impérieuse et aussi peu analysée que celle qui l'avait entraîné dans les eaux de la rivière [pour y recevoir, à son insu presque, le baptême de l'église épiscopale !]. Ou impossible à analyser; car si on l'avait analysée, puis qu'on ait analysé les composantes, n'aurait-on pas été finalement obligé d'affronter, dans l'obscurité la plus profonde», au-delà même, précise Penn Warren, «de tous les projets, intentions et justifications, au-delà de tous les livres qui furent jamais écrits, des histoires et des sermons et des prières et des explications du bien et du mal ou de l'héroïsme et de la lâcheté», le «besoin au visage impavide se balançant dans les ténèbres, enroulé sur lui-même comme le ressort de son être, l’œil sans paupière, l’œil éternel luisant d'un éclat impérieux, scrutant au plus profond de son propre œil avec la fixité hypnotique et impitoyable de la destinée ? (pp. 37-8).
Cet œil ressemble à celui, monstrueux et inexplicable, que Michel Bernanos fait surgir comme vision ultime, impossible comme une illumination noire, avant leur pétrification définitive, des explorateurs de La Montagne morte de la vie, et c'est sous le même soleil ou plutôt œil, nous l'avons dit, incompréhensible et monstrueux, que Robert Penn Warren place ses propres personnages, qui eux aussi considèrent leurs actes et ne les comprennent pas : «Mrs Lovehart le vit [son mari] s'écrouler. Elle se précipita hors de la maison et s'accroupit à côté de lui, sous les chênes, en relevant la tête pour pousser de grands cris d'angoisse qui auraient pu tout aussi bien être de grands cris de triomphe; car nul ne connaît le sens des cris que lui inspire la passion tant que la chair de la passion n'est pas depuis longtemps desséchée pour laisser voir l'austère et logique articulation des faits avec les faits dans le squelette du temps» (p. 43). Autant dire que c'est le romancier, et lui seul, encore plus que l'historien, qui peut démêler les intentions les plus obscures, contempler «le squelette du temps», en éprouvant ce que tel de ses personnages éprouve, une minuscule et éphémère illumination, un instant de déhiscence absolue, «dans la fusion et la contraction du temps, la pure, l'essentielle stupéfaction de la paix qui succède soudain au tumulte» (p. 44).
Robert Penn Warren, tout du moins son narrateur, voit ce que ses personnages ne voient pas, mais il n'est pas certain qu'il puisse voir autre chose qu'une aporie, l'absence de toute vision qui le laissera insoumis, inquiet et désireux, une fois de plus, de se mettre à la recherche de la vérité, qui seule permet à l'homme qui l'a découverte de «vivre loin de toutes les passions» (p. 28). Sara Darter se donne à Bolton Lovehart, avant de le quitter définitivement et d'en épouser un autre, et voici ce que nous savons et qui est fort maigre des raisons de sa décision : «Ce projet de départ toutefois, lui était venu brusquement à l'esprit, comme une révélation, la veille de sa dernière soirée avec Bolton Lovehart. L'ultime rencontre avec lui ne faisait pas partie du projet. Ou alors comme quelque chose qui ne s'était pas montré à la surface du fleuve, là où les scories du quotidien tournoient et s'accumulent en pleine lumière, mais se laissait ballotter par l'eau sombre et profonde au cœur même du courant, comme un vieux bout de bois noirci et gorgé d'eau, repris à la vase, et poussé en secret vers les rapides qui fusaient entre les rochers, là où les eaux bouillonnantes se précipitaient dans un dernier accès de fureur sur les calmes biefs de l'aval, et où dans la violence de cet ultime étranglement l'incontrôlable fardeau intérieur poussait et se soulevait, noir, brut, énorme et ruisselant, comme un poisson arraché à son trou d'eau et qu'on hisse en pleine lumière» (p. 56).
Obscurité, profondeur, sauvagerie, œil sans paupière qui se regarde mais aussi «miroir à l'intérieur du miroir réflecteur»; réalités contraires (vengeance et expiation) «à jamais opposées, à jamais orientées vers le dedans de soi et à jamais vers le dehors du monde, deux infinités jumelles» (p. 57); mots d'une autre que la mère de Bolton Lovehart entend lorsqu'elle comprend qu'elle va mourir, ces mots d'une autre qui ne sont portant que ses propres mots d'indignation et de peur face au gouffre noir, lancés contre cette «bestiole hypocrite et sournoise, ce coeur qui la trahissait» (p. 69) : autant d'exemples nous prouvant que la connaissance, pourtant synonyme de pouvoir selon l'auteur (cf. p. 73), est définitivement éloignée de nos personnages humbles et banals, qui semblent ne rien savoir ni comprendre d'eux-mêmes, sinon soupçonner, parfois, qu'ils ont été jetés dans le fleuve du temps qui jamais ne leur accordera plus que quelques courts instants de paix sur une berge elle-même instable.
Notes
(1) Robert Penn Warren, Le grenier de Bolton Lovehart (The Circus in the Attic, 1947, traduit de l'américain par Pierre Girard, Chambon / Le Rouergue, 2004). Je signale une bizarrerie fâcheuse, la mention, à la page 77, d'une date («automne 1917») qui est totalement incohérente avec les pages qui la précèdent et celles qui la suivent, qui décrivent la Seconde Guerre mondiale où Jason Parter, le fils de la femme que Bolton Lovehart finira par épouser, trouvera la mort.
(2) «Car Seth et Cassius n'étaient peut-être pas différents de tous les autres héros», affirme ainsi Robert Penn Warren, «des hommes ivres de whisky, ou de quelque chose de tout aussi fort qui vous monte au cerveau, et qui se jetèrent à la tête de l'ennemi, ou moururent en défendant un chargement de grain, ou n'importe quoi d'autre, produit à la sueur de leur front» (pp. 19-20).
(3) Ainsi de Lem Lovehart : «Puis il se coucha dans l'herbe, dans le grand silence que rompait de temps à autre le gazouillement liquide, somnolent, d'un rouge-gorge, ou une dernière explosion de cris d'oiseaux dans les cèdres, et sans raison apparente son cœur mollit et enfla dans sa poitrine et il pleura» (p. 22).
03/03/2016 | Lien permanent
Bellum Dei : Guerre sainte, martyre et terreur de Philippe Buc, par Francis Moury

«Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice.»
Saint Paul, Épitre aux Éphésiens (vers 60 à 61 après Jésus-Christ), versets 6-12 à 6-14, traduction Louis Segond (1910).
«Un prêtre, nommé Pierre Barthélémy, raconta que saint André lui avait montré dans l'église de Saint-Pierre l'endroit où l'on trouverait le fer de la lance qui avait percé le côté de Notre-Seigneur. Il l'avait assuré que ce fer sacré serait pour les croisés un gage certain de leur prochaine délivrance, pourvu qu'ils fissent pénitence de leurs péchés. Ce prêtre offrait de passer au travers d'un feu pour confirmer la vérité de ce qu'il annonçait. Le comte Raymond de Saint-Gilles (1) envoya à la recherche de la lance plusieurs seigneurs, parmi lesquels était Ponce de Balazuc. On creusa à l'endroit indiqué et, après toute une journée de travail, on trouva en effet un fer de lance dont la vue exalta le courage des croisés. Ceux-ci, ranimés par l'évènement, firent une sortie et triomphèrent des Musulmans dans une bataille célèbre. Pendant tout le combat, Raymond des Agiles porta la sainte lance devant Adhémar de Monteil son évêque, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même dans son histoire (2). La ville d'Antioche fut délivrée (fin de juin 1098), et l'armée chrétienne put continuer sa marche vers Jérusalem.»
Abbé Fillet, Un chevalier du Vivarais à la première croisade : Ponce de Balazuc (Imprimerie centrale de l'Ardèche, 1895), pages 6 et 7.
Quel est le point commun historique, sur une longue échelle temporelle couvrant la période de l'Ancien Testament à nos jours, entre des faits en apparence aussi hétérogènes que la Guerre de Judas Maccabée, la Guerre des Juifs selon Flavius Josèphe et Tacite au 1er siècle après Jésus-Christ, les martyrs chrétiens puis païens de la période impériale romaine, la première Croisade armée médiévale en Terre sainte de 1096, le procès de Jeanne d'Arc en 1431 puis son procès en réhabilitation en 1456, les guerres de religion anglaises et françaises des années 1550-1700, la Terreur de l'année 1793 durant la Révolution française, la Guerre américaine de Sécession de 1861-1865, les purges staliniennes soviétiques de 1937-1938, les exactions de la Fraction Armée Rouge ouest-allemande entre 1970 et 1980, la première guerre d'invasion américaine de l'Irak en 2003 ?
Fascinante car très ample question dont l'étude fut initiée (voir p. 9) par l'auteur au Maroc en 2001 dans une contribution (écrite en arabe) intitulée Violence et terreur dans la culture chrétienne occidentale puis dans une conférence prononcée à l'École française de Rome en 2003 sur La vengeance de Dieu. Parmi les historiens revendiqués comme inspirateurs valables, durant la rédaction principale du livre à l'université de Stanford puis à celle de Yale, Philippe Buc cite d'emblée, et dans cet ordre : Norman Housley, Jean Flori, Jay Rubinstein, Gerard E. Caspary, Denis Crouzet. De tous, c'est Caspary qui semble son mentor : ce dernier avait été, en 1979 à l'université de Berkeley, l'auteur d'une étude sur les relations de la politique et de l'exégèse chez Origène.
Philippe Buc utilise, pour y répondre, deux types de sources. Les sources primaires sont la patristique grecque et latine, les mémoires médiévaux, les minutes de procès, les articles de journaux, les libelles et les pamphlets, les entretiens, les discours, les correspondances. Les sources secondaires sont les thèses et mémoires universitaires, les livres, les articles de revues ayant tenté de ramener cette diversité historique à l'unité théorique. Philippe Buc prévient le lecteur que sources primaires et secondaires, distinguées pour la forme par une dichotomie bibliographique en fin de volume, se recoupent cependant parfois inévitablement : saint Paul, saint Augustin ou bien encore Tertullien sont, de toute évidence, parties prenantes sur les deux plans, historiques et théoriques.
Philippe Buc met, en outre, en garde contre une méprise possible du lecteur : le sujet sélectionné n'épuise pas la matière dans la mesure où il aurait pu choisir d'étudier les formes chrétiennes du pacifisme en Occident, non moins prégnantes et avérées que les formes chrétiennes de la violence en Occident. Dans la mesure aussi où toutes les violences historiquement repérables en Occident n'ont pas leur source unique dans le christianisme : autre évidence qui allait sans dire mais qui va mieux en la disant. Cette face sombre et tourmentée de la religion n'annule ni ne remplace donc sa face lumineuse et paisible : le lecteur doit avoir conscience que toutes deux existèrent et existent encore simultanément. Cette double face présume d'une possible dialectique philosophique dans l'interprétation du phénomène religieux, dialectique au sens le plus étymologique du terme, à savoir celui de la science des contraires (la tension théologique entre l'ancien et le nouveau, entre la lettre et l'esprit, entre la guerre et la paix, entre l'élection singulière et l'universalisme, entre l'idée de contrainte et celle de liberté) mais aussi (c'est moi qui l'ajoute car Philippe Buc ne lui accorde pas assez de place à mon goût) dialectique au sens moderne hégélien puisque G.W.F. Hegel fut peut-être le premier philosophe occidental à pleinement penser l'ambivalence du sacré avant même qu'elle soit, par la suite, confirmée par les travaux sur les religions primitives étudiées sociologiquement et psychologiquement par Frazer, Freud, Lévy-Bruhl, Mauss, Durkheim ou bien encore, plus près de nous, Mircea Eliade et Roger Caillois. Qu'on se souvienne que Roger Caillois faisait, dès 1950, de cette ambivalence une des caractéristiques essentielles du sacré (3), On sait aussi que le sacré est souvent doté, dans les religions primitives ou archaïques comme dans les religions monothéistes plus récentes, d'une charge ambivalente, source de vie mais aussi dispensatrice de mort. Elle est ici symbolisée très concrètement et historiquement par l'ambivalence du martyre qui perdure depuis la Rome antique en passant par la Guerre de Sécession jusqu'aux purges staliniennes en apparences purement athées mais, si j'ose dire, martyrologiquement comme structurellement influencées par le martyre chrétien antique : victime offerte à Dieu mais aussi victime permettant de déclencher la vengeance divine sur ses bourreaux, voire d'anticiper l'Apocalypse selon saint Jean. Les démonstrations sont souples, nuancées, parfois inattendues et toujours admirablement étayées.
Un exemple permet d'ailleurs de s'en rendre compte, sans pour autant verser dans le plus niais des relativismes. L'écrivain espagnol catholique Juan Ginès de Sepulveda (1490-1573) justifia les guerres menées par les conquérants espagnols contre les peuples primitifs américains par plusieurs arguments (p. 368), d'ailleurs inévitablement repris plus tard partiellement par les colons protestants de la Nouvelle Angleterre. Outre les attaques régulièrement atroces dont étaient victimes les colonisateurs, outre les blasphèmes occasionnels dont se rendaient coupables les colonisés, des cas avérés de cannibalisme et de sacrifices humains avaient été constatés; le christianisme devait donc y mettre fin, d'une manière (paisible) ou d'une autre (armée). La conscience morale occidentale contemporaine, ainsi que Philippe Buc le signale (aussi p. 368), n'approuverait probablement pas aujourd'hui l'idée qu'il faille faire la guerre pour une raison religieuse mais elle prendrait certainement en considération l'idée qu'il faille faire la guerre pour supprimer le cannibalisme. La conception médiévale de la loi naturelle (et de son contenu conceptuel) n'est, alors, plus tout à fait une étrangère pour la diplomatie internationale contemporaine : il y a une curieuse continuité dont les solutions formelles sont méticuleusement relevées.
En somme, de l'histoire religieuse à l'histoire des religions puis à la philosophie de la religion, la conséquence existe et le dialogue entre disciplines s'avère enrichissant. Un tel livre fait regretter que l'auteur ait fait l'impasse sur les «religions politiques» (sic) du vingtième siècle que sont, aux yeux d'un certain nombre de ses confrères, le nazisme, le fascisme et le communisme mais il s'en justifie (à la page 78). Sur le plan strictement philosophique, Philippe Buc adopte une sorte de néo-kantisme renonçant à l'explication causale pour se concentrer sur les formes des phénomènes. Les thèses, sinon étiologiques du moins partiellement explicatives de Sigmund Freud (4) ne sont même pas évoquées mais celles de René Girard, de Max Weber, d'Ernst Kantorowicz, de Michel Foucault et d'autres sont citées, parfois rapidement mais justement écartées (Foucault, p. 23). Globalement, Buc se veut modeste : il n'est ni G.W.F. Hegel ni Auguste Comte qui pensaient, l'un comme l'autre, détenir la clé permettant de comprendre les causes de l'histoire. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt de fournir au lecteur contemporain les clés lui permettant de comprendre la manière dont les hommes passés ont eux-mêmes envisagé le sens de leur action.
Passons à l'aspect matériel du livre. Cette traduction française diffère de l'édition originale américaine et de sa traduction allemande de deux manières. Elle est dénuée de son «lourd apparat critique de notes» (sic) bibliographiques de bas de page (apparat bien évidemment publié dans l'édition américaine originale Holy War, Martyrdom and Terror. Christianity, Violence and the West (Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2015) et dans sa traduction allemande Heiliger Krieg (Darmstadt, Wissenchaftliche Buchgesellchaft, 2015) mais elle est munie d'une Postface inédite (pp. 449 à 465) proposant «quelques réflexions préliminaires d'histoire comparée sur violence et religion, entre Byzance, l'Islam, le Japon et le Mexique précolombien (5). Elles visent à faire ressortir par contraste les spécificités du monde que le corps du livre explore, chrétiennes comme postchrétiennes». Je recommande évidemment les intéressantes pages sur l'Islam (454 à 458) qui sont d'une actualité brûlante et celles non moins passionnantes sur le bouddhisme japonais qui connut au moins une école, celle du moine médiéval Nichiren (1222 à 1282), prônant l'étude de la sagesse et la lutte armée pour la faire appliquer par la force. Byzance est un cas intéressant : ce rameau de l'arbre catholique ne fut pas violent comme le furent les autres branches du même arbre. Philippe Buc tente d'expliquer pourquoi. Le cas du Mexique précolombien qui occupe les dernières pages me semble totalement différent des précédents et, en cela, pas tout à fait à sa place car il relève en effet de la mentalité primitive que Jean Cazeneuve (disciple de Lucien Lévy-Bruhl dont il résuma soigneusement la pensée) préférait dénommer mentalité archaïque (6).
La question qui se pose n'est pas tant de savoir si le lecteur français appréciera de disposer d'une postface inédite de quinze pages (munie pour sa part, enfin, de ses riches et précises notes bibliographiques de bas de page, faisant ainsi davantage regretter l’absence de ces mêmes notes dans les sections précédentes) que celle de savoir comment Philippe Buc, professeur français enseignant dans les universités américaines et européennes les plus prestigieuses (Stanford, Yale, Vienne, etc.) a osé accepter que la Bibliothèque des Histoires fournisse aux étudiants français une édition amputée de son apparat critique. En quoi le «pari éditorial» (p. 7) de Pierre Nora, le directeur de la Bibliothèque des histoires, d'offrir une édition allégée se justifie-t-il ? S'imagine-t-on que pour habiller Paul (un éventuel et mythique grand public cultivé ou curieux) il faille déshabiller Pierre (le très réel public universitaire, premier destinataire naturel d'un tel livre) ?
La conséquence étant que, lorsque Buc cite saint Augustin – et il le cite assez souvent : c'est même un des auteurs les plus évoqués, ainsi qu'en témoigne l'index des noms cités, p. 530 – le lecteur doit se reporter à la bibliographie pour deviner, entre les différents titres de saint Augustin qui s'y trouvent rangés comme «source primaires», de quelle page de quel texte précis peut bien provenir la citation qu'il vient de lire : du De Doctrina christiana, du De Genesi ad litteram libri duodecim, du Enarratio in Psalmos, des Scripta contra Donatistas, d'un autre titre parmi la dizaine mentionnée ? Mystère ! En l'état, sur le plan universitaire, ce livre est donc – je le dis à regret mais avec la plus grande fermeté – inutilisable tant pour l'étudiant français que pour le professeur français qui devront se reporter systématiquement à son édition américaine ou allemande s'ils veulent connaître précisément l'origine des nombreuses citations qui enrichissent constamment ce texte passionnant. Inutile de dire que ni Jacques Le Goff ni Georges Dumézil, tous deux cités avec admiration par Philippe Buc parmi les auteurs publiés en Bibliothèque des histoires et en Bibliothèque des idées à la NRF, n'auraient approuvé une telle mutilation. J’espère sincèrement qu’une nouvelle édition, rétablissant les notes de bas de page, verra le jour.
La bibliographie, intégralement conservée (frissonnons tout de même rétrospectivement en songeant qu'elle était, si on tient compte de la même logique éditoriale, passible d'un allègement) est riche et mentionne des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Certaines de ces mentions ne sont cependant, sur le plan bibliographique francophone, pas à jour. L'auteur cite, par exemple, le Manuel de l'inquisiteur de Bernard Gui (1261-1331) dans une édition du texte latin parue en 1886 alors que nous disposons depuis 1926 de l'excellente édition critique du texte latin avec traduction française, apparat critique, présentation et notes de G. Mollat et G. Drioux, d'abord éditée en deux volumes chez Champion puis reprise en un seul volume aux éditions Les Belles lettres (collection Classiques de l'histoire de France au Moyen Âge, dernier tirage 2012). Même chose pour saint Augustin dont les livres sont cités d'après d'obscures éditions allemandes ou autrichiennes du texte latin alors qu'il existe depuis 1933 une Bibliothèque augustinienne francophone munie d'excellentes éditions critiques (texte latin + traduction française, introduction, variantes et notes) publiée par l'Institut d'études augustiniennes, actuellement éditée chez Brepols et dont le site est consultable ici.
L'index des noms cités est riche, globalement fiable et bien établi mais parfois lacunaire et, dans deux cas au moins, partiellement erroné. Certains noms cités dans le livre n'y figurent pas alors qu'ils le devraient ou bien l'index fournit certaines pages où le nom est cité mais n'en fournit pas certaines autres où il l'est pourtant. Voici quelques exemples : Christine de Pizan citée p. 289 ne figure pas dans l'index; idem pour Dante pourtant cité p. 132 ainsi que pour Lactance pourtant cité p. 337, le curieux témoin Phinéas pourtant cité p. 189, l'historien allemand Ernst Troeltsch pourtant cité p. 319 (d'une manière qui me semble un peu légère sur le plan théorique : sa position méritait d'être discutée plus amplement). L'historien américain Michael Gaddis est, pour sa part, cité (p. 149) et bien référencé dans l'index mais sa référence lui confère (p. 533) le faux prénom de «John» alors que la bibliographie lui restitue (p. 502) son correct prénom Michael ! Même configuration pour Joseph-François Michaud (1767-1839) correctement nommé dans la bibliographie mais rebaptisé «Jean-François» Michaud (p. 410) dans le corps du livre et ainsi référencé dans son index des noms (p. 536) ! (7) Le reste est impeccable.
Notes
1) Raymond IV, comte de saint Gilles et de Toulouse, commandait fin octobre 1096 l'armée d'environ 100 000 soldats, levée par l'évêque du Puy Adhémar de Monteil, prenant acte des prêches du pape Urbain II environ un an plus tôt.
2) Raymond des Agiles (ou d'Aguilers), Historia Francorum qui ceperunt Hierusalem éditée par Migne in Patrologie latine, CLV, 591. Il était le chapelain du comte Raymond de saint Gilles avec qui il ne faut évidemment pas le confondre. Il existe une belle édition critique bilingue d'un autre témoin, un chevalier italien rallié aux troupes de Bohémond de Tarente, à savoir Histoire anonyme de la première croisade [Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum] (1096-1099), présentation, édition latine et traduction française par Louis Bréhier (éditions Les Belles lettres, Classiques de l'histoire de France au Moyen Âge, dernier tirage 2007).
3) Roger Caillois, L'Homme et le sacré (éditions Gallimard, NRF, 1950).
4) Philippe Buc aurait dû au moins citer, dans son chapitre 3 intitulé Folie, martyre et terreur, la célèbre étude freudienne de psychanalyse appliquée sur Une névrose démoniaque au dix-septième siècle (initialement parue dans Imago, tome IX, fascicule 1, Vienne et Leipzig 1923) traduite par Marie Bonaparte dès 1927, traduction revue et approuvée par Freud lui-même, puis reprise dans Freud, Essais de psychanalyse appliquée (éditions Gallimard, NRF, 1933 puis collection Idées Gallimard, 1971). Cette lacune est difficilement excusable.
5) En somme, Philippe Buc retrouve in extremis le thème ethnographique qui était au cœur de l'étude anthropologique si célèbre de Georges Bataille, La Part maudite (éditions de Minuit, 1949 puis réédition posthume augmentée, 1967).
6) Jean Cazeneuve, La Mentalité archaïque (éditions Armand Colin, 1961).
7) J'en profite pour signaler que l'ahurissante coquille «Victor Deblos» dans la bibliographie finale de mon Introduction à la philosophie des sciences d'Émile Meyerson (1859-1933) n'est, évidemment, pas de mon fait : il faut lire Victor Delbos, l'un des trois grands Victor de l'histoire française de la philosophie et de l'histoire de la philosophie française tout autant, avec Victor Cousin et Victor Brochard.
09/05/2019 | Lien permanent

























































