Rechercher : bernanos, lapaque
Le Mémorial secret de Guillaume Gaulène dans le ciel de traîne de la Première Guerre mondiale

 C'est à Georges Duhamel que Guillaume Gaulène dédie son Mémorial secret, paru six ans avant le premier roman de Céline, plus de dix ans avant La Nausée de Sartre, ne retenant l'attention que de quelques critiques comme s'en émeut Claude Elsen dans le numéro de Carrefour du 8 août 1962, qu'il s'agisse d'Edmond Jaloux, de Jean Paulhan ou de Robert Poulet, mais nous ne pouvons nous empêcher de songer à Georges Bernanos qu'à la date de publication de ce roman, 1926, l'auteur n'avait bien sûr pratiquement aucune chance de connaître.
C'est à Georges Duhamel que Guillaume Gaulène dédie son Mémorial secret, paru six ans avant le premier roman de Céline, plus de dix ans avant La Nausée de Sartre, ne retenant l'attention que de quelques critiques comme s'en émeut Claude Elsen dans le numéro de Carrefour du 8 août 1962, qu'il s'agisse d'Edmond Jaloux, de Jean Paulhan ou de Robert Poulet, mais nous ne pouvons nous empêcher de songer à Georges Bernanos qu'à la date de publication de ce roman, 1926, l'auteur n'avait bien sûr pratiquement aucune chance de connaître. Achevé durant l'hiver 1924 et publié deux ans plus tard aux éditions Rieder et de nouveau remis en circulation par Gallimard en 1962, sans que cet éditeur ne daigne mentionner quel fut son prédécesseur ni ne nous permette de le lire dans une édition revue et, surtout, disponible, Le Mémorial secret, comme le premier roman du Grand d'Espagne ainsi que le surnomma Roger Nimier, est tout entier né de la boue de la Première Guerre mondiale.
Je ne parle pas seulement d'une circonstance, certes majeure mais pouvant après tout être réduite à quelque événement biographique, ayant permis au narrateur, accompagné de ses amis, d'être attiré «dans cette ville de l'Est où [ils] ne sav[aient] que faire pour paraître durs», ce qui est une assez bonne définition du malheur qui accable nos contemporains, mais d'une espèce de bouleversement intérieur qui a tout submergé, et laisse ces épaves, comme l'eût écrit Julien Green, s'amuser dans les bras des femmes. Guillaume Gaulène lui-même, comme Georges Bernanos, a participé à la Première Guerre mondiale, et en a ramené un ouvrage, Des soldats, que je n'ai pas encore lu mais qui est décrit comme un des meilleurs témoignages de la vie dans les tranchées.
 Le narrateur affirme ainsi, dès la première page du roman, qu'il est «la dupe d'un mécontentement», car, avec ses amis, ils ont «trop attendu de la vie», alors que tous leurs «espoirs se sont écroulés sous un souffle mauvais» (p. 11). Deux pages plus loin, ce même personnage principal du nom de Langeac affirme sans hésiter que c'est bel et bien le premier conflit mondial qui a accru sa «tendance à la vie intérieure et à l'analyse aiguë» par l'expérience des «années de solitude dans l'enfoncement des terres boueuses qu'éclaboussait parfois le sang des morts». Et il continue ainsi : «Elle avait été exaltée par cette impression que nous avions eue d'être sans cesse seuls et silencieux au milieu des foules et du tumulte, par cette méditation sans fin sur nous-mêmes et sur la mort dont nous avions pris l'habitude au cours des heures lourdes tandis que les gaz empoisonnaient l'atmosphère et en faisaient quelque chose de troublant où l'on croyait qu'on allait s'engloutir, tandis que les obus passaient avec de lointains sifflements dont le bruit monotone et prolongé donnait le vertige» (pp. 13-4).
Le narrateur affirme ainsi, dès la première page du roman, qu'il est «la dupe d'un mécontentement», car, avec ses amis, ils ont «trop attendu de la vie», alors que tous leurs «espoirs se sont écroulés sous un souffle mauvais» (p. 11). Deux pages plus loin, ce même personnage principal du nom de Langeac affirme sans hésiter que c'est bel et bien le premier conflit mondial qui a accru sa «tendance à la vie intérieure et à l'analyse aiguë» par l'expérience des «années de solitude dans l'enfoncement des terres boueuses qu'éclaboussait parfois le sang des morts». Et il continue ainsi : «Elle avait été exaltée par cette impression que nous avions eue d'être sans cesse seuls et silencieux au milieu des foules et du tumulte, par cette méditation sans fin sur nous-mêmes et sur la mort dont nous avions pris l'habitude au cours des heures lourdes tandis que les gaz empoisonnaient l'atmosphère et en faisaient quelque chose de troublant où l'on croyait qu'on allait s'engloutir, tandis que les obus passaient avec de lointains sifflements dont le bruit monotone et prolongé donnait le vertige» (pp. 13-4). Ce Dieu absent que l'abbé Donissan n'en finit pas de chercher, que Mouchette, à sa façon torve, cherche aussi, le narrateur du Mémorial secret le cherche également, de femme en femme, constituant ainsi, alors même qu'il s'en rend compte, une prison invisible de laquelle il ne cherche que mollement à s'évader : «Il me semblait que je m'en allais comme à travers un rêve. Et j'éprouvais de plus en plus ce sentiment, obsédant à me faire crier, que cette course je l'avais déjà faite, que c'était une très vieille histoire qui se renouvelait, et qu'ainsi j'étais destiné, éternellement, à voir fuir ce que je convoitais à la minute où je désirais l'étreindre» (p. 74).
Ce Dieu absent que l'abbé Donissan n'en finit pas de chercher, que Mouchette, à sa façon torve, cherche aussi, le narrateur du Mémorial secret le cherche également, de femme en femme, constituant ainsi, alors même qu'il s'en rend compte, une prison invisible de laquelle il ne cherche que mollement à s'évader : «Il me semblait que je m'en allais comme à travers un rêve. Et j'éprouvais de plus en plus ce sentiment, obsédant à me faire crier, que cette course je l'avais déjà faite, que c'était une très vieille histoire qui se renouvelait, et qu'ainsi j'étais destiné, éternellement, à voir fuir ce que je convoitais à la minute où je désirais l'étreindre» (p. 74).C'est finalement assez simplement que cette préoccupation que l'on n'ose même pas dire lancinante, plutôt sourde, est posée, dès la première page de ce beau roman non pas noir mais désespérément gris, lorsque le narrateur estime que «le sens religieux est en nous, et dès qu'il n'a plus matière à s'exercer, nous sommes pour ainsi dire désarçonnés... Comment dès lors oublier nos déboires ! Où trouver une règle ? Pourquoi agir ?» (pp. 11-2). C'est en citant ce même passage que Philippe Sénart, dans son feuilleton littéraire de la revue Combat du 12 juillet 1962, pouvait écrire que les personnages de Guillaume Gaulène qualifié de «romancier perdu», «sans axiome, sans religion, sans prince», ce qui n'est qu'une formule journalistique, ne «pourront, hélas ! dans quelques années, que prêter l'oreille avec complaisance au long hululement de néant et de peur d'un Malraux». C'est d'ailleurs ce même critique qui, à la fin de son papier, écrit avec justesse que «les romans que nous a donnés M. Guillaume Gaulène brûlent déjà, dans la nuit qu'il se plaît d'habiter, d'une flamme forte et étrange», celle sans doute que j'ai cru apercevoir dans les textes qui ont suivi Le Mémorial secret, comme Le Vent d'Autan, cette flamme éclairant «des visages connus : Bernanos, Green, Huysmans», bien qu'elle «laisse dans l'ombre le seul qui vous intéresse et mériterait d'apparaître dans la pleine lumière à laquelle il a droit», celui, bien sûr, du romancier lui-même qui s'est vu rapproché de plusieurs écrivains auxquels il fait en effet plus ou moins penser, comme Édouard Estaunié que j'avais évoqué dans la Zone et que, ô surprise, mentionne à son tour Guillaume Gaulène, et même fait beaucoup plus que le mentionner puisqu'il lui dédie un de ses romans, Du Sang sur la Croix publié en 1925 chez Rieder : «au poète de la solitude et du silence», écrira-t-il ainsi bellement, ce même roman annonçant une étude qui à ma connaissance n'a jamais été publiée, Le problème divin dans la littérature d'aujourd'hui, dont le premier volume devait être consacrée à l'auteur de L'Ascension de Monsieur Baslèvre, analysé sous la figure de l'angoisse.
Comme Mouchette et Donissan, les héros du roman de Guillaume Gaulène cèdent à ce que nous appellerons, sur les traces de
 Bernanos, la séduction du désespoir qui, d'ailleurs, occasionne bien des ravages chez les personnages féminins, Mouchette donc et, dans le roman de Gaulène, Lucie qui se suicidera et Émilienne qui s'enfoncera dans la prostitution. Et Bernanos, encore, n'est jamais bien loin lorsque Guillaume Gaulène peut écrire dans son Vent d'Autan, à propos de Monsieur Clément, que «l'appel d'une aventure prodigieuse déchirait le silence» (p. 132).
Bernanos, la séduction du désespoir qui, d'ailleurs, occasionne bien des ravages chez les personnages féminins, Mouchette donc et, dans le roman de Gaulène, Lucie qui se suicidera et Émilienne qui s'enfoncera dans la prostitution. Et Bernanos, encore, n'est jamais bien loin lorsque Guillaume Gaulène peut écrire dans son Vent d'Autan, à propos de Monsieur Clément, que «l'appel d'une aventure prodigieuse déchirait le silence» (p. 132).C'est à vrai dire l'atmosphère elle-même dans laquelle baigne le sombre roman de Guillaume Gaulène qui semble avoir été contaminée par l'expérience de la vie dans les tranchées, que Gaulène connut dans le nord du pays d'Artois si cher à Bernanos; ainsi, telle analyse concernant le premier roman du Grand d'Espagne pourrait parfaitement convenir au poisseusement célinien (par endroits) Mémorial secret : «Une certaine urgence de faire connaître cette profonde expérience du Mal qu'il avait lui-même faite dans la guerre des tranchées semble avoir motivé la création du roman» (1), Gaulène affirmant par la bouche de l'un de ses personnages que la Grande Guerre a fait fermenter bien d'âpres rancunes : «Comme nous avions été les sacrifiés ! On aurait dit que chacun tirait gloire de l'immolation de son fils. Dans les campagnes, la mort du mari rapportait une pension... Est-ce qu'elles ne s'étaient pas remariées, la plupart des veuves !» (p. 183).
Certes, ce Mal, chez Gaulène, n'est pas directement nommé, identifié comme étant le Père du mensonge, Satan sous les traits d'un maquignon, mais c'est bel et bien lui qui fait s'interroger les personnages sur leur responsabilité devant des témoins qu'ils refusent finalement d'honorer sinon en les prenant puis en s'en débarrassant, la ronde des femmes à ravir rendant tout de même plus vive l'interrogation : «mais le mal qu'on a fait à une âme peut-il se réparer ?» (p. 206), et plus vive parce que, moins directement nous l'avons dit, le monde dans lequel les épaves de Gaulène s'agitent en croyant tromper leur ennui est désespérément vide de toute signification religieuse véritable, ancrée, établie, irrévocable, même si cette affirmation ne vaut par exemple pas pour Du Sang sur la Croix où la foi rayonne, et rayonne d'abord en luttant contre un amour par trop terrestre entre un homme et une femme : «Il ne faut pas blasphémer. Dieu existe par cela seul que notre imagination le conçoit, que notre cœur le réclame. Et il ne faut pas être sans Dieu. Malheur à celui qui se détourne du Ciel et ne voit que la terre, et ne voit que lui et sa misère. Malheur à celui qui cesse de s'exténuer à créer des religions pour remplacer celles qui sont mortes !» (p. 165).
 Comment une vie simplement remplie de plaisirs vite satisfaits, qui occultent même la possibilité, pour le héros principal du roman de Gaulène, de jouer les bons samaritains auprès de la jeune Émilienne point encore totalement corrompue quand il la rencontre, comment une telle vie oisive ne se décomposerait-elle pas, tout comme se décompose la vie fade de M. Clément qui comme M. Ouine aspire au néant et qui finira par jouer cette dernière à pile ou face ? : «Et puis nous avions vu tant de femmes corrompues autour de nous ! Nous étions nous-mêmes à tel point corrompus ! On aurait dit que notre âme s'était émoussée au contact de notre corps; on aurait dit qu'elle commençait à pourrir au contact de tant de vices. Et il n'y avait en nous aucune foi !» (p. 163).
Comment une vie simplement remplie de plaisirs vite satisfaits, qui occultent même la possibilité, pour le héros principal du roman de Gaulène, de jouer les bons samaritains auprès de la jeune Émilienne point encore totalement corrompue quand il la rencontre, comment une telle vie oisive ne se décomposerait-elle pas, tout comme se décompose la vie fade de M. Clément qui comme M. Ouine aspire au néant et qui finira par jouer cette dernière à pile ou face ? : «Et puis nous avions vu tant de femmes corrompues autour de nous ! Nous étions nous-mêmes à tel point corrompus ! On aurait dit que notre âme s'était émoussée au contact de notre corps; on aurait dit qu'elle commençait à pourrir au contact de tant de vices. Et il n'y avait en nous aucune foi !» (p. 163).Ce n'est pas dans Le Mémorial secret, en tout cas, que nous trouverons un chemin, fût-il étroit, de salut, ni même dans ce Vent d'Autan publié en 1961 par Gallimard, qui de nouveau a laissé s'engloutir ce roman en annonçant plusieurs autres (Nuit, Les Juives, M. Laurent s'en va dans la Nature et Émeraudes) dont il ne reste aucune trace, et dans lequel, une nouvelle fois, l'horreur de la Première Guerre mondiale semble ne pouvoir se dissiper de la conscience du personnage principal, M. Clément, comme le montre ce très beau passage que
 je cite longuement : «Il n'entendait même pas. Toujours face à cette maison. Il songeait à leur jeunesse, celle de Pélissier et la sienne. L'odeur qui montait de la tombe de Spirou, voici qu'elle lui rappelait celle qui, au sortir des camions, lorsqu'on arrivait en soutien de quelque offensive ou pour colmater une brèche, vous prenait à la gorge, venue du rouge horizon où parmi des flammes rampaient les vapeurs de chlore, les gaz asphyxiants, ceux à l'ypérite, tandis que s'élevait le grondement sourd, incessant, monotone, des bombardements sur la terre calcinée, les rivières aux berges écroulées, les villes et les forêts mortes. Ils allaient vers ces charniers, Pélissier et lui, portant leur havresac, leur fusil, le sac à grenades, la pelle et la pioche, quarante kilos de chargement, traînant leurs lourds godillots, mais jeunes, robustes, surmontant leur lassitude, exaltés par leur jeunesse, et celui qui précédait l'autre dans les boyaux où ils s’engageaient parfois se retournait pour un signe d'encouragement, un regard fraternel» (2).
je cite longuement : «Il n'entendait même pas. Toujours face à cette maison. Il songeait à leur jeunesse, celle de Pélissier et la sienne. L'odeur qui montait de la tombe de Spirou, voici qu'elle lui rappelait celle qui, au sortir des camions, lorsqu'on arrivait en soutien de quelque offensive ou pour colmater une brèche, vous prenait à la gorge, venue du rouge horizon où parmi des flammes rampaient les vapeurs de chlore, les gaz asphyxiants, ceux à l'ypérite, tandis que s'élevait le grondement sourd, incessant, monotone, des bombardements sur la terre calcinée, les rivières aux berges écroulées, les villes et les forêts mortes. Ils allaient vers ces charniers, Pélissier et lui, portant leur havresac, leur fusil, le sac à grenades, la pelle et la pioche, quarante kilos de chargement, traînant leurs lourds godillots, mais jeunes, robustes, surmontant leur lassitude, exaltés par leur jeunesse, et celui qui précédait l'autre dans les boyaux où ils s’engageaient parfois se retournait pour un signe d'encouragement, un regard fraternel» (2).Ce regard fraternel, Monsieur Clément, dans Le Vent d'Autan, ne le recevra pas, et aucune révélation apocalyptique ne se produira même si le vent, furieux, démolit le haut du clocher du village, tous ses habitants, alors, fuyant, «haletants, hurlant de terreur, en proie à cette épouvante qui s'emparera de la Création à la fin des temps, poursuivis par la meute des morceaux de ciment et des briques qui se ruait vers eux parmi les ténèbres et la poussière dans un vacarme de grondements sourds, de sifflements aigus et de longs fouets aux claquements secs» (p. 166).
Le salut, pour M. Clément comme pour le héros du Mémorial secret (3), semble absent, bouché, même si le personnage principal du Vent d'Autan se souvient des «vieilles idées chrétiennes» et, «au-delà des idées chrétiennes, d'autres, toujours les mêmes, venues des millénaires engloutis». Ah, si, alors, se dit Monsieur Clément, «au bout de ce voyage qu'il allait entreprendre il y avait cela : retrouver ceux qui étaient partis avant lui ! Oui, il les retrouverait. Déjà il sentait auprès de lui leur grande force apaisante et protectrice» (p. 200). Et il avance, il continue de marcher dans un paysage subtilement modifié par les ravages du progrès (cf. pp. 245 et 247) mais, quelques minutes avant de poser la tête sur un rail de chemin de fer, une lumière indéfinissable l'attire et, tout autant, l'isole; il marche «entre les rails, et ainsi cette double coulée de lumière l'isolait des talus déserts, des terres en fusion et des vallons silencieux et tristes; elle formait devant lui un chemin mystérieux et royal» (p. 296) qu'il emprunte, désireux de retrouver ceux qu'il a perdus.
Son souhait, apparemment, a été exaucé, comme celui de Monsieur Mazel, condamné aux galères parce qu'il est devenu un propagateur de l’Église réformée, qui mourra en martyr de la Vraie Foi et, même, deviendra saint, un saint étonnamment semblable à ceux de Georges Bernanos, humble, doutant, approchant de la tentation du désespoir sans aller toutefois jusqu'à plonger, comme Donissan, dans le vortex du Mal (5), en tout cas «un pauvre homme misérable, toujours tenté, sans cesse chancelant, comme ivre, en proie à des images, pleurant de fatigue, hanté par les souvenirs des jours heureux...» (4).
Notes
(1) Voir Genèse et structures de Sous le soleil de Satan de W. Bush, Paris, Archives des Lettres Modernes n° 236, Archives Bernanos n°10, 1988, p. 91.
(2) Guillaume Gaulène, Le Vent d'Autan (Gallimard, 1961), pp. 172-3.
(3) J'écris ces mots en me trompant peut-être, car je n'ai pour l'heure pas lu Le Destin, résolument introuvable, qui est apparemment la suite directe du Mémorial secret.
(4) Du Sang sur la Croix (Rieder, 1925), p. 195.
(5) C'est tout le sujet, pour le coup, d'un roman plus récent, L'Assaut, datant de 1962, ce terme prolongeant d'ailleurs la réflexion menée dans Du Sang sur la Croix, puisque l'assaut en question est tentation diabolique faisant chanceler Monsieur Mazel et Pierre Dormoy, lui aussi condamné aux galères et qui aura été tenté, sous l'effet de sa femme devenant folle à cause de son obstination, d'abjurer la foi réformée.
26/04/2024 | Lien permanent
Le Grand Large du soir de Julien Green

 J'ai été quelque peu troublé par ma lecture du Grand Large du soir, le beau journal que Julien Green a tenu durant les deux dernières années de sa vie, comme par le fait de reconnaître, au hasard d'une rencontre, le visage d'un ami perdu de vue depuis des années, dont les traits se seraient lentement estompés. Et, avec la réapparition de ce noble visage, c'est toute l'atmosphère des années que l'on croyait oubliées qui se lève, à la brune, et vient hanter notre sommeil. Lire Julien Green m'a ainsi rappelé mes longues heures de fièvre lorsque, tout jeune adolescent, les persiennes baissées (il devait s'agir d'un mois d'août, je garde le souvenir d'une chaleur lyonnaise suffocante), je lisai frénétiquement Adrienne Mesurat, Histoires de vertige, Le malfaiteur et tant d'autres romans dont j'ai aujourd'hui presque totalement oublié la saveur. Les bizarres représentations (peut-être ne l'étaient-elles même pas, puisque je n'en garde également aucun souvenir...) que je me faisais des créatures à la froideur âpre et passionnée si je puis dire inventées par Julien Green n'étaient pas moins invinciblement cruelles que les interminables après-midi que je passais alors à lire, dans un silence gluant que pas un bruit ne troublait, hormis les mots sortis de la bouche de ces fantômes plus réels que des êtres de chair. Plus froids aussi je l'ai dit, bien plus froids, comme les diaboliques de Barbey d'Aurevilly, goules brûlantes comme de la glace. Peut-être est-ce cette froideur, cette minéralité des personnages de Julien Green, incapables toutes deux de lutter contre l'atmosphère d'irréalité baignant les histoires racontées par l'écrivain, qui en a effacé en fin de compte, assez rapidement même, les contours.Je me souviens également que je devais retrouver Green plusieurs années après cet été de 1984 ou 1985 passé à Villeurbanne, au moment de commencer ma thèse de doctorat sous la direction forcément parisienne de Monique Gosselin qui tint absolument à me faire travailler sur les romans de Bernanos, Green et Mauriac. Je lui objectai que le troisième de ces romanciers ne me passionnait guère, que le deuxième, je l'avais quelque peu oublié, finalement que j'aurais préféré, de bien loin, prendre la suite de Max Milner en consacrant mes efforts à une étude de la figure de Satan après Baudelaire (en me plongeant donc dans les livres de Barbey, Hello, Bloy, Huysmans, Bernanos), rien n'y fit. Monique Gosselin me répliqua sèchement que le jeune étudiant que j'étais n'avait franchement pas son mot à dire sur de pareilles questions, réservées aux démiurges universitaires présidant les destinées des pauvres mortels dont je faisais assurément partie. Elle savait, pas moi. Je n'avais donc qu'à me taire ou... plier bagage. Quelques semaines après avoir commencé mes recherches, je constatai que le sujet choisi entre mille par cette éminente spécialiste de Bernanos (et d'une bonne quinzaine d'autres auteurs, apparemment...) avait été proprement asséché par une thèse volumineuse tout récemment parue. Beau travail. Je laissai tomber ma thèse donc, profondément dégoûté, ainsi que l'autorité doctorale qui m'avait si remarquablement orienté... Green, bêtement, fut lui aussi jeté aux orties durant bien des années, avant que je ne lise ce dernier tome de son journal, monument des lettres françaises, ne serait-ce que par l'ampleur du projet et la série des vicissitudes ayant émaillé sa réalisation.Je parlais de passé, de son aura, enfuie avec les jours lointains. D'où me vient cette sensation de vide ? De la perte des êtres autrefois aimés ? Non. L'homme moderne est creux parce qu'il n'est entouré de rien de plus que de clones. D'autres hommes creux. Plus aucun visage altier ne semble contempler celui, gracquien, de Julien Green, dont le regard doux semble fixer quelque paysage secret, intérieur, dont les yeux paraissent chercher ceux de ses chers amis morts, Mgr Pezeril et, par sa surnaturelle médiation, le Grand d'Espagne, Georges Bernanos, dont les toutes dernières heures furent veillées par l'homme de foi et de lettres qui ordonna les complexes brouillons des Cahiers de Monsieur Ouine. «Autrefois écrit Green, la littérature était faite d’individus. On pouvait aimer ou ne pas aimer, les idées étaient présentes et il y avait le coup de patte, le style. Gide, Cocteau, Mauriac, Bergson, Claudel, Sartre, Monterlant, Malraux, Aragon, Breton, Colette, et pour remonter plus loin Proust, Péguy entre autres, un monde existait, des idées circulaient en France comme le sang dans le corps humain. Maintenant, le corps devient cadavre, le sang semble figé…»Ainsi, tous les romans de Green pourraient être parfaitement résumés par cette phrase mystérieuse extraite de son journal : «Ma vie est un rêve. Je m’explique : je n’ai jamais considéré ce qui m’environnait comme réel.» Et l'auteur de Mont-Cinère et de Léviathan de lier cette évanescence de la réalité (mais cette fois, contrairement à l'impression produite par le rêve romanesque : dangereuse, pernicieuse, diabolique) à la disparition des écrivains qu'il a connus, à la lente destruction de la langue française, qu'il ne peut empêcher bien sûr, contre laquelle il n'a pas de mots assez durs. N'oublions pas que Julien Green a publié en 1924 un Pamphlet contre les Catholiques de France où nous pouvions noter (Œuvres complètes, t. I, Gallimard, coll. La Pléiade, 1972, p. 894-5) telle proposition absolument scandaleuse aux yeux des modernes : «Une autre marque de l’amour divin est l’enfer. L’idée de l’enfer est peut-être plus enivrante que celle du paradis ; elle nous montre notre âme à sa juste valeur, elle nous fait comprendre que ses fautes atteignent à des proportions surhumaines et que certaines d’entre elles sont absolument inexpiables. Or, pour qu’on les juge inexpiables, il faut certainement qu’on attache un prix infini à l’âme qui les a commises.»Autre vision, fragile comme un songe, encore une fois une histoire de langues oubliées, mortes, punies. J'ai ainsi été frappé de voir apparaître dans ce même tome du journal de Green, après avoir terminé ma lecture du superbe recueil de textes de Daniel Heller-Roazen évoqué précédemment sur ce blog, le motif de la tour de Babel, non plus fièrement dressée vers un ciel de conquêtes et de révoltes mais au contraire volontairement rampante, ayant abandonné son caractère turgescent, donc blasphémateur. Une tour non plus immense ni même s'enfonçant, selon Kafka, dans la profondeur de la terre mais se couchant, étendant son babélique brouhaha. Green note : «Simplifier la langue appauvrit la pensée. La langue qu’on essaie d’instaurer par ordinateur pour faciliter les échanges devient un magma universel, sans la fantaisie du volapük ou de l’espéranto et conduit à la pensée unique. De nouveau on construit Babel avec le même orgueil, mais de nos jours c’est une Babel horizontale, on commence par la confusion, on l’étend. Le plus terrible châtiment est là : la confusion par la simplification.» Green paraît d'ailleurs ne point se lasser de creuser ce thème, puisqu'il ajoute : «De la confusion. Ce serait le traité qu’il faudrait écrire. Je n’ai plus l’âge de m’adonner à ce genre d’exercice, mais il est vrai que la confusion a remplacé la déesse Raison. Pour se borner au langage, nous en arrivons à une nouvelle Babel, cette fois en creux, car sans orgueil, sans espérances, sans dangers.»
J'ai été quelque peu troublé par ma lecture du Grand Large du soir, le beau journal que Julien Green a tenu durant les deux dernières années de sa vie, comme par le fait de reconnaître, au hasard d'une rencontre, le visage d'un ami perdu de vue depuis des années, dont les traits se seraient lentement estompés. Et, avec la réapparition de ce noble visage, c'est toute l'atmosphère des années que l'on croyait oubliées qui se lève, à la brune, et vient hanter notre sommeil. Lire Julien Green m'a ainsi rappelé mes longues heures de fièvre lorsque, tout jeune adolescent, les persiennes baissées (il devait s'agir d'un mois d'août, je garde le souvenir d'une chaleur lyonnaise suffocante), je lisai frénétiquement Adrienne Mesurat, Histoires de vertige, Le malfaiteur et tant d'autres romans dont j'ai aujourd'hui presque totalement oublié la saveur. Les bizarres représentations (peut-être ne l'étaient-elles même pas, puisque je n'en garde également aucun souvenir...) que je me faisais des créatures à la froideur âpre et passionnée si je puis dire inventées par Julien Green n'étaient pas moins invinciblement cruelles que les interminables après-midi que je passais alors à lire, dans un silence gluant que pas un bruit ne troublait, hormis les mots sortis de la bouche de ces fantômes plus réels que des êtres de chair. Plus froids aussi je l'ai dit, bien plus froids, comme les diaboliques de Barbey d'Aurevilly, goules brûlantes comme de la glace. Peut-être est-ce cette froideur, cette minéralité des personnages de Julien Green, incapables toutes deux de lutter contre l'atmosphère d'irréalité baignant les histoires racontées par l'écrivain, qui en a effacé en fin de compte, assez rapidement même, les contours.Je me souviens également que je devais retrouver Green plusieurs années après cet été de 1984 ou 1985 passé à Villeurbanne, au moment de commencer ma thèse de doctorat sous la direction forcément parisienne de Monique Gosselin qui tint absolument à me faire travailler sur les romans de Bernanos, Green et Mauriac. Je lui objectai que le troisième de ces romanciers ne me passionnait guère, que le deuxième, je l'avais quelque peu oublié, finalement que j'aurais préféré, de bien loin, prendre la suite de Max Milner en consacrant mes efforts à une étude de la figure de Satan après Baudelaire (en me plongeant donc dans les livres de Barbey, Hello, Bloy, Huysmans, Bernanos), rien n'y fit. Monique Gosselin me répliqua sèchement que le jeune étudiant que j'étais n'avait franchement pas son mot à dire sur de pareilles questions, réservées aux démiurges universitaires présidant les destinées des pauvres mortels dont je faisais assurément partie. Elle savait, pas moi. Je n'avais donc qu'à me taire ou... plier bagage. Quelques semaines après avoir commencé mes recherches, je constatai que le sujet choisi entre mille par cette éminente spécialiste de Bernanos (et d'une bonne quinzaine d'autres auteurs, apparemment...) avait été proprement asséché par une thèse volumineuse tout récemment parue. Beau travail. Je laissai tomber ma thèse donc, profondément dégoûté, ainsi que l'autorité doctorale qui m'avait si remarquablement orienté... Green, bêtement, fut lui aussi jeté aux orties durant bien des années, avant que je ne lise ce dernier tome de son journal, monument des lettres françaises, ne serait-ce que par l'ampleur du projet et la série des vicissitudes ayant émaillé sa réalisation.Je parlais de passé, de son aura, enfuie avec les jours lointains. D'où me vient cette sensation de vide ? De la perte des êtres autrefois aimés ? Non. L'homme moderne est creux parce qu'il n'est entouré de rien de plus que de clones. D'autres hommes creux. Plus aucun visage altier ne semble contempler celui, gracquien, de Julien Green, dont le regard doux semble fixer quelque paysage secret, intérieur, dont les yeux paraissent chercher ceux de ses chers amis morts, Mgr Pezeril et, par sa surnaturelle médiation, le Grand d'Espagne, Georges Bernanos, dont les toutes dernières heures furent veillées par l'homme de foi et de lettres qui ordonna les complexes brouillons des Cahiers de Monsieur Ouine. «Autrefois écrit Green, la littérature était faite d’individus. On pouvait aimer ou ne pas aimer, les idées étaient présentes et il y avait le coup de patte, le style. Gide, Cocteau, Mauriac, Bergson, Claudel, Sartre, Monterlant, Malraux, Aragon, Breton, Colette, et pour remonter plus loin Proust, Péguy entre autres, un monde existait, des idées circulaient en France comme le sang dans le corps humain. Maintenant, le corps devient cadavre, le sang semble figé…»Ainsi, tous les romans de Green pourraient être parfaitement résumés par cette phrase mystérieuse extraite de son journal : «Ma vie est un rêve. Je m’explique : je n’ai jamais considéré ce qui m’environnait comme réel.» Et l'auteur de Mont-Cinère et de Léviathan de lier cette évanescence de la réalité (mais cette fois, contrairement à l'impression produite par le rêve romanesque : dangereuse, pernicieuse, diabolique) à la disparition des écrivains qu'il a connus, à la lente destruction de la langue française, qu'il ne peut empêcher bien sûr, contre laquelle il n'a pas de mots assez durs. N'oublions pas que Julien Green a publié en 1924 un Pamphlet contre les Catholiques de France où nous pouvions noter (Œuvres complètes, t. I, Gallimard, coll. La Pléiade, 1972, p. 894-5) telle proposition absolument scandaleuse aux yeux des modernes : «Une autre marque de l’amour divin est l’enfer. L’idée de l’enfer est peut-être plus enivrante que celle du paradis ; elle nous montre notre âme à sa juste valeur, elle nous fait comprendre que ses fautes atteignent à des proportions surhumaines et que certaines d’entre elles sont absolument inexpiables. Or, pour qu’on les juge inexpiables, il faut certainement qu’on attache un prix infini à l’âme qui les a commises.»Autre vision, fragile comme un songe, encore une fois une histoire de langues oubliées, mortes, punies. J'ai ainsi été frappé de voir apparaître dans ce même tome du journal de Green, après avoir terminé ma lecture du superbe recueil de textes de Daniel Heller-Roazen évoqué précédemment sur ce blog, le motif de la tour de Babel, non plus fièrement dressée vers un ciel de conquêtes et de révoltes mais au contraire volontairement rampante, ayant abandonné son caractère turgescent, donc blasphémateur. Une tour non plus immense ni même s'enfonçant, selon Kafka, dans la profondeur de la terre mais se couchant, étendant son babélique brouhaha. Green note : «Simplifier la langue appauvrit la pensée. La langue qu’on essaie d’instaurer par ordinateur pour faciliter les échanges devient un magma universel, sans la fantaisie du volapük ou de l’espéranto et conduit à la pensée unique. De nouveau on construit Babel avec le même orgueil, mais de nos jours c’est une Babel horizontale, on commence par la confusion, on l’étend. Le plus terrible châtiment est là : la confusion par la simplification.» Green paraît d'ailleurs ne point se lasser de creuser ce thème, puisqu'il ajoute : «De la confusion. Ce serait le traité qu’il faudrait écrire. Je n’ai plus l’âge de m’adonner à ce genre d’exercice, mais il est vrai que la confusion a remplacé la déesse Raison. Pour se borner au langage, nous en arrivons à une nouvelle Babel, cette fois en creux, car sans orgueil, sans espérances, sans dangers.»
01/04/2007 | Lien permanent
Les éclats des Éditions de l'Éclat

 À propos des Éditions de l’Éclat qui viennent de lancer leur collection de poche, baptisée Éclats. Chaque volume est vendu au prix de 8 €.
À propos des Éditions de l’Éclat qui viennent de lancer leur collection de poche, baptisée Éclats. Chaque volume est vendu au prix de 8 €.Dirigées par Michel Valensi depuis leur création, les Éditions de l’Éclat peuvent s’enorgueillir de posséder un catalogue remarquable où des auteurs comme José Bergamín, Jules Lequier, María Zambrano évoquée par Élisabeth Bart, Carlo Michelstaedter, Gershom Scholem, Hermann Broch, Leo Strauss ou encore Jacob Taubes ont été, bien souvent (que l’on songe ainsi aux trois premiers noms cités), révélés aux lecteurs français.
De l’auteur du Puits de l’angoisse, l’Éclat a publié un livre érudit, fantasque, «disparate» pour reprendre un des termes qu’affectionnait ce très grand écrivain que l’on croirait être un mélange de Borges et de Bernanos, intitulé L’Importance du Démon et autres choses sans importance et, du plus fidèle et fascinant ami de Walter Benjamin, plusieurs ouvrages ainsi qu’une très belle étude de David Biale, Gershom Scholem : cabale et contre-histoire.
Il était donc tout naturel, volonté de s’adapter à l’esprit du temps ou bien déclinaison assumée d’une politique éditoriale aussi courageuse qu’intelligente, que soient proposés aux lecteurs de courts textes dans une collection fort à propos baptisée Éclats et dont les titres les plus récents reprennent des extraits des volumes indiqués ci-dessus.
Nous saluerons ainsi la parution, de Gershom Scholem, des Dix propositions anhistoriques sur la cabale très intelligemment présentées par David Biale ainsi que, de José Bergamín, un titre pour le moins diablement borgésien, En tauromachie, tout est vérité et tout est mensonge, traduit et présenté par Yves Roullière, le meilleur connaisseur de ce magnifique auteur qui reste hélas bien trop méconnu en France.
Signalons encore quelques titres comme De la peine de mort, du judaïsme, de la démocratie et du principe d’humanité d’Hermann Broch, extrait du monumental ouvrage intitulé Théorie de la folie des masses publié par l’Éclat en 2008, ou encore Le Jésus de Nietzsche de Massimo Cacciari, un auteur présent dans le catalogue de nos éditions au travers de deux titres, Déclinaisons de l’Europe et Drân.
04/06/2012 | Lien permanent
Béni soit Juan Asensio !, par Christopher Gérard
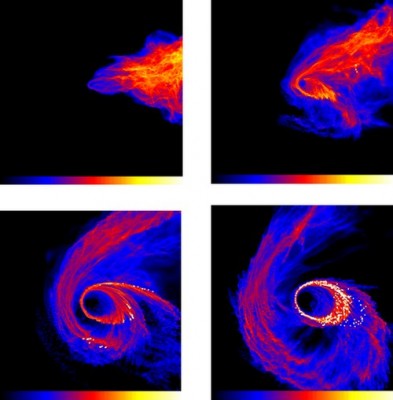
Je reproduis, avec la permission de l'intéressé, ce compte rendu de Maudit soit Andreas Werckmeister ! rédigé par Christopher Gérard pour le numéro d'été de la revue Éléments.
Juan Asensio, alias Stalker sur la toile, a ceci de nietzschéen qu’il vomit les tièdes. Son dernier livre se place, comme les précédents, dans la lignée Bloy-Bernanos-Boutang : l’écrivain cravache et agonit d’injures tous ceux qu’il soupçonne de pactiser avec le nihilisme ambiant – et ils sont légions, ceux qu’il appelle les cacographes ! Ce critique à la désespérante érudition, qui jongle avec Steiner (Georges, pas Rudolf), Broch et Celan, s’essaie pour la première fois à la création pure, du moins dans la première partie, vraiment réussie, de son inclassable ouvrage (pamphlet ?), où l’on suit, halluciné, le dernier homme, survivant d’un monde dévasté, déambulant dans une gigantesque salle d’autopsie et contemplant le cadavre desséché de notre littérature. Ses lecteurs reconnaîtront le goût très hispanique d’Asensio pour les scènes tour à tour apocalyptiques (maelström, trou noir) ou macabres, ainsi que des vues justes sur la fonction théophanique de la littérature. Ils reconnaîtront au passage l’influence de La Route, de Cormac Mac Carthy, chef-d’œuvre dont Asensio a magnifiquement parlé sur son site. Pour ce chrétien intransigeant, la littérature doit se libérer de l’infection idéologique qui la ronge jusqu’à l’os et corrompt la langue même. A rebours de l’étouffant matérialisme, il en appelle à un retour aux sources orphiques de la création et, pour la critique, à la redécouverte d’une vertu cardinale en art, aujourd’hui diabolisée : l’admiration. Asensio s’inscrit dans un courant encore minoritaire de reconquista spirituelle et intellectuelle, où l’on trouve aussi Millet, Barthelet ou Werner, pour citer des auteurs d’essais parus cette saison. Suivons-le avec attention, même si nous n’approuvons pas toutes ses fulminations, par exemple quand il regrette que la langue française n’ait «pas été épurée de ses fictions les plus dangereuses», ou quand il affirme que notre littérature se meurt – ce qui est faux, elle vit dans la clandestinité – parce qu’elle se serait éloignée de ses «fondements chrétiens». C’est oublier un peu vite Homère, Sophocle et Virgile, les pères de notre tradition. Curieux chrétien que cet Asensio : la charité ne l’inspire pas outre-mesure et la vertu d’espérance lui est étrangère. Or, pour faire allusion à un poète infréquentable, le désespoir n’est-il pas une forme de sottise ?
Pas de panique, Asensio, pasaremos.
28/08/2008 | Lien permanent
Les larmes du Stalker. Entretien avec Marc Alpozzo, 4

06/08/2008 | Lien permanent
Steiner, Boutang et le Christ

 Avec cette Crucifixion, du photographe Andres Serrano, que j'utilisai naguère en guise de couverture d'un des numéros de ma revue Dialectique, présentant le dialogue entre George Steiner et Pierre Boutang, je ne pouvais certes mieux trouver une image plus symbolique de ce qui s'est tramé entre l'auteur de Réelles présences et celui de l'Ontologie du secret, la symbolique de cette image étant bien évidemment parfaitement transposable à toute personne qui se pose, comme je le fais, la question redoutable, à vrai dire abyssale, des liens qu'entretiennent Chrétiens et Juifs. Steiner parle et répète à l'envi que le christianisme a une responsabilité écrasante dans la Shoah. Il affirme, sans absolument apporter de preuves, que l'horreur absolue du Golgotha a pour gouffre immonde le trou noir d'Auschwitz, dans un de ces paradoxes qu'il adore jeter à la face des crétins qui louent sa culture sans même comprendre que chaque ligne du bonhomme est un appel angoissé. Imre Kertész a écrit la même chose dans Un autre, où il retrouve l'image d'un Christ en Croix faisant face (si je puis dire) au puits de noirceur, à la figure grimaçante du fou Hitler. Il s'agit là, je n'ai pas peur de l'écrire, d'une espèce de vision mystique démoniaque, après tout logique sous la plume de ce penseur inquiet et ô combien paradoxal qu'est Steiner, grand lecteur de Kierkegaard, grand lecteur sans doute (mais en cachette...) de Léon Bloy, celui du terrible et difficile Salut par les Juifs, relu il y a peu, sans doute l'un des sommets de l'exégèse bloyenne, où je lis cette phrase : L’histoire des Juifs barre l’histoire du genre humain comme une digue barre un fleuve, pour en élever le niveau. L'outrance même de certaines métaphores, outrance revendiquée par Léon Bloy, n'a qu'un seul but : nous faire comprendre que Juifs et Chrétiens sont indissolublement liés. On comprend que Bloy n'ait jamais eu assez d'insultes pour se moquer de l'imbécile Drumont et de son antisémitisme grotesque, sentant la trouille et l'impuissance d'un pamphlétaire qui mourut dans la misère. On comprend aussi qu'Éric Marty, dans Bref séjour à Jérusalem, lâche quelques lourdes bêtises sur Bloy et Bernanos, qu'il a sans doute lus comme lisent les journalistes, en préférant aux textes les résumés vite digérables...
Avec cette Crucifixion, du photographe Andres Serrano, que j'utilisai naguère en guise de couverture d'un des numéros de ma revue Dialectique, présentant le dialogue entre George Steiner et Pierre Boutang, je ne pouvais certes mieux trouver une image plus symbolique de ce qui s'est tramé entre l'auteur de Réelles présences et celui de l'Ontologie du secret, la symbolique de cette image étant bien évidemment parfaitement transposable à toute personne qui se pose, comme je le fais, la question redoutable, à vrai dire abyssale, des liens qu'entretiennent Chrétiens et Juifs. Steiner parle et répète à l'envi que le christianisme a une responsabilité écrasante dans la Shoah. Il affirme, sans absolument apporter de preuves, que l'horreur absolue du Golgotha a pour gouffre immonde le trou noir d'Auschwitz, dans un de ces paradoxes qu'il adore jeter à la face des crétins qui louent sa culture sans même comprendre que chaque ligne du bonhomme est un appel angoissé. Imre Kertész a écrit la même chose dans Un autre, où il retrouve l'image d'un Christ en Croix faisant face (si je puis dire) au puits de noirceur, à la figure grimaçante du fou Hitler. Il s'agit là, je n'ai pas peur de l'écrire, d'une espèce de vision mystique démoniaque, après tout logique sous la plume de ce penseur inquiet et ô combien paradoxal qu'est Steiner, grand lecteur de Kierkegaard, grand lecteur sans doute (mais en cachette...) de Léon Bloy, celui du terrible et difficile Salut par les Juifs, relu il y a peu, sans doute l'un des sommets de l'exégèse bloyenne, où je lis cette phrase : L’histoire des Juifs barre l’histoire du genre humain comme une digue barre un fleuve, pour en élever le niveau. L'outrance même de certaines métaphores, outrance revendiquée par Léon Bloy, n'a qu'un seul but : nous faire comprendre que Juifs et Chrétiens sont indissolublement liés. On comprend que Bloy n'ait jamais eu assez d'insultes pour se moquer de l'imbécile Drumont et de son antisémitisme grotesque, sentant la trouille et l'impuissance d'un pamphlétaire qui mourut dans la misère. On comprend aussi qu'Éric Marty, dans Bref séjour à Jérusalem, lâche quelques lourdes bêtises sur Bloy et Bernanos, qu'il a sans doute lus comme lisent les journalistes, en préférant aux textes les résumés vite digérables...
04/03/2004 | Lien permanent
Un Cahier de l'Herne Joseph Conrad encalminé dans les eaux troubles de l'Université Lyon 2

 Joseph Conrad dans la Zone.
Joseph Conrad dans la Zone. Cœur des ténèbres et Le Transport de A. H. de George Steiner.
Cœur des ténèbres et Le Transport de A. H. de George Steiner. Cœur des ténèbres et The Hollow Men de T. S. Eliot.
Cœur des ténèbres et The Hollow Men de T. S. Eliot. Cœur des ténèbres et Monsieur Ouine de Georges Bernanos.
Cœur des ténèbres et Monsieur Ouine de Georges Bernanos.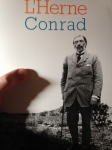 À propos de Cahier de l'Herne Joseph Conrad (sous la direction de Josiane Paccaud-Huguet, Éditions de l'Herne, 2015).
À propos de Cahier de l'Herne Joseph Conrad (sous la direction de Josiane Paccaud-Huguet, Éditions de l'Herne, 2015).L'un des dangers les plus sournois qui menace un écrivain me semble moins résider dans le fait qu'il demeure à la merci des passants, comme Jean-Loup Bernanos l'écrivait de son père, qu'à celle des universitaires. Les premiers, après tout, ne s'arrogent que fort rarement le droit de détenir la vérité sur celui qu'ils ont lu. Les seconds, en revanche, feront tout ce qu'ils peuvent pour vous empêcher de pénétrer dans la citadelle pseudo-herméneutique et interprétative dans laquelle ils se sont enfermés avec leur idole, lui consacrant un culte non seulement exclusif mais fanatique. Le dernier Cahier de l'Herne consacré à Joseph Conrad illustre ce risque, et il est navrant que, parti de la Tamise, le fier yawl de croisière où Marlow raconte telle de ses sombres et énigmatiques aventures soit venu, assez lamentablement, s'encalminer sur les berges du Rhône, à quelques coudées à peine des grosses péniches chargées non pas de sable mais de la poudre de savoir universitaire, aussi ténue que de la gaze mais néanmoins étouffante, avec laquelle les écrivants colmatent leurs poussives galères.
 Bien sûr, il y a de tout dans cette auberge espagnole éditoriale que représente un Cahier de l'Herne, et même de bons textes : dans celui-ci, les plus intéressants sont encore ceux de Joseph Conrad lui-même lesquels, sans être inconnus, sont parfois difficiles d'accès ou ont été ici traduits pour la première fois. Ce sont aussi ceux d'autres écrivains comme l'admirable Robert Penn Warren, qui jugent les œuvres de son confrère admiré. Les quelques pages, extraites de ses New and Selected Essays parus en 1989 chez Random House, intitulées Le grand mirage, valent à peu près l'ensemble des contributions, heureusement assez courtes, de nos universitaires rhônalpins ou apparentés.
Bien sûr, il y a de tout dans cette auberge espagnole éditoriale que représente un Cahier de l'Herne, et même de bons textes : dans celui-ci, les plus intéressants sont encore ceux de Joseph Conrad lui-même lesquels, sans être inconnus, sont parfois difficiles d'accès ou ont été ici traduits pour la première fois. Ce sont aussi ceux d'autres écrivains comme l'admirable Robert Penn Warren, qui jugent les œuvres de son confrère admiré. Les quelques pages, extraites de ses New and Selected Essays parus en 1989 chez Random House, intitulées Le grand mirage, valent à peu près l'ensemble des contributions, heureusement assez courtes, de nos universitaires rhônalpins ou apparentés.Ces universitaires, conradiens à leurs heures comme on est moussaillon, semblent en effet presque tous être passés par l'Université Lyon 2, où même y exercer leurs talents en tant que professeurs. C'est le cas de celle qui a ordonné ce Cahier de l'Herne, Josiane Paccaud-Huguet, professeur au Département d’Études du Monde anglophone qui écrivit, voici quelques années de cela, un projet de lecture qui ne pouvait que me faire craindre le pire, pire qui se révéla concrétisé par la direction d'un volume publié par Minard et consacré à Joseph Conrad, dans lequel nous pouvions lire : «Lire Conrad selon une approche postmallarméenne du langage, éventuellement avec Freud et Lacan, ne visera donc pas à réduire le texte mais au contraire à l'ouvrir au regard d'une humanité qui aux dires de l'auteur lui-même «a dépassé le stade des contes de fées, romantiques, réalistes ou mêmes épiques»» (1). C'est, en même temps que se placer sous le patronage ridicule d'une modernité vaguement déconstructrice et libérée de soi-disant pesantes contraintes, ne strictement rien dire, si ce n'est planquer son évident manque de talent derrière les propos d'un écrivain, pour mieux l'affadir et prévenir toute critique pouvant être adressée à ce type de lectures.
Outre le nom de Josiane Paccaud-Huguet, nous trouvons dans ce volume ceux d'autres anciens étudiants / professeurs de Lyon 2 comme Patrick Tourchon, chercheur indépendant mais auteur d'une thèse à Lyon 2, Louis-Antony Martinez, docteur es lettres et auteur d'une thèse soutenue à Lyon 2, Claude Maisonnat, professeur émérite de littérature anglaise à Lyon 2, auteur d'une étude assez oubliable intitulée Utopie / dystopie : les avatars du sujet dans The Shadow Line, ce qui fait toujours plus snob que de donner le titre en français, La Ligne d'ombre, Pierre-Julien Brunet, qui étudie les lettres modernes et l'anglais à Lyon 2, et enfin Catherine Pesso-Miquel, professeur émérite de littérature britannique et de nouvelles littératures anglophones, exerçant comme il se doit son art à cette même université décidément conradienne jusqu'au bout de sa plus humble secrétaire, Lyon 2 bien sûr. Afin de faire bonne mesure, et de contribuer à la nécessaire synergie propédeutique entre Lyon 2 et son éternelle rivale (j'en viens) mais très proche voisine géographique Lyon 3, je signale le nom de Catherine Delesalle-Nancey, professeur, donc, à cette dernière université, elle-même auteur d'un texte dont je ne me souviens même plus quelques secondes après l'avoir lu.
Comme je le disais, tout est parfaitement banal, oubliable, parfois approximatif (2) dans ce volume, à l'exclusion des textes de Joseph Conrad et de ses pairs écrivains, et ce ne sont pas les ridicules pseudo-études de Josiane Paccaud-Huguet (bien évidemment intitulée L'artiste et le psychanalyste, pp. 210-15) et celle de la très féministe Nathalie Martinière (bien évidemment intitulée La pensée du féminin et le féminisme, pp. 226-8) qui établiront le contraire. Finalement, le seul texte à peu près passable, digne non pas d'une étude en bonne et due forme, mais d'un travail s'approchant d'un quelconque intérêt universitaire est celui du très brouillon Michel Arouimi, qui évoque les liens entre Joseph Conrad et Arthur Rimbaud. Comme dans son livre pratiquement illisible, Jünger et ses dieux. Rimbaud, Conrad, Melville (Éditions Orizons, coll. Profils d'un classique, 2011), que j'évoquais dans une note sur Héliopolis de Jünger, l'auteur semble pressé de tout dire, fondant son intuition d'un rapprochement de forme et de fond entre Rimbaud et Conrad sur la biographie de Charles Whibley publiée en 1899 sur l'homme aux semelles de vent, un texte que lut Conrad selon Arouimi. J'extrais de cette pourtant très courte étude le seul passage qui résiste tant bien que mal à une lecture à tête reposée : «Si Conrad et Rimbaud sont les poètes les plus fascinants de leur époque, il faudrait méditer sur le sens de leur exil africain, prétexte à une prise de conscience du fondement le plus «horrible» de la vocation poétique, autrement dit la violence obscure, mieux assumée dans le silence de Rimbaud» (p. 189). Propos lisible, pas moins vague cependant, mais enfin, la perspective d'un rapprochement entre les destinées de ces deux horribles travailleurs que furent Conrad et Rimbaud, perspective également mentionnée par Jacques Darras, dans sa préface aux Nouvelles complètes de Conrad dans la collection Quarto (Gallimard), est fascinante.
N'étant, comme il se doit, jamais mieux servi que par soi-même, j'ai indiqué mes propres travaux sur Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, un texte que j'ai rapproché coup sur coup de trois grands autres textes avec lesquels il me semble entretenir des relations troubles. En amont du fleuve remonté par Marlow si je puis dire, les Soirées de Saint-Pétersbourg de Joseph de Maistre mais aussi, en aval, le Transport de A. H. de George Steiner. Je rappelle que cette étude, dont George Steiner lui-même me confirma la justesse, a paru dans un... numéro des Cahiers de l'Herne que Josiane Paccaud-Huguet aurait bien évidemment dû connaître, non seulement par simple curiosité intellectuelle, cette vertu qui n'est pas très répandue il est vrai au sein de l'Alma Mater, mais, tout bonnement, parce que son auteur préféré, Joseph Conrad, y figurait. Qui se prétend spécialiste d'un auteur se doit tout de même, dans la mesure du possible, de s'informer de ce qui a été écrit sur lui, quand bien même ces textes heurteraient ses plus profondes convictions intellectuelles. Ensuite, une fois encore en aval, tout d'abord The Hollow Men de T. S. Eliot, et, plus surprenant sans doute et en tout cas, à ce jour, un point de vue original, Monsieur Ouine de Georges Bernanos, une longue étude dont j'ai indiqué en note les références.
Les lecteurs un peu plus conséquents que Josiane Paccaud-Huguet, et peut-être même cette dernière nous pouvons nous prendre à rêver, pourront utilement consulter ces trois textes sans avoir besoin de débourser le prix assez élevé d'un volume des Cahiers de l'Herne, prix qui ne se justifie, dans le cas qui nous occupe, absolument pas à mes yeux. Ces mêmes lecteurs n'auront de toute façon qu'à se référer aux magnifiques travaux de Sylvère Monod sur Conrad, ainsi qu'à son édition des romans de cet auteur dans la collection de la Pléiade, et consulter dans une librairie, par simple curiosité, un Cahier de l'Herne sans intérêt et, comme toujours, assez mal relu et corrigé.
Notes
(1) Joseph Conrad 1. La fiction et l'Autre (Minard Lettres Modernes, coll. La Revue des lettres modernes, 1998), p. 2. J'avais exprimé quelques réserves sur la lecture psychanalytique ridicule d'une certaine Nadia d'Amelio-Martiello dans mon propre article rapprochant Cœur des ténèbres de Monsieur Ouine, cf. Bernanos 23. Monsieur Ouine 3, l'écriture romanesque et l'univers du Mal (Minard Lettres Modernes, coll. La Revue des lettres modernes, 2004), pp. 173-228).
 (2) Comme le fait de ne même pas exactement retranscrire les propos, écrits dans le français quelque peu approximatif qui était celui de Conrad, ainsi qu'en témoigne cette photographie d'une de ses lettres, accompagnée, donc, de sa légende fautive.
(2) Comme le fait de ne même pas exactement retranscrire les propos, écrits dans le français quelque peu approximatif qui était celui de Conrad, ainsi qu'en témoigne cette photographie d'une de ses lettres, accompagnée, donc, de sa légende fautive.
04/03/2015 | Lien permanent
Léon Bloy dans la Zone

 Éric Marty, les Juifs, Léon Bloy et quelques autres.
Éric Marty, les Juifs, Léon Bloy et quelques autres. Jean-René Huguenin n'est pas mort.
Jean-René Huguenin n'est pas mort. Léon Bloy redivivus.
Léon Bloy redivivus. Léon Bloy et l'attente de l'Apocalypse.
Léon Bloy et l'attente de l'Apocalypse. Marc-Édouard Nabe le si peu bloyen suivi d'un entretien avec Pierre Glaudes (première partie).
Marc-Édouard Nabe le si peu bloyen suivi d'un entretien avec Pierre Glaudes (première partie). Entretien avec Pierre Glaudes, suite.
Entretien avec Pierre Glaudes, suite. L’interview de Léon Bloy par Louis Vauxcelles (1904), par Émile Van Balberghe.
L’interview de Léon Bloy par Louis Vauxcelles (1904), par Émile Van Balberghe. Cloverfield, l'Apocalypse expliquée aux bourrins.
Cloverfield, l'Apocalypse expliquée aux bourrins. La Ville, son archange de misère, l'espérance, intermède, par Carmen Muñoz Hurtado.
La Ville, son archange de misère, l'espérance, intermède, par Carmen Muñoz Hurtado. L’Archiconfrérie de la Bonne Mort de Léon Bloy, par Émile Van Balberghe.
L’Archiconfrérie de la Bonne Mort de Léon Bloy, par Émile Van Balberghe. La mort de Jules Bonnot, par Léon Bloy.
La mort de Jules Bonnot, par Léon Bloy. L'âme de Léon Bloy.
L'âme de Léon Bloy. L'île de Jersey, un paradis infernal.
L'île de Jersey, un paradis infernal. La parole donnée de Louis Massignon.
La parole donnée de Louis Massignon. Les incarnations du Père dans Le Désespéré, par Nicolas Massoulier.
Les incarnations du Père dans Le Désespéré, par Nicolas Massoulier. Sous le soleil de Satan (1926) de Georges Bernanos rapproché du Révélateur du Globe et du Désespéré.
Sous le soleil de Satan (1926) de Georges Bernanos rapproché du Révélateur du Globe et du Désespéré. Actualité bloyenne : Maxence Caron, Emmanuel Godo et Yves Leclair.
Actualité bloyenne : Maxence Caron, Emmanuel Godo et Yves Leclair. Michel Houellebecq jugé par Léon Bloy.
Michel Houellebecq jugé par Léon Bloy. Léon Bloy bis repetita : François Angelier et Stanislas Fumet.
Léon Bloy bis repetita : François Angelier et Stanislas Fumet. Léon Bloy ou le pont sur l'abîme de Jacques Vier.
Léon Bloy ou le pont sur l'abîme de Jacques Vier. Nous n'arriverons jamais à Carcassonne. William Faulkner lecteur de Lord Dunsany ? (brève mention de Léon Bloy).
Nous n'arriverons jamais à Carcassonne. William Faulkner lecteur de Lord Dunsany ? (brève mention de Léon Bloy).Ouvrages de Léon Bloy
 La Chevalière de la Mort (1877, publié en 1891).
La Chevalière de la Mort (1877, publié en 1891). Christophe Colomb de Roselly de Lorgues, puis Le Révélateur du Globe (1884) et Christophe Colomb devant les taureaux (1890).
Christophe Colomb de Roselly de Lorgues, puis Le Révélateur du Globe (1884) et Christophe Colomb devant les taureaux (1890). Le Désespéré (1887).
Le Désespéré (1887). Le Salut par les Juifs (1892).
Le Salut par les Juifs (1892). Histoires désobligeantes (1884).
Histoires désobligeantes (1884). L'Ami des bêtes (une histoire désobligeante non recueillie en volume par Bloy) rapprochée de La Terreur d'Arthur Machen.
L'Ami des bêtes (une histoire désobligeante non recueillie en volume par Bloy) rapprochée de La Terreur d'Arthur Machen. Le Siècle des Charognes (1900).
Le Siècle des Charognes (1900). Le Fils de Louis XVI (1900).
Le Fils de Louis XVI (1900). Constantinople et Byzance (1906).
Constantinople et Byzance (1906).
Le Sang du Pauvre (1909).
 L'Âme de Napoléon (1912).
L'Âme de Napoléon (1912). Jeanne d'Arc et l'Allemagne (1915).
Jeanne d'Arc et l'Allemagne (1915). Méditations d'un solitaire en 1916 (1917).
Méditations d'un solitaire en 1916 (1917). Dans les ténèbres (1918).
Dans les ténèbres (1918).Correspondance
 Lettres à Paul Jury.
Lettres à Paul Jury.07/07/2009 | Lien permanent
Haine de la Hollande de Patrick Besson

 À propos de Haine de la Hollande de Patrick Besson, publié par les éditions Un infini Cercle Bleu, 2009.LRSP (livre reçu en service de presse).
À propos de Haine de la Hollande de Patrick Besson, publié par les éditions Un infini Cercle Bleu, 2009.LRSP (livre reçu en service de presse).Il paraît que Patrick Besson est un homme méchant et même qu'il fait peur. C'est sans doute parce qu'il a écrit avec acharnement beaucoup de livres tous passables, qu'il officie dans plusieurs journaux tous excellents où il distille ses phrases mononucléiques et même participe au jury du Prix Renaudot qui récompense, on le sait, les meilleurs romans publiés en France, dont celui de Patrick Besson paru en 1995, Les Braban et, en 2007, Chagrin d'école de Daniel Pennac. Du lourd n'est-ce pas ? En somme, Patrick Besson fait peur rien que pour de bonnes raisons, je veux dire, de nobles raisons, qui toutes ont un rapport étroit avec la littérature. Moi, Patrick, il me fait rire, certes pas aux éclats mais un tout petit peu tout de même parce que je me dis qu'un auteur qui a osé publier de pareils petits textes bessonniens, c'est-à-dire ni vraiment bons ni vraiment mauvais mais en revanche truffés de fautes de typographie, d'orthographe et de grammaire, hé bien, un écrivain pareil n'est pas vraiment sérieux, est même peut-être un clown.
Parfois, les clowns font peur lorsqu'ils arrêtent de rire. Un tout petit peu peur. Besson, on le dit, rit rarement. Il se prend même très au sérieux. Mais les clowns, surtout, sont des hommes pressés puisqu'il leur faut, toutes les semaines, faire leur numéro de clown. Dans le cas qui nous occupe, le numéro de clown a consisté à écrire, sans trop se préoccuper de l'existence d'un relecteur voire d'un lecteur même si, avec ce livre, un simple balayage réalisé par le plus élémentaire traitement de texte, disons la version Word utilisée dans les cabanes de la Transylvanie en 1987, eût amplement suffi à témoigner au lecteur quelque respect.
«L'objet de la critique, écrit Brunetière dans l'article Critique de L'Encyclopédie, est d'apprendre aux hommes à juger souvent contre leur propre goût». Je ne sais pas si je fâcherai, avec cette note, certains de mes lecteurs qui aiment l'écriture de Patrick Besson, puisque, statistiquement, il doit y en avoir, même si je n'ose songer à quoi ressemble un grand lecteur de Patrick Besson. À un clown, sans aucun doute. Un clown triste, lorsqu'il lit du Besson et qu'il voit, sous certains mots, la tristesse de l'écrivain. On n'ose pas bien sûr, par un pur sentiment de charité qui est comme ma seconde nature, imaginer ce qu'un Bernanos eût fait du sujet (l'hystérie anti-serbe dont la France se rendit coupable il y a quelques années) qui a mis en colère Besson, sujet d'écriture bien fait pour prendre à rebrousse-poil la prudence convenue des bien-pensants et des tartuffes. Avec Besson, nous n'avons que du Besson, c'est-à-dire une espèce de Bernanos sub-millimétrique, un Bernanos qui s'exprimerait par infra-sons en somme, écrivant comme une montre à l'ancienne indique l'heure, sans même y penser, sans autre rythme que celui, purement mécanique, provoqué par une machinerie minuscule que l'on devine suisse, voire hollandaise, donc increvable. Lorsque je tente de me faire peur, je me dis que le dernier écrivain encore vivant sur terre écrira sans doute comme Patrick Besson, sans même se rendre compte que plus personne ne pourra lire ses petites proses écrites pour lui seul et, feint-il de croire, une postérité impossible. Tiens, mais j'y songe tout d'un coup : Patrick Besson doit se dire qu'il est le dernier écrivain sur la terre, c'est ce qui explique que sa prose ne puisse rien faire d'autre que chuchoter sa petite musique aigrillarde, qui ne réveillerait pas, de son sommeil léger, un éphémère ridulant la surface d'une mare. Pas étonnant non plus qu'il écrive autant, Patrick, puisqu'il n'a presque rien à dire mais qu'il le dit d'une façon (appelons cela : le style, du moins, son style) qui nous ferait presque croire qu'il nous révèle des gouffres de paradoxes qui eussent flanqué la migraine à Sören Kierkegaard. Un exemple de ces gouffres : «Les guerres médiatiques sont plus sales que les guerres normales parce que les journalistes sont plus bêtes que les militaires, et la bêtise rend cruel» (p. 44).
Bon, voilà, le caniche est lâché, il fera deux ou trois mètres avant d'uriner (rassurez-vous, un tout petit pipi de rien du tout) puis de revenir bien vite mordre sa laisse, les caniches détestant la liberté et le grand large. Un texte de Patrick Besson, c'est à peu près carré, c'est plutôt concis, c'est même simpliste, c'est tout de même un peu mal fichu, ce dernier membre de phrase par exemple, mais enfin, c'est là le meilleur ou presque, du moins dans ce maigre recueil écrit en caractères bien larges pour faciliter la lecture des vieux, le lectorat principal je crois de Patrick Besson. Un texte de Patrick Besson, c'est comme un caniche : cela aboie de loin, parfois montre les dents, puis enrage de ne pouvoir vraiment mordre. Finalement, on plaint l'animal et même son maître, un petit vieux généralement qui discute avec son chien comme Socrate avec l'un de ses contradicteurs. Le meilleur passage du livre ? Je suis allé un peu vite et ai été injuste car le meilleur, le voici, enfin, je crois, n'ayant rien trouvé d'autre dans ce petit recueil de textes acrimonieux mais sans grandeur, méchants mais sans style, affreusement plats comme le monde vu à hauteur d'un caniche. Le meilleur, c'est un texte (Pétitionnade) ayant même été publié par Le Figaro qui, il est vrai, n'hésite pas à publier les textes de Yann Moix, qui sont aux textes de Patrick Besson ce qu'un caniche royal est à un caniche nain, un lointain cousin : «Les ennemis finissent toujours par servir à quelque chose, c'est pourquoi il faut en avoir beaucoup pour être bien servi» (p. 13).
Chapeau l'artiste, c'est une phrase diablement juste même si, comme toutes vos phrases, aucune vie ne la sustente. J'attendrai donc, patiemment, votre prochain numéro et tour de piste.
02/09/2009 | Lien permanent
La Ville, son archange de misère, l'espérance, intermède, par Carmen Muñoz Hurtado

27/04/2008 | Lien permanent


























































