Rechercher : bernanos, lapaque
Le Grand d'Espagne de Roger Nimier
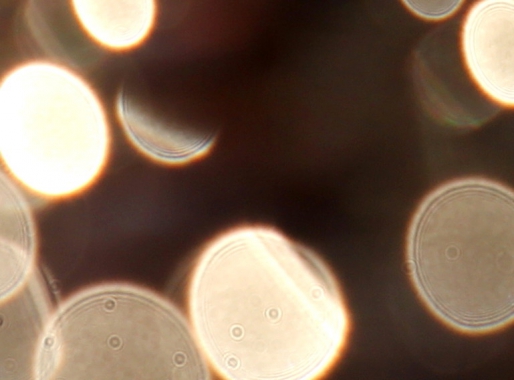
 Mâles lectures
Mâles lectures Georges Bernanos dans la Zone
Georges Bernanos dans la Zone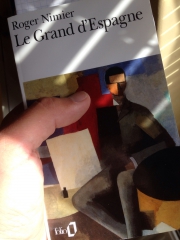 Tout grand livre naît du désespoir, mais du désespoir qui a été surmonté. S'il ne fallait citer qu'un seul roman qui me vient immédiatement à l'esprit, j'avancerais le labyrinthique et faustien Sous le volcan de Malcolm Lowry, ce livre dans le cratère duquel il est difficile de ne pas tomber, une fois qu'on s'est approché, imprudemment, de ses rebords. S'adressant, à 25 ans seulement, à celui qui, du désespoir, a offert l'une des explorations littéraires les plus profondes et fascinantes, Georges Bernanos, Roger Nimier ne pouvait que prétendre qu'il «faut savoir désespérer jusqu'au bout» (1) avant d'écrire comme un homme se jette dans un dernier sursaut de courage sur l'ennemi en surnombre qui l'encercle. Il mourra bien sûr, mais il se sera battu. Nous, nous mourrons, nous sommes en fait déjà morts. Mais contre qui nous sommes-nous battus, si ce n'est, dans ce pays vidé de sa substance, écouillé par des décennies de socialisme, de gauchisme, de féminisme, de véganisme, de structuralisme, d'humanisme intégral et autres fariboles devant tout au soi-disant modernisme, contre des pleutres, des Homais cramponnés à leurs places comme une sangsue à la peau qu'elle suce ? Parler d'humanisme intégral et de monde privé de sa force me fait penser à cette méchanceté de Georges Bernanos contre Maritain, dans une lettre à l'abbé Sudre datant du mois d'août 1927 : «Admirable parmi les abstractions, sitôt qu'il rencontre l'homme, on le voit plier ses reins. Pourquoi diable rêve-t-il d'une influence directe et personnelle ? Sa prise sur les consciences est nulle. Aucun sens de l'honneur» (in Correspondance inédite 1904 - 1934 Combat pour la vérité, Plon, 1971, p. 310). Aucun sens de l'honneur, voici la phrase qui caractérise le mieux notre époque devenue flache, et le comportement de tous les têtards qui y barbotent. Puis désespérer suppose de posséder encore un idéal, et je crains que le Français, de nos jours, non seulement n'en possède plus, si ce n'est de ne point se retrouver relégués dans une banlieue malfamée ou de rater leur soirée de match de football, mais ne soupçonne aussi de commettre quelque faute de goût en employant ce mot.
Tout grand livre naît du désespoir, mais du désespoir qui a été surmonté. S'il ne fallait citer qu'un seul roman qui me vient immédiatement à l'esprit, j'avancerais le labyrinthique et faustien Sous le volcan de Malcolm Lowry, ce livre dans le cratère duquel il est difficile de ne pas tomber, une fois qu'on s'est approché, imprudemment, de ses rebords. S'adressant, à 25 ans seulement, à celui qui, du désespoir, a offert l'une des explorations littéraires les plus profondes et fascinantes, Georges Bernanos, Roger Nimier ne pouvait que prétendre qu'il «faut savoir désespérer jusqu'au bout» (1) avant d'écrire comme un homme se jette dans un dernier sursaut de courage sur l'ennemi en surnombre qui l'encercle. Il mourra bien sûr, mais il se sera battu. Nous, nous mourrons, nous sommes en fait déjà morts. Mais contre qui nous sommes-nous battus, si ce n'est, dans ce pays vidé de sa substance, écouillé par des décennies de socialisme, de gauchisme, de féminisme, de véganisme, de structuralisme, d'humanisme intégral et autres fariboles devant tout au soi-disant modernisme, contre des pleutres, des Homais cramponnés à leurs places comme une sangsue à la peau qu'elle suce ? Parler d'humanisme intégral et de monde privé de sa force me fait penser à cette méchanceté de Georges Bernanos contre Maritain, dans une lettre à l'abbé Sudre datant du mois d'août 1927 : «Admirable parmi les abstractions, sitôt qu'il rencontre l'homme, on le voit plier ses reins. Pourquoi diable rêve-t-il d'une influence directe et personnelle ? Sa prise sur les consciences est nulle. Aucun sens de l'honneur» (in Correspondance inédite 1904 - 1934 Combat pour la vérité, Plon, 1971, p. 310). Aucun sens de l'honneur, voici la phrase qui caractérise le mieux notre époque devenue flache, et le comportement de tous les têtards qui y barbotent. Puis désespérer suppose de posséder encore un idéal, et je crains que le Français, de nos jours, non seulement n'en possède plus, si ce n'est de ne point se retrouver relégués dans une banlieue malfamée ou de rater leur soirée de match de football, mais ne soupçonne aussi de commettre quelque faute de goût en employant ce mot.Et puis, pour le dire simplement : il est impossible, du moins en littérature, de parvenir à se figurer ce que pourrait signifier une passation de pouvoirs, pour ainsi dire, entre représentants de différentes générations. Il n'y a plus de générations, le jeune crache sur le vieux, le gifle (du moins, prétend le gifler) et, de toute manière, le népotisme qui caractérise la vie intellectuelle parisienne (donc française, hélas) est un universalisme de la médiocrité : pas de différences établies sur des normes aussi ringardes que l'identité sexuelle, l'histoire personnelle, l'intelligence, le talent, l'âge même, le pays dans lequel nous vivons, fidèle à sa tradition d'avance sur le reste du monde, a inventé l'infernal remugle, la partouse pour le coup intégrale que Dalibor Frioux a cauchemardés dans son terrifiant Incident voyageurs.
C'est donc de plus d'une façon qu'un livre comme Le Grand d'Espagne est tout bonnement inconcevable de nos jours : par manque de talent, par absence de hardiesse, par intumescence prodigieuse d'inculture, de vulgarité, de bassesse, de médiocrité, et puis parce que tout le monde se contrefiche de saluer ce qui nous a précédés et qui, pour le dire point trop désobligeamment, est presque toujours plus grand que nous ne sommes.
Imaginons, de nos jours, un jeune premier, une jeune première refaisant le beau geste, après tout simple, point trop inouï ni même surhumain, d'Arthur Rimbaud saluant le prince Charles Baudelaire, ou de Roger Nimier envers son aîné, et s'adressant à... S'adressant à qui, au fait ? S'adressant aux guerriers de papier que sont Renaud Camus ou Richard Millet, ces Charles Martel en guimauve ? S'adressant au pédophile revendiqué, à coloration vaguement réactionnaire plaisant aux vieilles carnes, qu'est Gabriel Matzneff ? Certains de ces moitrinaires, pour reprendre le mot génial que Léon Daudet réserva pour une caste bien particulière d'impuissants, les impuissants à miroir, peuvent en tout cas revendiquer le rôle d'inspirateur de la jeunesse au vu de leur âge plus que respectable, un rôle que Gab la Rafale prend, lui, au pied de la lettre, même si, au passage, il aura quelque peu défiguré le début du mot inspirateur. Même Nabe, paraît-il, ne dédaigne pas de recevoir son lot d'enveloppes cachetées à la cyprine de bécasse antisémite, où il flaire paraît-il les fragrances vite éventées de son talent de polémiste gentiment bloyen. Nous avons donc nos muses, assurément, des muses à la hauteur de notre horizontalité sous-littéraire, même si elles sont parfaitement ridicules et saponifiées dans une comique suffisance, ou bien bronzées, comme le presque centenaire Jean d'Ormesson, au néon de la gloriole, qui ne provoque hélas pas d'expéditif cancer de la peau. Nos muses, quelque peu replâtrées pour l'exposition dans les librairies et sur les plateaux d'émissions télévisées sont nombreuses, bien que peu originales. Mais que pourrions-nous leur dire qui, sans être inoubliable, s'élève quelque peu au-dessus de l'exercice où une bouche de peu de talent mais pourvue d'une langue longue et admirablement souple prononce quelques mots à des pavillons auriculaires cimentés par le cérumen de la prétention et de l'insignifiance ?
J'ai lu le premier état du manuscrit de Georges Bernanos encore une fois où Sébastien Lapaque, crânement, avait imaginé une série de lettres qu'il eût pu adresser au romancier du mal et de la grâce, mais cet artifice, volonté de l'auteur ou de son éditeur Olivier Véron je ne sais, ne tint pas le choc ni même debout, et fut donc abandonné. Comme si, en fait, nous n'avions plus le courage, assurément simple, d'oser nous adresser à un homme qui, aussi imparfait et faillible qu'on le voudra, n'en demeure pas moins un modèle, ou encore, comme si ce geste, que la littérature des siècles passés a illustré de bien des remarquables manières, ne pouvait plus, de nos jours, qu'être une plaisanterie de potache qui, dans le meilleur des cas, sera jugée par ses professeurs d'un trait rageur au stylo rouge, en marge de la copie naïve mais sincère : Quel orgueil ! L'orgueil d'un gamin génial, admiratif à sa façon, ironique et cruelle, de ses aînés, Rimbaud saluant Hugo et Baudelaire, Huguenin Bernanos et Valéry, voilà un métal rarissime que la tête de pioche de tous les imbéciles du monde prétendra épuiser en quelques coups savamment frappés.
Nous sommes confrontés à une double impossibilité, tragique ou bien comique selon les humeurs, lorsque nous imaginons un jeune écrivain français s'adresser à celle ou celui qui le précéda et l'inspira : d'abord, il n'y a pas, en France, de jeune écrivain susceptible de posséder l'once de talent d'un Roger Nimier qui eut 20 ans en 1945, ce à quoi il ne pouvait évidemment rien mais qui, cinq ans plus tard, n'eut pas peur de clamer son admiration à l'égard de Georges Bernanos venant de mourir, ce qu'il eût pu avoir la peur de faire; ensuite, s'adresser à un écrivain suppose, je le crois du moins, de l'avoir lu et, ainsi, d'être capable de jauger et juger ce qu'il a pu vous apporter mais, surtout, ce qu'il a pu apporter à ce qui vous-même vous dépasse, et qui a pour nom la littérature. Or, et je fais ce constat à peu près chaque jour que je lis des livres, quel jeune écrivain français pourrait témoigner, à une ou deux exceptions près sans doute, qu'il s'agisse de Marien Defalvard ou encore de Julien Capron, en plus de quelques lignes mal écrites, de l'admiration qu'il porte à un autre écrivain, à condition même que nous puissions prétendre de ce dernier qu'il est, bel et bien, un écrivain, et pas un plaisantin un peu plus âgé que son jeune admirateur ? L'exercice de l'éloge véritable, qui peut s'enrober autant qu'il le voudra de la carapace de l'ironie, à condition qu'elle ne soit jamais moqueuse, vile, suppose intelligence, finesse, humilité et orgueil tout à la fois, piété, une notion presque tombée dans le plus méprisable des oublis, sens de la transmission et, bien sûr, talent, autant de conditions que je ne trouve nulle part réunies dans leur ensemble, ni même, trop souvent, réduites à leur portion congrue, parmi nos très nombreux écrivants, et même chez nos très rares écrivains.
Imaginons, avant de revenir au beau livre lucide et noir de Roger Nimier, Édouard Louis clamer son comique attachement et sa très minable admiration à un vieux mandarin expert en farces et attrapes sociologiques, pour le plus grand bonheur des idiots journalistiques qui ne pourront s'empêcher de saluer, comme ils l'écrivent avec emphase, une nouvelle conscience de gauche !
Imaginons, au centre du désert de l'écriture jeune et jolie, hélas aussi peu sexuée que vertébrée, une Cécile Coulon, saluée un peu partout, y compris dans les librairies et les salles de rédaction, comme une jeune prodige cousine, pardonnez du peu, de Rimbaud, s'adresser à telle figure féminine, Simone de Beauvoir ou Marguerite Yourcenar pourquoi pas, et tentons d'apprécier ce que pourrait signifier le fait de sonder la profonde inanité des mots qu'elle leur adresserait, dans des phrases offrant avec les flans à la courge une similarité d'aspect et de saveur qui n'aurait rien de métaphorique.
Ce n'est pas tout, car il serait injuste de ne distribuer nos coups que sur certaines faces aussi molles qu'interchangeables, Édouard Louis n'étant finalement qu'une Cécile Coulon en pantalon plutôt qu'en jupe, à moins, diraient les mauvaises langues, que ce ne soit l'inverse.
Imaginons, à droite cette fois-ci et même : à droite de la droite moins buissonnière que putassière, Solange Bied-Charreton, que tel ami ô combien drôle et cruel dans ses fulgurances point toutes littéraires ne peut s'imaginer autrement que comme un insecte, un papillon plutôt commun, voletant dans la mondanité de droite selon ses termes, imaginons cette jeune femme au talent littéraire aussi développé qu'une antenne de charançon, et qui vient de témoigner d'un bel entêtement en faisant publier un troisième roman encore plus mauvais que les deux qui l'ont précédé, imaginons-la clamer son admiration vers quelque anti-modèle absolu, c'est-à-dire une femme belle, intelligente et talentueuse, Cristina Campo par exemple, et retenons-nous de rire aux éclats. D'abord, Solange Bied-Charreton ne sait rien de Cristina Campo car, si elle avait lu avec exigence une seule des pages coruscantes et magnifiques de l'auteur des Impardonnables, elle saurait, d'une évidence intime n'ayant point besoin d'être démontrée, qu'elle n'a strictement pas la force d'écrire, et encore moins le droit, et que dire du péché consistant à lui écrire, à elle, la magnifique Cristina Campo qui évoqua mieux que nulle autre la sprezattura, cette incandescence sereine à la jointure entre la chair et l'esprit, et que dire de cette énormité existentielle quand on s'appelle Solange Bied-Charreton, et que le moindre de vos propos est repris par tous les bécasseaux droituriers qui se contorsionnent pour comprendre les oracles que la pythie de foire lâche sur la vie politique française et, comme ils disent encore, les grands enjeux sociétaux ? Que lui dirait-elle, d'ailleurs, Solange, à Cristina, je vous le demande ? Que dirait Solange Bied-Charreton à Cristina Campo (ou bien, si vous la voulez laide mais tout aussi intelligente, à Simone Weil), que lui écrirait-elle qui dépasse la construction, pour le moins sommaire, qui caractérise la presque totalité de ses phrases, très originalement alignées en sujets-mouflons, verbes-chèvres et compléments aussi domestiqués qu'un mouton d'alpage helvétique ?
Je m'éloigne de mon sujet et me livre à des attaques bassement misogynes ? Notons que ces gentes demoiselles (Édouard Louis ne m'en voudra pas que je l'inclue dans ce charmant groupe) exigent d'être traitées comme les hommes, montrant d'ailleurs, il faut le préciser, un peu plus de courage que nombre d'entre eux. Ensuite, cette petite digression s'intègre parfaitement dans notre problématique d'ensemble : la disparition de tout jugement critique, l'amenuisement drastique de la qualité des romans imprimés en France, la réduction jusqu'à peau de chagrin du prestige, autrefois immense, de la littérature, l'annihilation possible sinon de moins en moins improbable de la France, le refus de s'appuyer sur le passé pour guetter, la main en visière, les dangers qui grondent, et nous permettre, d'ores et déjà, de déjouer ce qui se trame jour après jour sous nos yeux. Je n'en ai donc pas fini avec ces animalcules bavards, qui bien mieux que d'autres, qui jamais n'ont prétendu incarner le renouveau intellectuel d'une nation moribonde, illustrent mon propos !
Parler de Solange Bied-Charreton ou de sa version journalistique officielle, donc à quotient intellectuel minimal exigible, la très vaguement télégénique Eugénie Bastié, c'est presque aussitôt voir émerger à l'horizon de la fulminance apprivoisée la haute figure marmoréenne du Melmoth des sacristies et des confessionnaux, sorte d'Urbain Grandier portatif à effet garanti sur les dortoirs de filles bien sages, j'ai nommé, pardon : invoqué le trois fois consacré au saint-chrême, quoique coupé au Picon, Jacques de Guillebon, sorte de Gauvain de prétention donquichottesquement monté sur son coursier apocalyptique gonflable, bien évidemment réutilisable en cas de harangue improvisée dans une Fête à Neuneu(s) catholique(s). Celui-là, sans doute touché par le don de bilocation qui lui permet de chanter les vertus de deux ou trois poules et coqs de basse-édition en même temps, a la langue suffisamment déliée pour raconter n'importe quoi, c'est-à-dire tout ce que l'on voudra et sur commande apostolique, sur n'importe qui, qu'il s'agisse du Christ ou de Marion Maréchal-Le Pen, de Gandhi ou de son ami Romaric Sangars, dont le prénom est aussi crânement francique que l'écriture est melliflue, fémininement douce, évasivement profonde, stochastiquement méchante, y compris lorsqu'elle feint de mordre. Il est vrai que, tout occupé à faire publier (pardon : «apporter», sic) la rinçure journalistique d'Eugénie Bastié au Cerf, sous le regard noir de Jean-François Colosimo qui a décidément beaucoup perdu de son acuité, le preux Jacques de Guillebon n'en est pas moins capable de saluer la daube surnuméraire de son ami à la coiffure plus savamment destructurée que la phrase, daube modestement intitulée Les Verticaux et publiée chez l'inénarrable (ne narrons point trop, son avocat veille) Léo Scheer, et qu'il sera n'en doutons point tout autant capable de chanter les mérites surnuméraires du dernier navet lacrymalo-guerrier de son ami Richard Millet qui, lui, a autant d'amis que peut en accueillir La Revue littéraire de son (nouvel) ami Léo Scheer, c'est-à-dire fort peu, mais à l'échine merveilleusement souple et au large cul adorateur de coups de pied. Inutile de préciser que Richard Millet, lui aussi, publie chez Léo Scheer, un éditeur dont nous pourrions presque deviner, j'y songe tout à coup, quel sera l'un des futurs auteurs. D'ici peu, Jacques de Guillebon va se prendre pour Claudel, lui qui se prend déjà pour Bernanos, et tenter de convertir aux vertus de la pauvreté christique celui qui, flairant le bon coup catéchétique, voudra le publier sans pour autant risquer d'être baptisé !
Imaginons encore un Marin de Viry qui fort heureusement n'a publié aucun livre depuis 2012, ou encore un Alexandre de Vitry, une ombre impossible à confondre avec la précédente et qui, lassée de son cinquantième colloque sur Philippe Muray, lui adresserait une dernière lettre, en forme d'hommage forcément (mais nous pouvons alors nous demander quelle sera cette forme), où ce percolateur de truismes relèvera l'inventivité lexicale de l'obsession anale développée par son mentor dans l'indigeste et sollersien Ultima Necat.
Imaginons une dernière fois, car le temps se fait long et surtout que je ne voudrais pas davantage m'égarer dans les sous-pentes du népotisme germano-sacristain à tropisme rebelle, cette théorie cliquetante et bavarde de fantômes sans talent, à laquelle nous pourrions joindre celle d'auteurs plus âgés, nullités à mouvement perpétuel (François Haenel et Yannick Meyronnis ou l'inverse, Antoni C
04/09/2016 | Lien permanent
Sur une île, stalker, quels livres emporteriez-vous ?, 6

26/05/2008 | Lien permanent
L’état de la littérature française sous Emmanuel Macron

 Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous.J’aimerais commencer par remercier les organisateurs de ce bel événement qui témoigne du fait que les forces vives de la nation, c’est-à-dire vous, les jeunes (et je n’oublie pas les moins jeunes !), n’êtes pas tout à fait sclérosés ni même éteints. En parlant des moins jeunes d’entre vous, j’aimerais aussi saluer Stéphane Blanchonnet, rencontré voici bien des années à Lyon, lorsqu’avec une autre personne je m’occupais de deux revues, Dialectique et Les Brandes, la première à orientation philosophico-politique, d’inspiration maurrassienne, très austère, très stricte, quasiment protestante dans son contenu et dans sa maquette, la seconde exclusivement littéraire et préoccupée de démonologie, sous les auspices du Grand d’Espagne comme Roger Nimier le surnomma, Georges Bernanos (1) bien sûr.
La cohabitation, vous vous en doutez, ne fut pas toujours évidente entre les auteurs phares de ces deux revues ! Nous avons en tout cas fait, à l’époque c’est-à-dire à la fin des années 90 et depuis, ce que nous avons pu, avec d’autres, comme les solides gaillards que sont les amis Sébastien Lapaque (2) et Jérôme Besnard, par le biais par exemple de feu la revue Immédiatement que certains d’entre vous connaissent peut-être, qui tenta de prendre la suite de Combat en se plaçant sous les auspices de Dominique de Roux (3).
1)
 Georges Bernanos dans la Zone.
Georges Bernanos dans la Zone.2)
 Une critique sur Les Identités remarquables de Sébastien Lapaque.
Une critique sur Les Identités remarquables de Sébastien Lapaque.3)
 Dominique de Roux dans la Zone.
Dominique de Roux dans la Zone.M’adressant à vous, je ne voudrais bien évidemment pas m’appesantir sur le passé, même s’il est fort proche, car c’est le présent qui nous occupe ce jour, mais aussi l’avenir c’est-à-dire, une fois de plus, vous. Pourtant, et vous le savez comme moi, le présent et a fortiori le futur de notre pays ne sont strictement rien sans le passé, sans son passé spécifiquement français, sans son passé culturellement français, sans son passé littérairement français, sans son passé spirituellement français et, pour poursuivre les anaphores si chères à Charles Péguy, sans son passé génialement français. Or, c’est ce passé qu’Emmanuel Macron semble avoir remis en cause lorsque, toujours à Lyon, qui décidément doit bien être quelque chose comme la capitale secrète de la France depuis Nostradamus, Maurice Scève et Blanc de Saint-Bonnet (4), il a déclaré le 4 février dernier, je le cite : «il n'y a d'ailleurs pas une culture française, il y a une culture en France, elle est diverse, elle est multiple». Vous noterez comment, jusque dans son phrasé parfaitement inepte, la baudruche macronienne est proche de son père, qu’il a bien évidemment tué comme il se doit, l’ignoble et ridicule pantin François Hollande. Tous deux, c’est bien simple, semblent gonflés au même hélium, celui d’un verbe vide et vidé de sa sève, raison pour laquelle ils sont parfaitement interchangeables, et vous pouvez bien sûr ajouter à cet envol de baudruches dans le ciel festiviste et versicolore de la doulce France Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, ou encore celui que Pierre Boutang (5) surnomma Foutriquet, Valéry Giscard d’Estaing. Mais voici qui nous éloigne non seulement du génial auteur du Porche du mystère de la deuxième vertu mais, aussi, de toute forme de littérature.
4)
 Sur De la douleur de Blanc de Saint-Bonnet.
Sur De la douleur de Blanc de Saint-Bonnet.5)
 Pierre Boutang dans la Zone.
Pierre Boutang dans la Zone.Revenons toutefois, pour mieux les oublier, à nos baudruches, qui sont aussi, d’ailleurs, des moutons. Relativiser la culture française, admettre qu’elle n’est pas une mais multiple, qu’elle est ouverte à la sacro-sainte diversité, au vivre-ensemblisme de dizaines de vagues migratoires qui l’ont façonnée au cours des siècles, nous faire comprendre qu’elle est là de toute éternité, sans l’effort des femmes et des hommes qui l’ont produite, souvent durant plusieurs générations, qu’elle flotte en somme à vide au-dessus de nos paysages : nous faire croire ces fadaises et ces mensonges, voilà qui est devenu une évidence partagée jusque dans le dernier village de Gaulois irréductibles, s’il en reste un, ce dont je doute. Cette relativisation de l’unicité de la culture, ce qui ne veut bien sûr pas dire son caractère univoque mais sa cohérence, son harmonie, touche le passé lui-même, et, partant, le présent, nous donc, vous, et ce que vous serez et ferez demain.
Une bonne manière de retrouver ce passé non pas tant perdu que nié voire moqué, en tout cas mis sous le boisseau pudibond du passéisme réactionnaire, c’est de pratiquer un peu d’étymologie. Nous allons faire, l’espace de quelques minutes, ce que jamais ni François Hollande, ni Emmanuel Macron, ni Giscard d’Estaing ni même 99 %, je suis généreux, de nos responsables politiques, et bientôt tous les élèves et les étudiants de France, n’ont fait ou ne vont faire. Nous allons sonder le passé français, sa culture d’une certaine façon, au travers des différentes strates évolutives de la langue française, déposées les unes au-dessus des autres, un peu comme nous pouvons lire l’histoire géologique du pays, de ce qui autrefois, voici plusieurs millions d’années, ne portait pas encore le nom de France, en contemplant les superbes falaises d’Étretat que j’ai abandonnées pour venir vous voir.
Le terme «culture» est une réfection savante datant du 14e siècle, provenant du terme «colture», lui-même emprunté au latin «cultura» ayant donné en ancien français le mot «couture », tout comme le terme latin «cultos» avait donné naissance aux deux verbes «coutiver» et «cultiver». Nous savons aussi que les Latins avaient à leur disposition trois noms plus ou moins synonymes, formés sur le supin «cultum» du verbe «colere» signifiant «habiter», mais aussi «cultiver» et «vénérer», c’est-à-dire : honorer les Muses. Le plus rare de ces trois termes, «cultio», désigne l’action de cultiver, de vénérer, et n’a rien donné en français, à la différence du mot «cultura», à savoir : l’action de cultiver la terre et, au figuré, l’action consistant à éduquer l’esprit mais aussi le fait de vénérer. Le troisième terme, «cultus», est surtout utilisé dans un sens moral et dans la langue religieuse. C’est donc ainsi que «culture» et «culte», dont les sens interféraient à l’origine, se sont progressivement différenciés au cours des siècles. Inutile de détailler plus avant cette histoire d’interférences et de spécialisations pour le moins complexe. Nous comprenons assez vite tout de même que le mot «culture» non seulement convoque, mais aussi lie de façon indissociable au moins deux notions : celle du temps qui passe et repasse sur les champs qu’il faut labourer, cultiver, afin de récolter ce qu’ils auront produit, leur culture ; celle du temps qui s’ouvre, qui est rendu présent, qui est, en un mot, rédimé, sauvé, dans le cérémonial du culte, qui consiste d’une certaine façon à récolter le fruit de ses prières, et à permettre à un fruit tout entier spirituel de prendre racine dans une terre arable, celle de l’âme.
Dans cette double acception, la culture française contemporaine, celle qui nous occupe dans cette intervention au travers du prisme de sa littérature, est, autant ne vous ménager aucun suspense, totalement inexistante. Dans un certain sens donc, il me faut bien avouer qu’Emmanuel Macron ne s’est pas trompé : la culture française contemporaine, du moins telle qu’elle s’exprime au travers de sa littérature, n’existe pas.
Oh, je sais bien qu’elle rayonne au travers du monde, cette culture française qui n’est plus vraiment rien d’autre qu’un certain art de vivre ou ce qu’il en reste (bons vins et bons fromages, belles robes et belles femmes pour les porter et, dans le meilleur des cas, quelques traductions de Michel Houellebecq (6) salué comme le nouveau colosse de Rhodes des lettres françaises moribondes, réduites à une bonne analyse sociologique sous la plume transparente de ce Français qui ressemble à notre voisin), et ce n’est certainement pas pour rien que des cars entiers de touristes venant des quatre coins du globe visitent notre pays, le voient et le photographient sous toutes ses coutures, sans jamais, bien sûr, le regarder, sans jamais lire autre chose que la version française de 50 nuances de Grey, à savoir les rinçures de Virginie Despentes. Michel Houellebecq encore, qui ne se trompe pas lorsqu’il affirme que notre pays tout entier se transforme en musée. Notre culture n'est pas vive, vivante, mais muséale, morte. Avant de venir ici, j’étais dans une région qui s’appelait autrefois la Haute-Normandie, et je crois bien qu’il m’a été impossible de photographier, à Étretat par exemple, non pas de splendides paysages façonnés par les millénaires, mais des paysages photographiés par des badauds ! Les entrepreneurs ambitieux qui dirigent ce pays de crevards, pour reprendre un terme qui a récemment défrayé la chronique, nous vantent aussi la beauté muséale de la France : oui, car ce qui est exposé dans un musée ne vit plus, tout comme la France est un pays mort, parce que, d’abord, sa culture est muséale, c’est-à-dire morte, exposée aux yeux de tous, mais point vivante, comme un cadavre placé sous les regards attentifs d’une poignée de carabins qui, eux au moins, du moins espérons-le, ne feront jamais la bêtise de confondre un cadavre avec un corps vivant.
6)
 Michel Houellebecq dans la Zone.
Michel Houellebecq dans la Zone.Cette évidence, vous me direz et je vous concèderai bien volontiers ce terme, ce paradoxe car vous avez beaucoup d’exemples de bons écrivains contemporains à me citer j’en suis sûr, est le premier point de mon exposé. Emmanuel Macron, bien qu’il ne le sache pas, a raison : il n’y a pas de culture française, et je vais même beaucoup plus loin que lui, puisque j’affirme, depuis quelques années déjà, que la littérature française est morte.
J’ai parlé de disparition de la culture française au sens large. J’en veux pour preuve absolument irrévocable l’état de sa culture, ou de sa production proprement littéraire, celle qui m’intéresse au premier chef. Voici quelques années, la revue inepte Chronic’art publiait un ouvrage collectif dans lequel mon défunt ami Maurice G. Dantec (7) évoquait le cadavre de la France qui, paraît-il, bougeait alors encore. Il s’est depuis je crois, non, j’en suis certain, arrêté de bouger. Nous allons, dans ce deuxième grand mouvement de mon propos, examiner plus minutieusement le cadavre de la littérature française, que nous imaginerons placé sur une table de métal, éclairé par la lumière crue de néons.
Les raisons de cette mort clinique sont pour le moins complexes et multiples (depuis la mort de Dieu et, consécutivement, celle de toute figure d’autorité, jusqu’à la perte de légitimité de tout discours vertical au profit d’une diffusion en rhizome comme le répète à l’envi la déconstruction postmoderniste), et ce n’est pas l’objet de mon intervention que de vous les exposer. La date précise de cette mort varie, elle-même, selon les auteurs : la tradition contre-révolutionnaire la fait remonter à la Mère de toutes les fautes, la Révolution française bien sûr. Certains auteurs, plus loin encore dans le passé, avec l’explosion de la raison raisonnante qu’aurait enclenché le Discours de la méthode de Descartes. Pour Manuel Arroyo-Stephens qui moque les Français dans un pamphlet érudit récemment traduit (8), c’est le classicisme qui est à l’origine de la quasi-nullité de la littérature française moderne. Je le cite : «On n'a pas découvert meilleur moyen pour donner de l'allure et de l'éclat aux artistes médiocres que de les obliger à suivre des règles qui cachent leur manque de talent : légiférer, en art, tue le créateur et produit des artisans. Il n'y a donc pas mieux, pour en finir avec la créativité d'un artiste, que de l'obliger à accepter des normes, des critères et des goûts émanant de ces vénérables institutions nommées académies. Rien n'est plus voisin de l'esprit français, conclut Manuel Arroyo-Stephens, que l'esprit académique» qui, du moins durant le ridicule 18e siècle, peut se confondre assez facilement avec un concours de « perruques poudrées et [de] mouches sur le visage», ou encore avec cet «art du paysage en éventail», «le vicomte maniéré des défis et l'abbé idiot des madrigaux», cet art «cérémonieux, mesuré, de la pavane» qui a donné un verbe pronominal qui, si mes souvenirs sont bons, a quelque rapport étymologique avec le mot paon, jetant ainsi une lumière non point crue mais elle-même artificielle et molle sur les habitudes françaises. Pour un très bel écrivain comme Guy Dupré (9), le merveilleux auteur des Fiancées sont froides, quelque chose s’est cassé avec la défaite de 1870, tout comme ce fut aussi le cas pour Ernest Renan, avant même que ne se déclenche la guerre d’extermination ou plutôt, selon Léon Bloy, sa pâle copie, je veux parler du premier conflit mondial. Je songe encore à ce que des auteurs comme Bernanos déjà nommé, mais aussi Brasillach ou Rebatet, et que dire de Céline, nous ont appris sur la débâcle de la Seconde Guerre mondiale. Peu importe au fond la date exacte qui signifierait, de manière claire, le début de la décadence de la littérature française, car elle ne peut de toute façon qu’être symbolique, puisqu’il est impossible de prétendre : «Mes amis, c’est à partir de cette date, et de cette date uniquement, que la France est entrée en déclin !».
7)
 Maurice G. Dantec dans la Zone.
Maurice G. Dantec dans la Zone.8)
 Contre les Français de Manuel Arroyo-Stephens.
Contre les Français de Manuel Arroyo-Stephens.9)
 Guy Dupré dans la Zone.
Guy Dupré dans la Zone.Les causes de ce déclin sont complexes, mais ses caractéristiques, elles, sont bien visibles dans ce que j’appellerais, plus que la littérature française contemporaine, la production littéraire française contemporaine. Nous allons maintenant examiner quelques-unes des particularités de cette mort ou, au mieux et si vous êtes d’indécrottables optimistes, de cette agonie.
D’abord, et c’est bien logique, la littérature française est devenue tout entière marchandise. Nous sommes à l’ère où tout se vend et s’achète, y compris les ventres des femmes, et il est donc tout à fait normal que dans un pays, le nôtre, dirigé par un représentant commercial de talent comme l’est Emmanuel Macron, cornaqué par une force de vente à la hauteur de ses prétentions de VRP international, les livres puissent se vendre comme n’importe quelle autre marchandise. Voyez le phénomène, annuel et désormais bisannuel, de la rentrée dite littéraire. En septembre, et maintenant désormais en janvier aussi, ce sont ainsi plusieurs centaines de nouveaux livres qui vont inonder les étals des charcutiers, pardon, des libraires, et il est parfaitement évident que ce ne seront pas les meilleurs livres qui auront la chance d’être lus, mais ceux qui auront bénéficié de la meilleure réclame publicitaire et de la complicité de journalistes incultes paraît-il critiques littéraires.
À la fin de l’été 2015, j’ai annoncé au public de l’Intime Festival de Namur auquel Benoît Poelvoorde (10) m’avait invité que le prochain prix Goncourt ne pouvait récompenser qu’un
05/09/2017 | Lien permanent
Pas pleurer de Lydie Salvayre, le Goncourt de la vulgarité

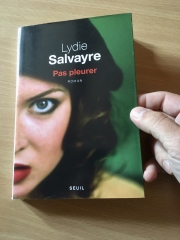 À propos de Lydie Salvayre, Pas pleurer (Éditions du Seuil, 2014).
À propos de Lydie Salvayre, Pas pleurer (Éditions du Seuil, 2014).Acheter Pas pleurer sur Amazon.
Voici la copie d'une note initialement publiée en 2014, à l'occasion de la parution de cet ignoble roman qu'est Pas pleurer de Lydie Salvayre. Pour une raison incompréhensible, cette note, qui avait été notablement partagée sur les réseaux sociaux, avait tout bonnement disparu de la Toile lorsque je me suis avisé de la rechercher.
Pauvre France qui naguère se voulut le phare intellectuel et littéraire du monde, que dis-je, de l'univers, se prit à croire à ce miracle et, finalement, parvint à le réaliser durant quelques siècles tout de même ! Aujourd'hui, elle n'en finit plus, comme un dernier de la classe obstiné dans sa nullité crasseuse, de prouver qu'elle mérite sa dernière place, sa place de cancre, la place qu'il est au moins aussi difficile de conquérir, puis de garder, que la première place, la dernière place avant la sortie hors de la classe, du classement, pour cause de nullité non rédimable, malgré tous les redoublements possibles, et les aides de la République des lettres si vigilante pour son mioche au nez morveux.
Tentons d'affoler nos journalistes en utilisant l'une de ces formules qu'ils goûtent tant et qui constituent, à vrai dire, le ban et l'arrière-ban de leur pensée, et que certains m'envieront, car il constitue un excellent titre d'article pour sûr, qui bien sûr jamais ne pourra être publié dans les colonnes d'un de nos valeureux suppléments journalistiques spécialisés en littérature, ni même dans celles d'une de ces si peu intéressantes revues évoquant des livres confondus avec des saucisses : Pas pleurer est le Goncourt de la vulgarité. Le Goncourt de trop ? Mon Dieu, non, même pas, car il y a quelques années tout de même que ce prix n'est plus qu'un entreléchage éhonté, une promotion à l'insignifiance, la récompense de la platitude, tares communes dont la particularité est d'être joyeusement célébrée, ce qui n'est pas rien dans la Ville des lumières, sous l’œil las des journalistes et d'un public de badauds qui jamais n'ont établi de grande différence entre un livre, celui que les critiques journalistiques leur recommandent chaudement, et un chapelet de saucisses, dis-je pour filer ma métaphore charcutière, tripale ou tripière. Pauvres lecteurs tout de même, bien informés de la traçabilité qui, désormais, est devenue le maître-mot de notre délire hygiéniste, ils risqueront de vomir et de cagarse (se chier) dessus bien davantage en lisant Pas pleurer, dont le seul avantage notable est qu'il facilitera le travail de la personne qui le traduira en espagnol, qu'en consommant la très saine cochonnaille.
C'est l'un des petits-fils de Georges Bernanos qui m'a demandé si j'avais lu ce roman qui évoque l'épisode de la terrifiante Guerre d'Espagne telle que son grand-père l'avait vue de ses propres yeux, puis dénoncée dans l'un des plus admirables livres du siècle passé, Les Grands cimetières sous la lune.
Non, cher ami, je n'ai pas lu ce roman, lui ai-je alors répondu et, pour l'heure, n'en pense à peu près rien, si ce n'est que d'autres personnes m'ont indiqué son existence, en effet, voire me conseillent de le lire, non pas tant qu'ils aient estimé la qualité de ce roman, mais parce qu'ils me savent passionné par Georges Bernanos, que Lydie Salvayre met en scène. Je me suis méfié, et je crois que j'ai bien fait de me méfier, car nous ne sommes jamais trop prudents en matière de consommation de carne, ou de piquette, ou de mauvais livre, c'est là tout un, surtout lorsque l'adresse qui vend cette carne, cette piquette ou ce mauvais livre vous est plaisamment recommandée. Quel sens aigu et insoupçonnable, comme l'odorat d'un malheureux qui serait tombé dans une fosse à purin, mit en alerte mon impeccable et redoutée capacité de décortiquer un livre salué comme il se doit par tous les crétins exerçant ce qui est décidément devenu, devant un autre plus moral, le plus vieux métier du monde ?
La réponse réside en deux mots : Pas pleurer, le titre du roman de Lydie Salvayre, que l'on croirait tout droit sorti, après des heures de cogitation mentale exténuante, d'une conversation par SMS entre deux pré-adolescents, ou bien du dialogue qui aurait été mitonné après des années de page désespérément blanche par Christophe Ono-dit-Biot, auteur d'un titre encore plus court que celui de Lydie Salvayre il fallait le faire, Plonger, un jour de propitiatoire et miraculeuse inspiration littéraire.
De l'inspiration littéraire, et peut-être même, tout simplement, du travail, Lydie Salvayre semble en avoir été privée, cette double absence étant fort heureusement compensée, pour le plus grand plaisir des imbéciles qui ont récompensé son roman, par une dose massive et pourtant non létale de vulgarité.
Nous trouvons en effet un concentré de vulgarité, douce fragrance annonçant la puanteur à venir, dès le titre du roman de Lydie Salvayre, ce minimalisme linguistique étant finalement le plus honnête indice de l'indigence littéraire du roman tout entier, sur laquelle nous reviendrons amplement, proposant ainsi la première véritable critique littéraire surnageant sans peine au milieu d'un océan de résumés de quatrième de couverture, d'éléments de langage publicitaires et de condensés de sottise.
 La vulgarité du roman de Lydie Salvayre, comme l’Être selon les métaphysiciens, est présente à tous les niveaux de conception de son roman, et englobe tout : cette vulgarité est donc formelle, dans l'emploi de termes et de formules vulgaires, grossiers, orduriers, et cette vulgarité constitue aussi comme un soubassement, puisqu'elle enrobe l'intention ayant présidé à la naissance de l’œuvre : la critique du catholicisme, du moins, d'un certain catholicisme rigoriste et tartuffe, traîné dans la boue et la merde, la critique du nationalisme, de tous les nationalismes, la critique de la guerre civile, la critique des fanatismes. Avouons que Lydie Salvayre s'est donné le beau rôle, n'est-ce pas ? Cerise sur le flan pas même correctement moulé, cette intention critique prétend s'inscrire sur les brisées de Georges Bernanos pour servir de miroir, disent les publicistes, aux dérives de notre franchouillarde société française, n'aimant pas le révolutionnaire, portant hauts ses légendaires cojones comme des ergots reposant sur le fumier et droite sa peur de la nouveauté et de la différence, les nouvelles mamelles de la Modernité.
La vulgarité du roman de Lydie Salvayre, comme l’Être selon les métaphysiciens, est présente à tous les niveaux de conception de son roman, et englobe tout : cette vulgarité est donc formelle, dans l'emploi de termes et de formules vulgaires, grossiers, orduriers, et cette vulgarité constitue aussi comme un soubassement, puisqu'elle enrobe l'intention ayant présidé à la naissance de l’œuvre : la critique du catholicisme, du moins, d'un certain catholicisme rigoriste et tartuffe, traîné dans la boue et la merde, la critique du nationalisme, de tous les nationalismes, la critique de la guerre civile, la critique des fanatismes. Avouons que Lydie Salvayre s'est donné le beau rôle, n'est-ce pas ? Cerise sur le flan pas même correctement moulé, cette intention critique prétend s'inscrire sur les brisées de Georges Bernanos pour servir de miroir, disent les publicistes, aux dérives de notre franchouillarde société française, n'aimant pas le révolutionnaire, portant hauts ses légendaires cojones comme des ergots reposant sur le fumier et droite sa peur de la nouveauté et de la différence, les nouvelles mamelles de la Modernité.Les grands lecteurs qui ont salué ce roman tout au plus lisible affirmeront que je commets un contresens majeur, puisque, après tout, Lydie Salvayre a pu ne vouloir que mettre en scène le vocabulaire grossier des campesinos, plus sûrement des catetos dont elle peint la soudaine révolte aiguillonnée par les idées communistes et anarchistes, ainsi que leur haine de la hiérarchie catholique espagnole, du curé jusqu'au Bon Dieu en passant par les bonnes sœurs, violées avec une charité toute particulière, inspirée dirons-nous.
Cette vulgarité, de fait, est incarnée dans sa bassesse blasphématoire par ce Notre Père ordurier : «Puto Nuestro que estás en el cielo, Cornudo sea tu nombre, Venga a nosotros tu follón, Danos nuestra puta cada día, y déjanos caer en tentación...» (p. 42). Cette vulgarité est le jus dans lequel semblent infuser presque toutes les phrases, par ailleurs si pauvres d'un point de vue stylistique, de Pas pleurer : «crucifix enfoncé dans le cul» (p. 44), dont l'antithétique version, espagnole et conservatrice, nous est aimablement offerte par «Yo la revolución me la pongo en el culo» (p. 46), le reste étant du même tonneau ou tube avec «entuber» (p. 55), l'attendu et de fait présent «Que le den por culo !» (p. 74), Lydie Salvayre parvenant fort heureusement à nous faire entrevoir l'envers du décor, le gland après le cul grâce «aux bons offices d'un âne pour se faire sucer la bite» (p. 77), appelée, ailleurs (p. 85), une fois qu'une bouche féminine aura avantageusement remplacé une gueule animale, «grosse queue», sans oublier la présence logique, au milieu de cette orgie festive, des «cabrones» (p. 56), la joie nihiliste s'étendant à tout le continent, «l'Europe [faisant] dans son froc à l'idée d'une révolution» (p. 59), «toute l'Europe catholique ferm[ant] sa gueule» (p. 70), tout cet étalage d'attributs féminins ou virils ne pouvant que faire se dresser la seule question valable, qui apparaît dans le roman comme les lettres de feu sous les yeux de Nabuchodonosor : «il se la touche ou quoi» (p. 60), ou bien encore «Qui est assez con pour croire qu'on puisse se passer d'un chef à grosses couilles» (p. 63), et, dans sa version castillane qui épargnera une fois de plus un sérieux travail au futur traducteur, l'«hombre con huevos» (p. 64 : littéralement, les œufs), d'aimables et martiaux «putain, je vais lui péter la gueule» (p. 65), l'un des personnages principaux, un peu trop roux pour les paysans du village, étant fort logiquement, au milieu de tant de soucis politiques et phalliques, un «enculé» (p. 73), la morne litanie de l'ordure graveleuse s'étendant sur le reste des pages de notre roman, mais l'acmé de l'insignifiance pas même vulgaire mais ordinaire (como se dice de una mujer que es ordinaria, Lydie) résidant peut-être, tout de même, à la page 118, où Lydie Salvayre évoque par le menu, si je puis dire, les différences subtiles entre les odeurs et mélodies des pets féminins et des pets masculins provoqués par les fameux garbanzos consommés à haute dose dans cette contrée reculée, arriérée, bien évidemment profondément phallocrate, qu'est l'Espagne de 1936 dont l'atmosphère qui plus est, on le suppose du moins, devait sentir fort mauvais à cause de tous ces dégazages intestinaux faisant une tranquille concurrence aux pourrissantes carcasses humaines jetées dans des fosses.
Les lecteurs rigoureux, dont l'ami Sébastien Lapaque, pourtant fin connaisseur de l’œuvre de Bernanos, ayant salué comme tant d'autres pigistes et sous-pigistes les hautes qualités littéraires du roman de Lydie Salvayre, affirmeront que je me scandalise de bien peu et que j'adopte, après tout, la position pour le moins louche qui est celle de l'un des personnages féminins du roman, doña Pura (au patronyme transparent), dans laquelle, bien évidemment, comme nous y autorise la ridicule quatrième de couverture du roman affirmant que la vision de Lydie Salvayre résonne «étrangement avec notre présent», nous ne pouvons que voir le portrait se voulant assassin et qui n'est que ridicule, d'une catholique engoncée dans sa macération et secrètement travaillée par l'unique envie paraît-il interdite par l’Église, le sexe bien sûr. Ainsi, il est clair aux yeux perçants de Lydie Salvayre que la charité de doña Pura ne peut qu'être éminemment trouble : «Car doña Pura aimait à soulager la misère des pauvres, activité qui constituait une excellent diversion, je dirais même un dérivatif puissant à ses perfides autant qu'innombrables indispositions, innombrables (1) tant dans leur expression que dans la nature des organes affectés, avec une prédominance nette des organes sis dans la sphère génito-urinaire» (pp. 87-8), Lydie Salvayre, qui cite tout de même Georges Bernanos, ayant dû lire une ou deux lignes de Léon Bloy et utilisant l'un de ses mots préférés quelques lignes plus loin : «autant de missions qui servaient d'émonctoire à ses prurits intimes et à ses ardeurs libidinales douloureusement rabrouées» (p. 88). C'est d'ailleurs à propos de cette caricature honteuse de catholique mal baisée que Lydie Salvayre nous fait part de sa science gynécologique en écrivant : «mais la pauvrette avait bien des excuses : elle n'avait jamais baisé y su chocho estaba sequito como una nuez» (p. 90; cette même délicatesse est répétée à la page 205). A croire que la pauvre Lydie Salvayre, en matière de sexualité féminine, s'y connaît aussi lamentablement qu'en écriture, puisque ce sont les plus impavides ogresses sexuelles qui, presque toujours et pour la raison que jamais leur appétit n'est rassasié, éprouvent les irritations d'une sécheresse passagère frappant leur outil de travail, qui du coup, malchance, se grippe, le plus intime. Passons, car je redeviens vulgaire et je ne dois pas oublier que je suis lu par de belles âmes ayant été touchées par la pureté d'âme dont Lydie Salvayre, incontestablement, fait montre dans son roman goncourisable et goncourisé.
Ce qui nous irrite n'est pas franchement la sécheresse stylistique de Lydie Salvayre qui, tout du moins en matière d'écriture, ni blanche comme des pertes ni rose mais d'une couleur limoneuse bien plus suspecte, répand quelques hectolitres d'ordures et de fadaises consensuelles.
Entendons-nous bien. La vulgarité, y compris en matière sexuelle, ne me choque ni ne m'émeut, je ne l'attends pas ni ne demande à la sentir comme l'absente de tout bouquet et, absente justement, je ne me désole pas de sa disparition. Lorsqu'elle est évoquée dans une écriture digne de ce nom, elle me fait bien davantage rire, comme c'est le cas dans La Chair de Serge Rivron. Me gêne davantage, m'incommode même franchement le fait que, dans le roman de Lydie Salvayre, cette vulgarité phagocyte absolument tout, les rares parties saines de l'organisme, disons les deux dernières parties du roman, comme un cancer pressé de dévorer la chair pour la transformer en matière noire, morte, pourrie, puante. En somme, et pour le dire vulgairement, d'une vulgarité qui ne pourra que réjouir notre auteuse (pardonnez-moi cette horreur, je deviens vulgaire à mon tour), Chie pas juste qui veut, comme l'écrivait le grand Céline, dont la vulgarité, du moins incarnée dans ses livres, est proverbiale et ravageuse, et irrésistiblement drôle, non parce qu'elle atteindrait à une fosse d'aisance plus profonde que toutes celles qui ont été creusées avant ou après lui (par exemple par Rabelais, Pierre Guyotat ou, en Espagne, Francisco Quevedo), mais parce que, tout simplement, elle était portée, servie, achalandée si je puis dire par une écriture digne de ce nom et même, une écriture géniale, une invention linguistique et stylistique prodigieuse. En lieu et place de génie ou même, simplement, de talent, Lydie Salvayre tente d'expliquer (de justifier ?) cette vulgarité qu'elle nous a fait renifler malgré notre sinusite surinfectée en évoquant les troubles mentaux de sa mère (cf. p. 82)...
Ainsi abordons-nous le deuxième reproche, bien plus essentiel que le premier, que tout lecteur est en droit d'adresser au lamentable roman de Lydie Salvayre : la pauvreté absolue de son écriture. La merde étalée à toutes les pages ou presque finit non seulement par sentir mauvais mais par dégoûter le plus coprophile des lecteurs, alors que la merde, transcendée par une écriture jubilatoire, accède à la ferveur mystique tant de fois évoquée par un Léon Bloy.
Nous pourrions illustrer de bien des façons l'absolue platitude de l'écriture de Lydie Salvayre, mais nous nous bornerons à évoquer deux de ses aspects : la pauvreté de son invention verbale, lorsqu'il s'agit de créer une langue, ou plutôt, un idiome à cheval entre le français et l'espagnol, puis la pauvreté réellement étique de deux ou trois procédés stylistiques déparant certains de ses dialogues au style indirect, censés, du moins je le suppose, conforter la langue «joyeusement malmenée» qu'évoque, ridiculement, la quatrième de couverture.
Me permettra-t-on une anecdote ? Ma mère a commencé à apprendre le français lorsqu'elle est arrivée en France, après avoir suivi celui qui allait devenir son mari quelques années plus tard, mon père. Elle n'avait alors que 18 ou 19 ans. Je connais donc par cœur, m'en agace tout autant que j'y suis attaché depuis mon enfance, l'espèce d'idiome dans lequel elle s'exprime, surtout lorsqu'elle se montre agacée ou émue, étrange mélange de mots français ressemblant à l'espagnol et de mots espagnols littéralement traduits en français, de phrases commencées dans une langue et finies dans une autre. Je précise que cet idiome a été lissé si je puis dire, au fil des années, et que ma mère s'exprime depuis longtemps tout de même dans un français digne d'être salué par Pierre Assouline, qui n'a pas craint de récompenser celui de Lydie Salvayre. Lisant donc le pidgin (pardon ! le frañol) faussement savant dans lequel notre romancière sans talent fait s'exprimer sa mère, je n'y ai absolument pas reconnu celui de ma mère, preuve que son invention est artificielle et pas même crédible, preuve que son invention ne parvient pas à transcender des contingences purement particulières. Voulant sans doute faire sourire, voire rire son lecteur, Lydie Salvayre atteint un grotesque involontaire qui se retourne contre elle. Prenons un exemple qui vaudra mieux que bien des explications : «Alors quand on se retrouve en la rue, je me mets à griter (moi : à crier), à crier» (p. 13) ou bien «Tu l'as comprendi ma chérie, me dit ma mère» (p. 86). L'invention verbale est ici proche du degré zéro qui parvient à congeler même le plus bienveillant des lecteurs, puisqu'il ne s'agit dans ces deux cas, déclinés tout au long du roman («hablent», p. 116, pour parler, provenant de l'espagnol «hablar», «romper» à la même page pour rompre), que d'adapter un verbe espagnol (gritar pour crier, comprender pour comprendre, ou encore, p. 79, permitir pour permettre) en le francisant grossièrement. Cet effet, comme une escopette antédiluvienne, ne peut tirer qu'un seul coup, là où Lydie Salvayre nous troue de rafales, sans compter le fait que ce procédé grossier de calque fait de sa mère une imbécile bien davantage qu'une pauvre immigrée éprouvant des difficultés à s'exprimer dans une langue qui n'est si visiblement pas la sienne et ne le sera jamais. Pour ne pas être accusés de ne citer qu'un seul procédé stylistique et ainsi d'appauvrir volontairement la richesse de l'écriture de notre romanceuse (la vulgarité, derechef), accordons à Lydie Salvayre qu'elle procède à ce type de calque expéditif et convenu en l'adaptant à des noms, c
10/09/2016 | Lien permanent
Léon Bloy redivivus

 Pour saluer la réédition en poche de l'impeccable Exégèse des lieux communs (que l'on préférera de loin à sa récente mouture sous la plume de Jacques Ellul) dans la collection Petite bibliothèque de Rivages Poche, je remets en ligne un vieil article de critique consacré à l'édition en deux volumes du Journal de Léon Bloy par Pierre Glaudes.
Pour saluer la réédition en poche de l'impeccable Exégèse des lieux communs (que l'on préférera de loin à sa récente mouture sous la plume de Jacques Ellul) dans la collection Petite bibliothèque de Rivages Poche, je remets en ligne un vieil article de critique consacré à l'édition en deux volumes du Journal de Léon Bloy par Pierre Glaudes.Léon Bloy, Journal 1 (Le Mendiant ingrat, Mon Journal, Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne, L'Invendable) et 2 (Le Vieux de la Montagne, Le Pèlerin de l'Absolu, Au seuil de l'Apocalypse, La Porte des Humbles), édition établie et annotée par Pierre Glaudes, Robert Laffont, coll. Bouquins.
La réédition du Journal de Léon Bloy a été un événement et continue de l’être, non pas tant pour la poignée de lecteurs perspicaces qui avaient pu en lire le texte, en quatre volumes, procuré par Joseph Bollery au Mercure de France, que pour les nouveaux lecteurs que va toucher sans aucun doute la large diffusion dont bénéficient les titres de la collection Bouquins. Guy Schoeller, directeur de cette excellente collection, est un
 homme éclectique, capable de promouvoir les oeuvres d'auteurs du Moyen Âge, d'Edgar Poe ou de Lovecraft, des sœurs Brontë ou même de Léon Daudet, le fils prodigue d'Alphonse, crétin que ne goûtait guère Bloy, l'auteur de Tartarin ayant prétendu un jour ne pas connaître le Mendiant ingrat, sur lequel se refermait lentement la porte étanche de la conspiration universelle du silence. Pour sa part, Pierre Glaudes, responsable de cette nouvelle édition (plutôt que réédition, puisque ce texte a bénéficié de la publication du premier volume du Journal inédit de Bloy, chez L'Âge d'Homme), est un très grand spécialiste de l'auteur de L'Âme de Napoléon, qu'il préface ici superbement et très finement (1).
homme éclectique, capable de promouvoir les oeuvres d'auteurs du Moyen Âge, d'Edgar Poe ou de Lovecraft, des sœurs Brontë ou même de Léon Daudet, le fils prodigue d'Alphonse, crétin que ne goûtait guère Bloy, l'auteur de Tartarin ayant prétendu un jour ne pas connaître le Mendiant ingrat, sur lequel se refermait lentement la porte étanche de la conspiration universelle du silence. Pour sa part, Pierre Glaudes, responsable de cette nouvelle édition (plutôt que réédition, puisque ce texte a bénéficié de la publication du premier volume du Journal inédit de Bloy, chez L'Âge d'Homme), est un très grand spécialiste de l'auteur de L'Âme de Napoléon, qu'il préface ici superbement et très finement (1). Quoi qu'il en soit, la lecture ou la relecture de cette œuvre grandiose est un séisme dans le monde lilliputien des actuelles productions littéraires. Car allez donc faire un tour au supermarché littéraire d'une quelconque FNAC, afin de vous délecter du spectacle : au rayon des nouveautés, le portrait de Bloy semble fixer les auteurs racoleurs qui osent étaler leurs œuvres infectes près de son Journal de l'âme, et réduire leur verbiage aigre à un mince filet limoneux, qui s'évaporera sous la chaleur de l'astre bloyen, dont le spectre étonne encore les spécialistes. De la dureté, de l'ironie, de la fureur, de l'imprécation, de la grâce, une soif furieuse de Dieu, du désespoir et de la misère, voici donc les éléments lourds qui composent l'étonnante singularité astronomique, effondrée sous son propre poids, comme s'il s'agissait d'un de ces trous noirs invisibles. Mais l'astre lourd, l'étoile super-massive a un autre secret : tous ces éléments exotiques éclairent les somptueuses drapures de la nébuleuse de l'Aigle qui, en réfléchissant leur lumière acérée, fait baigner dans ses vaporeuses dentelles les jets âpres de l'écriture bloyenne.
 C'est que, le croirez-vous, la violence, chez cet auteur, n'est pas première ; le sont en revanche le regret, l'imprescriptible nostalgie du royaume perdu, mais surtout, l'attente – énorme, puisque ses cris résonneront jusqu'à la dernière heure de Bloy, mort le 3 novembre 1917 – du retour de l'homme providentiel, saint ou démon, ange ou bête dont Le Salut par les Juifs nous donne le saisissant et mystérieux portrait, qu'un instant, Bloy, compagnon d'une prostituée (dans le milieu des années 1880) du nom d'Anne-Marie Roulé qu'il convertit et qui lui donna en échange la clé des visions qui allaient la faire sombrer dans la folie, pensera n'être autre que lui-même. C'est le secret de Bloy, éventé en partie par le verbiage paraclétien de Huysmans dans son Là-bas, néanmoins aussi impénétrable que celui de Kierkegaard, l'un et l'autre ayant déchaîné une folie de commentaires plus ou moins intelligents. Quoi qu'il en soit, la nostalgie de Bloy est une attente, ou plutôt, elle est ce que je pourrais appeler la nostalgie du futur, puisque pour l'auteur le temps qui gouverne nos destinées n'est rien de plus qu'une illusion du Démon, qui a figé le monde immédiatement après la Faute. De sorte que la lecture de son Journal, j'expose ce paradoxe révélateur de l'exégèse bloyenne, lecture faite par l'un de nos lecteurs qui sans doute n'a jamais rien su de Bloy jusqu'à ce qu'il parcoure ces lignes et qu'il en sorte retourné comme un gant, a peut-être favorisé, dans sa lutte contre les Anglais, les efforts de la Pucelle ou ceux du géant Napoléon, ou peut-être même, j'ose cette folie, a permis la naissance de Bloy à la vie érémitique et prophétique qui fut la sienne, ou encore, a permis que tel illustre mécréant, au soir de sa vie impie, trouve enfin le repos consolateur.
C'est que, le croirez-vous, la violence, chez cet auteur, n'est pas première ; le sont en revanche le regret, l'imprescriptible nostalgie du royaume perdu, mais surtout, l'attente – énorme, puisque ses cris résonneront jusqu'à la dernière heure de Bloy, mort le 3 novembre 1917 – du retour de l'homme providentiel, saint ou démon, ange ou bête dont Le Salut par les Juifs nous donne le saisissant et mystérieux portrait, qu'un instant, Bloy, compagnon d'une prostituée (dans le milieu des années 1880) du nom d'Anne-Marie Roulé qu'il convertit et qui lui donna en échange la clé des visions qui allaient la faire sombrer dans la folie, pensera n'être autre que lui-même. C'est le secret de Bloy, éventé en partie par le verbiage paraclétien de Huysmans dans son Là-bas, néanmoins aussi impénétrable que celui de Kierkegaard, l'un et l'autre ayant déchaîné une folie de commentaires plus ou moins intelligents. Quoi qu'il en soit, la nostalgie de Bloy est une attente, ou plutôt, elle est ce que je pourrais appeler la nostalgie du futur, puisque pour l'auteur le temps qui gouverne nos destinées n'est rien de plus qu'une illusion du Démon, qui a figé le monde immédiatement après la Faute. De sorte que la lecture de son Journal, j'expose ce paradoxe révélateur de l'exégèse bloyenne, lecture faite par l'un de nos lecteurs qui sans doute n'a jamais rien su de Bloy jusqu'à ce qu'il parcoure ces lignes et qu'il en sorte retourné comme un gant, a peut-être favorisé, dans sa lutte contre les Anglais, les efforts de la Pucelle ou ceux du géant Napoléon, ou peut-être même, j'ose cette folie, a permis la naissance de Bloy à la vie érémitique et prophétique qui fut la sienne, ou encore, a permis que tel illustre mécréant, au soir de sa vie impie, trouve enfin le repos consolateur. L'écriture de Bloy qui se moque du temps comme elle se moque de la racoleuse modernité et de ses corollaires assassins que sont l'idée de progrès, de réussite sociale et de morale, je pourrais la définir comme une gigantesque entreprise de déchirement du voile. En effet, le temps n'est rien, mais le Mal aussi, pourtant déchaîné dans le paroxysme de la Première Guerre que Bloy ne pense être que le prodrome de la Grande Tribulation qui se prépare, mais, tout autant, la raillerie des hommes, leur mépris, la haine que les contemporains de l'écrivain déversèrent à gros bouillon saumâtre sur la tête de ce pèlerin du Silence. Les mépris de Léon Bloy
 sont devenus légendaires, ainsi que ses pages flambantes d'une haine surnaturelle contre Huysmans – un temps son ami –, Péladan, Bourget ou Zola qui fut, aux yeux de l'auteur du Désespéré, le puits de toutes les avanies, l'immense loupe concentrant dans le foyer de son coffre-fort les rayons d'une gigantesque sottise alliée aux mérites d'un flair boutiquier sans pareil.
sont devenus légendaires, ainsi que ses pages flambantes d'une haine surnaturelle contre Huysmans – un temps son ami –, Péladan, Bourget ou Zola qui fut, aux yeux de l'auteur du Désespéré, le puits de toutes les avanies, l'immense loupe concentrant dans le foyer de son coffre-fort les rayons d'une gigantesque sottise alliée aux mérites d'un flair boutiquier sans pareil. C’est de cette haine parfois involontairement drôle, mais aussi de cette grandeur de vue, de ce génie de l'écriture (avec et sans majuscule), je pèse mes mots, qui fut probablement unique dans l'histoire des Lettres, que Jean-René Huguenin est né (celui, pamphlétaire et logocrate, du superbe Journal), mais aussi, mais bien sûr, Georges Bernanos, qui lui dédia un texte émouvant (Dans l'amitié de Léon Bloy) après avoir découvert la prose de ce Georges Darien apostolique dans les tranchées de l'Avant, où il pataugeait en regardant fixement la prunelle furieuse de son abbé Donissan. Sébastien Lapaque ou même Philippe Muray, mais également Marc-Édourad Nabe, qui l’a lu et oublié au milieu de sa collection de préservatifs, se réclament d'une aussi noble lignée, bien qu'ils n'égalent d'aucune façon la hargne de cet imprécateur né, qui écrivait, le 3 septembre 1893 : «Ma colère est l'effervescence de ma pitié...». Que voulez-vous, ces écrivains de talent (je répète que Nabe se galvaude complaisamment depuis son dernier roman, Printemps de feu) de même que tous les surgeons frénétiques se réclamant du Vieux de la montagne, aussi sincères qu'ils paraissent, auraient bien de la peine à fouailler les profondeurs d'une âme aussi véhémente que celle de Bloy, écrivant, le 19 mars 1900, dans le second volume de son Journal : «Je ne sens rien en moi que la présence, à une profondeur où je n'ose descendre, d'un sombre lac de douleurs dont les vagues me submergeront peut-être à l'heure de mon agonie». Applaudissant ce Lacordaire à la muflerie incandescente, Kafka comparait Bloy aux prophètes du vieil Israël qui secouaient leurs pieds harassés par la marche dans les déserts sur le seuil des demeures riches et avares de la Parole, en plaçant toutefois ces dangereux contempteurs de la lâcheté du Peuple élu dans les rangs des admirateurs, donc des débiteurs de Bloy. Borges, lui, génial et subtil entomologiste, écrivain pourtant au nadir de ce zénith de violence qu’est l’auteur des Histoires désobligeantes, déclarait le goûter plus qu'aucun autre, avec Carlyle et Poe.
 Mais qu'importent, au demeurant, les paternités spirituelles, qui constituent la trame réelle du monde invisible et qu'importe encore que je rapproche Bloy d'autres noms, qu'il goûta et tenta de propager dans les ornières des consciences de ses contemporains, le plus souvent engorgées par les immondices et la plus veule des médiocrités : Barbey d'Aurevilly qui fut son mentor littéraire, Villiers de L'Isle-Adam qu'il aima jusqu'à la mort misérable de l'auteur des Contes cruels, Lautréamont qu'il découvrit presque le premier, Ernest Hello qui fut son frère en souffrance et en génie : cette poignée d’écrivains et quelques autres moins connus furent les vrais compagnons du splendide vociférateur. C'est que Bloy, comme n'importe quel autre grand écrivain, est un inclassable. Le cliché fuligineux et stupide d'un Bloy antisémite (2) et réactionnaire traîne dans toutes les urinoirs de la bêtise irréparable. Sur la première fausse critique, laissons l'auteur du Salut par les Juifs répondre dans l'une de ses lettres : «L'antisémitisme, chose toute moderne, est le soufflet le plus horrible que Notre-Seigneur ait reçu dans sa Passion qui dure toujours ; c'est le plus sanglant et le plus impardonnable, parce qu'il le reçoit sur la Face de sa Mère de la main des chrétiens». Sur la seconde, pour les petits desservants qui fréquentent – encore – les cercles étriqués de l'Action Française, Bloy est sans aucune ambiguïté lorsqu'il écrit des catholiques monarchistes, dans ses remarquables Méditations d'un solitaire en 1916, «qui rêvent de je ne sais quelle restauration de la vieille bâtisse royale, où une niche à chien de garde serait offerte à Notre Seigneur Jésus-Christ», qu'ils sont à ranger dans le même sac – celui de la plus crasse nigauderie – que les prélats ralliés lesquels, comme le cardinal-archevêque de Paris, Mgr Amette, déroulent un tapis rouge (c'est le cas de le dire !) aux partisans de l'Union Sacrée : une fois la guerre terminée et gagnée, la République qu'ils idolâtres naïvement saura répondre convenablement à leurs rêves sots d'entente cordiale. Ces pitoyables socialistes de la Grâce font partie, selon l'auteur (23 septembre 1910, Le Pèlerin de l'Absolu), du «monde religieux moderne s'efforçant […] de prolonger un passé défunt dont Dieu ne veut plus».
Mais qu'importent, au demeurant, les paternités spirituelles, qui constituent la trame réelle du monde invisible et qu'importe encore que je rapproche Bloy d'autres noms, qu'il goûta et tenta de propager dans les ornières des consciences de ses contemporains, le plus souvent engorgées par les immondices et la plus veule des médiocrités : Barbey d'Aurevilly qui fut son mentor littéraire, Villiers de L'Isle-Adam qu'il aima jusqu'à la mort misérable de l'auteur des Contes cruels, Lautréamont qu'il découvrit presque le premier, Ernest Hello qui fut son frère en souffrance et en génie : cette poignée d’écrivains et quelques autres moins connus furent les vrais compagnons du splendide vociférateur. C'est que Bloy, comme n'importe quel autre grand écrivain, est un inclassable. Le cliché fuligineux et stupide d'un Bloy antisémite (2) et réactionnaire traîne dans toutes les urinoirs de la bêtise irréparable. Sur la première fausse critique, laissons l'auteur du Salut par les Juifs répondre dans l'une de ses lettres : «L'antisémitisme, chose toute moderne, est le soufflet le plus horrible que Notre-Seigneur ait reçu dans sa Passion qui dure toujours ; c'est le plus sanglant et le plus impardonnable, parce qu'il le reçoit sur la Face de sa Mère de la main des chrétiens». Sur la seconde, pour les petits desservants qui fréquentent – encore – les cercles étriqués de l'Action Française, Bloy est sans aucune ambiguïté lorsqu'il écrit des catholiques monarchistes, dans ses remarquables Méditations d'un solitaire en 1916, «qui rêvent de je ne sais quelle restauration de la vieille bâtisse royale, où une niche à chien de garde serait offerte à Notre Seigneur Jésus-Christ», qu'ils sont à ranger dans le même sac – celui de la plus crasse nigauderie – que les prélats ralliés lesquels, comme le cardinal-archevêque de Paris, Mgr Amette, déroulent un tapis rouge (c'est le cas de le dire !) aux partisans de l'Union Sacrée : une fois la guerre terminée et gagnée, la République qu'ils idolâtres naïvement saura répondre convenablement à leurs rêves sots d'entente cordiale. Ces pitoyables socialistes de la Grâce font partie, selon l'auteur (23 septembre 1910, Le Pèlerin de l'Absolu), du «monde religieux moderne s'efforçant […] de prolonger un passé défunt dont Dieu ne veut plus».Oui, comme Léon Bloy, terrible vivant au milieu des morts, plus vivant que les milliers de masques qui monologuent perpétuellement dans les caves de notre vieux pays, paraît décidément les précéder d’une perpétuelle longueur, eux qui, comme ils sont d’une pathétique mauvaise foi, ne lui pardonneront jamais cette offense.
Notes
(1) Je relève toutefois une étrange erreur, page 42 de son Introduction ; parlant de l'Inconnu que Bloy a attendu tout au long de sa vie, Pierre Glaudes écrit : «Ce personnage sublime, qui ne peut être saisi que par la négation ou par l'indéfini, relève à l'évidence de la logique du neutre, qui est proprement celle de l'utopie». Non ! Cette tentative n'est pas celle qui déboucherait sur une espèce d'entité politico-surnaturelle neutre, mais celle, apophatique, qui tente de focaliser l'attention des lecteurs sur le paradoxe absolu, c'est-à-dire l'alliance rigoureuse du oui et du non. Le neutre n'exige jamais le saut dans la foi qui, selon Kierkegaard, dénouait seul le nœud gordien de la catégorie du paradoxal.
(2) Sur cette question douloureuse et difficile, qui semble toujours résister aux hâtives lectures d’auteurs tels que Éric Marty (voir son pourtant corrosif Bref séjour à Jérusalem), une excellente mise au point nous est donnée par l'article de Denise Goitein, Léon Bloy et les Juifs, Cahier de l'Herne Léon Bloy, n° 55, (éditions de l'Herne, 1988), pp. 280-294.
11/05/2005 | Lien permanent
Il n'y a que la mauvaise presse qui sauve ou Philippe Muray ressuscité
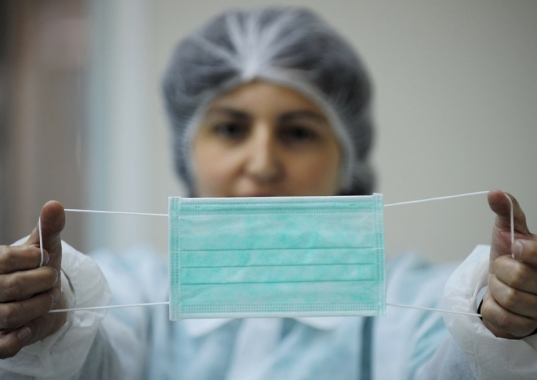
Philippe Muray.
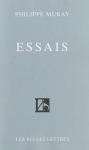 À propos de Philippe Muray, Essais (Éditions Les Belles Lettres, 2010).
À propos de Philippe Muray, Essais (Éditions Les Belles Lettres, 2010). Elias Canetti, fraîchement récompensé par le prix Nobel de littérature, eut à cœur de railler l'incurie des éditeurs et des journalistes de son propre pays : les premiers parce qu'ils avaient laissé son œuvre dans l'ombre en ne rééditant pas ses livres, les seconds parce qu'ils se précipitèrent sur ces derniers, les picorant (ou plutôt s'entreglosant) sans bien sûr les lire.
Lui qui avoua sa fascination et sa répulsion pour le grand Karl Kraus, retrouva même quelque peu de l'ire vindicative du fameux et terrifiant polémiste durant cette période bénie ou maudite, c'est selon, pendant laquelle les médiocres durent prendre un ticket numéroté et faire la queue en attendant le bon plaisir du maître désormais incontournable et bien trop visible pour qu'on puisse continuer à faire taire sa voix subtile et puissante. Il tenait, en somme, sa revanche sur les cuistres. Il était vivant. Philippe Muray, lui, ne l'est plus.
Nous ne sommes jamais assez durs avec les journalistes, c'est peut-être ce que découvrit aussi, avec un peu de stupeur tout de même, Elias Canetti. Leur médiocrité est toujours un cran au-dessus (ou au-dessous, c'est affaire de perspective) de celle que, par compassion plus qu'ignorance, nous avions cru être le maximum qu'un être humain pût supporter sans se dissoudre instantanément. Comme les créatures des très grandes profondeurs sous-marines, les journalistes se sont adaptés à des pressions extrêmes, n'ont pas besoin de lumière, se nourrissent des déchets qui lentement glissent vers leurs petites bouches translucides et, pour certains, parviennent même à écrire sans avoir, une seule fois, pris la peine de remuer leurs branchies atrophiées.
Tous ont beau ne pas être les résidents de la fosse dite de Marianne, ils n'en sont pas moins extrêmophiles, comme disent les biologistes qui paraissent tous les jours découvrir de nouvelles espèces de ces monstres mous habitués à l'obscurité la plus impénétrable. Vivants, ils sont morts car, à de pareilles profondeurs, toute dépense d'énergie inutile peut être létale. Ils végètent, ils planctonnisent, ils regardent parfois, de leurs gros yeux globuleux et aveugles, le ciel impénétrable et très profondément noir qui tend sa gueule au-dessus d'eux.
Vivants, s'agitant, ils sont déjà morts et se nourrissent de la chair de certains morts, mille fois plus vivants qu'eux.
Voyez-les, tous ces imbéciles claironnants et demi-soldes boulevardiers qui découvrent Philippe Muray quelques années seulement, ce n'est déjà pas si mal me dira-t-on, après sa mort, et encore, pressés qu'ils sont d'écrire leurs petits articulets navrants et incultes pour ne pas paraître en reste de ceux de leurs confrères, bluettes elles-mêmes incultes et creuses, voyez-les qui rédigent des papiers tellement originaux que le plus scrupuleux des experts en faux ne pourrait établir aucune différence entre eux. Ils s'agitent. Ils frétillent. Ils bavardent. Ils ne créent rien, car ils sont morts bien que vivants, et le règne des morts-vivants est une constante mais inéluctable pétrification, comme nous le voyons dans l'étonnant conte de Michel Bernanos. Il y a plus de différences entre deux ouvrières d'une termitière japonaise qu'entre deux journalistes qui partagent la même table de restaurant, rêvent de partager la même maîtresse et, quoi qu'il en soit, défendent les mêmes idées, c'est-à-dire celles qui sont l'émanation de l'air du temps.
Même le très gauchi et bientôt centenaire Jean Daniel, m'a-t-on dit, s'est subitement mis à trouver du génie à son illustre cadet contempteur, Philippe Muray, promettant à son fantôme ironique de sonner l'hallali, le derrière vissé sur sa bréhaigne, pour une cavalcade poussive de quelques centimètres sur les pâtures du lieu commun. Il ne sera pas dit que l'illustre Jean Daniel a méprisé, du moins après son trop court séjour sur terre, Philippe Muray.
Élisabeth Lévy elle-même, inflexible Cassandre du marronnier réactionnaire plutôt que du scoop véritable, causeuse lassante y compris même lorsqu'elle consent à vous laisser parler, journaliste point trop inintéressante tout de même lorsqu'elle écrit plutôt qu'elle bavarde, ronchonneuse professionnelle qui a réussi à faire reconnaître aux services de l'État la profession de mouche du coche, moderne incarnation d'une Amazone de toute éternité contrariée et peut-être même de tous les dangers réunis de la sauvage Amazonie ou de ce qu'il en reste, walkyrie miniaturisée du verbe journalistique qui ne rate jamais une occasion de se prétendre femme jusqu'aux bouts de ses flèches enduites de curare et d'affirmer qu'elle ne doit rien aux hommes (pas même sa propre naissance, référence faite à une conversation animée, désormais ancienne, en présence de Maurice G. Dantec), Élisabeth Lévy en personne n'a pas eu assez de mains et de pieds pour serrer tous ceux de ses collègues journalistes masculins lors de telle récente soirée privée (ce mardi 21 septembre vers 18 heures, au Lucernaire, un restaurant naguère fréquenté par Muray) où elle but les paroles de Fabrice Luchini, pas franchement dupe du cirque qui l'entourait et même, bien que disert et aimable, étrangement réservé.
Bien évidemment, unique couac (ou peu s'en faut) dans cette magnifique symphonie en culbute majeure, j'aurais quelque mauvaise grâce à ne point saluer le mystérieux regain d'intérêt dont paraissent (restons prudents) bénéficier les livres (en l'occurrence, ses exorcismes spirituels, regroupés en un seul beau volume préparé par Vincent Morch pour les Belles Lettres) de Muray mais enfin, nul ne m'en voudra je l'espère de jeter quelque sonde soupçonneuse dans la flache de cette subite attention, ni même de gentiment moquer le fait que le meilleur livre de cet auteur, le livre même qu'il n'a fait que décliner ou répéter jusqu'à sa mort, je veux bien sûr parler du XIXe siècle à travers les âges, est tout aussi étonnamment absent des meilleures ventes de la rentrée, catégorie essais comme il se doit.
Gageons même que cette si propitiatoire période de ventes d'ouvrages de qualité soit elle-même affublée d'une tare que Philippe Muray avait caractérisée de la façon suivante : «Il n’y a pas de lucidité sans séparation. Il n’y a pas non plus de littérature sans conflit et sans aggravation de conflit» (1).
Nous pouvons tirer deux postulats de cette constatation trempée, comme l'acier, dans un bain d'eau froide. D'abord, puisque nous voici plongés dans la mélasse la plus indifférenciée où gauche et droite se disputent la dépouille aimablement désagréable d'un mort et tentent de convoquer au-dessus de leur table barbante son mauvais génie posthume, le phénomène auquel nous assistons est tout ce que l'on voudra sauf le témoignage d'une miraculeuse prise de conscience, pour ne point évoquer, comme Muray le fait, quelque lucidité qui n'est tout de même pas la vertu la mieux partagée par nos contemporains, surtout s'ils exercent la profession immodeste de journaliste.
Ensuite, puisque ce remarquable et sans contestation possible mélodique accord sur la portée des œuvres de Muray nous a plongés dans le sucre candi des bons sentiments qui creusent, comme des larves de mouches, leur nid douillet dans la dépouille d'un auteur qui fut un redoutable vivant, il y a fort à craindre que la littérature soit, de nouveau l'absente des bouquets de toutes ces fiancées froides qui pleurent la mort d'un fiancé et même celle d'un véritable père, d'un père plus intensément père en ceci qu'il ne présente aucun lien de parenté avec les intéressées.
Pardon, vous me dites qu'il n'y a, encore elle, qu'Élisabeth Lévy qui menace de faire monter le niveau de la Seine à force d'ouvrir les vannes cyclopéennes de ses conduits lacrymaux ? J'ai cru qu'elles étaient au moins un bon millier, ces Antigones s'arrachant de douleur les cheveux et criant sur tous les toits, sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les ondes radiophoniques que c'était bel et bien le corps maltraité de leur propre malheureux frère qui était laissé sous les soleils corrupteurs des flashs des photographes qui, par conscience professionnelle sans doute, se déclarent près à déterrer un cadavre pour voir si sa texture réactionnaire l'a affublé de particularités anatomiques troublantes.
Non, il n'y a sur scène, vérification faite auprès du metteur en scène de notre impeccable et si actuelle tragédie, qu'Élisabeth Lévy mais celle-ci, phénomène qui devrait passionner et intriguer les physiciens de l'étrange et même les frères Bogdanoff, semble posséder la particularité d'être sur plusieurs plateaux d'émissions télévisées en même temps, à seule fin d'y délivrer son message aussi convenu que le bruit d'un coucou d'horloge suisse, prêt-à-consommé de crieuse et gouaille vulgaire de cabaretière éraillée rendant grâce au père, maître, intercesseur, modèle et bientôt bienheureux Philippe Muray d'avoir irrigué de sa sève polémistique les plates-bandes où poussent ses quelques navets journalistiques de si pâle couleur qu'on les confond avec des feuilles de gélatine.
La si brillante et versicolore réacosphère, ce mélange improbable de petits frontistes se planquant derrière des pseudonymes, de gros beaufs avinés commentant, comme le matin ils sont accoudés au zinc et le ballon de blanc faisant cercle sur un exemplaire de SAS, les communiqués immondes, suintant la haine et la peur la plus ignoble, la crispation identitaire autour de belles valeurs gersoises qu'hélas ces lamentables vivandiers de l'action politique véritable n'illustrent guère par leurs écrits, émis, avec un sérieux d'un grotesque inégalé, par le ridicule Parti de l'In-nocence de Renaud Camus, cette si probe congrégation d'évanescents ectoplasmes appartenant, par leur seul corps astral, à la Nouvelle Droite, ce maigre raout de puceaux proches de la quarantaine qui croient sans rire que Kierkegaard, Chesterton, Unamuno et peut-être même le Christ en personne leur soufflent à l'oreille les phrases suintantes de prétention et de vulgarité qui composent leur catéchisme névrosé et enfin ce bordel bien sous tout rapport composé de vieilles demi-mondaines confondant hostie et godemiché et ne se rendant pas compte qu'elles risquent une déchirure anale plutôt qu'une excommunication papale, la réacosphère donc, mutualisation de talents nanométriques et de prétentions himalayesques adore, mais alors là vraiment adore, paraît-il, les textes d'Élisabeth Lévy.
Ce doit donc être, hypothèse la plus sobre, un fameux signe d'excellence. Il est vrai que cette même réacosphère aime immodérément Philippe Muray, qu'elle ne cite d'ailleurs jamais très précisément, se contentant de tirer, sur sa face blême et maladive, un peu de la lumière crue que Muray dirige toujours, avec une cruauté raffinée, sur ses cibles fuligineuses.
Revenons au texte de Muray, qui poursuit, dans le même ouvrage : «Un critique, plutôt que de perdre son temps à analyser tous les romans de néo-sacristains, tous ces livres rédigés avec un style directement trempé dans le préservatif, pourrait s’amuser à les rapprocher de slogans publicitaires connus, montrer qu’ils se ramènent tous à l’une ou l’autre des injonctions récentes de la pub» (p. 13).
Un bon critique, colligeant donc les différents titres qui ont récemment fleuri à propos de la découverte, par de hardis paléontologues, d'un nouveau type humanoïde baptisé Homo festivus festivus (en somme, le sursinge qui prend conscience du fait qu'il fait la fête) en hommage à celui qui en avait théorisé le chaînon clinquant, Philippe Muray, pourrait donc montrer qu'ils ne sont que la forme la plus récente, et déjà parfaitement obsolète, de l'éternelle hydre publicitaire, dont voici quelques têtes sans beaucoup de cerveau : Exorcismes spiritueux pour Philippe Lançon (Libération Livres du 24 juin) qui commence nullement par un «Être de son époque, c'est savoir la détester», Désaccord parfait pour Laurent Lemire (Livres Hebdo du 16 septembre) qui, encore plus stupidement, n'a pas peur de faire hurler de rire ses lecteurs en calant dès son point de badinage : «Il y avait quelque chose de vrai chez Philippe Muray (1945-2006), c'est ce qu'il pensait», Le mieux-disant pour l'inégalable Aude Lancelin (Le Nouvel Observateur, semaine du 22 au 28 juillet), qui bavarde sur Fabrice Luchini, cet interprète de la Modernité qui, non content d'avoir mis Paris à ses pieds, a bel et bien réussi l'exploit de faire courber la nuque si raide de quelques journalistes après leur avoir déclaré qu'il n'était pas plus de droite que de gauche. Quoi d'autre encore, puisqu'il est vrai que même le canard le plus déplumé de France et de Navarre y est allé de sa petite bluette admirative pour Muray, histoire de ne pas rater la curée journalistique et peut-être même, qui sait, d'être repéré par les grosses légumes parisiennes ? Le petit-fils naturel de Georges Bernanos, Sébastien Lapaque, le sobre François Taillandier pour Le Figaro ou sa déclinaison en revue, le si mélomane Benoît Duteurtre (Marianne du 25 septembre) qui fait mine de s'extasier sur les rythmes délicieusement reggae du très oubliable Ce que j'aime ou l'intrusion de Léon Bloy dans la comptine pré-natale, tandis que Pierre Bottura (Philosophie Magazine du mois d'octobre) nous révèle, bien conscient qu'il prend des risques peut-être exagérés, que Philippe Muray était «romancier, essayiste et critique d'art», travail d'enquête tout de même moins poussé que celui de Tristan Savin (pour Lire du mois d'octobre), lequel rend grâce à l'histrion Luchini d'être un histrion. Subtile fausse note, celle émise par Alain Finkielkraut, l'autre père spirituel et intellectuel de notre chère Élisabeth, encore elle, note grinçante bien évidemment recueillie par l'antenne d'Arecibo d'une extrême finesse qu'est notre impénitente journaliste (Causeur numéro du mois de septembre) qui remet le couvert pour Le Point (du 16 septembre) où elle nous apprend que, chez Muray, «jubilation et exécration sont sœurs».
Si je n'avais pas connu les livres de Muray depuis quelques années, ces poussées hormonales imprimées sur papier recyclable m'auraient-elles donné envie de me jeter sur eux ?
Je ne crois pas.
Je suis même certain que non.
Il n'y a pas seulement, hélas, dans la canonisation actuelle dont Philippe Muray est la victime muette, que dévaluation du verbe, ce qui ne doit point nous étonner puisqu'il s'agit là de la plus constante et habituelle production des bouches mécaniques que sont les journalistes. En effet, si, selon notre redoutable polémiste, l'histoire de la littérature est celle des «prospérités de l'irrespect» (p. 250), nous ne pouvons que constater que Philippe Muray n'est point salué comme un véritable écrivain mais, tout au plus, comme un penseur réactionnaire, c'est-à-dire peu ou prou comme un fâcheux en perpétuelle colère contre le monde entier et nageant à contre-courant du fleuve tranquille où la France finit de noyer son ennui vertueux de n'être plus rien.
Puisque le fantôme de Muray est ces derniers temps très sollicité, j'oserai abuser quelque peu de son temps et poursuivre la lecture d'un de ses recueils de textes. Qu'est-ce qu'un bon critique selon Philippe Muray qui doit décidément se tordre de rire en nous observant du coin de l'œil ? C'est en tout premier lieu un esprit qui s'écarte de la foule et ne salue, dans un livre, que son essence la plus profondément romanesque, rien, donc, qui puisse ressembler au charlatanisme actuel consistant à mélanger pseudo-verve et acrimonies habituelles contre l'air du temps. Qu'est-ce dire ? Que Muray place la tâche du critique à une magnifique hauteur, la leste d'une lourde responsabilité. La critique est, ni plus ni moins, une œuvre qui répond à une œuvre. Non point un Du Bos, ni même un Thibaudet ou un Sainte-Beuve mais, tout simplement, tout impossiblement, un Conrad, un Joyce, un Faulkner, un romancier extravagant, un romancier sans roman, un maître du langage second cher à Foucault qui n'aurait pour seule mission que celle de pénétrer les romans qu'il n'a pas écrits, qu'il ne peut pas écrire, avec la souveraine vision de leur propre créateur.
C'est quelqu’un donc, ce critique idéal sinon rigoureusement surhumain, qui ne se considérerait pas comme «un agent culturel destiné à signaler au public des produits culturels (les livres), quelqu’un qui serait donc également un bon critique de la société [apte à devenir] un spécialiste de toute la consternante fantasmagorie qui tend socialement à rendre le roman impossible» (pp. 4-5).
Et Muray de poursuivre en écrivant que : «La connaissance de l’ennemi, la science de l’ennemi des romans, c’est-à-dire de presque tout ce qui se met en place, aujourd’hui, sous nos yeux (y compris dans certains romans, dans ceux que je viens d’évoquer par exemple, les livres de la nouvelle Bibliothèque rose universelle, les romans de l’École des sacristains), voilà ce qui pourrait être le propre de la critique, d’une critique faite dans l’intérêt de l’art romanesque, et non dans le dessein de s’auto-célébrer, de justifier sa propre existence ou carrément de nuire, comme les deux charlatanismes critiques, l’universitaire et le médiatique […]» (p. 14).
Curieux que nul, à ma connaissance du moins, n'ait songé à commenter cette célébration si spontanée et post-mortem du génie de Philippe Muray en l'éclairant par la seule lumière qui en révélerait la part d'ombre. Nous sommes ainsi parvenus au cœur de notre sujet, comme le fantôme de Muray d'ailleurs ne manque pas de nous le confirmer d'un sourire à peine esquissé.
C'est d'ailleurs, une fois de plus, l'auteur lui-même qui nous donne la clé de ce rituel propitiatoire autour d'une tombe encore fraîche, clé qui nous fait retrouver la magnifique ligne de basse qui cimente l'architecture du XIXe siècle à travers les âges. Cette clé est fort commune, qui ouvre pourtant toutes les portes, y compris celles qui sont réputées
13/10/2010 | Lien permanent
Tous mes livres

 Essai sur l’œuvre de George Steiner. La Parole souffle sur notre poussière (L'Harmattan, 2001).
Essai sur l’œuvre de George Steiner. La Parole souffle sur notre poussière (L'Harmattan, 2001). La Critique meurt jeune (Le Rocher, 2006) : études sur Maurice G. Dantec, Marc-Édouard Nabe, Éric Bénier-Bürckel, Jean Védrines, Pierre Boutang, Fiodor Dostoïevski, Joseph Conrad, Jorge Semprún, William Faulkner, Gershom Scholem, Jean-Luc Evard, Éric Marty, Georges Bernanos, Léon Bloy.
La Critique meurt jeune (Le Rocher, 2006) : études sur Maurice G. Dantec, Marc-Édouard Nabe, Éric Bénier-Bürckel, Jean Védrines, Pierre Boutang, Fiodor Dostoïevski, Joseph Conrad, Jorge Semprún, William Faulkner, Gershom Scholem, Jean-Luc Evard, Éric Marty, Georges Bernanos, Léon Bloy. La Littérature à contre-nuit (Sulliver, 2007) : études sur Joseph Conrad, Georges Bernanos, Georg Trakl, Paul Gadenne, Joseph de Maistre, Cormac McCarthy, Arthur Rimbaud, Ernest Hello, Ernesto Sábato.
La Littérature à contre-nuit (Sulliver, 2007) : études sur Joseph Conrad, Georges Bernanos, Georg Trakl, Paul Gadenne, Joseph de Maistre, Cormac McCarthy, Arthur Rimbaud, Ernest Hello, Ernesto Sábato. Maudit soit Andreas Werckmeister ! (Éditions de la Nuit, 2008).
Maudit soit Andreas Werckmeister ! (Éditions de la Nuit, 2008). La Chanson d'amour de Judas Iscariote (Le Cerf, 2010).
La Chanson d'amour de Judas Iscariote (Le Cerf, 2010).Ouvrages collectifs.
 Les Dossiers H Pierre Boutang (L'Âge d'Homme, 2002).
Les Dossiers H Pierre Boutang (L'Âge d'Homme, 2002).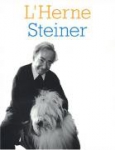 Cahier de l'Herne George Steiner (L'Herne, 2003).
Cahier de l'Herne George Steiner (L'Herne, 2003). Gueules d'amour (Fayard, 2003).
Gueules d'amour (Fayard, 2003). Études bernanosiennes n°23 consacré à Monsieur Ouine.
Études bernanosiennes n°23 consacré à Monsieur Ouine.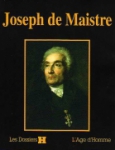 Dossier H Joseph de Maistre (L'Âge d'Homme, 2005).
Dossier H Joseph de Maistre (L'Âge d'Homme, 2005). Théorie-Rébellion. Un ultimatum (L'Harmattan, 2005). Critique de Francis Moury.
Théorie-Rébellion. Un ultimatum (L'Harmattan, 2005). Critique de Francis Moury. Vivre et penser comme des chrétiens (A contrario, 2005).
Vivre et penser comme des chrétiens (A contrario, 2005). Enquête sur le roman (Le Grand Souffle, 2007).
Enquête sur le roman (Le Grand Souffle, 2007).Préfaces.
 L'Imposture de Georges Bernanos (Le Castor Astral, 2011).
L'Imposture de Georges Bernanos (Le Castor Astral, 2011). La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos (L'Arbre vengeur, 2017).
La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos (L'Arbre vengeur, 2017).
22/07/2011 | Lien permanent
La dernière histoire de Mouchette ?

 Georges Bernanos dans la Zone
Georges Bernanos dans la Zone J'ai écrit cet article dans l'urgence, saisissant l'opportunité d'une double actualité : la publication en deux volumes de gloses aussi pesantes qu'inutiles qui composent la nouvelle édition des romans de Georges Bernanos dans la Pléiade, et l'apparition, sur la Toile, de l'un des descendants de Georges Bernanos, Antonin Bernanos. Plus long que la version ici donnée, je commençais par donner ce texte à Pierre Chardot pour Zone critique, tout en l'envoyant, par simple correction, à l'un des petits-fils du grand écrivain. Le moins que l'on puisse dire est que je fus profondément déçu par sa réaction, alors même qu'il me semblait faire un travail utile en tentant non point d'excuser mais de comprendre un comportement qui, sur la Toile, avait donné lieu à des tombereaux d'insultes, encore bien visibles. Je pris le parti de ne pas publier mon texte dans l'immédiat, puisqu'il avait si inexplicablement déçu ceux pour la défense desquels je l'avais écrit, et, continuant de l'étoffer et de l'amender, je me résolus alors à l'envoyer à plusieurs revues, dont Le Débat. Marcel Gauchet prit la peine de me répondre, me remerciant et, assez banalement, m'affirmant que mon article était trop loin des centres d'intérêt de la revue pour qu'il puisse le retenir. Je n'ai toujours pas compris, à vrai dire, quels pouvaient donc être les centres d'intérêt de cette revue dont mon article était si éloigné. Je reçus dans la foulée une autre réponse, de la part de la revue Commentaire, Jean-Claude Casanova, qui louait mon «intelligente vigueur qui rafraîchit», me disant qu'il pourrait le publier à condition qu'il soit réduit à 16 000 signes. Je me remis au travail et, après avoir une première fois grossi mon texte, je le réduisis avec la même ardeur. Je l'envoyai de nouveau. Nous étions à la mi-décembre de l'année passée et, depuis, rien : je suppose que mon texte était cette fois-ci trop concis ou bien que, entretemps, il ne répondait plus au cahier des charges, à moins tout simplement que le nom de Bernanos n'intéresse plus personne, hormis ceux qui le portent et quelques universitaires qui en vivent.
J'ai écrit cet article dans l'urgence, saisissant l'opportunité d'une double actualité : la publication en deux volumes de gloses aussi pesantes qu'inutiles qui composent la nouvelle édition des romans de Georges Bernanos dans la Pléiade, et l'apparition, sur la Toile, de l'un des descendants de Georges Bernanos, Antonin Bernanos. Plus long que la version ici donnée, je commençais par donner ce texte à Pierre Chardot pour Zone critique, tout en l'envoyant, par simple correction, à l'un des petits-fils du grand écrivain. Le moins que l'on puisse dire est que je fus profondément déçu par sa réaction, alors même qu'il me semblait faire un travail utile en tentant non point d'excuser mais de comprendre un comportement qui, sur la Toile, avait donné lieu à des tombereaux d'insultes, encore bien visibles. Je pris le parti de ne pas publier mon texte dans l'immédiat, puisqu'il avait si inexplicablement déçu ceux pour la défense desquels je l'avais écrit, et, continuant de l'étoffer et de l'amender, je me résolus alors à l'envoyer à plusieurs revues, dont Le Débat. Marcel Gauchet prit la peine de me répondre, me remerciant et, assez banalement, m'affirmant que mon article était trop loin des centres d'intérêt de la revue pour qu'il puisse le retenir. Je n'ai toujours pas compris, à vrai dire, quels pouvaient donc être les centres d'intérêt de cette revue dont mon article était si éloigné. Je reçus dans la foulée une autre réponse, de la part de la revue Commentaire, Jean-Claude Casanova, qui louait mon «intelligente vigueur qui rafraîchit», me disant qu'il pourrait le publier à condition qu'il soit réduit à 16 000 signes. Je me remis au travail et, après avoir une première fois grossi mon texte, je le réduisis avec la même ardeur. Je l'envoyai de nouveau. Nous étions à la mi-décembre de l'année passée et, depuis, rien : je suppose que mon texte était cette fois-ci trop concis ou bien que, entretemps, il ne répondait plus au cahier des charges, à moins tout simplement que le nom de Bernanos n'intéresse plus personne, hormis ceux qui le portent et quelques universitaires qui en vivent. Excédé par ces façons de faire, je décidai de tenter ma chance auprès de La Revue des Deux Mondes qui, depuis que le gras Michel Crépu, cet intraitable liftier au doigt pourtant vissé sur le bouton de l'ascenseur de tous les renvois, l'a quittée, présente l'avantage de péter un peu moins haut que son cul diplomatique. Poliment, classiquement, puisque la littérature et la critique littéraire sont réduites à la portion congrue, il me fut répondu par la coordinatrice de cette revue, Aurélie Julia, qu'il fallait réduire mon texte (à 12 000 signes espaces comprises), ce que, bien sûr, je fis une nouvelle fois, méditant sur le fait qu'écrire un texte pour une revue ne reviendra bientôt plus qu'à envoyer une note d'intention. Hélas, cette même personne finit par m'avertir que tous les numéros étaient bouclés jusqu'au printemps, raison pour laquelle (et sans doute aussi parce que, à la différence d'un texte imprimé, une publication sur la Toile ne paie pas un centime) elle me proposa de publier mon texte sur le site de la revue. Il parut donc le 9 janvier 2017, ici. La morale de cette histoire ? J'aurais dû, dès le début, donner ce texte dans sa version initiale à Pierre Chardot car, décidément, c'est sur la Toile que les choses se jouent désormais, et cela depuis plusieurs années, le texte imprimé dans une revue, si tant est qu'il soit lu, ce dont je doute de plus en plus, n'intéressant plus grand monde. La version que je donne ci-dessous diffère assez légèrement du texte paru.
Dans un beau livre, Maurizio Serra évoque Georges Bernanos comme un «chrétien qui croyait en Dieu parce qu’il croyait au péché originel et à la présence du diable sur la terre». C’est en peu de mots se conformer à la simplicité de la définition que donnait Georges Bernanos du Roi («Un jeune homme à cheval qui n’a pas peur !»). C’est aussi rappeler que nous devons veiller à ne pas lire de travers cet écrivain immense, au risque de ne point comprendre quel a été l’ennemi qu’il a figuré dans l’un de ses plus beaux livres, Les Grands cimetières sous la lune. Maurizio Serra affirme ainsi que »l’émouvant pamphlet de Bernanos» est considéré depuis sa parution en 1938 «comme une dénonciation du franquisme». Cette interprétation lui semble «très partielle et typique des simplifications auxquelles a mené le conflit», car, à lire attentivement Les Grands cimetières sous la lune, «on voit qu’il s’agit plutôt du j’accuse d’un croyant légitimiste contre l’Église, les grands propriétaires espagnols et les généraux insurgés qui ont sali la cause du Christ-Roi». Et Maurizio Serra d’ajouter que pour Bernanos, la guerre d’Espagne «ne représenta absolument pas une conversion à des positions progressistes mais la perversion des idéaux d’une certaine droite, tombée aux mains de l’Antéchrist» (1).
Ce constat désigne un double sujet ou plutôt, un seul sujet qui comme certaines sculptures romanes présente deux visages grimaçants : tout d’abord, Georges Bernanos n’est plus vraiment lu ni compris et, quand il est évoqué, par exemple dans tel roman insignifiant comme Pas pleurer de Lydie Salvayre, c’est pour nourrir une série de contresens que nous qualifierons de «progressistes». Certains prétendent faire de Georges Bernanos ce qu’à l’évidence il n’était absolument pas : un apôtre non seulement convaincu mais éclairé des forces démocratiques du Progrès.
Il serait naïf de croire qu’un roman ayant reçu le prix Goncourt, fût-il sot, qui évoque Georges Bernanos, ne témoignerait pas d’une incompréhension profonde de sa pensée. Les raisons qui nous éloignent de l’œuvre de l’écrivain sont nombreuses, au moins autant que celles qui nous le font lire au rebours de ses intentions : une déchristianisation en voie d’achèvement, du moins en France et, partant, l’obsolescence comique du dogme du péché originel mais aussi, plus largement, de toute notion jugée rétrograde de Mal radical. Cette dernière ne peut, chez Bernanos, que convoquer l’apparition de celui qu’il a figuré sous l’apparence d’un maquignon jovial dans son premier roman car, pour Bernanos comme pour le Léon Bloy du Révélateur du Globe, l’époque moderne réduit Satan aux figurations littéraires les plus grotesques et puériles, quand elle ne nie pas, tout simplement, son existence.
Ajoutons à ces raisons l’enseignement catastrophique de la littérature française, la honte perpétuelle de notre passé, la massification généralisée de l’inculture, le triomphe de l’Argent, ennemi commun de Bloy, de Péguy et de Bernanos, ainsi que la victoire de la Machine, ou même, sans que cette liste ne soit hélas exhaustive, la propagation à vitesse accélérée de l’eunuquat qui nous rend totalement incompréhensible la vieille et noble tradition française de la parole pamphlétaire, etc. Je relèverai deux indices, l’un et l’autre empruntés au monde des lettres, de cet éloignement de l’intelligence-épée bernanosienne.
Parue aux éditions Perrin en 2013, la biographie que Philippe Dufay consacre à Georges Bernanos est indigente. Truffée d’erreurs factuelles, elle regorge des invincibles platitudes propres aux journalistes qui écrivent des livres. Georges Bernanos est ainsi désigné comme «un écrivain, un chrétien, un royaliste et un antisémite» dès le Prologue du livre, alors que dans la page qui suit (cf. p. 12), l’auteur condense en un paragraphe qui mériterait d’être cité intégralement tous les clichés pas même dignes de figurer dans un mauvais épisode de Rouletabille contaminé par La Varende : «Georges Bernanos était un preux. Une réincarnation des Bayard et Du Guesclin, des vieilles gestes qui nourrirent son enfance», «Une sorte d’hibernatus congelé à l’époque des croisades et «dégelé» sous la IIIe République des affaires Dreyfus, Panama et Stavisky». Que nous apportent de telles facilités, indignes de la complexité de l’homme et, bien plus encore, de ses œuvres ? Rien.
Le second exemple, prestigieux s’il en est, concerne la parution en deux volumes des œuvres romanesques (ainsi que des Dialogues des Carmélites) de Bernanos dans la célèbre collection de la Pléiade. La composition de l’équipe d’universitaires ayant établi ces volumes a été décidée du vivant du fils cadet de Georges Bernanos, Jean-Loup Bernanos. Autant dire que ce travail a eu le temps de mûrir. Je ne puis entrer dans le détail de l’apparat critique pour le moins fourni de chacun des romans de Bernanos, puisque le très honnête volume jusqu’alors disponible, dans cette même collection de la Pléiade, composé sous la houlette de Michel Estève, Albert Béguin et Gaëtan Picon, s’est magiquement dédoublé, d’un coup de baguette magique universitaire. Je ne rejette pas en bloc ce travail, la biographie très minutieuse établie par Gilles Bernanos étant ainsi plus qu’utile. Prenons cependant un seul exemple, qui concerne la toute première ligne, célèbre, du premier roman de l’écrivain, Sous le soleil de Satan : «Voici l’heure du soir qu’aima P.-J. Toulet». Nous apprenons, à la page 1777 de l’édition en Pléiade parue en 1974, que Paul-Jean Toulet est un «poète et romancier en vogue au début du XXe siècle, auteur de La Jeune Fille verte, que l’on peut rapprocher, sur certains points mineurs» du roman de Bernanos. Voici le texte qui se trouve à la page 1190 du premier volume de la nouvelle édition : «Plutôt qu’aux célèbres Contrerimes (1921), Bernanos pourrait se référer ici au dernier roman de Paul-Jean Toulet (1867-1920), La Jeune Fille verte [où il aura trouvé] une satire particulièrement vive du monde bourgeois et ecclésiastique d’une petite ville, et des ambiances, comme l’évocation finale, par l’orateur, des «heures divines du crépuscule».»
Quoi d’autre ? Rien. En plusieurs dizaines d’années de recherche intense, nos érudits n’ont apporté que deux ou trois précisions absolument essentielles sur un roman dont aurait pu s’inspirer Georges Bernanos ! J’ai montré, dans une longue étude, que Sous le soleil de Satan pouvait non seulement être rapproché de La Jeune Fille verte mais, plus souterrainement, du Grand Dieu Pan écrit par le maître de Lovecraft, Arthur Machen, un titre que Paul-Jean Toulet, ô surprise, a traduit en français, et qui évoque les amours monstrueuses d’une jeune femme et d’une entité maléfique. Cela ne rappelle-t-il décidément rien à nos universitaires, pas même l’histoire de Mouchette qui finira par se donner au démon, tout de même plus séduisant que le marquis de Cadignan et le docteur Gallet ? Je renvoie le lecteur intéressé par cette question à ma note, mais le constat est clair : non seulement Georges Bernanos est aujourd’hui à la merci de n’importe quel écrivant qui se permettra de lui faire dire à peu près n’importe quoi, mais, à l’autre bout de cette chaîne herméneutique pour le moins distendue, ce sont désormais des universitaires chevronnés qui ne nous apprennent rien de nouveau sur une œuvre fulgurante qu’ils auront réussi à muséifier en hérissant autour d’elle une enceinte de phrases inutiles.
Nous ne savons plus lire Georges Bernanos, par excès de bêtise publicitaire ou, à l’inverse, à cause d’une fausse érudition qui tourne à vide. C’est peut-être, aussi, que nous avons touché le moment où il ne nous est plus seulement permis de lire, et, confortablement installés, de commenter sans fin Georges Bernanos, mais où il nous faut agir, en restant fidèles à l’enseignement de cet écrivain qui n’aura jamais voulu enseigner, mais s’est lui-même exposé à la corne de taureau chère à Michel Leiris.
Si «lire bien, c’est lire avec une intensité telle qu’on pourrait retrouver le moyen d’agir» comme l’affirmait Pierre Boutang, il est une façon d’agir silencieuse, noble, qui ne s’expose pas à la réclame journalistique. C’est cette façon d’être authentiquement bernanosienne qui fait peut-être que ce monde continue de tourner sur son axe. L’autre attitude est caractéristique des bernanosiens de tréteaux, je veux parler du verbiage de pion aigri ayant moins de saveur qu’une hostie dispensé par les nouveaux réactionnaires. Il faut savoir se lever contre l’injustice, non pas la bouche pleine de beaux mots, comme ces êtres dont l’âme est un larynx, mais ici et maintenant, à la mesure, humble mais essentielle, de toute vie d’homme. Qu’importe le faux-pas, si la ferveur reste encore l’unique mesure de la chère jeunesse tant convoitée par les vieillards !
Voici quelques mois, nous avons surpris le visage de l’un des descendants de Georges Bernanos, Antonin Bernanos, sur plusieurs sites d’extrême droite. Les commentaires, dans le meilleur des cas simplement ironiques, moquaient l’indigne héritier «antifa des beaux quartiers». Au vu du déferlement d’indignation et de colère toutes deux compréhensibles, mais aussi de haine que le comportement présumé du jeune Bernanos a provoqué, je risque d’être bien mal compris, en prétendant éviter de le condamner au lynchage et au déshonneur national. Certes, il est possible d’agir de façon non violente en se réclamant des textes de Georges Bernanos même si, bien davantage qu’aux Veilleurs nourris du petit catéchisme commercial de Fabrice Hadjadj, ma sympathie va à ceux que Ramon Fernandez a appelés les violents, et que Bernanos a appelés, lui, les enfants humiliés, qui ne semblent jamais que poursuivre un seul but obsessionnel : l’instauration, y compris par l’action directe, d’une société plus juste et, chez les plus fanatiques, d’un lendemain qui chante pour des éons de bonheur. Maints exemples de jacqueries et de mouvements d’inspiration millénariste nous montrent que ce bonheur est bâti sur des charniers à peine recouverts de chaux vive.
Je me demande s’il n’y a pas dans la colère d’Antonin Bernanos la plus claire manifestation de la colère de Georges Bernanos, mais en somme moquée, parodiée, contre une époque qu’il est impossible d’abattre, si ce n’est en s’en prenant à ses représentants, quitte à provoquer plus ou moins intentionnellement un drame qui, pour le coup, sera tout chaud et bien réel du sang versé. Osons écrire qu’Antonin Bernanos, n’en fût-il même pas conscient, s’est levé de son fauteuil familial et a dressé son poing contre un ordre qu’il estime radicalement mauvais et totalement désincarné, comme une idole de fer qu’il serait impossible de jeter à terre, sinon par la violence, bien moins méthodique et froide que secrètement désespérée.
Ce retour à l’action, fût-il grotesque, ridiculisant et même inversant le sens du combat pour le coup véritablement antifasciste que ne cessa de mener Georges Bernanos, signifie au moins qu’Antonin Bernanos, par l’une de ces magnifiques ironies dont l’Histoire est le terrain d’élection, a réanimé la colère phénoménale de son arrière-grand-père. Nous préférerons toujours cette colère, même rejouée parodiquement, à des livres sans colonne vertébrale et à de pulvérulentes gloses de professeurs.
Note
(1) Maurizio Serra, Une génération perdue. Les poètes guerriers dans l’Europe des années 1930 (traduit de l’italien par Carole Cavallera, Seuil, 2016), p. 47. La seconde citation se trouve à la page 174, suite de la note 3 publiée dans la page qui précède.
24/02/2017 | Lien permanent
Quelques lectures du stalker - Gustave Thibon

12/06/2004 | Lien permanent
Sur une île, stalker, quels livres emporteriez-vous ?, 3

12/08/2004 | Lien permanent
























































