Rechercher : bernanos%2C lapaque
Quelques lectures du stalker - Gustave Thibon

12/06/2004 | Lien permanent
Sur une île, stalker, quels livres emporteriez-vous ?, 3

12/08/2004 | Lien permanent
L'âme de François Hollande

«We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas !
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over broken glass
In our dry cellar
Shape without form, shade without color,
Paralysed force, gesture without motion;
Those who have crossed
With direct eyes, to death's other kingdom
Remember us – if at all – not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men
The stuffed men.»
T. S. Eliot, Les Hommes creux (1).
«Mir fällt zu Hollande nichts ein». C'est la phrase par laquelle le grand Karl Kraus aurait pu ouvrir sa terrifiante Troisième nuit de Walpurgis si, à la place d'Adolf Hitler à qui ces mots sujets à bien des mauvais procès faits à l'auteur étaient adressés, le satiriste autrichien avait eu sous ses yeux un peuple d'ombres dolentes, fonctionnaires et demi-soldes de l'État plutôt que des meurtriers et si, à la place de la prise de pouvoir méthodique et acharnée d'Adolf Hitler, il avait assisté à l'ascension laborieuse, méthodique et acharnée elle aussi, patiente, vaine, bonhomme, en un mot : grise plutôt que brune, de François Hollande aux fonctions de Président de la République française.
Les prudents et les imbéciles jugeront douteux, voire scandaleux mon rapprochement entre deux beaux-parleurs, l'un doué d'une aura et d'un verbe démoniaques, l'autre dépourvu de la moindre qualité susceptible de faire, d'un homme, un chef, d'un homme politique, un dirigeant à tout le moins compétent sinon respecté et d'un beau-parleur, autre chose qu'un lamentable amateur de petites blagues servies entre deux cocktails.
Il est pourtant clair qu'aux yeux de Karl Kraus, les meurtriers nazis, y compris leur Führer charismatique, n'étaient pas grand-chose de plus que des ombres bavardes, des médiocres qui, alliant cependant le geste à la parole, précédant leurs innombrables meurtres de paroles elles-mêmes criminelles, n'hésiteraient pas à tuer, et à couvrir leurs crimes (pour Kraus : en les exposant) de paroles et de mots tellement banals que des personnalités aussi remarquables qu'Hannah Arendt pourraient, à juste droit, estimer que leurs millions de victimes avaient été assassinées deux fois : une première fois par la violence, aussi banale qu'innommable, une seconde fois par l'extrême banalité du Mal, justement, se disant au travers de termes strictement techniques, solution finale par exemple étant la plus connue de ces expressions, Victor Klemperer en ayant analysé bien d'autres dans son remarquable LTI, la langue du 3e Reich. Je me demande d'ailleurs ce que Klemperer eût pu écrire d'une expression telle que redressement productif qui, après tout, n'aurait pas été incongrue comme slogan des camps, staliniens sinon nazis. Ce que nous pourrions appeler la puissance utopisante du langage est presque toujours meurtrière lorsqu'elle est utilisée par des politiciens plutôt que par des écrivains.
Il faut donc croire qu'existent, moins que des qualités de médiocrité différentes comme il y a des qualités différentes de bonté, des facteurs historiques et sociaux, des spécificités tenant au génie individuel aussi, d'épanouissement et de croissance de cette médiocrité, et que la médiocrité d'un homme qui ne ferait certainement pas de mal à une mouche, François Hollande bien évidemment, n'est pas, dans sa nature ontologique, fondamentalement différente de celle du Führer, qui a tué des millions d'hommes comme s'ils n'étaient rien de plus que des larves de mouches. La bonté est une, tout comme la médiocrité, au sens que Kraus donnait à ce mot, laquelle n'impliquait donc pas forcément qu'un homme médiocre baisse les yeux devant sa femme en colère ou qu'il souhaite se rendre au sommet des plus grandes puissances du monde sur un vélo, afin de paraître le faux humble qu'il n'est bien évidemment pas.
Un homme médiocre peut être un assassin, un père de famille tranquille ou même un socialiste arborant une cravate éternellement de guingois, mais sans doute ferais-je mieux comprendre l'apparent paradoxe que constitue mon propos en citant Ernest Hello, qui consacra des pages remarquables à la médiocrité faite homme, à la médiocrité parvenant, l'espace d'une vie et dans une enveloppe labile de chair fade, à s'incarner de façon parodique : «L'homme médiocre est juste-milieu sans le savoir. Il l'est par nature, et non par opinion; par caractère, et non par accident. Qu'il soit violent, emporté, extrême; qu'il s'éloigne autant que possible des opinions du juste-milieu, il sera médiocre. Il y aura de la médiocrité dans sa violence» (2). Autant dire que tous les génies, selon Hello, qu'il s'agisse du plus courageux des aventuriers, du plus admirable des artistes ou du scientifique le plus original, peuvent tous, au dernier recès de leur conscience, être qualifiés de médiocres.
Si la médiocrité est une, tentons de préciser les contours, forcément flous, du visage qui l'incarne et l'arbore comme une distinction éminente, la face blême de Homais capitaine du rafiot Feue la France, aux yeux de millions de Français et, apparemment, d'un nombre pas moins conséquent d'Anglais, d'Allemands, d'Américains ou même d'Espagnols et d'Italiens, tentons donc de qualifier de quelle pâte molle est composée l'homme creux qu'est François Hollande, un Président empaillé, une silhouette sans forme, une ombre décolorée dont les gestes sont sans mouvement, dont la force [est] paralysée selon la traduction donnée par Pierre Leyris du grand poème de T. S. Eliot, un homme dont la caboche [est] pleine de bourre et dont la voix, desséchée, est aussi sourde et inane que le trottis des rats sur les tessons brisés [d'une] cave sèche.
François Hollande est, paraît-il, Président de la République française. Il est même, ce sont les commentateurs politiques les plus avisés, les journalistes d'expérience et ceux qui l'ont personnellement connu qui n'ont pas peur de l'affirmer, il est même un homme. Un homme creux, certes, mais un homme tout de même, avec des passions creuses, médiocres, des colères creuses, médiocres, des enthousiasmes creux, médiocres, des petitesses et des grandeurs creuses, médiocres, un homme qui aura été Président d'une nation autrefois grande, respectée et crainte et qui ne survit plus, médiocrement, parmi les autres nations qui la regardent en souriant, qu'à crédit, un homme médiocre de pouvoir médiocre qui aura sans doute besoin de son écrivain médiocre, pourquoi pas Frédéric Beigbeder écrivant dans Un roman français (Grasset, 2009, pp. 20-21) cette phrase qui convient admirablement à la destinée médiocre de François Hollande et à sa geste translucide et flasque : «Ce livre serait alors une enquête sur le terne, le creux, un voyage spéléologique au fond de la normalité bourgeoise, un reportage sur la banalité française». Un reportage sur la banalité française ne pourrait convenablement ignorer celui qui en est le chantre, proposition inverse de celle affirmant une exception française mais tout aussi fausse, la seule marque dont s'honore la France ne pouvant être ni la banalité ni l'exception mais le génie, qui n'a aucun compte à rendre. Potachons quelque peu en écrivant que François Hollande pourrait peut-être être défini comme étant le génie de la banalité, celui qui, devant les amateurs de la médiocrité que nous sommes, en impose.
L'évidence, strictement scientifique, définit l'homme comme un corps vivant interagissant avec son milieu et ses semblables, occupant un certain volume et, surtout, doué de parole, ce qui suffit à le distinguer d'un colibri ou même d'un concombre de mer. Une partie évidente, la plus grande sans doute, des pouvoirs de la parole échappe aux expériences de laboratoire, tout comme l'âme, et peut donc être qualifiée d'irréductible.
Il ne serait pas charitable d'affirmer que François Hollande, s'il est un être doué de parole, d'une parole molle, d'une parole creuse, de la parole vide de l'homme creux, d'une parole dont la seule force de persuasion, donc la pesanteur selon Carlo Michelstaedter, réside dans sa capacité à faire des blagues de potache, ne possède néanmoins pas d'âme car François Hollande est doué de parole, d'une parole destituée puisqu'elle n'est que l'écho perpétuel de l'ondée monotone du sous-langage si brillamment évoquée par Armand Robin.
Le mystère est que François Hollande possède, comme nous tous, une âme. Le mystère absolu, avant même l'existence de Dieu, avant même la possibilité d'admettre que le pire des criminels possède une âme, réside dans ce pari qui eût effrayé Pascal, Hello et Bloy : il faut admettre que François Hollande possède une âme, une âme creuse, vide, comblée seulement par une parole creuse, vide, dont elle est à la fois l'origine et la fin, la matrice et le corollaire, la cause et la conséquence. L'âme étant par essence infinie, nous devons donc supposer l'existence d'une médiocrité infinie, étale, qui par son inaction même peut venir à bout du bien et du mal, ces dépenses inutiles aux yeux du médiocre. Le prodige incompréhensible est que le royaume de la médiocrité ne peut être confondu avec celui de l'absurdité : «Si l’homme, écrit ainsi Sören Kierkegaard dans Crainte et Tremblement, n’avait point de conscience éternelle, si au fond de toutes choses il n’y avait qu’une puissance sauvage et bouillonnante qui tout produit, le grand et le futile, dans le tourbillon de passions obscures; si sous toutes choses se cachait un vide sans fond que rien ne peut combler, que serait alors la vie sinon désespérance ? François Hollande et son gouvernement sont les marionnettes de ce vide sans fond dont le nihilisme est peut-être un des noms.
«Il y a des hommes, innocents ou criminels écrit ainsi Léon Bloy, en qui Dieu semble avoir tout mis, parce qu’ils prolongent son Bras et Napoléon est un de ces hommes» (3).
François Hollande, lui, n'est pas innocent. Il n'est pas criminel. François Hollande n'est ni l'un ni l'autre, n'a jamais été et ne sera jamais ni l'un ni l'autre, innocent ou criminel, et si, toujours selon Bloy, «Napoléon, c'est la Face de Dieu dans les ténèbres» (4), alors François Hollande est l'inimaginable face du Vide dans le rien. «Nul ne sait, ajoute le Mendiant ingrat en parlant d'un homme creux quoique prodigieusement dépensier d'actions et dévorateur d'hommes, Napoléon, nul ne sait ce qu'il est venu faire en ce monde, à quoi correspondent ses actes, ses sentiments, ses pensées; qui sont ses plus proches parmi tous les hommes, ni quel est son nom véritable, son impérissable Nom dans le registre de la Lumière. Empereur ou débardeur nul ne sait son fardeau ni sa couronne» (5).
Que savons-nous du nom réel de François Hollande, le nom, rigoureusement imprononçable, par lequel le néant commande pardon, laisse faire, se répandre, infuser, l'un de ses commis les plus efficaces ? Pouvons-nous imaginer, aussi, que des mots tels que couronne ou fardeau ne désignent pas des réalités absolument incompatibles avec les frêles épaules de notre Président qui pourtant, comme Napoléon, doit être considéré comme étant le bras de Dieu, celui (Celui) par lequel Il veut nous signifier la cohérence et la beauté de sa création, celui (Celui) par lequel Il accomplit sa volonté insondable ?
Évoquer l'âme de François Hollande est un exercice moins périlleux, d'un point de vue philosophique, que d'évoquer les qualités, ou plutôt l'absence de toute qualité qui distingue ce Président blagueur et le fond dans la masse, l'indistingue si je puis dire dans une foule grise d'hommes en costume sombre, et le réduit à n'être rien de plus qu'un homme creux, un homme qui pourtant possède, comme nous tous, un nom inconnu des hommes et qui sert, comme nous tous, son créateur, à moins, bien sûr, qu'Hollande, comme Napoléon, ne serve personne, comme le suggère, encore, Léon Bloy à propos de son grand homme médiocre : «Napoléon, semblable à un monstre qui aurait survécu à l'abolition de son espèce, fut vraiment seul, sans compagnons pour le comprendre ou l'assister, sans anges visibles et, peut-être aussi, sans Dieu, mais cela, qui peut le savoir ?» (6).
Le vide, le creux, deux notions que je ne confonds que pour les besoins de cette courte note, impliquent donc, dès qu'on les mentionne, un horizon ontologique immense et souverain, que tentèrent de scruter les plus grands philosophes et, bien sûr, les plus grands romanciers et poètes.
Si écrire c'est, peu ou prou, créer, François Hollande, quoi qu'il en dise, est l'ennemi fondamental de tout créateur, qui sera néanmoins, le cas échéant, heureux de recevoir les subsides des officines étatiques que son ministre de la Culture dirige.
Pour un poète hanté par l'idée de vide, de creux, de néant, François Hollande, qui n'a d'autre existence que celle que le vide, temporairement, lui a accordée, ne peut jamais surgir que par surprise, mais une surprise attendue, morne, étale, comme une interrogation non pas extrême mais banale, grise et même fade, un Sphinx légèrement souriant qui jamais n'exigera de vous une réponse qui peut engager votre vie. François Hollande, puisqu'il est un homme creux (7), est une surprise plate, un bouleversement attendu, une exception commune, une intrusion placide, l'homme qui jamais ne part puisqu'il est toujours-déjà-là comme la banalité la plus intime, à la différence de celui que prétendit chasser Sébastien Lapaque dans un livre très vaguement bernanosien, autant de modes d'intrusion qui ne peuvent en aucun cas se confondre avec la violence entraînant le corps et l'esprit du poète frappé par la brutale déhiscence du rien :
«One evening like the years that shut us in,
Roofed by dark-blooded and convulsing cloud,
Led onward by the scarlet and black flag
Of anger and despondency, my self :
My searcher and destroyer : wandering
Through unnamed streets of a great nameless town,
As in a syncope, sudde, absolute,
Was shown the Void that undermines the world.»
«Un soir semblable aux années qui nous enferment
Réfugié sous le nuage convulsif et sombre comme le sang,
Entraîné par le drapeau écarlate et noir
De la colère et de l’accablement, moi-même :
Mon inquisiteur, mon destructeur : errant
À travers les rues innommées d’une grande ville sans nom
Quand, syncope soudaine, illimitée,
Apparut le vide qui mine le monde.» (8)
C'est une autre évidence qui saisit le romancier lorsqu'il décrit, dès les toutes premières lignes de son livre, le vide qu'est devenu le monde : «Le froid et le silence. Les cendres du monde défunt emportées çà et là dans le vide sur les vents froids et profanes. Emportées au loin et dispersées et emportées encore plus loin. Toute chose coupée de son fondement» (9).
Toute chose coupée de son fondement, écrit Cormac McCarthy. François Hollande n'a pas de fondement puisque, comme tout vide, il est sans fond. Il reste quelques fondations, plus solides que le croient sans doute les techniciens de Bruxelles et les énarques de Paris, à notre pays et il est donc normal que l'homme creux qu'est François Hollande ait prétendu désamarrer un navire qui fait pourtant eau de toutes parts, la France, de son môle en coupant par exemple le lien de la filiation et, par exemple encore, en donnant quelque crédit aux ridicules théories dites du genre qui se proposent de mettre en place, sans le moindre à-coup politique, l'utopie meurtrière d'une société où femme et homme se confondent, bientôt vieillard et enfant, ces mots suspects n'étant considérés comme rien de plus que de réactionnaires conventions lexicales recouvrant une réalité perpétuellement modelable, changeante et indéfinissable.
Bien évidemment, il serait faux de croire que, une seule fois dans sa vie, François Hollande ait pu fermement décider de conduire une action politique ou même de prendre une décision. L'excès répugne au médiocre qu'est l'homme creux et jamais celui-ci ne décide ou ne se décide, tout comme il ne décide même pas de ne rien faire : il flotte, comme une méduse, au gré des courants, et filtre l'eau qui passe à sa portée, comme une moule, y trouvant sa maigre nourriture. L'homme médiocre, s'agitant aux quatre vents, ne possède aucune assise, qu'elle soit intellectuelle, philosophique ou religieuse, morale ou politique, ce qui ne signifie pas qu'il aime particulièrement être ballotté par des courants qu'il ne peut maîtriser. Du moins essaie-t-il de ne pas trop s'éloigner du rivage, car il n'aime pas le grand large, et la perspective que des millions de mètres cubes d'eau se trouvent sous ses pieds le terrorise. Il flotte, certes, mais il déteste plus que tout perdre pied, devoir se résoudre à ne plus s'enter sur l'être, ne plus le parasiter, car l'homme médiocre ne tire sa force réellement prodigieuse que de sa capacité à vampiriser ce qui est. Il ne détruit pas. Il dilue. Il ne dévore pas. Il mâchonne. Il n'abat pas. Il digère sans fin.
Notre placide Président s'est donc contenté de laisser faire, puisqu'il ne décide de rien, ne dit jamais oui et ne dit jamais non, envoyant au front l'un de ses ministres, une femme dont les ennemis politiques, eux-mêmes creux, saluent la pugnacité et même le courage, une femme devenue ministre et elle aussi parfaitement creuse, l'hélium de l'idéologie étant finalement le gaz le plus commun que les usines universitaires françaises aient produit depuis des décennies, qui plus est en quantités massives. Heureusement, le gaz idéologique ne réchauffe pas l'atmosphère mais la refroidit : l'idéologie, quelle qu'elle soit, est le froid le plus pur et François Hollande, en médiocre émérite qu'il est, s'en tient à raisonnable distance.
J'ai écrit que François Hollande n'aimait pas dire oui, tout comme il n'aimait pas dire non. Ernest Hello analyse cette banale incapacité du médiocre, son arme la plus destructrice : «Il trouve insolente toute affirmation, parce que toute affirmation exclut la proposition contradictoire. Mais si vous êtes un peu ami et un peu ennemi de toutes choses, il vous trouvera sage et réservé. Il admirera la délicatesse de votre pensée, et dira que vous avez le talent des transitions et des nuances» (op. cit., p. 60).
François Hollande ne croit pas en Dieu bien qu'il Le serve, et il ne croit bien évidemment pas au diable même s'il ne dédaignera jamais, pour montrer l'étendue considérable de sa liberté intellectuelle, d'en moquer les romantiques atours.
François Hol
21/05/2013 | Lien permanent
Richard Millet tel qu'en lui-même la vanité l'exalte : Israël depuis Beaufort

 Richard Millet dans la Zone.
Richard Millet dans la Zone. Israël depuis Beaufort est sans aucun doute l'un des textes les moins mauvais que la petite entreprise éditoriale de Richard Millet, avec la régularité monotone d'une kalachnikov germanopratine, produit maintenant depuis quelques années de bienheureuse et frénétique activité, laquelle n'empêche absolument pas l'homme, sorte de Melmoth errant le long du boulevard Saint-Germain ou de Vieux Marin racontant à qui veut l'entendre, sur la terrasse de Lipp, son héroïque passé de phalangiste du Verbe, de se prétendre aussi éternel mais glorieux proscrit, alors qu'au moins trois éditeurs (Olivier Véron, Pierre-Guillaume de Roux, Léo Scheer) lui assurent que ses ouvrages sont dignes d'être publiés et même, cela est bien plus remarquable, les publient, alors que la simple collation des livres qu'il a publiés chez près d'une dizaine d'éditeurs suffit à remplir plusieurs pages, compilant méthodiquement plus de... 70 ouvrages ! Mon Dieu, ma soirée, et même ma semaine tout entière, vont être gâchées à la simple perspective qu'il reste, si Dieu donne longue vie à ce rétiaire de pacotille, une bonne cinquantaine supplémentaire de livres à écrire, dressés sur l'autel célébrant la messe que Richard Millet récite avec un savoir-faire d'officiant chevronné à sa propre gloire immarcescible.
Israël depuis Beaufort est sans aucun doute l'un des textes les moins mauvais que la petite entreprise éditoriale de Richard Millet, avec la régularité monotone d'une kalachnikov germanopratine, produit maintenant depuis quelques années de bienheureuse et frénétique activité, laquelle n'empêche absolument pas l'homme, sorte de Melmoth errant le long du boulevard Saint-Germain ou de Vieux Marin racontant à qui veut l'entendre, sur la terrasse de Lipp, son héroïque passé de phalangiste du Verbe, de se prétendre aussi éternel mais glorieux proscrit, alors qu'au moins trois éditeurs (Olivier Véron, Pierre-Guillaume de Roux, Léo Scheer) lui assurent que ses ouvrages sont dignes d'être publiés et même, cela est bien plus remarquable, les publient, alors que la simple collation des livres qu'il a publiés chez près d'une dizaine d'éditeurs suffit à remplir plusieurs pages, compilant méthodiquement plus de... 70 ouvrages ! Mon Dieu, ma soirée, et même ma semaine tout entière, vont être gâchées à la simple perspective qu'il reste, si Dieu donne longue vie à ce rétiaire de pacotille, une bonne cinquantaine supplémentaire de livres à écrire, dressés sur l'autel célébrant la messe que Richard Millet récite avec un savoir-faire d'officiant chevronné à sa propre gloire immarcescible.Je me revois discuter avec Olivier Véron à une terrasse de brasserie, il y a quelques semaines à peine. Je publierai ton livre si tu évoques Israël. Drôle marchandage que tu me proposes. Mais je n'ai rien à dire, Olivier, sur Israël, je te l'ai déjà dit je crois. C'est absolument impossible voyons, tout le monde à quelque chose à dire sur un tel sujet ! Oui Olivier, et c'est bien le problème. Bon. Alors ? Alors quoi ? Alors, vas-tu m'écrire ce texte sur Israël ? Non, car je n'ai rien à dire sur un tel sujet dont tout le monde, en effet, parle, et sur lequel tout le monde écrit. Je ne te comprends pas. Ne veux-tu pas être publié ? Certainement pas au prix d'un bavardage inconséquent, un de plus, alors que les librairies croulent sous les mauvais livres. C'est pourtant assez simple, Olivier : je me tais, sur Israël, car ce sujet est si terriblement complexe et grand que je ne me sens le droit de rien dire, est-ce plus clair ?, et que, si je devais écrire quelque chose sur pareil sujet, ce serait après m'être enfermé des années durant dans son étude. Non, pas vraiment, ce n'est pas beaucoup plus clair. Pourtant, c'est absolument limpide : je n'ai rien à dire sur Israël, car un tel sujet devrait, comme la kabbale, faire l'objet d'innombrables années de rumination intellectuelle et spirituelle, et donner lieu, tout au mieux, à quelques lignes prudentes à la fin d'une vie, moins peut-être, comme le dernier trait d'un Hokusai où se liraient toutes les mers possibles. Je ne te comprends pas, décidément. Allez, écris-moi ce texte sur Israël bon sang ! Non. Je le vois bien, que tu ne comprends rien. Puis je mens car, à vrai dire, j'ai déjà enfreint cet impératif catégorique. Ah bon ? Oui. Comment cela ? Je te rappelle que j'ai déjà écrit sur Israël. Sur Stalker je suppose ? Oui, mais, avant que je ne crée ce blog, dans un livre que tu as failli publier, je te le rappelle, et que tu n'as pas publié parce que, si mes souvenirs sont bons, tu m'as reproché d'y avoir été beaucoup trop steinerien, donc matois, rusé ou peut-être, plus simplement, respectueux des détours composés par la pensée de ce diable de Steiner, et tu m'as aussi reproché de ne pas conclure mon étude sur l'auteur de Réelles présences dans le sens qui à tes yeux ne pouvait qu'être le seul et unique valable, à savoir : en pointant les doutes et les contradictions de George Steiner face au christianisme certes, ce que j'ai fait dans ce livre et une autre fois après ce livre, dans un article pour la revue Études, mais, surtout, en forçant sa pensée, c'est-à-dire en l'incarnant à la mode péguyste ce que, je te rappelle, j'ai refusé de toutes mes forces, car il eût été pitoyable, grotesque et surtout ridicule d'affirmer que cet auteur se trouvait, comme d'autres avant lui, au porche de l’Église et même de prétendre l'y faire entrer, comme tu me le demandais pour être publié chez toi (aux côtés, à l'époque, de Giocanti, Soulié, Lapaque et Hadjadj), d'un coup de pied dans le cul. Ce livre sur Steiner, t'en souviens-tu Olivier ?, non seulement que tu n'as pas voulu éditer parce qu'il ne te semblait pas assez catholique, tandis que Denis Tillinac à qui je le proposai alors, et qui me dit oui, puis non, puis oui mais à combien d'exemplaires se vendra-t-il ?, puis non, puis plus rien, ce livre donc, que non seulement tu ne publias pas alors qu'il évoquait bien évidemment la question d'Israël, mais dont tu n'as même pas voulu de la réédition puisqu'il est devenu introuvable, ce livre, je n'en renie pas un mot mais si certains de ses défauts me font rougir, ce livre, je l'ai écrit, Olivier et il me me semble ma foi pas plus franchement mauvais que tous ceux que tu as édités. Puis, mon cher Olivier, je te rappelle que plusieurs de tes si chers auteurs, apparemment affligés d'un eczéma qu'ils ne cessent d'exacerber tout en le grattant, t'ont déjà proposé leur petit texte sur Israël, notamment Richard Millet, dont je te remercie de m'avoir envoyé le livre. Au fait, Olivier, j'espère que tu as parlé avec lui de son prétendu engagement dans les phalanges chrétiennes, qu'il exhibe comme une espèce de schiboleth censé lui ouvrir toutes les cuisses de l'admiration féminine, et même quelques organes masculins encore moins nobles ! Ne sois pas vulgaire. Nous avons évoqué ce sujet, oui, mais je ne t'en dirai pas plus. Oh, rassures-toi, je n'ai pas vraiment besoin de connaître la réponses qu'il t'a, d'aventure, donnée, ma religion, et depuis longtemps, est faite sur ce sujet, et il n'y a pas franchement besoin d'être un enquêteur de la trempe de Sherlock Holmes pour savoir de quoi il en retourne. Mais, ne veux-tu pas, je te le demande une dernière fois, écrire sur Israël ? Ma parole, je t'ai dit non ! Non ! NON ! (1).
 Affirmer qu'Israël depuis Beaufort (2) est l'un des textes récents les moins mauvais, grandiloquents, martiaux et ridicules de Richard Millet ne garantit bien évidemment d'aucune façon qu'il soit complètement débarrassé des défauts que nous avons systématiquement relevés dans ses autres essais. Ils y sont, plus simplement, moins présents, moins concentrés, leur dilution rendant ce texte acceptable tout au plus, ni bon ni mauvais, mais moins mauvais que ceux qui l'ont précédé, meilleur oui, allez savoir, plus mauvais que ceux qui, en rafale narcissique, vont immanquablement le suivre.
Affirmer qu'Israël depuis Beaufort (2) est l'un des textes récents les moins mauvais, grandiloquents, martiaux et ridicules de Richard Millet ne garantit bien évidemment d'aucune façon qu'il soit complètement débarrassé des défauts que nous avons systématiquement relevés dans ses autres essais. Ils y sont, plus simplement, moins présents, moins concentrés, leur dilution rendant ce texte acceptable tout au plus, ni bon ni mauvais, mais moins mauvais que ceux qui l'ont précédé, meilleur oui, allez savoir, plus mauvais que ceux qui, en rafale narcissique, vont immanquablement le suivre. Défaut par exemple que cette opposition systématique, puérile, usée jusqu'à la corde de la prétention lyrique, entre l'emphatique Nous (nous les courageux, nous les «catholiques français» (p. 115), nous qui «sommes vivants» et qui «traversons une épreuve bien plus difficile qu'on ne pense» (p. 68), nous qui ne mangeons pas de ce pain-là (cf. p. 114), nous les derniers hommes libres, nous les derniers résistants, nous les derniers écrivains, nous qui espérons «qu'il en ira un jour du français comme de l'hébreu en Israël» (pp. 110-1), nous les derniers amoureux de la langue, nous les derniers guerriers, nous les derniers nommeurs de la barbarie post-moderne, bref, nous les derniers hommes libres) et vous, vous les chiens, les petits-bourgeois, les rassis du bulbe, les enchaînés aux misérables convenances républicaines, vous qui n'êtes qu'un immense on à vrai dire, vous qui êtes moi, toi, toutes celles et tous ceux qui n'ont pas la chance d'être Richard Millet, toutes celles et tous ceux qui s'engluent complaisamment dans la «donne égalitariste» (p. 11), «l'imbécile quiétude du psychologisme» (p. 12), adhèrent en chantant et pleurant à «l'internationale des larmes» (p. 79), pratiquent les «inversions et pathologies culturelles» (p. 14, l'auteur souligne) de notre époque, saluent «le totem féministe» (p. 37), courbent l'échine devant le «culte consumériste du Veau d'Or» (p. 88), accélèrent la «parcellarisation communautariste» (p. 90), rendent grâce à «la judiciarisation multiculturelle de la société, notamment l'antiracisme étatique» (p. 93), flattent les «rhéteurs du capitalisme mondialisé» (p. 104), chantent les vertus d'un «néo-paganisme accusateur teinté de Coran et de bouddhisme» (p. 106) et s'enfièvrent devant l'«ethnicisation différentialiste» (p. 55).
La liste de ces expressions toutes faites, si commodes à exhiber comme les griottes centenaires que grand-mère expose dans son bocal hermétiquement fermé, n'est bien évidemment pas exhaustive car, à vrai dire, c'est tout le texte de Richard Millet qui en est lardé ou, pour filer ma métaphore, qui baignent dans l'alcool éventé d'un frontisme à tropisme réflexif, et qui n'est, en fin de compte, que la version améliorée de la gnôle de Pinot, simple flic. Procédé habituel de ce si piètre auteur qui se vante à longueur de page de savoir écrire, d'être le seul qui sache encore écrire en langue française et qui, comme une gamine découvrant de grands auteurs virils mouillerait à eau timide de se croire géniale et solitaire, gémit d'être un grand écrivain non seulement incompris mais pas lu (cf. p. 89) ! Tartufferie habituelle, répétée, consubstantielle, qui est devenue la signature du pseudo-écrivain, de l'essayiste lamentable qui ne parvient même pas à se convaincre lui-même de son ineffable talent et qui, pour en exalter l'empan expansif comme l'univers, a besoin, dix fois par livre, de se rassurer. Non pas des mots clairs donc, voire, grands dieux !, des concepts opératoires qu'il s'agirait de définir et dont il faudrait préciser la portée, mais des mots-valises ou des mots allant par deux (un nom commun, un adjectif le qualifiant) censés frapper l'imagination et devenant des espèces de catachrèses où se fige toute capacité de distinction analytique. Des cadavres de mots, que Richard Millet, avec un art de l'embaumement qui force l'admiration des meilleurs préparateurs de cadavres, aligne pour ses bimensuelles mises en bière éditoriale. Que signifie, par exemple, le «totem féministe» (déjà vu plus haut), ou bien encore la «disneylandisation générale de l'Histoire» (p. 67) ? Rien du tout bien sûr, sinon de bons mots journalistiques qui seront repris par un si talentueux Romaric Sangars ou une martiale Eugénie Bastié et qui, toujours chez Richard Millet, court-circuitent toute volonté de travail de la raison : la démarche intellectuelle de cet auteur, si tant est que nous ne l'insultions pas en employant de tels gros mots, ne prétend jamais mener le lecteur vers le dernier pas logique qu'il faudra veiller à lui laisser faire seul, dans le respect de sa liberté et, surtout, de son entière capacité à nous suivre ou à refuser de nous suivre. Non, rien de tel dans la prose sidérante bien davantage que coercitive par sa rigueur altière de Richard Millet qui, à coups d'images se voulant frappantes et qui ne sont plus que des slogans et des mots d'auteur sinon de journaliste souffleur de meeting lepéniste, prétend figer notre attention, passer par-dessus notre réflexion, bref, nous embrigader, nous charmer.
Ainsi, si Richard Millet est ventriloque, c'est devant son miroir, répétant sa petite antienne devant son seul juge, non pas lui-même mais l'idée qu'il se fait de lui-même, Madame Infatuation préparée outrancièrement comme un irrésistible cadeau de chair d'une nuit de débauche, dans la volonté, aussi évidente que grimaçante et ridiculement visible, de tenter de se convaincre lui-même : qu'il est un grand écrivain, le dernier des écrivains de langue française même, comme il n'a jamais cessé de le répéter dans plusieurs de ses essais, qu'il est un guerrier, un homme, nous le verrons, qui prétend évoquer sans peur l'ivresse de la violence physique alors qu'il n'a jamais fait violence qu'à une seule catégorie de combattants, ses lecteurs, en forçant leur interprétation, en établissant des concaténations qui n'ont jamais convaincu que son seul esprit (3) et encore, ce n'est là qu'une généreuse pétition de principe, car qui déchiffre la petite musique de Richard Millet a vite fait de saisir toute l'étendue de sa pauvre gamme de notes creuses, fausses : Arrêtez-moi, vous, lecteurs, où je fais un malheur !, mais qui aurait envie, je vous le demande, d'interrompre le numéro d'un clown triste dressé pour effectuer son petit tour devant un public de crétins ravis qui, à si bon compte, se croient molosses et Gauvains d'armée de reconquête chrétienne arpentant la terre orde d'Islam ? Personne, le spectacle est trop beau, s'il n'est pas franchement cathartique.
De grands mots creux que le maigre savoir-faire de Richard Millet ne parvient même pas à faire se tenir debout, voire, tout bonnement, se redresser, pour une parade organisée devant quelque bourgeoise de Neuilly sans plus de cervelle qu'il n'en faut pour écarter les cuisses devant le rétiaire au verbe si mirifiquement démuni qu'il en devient touchant, voilà le pauvre spectacle à quoi se résume, je le crains, un essai de Richard Millet, que Denis Tillinac, harpon perpétuel de cocktail présente, on se demande par quelle incompréhensible faveur, comme un grand écrivain. Il s'agit, contre tous les autres, de témoigner de sa propre intégrité comme je l'ai dit, l'une des rares figures de style de la si vantée écriture milletienne consistant dans l'opposition entre un nous forcément de majesté et un on forcément de meurtrière légèreté, de coupable médiocrité, cette si banale confrontation qui n'est qu'une supplication déguisée (Regardez-moi me dévêtir, souffrir et, surtout, prenez-moi pour le Christ je vous en conjure, et clouez-moi sur la Croix sévère mais juste de votre implacable jugement !) qui, presque toujours, se gonfle vite de vent, puis se dégonfle encore plus vite, tel un friselis qui n'animerait pas la voile d'une maquette d'enfant jouant à la bataille navale dans sa baignoire : «On me pardonnera donc d'employer le verbe émigrer dans un sens absolu, c'est-à-dire dans la douleur de la séparation : celle de voir, de mon côté, les juifs français quitter la France, et celle, pour moi, de ne savoir où émigrer, sinon en moi-même, dans ce site hors territoire qu'est la littérature, séjour invisible et néanmoins en quête, inlassablement, du génie de son lieu comme d'une incarnation définie par l'alliance entre les deux Testaments, le mot même de testament à entendre comme témoignage autant que legs : ce qui est toujours à ouvrir et à lire pour que nous témoignions à notre tour, particulièrement en ces temps de tiédeur spirituelle, où le refus de l'obéissance et le discrédit, voire l'opprobre jetés sur le témoin solitaire sont des signes du Démon» (pp. 28-9). Une telle tirade pourrait être, par le menu, analysée comme l'exemple même d'une rhétorique réactionnaire qui, d'habitude, présente quand même l'avantage d'être superbement ciselée, méchante ou bien drôle, bien souvent ces trois qualités ensemble. Richard Millet, lui, a inventé la réaction compassionnelle, la moraline anti-moderne, l'envie d'en découdre dolente, de préférence devant un public de lecteurs où il pourra faire rouler les petites muscles de sa phrase atone et étique, maigre comme une longue spatule de héron qui aurait la particularité de s'alimenter sur quelque théâtre des opérations factice : spiritualité diffuse prenant racine dans le cliché suranné de l'alliance des grands ensembles de textes judéo-chrétiens et se concrétisant par la chute (c'est le cas de le dire) involontairement comique qu'est la mention du Démon; opposition habituelle, comme une ritournelle acide ou bien une comptine pour gros dur de cour d'école, entre les autres, tous les autres, salopards, mous et corrompus, et soi-même comme un roc inaltérable, plus dur que le diamant; mots qui, à force de s'engendrer mécaniquement les uns des autres, par association spontanée de sonorités comme on parlait, jadis, de génération spontanée des mouches sur la carne, prétendent remplacer une cascade concaténative par la morne rigole de la parataxe à tropisme romantico-guerrier, l'effet étant encore accentué par l'usage des infinitifs et/ou des participes présents, qui ont l'avantage de présenter les vues de Richard Millet comme si elles existaient de toute éternité et n'étaient dues qu'à l'habituel et discret triomphe du bon sens; comédie, tant jouée par d'autres qui furent tout de même plus grands que ne l'est ce nain verbeux juché sur ses propres épaules, de l'émigration ou de la «diaspora intérieure» (p. 119); bouillabaisse insipide pour élève de troisième ayant lu quelques énigmatiques banalités ronflantes d'Edmond Jabès sur la littérature comme lieu hors du lieu subsumant tous les lieux trop grossièrement réels. Nous pourrions multiplier les (longs) exemples de ce calibre lacrymo-lyrique que nous n'en saurions pas davantage sur l'étrange maladie du langage qui semble avoir, depuis quelques années déjà, infecté la prose boursoufflée de Richard Millet. Voyez Renaud Camus, d'ailleurs fort peu discrètement rappelé via le thème du Grand Remplacement dans le texte de Richard Millet (cf. pp. 71 et 103), dont la prose, tout aussi malade que celle de l'auteur d'Israël depuis Beaufort, ne sait plus quel euphémisme inventer pour désigner le fait innommable : exterminez toutes ces brutes !, selon le mot célèbre de Kurtz, mais, surtout, commencez par exterminer toutes ces brutes qui se trouvent déjà sur le territoire français, en tant que bras de plus en plus armé des hordes conquérantes islamistes qui ne vont pas tarder à nous submerger !
Comme Karl Kraus, je devrais me contenter de citer un second extrait de la prose milletienne, que d'aucuns jugent aussi admirable que profonde, sans doute parce qu'ils ne lisent plus qu'avec des lunettes idéologiques, lesquelles ont l'appréciable avantage de conférer une profondeur (mais illusoire) à ce qui n'est que surface clinquante, toc de bazar oriental : «Et nous voyons bien dans quel satanique labor
02/12/2015 | Lien permanent
Trois buccins de l’Apocalypse : Baudouin de Bodinat, Matthieu Grimpret et Leonardo Castellani

 Acheter En attendant la fin du monde sur Amazon.
Acheter En attendant la fin du monde sur Amazon.Quelque chose me gêne dans le dernier texte de Baudouin de Bodinat, En attendant la fin du monde paru chez Fario, un éditeur aussi discret qu’intéressant qui a d’ailleurs publié, en livre ou en revues, plusieurs textes du grand Sebald. Bien avant Baudouin de Bodinat, ce dernier avait pour coutume de proposer des textes comprenant des photographies ayant une signification directe, ou bien indirecte mais pas moins flagrante, avec le récit proposé. Mais, là où l’auteur de Vertiges n’en finissait pas de suivre une piste que lui seul savait pouvoir suivre, en déployant une écriture aussi attentive aux plus extrêmes détails que capable d’attirer notre attention sur les correspondances subtiles existant entre les cercles concentriques s’étendant depuis un abîme de noirceur, Baudouin de Bodinat ne nous mène nulle part et même, comble de l’ironie, nous laisse sur place.
Ce quelque chose qui me frappe puis, dans le même mouvement ou presque, me gêne dans le livre de Baudouin de Bodinat qui eût pu s’intituler Petit précis de phraséologie à usage réactionnaire, c’est rien de moins que l’écriture même de l’auteur. Sa structure n’est que faussement complexe, puisqu’elle est décomposable en un usage monomaniaque de participes présents et d’infinitifs qui sont moins enchaînés que juxtaposés et nous donnent ainsi l’impression d’un emboîtement de phrases entre parenthèses et d’incises s’étendant avant qu’un point final ne vienne, passagèrement du moins – avant une nouvelle explosion obéissant au même principe de gonflement irrésistible – clore cette expansion qu’on dirait invincible, et qui ne semble devoir faire halte que lorsqu’elle est figée par une photographie de rue déserte de village perdu, photographies prises, nous dit-on, par le biais de pellicules périmées, et qui apportent un contrepoint utile, par leur extrême dépouillement et même pauvreté volontaire, aux tortillements des phrases butant sur des rues désertes, où sont banalement garées des voitures banales, sous un ciel bleu lui-même insignifiant, ou bien «sous le ciel diffus; ou quand l’été s’étiole, se perd en rêverie du proche automne» (p. 68). Michel Houellebecq, désormais considéré comme un photographe, eût montré plus de volonté d’enjoliver le vide d’une bourgade de province où rien ne se passe, «moindre ville de province indécise» comme l’écrit l’auteur, mais c’est justement de cette volonté que Baudouin de Bodinat se tient éloigné, aussi sûrement qu’il se tient éloigné, du moins c’est ce que l’on veut nous faire croire (et, pour m’amuser, je l’imagine envoyer par courriel son manuscrit à son éditeur, ou bien, plus désuet encore, en l’enregistrant sur une clé USB) d’un des moyens modernes de communication par lesquels l’essence de notre monde, s’il n’a pas complètement plié bagage comme l’aura selon Walter Benjamin, se dilue et dissout. C'est donc moins la fausse complexité du style de Baudouin de Bodinat que la maigreur des résultats obtenus : quoi, tant d'incises, d'escaliers embranchés sur des escaliers, tant de portes ouvertes pour nous mener dans une cabane pas même débranchée mais équipée d'un ordinateur dernier cri et bien sûr d'une connexion, depuis laquelle nous pouvons envoyer notre texte soulevé d'une indignation qu'un livre de Jacques Ellul, qu'une ligne de Gustave Thibon eût aisément concentrée.
Une seule fois, à la dernière page de son livre, cette écriture syncopée, comme désireuse de mimer la froideur minérale ou plutôt machinale de notre modernité décriée, une seule fois l’écriture de Baudouin de Bodinat se risque à ne pas ahaner mais à s’élancer en trois phrases qui n’en sont qu’une et qui annoncent ce que d’autres livres, ceux qui suivront peut-être, auront à charge d’explorer, «cette transparence où quelque chose en soi semble sur le point de s’ouvrir et tout réconcilier» (p. 70). J’exagère, car ce village, lieu de la déambulation photographique de l’auteur, apparaissait dès les premières lignes sous la forme de tel «vieux quartier de ce gros bourg», mais aussi du beffroi demeurant «inflexible à égrener les heures» (p. 12) comme s’il fallait, pour que la banderole des récriminations de Baudouin de Bodinat soit déployée au-dessus de nos têtes diantrement modernes, qu’elle soit plantée entre deux piquets champêtres d’un de ces lieux, si communs dès que nous quittons les grandes villes, si communs qu’ils ne peuvent que nous faire suspecter que c’est le texte lui-même de l’auteur qui est une série de clichés, et sa volonté d’encadrer de simplicité (prétendument) provinciale voire paysanne un texte savant.
Cliché du cadre bucolique où le dernier sage attend la catastrophe qui vient, la catastrophe qui est déjà là plutôt, la catastrophe qu’il est trop tard pour éviter mais non point pour déplorer, ce sera un livre de plus pour les journalistes après tout. Clichés que tous ces termes, parfois des trouvailles heureuses, mais noyées dans une foule d’autres termes rapidement entrechoqués, que l’on dirait avoir été moins inventés que méthodiquement alignés par un Renaud Camus qui n’aurait pas complètement perdu le sens de la phrase et saurait, partant, que son empilement de «que» et de «&» n’a d’autre sens que se fondre dans le silence minéral d’une fin d’après-midi de bourg oublié, autant de piquets devant lesquels toutes les vaches journalistiques vont venir mâcher leur ration de lieux communs agrémentés d’un peu de fortifiant aux hormones, «sage expansif» (p. 11), «édifice social», «radiovision» ou «optiphone» (p. 12) plusieurs fois répétés, «sonorisation distractive» (p. 13), «économie d’exploitation et de pillage» (p. 17), «économie concurrentielle» (p. 23) ou encore, et ce sont les trouvailles dont j’ai parlé, «hypoxie spirituelle» (p. 57), «dégénérescence maculaire de la conscience» (p. 58), «lumignons [qui] filent, s’étouffent et puis charbonnent» (p. 18), comme si l’auteur, sur lequel tant de spéculations courent, pour gagner sa vie avant que le Septième Sceau ne rende définitivement caducs ses efforts de vigie, officiait en tant que rédacteur des débats et par ce biais alimentait son lexique professionnel de tous les termes entendus lors de réunions de Conseil d’Administration ou de Comité d’Entreprise, sans oublier celles des CHSCT, ou Comités d’hygiène et de sécurité au travail.
Nous ne sortons guère quoi qu’il en soit, écriture savante et même précieuse ou pas, plates photographies suintant l’ennui et choisies pour cette raison, de la réaction, au sens le plus commun et banal du terme, long ver cavernicole dont Renaud Camus tiendrait la queue translucide et Alain Finkielkraut la tête aveugle (à moins que ce ne soit l’inverse, pour éviter toute allusion graveleuse dont on me supposerait coupable) en passant par Éric Zemmour, la poissonnière de Causeur et toute la clique piaillante des oisillons martiaux recevant la becquée dans le nid de L’Incorrect, de l’indigent écrivant Yrieix Denis écrivant avec un organe par lequel tout mammifère expulse ce dont son corps n’a pas besoin jusqu’à Matthieu Baumier écrivant avec les pieds de Philippe Sollers, en passant par Romaric Sangars qui, lui, aimerait bien écrire avec sa main et doit se contenter d’un moignon d’esthète gourmé, sans oublier le légendaire phénix de ces hauts lieux de la consanguinité Jacques de Guillebon qui, lui, n’écrit avec rien du tout mais remplit quand même des pages entières de ses fulminations apoplectiques d’adolescent brûlé par la vision du Buisson ardent et qui doit je le suppose beaucoup aimer les textes de Baudoin de Bodinat, pour cette exquise raison que l’auteur lui donne des mots bien frappés, journalistiques donc, qu’il pourra citer dans ses revues de presse nulles.
C’est finalement peut-être cela qui manque au maniéré Baudouin de Bodinat, l’un des plus récents surgeons de ce que Julien Benda appelait le byzantinisme, sorte de croisement puissant mais instable entre le matois pessimiste Michel Houellebecq et le remarquable Jaime Semprun qui a tout dit avant lui, et dans des phrases dont la mordacité le dispute à la perfection, c’est cela qui manque à l’auteur de La Vie sur Terre, la simplicité militante d’une foi farouche, de charbonnier si l’on veut bien que cette honorable profession n’existe plus en France ni même, sans doute, en Europe, une ligne de basse en somme à son chant trop travaillé pour être autre chose que l’un des rhizomes surprenants mais point aberrants de la modernité qu’il décrie à longueur de phrase à enchâssements se voulant antimodernes et n’étant que l’extrême proue du navire rutilant mais aveugle sans son pesant barda électronique qu’est notre époque terminale. Ligne de basse qui, comme «le beffroi [qui] demeure inflexible à égrener les heures» (p. 12), permettrait à Baudouin de Bodinat de ne point se contenter de se lamenter sur le monde comme il ne va plus du tout mais accepterait de souffrir pour lui et, d’une certaine façon absolument scandaleuse, kierkegaardienne, évangélique, le rachèterait. Pour le dire encore plus simplement, et je m’étonne que Sébastien Lapaque, d’habitude si attentif à détecter les failles les plus intimes, ne l’ait pas vu, Baudoin de Bodinat est un homme, du moins un auteur triste, à la différence des deux autres que nous allons évoquer, Matthieu Grimpret et le fou écrivant qu’est Eduardo Castellani. Il manque à Baudouin de Bodinat une échappée que laissent entrevoir, je l’ai dit, les toutes dernières lignes de son texte mélancolique et peut-être même désespéré, un solide maillet pour entamer l’édifice coruscant de tant de phrases qui l’emprisonnent : «& aussi que peut-être tout le monde se doute qu’au point où en sont les choses (en vision cavalière, ou aérienne à survoler ces périphéries de lotissements, de banlieues informes qui vont s’épaissir en entassements chaotiques d’habitations et de fonctions urbaines, et ainsi de suite à perte de vue recouvrant la Terre de cette densité de peuplement en survie assistée), c’est tout simplement sans solution. Sans plus aucun moyen pour l’espèce humaine de se dégager de ce piège où elle est entrée et qui la tient» (p. 59).
Notre royaume de Matthieu Grimpret (LGM Éditions)
 Acheter Notre royaume sur Amazon.
Acheter Notre royaume sur Amazon.J’avoue avoir été tout proche de sombrer dans le plus mélancolique découragement en lisant quelques-uns des plus récents ouvrages de ce qui passe pour de la littérature ou bien des témoignages d’inspiration chrétienne, voire spécifiquement catholique. Je n’évoquerai pas de nouveau le juvénilement martial Conversion de Romaric (Beau) Sangars, qui finira bien par dépasser son maître et ami en palabres creuses Jacques de Guillebon, ou bien tel essai, le millième sans doute, de la florissante petite entreprise Hadjadj & Cie, qui d’ici peu lancera sur le marché une compilation de comptines chantées et jouées par notre petite famille apostoliquement consacrée, des bougies sentant bon la myrrhe et l’encens, et peut-être même des harmonicas qui se déclencheront automatiquement pour jouer de petits airs entraînants et ainsi marquer d’utiles bien que répétitives prières toutes les heures d’une journée dévotement dédiée à Dieu. Tout cela, c’est-à-dire si peu voire rien, aurait déjà disparu si je n’en avais parlé, même s’il est dit que Dieu n’ignore rien du tout du dernier brin d’herbe perdu au fin fond d’une grotte inexplorée.
Matthieu Grimpret, dont je ne savais jusqu’alors strictement rien si ce n’est que nous avions un ami commun qui m’est très cher, m’a demandé la permission de m’envoyer son texte paru en 2017 aux éditions LGM, intitulé Notre royaume ou plutôt Notre Royaume. Je n’y ai plus du tout pensé je l’avoue jusqu’à ce que je commence sa lecture, achevée très vite tant ce beau texte dit l’essentiel, sans aucune de ces fioritures jaculatoires insupportables dont usent sans vergogne nos récents convertis qui, comme tous les convertis, se croient obligés de gueuler sur tous les clochers que Dieu a soulevé leur cœur et même peut-être tel autre organe, ce qui leur fait immédiatement penser qu’ils ont pour unique destin, outre celui de nous bassiner, le martyre, en étant soumis aux plus atroces souffrances qui leur seraient infligées par de mécréants islamistes, du moins qu’ils sont autorisés à le haranguer lors de soirées parisiennes où il fait bon se graisser la main d’eau bénite et de compliments évangéliques : «Que ton dernier livre est beau !, mon cher Jacques !»; «Que ton article qui salue la beauté de mon dernier livre est juste, mon cher Yrieix !»; «Que ta maison d’édition est riche de grands livres, mon cher Léo !»; «Quelle joie je me fais de t’y publier, mon cher Romaric !» et puis, enfin, avant que tous ces animalcules à antennes et dents longues quoique translucides : «Quelle grande chose que nous nous empoissions de bave en gaie farandole œcuménique, mes chers tous !».
Matthieu Grimpret, se tenant à ma connaissance loin de ces petits raouts moins sanguins que consanguins où ces premiers de cordée transcendantale se reconnaissent les uns les autres à leur tatouage ecclésial, a rappelé quelle doit être la première exigence du chrétien, que ne manqua d’ailleurs pas de crier dans son premier (et dernier, hélas) beau livre Fabrice Hadjadj, Et les violents s’en emparent . Cet impératif catégorique est, d’abord, moral ou, allais-je dire, vital : s’élancer, marcher, ne jamais s’arrêter, afin que notre marche et notre mouvement s’accordent avec le mouvement initial prodigieux par lequel Dieu a créé l’univers en perpétuelle expansion. Seule cette mise en branle de toutes les ressources du corps et de l’esprit, de l’âme bien sûr aussi, peut nous laisser entrevoir que notre royaume, le Royaume, est pure densité, dimension qui nous leste d’une poids et même d’une gravité que nous n’avons pas le droit de refuser, ni même d’écarter de nos épaules : «Le Père me l’a encore dit, lors de notre dernière rencontre : l’homme est fait pour la densité. Il est fait pour recevoir la mesure bien pleine, bien tassée, débordante, dont parle l’Écriture. Il est fait pour que toutes les dimensions de sa vie se tiennent fermement ensemble, réunies sous un même chef et dans un même rayonnement, comme la chair d’un fruit s’alourdit au soleil, comme les doigts d’une main paternelle forment un poing qui, élevé bien haut dans le ciel, inspire confiance. Non pas d’abord une confiance en quelqu’un d’ici-bas pour quelque chose d’ici-bas – une confiance tout court, une confiance ontologique, une confiance d’un autre ordre, une confiance qui vient d’ailleurs et que nul ne saurait qualifier convenablement, la confiance simple de l’homme vivant et debout» (pp. 16-7). Matthieu Grimpret commente ici de la façon la plus succincte et juste Charles Péguy, en mimant son style fait de répétitions qui pourtant jamais ne nous donnent l’impression de la redite ou de la phrase qui s’encalmine, encore moins du petit rythme haletant par lequel les béjaunes plus haut cités expulsent leurs ridicules créations verbales, mais au contraire évoque le mouvement de la vie reçue qui toujours doit s’inscrire dans le grand fleuve du monde, puisque l’homme, parmi tant d’autres définitions possibles, est celui qui comprend, à moins d’être aussi emmuré qu’une veine d’or au sein de son bloc de roches inamovibles, qu’il y a sous les choses «autre chose de plus puissant, de plus efficace, de plus vivant que ces milliards de molécules si simples» (p. 18) : un cœur qui bat, une âme à ouvrir, un souffle du vent qui est «le signe de l’histoire en marche», qui «rappelle à nos cœurs et à nos corps que la figure de ce monde passe, et qu’il faut avancer» (p. 58).
Qu’il s’agisse d’habiter le Royaume qu’il faudra une vie pour parvenir à entrevoir bien davantage qu’à espérer fouler sa terre chaude, maternelle, de ses pieds, et encore, en ayant réussi à s’extirper de la boue puante du Chantier, ou qu’il s’agisse d’apprendre à aimer, Matthieu Grimpret n’a de cesse de nous redire que l’homme n’est pas à l’origine de l’homme, et cela jusqu’en ses actes les plus communs et humbles, puisque la vie n’est pas produite par lui, mais qu’elle vient d’ailleurs (cf. p. 19), comme le vent qui nous précède et qui pourtant, toujours, est là, comme le Royaume plus tremblant qu’un mirage et qui, pourtant, lui aussi, se trouve sous nos pas, en nos cœurs : «Cette demeure, ces conditions d’habitation doivent venir d’ailleurs, l’homme doit les recevoir d’un autre, d’un père, d’un père qui soit le père des choses, le père des êtres, et leur architecture intentionnelle prend la forme d’un désir – et donc d’un mouvement, et donc d’un temps, et donc d’un espace» (p. 23). Je ne sais si Matthieu Grimpret a lu les plus beaux livres (beaux, ils le sont tous à vrai dire) de Max Picard, mais je l’invite sans tarder à se procurer un ouvrage comme La fuite devant Dieu, où il trouvera thématisées ses interrogations sous une forme plus philosophique que la sienne, pas moins poétique cependant.
Ce n’est pas le seul auteur, avec Péguy je l’ai dit, des textes duquel nous pouvons rapprocher ce que nous donne à voir et comprendre Matthieu Grimpret, car nous pourrions tout autant songer, en lisant Notre royaume, à un très beau récit symbolique comme L’Avenue de Paul Gadenne, où l’architecture, le plus souvent e
19/07/2018 | Lien permanent
Écrits d'exil, 1927-1928 de Léon Daudet

 Mâles lectures.
Mâles lectures. Écrivains et artistes de Léon Daudet.
Écrivains et artistes de Léon Daudet.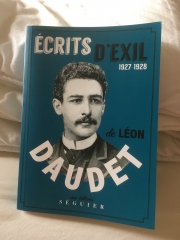 Acheter Écrits d'exil sur Amazon.
Acheter Écrits d'exil sur Amazon.La Préface de Sébastien Lapaque aux Écrits d'exil de Léon Daudet (1), si elle ne pipe mot sur les qualités littéraires évidentes et l'originalité incontestable de l'écriture toute faite de parallèles aussi vifs qu'une décharge d'adrénaline et de notations intimes ou de confidences sur des auteurs (Hugo, Baudelaire) aussi touchantes que surprenantes, que se remémore, pour notre plus grand plaisir, ce tonitruant continuateur de Rabelais et de Bloy que fut Léon Daudet, nous renseigne suffisamment sur la période personnelle, atroce, qu'il traverse, puisque son deuxième fils, Philippe, est mort, s'étant suicidé ou bien ayant été éliminé par les sbires de l'ombre du pouvoir en place, comme le père ravagé n'aura cessé de le penser jusqu'à sa mort. Il trouve, alors, la force d'écrire un ouvrage intitulé Courrier des Pays-Bas dont sont extraits les différents textes composant ce recueil.
Il ne faut chercher aucune cohérence directe entre les textes ainsi colligés, fort courts ou de belle ampleur, qu'il s'agisse de portraits ou de méditations littéraires, mais aussi d'épigrammes, sinon, bien sûr, la constante tension stylistique d'une écriture qui n'éclate jamais mieux que dans les séries de courtes notations, longues parfois de deux phrases, dans lesquelles Léon Daudet non seulement ramasse ses forces et bande ses muscles, mais jamais n'hésite à décocher telle flèche qui à coup sûr se plantera dans l'ennemi qu'il s'est choisi, Paul Valéry ou Ernest Renan par exemple, qu'il déteste visiblement par-dessus tout, le second davantage encore que le premier. Parfois, cette force contenue permet au fauve de sauter directement à la gorge de sa proie, et nous assistons, d'un claquement sec de mâchoire, à l'égorgement de la gazelle ou du pourceau : ainsi, l'auteur de Monsieur Teste est-il surnommé «Léonard de Vichy» (p. 206) ou, petite facilité que nous excuserons sans peine à notre atrabilaire qui ne peut pas toujours saigner proprement, si je puis dire, sa victime mais la larde de coups de canif inoffensifs, «Paul Valait-rien» (p. 217), facilité de potache disais-je, comme si Léon Daudet nous montrait par avance le maximum auquel atteindrait, quelques années après sa sanglante carrière d'imprécateur, un Jean Cau, pire encore, je veux dire, bien plus petit, un Denis Tillinac, si nous nous souvenons que, comme Georges Bernanos, Daudet fils «déchire comme l'aigle», mais «un aigle qui saurait l'anatomie» (p. 124). Parfois également, cette fois-ci à l'exemple de Léon Bloy, l'auteur des Morticoles, pourtant mieux nourri et sustenté que le Mendiant ingrat, a pu accrocher aux mesquineries (cf. p. 118), travers qui est celui de tous les prodigues et prodiges verbaux. Du second, Renan donc, tout est sale et abject et là, le trait est aussi juste qu'assassin, donc définitif : «Quand je lis Renan, j'entends, derrière la toile peinte en couleurs tendres, des blasphèmes furieux, des jurons de charretier ivre» puisque «son style lui servait à masquer son âme» qu'il avait vile (Aphorismes sur la polémique et l'invective, p. 127). Je retiens cette autre magnifique méchanceté, d'une brièveté lardant la masse des dix mille pages inutiles et fausses écrites par l'auteur de La vie de Jésus : «Renan, ou le bidet de Ponce Pilate. Il s'y lavait, non les mains, mais le cul» (Réflexions sur la connaissance, p. 301). Si la polémique, telle que la définit Léon Daudet, est ainsi «un combat mené par la plume en faveur de certaines idées» et «la réaction de défense contre les enlisements et endormements philosophiques, artistiques et littéraires» (Le plus grand de nos polémistes, François Rabelais, p. 66), nul doute qu'il soit, lui, tandis que d'autres dorment, constamment en éveil ! Nous verrons pourtant que l'un des effets bénéfiques de cette hargne à ne jamais fermer l’œil est une étonnante capacité d'accommodement, au sens optique du terme, de la vision, susceptible tout autant de replacer le plus fin détail dans un plan d'ensemble ordonnateur, qu'il sera cependant le seul capable de parvenir à discerner avec autant de justesse, nous en précisant le moindre dentelé. Léon Daudet nous le dit avec humour lorsqu'il prétend que le polémiste est réactionnaire, donc réaliste : «il est pour ce qui est, contre ce qu'on lui dit qui sera, mais dont il n'est pas du tout sûr que ce sera; en d'autres termes, le polémiste est avant tout un réaliste» (ibid., p. 68), à condition de préciser que ce réaliste-là sera doué d'une finesse de jugement et d'une sensibilité inouïes, ce qui n'est en fin de compte pas très étonnant puisqu'il est celui qui, «aux périodes critiques de notre histoire», venge «la justice et la morale bafouées en montrant les choses et les gens sous leur véritable aspect, en dehors des conventions d'écoles, d'assemblée et d'instituts» (ibid., p. 103). En somme, le polémiste, loin d'être un aigri et un raté, communes insultes dont les bonnes âmes l'accablent avec leurs petits crachats, est bien au contraire celui qui, derrière les apparences du luxe et de la volupté, flaire la pourriture de la charogne maquillée pour la fête démocratique et, non content d'incommoder l'odorat de nos vertueux, expose la pourriture en plein défilé républicain. Pas étonnant que la vieille démocratie française, que Léon Daudet qualifie de «Révolution couchée, et qui fait ses besoins dans ses draps» (Les atmosphères politiques et l'histoire de la Révolution, p. 193) ne lui ait jamais pardonné un tel outrage, et l'ait enfermé à quintuple tour dans le cabanon capitonné où elle a relégué ses plus fiers contempteurs, qu'il s'agisse de Barbey, de Bloy, de Darien, de Céline, de Marc-Édouard Nabe et, donc, de Léon Daudet.
D'autres ressemblances entre les divers textes appartenant qui plus est à des genres eux-mêmes différents, plus évanescentes et subtiles, composent la toile de fond sur laquelle Léon Daudet projette au premier plan des motifs grossiers, comme un peintre qui n'hésiterait pas à accorder un soin maniaque à l'arrière-plan de la scène qu'il représente, mais se contenterait, pour peindre le devant de la scène, de larges traits de gouache, tout pressé en somme de signifier une mystérieuse transparence aux yeux de ceux qui se tiendront devant sa toile. Il est d'ailleurs difficile de préciser la nature de cette musicalité diffuse, de cette colle qui unit apparemment tous les textes sans les confondre, qu'il s'agisse de notations ou d'aphorismes fulgurants de justesse et d'alacrité ou de passages plus amples, élégiaques, chantant la beauté des grands écrivains et des textes qui tous se répondent les uns les autres, si ce n'est par ce que nous pourrions appeler une espèce d'atmosphère de sympathie, équivalent moderne des correspondances baudelairiennes que Léon Daudet place au-dessus de la faculté épaisse, bornée, répétitive, kilométrique même d'un Victor Hugo à dérouler des images poétiques, remarquables ou, inversement, d'une sottise républicaine consommée (voir le beau texte intitulé Hugo grandi par l'exil et la douleur).
Si, écrit Daudet, «dans le pamphlétaire de bon aloi, il y a du chien, dressé à sauter à la gorge du faux (Aphorismes sur la polémique et l'invective, p. 127), raison pour laquelle il goûte la puissance d'un Léon Bloy (2) tout en n'oubliant pas d'indiquer certaine petitesse on l'a dit, il y a aussi chez ce diable d'écrivain qui est, avant tout, un critique littéraire puissant, ce que nous pourrions affirmer être une constante instabilité : je ne veux pas parler de l'incapacité, pour Daudet, de planter le dard d'un jugement dans une bajoue ou une fesse molle, cette arme dont jamais les cochons de la critique journalistique contemporaine n'ont imaginé le pouvoir de trancher de fines lamelles de lard, mais d'une espèce de perpétuelle, à vrai dire dévorante curiosité, un appétit formidablement rabelaisien de tout lire, de tout connaître, de tout vanter ou, dans certains cas, de tout exécrer, avec une même étonnante capacité d'ingestion et, reconnaissons-le dans le cas de cet exécrateur surdoué, de digestion et d'expulsion.
Rien de moins figé en effet que la pensée sans cesse mouvante de Léon Daudet ou, pour le dire autrement, rien de moins compassé que certaines de ses vues ondoyantes, perpétuellement souples mais non point labiles ou fragiles, que l'on aura quelque mal à penser avoir été celles d'un prétendu réactionnaire engoncé dans son corset de certitudes ripolinées plutôt qu'émises par un zélé moderniste s'extasiant, comme un nouveau-né, du moindre bilboquet qu'on lui mettra sous le nez. Lisons-le prétendre, à juste titre puisque la hauteur de vue, l'empan intellectuel véritable toujours s'entent sur une très solide culture, sur la connaissance du tuf où l'art a germé au long des siècles et jamais sur une voracité instantanée, devant être perpétuellement comblée par de nouveaux aliments qui exténueront la volonté et tortureront l'estomac, que «toute œuvre d'art de forme nouvelle provoque un véritable choc, et celui-ci est douloureux à ceux qui ne font pas partie des élites, intellectuelles ou artistiques, de ce temps. Ces élites savent bien que l'art aussi doit changer, que ses formes sont éternellement mouvantes, qu'il en est d'elles comme des reflets du soleil, ou de la lune, sur les flots incessamment agités; mais les autres, les gens de peu d'esprit, d’œil, d'oreille, de sensibilité, les «verts» d'académie et d'institut, les professeurs de facultés, les mandarins à douze boutons, se figurent qu'il y a des formes de beauté immuables et que quiconque s'en écarte et apporte un étincellement inédit en littérature, une configuration inédite en sculpture, une couleur inédite en peinture, etc., ou bien est fou, ou bien veut se moquer du monde» (Baudelaire, le malaise et «l'aura», p. 271). Quelques pages plus loin, il affirmera qu'il semble, à propos d'un poème de Baudelaire, que «tous les mots soient employés là pour la première fois», comme s'ils étaient «décrassés de l'accoutumance, de la même façon syntaxique que dans les Pensées de Pascal» ou que «leurs coordonnées mentales sont changées (ibid., p. 285) : encore faut-il, n'est-ce pas, pouvoir non seulement supporter ce changement des repères, accepter un nouveau mètre étalon par quoi, le plus souvent, un génie établit sa souveraineté, mais en qualifier la pertinence, l'originalité et la beauté.
Nous savons plus d'un écrivain qui aura dû son lancement de carrière, si je puis dire, à ce superbe facilitateur que fut le fils d'Alphonse Daudet, car Léon a une remarquable capacité non seulement d'accueillir le talent, où qu'il se trouve (en cela, la critique littéraire d'un Pierre Boutang peut à bon droit être considérée comme sa plus riche héritière), mais à s'enthousiasmer sans feinte ni cynisme pour la grandeur, en vertu, peut-être, de l'universelle communication des livres entre eux, la beauté nourrissant et même : faisant naître la beauté, dans une atmosphère ténue que Léon Daudet définit en la qualifiant d'ambiance, et qui pourrait en peu de mots être décrite comme l'«étincellement général de l'intelligence» (Le plus grand de nos polémistes, François Rabelais, p. 64) : «L'ambiance est voisine du frisson et de l'aura, et c'est par là que s'expliquent les grandes frénésies et terreurs en commun, les pressentiments en nappe, et non plus seulement individuels, et les épidémies prétendues mentales, en réalité cutanées» (Les atmosphères politiques et l'histoire de la Révolution, p. 191). Notons, ici, la prévalence du vocabulaire clinique, médical, que Léon Daudet n'hésite jamais à utiliser, avec l'avidité d'un glouton, se servant d'images, de métaphores ou de comparaisons aussi précises que les gestes d'un découpeur de cadavres, non seulement parce qu'il a retenu la leçon du spiritualisme charnel que Huysmans invoquait dans l'entame de Là-bas mais surtout parce qu'il a, d'abord, été médecin, comme un autre pestiféré des lettres, cette fois-ci d'outre-Rhin, Gottfried Benn : la Révolution, qualifiée de bloc, «est plutôt un énorme caillot de sang et de sanie, et comparable à la soudaineté d'un cancer rongeur et dévastateur, qui envoya ensuite des métastases, de formes très diverses, à travers l'Europe» (Les atmosphères politiques et l'histoire de la Révolution, p. 195).
C'est sans doute, avec bien sûr les fulgurances de jugement dont nous avons parlé (3) et ce qu'il a appelé l'aura ou l'ambiance d'une époque, avec la délicieuse accumulation de souvenirs bien souvent directs (4) d'écrivains reçus par son fameux père ou encore une sensibilité étonnante à la musicalité de la langue (5), la dimension la plus intéressante du génie de Léon Daudet que cette délicate et exquise intrication entre le charnel, voire le corporel le plus humble et même misérable, et le spirituel, le corps et l'esprit ou même l'âme mais, surtout, plus profondément encore, cet entremêlement de la matière et de ce qui n'en est pas, ou bien est une matière ténue, toute pleine, toute grosse de ce qui la dépasse, l'essentialise, la subtilise. Ainsi du génie, que Léon Daudet explique très bellement dans son Hérédo, lequel naît d'une lutte, «d'un combat victorieux de la personnalité souveraine, et donc saine, contre la pression héréditaire et neurochimique, contre les troubles de ce [qu'il a] appelé la gravitation intérieure» (Baudelaire, le malaise et «l'aura», p. 260, je souligne). Nous pourrions croire Léon Daudet, comme Émile Zola, dans le matérialisme le plus fangeux, et trempant sa plume dans le bidet où Renan, donc, lavait son cul, que nous ferions entièrement fausse route puisque plus d'une fois l'auteur vitupère contre «les sombres crétins du matérialisme médical» définissant la pensée comme une «sécrétion du cerveau» alors qu'elle est bien davantage, et la formule est superbe, «un rythme de rythmes» : «En effet, un écrivain, comme un savant, n'est pas seulement parcouru par des ondes rythmiques, quantitatives ou qualitatives, normales et classées, et glissant dans le sens unilinéaire du temps, ou polylinéaire de l'espace. Il est le point de rencontre et la jonction de ces rythmes, accourus de l'avenir, que l'on ne pourrait pas plus nier que le mirage, ou le pressentiment. Tout orateur, ayant l'habitude de la parole en public, sait qu'il est commandé par trois séries d'ondes intellectuelles : celles venues du passé, c'est-à-dire du thème qu'il s'est donné; celles venues du public; celles venues, plus subrepticement et plus mystérieusement, d'un résultat moral ou actif, à obtenir, qu'il n'entrevoir pas mais qui, à son insu, le guide. J'en ai fait personnellement l'expérience vingt fois; et ce qui est vrai de l'orateur est vrai de l'écrivain, et aussi du savant» (Rythmes et cadences de la prose française, p. 51). Ces rythmes, ce réseau de fines cordes qui semblent ne jamais s'arrêter de résonner, toutes parcourues de frissons qu'il importera au lecteur immense de capter et d'ordonner, prouvent donc que «les sommets de l'esprit se relient à des attaches organiques», Baudelaire, d'autres aussi, étant de fait «de connivence avec les secrets permanents de la vie animale» (Baudelaire, le malaise et «l'aura», p. 283).
Cette conception que nous ne pouvons absolument pas prétendre mécaniciste de l'univers, puisque les forces de l'esprit infusent la secrète architecture, puisque l'ambiance, ou l'aura, ou encore l'influence, l'atmosphère dira l'auteur (cf. p. 193), imprègnent l'histoire humaine, conception que nous pourrions sans doute, au prix d'une excessive simplification, nommer organique ou organiciste, apparaît très nettement lorsque Léon Daudet évoque les lettres françaises, qualifiées comme étant «une sorte de corps, qui a une continuité, des ramifications et une direction générale en dehors des corps des citoyens français qui se succèdent de famille en famille suivant les lois et des dérivations héréditaires» (Montaigne et l'ambiance du savoir, p. 163), le mouvement que réalise le critique littéraire pouvant en fin de compte être comparé à l'exploration méthodique d'un corps immense dont aucune des parties ne serait ignorée ni considérée comme ne faisant pas partie d'un tout dont il importe, avant tout, de bien comprendre la fondamentale complexité, si la visée du grand lecteur, comme la pensée de Montaigne selon Daudet, «se met à décrire des cercles successifs et subintrants, auxquels sont tangents d'autres livres et d'autres réflexions» (ibid., p. 164).
Ainsi pouvons-nous dire que, tout comme Léon Daudet resta émerveillé devant la pénétration de Charles Baudelaire, sa logique et ce «je ne sais quoi de divinatoire qui est au-delà de l'analyse et de l'exposé et qui fait les synthétistes et rassembleurs de premier plan» (Baudelaire, le malaise et «l'aura», p. 358), nous restons émerveillés devant la puissance synthétique de cet auteur, laquelle, il faut bien le noter, jamais ne se départit d'une formidable capacité de concentration de la vue, comme si ce pénétrant critique dispo
03/11/2020 | Lien permanent
Pas pleurer de Lydie Salvayre, le Goncourt de la vulgarité

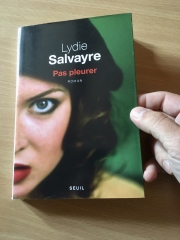 À propos de Lydie Salvayre, Pas pleurer (Éditions du Seuil, 2014).
À propos de Lydie Salvayre, Pas pleurer (Éditions du Seuil, 2014).Acheter Pas pleurer sur Amazon.
Voici la copie d'une note initialement publiée en 2014, à l'occasion de la parution de cet ignoble roman qu'est Pas pleurer de Lydie Salvayre. Pour une raison incompréhensible, cette note, qui avait été notablement partagée sur les réseaux sociaux, avait tout bonnement disparu de la Toile lorsque je me suis avisé de la rechercher.
Pauvre France qui naguère se voulut le phare intellectuel et littéraire du monde, que dis-je, de l'univers, se prit à croire à ce miracle et, finalement, parvint à le réaliser durant quelques siècles tout de même ! Aujourd'hui, elle n'en finit plus, comme un dernier de la classe obstiné dans sa nullité crasseuse, de prouver qu'elle mérite sa dernière place, sa place de cancre, la place qu'il est au moins aussi difficile de conquérir, puis de garder, que la première place, la dernière place avant la sortie hors de la classe, du classement, pour cause de nullité non rédimable, malgré tous les redoublements possibles, et les aides de la République des lettres si vigilante pour son mioche au nez morveux.
Tentons d'affoler nos journalistes en utilisant l'une de ces formules qu'ils goûtent tant et qui constituent, à vrai dire, le ban et l'arrière-ban de leur pensée, et que certains m'envieront, car il constitue un excellent titre d'article pour sûr, qui bien sûr jamais ne pourra être publié dans les colonnes d'un de nos valeureux suppléments journalistiques spécialisés en littérature, ni même dans celles d'une de ces si peu intéressantes revues évoquant des livres confondus avec des saucisses : Pas pleurer est le Goncourt de la vulgarité. Le Goncourt de trop ? Mon Dieu, non, même pas, car il y a quelques années tout de même que ce prix n'est plus qu'un entreléchage éhonté, une promotion à l'insignifiance, la récompense de la platitude, tares communes dont la particularité est d'être joyeusement célébrée, ce qui n'est pas rien dans la Ville des lumières, sous l’œil las des journalistes et d'un public de badauds qui jamais n'ont établi de grande différence entre un livre, celui que les critiques journalistiques leur recommandent chaudement, et un chapelet de saucisses, dis-je pour filer ma métaphore charcutière, tripale ou tripière. Pauvres lecteurs tout de même, bien informés de la traçabilité qui, désormais, est devenue le maître-mot de notre délire hygiéniste, ils risqueront de vomir et de cagarse (se chier) dessus bien davantage en lisant Pas pleurer, dont le seul avantage notable est qu'il facilitera le travail de la personne qui le traduira en espagnol, qu'en consommant la très saine cochonnaille.
C'est l'un des petits-fils de Georges Bernanos qui m'a demandé si j'avais lu ce roman qui évoque l'épisode de la terrifiante Guerre d'Espagne telle que son grand-père l'avait vue de ses propres yeux, puis dénoncée dans l'un des plus admirables livres du siècle passé, Les Grands cimetières sous la lune.
Non, cher ami, je n'ai pas lu ce roman, lui ai-je alors répondu et, pour l'heure, n'en pense à peu près rien, si ce n'est que d'autres personnes m'ont indiqué son existence, en effet, voire me conseillent de le lire, non pas tant qu'ils aient estimé la qualité de ce roman, mais parce qu'ils me savent passionné par Georges Bernanos, que Lydie Salvayre met en scène. Je me suis méfié, et je crois que j'ai bien fait de me méfier, car nous ne sommes jamais trop prudents en matière de consommation de carne, ou de piquette, ou de mauvais livre, c'est là tout un, surtout lorsque l'adresse qui vend cette carne, cette piquette ou ce mauvais livre vous est plaisamment recommandée. Quel sens aigu et insoupçonnable, comme l'odorat d'un malheureux qui serait tombé dans une fosse à purin, mit en alerte mon impeccable et redoutée capacité de décortiquer un livre salué comme il se doit par tous les crétins exerçant ce qui est décidément devenu, devant un autre plus moral, le plus vieux métier du monde ?
La réponse réside en deux mots : Pas pleurer, le titre du roman de Lydie Salvayre, que l'on croirait tout droit sorti, après des heures de cogitation mentale exténuante, d'une conversation par SMS entre deux pré-adolescents, ou bien du dialogue qui aurait été mitonné après des années de page désespérément blanche par Christophe Ono-dit-Biot, auteur d'un titre encore plus court que celui de Lydie Salvayre il fallait le faire, Plonger, un jour de propitiatoire et miraculeuse inspiration littéraire.
De l'inspiration littéraire, et peut-être même, tout simplement, du travail, Lydie Salvayre semble en avoir été privée, cette double absence étant fort heureusement compensée, pour le plus grand plaisir des imbéciles qui ont récompensé son roman, par une dose massive et pourtant non létale de vulgarité.
Nous trouvons en effet un concentré de vulgarité, douce fragrance annonçant la puanteur à venir, dès le titre du roman de Lydie Salvayre, ce minimalisme linguistique étant finalement le plus honnête indice de l'indigence littéraire du roman tout entier, sur laquelle nous reviendrons amplement, proposant ainsi la première véritable critique littéraire surnageant sans peine au milieu d'un océan de résumés de quatrième de couverture, d'éléments de langage publicitaires et de condensés de sottise.
 La vulgarité du roman de Lydie Salvayre, comme l’Être selon les métaphysiciens, est présente à tous les niveaux de conception de son roman, et englobe tout : cette vulgarité est donc formelle, dans l'emploi de termes et de formules vulgaires, grossiers, orduriers, et cette vulgarité constitue aussi comme un soubassement, puisqu'elle enrobe l'intention ayant présidé à la naissance de l’œuvre : la critique du catholicisme, du moins, d'un certain catholicisme rigoriste et tartuffe, traîné dans la boue et la merde, la critique du nationalisme, de tous les nationalismes, la critique de la guerre civile, la critique des fanatismes. Avouons que Lydie Salvayre s'est donné le beau rôle, n'est-ce pas ? Cerise sur le flan pas même correctement moulé, cette intention critique prétend s'inscrire sur les brisées de Georges Bernanos pour servir de miroir, disent les publicistes, aux dérives de notre franchouillarde société française, n'aimant pas le révolutionnaire, portant hauts ses légendaires cojones comme des ergots reposant sur le fumier et droite sa peur de la nouveauté et de la différence, les nouvelles mamelles de la Modernité.
La vulgarité du roman de Lydie Salvayre, comme l’Être selon les métaphysiciens, est présente à tous les niveaux de conception de son roman, et englobe tout : cette vulgarité est donc formelle, dans l'emploi de termes et de formules vulgaires, grossiers, orduriers, et cette vulgarité constitue aussi comme un soubassement, puisqu'elle enrobe l'intention ayant présidé à la naissance de l’œuvre : la critique du catholicisme, du moins, d'un certain catholicisme rigoriste et tartuffe, traîné dans la boue et la merde, la critique du nationalisme, de tous les nationalismes, la critique de la guerre civile, la critique des fanatismes. Avouons que Lydie Salvayre s'est donné le beau rôle, n'est-ce pas ? Cerise sur le flan pas même correctement moulé, cette intention critique prétend s'inscrire sur les brisées de Georges Bernanos pour servir de miroir, disent les publicistes, aux dérives de notre franchouillarde société française, n'aimant pas le révolutionnaire, portant hauts ses légendaires cojones comme des ergots reposant sur le fumier et droite sa peur de la nouveauté et de la différence, les nouvelles mamelles de la Modernité.Les grands lecteurs qui ont salué ce roman tout au plus lisible affirmeront que je commets un contresens majeur, puisque, après tout, Lydie Salvayre a pu ne vouloir que mettre en scène le vocabulaire grossier des campesinos, plus sûrement des catetos dont elle peint la soudaine révolte aiguillonnée par les idées communistes et anarchistes, ainsi que leur haine de la hiérarchie catholique espagnole, du curé jusqu'au Bon Dieu en passant par les bonnes sœurs, violées avec une charité toute particulière, inspirée dirons-nous.
Cette vulgarité, de fait, est incarnée dans sa bassesse blasphématoire par ce Notre Père ordurier : «Puto Nuestro que estás en el cielo, Cornudo sea tu nombre, Venga a nosotros tu follón, Danos nuestra puta cada día, y déjanos caer en tentación...» (p. 42). Cette vulgarité est le jus dans lequel semblent infuser presque toutes les phrases, par ailleurs si pauvres d'un point de vue stylistique, de Pas pleurer : «crucifix enfoncé dans le cul» (p. 44), dont l'antithétique version, espagnole et conservatrice, nous est aimablement offerte par «Yo la revolución me la pongo en el culo» (p. 46), le reste étant du même tonneau ou tube avec «entuber» (p. 55), l'attendu et de fait présent «Que le den por culo !» (p. 74), Lydie Salvayre parvenant fort heureusement à nous faire entrevoir l'envers du décor, le gland après le cul grâce «aux bons offices d'un âne pour se faire sucer la bite» (p. 77), appelée, ailleurs (p. 85), une fois qu'une bouche féminine aura avantageusement remplacé une gueule animale, «grosse queue», sans oublier la présence logique, au milieu de cette orgie festive, des «cabrones» (p. 56), la joie nihiliste s'étendant à tout le continent, «l'Europe [faisant] dans son froc à l'idée d'une révolution» (p. 59), «toute l'Europe catholique ferm[ant] sa gueule» (p. 70), tout cet étalage d'attributs féminins ou virils ne pouvant que faire se dresser la seule question valable, qui apparaît dans le roman comme les lettres de feu sous les yeux de Nabuchodonosor : «il se la touche ou quoi» (p. 60), ou bien encore «Qui est assez con pour croire qu'on puisse se passer d'un chef à grosses couilles» (p. 63), et, dans sa version castillane qui épargnera une fois de plus un sérieux travail au futur traducteur, l'«hombre con huevos» (p. 64 : littéralement, les œufs), d'aimables et martiaux «putain, je vais lui péter la gueule» (p. 65), l'un des personnages principaux, un peu trop roux pour les paysans du village, étant fort logiquement, au milieu de tant de soucis politiques et phalliques, un «enculé» (p. 73), la morne litanie de l'ordure graveleuse s'étendant sur le reste des pages de notre roman, mais l'acmé de l'insignifiance pas même vulgaire mais ordinaire (como se dice de una mujer que es ordinaria, Lydie) résidant peut-être, tout de même, à la page 118, où Lydie Salvayre évoque par le menu, si je puis dire, les différences subtiles entre les odeurs et mélodies des pets féminins et des pets masculins provoqués par les fameux garbanzos consommés à haute dose dans cette contrée reculée, arriérée, bien évidemment profondément phallocrate, qu'est l'Espagne de 1936 dont l'atmosphère qui plus est, on le suppose du moins, devait sentir fort mauvais à cause de tous ces dégazages intestinaux faisant une tranquille concurrence aux pourrissantes carcasses humaines jetées dans des fosses.
Les lecteurs rigoureux, dont l'ami Sébastien Lapaque, pourtant fin connaisseur de l’œuvre de Bernanos, ayant salué comme tant d'autres pigistes et sous-pigistes les hautes qualités littéraires du roman de Lydie Salvayre, affirmeront que je me scandalise de bien peu et que j'adopte, après tout, la position pour le moins louche qui est celle de l'un des personnages féminins du roman, doña Pura (au patronyme transparent), dans laquelle, bien évidemment, comme nous y autorise la ridicule quatrième de couverture du roman affirmant que la vision de Lydie Salvayre résonne «étrangement avec notre présent», nous ne pouvons que voir le portrait se voulant assassin et qui n'est que ridicule, d'une catholique engoncée dans sa macération et secrètement travaillée par l'unique envie paraît-il interdite par l’Église, le sexe bien sûr. Ainsi, il est clair aux yeux perçants de Lydie Salvayre que la charité de doña Pura ne peut qu'être éminemment trouble : «Car doña Pura aimait à soulager la misère des pauvres, activité qui constituait une excellent diversion, je dirais même un dérivatif puissant à ses perfides autant qu'innombrables indispositions, innombrables (1) tant dans leur expression que dans la nature des organes affectés, avec une prédominance nette des organes sis dans la sphère génito-urinaire» (pp. 87-8), Lydie Salvayre, qui cite tout de même Georges Bernanos, ayant dû lire une ou deux lignes de Léon Bloy et utilisant l'un de ses mots préférés quelques lignes plus loin : «autant de missions qui servaient d'émonctoire à ses prurits intimes et à ses ardeurs libidinales douloureusement rabrouées» (p. 88). C'est d'ailleurs à propos de cette caricature honteuse de catholique mal baisée que Lydie Salvayre nous fait part de sa science gynécologique en écrivant : «mais la pauvrette avait bien des excuses : elle n'avait jamais baisé y su chocho estaba sequito como una nuez» (p. 90; cette même délicatesse est répétée à la page 205). A croire que la pauvre Lydie Salvayre, en matière de sexualité féminine, s'y connaît aussi lamentablement qu'en écriture, puisque ce sont les plus impavides ogresses sexuelles qui, presque toujours et pour la raison que jamais leur appétit n'est rassasié, éprouvent les irritations d'une sécheresse passagère frappant leur outil de travail, qui du coup, malchance, se grippe, le plus intime. Passons, car je redeviens vulgaire et je ne dois pas oublier que je suis lu par de belles âmes ayant été touchées par la pureté d'âme dont Lydie Salvayre, incontestablement, fait montre dans son roman goncourisable et goncourisé.
Ce qui nous irrite n'est pas franchement la sécheresse stylistique de Lydie Salvayre qui, tout du moins en matière d'écriture, ni blanche comme des pertes ni rose mais d'une couleur limoneuse bien plus suspecte, répand quelques hectolitres d'ordures et de fadaises consensuelles.
Entendons-nous bien. La vulgarité, y compris en matière sexuelle, ne me choque ni ne m'émeut, je ne l'attends pas ni ne demande à la sentir comme l'absente de tout bouquet et, absente justement, je ne me désole pas de sa disparition. Lorsqu'elle est évoquée dans une écriture digne de ce nom, elle me fait bien davantage rire, comme c'est le cas dans La Chair de Serge Rivron. Me gêne davantage, m'incommode même franchement le fait que, dans le roman de Lydie Salvayre, cette vulgarité phagocyte absolument tout, les rares parties saines de l'organisme, disons les deux dernières parties du roman, comme un cancer pressé de dévorer la chair pour la transformer en matière noire, morte, pourrie, puante. En somme, et pour le dire vulgairement, d'une vulgarité qui ne pourra que réjouir notre auteuse (pardonnez-moi cette horreur, je deviens vulgaire à mon tour), Chie pas juste qui veut, comme l'écrivait le grand Céline, dont la vulgarité, du moins incarnée dans ses livres, est proverbiale et ravageuse, et irrésistiblement drôle, non parce qu'elle atteindrait à une fosse d'aisance plus profonde que toutes celles qui ont été creusées avant ou après lui (par exemple par Rabelais, Pierre Guyotat ou, en Espagne, Francisco Quevedo), mais parce que, tout simplement, elle était portée, servie, achalandée si je puis dire par une écriture digne de ce nom et même, une écriture géniale, une invention linguistique et stylistique prodigieuse. En lieu et place de génie ou même, simplement, de talent, Lydie Salvayre tente d'expliquer (de justifier ?) cette vulgarité qu'elle nous a fait renifler malgré notre sinusite surinfectée en évoquant les troubles mentaux de sa mère (cf. p. 82)...
Ainsi abordons-nous le deuxième reproche, bien plus essentiel que le premier, que tout lecteur est en droit d'adresser au lamentable roman de Lydie Salvayre : la pauvreté absolue de son écriture. La merde étalée à toutes les pages ou presque finit non seulement par sentir mauvais mais par dégoûter le plus coprophile des lecteurs, alors que la merde, transcendée par une écriture jubilatoire, accède à la ferveur mystique tant de fois évoquée par un Léon Bloy.
Nous pourrions illustrer de bien des façons l'absolue platitude de l'écriture de Lydie Salvayre, mais nous nous bornerons à évoquer deux de ses aspects : la pauvreté de son invention verbale, lorsqu'il s'agit de créer une langue, ou plutôt, un idiome à cheval entre le français et l'espagnol, puis la pauvreté réellement étique de deux ou trois procédés stylistiques déparant certains de ses dialogues au style indirect, censés, du moins je le suppose, conforter la langue «joyeusement malmenée» qu'évoque, ridiculement, la quatrième de couverture.
Me permettra-t-on une anecdote ? Ma mère a commencé à apprendre le français lorsqu'elle est arrivée en France, après avoir suivi celui qui allait devenir son mari quelques années plus tard, mon père. Elle n'avait alors que 18 ou 19 ans. Je connais donc par cœur, m'en agace tout autant que j'y suis attaché depuis mon enfance, l'espèce d'idiome dans lequel elle s'exprime, surtout lorsqu'elle se montre agacée ou émue, étrange mélange de mots français ressemblant à l'espagnol et de mots espagnols littéralement traduits en français, de phrases commencées dans une langue et finies dans une autre. Je précise que cet idiome a été lissé si je puis dire, au fil des années, et que ma mère s'exprime depuis longtemps tout de même dans un français digne d'être salué par Pierre Assouline, qui n'a pas craint de récompenser celui de Lydie Salvayre. Lisant donc le pidgin (pardon ! le frañol) faussement savant dans lequel notre romancière sans talent fait s'exprimer sa mère, je n'y ai absolument pas reconnu celui de ma mère, preuve que son invention est artificielle et pas même crédible, preuve que son invention ne parvient pas à transcender des contingences purement particulières. Voulant sans doute faire sourire, voire rire son lecteur, Lydie Salvayre atteint un grotesque involontaire qui se retourne contre elle. Prenons un exemple qui vaudra mieux que bien des explications : «Alors quand on se retrouve en la rue, je me mets à griter (moi : à crier), à crier» (p. 13) ou bien «Tu l'as comprendi ma chérie, me dit ma mère» (p. 86). L'invention verbale est ici proche du degré zéro qui parvient à congeler même le plus bienveillant des lecteurs, puisqu'il ne s'agit dans ces deux cas, déclinés tout au long du roman («hablent», p. 116, pour parler, provenant de l'espagnol «hablar», «romper» à la même page pour rompre), que d'adapter un verbe espagnol (gritar pour crier, comprender pour comprendre, ou encore, p. 79, permitir pour permettre) en le francisant grossièrement. Cet effet, comme une escopette antédiluvienne, ne peut tirer qu'un seul coup, là où Lydie Salvayre nous troue de rafales, sans compter le fait que ce procédé grossier de calque fait de sa mère une imbécile bien davantage qu'une pauvre immigrée éprouvant des difficultés à s'exprimer dans une langue qui n'est si visiblement pas la sienne et ne le sera jamais. Pour ne pas être accusés de ne citer qu'un seul procédé stylistique et ainsi d'appauvrir volontairement la richesse de l'écriture de notre romanceuse (la vulgarité, derechef), accordons à Lydie Salvayre qu'elle procède à ce type de calque expéditif et convenu en l'adaptant à des noms, c
10/09/2016 | Lien permanent
Sérotonine : et Michel Labrouste niqua (mollement) Florent-Claude Houellebecq

 Michel Houellebecq dans la Zone.
Michel Houellebecq dans la Zone. Banal romancier ayant tiré de sa banalité corrosive une petite entreprise florissante et décalqueur remarquable, Michel Houellebecq est parvenu, au bout de son septième roman aussi surprenant qu'une pénéplaine belge, à nuancer à la marge l'équation implacable à laquelle Marc-Edouard Nabe avait réduit notre gloire littéraire nationale et même internationale, pauvre homme connaissant le tout-Paris, dans son Vingt-Septième Livre où il écrivait de façon lapidaire : «Roman à thèse + écriture plate + athéisme revendiqué + critique de son temps (mais pas trop) + culture rock-pop + défense du capitalisme + attaque des Arabes = succès garanti». La nuance de gris que Houellebecq est parvenu, au bout de son morne et «laborieux best-seller de la glauquitude qui se la joue grand écrivain maudit» (Nabe encore, extrait du Tract du 23 novembre 2006 intitulé Et Littell niqua Angot) concerne l'athéisme revendiqué de l'auteur qui ne cesse plus vraiment de tourner autour de la religion, comme je l'avais amplement montré dans ma critique de Soumission. Il est vrai aussi, nous disent les journalistes, que la critique du libéralisme, surtout lorsqu'il est diligemment relayé par l'Union européenne, est de plus en plus de mise dans ses romans, jusqu'à faire paraître ces derniers, nous disent encore nos fins lecteurs, comme des critiques implacables de notre société marchande arraisonnant tout ce qui n'est pas marché, soumettant comme il se doit les dernières forces d'opposition encore libre (quelque désespéré qui n'hésitera plus à faire le coup de feu contre l’État et ses représentants) à la seule logique dudit marché. Peut-être Nabe a-t-il mal lu Houellebecq pour dire qu'il défend dans ses romans le capitalisme, à moins qu'il ne l'ait trop bien lu bien au contraire, chacun des livres de Houellebecq étant un succès de librairie, Sérotonine ne faisant pas exception, bien au contraire, l'auteur nous apparaissant dès lors comme un faux adversaire du capitalisme, dont il profite largement et même dont il illustre remarquablement telle maxime lâchée par son propre personnage : «l'argent allait à l'argent et accompagnait le pouvoir, tel était le dernier mot de l'organisation sociale» (p. 135).
Banal romancier ayant tiré de sa banalité corrosive une petite entreprise florissante et décalqueur remarquable, Michel Houellebecq est parvenu, au bout de son septième roman aussi surprenant qu'une pénéplaine belge, à nuancer à la marge l'équation implacable à laquelle Marc-Edouard Nabe avait réduit notre gloire littéraire nationale et même internationale, pauvre homme connaissant le tout-Paris, dans son Vingt-Septième Livre où il écrivait de façon lapidaire : «Roman à thèse + écriture plate + athéisme revendiqué + critique de son temps (mais pas trop) + culture rock-pop + défense du capitalisme + attaque des Arabes = succès garanti». La nuance de gris que Houellebecq est parvenu, au bout de son morne et «laborieux best-seller de la glauquitude qui se la joue grand écrivain maudit» (Nabe encore, extrait du Tract du 23 novembre 2006 intitulé Et Littell niqua Angot) concerne l'athéisme revendiqué de l'auteur qui ne cesse plus vraiment de tourner autour de la religion, comme je l'avais amplement montré dans ma critique de Soumission. Il est vrai aussi, nous disent les journalistes, que la critique du libéralisme, surtout lorsqu'il est diligemment relayé par l'Union européenne, est de plus en plus de mise dans ses romans, jusqu'à faire paraître ces derniers, nous disent encore nos fins lecteurs, comme des critiques implacables de notre société marchande arraisonnant tout ce qui n'est pas marché, soumettant comme il se doit les dernières forces d'opposition encore libre (quelque désespéré qui n'hésitera plus à faire le coup de feu contre l’État et ses représentants) à la seule logique dudit marché. Peut-être Nabe a-t-il mal lu Houellebecq pour dire qu'il défend dans ses romans le capitalisme, à moins qu'il ne l'ait trop bien lu bien au contraire, chacun des livres de Houellebecq étant un succès de librairie, Sérotonine ne faisant pas exception, bien au contraire, l'auteur nous apparaissant dès lors comme un faux adversaire du capitalisme, dont il profite largement et même dont il illustre remarquablement telle maxime lâchée par son propre personnage : «l'argent allait à l'argent et accompagnait le pouvoir, tel était le dernier mot de l'organisation sociale» (p. 135).Je veux bien que l'on tente de nous présenter Michel Houellebecq comme une sorte de prophète, et, même, une espèce de maître du Haut-Château qui nous dirait, depuis quelque recoin invisible d'une réalité seconde trouant la nôtre, répugnante, la vérité éminente de cette dernière, à savoir, comme dans le grand roman de Dick : le monde dans lequel tu vis, pauvre imbécile, est non seulement atroce mais absolument faux, mais il faudrait alors imaginer le cas curieux d'un prophète qui ne serait pas obligé de quitter sa demeure, de courir les routes de son pays où chaque gamin serait autorisé à lui lancer une pierre, en somme un prophète reçu, célébré, écouté, dont la parole de feu serait exposée en tous lieux publicitaires, de l'entrée des grandes surfaces jusqu'aux librairies, qui elles aussi ne sont le plus souvent que des grandes surfaces, voire des hypermarchés à patine intellectuelle.
Dans Sérotonine justement, Dieu, la religion, la foi ou plutôt, la possibilité de la foi ne sont plus frontalement abordés comme ils l'étaient dans le précédent roman, où Houellebecq s'inspirait, pour le dire poliment, de Huysmans, mais prudemment quand même, en réutilisant le seul Durtal (ou même, ai-je écrit ailleurs, Folantin) qui l'intéresse, celui qui jamais ne parvient à se mettre en route et peste contre la vie moderne, par exemple, mais c'est le cas du dernier avatar de Durtal, Florent-Claude Labrouste, contre l'interdiction de fumer dans les chambres d'hôtel. Léon Bloy a dit, contre celui qui fut un temps son ami et, par avance en somme, contre celui qui est son si visible et si peu original surgeon, tout ce qu'il fallait dire pour que nous ne nous répétions pas.
Cette dilution de la thématique principale des textes de Houellebecq, bien avant l'exposition jubilatoire, désormais réduite à un sempiternel tour de piste, du clown délabré et haineux qu'est devenu l'homme occidental, bien avant encore l'évocation, souvent fort juste, drôle et même réjouissante, de la laideur consumériste qui menace de nous submerger une fois pour toute, s'explique peut-être par le curieux tropisme que l'on a vite fait de remarquer dans Sérotonine : Michel Houellebecq, après Huysmans, semble avoir décidé de s'inspirer comme il se doit librement de Marcel Proust (qu'il moque d'ailleurs à la fin de son roman), ainsi que le montre l'exemple de telle fort longue phrase s'étendant des pages 32 à 34 du roman, passage commençant par «Un simple gaijin comme moi» et se concluant, une fois le robinet de mélasse heureusement fermé, et les groupes de mots simplement séparés par des virgules hâtives vous laissant une impression de discussion de comptoir, par «un réfugié somalien», exemple à vrai dire point unique dans notre roman (cf. p. 198 pour un autre exemple de proustisme aigu) mais qui a l'avantage de condenser non seulement l'ensemble ou peu s'en faut des thèmes prisés par l'auteur mais nous met sous le regard un magnifique débraillé stylistique.
Ce débraillé, je tiens tout de suite à le préciser, est la marque de fabrique de Michel Houellebecq et, comme telle, lui rapporte de copieuses royalties, et même la considération de bon nombre de journalistes parisiens, les autres, ceux de la province ou de la France périphérique, calquant prudemment leurs banalités sur celles émises par leurs prestigieux confrères : qu'on l'aime ou pas, Michel Houellebecq semble avoir accédé au statut réellement mystérieux, peut-être même miraculeux, de l'augure, du prophète. S'aviserait-on de critiquer la langue dans laquelle un prophète non seulement annonce le futur, mais révèle sous nos yeux le gouffre sur lequel nous avons bâti notre chimérique société ?
Non, donc, que ce débraillé nuise à l'écriture de Houellebecq, puisque l'écriture houellebequienne est, justement, ce débraillé, les lecteurs sortant de khâgne parlant, sans beaucoup d'imagination, de mise en abyme, sotte figure de style diluée à toutes les sauces et qui permet, presque toujours, de sauver les plats les plus indigents du haut-le-cœur : puisque l'auteur décrit un héros et une société, la nôtre, en phase terminale de dissolution, il est bien normal après tout que l'écriture chargée de planter ce décor pour le moins instable perde elle-même le peu de tenue qui la caractérisait jusqu'alors. De la même façon, ce débraillé accroît la drôlerie de certaines scènes et descriptions; je précise qu'il n'est pas tellement drôle de lire Michel Houellebecq évoquer, à propos de Yuzu, son coupable manque d'entrain pour la figure bien connue de la gorge profonde, alors qu'elle se montre experte «en particulier dans le domaine crucial de la pipe», puisqu'elle lèche «le gland avec application sans jamais perdre de vue l'existence des couilles», sa lacune étant due à «la petite taille de sa bouche» même si, concède le narrateur beau joueur, la gorge profonde n'était à ses yeux «qu'une obsession de maniaques minoritaires» car, «si l'on veut que sa bite soit entièrement entourée de chair eh bien il y a tout simplement la chatte, elle est faite pour ça, la supériorité de la bouche, qui est la langue, se voit de toute façon annulée dans l'univers clos de la gorge profonde» (1). Ce genre de passages, qu'il s'agisse de descriptions crues, de mémorables sentences à graver sur l'émail jauni d'un urinoir public («je ne nourrissais aucune ambition particulière à l'égard de ma bite, il suffisait qu'on l'aime et je l'aimerais moi aussi, voilà où j'en étais par rapport à ma bite», p. 75) ou de franches insultes jetées aux femmes, quand il ne s'agit pas de scènes tout franchement dégradantes avec de sympathiques chiens bien désorientés et on les comprend, de «besogner» dans une «chatte [de] femme [qui] doit présenter de notables différences avec celle de la chienne» (p. 54) même si la différence est souvent ténue, aux yeux du romancier, entre les chiennes et les femmes (2), mais aussi franches insultes jetées aux homosexuels traités, encore fort banalement, de pédés, ce genre de passages donc, pour le moins si nombreux dans le roman de Michel Houellebecq qu'ils nous semblent en constituer toute la trame, ne sont pas tant drôles en eux-mêmes que parce que nous imaginons parfaitement le visage consterné, la moue de dégoût même, qui sait, que feront certaines lectrices (et aussi, sans doute, lecteurs), point n'est besoin de les imaginer femelles féministes, refermant aussitôt l'ouvrage qui leur aura pourtant été recommandé par la réclame publicitaire et s'indignant de colère, ou faisant mine de s'indigner devant tant de vulgarité.
Il faut aussi noter que Sérotonine, du moins à l'exception de cette première longue partie si nettement sexuée, et même sexuelle voire franchement pornographique, se lit sans véritable déplaisir, Houellebecq semblant avoir saisi le véritable centre de gravité de son histoire, non pas ses vues sur la féminité, que l'errance existentielle et même ontologique de son héros, le récit de l'ancien amant de Yuzu se concentrant alors, après l'éviction de cette dernière, sur le personnage principal, concentration pour le moins paradoxale puisqu'elle évoque sa longue et morne dissolution dans un pays, le nôtre, peint avec un réalisme cru et qui n'a pu saisir de stupeur que les sots journalistiques qui nous ont resservi, pour la millième fois, l'antienne du visionnaire à propos d'un auteur qui semble avoir anticipé le désespoir des Gilets Jaunes, du moins chez leurs représentants paysans.
C'est finalement moins la maigreur de quelques épisodes (comme celui du pédophile allemand surpris sur le fait, son vague projet de tuer le fils de son ancienne maîtresse, Camille) que traverse, sans réelle pesanteur Florent-Claude Labrouste, que sa déambulation hagarde dont le centre d'attraction reste Paris quoi qu'il fasse pour le fuir, et plus particulièrement sa très proche et très laide banlieue, qui retient notre attention, car cette descente, non point aux Enfers mais aux Limbes, mime les étapes ridicules d'une véritable catabase clownesque quelque peu atténuée par les références, directes ou pas, à Lamartine et à Baudelaire (3) mais aussi à une multitude de marques que l'on peut considérer, au choix, comme un tragique manque de puissance imaginative ou bien comme la consternante déliquescence d'un langage devenu entièrement publicitaire, l'adhérence au monde du narrateur, comme il le concède lui-même, n'étant que limitée puis «peu à peu deven[ant] nulle, jusqu'à ce que plus rien ne puisse interrompre le glissement» (p. 278).
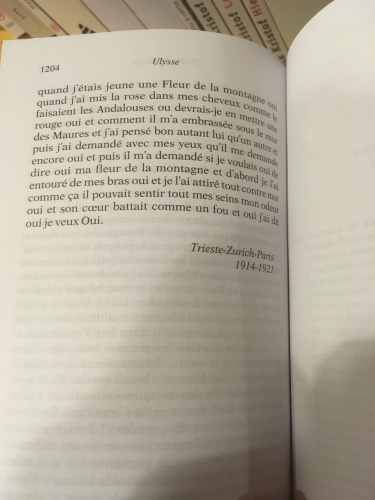 Ce glissement est saisissant dans son inéluctabilité même, mais après tout elle est fort logique car, si Sébastien Lapaque a cru voir, dans la toute dernière ligne du roman de Michel Houellebecq, une référence au moins implicite aux tous derniers mots de Joyce, c'est au Wakefield d'Hawthorne que j'ai songé pour ma part, le narrateur du romancier ne faisant finalement rien d'autre que déserter systématiquement les lieux où il vit, tout comme il aura abandonné chacune des femmes qui semblent avoir compté pour lui, Kate ou Camille.
Ce glissement est saisissant dans son inéluctabilité même, mais après tout elle est fort logique car, si Sébastien Lapaque a cru voir, dans la toute dernière ligne du roman de Michel Houellebecq, une référence au moins implicite aux tous derniers mots de Joyce, c'est au Wakefield d'Hawthorne que j'ai songé pour ma part, le narrateur du romancier ne faisant finalement rien d'autre que déserter systématiquement les lieux où il vit, tout comme il aura abandonné chacune des femmes qui semblent avoir compté pour lui, Kate ou Camille.Pas davantage que ces étapes ou ces non-étapes, la fin ne peut nous surprendre qui, nous apprend-elle, a fait pleurer telle idiote journalistique paraît-il spécialiste de questions féministes et d'humour de quinzième degré en situation d'attentat, ce qui ne lui était pas arrivé, affirme-t-elle encore, depuis sa lecture de Dostoïevski. Cette fin, consacrant la retombée de la trajectoire narrative qui du reste ne s'est jamais vraiment élevée, à savoir la seule chose que peut «proposer la social-démocratie», «juste une perpétuation du manque, un appel à l'oubli» (p. 159), est bien évidemment logique, la logique étant du reste la maîtresse que Michel Houellebecq semble toujours le plus disposé à suivre, où qu'elle le conduise c'est-à-dire nulle part, non-lieu où s'acheminent chacune de ses histoires. En voilà une, la logique, que ni Florent-Claude Houellebecq ni Michel Labrouste n'ont plantée au beau milieu d'une partie fine, y compris avec des membres fort serviables de la gente canine ! Elle est logique puisque Michel Houellebecq aura figuré, dans chacun de ses romans ou presque, le parcours sans cesse différé, comme un ébranlement initial qui est incapable de courir plus de quelques mètres sans faire immédiatement usage de tout un tas de moyens de secours et d'expédients, vers une foi qu'il suppose refusée, qui en tout cas ne lui semble pas accordée, mais qu'il se refuse en tous les cas à ne pas tenter de continuer à chercher, le sort, qu'il moque, d'un Conan Doyle qui, indécrottablement matérialiste, s'orienta néanmoins, au soir de sa vie et après bien des épreuves, vers le spiritisme (cf. p. 336), n'étant apparemment pas digne de celui qui, quand bien même il fût incapable d'adhérer à la chrétienté, est persuadé que toute chose ayant eu lieu «avait lieu pour l'éternité», mais que cette éternité n'en était pas moins, pour lui en tout cas, «fermée, inaccessible» (p. 338).
Plus d'un journaliste, si piètre lecteur, a pu trouver étonnante, voire incompréhensible, la dernière page; nous savons même qu'une pécore inculte a pleuré en la lisant, puisqu'elle s'est empressée de nous l'apprendre urbi et orbi. Cette dernière page n'est étonnante que pour celles et ceux qui ne savent pas lire, Houellebecq comme tant d'autres, car ce qu'il nous propose, ni plus ni moins, c'est un Christ à notre image, un Christ de pacotille, un minable, qui donnera sa vie pour d'autres minables, autrement dit Florent-Claude Labrouste qui, par son suicide plus que probable, paiera pour ses semblables.
Voilà un signe extrêmement clair de tromperie sur la marchandise et nous ne pouvons qu'être à notre tour agacé, comme le Christ selon Houellebecq, par l'endurcissement des esprits bien davantage que des cœurs devant cette évidence que nous jette ce romancier qui, décidément, a décidé de nous planter (et je reste bien évidemment poli, mais le fond de ma pensée est livré dès le titre, on l'aura compris décalque de celui de Nabe, de cette note), nous, ses lecteurs, et de faire une fois de plus sécession, reprenant d'une certaine façon le cri de Dieu tel que l'imagina Léon Bloy, et nous hurlant que si nous avons besoin du Christ, nous n'avons qu'à aller le chercher dans les ordures, autrement dit à nous débrouiller en imaginant que le pâle, le raté, le désespéré Florent-Claude Labrouste, ce semblable, notre frère glousseront tous les admirateurs de Houellebecq qui, bien qu'eux-mêmes ratés, n'ont pas son compte en banque, pourra faire quoi que ce soit pour nous, et même nous racheter.
Notes
(1) Michel Houellebecq, Sérotonine (Flammarion, 2018). Toutes les pages indiquées entre parenthèses renvoient à notre édition et les italiques, sauf mention contraire, sont de l'auteur.
(2) «Chez les naturalistes il y a, comme chez les empailleurs, une impuissance congénitale à différencier la femme de la femelle», écrivait, significativement, Léon Bloy. Voir la note que j'ai rappelée plus haut. Houellebecq, en héritier tourmenté des naturalistes, a décidé de tirer toutes les conséquences de cette identité commune.
(3) Agathe Novak-Lechevalier a dit beaucoup de choses justes sur ces deux auteurs que Michel Houellebecq connaît parfaitement.
20/01/2019 | Lien permanent
Le Grand d'Espagne de Roger Nimier
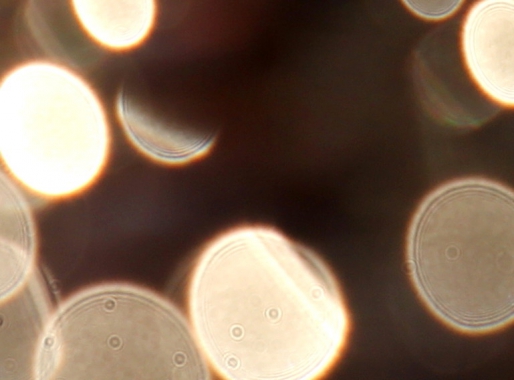
 Mâles lectures
Mâles lectures Georges Bernanos dans la Zone
Georges Bernanos dans la Zone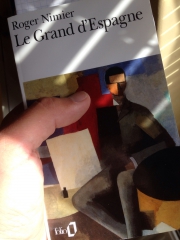 Tout grand livre naît du désespoir, mais du désespoir qui a été surmonté. S'il ne fallait citer qu'un seul roman qui me vient immédiatement à l'esprit, j'avancerais le labyrinthique et faustien Sous le volcan de Malcolm Lowry, ce livre dans le cratère duquel il est difficile de ne pas tomber, une fois qu'on s'est approché, imprudemment, de ses rebords. S'adressant, à 25 ans seulement, à celui qui, du désespoir, a offert l'une des explorations littéraires les plus profondes et fascinantes, Georges Bernanos, Roger Nimier ne pouvait que prétendre qu'il «faut savoir désespérer jusqu'au bout» (1) avant d'écrire comme un homme se jette dans un dernier sursaut de courage sur l'ennemi en surnombre qui l'encercle. Il mourra bien sûr, mais il se sera battu. Nous, nous mourrons, nous sommes en fait déjà morts. Mais contre qui nous sommes-nous battus, si ce n'est, dans ce pays vidé de sa substance, écouillé par des décennies de socialisme, de gauchisme, de féminisme, de véganisme, de structuralisme, d'humanisme intégral et autres fariboles devant tout au soi-disant modernisme, contre des pleutres, des Homais cramponnés à leurs places comme une sangsue à la peau qu'elle suce ? Parler d'humanisme intégral et de monde privé de sa force me fait penser à cette méchanceté de Georges Bernanos contre Maritain, dans une lettre à l'abbé Sudre datant du mois d'août 1927 : «Admirable parmi les abstractions, sitôt qu'il rencontre l'homme, on le voit plier ses reins. Pourquoi diable rêve-t-il d'une influence directe et personnelle ? Sa prise sur les consciences est nulle. Aucun sens de l'honneur» (in Correspondance inédite 1904 - 1934 Combat pour la vérité, Plon, 1971, p. 310). Aucun sens de l'honneur, voici la phrase qui caractérise le mieux notre époque devenue flache, et le comportement de tous les têtards qui y barbotent. Puis désespérer suppose de posséder encore un idéal, et je crains que le Français, de nos jours, non seulement n'en possède plus, si ce n'est de ne point se retrouver relégués dans une banlieue malfamée ou de rater leur soirée de match de football, mais ne soupçonne aussi de commettre quelque faute de goût en employant ce mot.
Tout grand livre naît du désespoir, mais du désespoir qui a été surmonté. S'il ne fallait citer qu'un seul roman qui me vient immédiatement à l'esprit, j'avancerais le labyrinthique et faustien Sous le volcan de Malcolm Lowry, ce livre dans le cratère duquel il est difficile de ne pas tomber, une fois qu'on s'est approché, imprudemment, de ses rebords. S'adressant, à 25 ans seulement, à celui qui, du désespoir, a offert l'une des explorations littéraires les plus profondes et fascinantes, Georges Bernanos, Roger Nimier ne pouvait que prétendre qu'il «faut savoir désespérer jusqu'au bout» (1) avant d'écrire comme un homme se jette dans un dernier sursaut de courage sur l'ennemi en surnombre qui l'encercle. Il mourra bien sûr, mais il se sera battu. Nous, nous mourrons, nous sommes en fait déjà morts. Mais contre qui nous sommes-nous battus, si ce n'est, dans ce pays vidé de sa substance, écouillé par des décennies de socialisme, de gauchisme, de féminisme, de véganisme, de structuralisme, d'humanisme intégral et autres fariboles devant tout au soi-disant modernisme, contre des pleutres, des Homais cramponnés à leurs places comme une sangsue à la peau qu'elle suce ? Parler d'humanisme intégral et de monde privé de sa force me fait penser à cette méchanceté de Georges Bernanos contre Maritain, dans une lettre à l'abbé Sudre datant du mois d'août 1927 : «Admirable parmi les abstractions, sitôt qu'il rencontre l'homme, on le voit plier ses reins. Pourquoi diable rêve-t-il d'une influence directe et personnelle ? Sa prise sur les consciences est nulle. Aucun sens de l'honneur» (in Correspondance inédite 1904 - 1934 Combat pour la vérité, Plon, 1971, p. 310). Aucun sens de l'honneur, voici la phrase qui caractérise le mieux notre époque devenue flache, et le comportement de tous les têtards qui y barbotent. Puis désespérer suppose de posséder encore un idéal, et je crains que le Français, de nos jours, non seulement n'en possède plus, si ce n'est de ne point se retrouver relégués dans une banlieue malfamée ou de rater leur soirée de match de football, mais ne soupçonne aussi de commettre quelque faute de goût en employant ce mot.Et puis, pour le dire simplement : il est impossible, du moins en littérature, de parvenir à se figurer ce que pourrait signifier une passation de pouvoirs, pour ainsi dire, entre représentants de différentes générations. Il n'y a plus de générations, le jeune crache sur le vieux, le gifle (du moins, prétend le gifler) et, de toute manière, le népotisme qui caractérise la vie intellectuelle parisienne (donc française, hélas) est un universalisme de la médiocrité : pas de différences établies sur des normes aussi ringardes que l'identité sexuelle, l'histoire personnelle, l'intelligence, le talent, l'âge même, le pays dans lequel nous vivons, fidèle à sa tradition d'avance sur le reste du monde, a inventé l'infernal remugle, la partouse pour le coup intégrale que Dalibor Frioux a cauchemardés dans son terrifiant Incident voyageurs.
C'est donc de plus d'une façon qu'un livre comme Le Grand d'Espagne est tout bonnement inconcevable de nos jours : par manque de talent, par absence de hardiesse, par intumescence prodigieuse d'inculture, de vulgarité, de bassesse, de médiocrité, et puis parce que tout le monde se contrefiche de saluer ce qui nous a précédés et qui, pour le dire point trop désobligeamment, est presque toujours plus grand que nous ne sommes.
Imaginons, de nos jours, un jeune premier, une jeune première refaisant le beau geste, après tout simple, point trop inouï ni même surhumain, d'Arthur Rimbaud saluant le prince Charles Baudelaire, ou de Roger Nimier envers son aîné, et s'adressant à... S'adressant à qui, au fait ? S'adressant aux guerriers de papier que sont Renaud Camus ou Richard Millet, ces Charles Martel en guimauve ? S'adressant au pédophile revendiqué, à coloration vaguement réactionnaire plaisant aux vieilles carnes, qu'est Gabriel Matzneff ? Certains de ces moitrinaires, pour reprendre le mot génial que Léon Daudet réserva pour une caste bien particulière d'impuissants, les impuissants à miroir, peuvent en tout cas revendiquer le rôle d'inspirateur de la jeunesse au vu de leur âge plus que respectable, un rôle que Gab la Rafale prend, lui, au pied de la lettre, même si, au passage, il aura quelque peu défiguré le début du mot inspirateur. Même Nabe, paraît-il, ne dédaigne pas de recevoir son lot d'enveloppes cachetées à la cyprine de bécasse antisémite, où il flaire paraît-il les fragrances vite éventées de son talent de polémiste gentiment bloyen. Nous avons donc nos muses, assurément, des muses à la hauteur de notre horizontalité sous-littéraire, même si elles sont parfaitement ridicules et saponifiées dans une comique suffisance, ou bien bronzées, comme le presque centenaire Jean d'Ormesson, au néon de la gloriole, qui ne provoque hélas pas d'expéditif cancer de la peau. Nos muses, quelque peu replâtrées pour l'exposition dans les librairies et sur les plateaux d'émissions télévisées sont nombreuses, bien que peu originales. Mais que pourrions-nous leur dire qui, sans être inoubliable, s'élève quelque peu au-dessus de l'exercice où une bouche de peu de talent mais pourvue d'une langue longue et admirablement souple prononce quelques mots à des pavillons auriculaires cimentés par le cérumen de la prétention et de l'insignifiance ?
J'ai lu le premier état du manuscrit de Georges Bernanos encore une fois où Sébastien Lapaque, crânement, avait imaginé une série de lettres qu'il eût pu adresser au romancier du mal et de la grâce, mais cet artifice, volonté de l'auteur ou de son éditeur Olivier Véron je ne sais, ne tint pas le choc ni même debout, et fut donc abandonné. Comme si, en fait, nous n'avions plus le courage, assurément simple, d'oser nous adresser à un homme qui, aussi imparfait et faillible qu'on le voudra, n'en demeure pas moins un modèle, ou encore, comme si ce geste, que la littérature des siècles passés a illustré de bien des remarquables manières, ne pouvait plus, de nos jours, qu'être une plaisanterie de potache qui, dans le meilleur des cas, sera jugée par ses professeurs d'un trait rageur au stylo rouge, en marge de la copie naïve mais sincère : Quel orgueil ! L'orgueil d'un gamin génial, admiratif à sa façon, ironique et cruelle, de ses aînés, Rimbaud saluant Hugo et Baudelaire, Huguenin Bernanos et Valéry, voilà un métal rarissime que la tête de pioche de tous les imbéciles du monde prétendra épuiser en quelques coups savamment frappés.
Nous sommes confrontés à une double impossibilité, tragique ou bien comique selon les humeurs, lorsque nous imaginons un jeune écrivain français s'adresser à celle ou celui qui le précéda et l'inspira : d'abord, il n'y a pas, en France, de jeune écrivain susceptible de posséder l'once de talent d'un Roger Nimier qui eut 20 ans en 1945, ce à quoi il ne pouvait évidemment rien mais qui, cinq ans plus tard, n'eut pas peur de clamer son admiration à l'égard de Georges Bernanos venant de mourir, ce qu'il eût pu avoir la peur de faire; ensuite, s'adresser à un écrivain suppose, je le crois du moins, de l'avoir lu et, ainsi, d'être capable de jauger et juger ce qu'il a pu vous apporter mais, surtout, ce qu'il a pu apporter à ce qui vous-même vous dépasse, et qui a pour nom la littérature. Or, et je fais ce constat à peu près chaque jour que je lis des livres, quel jeune écrivain français pourrait témoigner, à une ou deux exceptions près sans doute, qu'il s'agisse de Marien Defalvard ou encore de Julien Capron, en plus de quelques lignes mal écrites, de l'admiration qu'il porte à un autre écrivain, à condition même que nous puissions prétendre de ce dernier qu'il est, bel et bien, un écrivain, et pas un plaisantin un peu plus âgé que son jeune admirateur ? L'exercice de l'éloge véritable, qui peut s'enrober autant qu'il le voudra de la carapace de l'ironie, à condition qu'elle ne soit jamais moqueuse, vile, suppose intelligence, finesse, humilité et orgueil tout à la fois, piété, une notion presque tombée dans le plus méprisable des oublis, sens de la transmission et, bien sûr, talent, autant de conditions que je ne trouve nulle part réunies dans leur ensemble, ni même, trop souvent, réduites à leur portion congrue, parmi nos très nombreux écrivants, et même chez nos très rares écrivains.
Imaginons, avant de revenir au beau livre lucide et noir de Roger Nimier, Édouard Louis clamer son comique attachement et sa très minable admiration à un vieux mandarin expert en farces et attrapes sociologiques, pour le plus grand bonheur des idiots journalistiques qui ne pourront s'empêcher de saluer, comme ils l'écrivent avec emphase, une nouvelle conscience de gauche !
Imaginons, au centre du désert de l'écriture jeune et jolie, hélas aussi peu sexuée que vertébrée, une Cécile Coulon, saluée un peu partout, y compris dans les librairies et les salles de rédaction, comme une jeune prodige cousine, pardonnez du peu, de Rimbaud, s'adresser à telle figure féminine, Simone de Beauvoir ou Marguerite Yourcenar pourquoi pas, et tentons d'apprécier ce que pourrait signifier le fait de sonder la profonde inanité des mots qu'elle leur adresserait, dans des phrases offrant avec les flans à la courge une similarité d'aspect et de saveur qui n'aurait rien de métaphorique.
Ce n'est pas tout, car il serait injuste de ne distribuer nos coups que sur certaines faces aussi molles qu'interchangeables, Édouard Louis n'étant finalement qu'une Cécile Coulon en pantalon plutôt qu'en jupe, à moins, diraient les mauvaises langues, que ce ne soit l'inverse.
Imaginons, à droite cette fois-ci et même : à droite de la droite moins buissonnière que putassière, Solange Bied-Charreton, que tel ami ô combien drôle et cruel dans ses fulgurances point toutes littéraires ne peut s'imaginer autrement que comme un insecte, un papillon plutôt commun, voletant dans la mondanité de droite selon ses termes, imaginons cette jeune femme au talent littéraire aussi développé qu'une antenne de charançon, et qui vient de témoigner d'un bel entêtement en faisant publier un troisième roman encore plus mauvais que les deux qui l'ont précédé, imaginons-la clamer son admiration vers quelque anti-modèle absolu, c'est-à-dire une femme belle, intelligente et talentueuse, Cristina Campo par exemple, et retenons-nous de rire aux éclats. D'abord, Solange Bied-Charreton ne sait rien de Cristina Campo car, si elle avait lu avec exigence une seule des pages coruscantes et magnifiques de l'auteur des Impardonnables, elle saurait, d'une évidence intime n'ayant point besoin d'être démontrée, qu'elle n'a strictement pas la force d'écrire, et encore moins le droit, et que dire du péché consistant à lui écrire, à elle, la magnifique Cristina Campo qui évoqua mieux que nulle autre la sprezattura, cette incandescence sereine à la jointure entre la chair et l'esprit, et que dire de cette énormité existentielle quand on s'appelle Solange Bied-Charreton, et que le moindre de vos propos est repris par tous les bécasseaux droituriers qui se contorsionnent pour comprendre les oracles que la pythie de foire lâche sur la vie politique française et, comme ils disent encore, les grands enjeux sociétaux ? Que lui dirait-elle, d'ailleurs, Solange, à Cristina, je vous le demande ? Que dirait Solange Bied-Charreton à Cristina Campo (ou bien, si vous la voulez laide mais tout aussi intelligente, à Simone Weil), que lui écrirait-elle qui dépasse la construction, pour le moins sommaire, qui caractérise la presque totalité de ses phrases, très originalement alignées en sujets-mouflons, verbes-chèvres et compléments aussi domestiqués qu'un mouton d'alpage helvétique ?
Je m'éloigne de mon sujet et me livre à des attaques bassement misogynes ? Notons que ces gentes demoiselles (Édouard Louis ne m'en voudra pas que je l'inclue dans ce charmant groupe) exigent d'être traitées comme les hommes, montrant d'ailleurs, il faut le préciser, un peu plus de courage que nombre d'entre eux. Ensuite, cette petite digression s'intègre parfaitement dans notre problématique d'ensemble : la disparition de tout jugement critique, l'amenuisement drastique de la qualité des romans imprimés en France, la réduction jusqu'à peau de chagrin du prestige, autrefois immense, de la littérature, l'annihilation possible sinon de moins en moins improbable de la France, le refus de s'appuyer sur le passé pour guetter, la main en visière, les dangers qui grondent, et nous permettre, d'ores et déjà, de déjouer ce qui se trame jour après jour sous nos yeux. Je n'en ai donc pas fini avec ces animalcules bavards, qui bien mieux que d'autres, qui jamais n'ont prétendu incarner le renouveau intellectuel d'une nation moribonde, illustrent mon propos !
Parler de Solange Bied-Charreton ou de sa version journalistique officielle, donc à quotient intellectuel minimal exigible, la très vaguement télégénique Eugénie Bastié, c'est presque aussitôt voir émerger à l'horizon de la fulminance apprivoisée la haute figure marmoréenne du Melmoth des sacristies et des confessionnaux, sorte d'Urbain Grandier portatif à effet garanti sur les dortoirs de filles bien sages, j'ai nommé, pardon : invoqué le trois fois consacré au saint-chrême, quoique coupé au Picon, Jacques de Guillebon, sorte de Gauvain de prétention donquichottesquement monté sur son coursier apocalyptique gonflable, bien évidemment réutilisable en cas de harangue improvisée dans une Fête à Neuneu(s) catholique(s). Celui-là, sans doute touché par le don de bilocation qui lui permet de chanter les vertus de deux ou trois poules et coqs de basse-édition en même temps, a la langue suffisamment déliée pour raconter n'importe quoi, c'est-à-dire tout ce que l'on voudra et sur commande apostolique, sur n'importe qui, qu'il s'agisse du Christ ou de Marion Maréchal-Le Pen, de Gandhi ou de son ami Romaric Sangars, dont le prénom est aussi crânement francique que l'écriture est melliflue, fémininement douce, évasivement profonde, stochastiquement méchante, y compris lorsqu'elle feint de mordre. Il est vrai que, tout occupé à faire publier (pardon : «apporter», sic) la rinçure journalistique d'Eugénie Bastié au Cerf, sous le regard noir de Jean-François Colosimo qui a décidément beaucoup perdu de son acuité, le preux Jacques de Guillebon n'en est pas moins capable de saluer la daube surnuméraire de son ami à la coiffure plus savamment destructurée que la phrase, daube modestement intitulée Les Verticaux et publiée chez l'inénarrable (ne narrons point trop, son avocat veille) Léo Scheer, et qu'il sera n'en doutons point tout autant capable de chanter les mérites surnuméraires du dernier navet lacrymalo-guerrier de son ami Richard Millet qui, lui, a autant d'amis que peut en accueillir La Revue littéraire de son (nouvel) ami Léo Scheer, c'est-à-dire fort peu, mais à l'échine merveilleusement souple et au large cul adorateur de coups de pied. Inutile de préciser que Richard Millet, lui aussi, publie chez Léo Scheer, un éditeur dont nous pourrions presque deviner, j'y songe tout à coup, quel sera l'un des futurs auteurs. D'ici peu, Jacques de Guillebon va se prendre pour Claudel, lui qui se prend déjà pour Bernanos, et tenter de convertir aux vertus de la pauvreté christique celui qui, flairant le bon coup catéchétique, voudra le publier sans pour autant risquer d'être baptisé !
Imaginons encore un Marin de Viry qui fort heureusement n'a publié aucun livre depuis 2012, ou encore un Alexandre de Vitry, une ombre impossible à confondre avec la précédente et qui, lassée de son cinquantième colloque sur Philippe Muray, lui adresserait une dernière lettre, en forme d'hommage forcément (mais nous pouvons alors nous demander quelle sera cette forme), où ce percolateur de truismes relèvera l'inventivité lexicale de l'obsession anale développée par son mentor dans l'indigeste et sollersien Ultima Necat.
Imaginons une dernière fois, car le temps se fait long et surtout que je ne voudrais pas davantage m'égarer dans les sous-pentes du népotisme germano-sacristain à tropisme rebelle, cette théorie cliquetante et bavarde de fantômes sans talent, à laquelle nous pourrions joindre celle d'auteurs plus âgés, nullités à mouvement perpétuel (François Haenel et Yannick Meyronnis ou l'inverse, Antoni C
04/09/2016 | Lien permanent
L'Architecture de Marien Defalvard

 Marien Defalvard dans la Zone.
Marien Defalvard dans la Zone.Quand les nains et les caco-nains commentent le tout dernier écrivain de langue française, ou petit traité de lecture en époque alogale
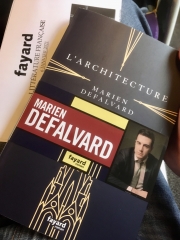 Acheter L'Architecture sur Amazon.
Acheter L'Architecture sur Amazon. Voici quelques jours à peine, un joli chapelet d'andouilles radiophoniques présentant la particularité dâêtre composées de davantage de chaudins de blaireaux plutôt que de gras de porc, dont une parfaite idiote pigeant pour Elle (oui, une femme peut gagner ainsi sa vie, en accomplissant une aussi sale besogne quâécrire pour un magasine comme Elle); oui, une lamentable sous-pigiste, une certaine Ãlisabeth Philippe qui ne sait même pas quâun grand écrivain du nom de Carlo Emilio Gadda a par avance réduit à un peu de cendre refroidie et puante chacun de ses bavardages, peut écrire un monceau dââneries à tropisme de petit flic (et, dès lors, faisant passer pour une enquête digne de ce nom sa consultation de Twitter et de Google) pour LâObs et être payée pour cela, oui, et dâautres, dâautres nains et mégères, tant dâautres se reproduisant, comme les mouches à merde, par génération spontanée sur la carne avariée de la Presse), ou encore, pour continuer à détailler ces exemplaires dâune évolution régressive, dâune dévolution comme disent les Anglais, de lâhomme, le communiste des beaux quartiers Arnaud Viviant, le pseudo-décadent et vrai arriviste poudré Frédéric Beigbeder et je ne sais plus quelle nullité (ah, si, un certain Jean-Claude Raspiengeas, dont le nom est si laborieusement laid à prononcer quâil vous démange la glotte comme un crachat), nullité parfaitement digne d'écrire pour La Croix, tous fiers, en tout cas de leur stupidité bavarde, de leur inculture triomphante, assumée, décomplexée, pornographique, germanopratine, échangèrent donc avec force gloussements, silences entendus de conspirateurs de troquet et mines que l'on devinait interloquées tout autant que complices, sur l'antenne consanguine de France Inter, de consternants truismes que je résumerai en quelques mots : Marien Defalvard est un écrivain passablement compliqué à lire, pas vrai Raoul ?, mais son dernier roman (1), L'Architecture, alors lui, est, je vous le dis tout de go, parfaitement i-l-l-i-s-i-b-l-e et même tout simplement hermétique ! En tout cas, moi, Frédéric, moi, Jean-Claude, moi, Arnaud, moi, Jérôme et moi, Bécassine, je nây ai rien compris !. Quelques jours plus tard, cette fois-ci pour Le Figaro Magazine, Frédéric Beigbeder, omniprésent lorsquâil sâagit dâécrire ou de parler pour ne rien dire et le dire, qui plus est, sans éclat mais avec la nonchalance de celui qui, depuis quâil est né, nâaura jamais exercé dâautre spécialité que celle de branleur, dont il est Docteur honoris causa dâun bon millier de bars parisiens, répétera que Marien Defalvard est un «génie illisible», un propos stupide qui sera pratiquement recopié, mot pour mot, par Christian Authier (qui nâoubliera tout de même pas de saluer les nouveaux livres de ses petits copains Jérôme Leroy et Sébastien Lapaque) pour LâOpinion Indépendante : ces nains sont tellement peu sûrs dâeux-mêmes quâils vont, on le suppose inconsciemment mais je nâen suis pas certain, jusquâà se recopier les uns les autres, en invoquant, dans les cas dâAuthier et de Beigbeder, Lautréamont, comble, pour ces cerveaux en forme de crachoir, de la difficulté, que dis-je, de lâimpénétrabilité littéraire !
Misère de la critique journalistique française bien sûr, ces clowns qui jamais nâont fait rire devant se contenter, faute de moyens esthétiques, littéraires et tout bonnement : intellectuels, dâune accusation dâillisibilité, confondante aberration à la morgue jupitérienne fientée par ces perdreaux aux ailes rabotées avec une autorité de saint Jean proclamant l'ouverture des sceaux au-dessus de la mer d'huile entourant Patmos, et sans doute reçue â mais là encore nous ne pouvons quâimaginer sa mine ahurie â avec un hochement de tête par Jérôme Garcin qui était chargé, en fait de distribution de la parole, de repasser les plats remplis à ras bord dâun potage verbal aussi peu ragoûtant : de la merde, nâest-ce pas, quelle que soit la manière de lâaccommoder, reste de la merde. LâArchitecture est donc illisible selon lâalpha et lâoméga de la critique journalistique, et même, nous dit notre GO mononeuronal, imbattable dans lâimbitable, ce qui, dans la bouche pâteuse de ce Monsieur de Phocas de bac à sable, doit il me semble correspondre à un compliment enrobé dans un mot quâil a le tort de croire bon et qui nâest quâune déjection supplémentaire, cette fois-ci entourée dâune imitation de papier de soie.
Je suis particulièrement frappé, au-delà bien sûr de la crétinerie inimaginable de ces cuistres qui font pourtant office de critiques littéraires sur moult types de supports médiatiques (le plus possible, si possible), par la fausseté de leurs dires, qui ne sont même pas des affirmations mais, tout au plus, de molles hésitations, des flatulences, qu'ils lâchent en tournant autour du trou de toilettes à la turque qui leur sert de cerveau infundibuliforme : disons-le comme nous le pensons, L'Architecture se lit parfaitement, bien plus facilement en tous les cas que de très compacts petits tas de conneries point recyclables comme le sont les livres d'une Cécile Coulon, seule écrivassière à laquelle les journalistes pensent, avant même de songer que le génie de Pascal a jadis irrigué les rues de la ville de Clermont-Ferrand qui, marâtre, détruisit sa maison, lorsqu'ils veulent tenter d'associer l'idée de littérature, celle qu'ils s'en font bien sûr, à l'ingrate cité saccagée des années durant par une municipalité quasiment soviétique, pire que soviétique puisque française, stalinienne donc, ou encore à la région auvergnate, à peu près épargnée par ces salopards salopeurs et même raseurs de patrimoine, dont la folie destructrice eût dû être confinée dans une grande salle capitonnée avec, pour obligation de soins, le visionnage 24 heures sur 24, de documentaires sur la destruction méthodique de villes entières : peut-être y auraient-ils vu quâà trop vouloir faire table rase du passé, câest lâhomme que détruisent ces réformateurs intraitables ? Il a quoi quâil en soit toujours été parfaitement clair à mes yeux que ce ne sont pas les grands textes qui sont durs à lire, voire incompréhensibles, imbitables selon Frédéric Beigbeder, ce nouveau Sainte-Beuve, mais, bien au contraire et au rebours des affirmations les plus sottes, les mauvais, les médiocres, les petits, les nuls, comme ceux dâune autre Auvergnate, Cécile Coulon et de ses innombrables consÅurs, toutes écrinaines et déparant dâautres belles régions françaises, cachant leur totale indigence de baudruche vulgaire et peroxydée dans le cas qui nous occupe sous le vernis d'une insipide simplicité qui ne berne que les sots, certes nombreux, surtout lorsqu'il s'agit de promouvoir de si rondes boulettes de fumier.
Si je voulais continuer à choquer les imbéciles, je m'amuserais même à prétendre que L'Architecture se lit non seulement d'une traite, mais ne m'a causé aucune difficulté particulière, de lexique comme de forme (je veux dire : de structure grammaticale), contrairement à tels autres textes eux aussi réputés «imbattables dans lâimbitable» comme Tristram Shandy de Laurence Sterne, Locus Solus de Raymond Roussel, Gothique charpentier de William Gaddis, Absalon, Absalon ! de William Faulkner, Le Purgatoire de Pierre Boutang ou encore Sous le volcan de Malcolm Lowry, voire Monsieur Ouine de Georges Bernanos, bien souvent considéré comme le roman le plus obscur et difficile, pardon Frédéric, «imbittable», du Grand dâEspagne : ce ne sont du reste pas des textes que nous pourrions qualifier, rapidement, sottement, journalistiquement, d'hermétiques à proprement parler, comme le sont par exemple ceux du si tristement surestimé Pierre Guyotat ou bien, d'un degré bien supérieur à ce dernier, ceux de Maurice Scève (la Délie est nommée, p. 185) ou de Georg Trakl, et que dire de Paul Celan. Ces textes sont difficiles parce qu'ils évoquent la matière même qui les constitue, qui nous constitue, le langage et, l'évoquant, parce quâils le mettent en joue et en jeu, jouent avec lui, s'enfoncent en lui, et ce sera, dans ce concours extraordinairement sélectif, à celui qui parviendra à creuser le plus profond, moins, dâailleurs, pour y trouver du nouveau, selon lâimpératif baudelairien, que pour y retrouver ce que lâon a perdu.
Le saint langage ou la descente dans la fosse de Babel
Exploration des plus épaisses couches du langage, L'Architecture est aussi, d'abord même, au niveau le plus superficiel où barbotent les animalcules à tuba et palmes en plastique mou, un remarquable essai sur la littérature, sur ce qu'est la grande littérature et celles et ceux qui la font aux yeux de l'écrivain. Pour Marien Defalvard, le style se caractérise avant tout sinon uniquement par lâécart, le pas de côté : «non la fusion mais l'inadéquation, l'inappropriation; la singularité qui apparaissait dans les grincements, dans les brisements, dans les points-virgules écaillés, non pas dans l'application heureuse, le succès» (p. 154). Ainsi le texte de Marien Defalvard fourmille d'impressions, de jugements, de rapprochements, le plus souvent étonnants et parfois remarquables, sur des auteurs comme Virginia Woolf, «l'alacrité anglaise qui fait baigner le dernier état de la mélancolie victorienne dans les obus prochains» (p. 161), Shakespeare (surtout par l'évocation de sa pièce la plus noire, Macbeth), que Defalvard, sur les brisées d'Ezra Pound, orthographie à sa façon phonétique et signifiante (soit «Shaxpeare»), mais aussi, bien quâils ne puissent être directement rattachés à la seule littérature, Pierre Legendre ou encore (et encore, et encore, hélas) René Girard, Philippe Muray, dâautres aussi, comme Carlo Emilio Gadda, et son Château dâUdine (cf. p. 28).
Mais ce nâest là que la surface des choses je lâai dit, quelques noms dâauteurs que les journalistes, en pseudo-lecteurs paresseux, prélèveront ici ou là sans jamais comprendre quelle cohérence intime a exigé leur mention, leur apparition au détour dâune phrase quâen apparence rien ne prédisposait à voir germer en tel ou tel bouquet. Tout au plus de quoi écrire un petit article qui, dans le meilleur des cas, saluera lâévidence si affreusement située au rebours de toutes les assurances contemporaines selon laquelle un grand écrivain est aussi, dâabord là encore, un grand lecteur. Dans cette exploration de la littérature et des cavernes et puits sur lesquels elle sâappuie, Marien Defalvard est l'un de ceux qui descend le plus bas, qui, même, parfois, comme l'indique telle image éblouissante, telle comparaison ou métaphore qui ne sont pas simplement remarquables mais géniales en ce sens qu'elles établissent des rapports évidents mais que lui seul aura ainsi signifiés, qui même, donc, parvient à passer derrière, au-delà ou en dessous on ne saurait dire de quelque inimaginable frontière du langage. Ce qui saisit, plus dâune fois, à la lecture de LâArchitecture, câest tel méplat de visage quâon croyait enfoui et qui brille selon un angle inaccoutumé, telle tranchante pointe qui, une fois dégagée la terre autour dâelle, se révélera nâêtre que le sommet le plus pointu dâun édifice inconnu, comme les explorateurs des textes de Lovecraft ou de Machen, en passant le doigt sur un relief aux motifs étranges, ont la sensation bizarre quâils commencent à sâaventurer dans un royaume qui nâest non seulement pas de ce monde mais en aucun cas ne les préservera de rencontres dangereuses, de noires révélations. Comme toujours chez les très grands, il y a, dans la prose de Marien Defalvard, des espèces de trouées qui, dans une mare que nous pensions connaître, ouvrent des puits de profondeur dâun bleu dâoutre-monde.
Voici quelques jours, profitant de sa présence, devenue rare, à Paris, Marien et moi avons longuement discuté en marchant vers la gare d'Austerlitz, et n'avons pas fait qu'aborder W. G. Sebald, qu'il ne tient pas en aussi haute estime que moi, mais l'un de mes textes, dont je ne tire aucune fierté particulière, La chanson d'amour de Judas Iscariote; Marien s'est déclaré surpris que je n'aie pas désiré m'aventurer, de nouveau, dans ces territoires finalement assez peu explorés qui se situent aux confins de la prose et de la poésie, de l'essai et du roman et, parfois aussi, mais ce choix était pleinement assumé, de l'hermétisme. Imaginant, sous la figure de Judas, quelque impossible dernier écrivain ou, pour le dire avec les mots de Marien Defalvard qui lui aussi peut prétendre tenir ce poste de vigie si peu enviable, le dernier homme, le dernier de cordée ou de lignage (cf. p. 88), il me fallait bien tenter de sonder ce que le rapport pour le moins paradoxal que l'apôtre-félon a noué avec le Christ, autrement dit le Verbe incarné pour la théologie chrétienne, forer, à mon tour, après tant d'autres, probablement avant d'autres qui, je le crains, deviendront de plus en plus rares à mesure que le langage s'amenuisera à une novlangue macronienne, il me fallait bien m'enfoncer dans le tuf primordial du langage, produisant un texte pour le coup énigmatique après plusieurs années d'écriture, de réécriture, de polissage, de sertissage des mots. Ah oui, on peut dire, selon le mot qu'aimait citer Bernanos, que je n'ai alors pas tenu une plume pour rigoler ! Marien Defalvard lui non plus, ne tient pas une plume pour rigoler, se souvient peut-être de Jacques Chessex écrivant, dans LâInterrogatoire, quâil ne faut jamais «considérer la littérature comme un jeu, mais se rappeler que tout vrai texte manifeste la Parole dans la parole», ce qui signifie assez clairement quâil vous faut laisser tomber les billevesées sur la prétendue illisibilité de ses textes, car vous pouvez être certains que ce que lui reprochent les sots que jâai mentionnés, et une foule dâautres, connus ou pas, câest justement quâil ne le fait pas, quâil ne sâamuse pas en écrivant, mais alors vraiment pas une seconde, puisquâil rappelle à ces pitres ce quâils ont oublié dans le meilleur des cas ou, plus sûrement, nâont jamais soupçonné : lâécriture et, à un moindre degré, la lecture, sont toutes deux expositions de celui qui les pratique à la corne de taureau évoquée par Michel Leiris dans LâÃge dâhomme. Voyez, au moment de comprendre quâils sâengagent dans une rue où ils risquent de gager leur peau de trouillards, nos bravaches : lâchés sans autre solution que courir aux ferias de San FermÃn, vous pourrez être certains que, dans lâexemple le moins manifeste de débandade radicale, ils tenteront de cacher lâauréole de pisse dont leur peur comique aura poissé leur pantalon. Cette peur, ce relâchement de vessie et même de sphincters, ils lâétalent, à leur façon inconvenante car publicitaire, dans ce quâils écrivent : tous ces imbéciles, en fait, exsudent leur trouille quand ils écrivent.
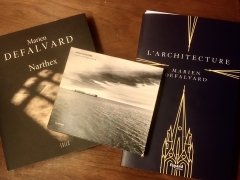 Marien Defalvard ne rigole pas câest une certitude, plus dâun événement, dâailleurs, lui a apparemment passé lâenvie de rigoler, lui dont l'esprit de sérieux passera pour de la prétention; or, de la même manière quâil en va pour les grands textes, les grands auteurs ne sont jamais prétentieux, puisque ce sont ceux qui jouent à paraître ce qu'ils ne sont pas, des écrivains, qui le sont, et au plus haut degré, comme tant d'exemples suffisent à nous en convaincre, de l'indigent Emmanuel Carrère, fils de maman, jusqu'au kouglof verbal sué par Mathias Enard qui se croit le fils de Balzac, ou au mage de pacotille Yannick Haenel confondant une pellicule de peau saponifiée de Philippe Sollers avec le rayonnant aleph dont parle Borges, en passant par tous les animalcules, têtards, plantigrades, etc., sollersiens ou pas, et toute la clique écouillée mais pas moins cacographique des éditions POL, tant d'idiotes intarissables aussi, et puis tous ces écrivaillons n'ayant rien à dire mais, tel un Sylvain Tesson fils de papa, le disant quand même, devant un parterre de crétins et, hélas pour les mâles idéalistes, sâil en reste, d'idiotes à cyprine hypokhâgneuse.
Marien Defalvard ne rigole pas câest une certitude, plus dâun événement, dâailleurs, lui a apparemment passé lâenvie de rigoler, lui dont l'esprit de sérieux passera pour de la prétention; or, de la même manière quâil en va pour les grands textes, les grands auteurs ne sont jamais prétentieux, puisque ce sont ceux qui jouent à paraître ce qu'ils ne sont pas, des écrivains, qui le sont, et au plus haut degré, comme tant d'exemples suffisent à nous en convaincre, de l'indigent Emmanuel Carrère, fils de maman, jusqu'au kouglof verbal sué par Mathias Enard qui se croit le fils de Balzac, ou au mage de pacotille Yannick Haenel confondant une pellicule de peau saponifiée de Philippe Sollers avec le rayonnant aleph dont parle Borges, en passant par tous les animalcules, têtards, plantigrades, etc., sollersiens ou pas, et toute la clique écouillée mais pas moins cacographique des éditions POL, tant d'idiotes intarissables aussi, et puis tous ces écrivaillons n'ayant rien à dire mais, tel un Sylvain Tesson fils de papa, le disant quand même, devant un parterre de crétins et, hélas pour les mâles idéalistes, sâil en reste, d'idiotes à cyprine hypokhâgneuse.Marien Defalvard, lui, comme le prouve chacune des critiques que j'ai consacrées à ses trop rares textes, est un monstre qui va finir par devenir absolument unique, puisqu'il est tout entier composé par le langage. Lui-même le dit, et cette affirmation suit de quelques lignes à peine une distinction entre deux types d'écrivains, ceux qui creusent (Paul Gadenne (2) d'un côté, dont L'Avenue constitue comme un palimpseste et l'horizon si tentateur, à la fois esthétique et ontologique, peut-être même théologique, de L'Architecture, et Nabokov de l'autre, celui des écrivains qui se donnent au monde, vont vers lui, le dévorent en quelque sorte); d'abord, donc, la confession de l'auteur, qui écrit que sa «dépendance aux mots était une dépendance de drogué, la dépendance de l'opiomane ou du cocaïnomane malheureux, qui connaît sa dépendance mais aime à l'éprouver avec une espèce de gratuite répétitive ou de répétition gratuite, et l'éprouve avec une voluptÃ
14/01/2021 | Lien permanent

























































