Rechercher : bernanos, lapaque
L'ombre des forêts de Jean-Pierre Martinet

À propos de L’ombre des forêts de Jean-Pierre Martinet (1987, La Table Ronde, coll. La petite vermillon, 2008).Florent Georgesco : Comment Martinet réagissait-il à l’accueil de ses livres ?
Alfred Eibel : L’échec de L’Ombre des forêts, sur lequel il avait vu que nous fondions quelques espoirs, a été terrible pour lui. Il m’a dit : «J’arrête.»
F. G. : De fait, il a arrêté. Il n’a plus rien publié jusqu’à sa mort, six ans plus tard.
A. E. : Il faut dire qu’il a ensuite eu un accident de santé très grave, une sorte d’embolie qui l’a laissé partiellement paralysé. Il me disait : «J’ai l’impression que les ampoules de ma tête sautent les unes après les autres.»
Extrait d'un entretien intitulé Les oiseaux de métal, Jean-Pierre Martinet (1944-1993) entre Alfred Eibel, Julia Curiel et Florent Georgesco, paru dans le numéro 36 de La Revue littéraire éditée par Léo Scheer.
D'où vient cette impression aussi pénible qu'étouffante que, quoique la canicule pèse sur la ville imaginaire de Rowena cuite par le soleil qui fait puruler les âmes, nous nous déplaçons dans une nuit qu'aucune aurore ne viendra trouer, aucune brise rafraîchir ? D'où, cette sensation que Jean-Pierre Martinet a extraite du grand roman de Bernanos ses personnages les plus marquants, Monsieur Ouine et Jambe-de-Laine, pour les transplanter au milieu d'un décor vidé à la fois de Dieu et de Satan que parcourent quelques fantômes malades de solitude, de crasse et de rêves brisés ? D'où, ce sentiment malsain que l'auteur se serait amusé à allonger indéfiniment, pour y perdre son lecteur pris à la gorge, un des noirs tableaux grotesques, une de ces fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot inventés par Aloysius Bertrand ? D'où, cette vision de personnages qui, privés de leur ressort premier, la colère, l'exigence que justice soit faite, l'indicible et scandaleux amour qui lie le meurtrier à sa victime, peut-être même moins que cela : la volonté, animale et bornée, de vivre coûte que coûte, L'ombre des forêts ressemblant ainsi à quelque Vent noir où sombrent de pauvres créatures privées d'un ultime sursaut d'honneur et de la volonté de ne point disparaître dans l'indifférence du monde ?
Une seule trouée véritable, aussi inattendue que splendide, fore ce roman étrange, envoûtant et parfois irritant d'une profondeur de révélation sans suite, vision d'un ciel de toute façon refusé aux hommes, à l'occasion d'une songerie de Céleste sur un film où jouait Clark Gable, ou un autre acteur peu importe, elle ne sait tout simplement plus, ne l'a peut-être même jamais su : «S’agissait-il du même film ? Peut-être, mais elle n’en était pas très sûre. Pourtant il y avait toujours Clark Gable, mais il lui semblait qu’il avait terriblement vieilli, qu’il n’était plus que l’ombre de lui-même, revêtu d’habits anciens pour faire illusion, ou alors elle confondait avec un autre film, une autre époque, un autre rôle plus prestigieux, peut-être même un autre acteur, elle ne savait plus, tant d’années peuvent s’écouler en quelques minutes, elle éprouvait un effroyable sentiment de tristesse, d’anéantissement, tandis qu’elle regardait d’un air absent les champs de coton, les grandes plantations disparaître dans les flammes, sous le ciel du Sud, immense et blanc, arrogant, comme intouchable, si loin, si haut, que même les fumées des incendies semblaient hésiter un instant, respectueusement, avant de monter vers lui, et de s’y perdre, disséminées par le vent qui attisait de nouveaux foyers, en bas, chez les hommes, là où l’on s’agite et l’on hurle silencieusement, au milieux des décombres» (op. cit., p. 178).
02/02/2009 | Lien permanent
Intégralité de l'Enquête sur le roman

 1 – La littérature peut-elle être encore pensée en termes d’évolution, de révolution ? En d’autres termes, face aux impératifs commerciaux, qui tendent, semble-t-il, à la niveler en la réduisant, par exemple, à ne plus ressortir qu’au seul genre du roman, reste-t-elle cet espace (que l’on dit sacré) de liberté, ce lieu de tous les possibles ?De révolution, je n’en sais rien car ce n’est pas l’art qui fait les révolutions mais les révolutionnaires il me semble, n’en déplaise aux surréalistes et aux Netchaïev de salon de la revue Ligne de risque.Parler d’évolution est tout aussi problématique dans le cas de l’art : quarante ans d’emprisonnement dans l’un des camps de rééducation gauchiste du prêt-à-penser idéologique ne parviendraient pas à briser, tout du moins je l’espère, la conviction qui me fera toujours hurler qu’une criarde fresque murale griffonnée sur un mur du «neuf trois» vaut moins, infiniment moins qu’une peinture miraculeusement nichée au plus profond des grottes de Lascaux, Altamira ou Chauvet. Toutefois, il me semble indéniable d’affirmer que le roman, au moins formellement, évolue, a évolué et continuera de le faire, même si, après Dos Passos, Musil, Broch, Joyce ou Faulkner, je ne vois pas bien ce qu’il lui reste à expérimenter...Selon Sábato dans L’Écrivain et la catastrophe, cette évolution est parallèle «à la profanation de l'être humain, à l'effrayant processus de démystification du monde». Or, un monde qui se démystifie étant aussi un monde avalé par le règne de la machine, un monde qui connaît de plus en plus le vertige, écrivait Anders, de «l’obsolescence de l’homme», un monde qui se vend et s’achète, nul doute que le livre, comme n’importe quel autre produit, devienne consommable (il l’est déjà bien sûr, et avec quels excès), c’est-à-dire véhicule d’une «parole putanisée» selon la trouvaille de Michel Waldberg. En somme, le roman, comme son nom l’indique, est lui aussi non seulement un genre profane mais surtout, oserais-je écrire, profané depuis longtemps. Une autre question, et des plus complexes, est de savoir si le «sentiment de la langue» comme l’écrit Richard Millet, si le langage lui-même, attaqué de toutes parts, n’est pas le principal agent infectieux contaminant l’homme moderne et ce qu’il écrit, par exemple des romans. Le langage corrompu infecterait en premier lieu l’écrivain lui-même, qui, à son tour, ne pourrait créer rien d’autre que des moignons d’œuvre, des sortes de phocomèles littéraires, l’ensemble de cette toupie devenue folle ressemblant à ce « camp de concentration verbal » évoqué par Armand Robin. Je vous invite quoi qu’il en soit à relire Babel de Roger Caillois, dont un passage assimile le langage moderne à l’argent. Je vous invite aussi à relire les fulgurantes notations de Kierkegaard qui dans son Journal de 1846 (Pap. VII 1 A 77) analysait la réduction de l’œuvre d’art à une marchandise, bien avant que Walter Benjamin ne s’offusque du fait que l’art avait perdu son aura, que Canetti, lui-même grand lecteur de Kraus, ne déplore l’apparition d’un monde où la parole est tout entière, de plus en plus, réifiée… Tout cela n’a donc strictement rien de nouveau, je le sais, de même que la réponse à votre seconde question : au sein même des immenses monades urbaines (ce parangon d’une société devenue, enfin !, sous la plume de Silverberg, tout entière communiste) que nous promettent nos apôtres du bonheur perpétuel, au dernier recès, fût-il minuscule, du novlangue orwellien («Le langage est la forme ontologique de notre liberté» écrivait Pierre Boudot), se nichera toujours le génie d’un auteur et d’une œuvre puisque l’art vit de contraintes, parfois mortelles, en tous les cas, potentiellement mortelles (y compris même pour l’auteur, comme nombre de grands écrivains russes nous l’ont appris) et au contraire meurt pitoyablement, en se gonflant comme un cadavre qui fermente, de libertés ou plutôt du culte ridicule et dangereux de la liberté sans contenu des Modernes. Tant que notre pays, tant que l’Europe n’aspireront à devenir rien d’autre qu’un espace de libertés strictement économiques, sans la moindre référence à une tradition judéo-chrétienne pourtant très ancienne, tout autant que le théâtre parallèle d’une déconstruction de l’homme par l’homme, son orlanisation infinie pourrait-on dire, c’est-à-dire son indifférenciation absolue, chimère faite d’un assemblage asexué de différents éléments que l’on dirait prélevés sur des cadavres alors, je crois pouvoir affirmer sans crainte de me tromper que notre art ne vaudra pas plus que le prix d’une capote, aussi vite remplacée qu’utilisée. Il en sera de même ; pardon, il en est déjà de même avec le roman. «Chaque vibration de la parole, écrit Roberto Calasso dans La Littérature et les dieux, présuppose quelque chose de violent, un palaon pénthos, un «deuil ancien». Un meurtre ? Un sacrifice ? Ce n’est pas clair, mais la parole ne cessera jamais de le raconter». C’est donc une extraordinaire banalité qu’il est toutefois bon de répéter : nos plus grands prosateurs étaient des hommes qui ne craignaient pas le danger physique, qui parfois même eurent du sang sur les mains (je songe à Villon mais aussi à Agrippa d’Aubigné) en tout cas qui auraient assurément admis que le comble du déshonneur eût été de courir derrière une subvention étatique plus ou moins maquillée en incitation à la création vivante. Sans danger ou corne de taureau, pas de liberté possible, pas de persuasion, c’est-à-dire de poids, mais au contraire uniquement de la rhétorique, c’est-à-dire moins de la légèreté que de la vanité… Je crois donc que nous avons besoin d’hommes véritables plutôt que de livres, sous la masse desquels nous croulons.
1 – La littérature peut-elle être encore pensée en termes d’évolution, de révolution ? En d’autres termes, face aux impératifs commerciaux, qui tendent, semble-t-il, à la niveler en la réduisant, par exemple, à ne plus ressortir qu’au seul genre du roman, reste-t-elle cet espace (que l’on dit sacré) de liberté, ce lieu de tous les possibles ?De révolution, je n’en sais rien car ce n’est pas l’art qui fait les révolutions mais les révolutionnaires il me semble, n’en déplaise aux surréalistes et aux Netchaïev de salon de la revue Ligne de risque.Parler d’évolution est tout aussi problématique dans le cas de l’art : quarante ans d’emprisonnement dans l’un des camps de rééducation gauchiste du prêt-à-penser idéologique ne parviendraient pas à briser, tout du moins je l’espère, la conviction qui me fera toujours hurler qu’une criarde fresque murale griffonnée sur un mur du «neuf trois» vaut moins, infiniment moins qu’une peinture miraculeusement nichée au plus profond des grottes de Lascaux, Altamira ou Chauvet. Toutefois, il me semble indéniable d’affirmer que le roman, au moins formellement, évolue, a évolué et continuera de le faire, même si, après Dos Passos, Musil, Broch, Joyce ou Faulkner, je ne vois pas bien ce qu’il lui reste à expérimenter...Selon Sábato dans L’Écrivain et la catastrophe, cette évolution est parallèle «à la profanation de l'être humain, à l'effrayant processus de démystification du monde». Or, un monde qui se démystifie étant aussi un monde avalé par le règne de la machine, un monde qui connaît de plus en plus le vertige, écrivait Anders, de «l’obsolescence de l’homme», un monde qui se vend et s’achète, nul doute que le livre, comme n’importe quel autre produit, devienne consommable (il l’est déjà bien sûr, et avec quels excès), c’est-à-dire véhicule d’une «parole putanisée» selon la trouvaille de Michel Waldberg. En somme, le roman, comme son nom l’indique, est lui aussi non seulement un genre profane mais surtout, oserais-je écrire, profané depuis longtemps. Une autre question, et des plus complexes, est de savoir si le «sentiment de la langue» comme l’écrit Richard Millet, si le langage lui-même, attaqué de toutes parts, n’est pas le principal agent infectieux contaminant l’homme moderne et ce qu’il écrit, par exemple des romans. Le langage corrompu infecterait en premier lieu l’écrivain lui-même, qui, à son tour, ne pourrait créer rien d’autre que des moignons d’œuvre, des sortes de phocomèles littéraires, l’ensemble de cette toupie devenue folle ressemblant à ce « camp de concentration verbal » évoqué par Armand Robin. Je vous invite quoi qu’il en soit à relire Babel de Roger Caillois, dont un passage assimile le langage moderne à l’argent. Je vous invite aussi à relire les fulgurantes notations de Kierkegaard qui dans son Journal de 1846 (Pap. VII 1 A 77) analysait la réduction de l’œuvre d’art à une marchandise, bien avant que Walter Benjamin ne s’offusque du fait que l’art avait perdu son aura, que Canetti, lui-même grand lecteur de Kraus, ne déplore l’apparition d’un monde où la parole est tout entière, de plus en plus, réifiée… Tout cela n’a donc strictement rien de nouveau, je le sais, de même que la réponse à votre seconde question : au sein même des immenses monades urbaines (ce parangon d’une société devenue, enfin !, sous la plume de Silverberg, tout entière communiste) que nous promettent nos apôtres du bonheur perpétuel, au dernier recès, fût-il minuscule, du novlangue orwellien («Le langage est la forme ontologique de notre liberté» écrivait Pierre Boudot), se nichera toujours le génie d’un auteur et d’une œuvre puisque l’art vit de contraintes, parfois mortelles, en tous les cas, potentiellement mortelles (y compris même pour l’auteur, comme nombre de grands écrivains russes nous l’ont appris) et au contraire meurt pitoyablement, en se gonflant comme un cadavre qui fermente, de libertés ou plutôt du culte ridicule et dangereux de la liberté sans contenu des Modernes. Tant que notre pays, tant que l’Europe n’aspireront à devenir rien d’autre qu’un espace de libertés strictement économiques, sans la moindre référence à une tradition judéo-chrétienne pourtant très ancienne, tout autant que le théâtre parallèle d’une déconstruction de l’homme par l’homme, son orlanisation infinie pourrait-on dire, c’est-à-dire son indifférenciation absolue, chimère faite d’un assemblage asexué de différents éléments que l’on dirait prélevés sur des cadavres alors, je crois pouvoir affirmer sans crainte de me tromper que notre art ne vaudra pas plus que le prix d’une capote, aussi vite remplacée qu’utilisée. Il en sera de même ; pardon, il en est déjà de même avec le roman. «Chaque vibration de la parole, écrit Roberto Calasso dans La Littérature et les dieux, présuppose quelque chose de violent, un palaon pénthos, un «deuil ancien». Un meurtre ? Un sacrifice ? Ce n’est pas clair, mais la parole ne cessera jamais de le raconter». C’est donc une extraordinaire banalité qu’il est toutefois bon de répéter : nos plus grands prosateurs étaient des hommes qui ne craignaient pas le danger physique, qui parfois même eurent du sang sur les mains (je songe à Villon mais aussi à Agrippa d’Aubigné) en tout cas qui auraient assurément admis que le comble du déshonneur eût été de courir derrière une subvention étatique plus ou moins maquillée en incitation à la création vivante. Sans danger ou corne de taureau, pas de liberté possible, pas de persuasion, c’est-à-dire de poids, mais au contraire uniquement de la rhétorique, c’est-à-dire moins de la légèreté que de la vanité… Je crois donc que nous avons besoin d’hommes véritables plutôt que de livres, sous la masse desquels nous croulons. 2 – Par corrélation, et une fois retenue la problématique de la Forme et du Fond, une telle normalisation de l’expression littéraire pourrait-elle provoquer logiquement, en retour, une normalisation des contenus, c’est-à-dire des modes de pensée et, plus profondément, des imaginaires ?Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Joseph Conrad remarque dans ses Propos sur les lettres que les livres sont les objets les plus proches de nous, puisqu’ils sont vivants.Comme Paul Gadenne l’écrit dans À propos du roman (dans un texte datant je crois de 1944 intitulé Efficacité du roman), les grandes scènes romanesques s’intègrent peu à peu à notre univers spirituel, et, ajoute l’auteur, «parce qu'elles représentent le point de culmination d'une pensée, un certain point de vue sur le monde, le concrétisent dans une image», un tel phénomène n'est sans doute pas sans influence sur notre vie. Je me demande quel peut bien être le sens, hormis celui de nous aider à ne pas désespérer, d’une image telle que Tarkovski, Bergman ou Tarr l’ont imaginée puis filmée, d’une lumière mystérieuse peinte par Georges de La Tour, Goya ou Rembrandt, d’une scène cruciale de Dostoïevski, de Melville ou de Faulkner dans un monde qui accueillera ces œuvres de l’esprit comme il accueille – avec indifférence et affairisme – n’importe quelle information : aussi vite digérée qu’ingurgitée. Gershom Scholem n’a jamais cessé de répéter que faire dire au langage n’importe quoi, tenir une plume pour rire en somme, pour prendre le contre-pied d’une maxime d’Angèle de Foligno, était un crime. Nous en voyons déjà les conséquences : une réduction inhumaine de l’imaginaire des adolescents (et des adultes !), perclus dans la répétition hagarde de quelques gestes et paroles directement puisés dans le langage médiatique au sens le plus large, mécaniquement transposés à une vie quotidienne qui est elle-même le clone de millions d’autres, tout aussi télévisuelles et anodines. D’une façon inverse mais bien évidemment diaboliquement liée, un univers aussi plat que le nôtre, à moins d’être transcendé par le génie d’une espèce de vision seconde, comme celle qui fit émerger selon Merleau-Ponty, des murs sans vie de Lascaux, de somptueuses fresques, ne fera surgir que des images d’une absolue pauvreté, des langues réduites à quelque sabir décérébré, des romans eux-mêmes épris de vitesse et d’efficacité, suintant de bons sentiments œcuméniques et tiers-mondistes. Des œuvres mortes, des cadavres. Ce n’est tout de même pas un hasard si des œuvres télévisuelles, voire cinématographiques de piètre qualité séduisent des millions de personnes, ce n’en est pas moins un si des navets littéraires, que l’on nous sert à grand renfort de sauce médiatique, se consomment à des dizaines de milliers d’exemplaires : ne me dites pas de ces rinçures qu’elles ont une portée universelle mais parlez-moi plutôt d’une réduction drastique et dramatique de nos attentes, fussent-elles celles de notre imaginaire ! Reste que demeurent des invariants troublants dans ce que je pourrais appeler, pompeusement, l’imaginaire occidental, irrécusablement hanté (mais pour combien de temps encore ?) par le divin. L’un de ces invariants est à mon sens l’attente eschatologique du Sauveur, que l’on retrouve, autant de fois grimée qu’on le souhaitera, dans une œuvre telle que Dune de Frank Herbert ou bien dans la trilogie Matrix par exemple (œuvres formatées d’une dimension pourtant infiniment supérieure, je m’empresse de le préciser, à celle des lamentables productions d’un Paulo Coelho et de tant d’autres boutiquiers du spirituel). Parfois donc, il faut admettre que la vérité choisit, pour paraître, de se travestir, parfois donc ce que je lis m’empêche d’être totalement pessimiste même si je crois, comme le comique Sar Joséphin Péladan répondant fort justement à Jules Huret, que «Hors des religions, il n’y a pas de grand art et lorsqu’on est d’éducation latine : hors du catholicisme, il n’y a que le néant». Qui, aujourd’hui, ose écrire cela noir sur blanc ? Péladan, mage de foire et polygraphe de nos jours quelque peu oublié, n’a toutefois pas craint d’écrire une phrase qui, à présent, ferait hurler de rire les belles âmes.
2 – Par corrélation, et une fois retenue la problématique de la Forme et du Fond, une telle normalisation de l’expression littéraire pourrait-elle provoquer logiquement, en retour, une normalisation des contenus, c’est-à-dire des modes de pensée et, plus profondément, des imaginaires ?Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Joseph Conrad remarque dans ses Propos sur les lettres que les livres sont les objets les plus proches de nous, puisqu’ils sont vivants.Comme Paul Gadenne l’écrit dans À propos du roman (dans un texte datant je crois de 1944 intitulé Efficacité du roman), les grandes scènes romanesques s’intègrent peu à peu à notre univers spirituel, et, ajoute l’auteur, «parce qu'elles représentent le point de culmination d'une pensée, un certain point de vue sur le monde, le concrétisent dans une image», un tel phénomène n'est sans doute pas sans influence sur notre vie. Je me demande quel peut bien être le sens, hormis celui de nous aider à ne pas désespérer, d’une image telle que Tarkovski, Bergman ou Tarr l’ont imaginée puis filmée, d’une lumière mystérieuse peinte par Georges de La Tour, Goya ou Rembrandt, d’une scène cruciale de Dostoïevski, de Melville ou de Faulkner dans un monde qui accueillera ces œuvres de l’esprit comme il accueille – avec indifférence et affairisme – n’importe quelle information : aussi vite digérée qu’ingurgitée. Gershom Scholem n’a jamais cessé de répéter que faire dire au langage n’importe quoi, tenir une plume pour rire en somme, pour prendre le contre-pied d’une maxime d’Angèle de Foligno, était un crime. Nous en voyons déjà les conséquences : une réduction inhumaine de l’imaginaire des adolescents (et des adultes !), perclus dans la répétition hagarde de quelques gestes et paroles directement puisés dans le langage médiatique au sens le plus large, mécaniquement transposés à une vie quotidienne qui est elle-même le clone de millions d’autres, tout aussi télévisuelles et anodines. D’une façon inverse mais bien évidemment diaboliquement liée, un univers aussi plat que le nôtre, à moins d’être transcendé par le génie d’une espèce de vision seconde, comme celle qui fit émerger selon Merleau-Ponty, des murs sans vie de Lascaux, de somptueuses fresques, ne fera surgir que des images d’une absolue pauvreté, des langues réduites à quelque sabir décérébré, des romans eux-mêmes épris de vitesse et d’efficacité, suintant de bons sentiments œcuméniques et tiers-mondistes. Des œuvres mortes, des cadavres. Ce n’est tout de même pas un hasard si des œuvres télévisuelles, voire cinématographiques de piètre qualité séduisent des millions de personnes, ce n’en est pas moins un si des navets littéraires, que l’on nous sert à grand renfort de sauce médiatique, se consomment à des dizaines de milliers d’exemplaires : ne me dites pas de ces rinçures qu’elles ont une portée universelle mais parlez-moi plutôt d’une réduction drastique et dramatique de nos attentes, fussent-elles celles de notre imaginaire ! Reste que demeurent des invariants troublants dans ce que je pourrais appeler, pompeusement, l’imaginaire occidental, irrécusablement hanté (mais pour combien de temps encore ?) par le divin. L’un de ces invariants est à mon sens l’attente eschatologique du Sauveur, que l’on retrouve, autant de fois grimée qu’on le souhaitera, dans une œuvre telle que Dune de Frank Herbert ou bien dans la trilogie Matrix par exemple (œuvres formatées d’une dimension pourtant infiniment supérieure, je m’empresse de le préciser, à celle des lamentables productions d’un Paulo Coelho et de tant d’autres boutiquiers du spirituel). Parfois donc, il faut admettre que la vérité choisit, pour paraître, de se travestir, parfois donc ce que je lis m’empêche d’être totalement pessimiste même si je crois, comme le comique Sar Joséphin Péladan répondant fort justement à Jules Huret, que «Hors des religions, il n’y a pas de grand art et lorsqu’on est d’éducation latine : hors du catholicisme, il n’y a que le néant». Qui, aujourd’hui, ose écrire cela noir sur blanc ? Péladan, mage de foire et polygraphe de nos jours quelque peu oublié, n’a toutefois pas craint d’écrire une phrase qui, à présent, ferait hurler de rire les belles âmes. 3 – A propos justement du roman, Edmond de Goncourt disait : «Le roman est un genre usé, éculé, qui a dit tout ce qu’il avait à dire…». Aussi, et au-delà du simple fait – peut-être paradoxal – que cet auteur ait donné son nom à un prix littéraire qui, de par sa prééminence, contribue en effet à la promotion du roman comme genre ultime et incontournable, que pensez-vous de cette assertion ?Cette réponse d’Edmond de Goncourt à Jules Huret est tout simplement stupide. Du reste, le fait même que, comme vous le rappelez, cet auteur ait laissé son nom au prix éponyme derrière lequel courent tous les ânes de Paris et même ceux de Navarre est une juste moquerie, un retournement comique des événements qui ne s’en laissent jamais compter.Dois-je rappeler que le roman, justement, allait, quelques années seulement après cette sottise pompeusement affirmée, produire quelques-uns de ses plus grands chefs-d’œuvre avec Conrad, Proust, Musil, Joyce, Broch, Faulkner, Bernanos ou Sábato ? Remarquez a contrario dans cette même enquête remarquablement menée par Jules Huret, qui reste encore d’actualité plus d’un siècle après sa parution, la réponse faite par J.-K. Huysmans, qui, évoquant ce que nous appellerions maintenant la voie de garage dans laquelle s’engageait alors le roman, coincé entre le spiritualisme pur et la bauge matérialiste, n’avait toutefois pas encore osé évoquer ni réellement peindre le personnage du prêtre, ses tourments de conscience et d’âme. Ce sera chose faite quelques années plus tard avec Bernanos qui, dans son premier roman datant de 1926, Sous le soleil de Satan, sut mieux que l’auteur de Là-bas créer, selon les vœux d’ailleurs de ce dernier, une sorte de matérialisme spiritualiste. J’ajoute que pareille tentation consistant à annoncer la mort prochaine du roman s’est bien souvent répétée au cours de l’histoire littéraire : il s’agit d’abattre le roman ou, à tout le moins, d’en pratiquer la dissection savante, par exemple après la mort du naturalisme puis à la sortie du premier Conflit mondial, lorsque de jeunes écrivains ont tout d’un coup compris que les leçons érudites d’un France, d’un Loti, d’un Bourget ou même d’un Barrès ne pouvaient plus être suivies à la lettre si je puis dire, à moins de ne point craindre le ridicule. Ainsi, le 14 octobre 1924, Boylesve donnait à la Revue de France son article intitulé Un genre littéraire en danger, le Roman qui sonna l'ouverture d'une querelle devant occuper toute l'année 1925, et pendant laquelle les défenses succédèrent aux réquisitoires. En 1925 fut fondé le prix Théophraste-Renaudot, afin de concurrencer justement le prix Goncourt. En 1926 je l’ai dit, Bernanos faisait paraître Sous le soleil de Satan, roman romanesque s’il en est, tout droit sorti des lectures de Balzac, Barbey et Bloy. Que voulez-vous, les romanciers écrivent et ceux qui ne savent pas écrire se posent la sempiternelle question de la mort de l’écriture… Toutefois, Edmond de Goncourt, il faut le noter, en veut autant au roman («Pour moi il y a une nouvelle forme à trouver que le roman pour les imaginations en prose») qu’au romanesque, c’est-à-dire au fait, dans son esprit, de faire sortir les marquises à cinq heures. Pour ma part, je considère le romanesque dans l’acception qu’en donnait Bergamín, qui y voyait une sorte de monstre mystérieux, tapi au centre du labyrinthe qu’est tout roman, en tout cas tout bon roman. J’ajouterai que ce monstre est, comme celui que traquent les astronomes, une sorte de trou noir avalant le langage, le livre dans son ensemble pouvant donc être compris comme le résultat de cette chute de l’écriture dans la gueule du monstre (Mario Vargas Llosa parle, lui, de «cratère»), ce vortex qui n’avale jamais tout à fait le langage mais, comme dans le conte de Poe, permet qu’une minuscule bouteille survive à l’engloutissement. Du génie de l’artiste dépendront deux choses : la profondeur à laquelle il aura réussi à descendre et, surtout, la matière exotique qu’il sera parvenu à enfermer dans la bouteille. Broch, avec sa Mort de Virgile, est descendu très bas, de même que Sábato avec le dernier tome de sa trilogie romanesque, L’Ange des ténèbres. Je ne vois, aujourd’hui, qu’un seul auteur ayant osé arpenter le gouffre (et encore, sans l’aide d’aucun cicérone !) : Maurice G. Dantec, avec Villa Vortex et les romans étranges et fascinants qui ont suivi ce livre que l’on dirait hermétiquement clos sur d’inavouables vérités.Quoi qu’il en soit, faire grief au romancier, lorsqu’il écrit un roman, d’évoquer l’anecdotique, est une idiotie, extrémisée par les tentatives elles-mêmes moins idéologiques que sottes du Nouveau Roman, toute cette théorisation inepte (ayant encore et toujours les faveurs des caciques de l’Alma Mater) visant à purger le roman de ses inévitables scories, de ses lenteurs et redites voire, du récit lui-même, en tant que vecteur d’une norme parfaitement critiquable que je nommerai, sans m’étendre, logocentrique au sens où Gilles Deleuze puis George Steiner (qui préfère le mot «logocratique») l’ont entendue et analysée. Il s’agit en somme de suspecter puis de dénoncer (les procédés du flicage intellectuel ne différant pas de ceux utilisés naguère dans les joyeux régimes démocratiques populaires) la position éminente du romancier, deus ex machina ayant don d’ubiquité et pouvoir de vie et de mort sur ses personnages. Qu’est-ce que cela donne ? Maurice Blanchot dans le meilleur des cas et, dans le pire, une suite stochastique de phrases pardon, pas même, de mots, voire de lettres qui affirmeront haut et fort (mais que peuvent affirmer pareils écrits, ceux d’un Pierre Guyotat par exemple ?) que l’écrivain, pardon encore, le garagiste ou le garçon de café, voire la ménagère, en ont bel et bien fini avec la dictature judéo-chrétienne imposant un double horizon : un principe d’autorité qui décide, en somme, ex nihilo, de faire émerger la parole du néant puis de la faire cesser et un autre, que je dirai de légitimité, qui pose de façon corollaire qu’une tradition existe qui doit être respectée et connue avant même que d’être balayée par quelques ignares qui se proclament génies. Je vous rappelle que Monsieur Ouine, le dernier roman de Georges Bernanos, va plus loin, infiniment plus loin, dans sa tentative crépusculaire de «déconstruction» de l’ordre logocentrique occidental, que l’ensemble des productions péniblement accouchées par le Nouveau Roman, qu’aujourd’hui plus personne ne lit, pas même les thésards en peine de sujets. Oui, le rêve de tous ces cancres désireux de secouer le cocotier de la tradition a été déjà fait, et avec quelle finesse, par le Monsieur Teste de Paul Valéry ou par ce qu’on appela naguère l’écriture blanche, Saint Graal romanesque où s’abreuvent ces ânes des années après le passage des fauves. Une fois pour toutes, Ernesto Sábato a punaisé tous ces cancrelats bavards en écrivant : «Un roman dans lequel le créateur – et déjà le mot «créateur» devrait être remplacé par un autre – ne ferait pas intervenir son point de vue et ses opinions devrait être une vaste, que dis-je ? une totale description de l'univers, de tout ce que l'on peut voir, toucher, sentir, goûter et palper, pour ne pas sortir du sensorialisme de base de la doctrine». Une aberration en somme, un monstre, ou, je l’ai dit : une chimère.
3 – A propos justement du roman, Edmond de Goncourt disait : «Le roman est un genre usé, éculé, qui a dit tout ce qu’il avait à dire…». Aussi, et au-delà du simple fait – peut-être paradoxal – que cet auteur ait donné son nom à un prix littéraire qui, de par sa prééminence, contribue en effet à la promotion du roman comme genre ultime et incontournable, que pensez-vous de cette assertion ?Cette réponse d’Edmond de Goncourt à Jules Huret est tout simplement stupide. Du reste, le fait même que, comme vous le rappelez, cet auteur ait laissé son nom au prix éponyme derrière lequel courent tous les ânes de Paris et même ceux de Navarre est une juste moquerie, un retournement comique des événements qui ne s’en laissent jamais compter.Dois-je rappeler que le roman, justement, allait, quelques années seulement après cette sottise pompeusement affirmée, produire quelques-uns de ses plus grands chefs-d’œuvre avec Conrad, Proust, Musil, Joyce, Broch, Faulkner, Bernanos ou Sábato ? Remarquez a contrario dans cette même enquête remarquablement menée par Jules Huret, qui reste encore d’actualité plus d’un siècle après sa parution, la réponse faite par J.-K. Huysmans, qui, évoquant ce que nous appellerions maintenant la voie de garage dans laquelle s’engageait alors le roman, coincé entre le spiritualisme pur et la bauge matérialiste, n’avait toutefois pas encore osé évoquer ni réellement peindre le personnage du prêtre, ses tourments de conscience et d’âme. Ce sera chose faite quelques années plus tard avec Bernanos qui, dans son premier roman datant de 1926, Sous le soleil de Satan, sut mieux que l’auteur de Là-bas créer, selon les vœux d’ailleurs de ce dernier, une sorte de matérialisme spiritualiste. J’ajoute que pareille tentation consistant à annoncer la mort prochaine du roman s’est bien souvent répétée au cours de l’histoire littéraire : il s’agit d’abattre le roman ou, à tout le moins, d’en pratiquer la dissection savante, par exemple après la mort du naturalisme puis à la sortie du premier Conflit mondial, lorsque de jeunes écrivains ont tout d’un coup compris que les leçons érudites d’un France, d’un Loti, d’un Bourget ou même d’un Barrès ne pouvaient plus être suivies à la lettre si je puis dire, à moins de ne point craindre le ridicule. Ainsi, le 14 octobre 1924, Boylesve donnait à la Revue de France son article intitulé Un genre littéraire en danger, le Roman qui sonna l'ouverture d'une querelle devant occuper toute l'année 1925, et pendant laquelle les défenses succédèrent aux réquisitoires. En 1925 fut fondé le prix Théophraste-Renaudot, afin de concurrencer justement le prix Goncourt. En 1926 je l’ai dit, Bernanos faisait paraître Sous le soleil de Satan, roman romanesque s’il en est, tout droit sorti des lectures de Balzac, Barbey et Bloy. Que voulez-vous, les romanciers écrivent et ceux qui ne savent pas écrire se posent la sempiternelle question de la mort de l’écriture… Toutefois, Edmond de Goncourt, il faut le noter, en veut autant au roman («Pour moi il y a une nouvelle forme à trouver que le roman pour les imaginations en prose») qu’au romanesque, c’est-à-dire au fait, dans son esprit, de faire sortir les marquises à cinq heures. Pour ma part, je considère le romanesque dans l’acception qu’en donnait Bergamín, qui y voyait une sorte de monstre mystérieux, tapi au centre du labyrinthe qu’est tout roman, en tout cas tout bon roman. J’ajouterai que ce monstre est, comme celui que traquent les astronomes, une sorte de trou noir avalant le langage, le livre dans son ensemble pouvant donc être compris comme le résultat de cette chute de l’écriture dans la gueule du monstre (Mario Vargas Llosa parle, lui, de «cratère»), ce vortex qui n’avale jamais tout à fait le langage mais, comme dans le conte de Poe, permet qu’une minuscule bouteille survive à l’engloutissement. Du génie de l’artiste dépendront deux choses : la profondeur à laquelle il aura réussi à descendre et, surtout, la matière exotique qu’il sera parvenu à enfermer dans la bouteille. Broch, avec sa Mort de Virgile, est descendu très bas, de même que Sábato avec le dernier tome de sa trilogie romanesque, L’Ange des ténèbres. Je ne vois, aujourd’hui, qu’un seul auteur ayant osé arpenter le gouffre (et encore, sans l’aide d’aucun cicérone !) : Maurice G. Dantec, avec Villa Vortex et les romans étranges et fascinants qui ont suivi ce livre que l’on dirait hermétiquement clos sur d’inavouables vérités.Quoi qu’il en soit, faire grief au romancier, lorsqu’il écrit un roman, d’évoquer l’anecdotique, est une idiotie, extrémisée par les tentatives elles-mêmes moins idéologiques que sottes du Nouveau Roman, toute cette théorisation inepte (ayant encore et toujours les faveurs des caciques de l’Alma Mater) visant à purger le roman de ses inévitables scories, de ses lenteurs et redites voire, du récit lui-même, en tant que vecteur d’une norme parfaitement critiquable que je nommerai, sans m’étendre, logocentrique au sens où Gilles Deleuze puis George Steiner (qui préfère le mot «logocratique») l’ont entendue et analysée. Il s’agit en somme de suspecter puis de dénoncer (les procédés du flicage intellectuel ne différant pas de ceux utilisés naguère dans les joyeux régimes démocratiques populaires) la position éminente du romancier, deus ex machina ayant don d’ubiquité et pouvoir de vie et de mort sur ses personnages. Qu’est-ce que cela donne ? Maurice Blanchot dans le meilleur des cas et, dans le pire, une suite stochastique de phrases pardon, pas même, de mots, voire de lettres qui affirmeront haut et fort (mais que peuvent affirmer pareils écrits, ceux d’un Pierre Guyotat par exemple ?) que l’écrivain, pardon encore, le garagiste ou le garçon de café, voire la ménagère, en ont bel et bien fini avec la dictature judéo-chrétienne imposant un double horizon : un principe d’autorité qui décide, en somme, ex nihilo, de faire émerger la parole du néant puis de la faire cesser et un autre, que je dirai de légitimité, qui pose de façon corollaire qu’une tradition existe qui doit être respectée et connue avant même que d’être balayée par quelques ignares qui se proclament génies. Je vous rappelle que Monsieur Ouine, le dernier roman de Georges Bernanos, va plus loin, infiniment plus loin, dans sa tentative crépusculaire de «déconstruction» de l’ordre logocentrique occidental, que l’ensemble des productions péniblement accouchées par le Nouveau Roman, qu’aujourd’hui plus personne ne lit, pas même les thésards en peine de sujets. Oui, le rêve de tous ces cancres désireux de secouer le cocotier de la tradition a été déjà fait, et avec quelle finesse, par le Monsieur Teste de Paul Valéry ou par ce qu’on appela naguère l’écriture blanche, Saint Graal romanesque où s’abreuvent ces ânes des années après le passage des fauves. Une fois pour toutes, Ernesto Sábato a punaisé tous ces cancrelats bavards en écrivant : «Un roman dans lequel le créateur – et déjà le mot «créateur» devrait être remplacé par un autre – ne ferait pas intervenir son point de vue et ses opinions devrait être une vaste, que dis-je ? une totale description de l'univers, de tout ce que l'on peut voir, toucher, sentir, goûter et palper, pour ne pas sortir du sensorialisme de base de la doctrine». Une aberration en somme, un monstre, ou, je l’ai dit : une chimère.  4 – Julien Gracq constatait : «la littérature est essentiellement une chose dont il (le lecteur français) parle» et, plus loin : «l’écrivain français se
4 – Julien Gracq constatait : «la littérature est essentiellement une chose dont il (le lecteur français) parle» et, plus loin : «l’écrivain français se
18/07/2011 | Lien permanent
Entretien avec Benoît Hocquet

Richard Millet, L'Opprobre. Essai de démonologie (Gallimard, 2008), p. 167.
Benoît Hocquet
Vous êtes ce qu'on peut appeler un écrivain catholique. Comment se définit le rapport entre ces deux qualités, à savoir écrivain et catholique ? Et à partir de là, est-ce que pour vous l'expérience littéraire est suffisante en elle-même ou ne se conçoit-elle nécessairement qu'avec la Foi, dans un rapport religieux ?
Juan Asensio
Un écrivain qui ne serait que cela : un écrivain catholique, serait un bien mauvais écrivain ou bien un écrivain seulement capable de faire frémir les vieilles filles des Procure. Je vous rappelle que ce genre de classification particulièrement sotte faisait éructer de mécontentement d’immenses écrivains tels que Claudel ou Bernanos, catholiques pour le moins intransigeants. Je reprends à mon compte l’idée de Harold Bloom selon laquelle tout écrivain digne de ce nom doit, lorsqu’il décide d’écrire, «ruiner les vérités sacrées», c’est-à-dire, tout en admirant ses prédécesseurs, faire comme si, avant lui, nul n’avait écrit. Si Hermann Broch n’était resté que respectueux de son modèle antique, jamais il n’aurait pu parvenir à achever son somptueux roman intitulé La mort de Virgile.
De la théorie à la pratique : je ne suis pas écrivain mais critique littéraire et essayiste, ne mélangeons pas les genres. Je dis cela non par dédain envers les écrivains ou dépit de n’en être point mais bien au contraire parce que j’éprouve à leur endroit un respect immense. Or, vous avez sans doute remarqué que n’importe qui, aujourd’hui, se prétend le digne héritier de Céline ou de Proust. Je laisse donc l’appellation d’écrivain, aussi sale qu’une putain centenaire qui n’aurait pas pris de douche, à des vieillards libidineux comme Philippe Sollers et à de prétentieuses bonnes femmes telles que Christine Angot que son nouvel éditeur, Le Seuil, sans la moindre honte, a achetée (comme s'il s'agissait d'une marchandise : c'est peut-être bien le cas, le marché est désarmant) pour une somme parfaitement indécente. Nous nous trouvons dans une époque, hélas, où le premier crétin ayant tagué deux rimes plates sur un mur de pissotière est digne de recevoir tous les honneurs. S’il favorise le «lien social», s’il évoque le délicat phrasé de la banlieue, s’il va même jusqu’à choquer le bon père de famille (en lui rappelant par exemple qu’une gamine de douze ans peut être diablement désirable) tout en restant dans les normes (il faut choquer jusqu’à un certain point mais pas au-delà) en prétendant que l'art se doit d'ignorer les tabous, alors dans ce cas, il peut directement prétendre à l’Académie française.
Benoît Hocquet
Vous évoquez en mal Christine Angot ou Philippe Sollers. Cependant, vous avez suivi depuis quelques années maintenant, avec ce qu'on pourrait nommer un grand zèle critique, l'œuvre de Maurice G. Dantec, dont vous ne lirez pas, comme vous l'annonciez dans une de vos notes, le dernier roman Artefact, paru cette rentrée. Maintenant, il semble que vous n'ayez plus rien à dire sur cet auteur. Pour autant, quel regard jetez-vous sur les nombreux textes critiques que vous lui avez consacrés jusqu'à maintenant ? Est-ce qu'il n'y a pas chez le critique un véritable risque de désaffection au terme d'un long travail, perspective que je trouve personnellement assez désespérante, après que vous l'avez défendu avec conviction pendant si longtemps ? Et pour en finir avec Dantec, ne trouvez-vous pas un peu louche l'esprit de secte qui semble animer toute la communauté de ses lecteurs, quand même le dernier tome de son journal maniait avec une autodérision certaine toutes ces considérations à propos d'une Apocalypse dont l'auteur ne cesse d'annoncer la venue, avec une certaine confusion d'ailleurs ?
Juan Asensio
Beaucoup de questions en une seule.
Je ne renie évidemment aucun de mes textes consacrés aux romans de Maurice G. Dantec, ce serait absurde même si, après ma critique de Villa Vortex qui annonçait (pour qui savait lire, je vous l’accorde) la conversion de son auteur au christianisme, effectivement, je me suis trouvé quelque peu… vidé ou plutôt désarçonné. Et puis, comme ce que j’avais écrit sur Villa Vortex me paraissait, et me paraît encore parfaitement valable pour les romans qui l’ont suivi (à l’exception d’Artefact, vous l’avez signalé, que je n’ai pas lu), à quoi bon réécrire le même texte avec moins de hargne pour défendre l’auteur, moins de vigueur et surtout, sans réellement y croire ?
Un écrivain, pardonnez-moi cette banalité, est une personne sachant écrire et l’on ne peut pas exactement parler de Dantec comme étant un styliste, un puriste de la langue française… Ce qui m’intéressait donc davantage chez cet auteur, c’étaient ses fulgurances, l’étendue de ses références (de Deleuze jusqu’aux Pères de l’Église en passant par beaucoup d’auteurs de science-fiction), le fait de citer, ce que quasiment plus personne ne fait aujourd’hui, par ignorance mais aussi par trouille, des auteurs tels que Georges Bernanos, Dominique de Roux, Pierre Boutang, Léon Bloy, George Steiner et même Ernest Hello (par exemple dans le dernier tome de son Journal)…
Il y a donc, oui, vous avez raison, un risque véritable de fatigue, de lassitude, de désaffection, position compliquée par le fait que je connaissais personnellement Maurice G. Dantec, du moins, jusqu’à ce que son agent littéraire, celui-là même qui l’a fait signer chez Albin Michel, décide que j’étais, subitement, devenu persona non grata, ayant trahi la sainte cause… Me voici une nouvelle fois promu Judas !
Soyons sérieux. Il y a donc, oui encore, un risque non plus simplement de simple désaffection mais de réel éloignement puisque, vous l’aurez compris, la pire calamité pouvant tomber sur un écrivain est la création d’une société des lecteurs, qui ne lisent rien ou de travers et se réclament de l’œuvre d’un romancier à des fins presque systématiquement uniquement, hélas, politiques, ce qui est le cas avec la majorité des lecteurs de Dantec, qui ont peut-être quelque mal à croire que Duns Scott est autre chose qu'un super-gentil de la revue Strange… À mon sens, les meilleurs lecteurs de l’œuvre du romancier sont également ceux qui s’en sont finalement assez rapidement éloignés : Olivier Noël, Bruno Gaultier, Germain Souchet, Jean-Baptiste Morizot et enfin moi-même.
Je ne vois personne d’autre susceptible de défendre intelligemment (Jean-Louis Kuffer peut-être...) les textes de Dantec qui, après tout, est un grand garçon et reste parfaitement libre de diriger sa carrière comme il l’entend.
Benoît Hocquet
C'est très intéressant en un sens puisque vous en revenez presque à l'avis de Richard Millet disant ne trouver dans les romans de Dantec aucune «écriture digne de ce nom». Vous y aviez fait référence dans une de vos notes, en invitant Richard Millet à s'intéresser d'un peu plus près à justement ces éclairs de beauté, ces fulgurances. Par ailleurs, vous évoquez surtout le cas de Dantec mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu passé la même chose avec George Steiner que vous teniez aux commencements pour «génial commentateur» alors que maintenant vous semblez plus le considérer comme un «habile vulgarisateur», comme si l'édifice critique que vous bâtissez patiemment menace à tout moment de s'affaisser comme un château de cartes. Je sais bien que l'infaillibilité critique est impossible mais cela dénote un réel risque.
Juan Asensio
Vous avez tout à fait raison et je n’ai pas l’habitude de me dédire. Attention tout de même : vous n’évoquez que des jugements, les miens (que je ne renie absolument pas) parus sur mon blog alors que j’ai été, vis-à-vis de Steiner comme de Dantec, toujours assez critique dans mes ouvrages. Il n’y a aucune infaillibilité de la critique, qui peut bien sûr se tromper. Or, je ne me suis pas trompé sur Dantec, m’étant contenté, lors de la parution de Villa Vortex, de dire, en somme : voici les raisons pour lesquelles ce romancier est diablement intéressant et voici de quelle façon, en suivant quelle voix, il le deviendra encore plus. La fonction d’un critique est d’accompagner l’auteur, de démêler à ses propres yeux ses ouvrages (comme Claude-Edmonde Magny le fit à propos de Monsieur Ouine de Georges Bernanos, lequel n’oublia pas de remercier la critique…), et non point, comme c’est hélas le cas aujourd’hui, d’en vendre les produits ou de déclarer qu’ils sont périmés, en les ayant, tout au plus, vaguement reniflés. Cela, c’est le métier d’un vendeur de saucisses, pas d’un critique littéraire. Il est vrai que les professions ont aujourd’hui tendance à se mélanger de fâcheuse manière.
Richard Millet, magnifique romancier, nul ne lui conteste ce titre, ferait d’ailleurs bien de revoir sa méthode herméneutique, pour le moins sujette à caution. Je le soupçonne de n’avoir lu aucun roman de Dantec parce que, s’il l’a effectivement lu et qu’il continue d’affirmer qu’il n’y a là pas d’écriture (aussi bancale qu’on le voudra mais, je le répète, charriant des fulgurances), alors cela signifie que cet homme est tout simplement un sot. C’est d’ailleurs un doute qui, dans mon esprit, ne cesse de grandir. Je vous renvoie à ma critique du bizarre Désenchantement de la littérature : d’excellentes choses sont écrites dans ce petit livre mais il y a un problème, et de belle taille, dans le fait que cet ouvrage est davantage qu’un pamphlet un traité de savoir-vivre à l’usage d’un écrivain en fin de course (selon ses propres dires). Nous verrons donc si Millet se tient à son impératif catégorique : le silence, le sien d’abord…
[Ajout du 18 mai : non, si j'en juge par le récent Opprobre].
Le cas de George Steiner est autrement plus complexe que celui de Dantec, d’abord parce qu’il nourrit un étrange rapport avec les auteurs qu’il commente (il sait ne pas leur arriver à la cheville, il souffre de ne point posséder leur talent ou leur génie, certain ami l’a même vu pleurer de rage devant l’évidence de ce fait, et pourtant, il juge ces mêmes auteurs qui le paralysent, il les critique parfois durement, ou ne les cite jamais, l’exemple le plus frappant de ce mutisme étant le cas du Grand d’Espagne, Georges Bernanos); ensuite parce qu’il nourrit un rapport plus que paradoxal avec le christianisme, qui le fascine et l’horripile. Il y a plus : j’ai rencontré l’homme et, ma foi, pour rester poli, je ne l’ai pas franchement trouvé à la hauteur de son œuvre. Dantec, au moins, qui est d’une gentillesse assez exceptionnelle, ne fait pas mentir son œuvre en se juchant sur un promontoire depuis lequel il distribue à ses admirateurs les bons et les mauvais points.
En règle générale, les sociétés de lecteurs, les cercles d’amis, les «happy few», bref, donnez-leur le nom que vous voudrez, qui s’érigent autour d’une œuvre et surtout de son auteur dont il s’agit d’analyser le moindre grattement de nez sont l’une des pires calamités digne de s’abattre sur la tête d’un écrivain : ainsi, pour ne vous citer qu’un seule exemple, la ridicule société des lecteurs de Renaud Camus est d’une insignifiance, d’une prétention et d’une vulgarité sans bornes. Il est vrai que Camus lui-même fait absolument tout ce qu’il est possible de faire pour distribuer, tous les jours, quelques miettes pour lesquelles ses poules et ses coqs seraient prêts à se dévorer les uns les autres.
Benoît Hocquet
Finissons-en donc, puisqu'il le faut. Une chose m'a toujours frappé à la lecture de votre blog, c'est la référence immédiate que vous faites à Andrei Tarkovski et à son chef-d'œuvre Stalker. Ne pensez-vous pas qu'avec des auteurs comme Bergman ou Tarkovski, le cinéma atteint une densité proprement littéraire, supplantant par là même la peinture par exemple ? Il vous est fréquemment arrivé d'évoquer des films et dans une note récente intitulée Synesthésies, vous déploriez l'incapacité de la littérature contemporaine à susciter des images comme elle pouvait le faire autrefois. Est-ce que «le désenchantement de la littérature» dont parle Richard Millet ne s'accompagne pas nécessairement de l'avènement du cinématographe en tant qu'art de la modernité, promis à une large diffusion ?
Juan Asensio
Peut-être mais n’oubliez pas la grande importance de la peinture dans les chefs-d’œuvre de Tarkovski. Certes, certaines des images que ces deux génies nous ont données sont destinées à hanter, je l’espère pour quelques siècles, notre imaginaire.
Votre second point : le cinématographe, s’il est de qualité (Tarr, Bresson, Rohmer, les deux que vous avez cités et une toute petite poignée de maîtres) ne me gêne pas. La télévision en revanche et la pornographie visuelle qu’elle implique, c’est là un autre sujet…
Ceci dit, attention, évitons de faire trop de généralités à propos de la technique qui, en elle-même, n’est ni bonne ni mauvaise : la Toile est ainsi le lieu où naissent (et parfois meurent) des sites ou des blogs d’une immense qualité tout comme celui où pullulent les désirs imbéciles de quelques millions d’anonymes crétins.
Quoi qu’il en soit, dans la note que vous avez l’amabilité de rappeler, je vous rappelle que j’affirmais également que l’Esprit souffle où il veut, puisque je rapprochais certaines des somptueuses images de Matrix des gravures de Doré pour L’Enfer de Dante !
21/05/2008 | Lien permanent
Les Français sont des veaux, pourtant rédimés par l'Agneau

29/03/2004 | Lien permanent
Heureux et fier... Mais après ?, par Serge Rivron

 Aujourd'hui 29 mai 2005, la grande majorité des Français a dit NON. Des voix se sont élevées qu'on présumait depuis si longtemps confinées à la soumission ou à la démission. Un PEUPLE existait qu'on imaginait tellement avachi, qu'on décrivait depuis tellement de temps comme tellement abruti qu'il avait fini lui-même par ne plus se savoir Histoire. Malgré les mensonges dont on pensait l'avoir éparpillé, malgré le gouffre du doute ouvert devant celui à qui l'on répète qu'il a tort, et qui s'avance quand même au châtiment promis, le peuple de France a rejoint son destin. Il attendait seulement que l'Histoire à nouveau le sollicite.Ce soir je ne peux m'empêcher de penser à Georges Bernanos, à ses imprécations contre les imbéciles, à sa France contre les robots : «Les réalistes, mêmes catholiques, m’objecteront que, puisque le mal est fait, mieux vaut ne pas laisser se déchaîner la colère des masses dupées et trahies. Pourquoi ? Nous préférons ce risque pour le monde. Ce risque est selon l’histoire, selon l’homme, selon la nature des choses. Il est selon l’ordre du monde, selon la volonté de Dieu, que les peuples se vengent.»Enlevez, si vous voulez, le «même catholique», et écoutez tonner cette phrase à l'heure de la victoire du non à l'abominable texte qu'on voulait nous faire boire. «Nous préférons ce risque pour le monde». Le peuple français, contre ses édiles, contre toute sa médiature unie dans le mépris, le trucage et le mensonge, le peuple de France a choisi sa voie, ce risque. Le peuple français s'est vengé, et qui plus est il s’est vengé à bon escient, refusant un texte abject et vomissant les mensonges et les menaces par lesquels on voulait le bâillonner. J'en suis heureux, et pour la première fois de mon existence je suis fier, bêtement, d’être de France.
Aujourd'hui 29 mai 2005, la grande majorité des Français a dit NON. Des voix se sont élevées qu'on présumait depuis si longtemps confinées à la soumission ou à la démission. Un PEUPLE existait qu'on imaginait tellement avachi, qu'on décrivait depuis tellement de temps comme tellement abruti qu'il avait fini lui-même par ne plus se savoir Histoire. Malgré les mensonges dont on pensait l'avoir éparpillé, malgré le gouffre du doute ouvert devant celui à qui l'on répète qu'il a tort, et qui s'avance quand même au châtiment promis, le peuple de France a rejoint son destin. Il attendait seulement que l'Histoire à nouveau le sollicite.Ce soir je ne peux m'empêcher de penser à Georges Bernanos, à ses imprécations contre les imbéciles, à sa France contre les robots : «Les réalistes, mêmes catholiques, m’objecteront que, puisque le mal est fait, mieux vaut ne pas laisser se déchaîner la colère des masses dupées et trahies. Pourquoi ? Nous préférons ce risque pour le monde. Ce risque est selon l’histoire, selon l’homme, selon la nature des choses. Il est selon l’ordre du monde, selon la volonté de Dieu, que les peuples se vengent.»Enlevez, si vous voulez, le «même catholique», et écoutez tonner cette phrase à l'heure de la victoire du non à l'abominable texte qu'on voulait nous faire boire. «Nous préférons ce risque pour le monde». Le peuple français, contre ses édiles, contre toute sa médiature unie dans le mépris, le trucage et le mensonge, le peuple de France a choisi sa voie, ce risque. Le peuple français s'est vengé, et qui plus est il s’est vengé à bon escient, refusant un texte abject et vomissant les mensonges et les menaces par lesquels on voulait le bâillonner. J'en suis heureux, et pour la première fois de mon existence je suis fier, bêtement, d’être de France. Et après ? Le texte rejeté cumulait les chausse-trapes, à l’espoir, à l’éthique, à l’histoire, à l’économie, à la solidarité, à la simple possibilité pour les hommes en société de vivre et d’aimer en préférant l’être à l’avoir, et d’être respectés comme êtres humains avant de l’être pour leur pouvoir de produire ou de consommer. Un peuple a majoritairement refusé l’institutionnalisation de ce qu’il pressentait comme une émanation de la morbidité. J’entends au gré de mes zappings pérorer les perdants, et les «vainqueurs» tenter, devant la morgue de leurs adversaires, des arguments pour reconstruire enfin l’Europe que les peuples attendent, et j’ai peur que la vengeance de mon peuple n’en soit qu’à son premier acte.Barrozo ne croit pas à la possibilité d’une renégociation, et Chirac nous parle de porter le verdict des Français devant les instances européennes tout en menaçant les Français de sa propre définition de «l’intérêt national». Personne n’a relevé cette ultime argutie. Sarkozy plante ses banderilles pour son élection certaine à la Présidence. Mammère et Ségolène s’enlisent dans la mauvaise foi, ils finiront par rendre Marine Le Pen sympathique à l’imbécile bernanosien lambda. On ose encore dire que le NON tourne le dos à l’Europe. Une souriante blondasse et quelques ministres fatigués nous parlent de gâchis comme si le gâchis n’était pas de leur fait. Arlette est persuadée que les 15 millions de Français qui ont dit non veulent avant tout qu’on les protège, et Dominique Voynet saisit cette planche moisie pour encore une fois remettre le terrible verdict sur l’angoisse et la paupérisation des Français.Ils n’ont rien entendu, ou si peu.Il faudra pourtant qu’on en sorte avant que la prochaine manœuvre des pantins ne provoque un carnage. On me rétorquera que loin s’en faut. Il y a six mois à peine, la ratification par les Français du Traité constitutionnel était vendue comme une formalité dans les salons de la «gouvernance».
Et après ? Le texte rejeté cumulait les chausse-trapes, à l’espoir, à l’éthique, à l’histoire, à l’économie, à la solidarité, à la simple possibilité pour les hommes en société de vivre et d’aimer en préférant l’être à l’avoir, et d’être respectés comme êtres humains avant de l’être pour leur pouvoir de produire ou de consommer. Un peuple a majoritairement refusé l’institutionnalisation de ce qu’il pressentait comme une émanation de la morbidité. J’entends au gré de mes zappings pérorer les perdants, et les «vainqueurs» tenter, devant la morgue de leurs adversaires, des arguments pour reconstruire enfin l’Europe que les peuples attendent, et j’ai peur que la vengeance de mon peuple n’en soit qu’à son premier acte.Barrozo ne croit pas à la possibilité d’une renégociation, et Chirac nous parle de porter le verdict des Français devant les instances européennes tout en menaçant les Français de sa propre définition de «l’intérêt national». Personne n’a relevé cette ultime argutie. Sarkozy plante ses banderilles pour son élection certaine à la Présidence. Mammère et Ségolène s’enlisent dans la mauvaise foi, ils finiront par rendre Marine Le Pen sympathique à l’imbécile bernanosien lambda. On ose encore dire que le NON tourne le dos à l’Europe. Une souriante blondasse et quelques ministres fatigués nous parlent de gâchis comme si le gâchis n’était pas de leur fait. Arlette est persuadée que les 15 millions de Français qui ont dit non veulent avant tout qu’on les protège, et Dominique Voynet saisit cette planche moisie pour encore une fois remettre le terrible verdict sur l’angoisse et la paupérisation des Français.Ils n’ont rien entendu, ou si peu.Il faudra pourtant qu’on en sorte avant que la prochaine manœuvre des pantins ne provoque un carnage. On me rétorquera que loin s’en faut. Il y a six mois à peine, la ratification par les Français du Traité constitutionnel était vendue comme une formalité dans les salons de la «gouvernance».
30/05/2005 | Lien permanent
Amnésie de Sarah Vajda ou les voix de nos morts

 S’il se trouve, les pauvres, des lecteurs aimant les déshabillés de gaze érotico-spirituelle qui deviennent de plus en plus les paletots aguicheurs de la littérature contemporaine et, moins poétiquement, comme son parterre de courges odorantes s’étendant jusqu’à l’horizon, qu’ils passent leur chemin soyeux et réfugient leur regard et quelque autre organe indolent dans un livre d’Alina Reyes par exemple. Ceux-là, je le répète, perdront leur temps inconsistant et parfumé à moins que, à trop voisiner avec la force et goûter pour une fois, à petites lampées, certes, de minet, les jets roboratifs d’une écriture rageuse, ils risquent une cassure nette de leur colonne vertébrale ou bien une explosion de leur estomac tapissé de fleurs. Je propose une nourriture plus rude, une vraie lampée de plomb fondu plutôt, un bain d’acide qui aurait la particularité de révéler plutôt que de corrompre ou de dissoudre, Amnésie de Sarah Vajda. L’évidence même du talent ne nous empêchera toutefois pas de rappeler cette banalité confiante : Sarah Vajda, de livres en livres pléthoriques (son Barrès (1) mais, plus encore, son monstrueux Edern-Hallier(2)), souvent confus, presque toujours gonflés de redites et d’images qu’il s’agit de crever comme on perce une bulle remontée des profondeurs, écrit le même livre, lui aussi monstrueux, infini, de pierre rugueuse plus que de sable, poursuit comme une vierge folle le même visage grimaçant d’une France aimée dans sa déchéance, aimée maladivement dans son mensonge et sa grimace de cadavre : «La Collaboration, est-il dit à propos d’un des personnages du roman qui semble être le frère érudit de la romancière, n’a pas cessé d’être son champ d’études, sa cosa mentale». Sarah Vajda, elle, paraît littéralement dévorée par cette lèpre, pas seulement mentale, qui pour a nom (j’en donnerai un autre plus loin, tout aussi peu noble) : déshonneur.Amnésie, dont l’encre noir n’en finit pas de poisser mes doigts, est un livre consacré aux morts, aux seuls morts que, selon Sarah, il ne faut jamais prétendre enterrer trop vite, comme si nous voulions nous en débarrasser, les oublier. Au contraire, il s’agit d’ouvrir, semblables à de petits enfants courageux, les yeux dans l’obscurité, de fixer les spectres et d’oser dire : «Je me souviens» et encore : «Je vous attendais» et enfin : «Parlez». Écoutez donc, alors, l’étrange rumeur qui, comme un roulement assourdi, soulève la terre grasse, jamais repue de sang, impur ou saint, maudit ou consacré, le sang de la France charnelle et, pour cela, parce qu’elle est charnelle et pauvre, mystique, écoutez ce chant de la nuit aux lueurs confuses grondant de montagne en montagne, par exemple dans Stalag (3) de Jean Védrines, superbe roman des voix fidèles ou infidèles, lumineuses ou démoniaques, les voix étranges de nos morts qu’à son tour Sarah Vajda a voulu écouter, depuis de longues années troublée par leur écho atténué. Vajda et Védrines d’ailleurs sont de la même couche impure, celle qui a été contaminée par les sucs lents de l’ancien professeur de langues, experts en mots creux, sonores et vides, Monsieur Ouine, autre mort qui ne meurt pas, autre carcasse immense, celle-là de la taille d’une civilisation, la nôtre, qui ne peut se résoudre à crever une bonne fois, fameux Valdemar perclus dont le cadavre imputrescible, ayant la dureté de l’ivoire, grouille de mots sales, répétés, de livre en livre encore une fois, par Sarah Vajda et, sans aucun doute également, Jean Védrines, lui aussi lecteur passionné de Bernanos. Les morts mastiquent assurément, ils ont même, dit-on, la manie tenace de vouloir se relever de leur trou puant, Michaël Ranft le prédit dans un petit livre (4) écrit pour apaiser justement leur ire, l’insatiable colère des morts. Ouine mastique à sa façon, mâchonne les mots de corruption à l’oreille tendue du jeune Steeny, avant qu’il ne dévore sa propre substance et tombe dans son âme corrompue devenue puits sans fond. Ils veulent tous revenir, ces morts insatiables, quitte à forer des galeries avec leurs dents blanches mais certains, écoutez-les, chantent, les chers écrivains (Bernanos, Péguy, Barrès) qui annoncent la déchéance, et l’orgueil d’une vieille nation, et l’imposture et, dernière note vibrante au-dessus du charnier entrouvert, la trahison, autre nom du déshonneur. Des morts, leurs phrases sans répit dressées contre l’enflure du Mal, pour contrebalancer l’influence, mauvaise, d’autres morts, qui grondent sous terre, jamais apaisés, toujours prêts, fiévreux. Des morts deux fois morts, des morts, donc, trahis. D’abord tombés pour de mauvaises paroles qu’ils crurent de toute leur âme simple, ces mensonges proférés par l’Arrière sacrifiant l’Avant, les enfants des campagnes envoyés au feu, les voici donc enterrés une nouvelle fois, oubliés une deuxième fois, muselés de nouveau sous le poids des travestissements, des gauchissements pieux de l’histoire officielle : leurs maigres os tiendraient sans doute, réduits en une fine poudre grise, dans ce mystérieux coffret que Morel va dérober à l’enquête officielle mais leurs pensées, toutes sanglantes dans leur démesure, se cognent aux murs de leur prison grande comme un monde. En terre de France riche de tant de voix qui ne sont pas toutes, tant s’en faut, de bon conseil, nul écrivain de race ne s’est levé qui n’ait, d’abord, patiemment, humblement, parfois tressaillant d’horreur, écouté ce que lui disaient les morts. L’amnésie, ainsi, est trahison plutôt qu’oubli. C’est que Judas est le saint patron de la France, voilà l’irrécusable folie que ne cesse de nous clamer Sarah Vajda, agenouillée, pouilleuse et mendiante, athée encore elle ne cesse de nous le répéter, sous la croix tordue de Grünewald. Judas bien décidé, par sa forfaiture, à hâter, à réveiller la Révélation messianique bizarrement engourdie comme, dans l’ignoble commerce, certains petits apôtres véreux prétendirent, en se débarrassant des Juifs, conduire plus promptement la France et l’Europe vers l’âge d’or enfin révélé, acheté au prix du sang. Haceldama, la France est un charnier à ciel ouvert, il suffit pour s’en convaincre qu’un malencontreux accident de la route, lorgnant à peine du côté de l’embardée romanesque, éventre l’une quelconque de ses terres gonflées de morts. La France oublieuse (alors que tout, dans le roman de Sarah Vajda, est affaire de mémoire retrouvée, reconquise) est bâtie sur un charnier et qui prétend clamer cette vérité noire est condamné, comme l’apôtre félon, à entrer dans la nuit, qu’il s’agisse, dans notre roman, de l’infatigable Brodski, du doux professeur Frank ou du tenace flic Morel, qui joue là sa dernière carte, il le sait mais n’en a cure. Qui dénonce le Mal sera dévoré par le Mal, c’est la loi implacable de la littérature, Fernando Vidal Olmos d’Ernesto Sabato et le narrateur de La Geôle d’Hubert Selby Jr., parmi tant d’autres personnages sacrifiés, l’apprirent assez : nul ne saurait s’exclure du royaume vicié des hommes, tous pécheurs. Morel à son tour, après Brodski, Frank et Kariew, son énigmatique professeur en criminologie, plonge dans la nuit les yeux ouverts. Il y verra, première station de sa descente, il y retrouvera plutôt le visage d’une jeune femme juive jadis aimée, Sibylle, devenue mère mais toujours insolente, de Marie Sarah qu’il aimera également avant de se suicider en sa compagnie dans une chambre d’hôtel. Marie Sarah, sauvée in articulo mortis, tombée dans un coma profond, mourra cependant, sans jamais s’être réveillée, après avoir donné naissance à une petite fille, prénommée (sa mère elle-même, dans son long sommeil parsemé de quelques mots, l’a soufflé) Véronique, jeune fille chargée peut-être, mais nous n’en saurons rien, de pacifier les cœurs pleins de violence, de déposer, sur le visage horrible des morts, un voile mouillé de larmes.Vous jugez l’histoire invraisemblable et la symbolique trop grossièrement christique c’est-à-dire, sous la plume de notre écrivain, bloyenne, torve ou encore réversible, de cette réversibilité des mérites que l’on nomme communion des saints ? Invraisemblable, cette histoire l’est bien évidemment, et encore n’ai-je pas pointé les nombreuses bizarreries, d’abord chronologiques, qui trament cette histoire complexe où les récits de morts (Frank, Brasillach mais aussi Morel, flic expédié dès les premières pages comme dans Villa Vortex de Maurice G. Dantec) ou de presque morts (Toulouse, serial killer de mauvais polar) s’emboîtent tout en paraissant contaminer les cœurs et les cervelles de celles et ceux qui les écoutent et les lisent. Les couples eux aussi (Morel et Sibylle et Marie Sarah, mais aussi le flic Javier Sanchez et la jeune Bèla, sans oublier ce couple accidenté par qui tout est arrivé et dont nous ne saurons rien, si ce n’est qu’il ressemble un peu trop à celui que Nimier forma avec sa dernière conquête, ainsi qu’Alfred Brodski et Rosalía Vásquez et, enfin, platoniques, Jehuda Frank et Marie Sarah) tissent des liens qui se moquent de tout souci de véracité, fût-elle littéraire car, nous répète Sarah Vajda, ne sommes-nous pas entrés, avec tant d’autres auteurs qui ont écrit l’immense livre qu’est la France, en Romancie ? L’invraisemblance, si elle est bien réelle, parfois même masquée laborieusement et rattachée au reste de l’histoire sous les dehors d’une simple enquête policière en terre bourgeoise toulousaine, est donc celle du mauvais rêve duquel nous ne pouvons nous réveiller, puisque le dormeur, dès le premier chapitre, est mort, cauchemar qui fait se révéler, avec une précision chirurgicale, l’enchaînement crépusculaire des actions mauvaises, comme nous le voyons par exemple dans La Promesse de Dürrenmatt, autre roman de l’exploration d’un Mal enfoui, pourtant partout bouillonnant, désireux de revenir à la surface, autre livre superficiellement artificiel, je veux dire construit à seule fin de dévoiler ce qui était su, de toute façon, dès le début : pas d’échappatoire possible, nulle trouée d’air frais dans ce monde contaminé par les morts. Car ce roman auxquels les mauvais critiques donneront du retour du refoulé et autre balivernes lorgnant vers la cure et l’anamnèse psychanalytique, car ce roman ténébreux, Amnésie, comme tous les grands romans, est un bâtard né d’une multitude de pères, le surgeon englué dans un cauchemar issu tout à la fois de la geste colossale et épique du roman français jusqu’à son étrange éclipse, d’abord annoncée avant que d’être réellement vécue puis, aujourd’hui, son oubli lamentable. Amnésie est un conte noir, lui qui n’hésite jamais à convoquer les ombres d’Alice et de Peter Pan, et ce qu’il chuchote n’est pas exactement une histoire pour petits enfants. Il évente le secret que d’autres écrivains ont tremblé de coucher par écrit dans leurs propres romans, Barrès, Péguy et Bernanos je l’ai dit mais aussi le fils maudit de ce dernier, Michel Bernanos, et combien d’autres, Céline, Brasillach, Malraux, Bloy, Giraudoux, tous convoqués pour une scène de confession ultime, forcément nocturne, où il s’agira de rendre la vérité, innommable, avant de se taire à jamais. Quel est ce secret de notre littérature et, Sarah Vajda ne craint pas de l’affirmer, de la conscience nationale française tout entière ? Allez, la romancière le sait bien, ce secret misérable, mais n’en finit pourtant pas de le chercher et, lorsqu’elle le tiendra, elle se trouvera sans aucun doute tout étonnée de constater qu’il est si petit, qu’il tient aussi peu de place, que le secret, en un mot, était aussi visible que la lettre volée de Poe, qu’il n’était même pas, comme dans Amnésie, enfermé dans un coffret scellé. Ce secret ? Tout simplement : la littérature française, depuis au moins un siècle, la France (pour Vajda, la France et sa littérature sont une seule et même personne), est littéralement hantée par le crime inouï qu’elle a laissé perpétrer, parfois même encouragé, chanté, sur son propre sol. De sorte que, une fois de plus, la littérature s’écrit devant le bourreau, de sorte que, comme Albert Thibaudet dans sa République des Professeurs citant Péguy, nous pouvons écrire que «Aujourd’hui comme jamais, tout propos qui se tient, tout article de revue ou de journal, tout livre, tout cahier qui s’écrit de l’affaire Dreyfus a en lui, porte en lui on ne sait quel virus, quel point de virus qui nous travaille infatigable». Pourtant ce virus, quel que soit le grossissement de notre microscope, lui qui bénéficie d’une puissance pas moins grande que celle qu’offrit à la nation la fameuse affaire faisant office de gigantesque loupe, pourtant ce mal paraît indétectable, peut-être parce qu’il a mué, préférant, après la trop visible livraison brune jadis, la rouge naguère, aujourd’hui la verte et leur miction immonde. Peut-être encore parce que, tout véritable chercheur de traces le sait bien, le lieu du crime le plus épouvantable est absolument identique à n’importe quel autre lieu, je veux dire que le plus infime détail est encore une manne trop précieuse, un miracle rare, pour être délivré à celui qui revient, comme le personnage de Kertesz (mais avant, lui, la Juliette de Sade), sur le lieu insigne et pourtant affreusement banal de la torture inimaginable. Parfois, certes, la réalité, en silence, semble crier ce qui doit être caché, tu, à n’importe quel prix, fût-ce le meurtre des témoins gênants. Le voile se déchire et les personnages traversent, comme Arthur Gordon Pym, Marlow ou, dans le roman de Sarah Vajda, Brodski et Morel, l’épais mur de brume. Et de quitter dès lors le territoire bienfaisant de la Romancie pour pénétrer en Réalité, c’est-à-dire, selon la romancière, au «pays de la Paranoïa» qui n’est autre que le nôtre, la France, à bout de souffle, honteux de son passé abject, honteux aussi de son passé glorieux, mastiquant sans relâche la chique aigre de sa grandeur oubliée. Ainsi encore, séjournant à Paris comme tous les étés, Jehuda Frank, comme s’il s’agissait d’un des déclassés chers à Philip K. Dick, constate la transfiguration du paysage anodin en enfer discret : «Pour l’heure, l’historien ne pouvait s’empêcher de voir dans l’exercice démocratique de la parité la prolongation du décret vichyssois intimant aux conseils municipaux l’ordre d’inscrire au moins une mère de famille dans l’assemblée, la primauté de la verdure sur les machines, l’habitude de fermer les yeux sur la tragédie, le choix de l’hypothèse consolante, les meilleures places du box-office réservées à la variété ou au mélodrame social et au-dessus de tout, souvenir vichyssois parmi les souvenirs, le retour du péché antijuif assaisonné à la sauce tiers-mondiste.» Voilà ce que cache la France, voilà son petit secret qui ne tombera pas, grands dieux non !, dans l’âme scellée du prêtre évoqué par Malraux dans ses Antimémoires : la France est morte, définitivement, avec la cendre envolée de ses milliers de Juifs livrés. «Des hommes avaient commis des horreurs, découpé des femmes écrit Sarah Vajda, assassiné pour de l’argent, tiré sur des inconnus par simple curiosité ou par jeu, avec la légèreté de Brasillach séparant les brebis juives du troupeau de Dieu. Le secret du pays gisait là, dichotomie, schizophrénie entre l’acte et l’intention, dont les Jésuites seuls savaient peut-être le fin mot.» Les Jésuites ? Pas même semble-t-il. Le diable peut-être, oui, Prince de la logique et maître, pour un temps en tout cas, des cadavres.Et alors me demandera tel lecteur à la fibre naïvement romancière, que déduire de cette invisibilité coutumière du Mal, de sa – trop célèbre – banalité, comme abritée dirait-on, camouflée, sous un déguisement de faits anodins qui, mis bout à bout, n’en constituent pas moins une chaîne nous menant aux Enfers ? Car, oui, c’est se montrer bêtement cartésien (comme Morel, décrit de la sorte dans ce beau passage : «Pour toi, Morel, honnête figure cartésienne, est venue l’heure de l’acédie, midi le juste, sans partage, sans autre Ysé que Mémoire revenue, chiendent dont nul pesticide ne viendra à bout»), c’est rester à la surface des choses que de pointer, ici ou là, les incohérences (par exemple, je l’ai dit, chronologiques, celles évoquant de possibles liens souterrains entre les événements, tus, du passé français, et telle explosion d’une usine à gaz) qui parsèment les pages d’Amnésie. Il faut au contraire remarquer que ce roman, comme une toile du Greco tant aimé par l’auteur, fait voisiner deux plans absolument inconciliables si ce n’est par la vertu de l’art : «l’un nous dit Sarah Vajda, celui où des corps à voix articulaient des mots à la suite, l’autre, où des flammes qui n’étaient que leurs âmes hurlaient et chantaient à tue-tête». Ainsi le trio infernal constitué par le tueur en série, surnommé Toulouse et celui qui le protège, quelque notable inspiré d’une actualité récente à l’évidence, mais ici masquée, lui-même surnommé, simplement, «l’Huile» et ayant été corrompu, durant sa jeunesse, par les phrases gidiennes d’un ecclésiastique jouisseur, ainsi ce trio est-il annoncé et comme dédoublé, expliqué, subsumé, en début de roman, par la célèbre toile de Valdès Léal représentant Miguel Mañara (qui inspira dit-on la légende de Don Juan) repenti de ses crimes passés aux côtés du corps en décomposition d’un archevêque. Dans ce roman qui, comme le paysage désertique chanté par T. S. Eliot, est baigné de la lumière d’une étoile mourante, les véritables personnages et, tout autant, la nature de leurs mystérieuses relations, ne sont peut-être pas ceux que nous imaginons s’il est vrai, comme l’éc
S’il se trouve, les pauvres, des lecteurs aimant les déshabillés de gaze érotico-spirituelle qui deviennent de plus en plus les paletots aguicheurs de la littérature contemporaine et, moins poétiquement, comme son parterre de courges odorantes s’étendant jusqu’à l’horizon, qu’ils passent leur chemin soyeux et réfugient leur regard et quelque autre organe indolent dans un livre d’Alina Reyes par exemple. Ceux-là, je le répète, perdront leur temps inconsistant et parfumé à moins que, à trop voisiner avec la force et goûter pour une fois, à petites lampées, certes, de minet, les jets roboratifs d’une écriture rageuse, ils risquent une cassure nette de leur colonne vertébrale ou bien une explosion de leur estomac tapissé de fleurs. Je propose une nourriture plus rude, une vraie lampée de plomb fondu plutôt, un bain d’acide qui aurait la particularité de révéler plutôt que de corrompre ou de dissoudre, Amnésie de Sarah Vajda. L’évidence même du talent ne nous empêchera toutefois pas de rappeler cette banalité confiante : Sarah Vajda, de livres en livres pléthoriques (son Barrès (1) mais, plus encore, son monstrueux Edern-Hallier(2)), souvent confus, presque toujours gonflés de redites et d’images qu’il s’agit de crever comme on perce une bulle remontée des profondeurs, écrit le même livre, lui aussi monstrueux, infini, de pierre rugueuse plus que de sable, poursuit comme une vierge folle le même visage grimaçant d’une France aimée dans sa déchéance, aimée maladivement dans son mensonge et sa grimace de cadavre : «La Collaboration, est-il dit à propos d’un des personnages du roman qui semble être le frère érudit de la romancière, n’a pas cessé d’être son champ d’études, sa cosa mentale». Sarah Vajda, elle, paraît littéralement dévorée par cette lèpre, pas seulement mentale, qui pour a nom (j’en donnerai un autre plus loin, tout aussi peu noble) : déshonneur.Amnésie, dont l’encre noir n’en finit pas de poisser mes doigts, est un livre consacré aux morts, aux seuls morts que, selon Sarah, il ne faut jamais prétendre enterrer trop vite, comme si nous voulions nous en débarrasser, les oublier. Au contraire, il s’agit d’ouvrir, semblables à de petits enfants courageux, les yeux dans l’obscurité, de fixer les spectres et d’oser dire : «Je me souviens» et encore : «Je vous attendais» et enfin : «Parlez». Écoutez donc, alors, l’étrange rumeur qui, comme un roulement assourdi, soulève la terre grasse, jamais repue de sang, impur ou saint, maudit ou consacré, le sang de la France charnelle et, pour cela, parce qu’elle est charnelle et pauvre, mystique, écoutez ce chant de la nuit aux lueurs confuses grondant de montagne en montagne, par exemple dans Stalag (3) de Jean Védrines, superbe roman des voix fidèles ou infidèles, lumineuses ou démoniaques, les voix étranges de nos morts qu’à son tour Sarah Vajda a voulu écouter, depuis de longues années troublée par leur écho atténué. Vajda et Védrines d’ailleurs sont de la même couche impure, celle qui a été contaminée par les sucs lents de l’ancien professeur de langues, experts en mots creux, sonores et vides, Monsieur Ouine, autre mort qui ne meurt pas, autre carcasse immense, celle-là de la taille d’une civilisation, la nôtre, qui ne peut se résoudre à crever une bonne fois, fameux Valdemar perclus dont le cadavre imputrescible, ayant la dureté de l’ivoire, grouille de mots sales, répétés, de livre en livre encore une fois, par Sarah Vajda et, sans aucun doute également, Jean Védrines, lui aussi lecteur passionné de Bernanos. Les morts mastiquent assurément, ils ont même, dit-on, la manie tenace de vouloir se relever de leur trou puant, Michaël Ranft le prédit dans un petit livre (4) écrit pour apaiser justement leur ire, l’insatiable colère des morts. Ouine mastique à sa façon, mâchonne les mots de corruption à l’oreille tendue du jeune Steeny, avant qu’il ne dévore sa propre substance et tombe dans son âme corrompue devenue puits sans fond. Ils veulent tous revenir, ces morts insatiables, quitte à forer des galeries avec leurs dents blanches mais certains, écoutez-les, chantent, les chers écrivains (Bernanos, Péguy, Barrès) qui annoncent la déchéance, et l’orgueil d’une vieille nation, et l’imposture et, dernière note vibrante au-dessus du charnier entrouvert, la trahison, autre nom du déshonneur. Des morts, leurs phrases sans répit dressées contre l’enflure du Mal, pour contrebalancer l’influence, mauvaise, d’autres morts, qui grondent sous terre, jamais apaisés, toujours prêts, fiévreux. Des morts deux fois morts, des morts, donc, trahis. D’abord tombés pour de mauvaises paroles qu’ils crurent de toute leur âme simple, ces mensonges proférés par l’Arrière sacrifiant l’Avant, les enfants des campagnes envoyés au feu, les voici donc enterrés une nouvelle fois, oubliés une deuxième fois, muselés de nouveau sous le poids des travestissements, des gauchissements pieux de l’histoire officielle : leurs maigres os tiendraient sans doute, réduits en une fine poudre grise, dans ce mystérieux coffret que Morel va dérober à l’enquête officielle mais leurs pensées, toutes sanglantes dans leur démesure, se cognent aux murs de leur prison grande comme un monde. En terre de France riche de tant de voix qui ne sont pas toutes, tant s’en faut, de bon conseil, nul écrivain de race ne s’est levé qui n’ait, d’abord, patiemment, humblement, parfois tressaillant d’horreur, écouté ce que lui disaient les morts. L’amnésie, ainsi, est trahison plutôt qu’oubli. C’est que Judas est le saint patron de la France, voilà l’irrécusable folie que ne cesse de nous clamer Sarah Vajda, agenouillée, pouilleuse et mendiante, athée encore elle ne cesse de nous le répéter, sous la croix tordue de Grünewald. Judas bien décidé, par sa forfaiture, à hâter, à réveiller la Révélation messianique bizarrement engourdie comme, dans l’ignoble commerce, certains petits apôtres véreux prétendirent, en se débarrassant des Juifs, conduire plus promptement la France et l’Europe vers l’âge d’or enfin révélé, acheté au prix du sang. Haceldama, la France est un charnier à ciel ouvert, il suffit pour s’en convaincre qu’un malencontreux accident de la route, lorgnant à peine du côté de l’embardée romanesque, éventre l’une quelconque de ses terres gonflées de morts. La France oublieuse (alors que tout, dans le roman de Sarah Vajda, est affaire de mémoire retrouvée, reconquise) est bâtie sur un charnier et qui prétend clamer cette vérité noire est condamné, comme l’apôtre félon, à entrer dans la nuit, qu’il s’agisse, dans notre roman, de l’infatigable Brodski, du doux professeur Frank ou du tenace flic Morel, qui joue là sa dernière carte, il le sait mais n’en a cure. Qui dénonce le Mal sera dévoré par le Mal, c’est la loi implacable de la littérature, Fernando Vidal Olmos d’Ernesto Sabato et le narrateur de La Geôle d’Hubert Selby Jr., parmi tant d’autres personnages sacrifiés, l’apprirent assez : nul ne saurait s’exclure du royaume vicié des hommes, tous pécheurs. Morel à son tour, après Brodski, Frank et Kariew, son énigmatique professeur en criminologie, plonge dans la nuit les yeux ouverts. Il y verra, première station de sa descente, il y retrouvera plutôt le visage d’une jeune femme juive jadis aimée, Sibylle, devenue mère mais toujours insolente, de Marie Sarah qu’il aimera également avant de se suicider en sa compagnie dans une chambre d’hôtel. Marie Sarah, sauvée in articulo mortis, tombée dans un coma profond, mourra cependant, sans jamais s’être réveillée, après avoir donné naissance à une petite fille, prénommée (sa mère elle-même, dans son long sommeil parsemé de quelques mots, l’a soufflé) Véronique, jeune fille chargée peut-être, mais nous n’en saurons rien, de pacifier les cœurs pleins de violence, de déposer, sur le visage horrible des morts, un voile mouillé de larmes.Vous jugez l’histoire invraisemblable et la symbolique trop grossièrement christique c’est-à-dire, sous la plume de notre écrivain, bloyenne, torve ou encore réversible, de cette réversibilité des mérites que l’on nomme communion des saints ? Invraisemblable, cette histoire l’est bien évidemment, et encore n’ai-je pas pointé les nombreuses bizarreries, d’abord chronologiques, qui trament cette histoire complexe où les récits de morts (Frank, Brasillach mais aussi Morel, flic expédié dès les premières pages comme dans Villa Vortex de Maurice G. Dantec) ou de presque morts (Toulouse, serial killer de mauvais polar) s’emboîtent tout en paraissant contaminer les cœurs et les cervelles de celles et ceux qui les écoutent et les lisent. Les couples eux aussi (Morel et Sibylle et Marie Sarah, mais aussi le flic Javier Sanchez et la jeune Bèla, sans oublier ce couple accidenté par qui tout est arrivé et dont nous ne saurons rien, si ce n’est qu’il ressemble un peu trop à celui que Nimier forma avec sa dernière conquête, ainsi qu’Alfred Brodski et Rosalía Vásquez et, enfin, platoniques, Jehuda Frank et Marie Sarah) tissent des liens qui se moquent de tout souci de véracité, fût-elle littéraire car, nous répète Sarah Vajda, ne sommes-nous pas entrés, avec tant d’autres auteurs qui ont écrit l’immense livre qu’est la France, en Romancie ? L’invraisemblance, si elle est bien réelle, parfois même masquée laborieusement et rattachée au reste de l’histoire sous les dehors d’une simple enquête policière en terre bourgeoise toulousaine, est donc celle du mauvais rêve duquel nous ne pouvons nous réveiller, puisque le dormeur, dès le premier chapitre, est mort, cauchemar qui fait se révéler, avec une précision chirurgicale, l’enchaînement crépusculaire des actions mauvaises, comme nous le voyons par exemple dans La Promesse de Dürrenmatt, autre roman de l’exploration d’un Mal enfoui, pourtant partout bouillonnant, désireux de revenir à la surface, autre livre superficiellement artificiel, je veux dire construit à seule fin de dévoiler ce qui était su, de toute façon, dès le début : pas d’échappatoire possible, nulle trouée d’air frais dans ce monde contaminé par les morts. Car ce roman auxquels les mauvais critiques donneront du retour du refoulé et autre balivernes lorgnant vers la cure et l’anamnèse psychanalytique, car ce roman ténébreux, Amnésie, comme tous les grands romans, est un bâtard né d’une multitude de pères, le surgeon englué dans un cauchemar issu tout à la fois de la geste colossale et épique du roman français jusqu’à son étrange éclipse, d’abord annoncée avant que d’être réellement vécue puis, aujourd’hui, son oubli lamentable. Amnésie est un conte noir, lui qui n’hésite jamais à convoquer les ombres d’Alice et de Peter Pan, et ce qu’il chuchote n’est pas exactement une histoire pour petits enfants. Il évente le secret que d’autres écrivains ont tremblé de coucher par écrit dans leurs propres romans, Barrès, Péguy et Bernanos je l’ai dit mais aussi le fils maudit de ce dernier, Michel Bernanos, et combien d’autres, Céline, Brasillach, Malraux, Bloy, Giraudoux, tous convoqués pour une scène de confession ultime, forcément nocturne, où il s’agira de rendre la vérité, innommable, avant de se taire à jamais. Quel est ce secret de notre littérature et, Sarah Vajda ne craint pas de l’affirmer, de la conscience nationale française tout entière ? Allez, la romancière le sait bien, ce secret misérable, mais n’en finit pourtant pas de le chercher et, lorsqu’elle le tiendra, elle se trouvera sans aucun doute tout étonnée de constater qu’il est si petit, qu’il tient aussi peu de place, que le secret, en un mot, était aussi visible que la lettre volée de Poe, qu’il n’était même pas, comme dans Amnésie, enfermé dans un coffret scellé. Ce secret ? Tout simplement : la littérature française, depuis au moins un siècle, la France (pour Vajda, la France et sa littérature sont une seule et même personne), est littéralement hantée par le crime inouï qu’elle a laissé perpétrer, parfois même encouragé, chanté, sur son propre sol. De sorte que, une fois de plus, la littérature s’écrit devant le bourreau, de sorte que, comme Albert Thibaudet dans sa République des Professeurs citant Péguy, nous pouvons écrire que «Aujourd’hui comme jamais, tout propos qui se tient, tout article de revue ou de journal, tout livre, tout cahier qui s’écrit de l’affaire Dreyfus a en lui, porte en lui on ne sait quel virus, quel point de virus qui nous travaille infatigable». Pourtant ce virus, quel que soit le grossissement de notre microscope, lui qui bénéficie d’une puissance pas moins grande que celle qu’offrit à la nation la fameuse affaire faisant office de gigantesque loupe, pourtant ce mal paraît indétectable, peut-être parce qu’il a mué, préférant, après la trop visible livraison brune jadis, la rouge naguère, aujourd’hui la verte et leur miction immonde. Peut-être encore parce que, tout véritable chercheur de traces le sait bien, le lieu du crime le plus épouvantable est absolument identique à n’importe quel autre lieu, je veux dire que le plus infime détail est encore une manne trop précieuse, un miracle rare, pour être délivré à celui qui revient, comme le personnage de Kertesz (mais avant, lui, la Juliette de Sade), sur le lieu insigne et pourtant affreusement banal de la torture inimaginable. Parfois, certes, la réalité, en silence, semble crier ce qui doit être caché, tu, à n’importe quel prix, fût-ce le meurtre des témoins gênants. Le voile se déchire et les personnages traversent, comme Arthur Gordon Pym, Marlow ou, dans le roman de Sarah Vajda, Brodski et Morel, l’épais mur de brume. Et de quitter dès lors le territoire bienfaisant de la Romancie pour pénétrer en Réalité, c’est-à-dire, selon la romancière, au «pays de la Paranoïa» qui n’est autre que le nôtre, la France, à bout de souffle, honteux de son passé abject, honteux aussi de son passé glorieux, mastiquant sans relâche la chique aigre de sa grandeur oubliée. Ainsi encore, séjournant à Paris comme tous les étés, Jehuda Frank, comme s’il s’agissait d’un des déclassés chers à Philip K. Dick, constate la transfiguration du paysage anodin en enfer discret : «Pour l’heure, l’historien ne pouvait s’empêcher de voir dans l’exercice démocratique de la parité la prolongation du décret vichyssois intimant aux conseils municipaux l’ordre d’inscrire au moins une mère de famille dans l’assemblée, la primauté de la verdure sur les machines, l’habitude de fermer les yeux sur la tragédie, le choix de l’hypothèse consolante, les meilleures places du box-office réservées à la variété ou au mélodrame social et au-dessus de tout, souvenir vichyssois parmi les souvenirs, le retour du péché antijuif assaisonné à la sauce tiers-mondiste.» Voilà ce que cache la France, voilà son petit secret qui ne tombera pas, grands dieux non !, dans l’âme scellée du prêtre évoqué par Malraux dans ses Antimémoires : la France est morte, définitivement, avec la cendre envolée de ses milliers de Juifs livrés. «Des hommes avaient commis des horreurs, découpé des femmes écrit Sarah Vajda, assassiné pour de l’argent, tiré sur des inconnus par simple curiosité ou par jeu, avec la légèreté de Brasillach séparant les brebis juives du troupeau de Dieu. Le secret du pays gisait là, dichotomie, schizophrénie entre l’acte et l’intention, dont les Jésuites seuls savaient peut-être le fin mot.» Les Jésuites ? Pas même semble-t-il. Le diable peut-être, oui, Prince de la logique et maître, pour un temps en tout cas, des cadavres.Et alors me demandera tel lecteur à la fibre naïvement romancière, que déduire de cette invisibilité coutumière du Mal, de sa – trop célèbre – banalité, comme abritée dirait-on, camouflée, sous un déguisement de faits anodins qui, mis bout à bout, n’en constituent pas moins une chaîne nous menant aux Enfers ? Car, oui, c’est se montrer bêtement cartésien (comme Morel, décrit de la sorte dans ce beau passage : «Pour toi, Morel, honnête figure cartésienne, est venue l’heure de l’acédie, midi le juste, sans partage, sans autre Ysé que Mémoire revenue, chiendent dont nul pesticide ne viendra à bout»), c’est rester à la surface des choses que de pointer, ici ou là, les incohérences (par exemple, je l’ai dit, chronologiques, celles évoquant de possibles liens souterrains entre les événements, tus, du passé français, et telle explosion d’une usine à gaz) qui parsèment les pages d’Amnésie. Il faut au contraire remarquer que ce roman, comme une toile du Greco tant aimé par l’auteur, fait voisiner deux plans absolument inconciliables si ce n’est par la vertu de l’art : «l’un nous dit Sarah Vajda, celui où des corps à voix articulaient des mots à la suite, l’autre, où des flammes qui n’étaient que leurs âmes hurlaient et chantaient à tue-tête». Ainsi le trio infernal constitué par le tueur en série, surnommé Toulouse et celui qui le protège, quelque notable inspiré d’une actualité récente à l’évidence, mais ici masquée, lui-même surnommé, simplement, «l’Huile» et ayant été corrompu, durant sa jeunesse, par les phrases gidiennes d’un ecclésiastique jouisseur, ainsi ce trio est-il annoncé et comme dédoublé, expliqué, subsumé, en début de roman, par la célèbre toile de Valdès Léal représentant Miguel Mañara (qui inspira dit-on la légende de Don Juan) repenti de ses crimes passés aux côtés du corps en décomposition d’un archevêque. Dans ce roman qui, comme le paysage désertique chanté par T. S. Eliot, est baigné de la lumière d’une étoile mourante, les véritables personnages et, tout autant, la nature de leurs mystérieuses relations, ne sont peut-être pas ceux que nous imaginons s’il est vrai, comme l’éc
23/01/2006 | Lien permanent
Excellences et nullités, une année de lectures : 2013

 Excellences et nullités de l'année 2010.
Excellences et nullités de l'année 2010. Excellences et nullités de l'année 2011.
Excellences et nullités de l'année 2011. Excellences et nullités de l'année 2012.
Excellences et nullités de l'année 2012.Excellences.
 Méridien de sang de Cormac McCarthy (Seuil, coll. Points Roman).
Méridien de sang de Cormac McCarthy (Seuil, coll. Points Roman). Requiem pour une nonne de William Faulkner (Gallimard, coll. Folio).
Requiem pour une nonne de William Faulkner (Gallimard, coll. Folio). Par-delà le crime et le châtiment de Jean Améry (Actes Sud, coll. Babel).
Par-delà le crime et le châtiment de Jean Améry (Actes Sud, coll. Babel). La gloire du vaurien de René Ehni (Seuil, coll. Points Roman).
La gloire du vaurien de René Ehni (Seuil, coll. Points Roman). Un anarchiste de Joseph Conrad (Fayard, coll. Mille et une nuits).
Un anarchiste de Joseph Conrad (Fayard, coll. Mille et une nuits). Entretien sur Dante d'Ossip Mandelstam (La Dogana).
Entretien sur Dante d'Ossip Mandelstam (La Dogana). Les grands jours de Pierre Mari (Fayard).
Les grands jours de Pierre Mari (Fayard). Le Salut par les Juifs de Léon Bloy (Mercure de France).
Le Salut par les Juifs de Léon Bloy (Mercure de France). Les saisons de Giacomo de Mario Rigoni Stern (Flammarion, coll. Pavillons poche).
Les saisons de Giacomo de Mario Rigoni Stern (Flammarion, coll. Pavillons poche). Le Sang du Pauvre de Léon Bloy (Mercure de France).
Le Sang du Pauvre de Léon Bloy (Mercure de France). La Folle Semence d'Anthony Burgess (Éditions du Rocher, coll. Motifs).
La Folle Semence d'Anthony Burgess (Éditions du Rocher, coll. Motifs). Le Grand Coucher de Guy Dupré (Éditions de La Table Ronde, coll. La petite vermillon).
Le Grand Coucher de Guy Dupré (Éditions de La Table Ronde, coll. La petite vermillon). Méditations d'un solitaire en 1916 de Léon Bloy (Mercure de France).
Méditations d'un solitaire en 1916 de Léon Bloy (Mercure de France). Ultramarine de Malcolm Lowry (Gallimard, coll. L'Imaginaire).
Ultramarine de Malcolm Lowry (Gallimard, coll. L'Imaginaire). Un jeune mort d'autrefois. Tombeau de Jean-René Huguenin de Jérôme Michel (Pierre-Guillaume de Roux).
Un jeune mort d'autrefois. Tombeau de Jean-René Huguenin de Jérôme Michel (Pierre-Guillaume de Roux). L'Orange mécanique d'Anthony Burgess (Flammarion, coll. Pavillons).
L'Orange mécanique d'Anthony Burgess (Flammarion, coll. Pavillons). Nous, fils d'Eichmann de Günther Anders (Payot & Rivages).
Nous, fils d'Eichmann de Günther Anders (Payot & Rivages). Souvenirs du futur de Sigismund Krzyzanowski (Verdier).
Souvenirs du futur de Sigismund Krzyzanowski (Verdier). Le retour de Münchhausen de Sigismund Krzyzanowski (Verdier).
Le retour de Münchhausen de Sigismund Krzyzanowski (Verdier). Les Veilles de Bonaventura (José Corti, coll. Romantiques).
Les Veilles de Bonaventura (José Corti, coll. Romantiques).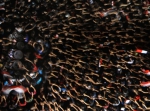 LTI, la langue du Troisième Reich de Victor Klemperer (Presses Pocket, coll. Agora).
LTI, la langue du Troisième Reich de Victor Klemperer (Presses Pocket, coll. Agora). Masante de Wolfgang Hildesheimer (Verdier).
Masante de Wolfgang Hildesheimer (Verdier). Le Chemin des morts de François Sureau (Gallimard).
Le Chemin des morts de François Sureau (Gallimard). L'Âme de Napoléon de Léon Bloy (Mercure de France).
L'Âme de Napoléon de Léon Bloy (Mercure de France). Les Premiers Rois de Norvège de Thomas Carlyle (Le Félin).
Les Premiers Rois de Norvège de Thomas Carlyle (Le Félin). Austerlitz de W. G. Sebald (Gallimard).
Austerlitz de W. G. Sebald (Gallimard). La venue d'Isaïe de László Krasznahorkai (Cambourakis).
La venue d'Isaïe de László Krasznahorkai (Cambourakis). L'Ange des ténèbres d'Ernesto Sábato (Seuil).
L'Ange des ténèbres d'Ernesto Sábato (Seuil). Guerre et Guerre de László Krasznahorkai (Cambourakis).
Guerre et Guerre de László Krasznahorkai (Cambourakis).Nullités.
 Tout autre. Une confession de François Meyronnis (Gallimard, coll. L'Infini).
Tout autre. Une confession de François Meyronnis (Gallimard, coll. L'Infini). Magma de Lionel-Édouard Martin (Publie.net).
Magma de Lionel-Édouard Martin (Publie.net). La France Orange mécanique de Laurent Obertone (Éditions Ring).
La France Orange mécanique de Laurent Obertone (Éditions Ring). Traum. Philip K. Dick, le martyr onirique d'Aurélien Lemant (Éditions Le Feu sacré).
Traum. Philip K. Dick, le martyr onirique d'Aurélien Lemant (Éditions Le Feu sacré). Les Renards pâles de Yannick Haenel (Gallimard).
Les Renards pâles de Yannick Haenel (Gallimard). La Conjuration de Philippe Vasset (Fayard).
La Conjuration de Philippe Vasset (Fayard). Plonger de Christophe Ono-Dit-Biot (Gallimard).
Plonger de Christophe Ono-Dit-Biot (Gallimard). Georges Bernanos à la merci d'un journaliste, Philippe Dufay (Perrin).
Georges Bernanos à la merci d'un journaliste, Philippe Dufay (Perrin). Les moins de seize ans ou les solitudes pédérastiques de Tonton Gabriel (Julliard).
Les moins de seize ans ou les solitudes pédérastiques de Tonton Gabriel (Julliard). De quoi Richard Millet, Alain Finkielkraut et quelques autres sont-ils le nom ? Sur Richard Millet, De l'antiracisme comme terreur littéraire (Éditions Pierre-Guillaume de Roux), Alain Finkielkraut, L'identité malheureuse (Stock).
De quoi Richard Millet, Alain Finkielkraut et quelques autres sont-ils le nom ? Sur Richard Millet, De l'antiracisme comme terreur littéraire (Éditions Pierre-Guillaume de Roux), Alain Finkielkraut, L'identité malheureuse (Stock). Autobiographie des objets de François Bon ou l'écriture constipée (Seuil).
Autobiographie des objets de François Bon ou l'écriture constipée (Seuil).
30/12/2013 | Lien permanent
Excellences et nullités, une année de lectures : 2014


Rappel
 Excellences et nullités de l'année 2010.
Excellences et nullités de l'année 2010. Excellences et nullités de l'année 2011.
Excellences et nullités de l'année 2011. Excellences et nullités de l'année 2012.
Excellences et nullités de l'année 2012. Excellences et nullités de l'année 2013.
Excellences et nullités de l'année 2013.C'est donc la cinquième fois que je me livre à ce réjouissant exercice consistant à établir, fort sommairement mais de façon frappante voire choquante je l'espère, une liste des livres* excellents ou nuls parus ou lus / relus au cours de cette année 2014. Il va de soi, comme toujours d'ailleurs, que les excellences sont plus nombreuses, heureusement, que les nullités, sans doute parce que je n'ai point lu ou relu, cette année, des livres de Lionel-Édouard Martin, Antoni Casas Ros, Yannick Haenel et son frère jumeau à la mode sollersienne, François Meyronnis.
* Ne figurent dans cette liste, bien sûr, que les livres que j'ai lus, Pierre Mari ou Gregory Mion ayant évoqué des ouvrages remarquables ou mauvais.
Excellences.
 Théologie de l'histoire et crise de civilisation de Juan Donoso Cortès (Le Cerf).
Théologie de l'histoire et crise de civilisation de Juan Donoso Cortès (Le Cerf). Benito Cereno de Herman Melville (Flammarion, coll. GF).
Benito Cereno de Herman Melville (Flammarion, coll. GF). Des cités détruites au monde inaltérable de Max Picard (Plon).
Des cités détruites au monde inaltérable de Max Picard (Plon). Vertiges de W. G. Sebald (Actes Sud).
Vertiges de W. G. Sebald (Actes Sud). Le drame du présent. Les Modérés d'Abel Bonnard (Grasset).
Le drame du présent. Les Modérés d'Abel Bonnard (Grasset). Le Grand Souffle de Robert Penn Warren (Stock).
Le Grand Souffle de Robert Penn Warren (Stock). Les Émigrants de W. G. Sebald (Actes Sud).
Les Émigrants de W. G. Sebald (Actes Sud). Cette sombre ferveur (Lettres à Didier, II) de Vincent La Soudière (Cerf).
Cette sombre ferveur (Lettres à Didier, II) de Vincent La Soudière (Cerf). Le Soulèvement contre le monde secondaire de Botho Strauss (L'Arche).
Le Soulèvement contre le monde secondaire de Botho Strauss (L'Arche). L'Apprenti sorcier de Hanns Heinz Ewers (Christian Bourgois).
L'Apprenti sorcier de Hanns Heinz Ewers (Christian Bourgois). Ô mort, où est ta victoire ? À propos de Campo Santo de W. G. Sebald (Actes Sud).
Ô mort, où est ta victoire ? À propos de Campo Santo de W. G. Sebald (Actes Sud). Les mandarins sont revenus, chassez-les ! de Pierre Boudot (Les Provinciales).
Les mandarins sont revenus, chassez-les ! de Pierre Boudot (Les Provinciales). Le danseur et sa corde de Jacques Bouveresse (Agone).
Le danseur et sa corde de Jacques Bouveresse (Agone). La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos (La Table ronde, coll. La Petite Vermillon).
La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos (La Table ronde, coll. La Petite Vermillon). Danube de Claudio Magris (Gallimard, coll. Folio).
Danube de Claudio Magris (Gallimard, coll. Folio). Un Enfant de Dieu de Cormac McCarthy (Le Seuil, coll. Points).
Un Enfant de Dieu de Cormac McCarthy (Le Seuil, coll. Points). Le Quart de Nikos Kavvadias (Gallimard, coll. Folio).
Le Quart de Nikos Kavvadias (Gallimard, coll. Folio). L'Avenue de Paul Gadenne (Gallimard).
L'Avenue de Paul Gadenne (Gallimard). La Politique considérée comme souci de Pierre Boutang (Les Provinciales).
La Politique considérée comme souci de Pierre Boutang (Les Provinciales). Je n'ai aucune idée sur Hitler de Karl Kraus (Agone).
Je n'ai aucune idée sur Hitler de Karl Kraus (Agone). Les Anneaux de Saturne de W. G. Sebald (Actes Sud).
Les Anneaux de Saturne de W. G. Sebald (Actes Sud). Être homme c'est ne pas se contenter. Sur quelques poèmes ésotériques de Fernando Pessoa (Christian Bourgois).
Être homme c'est ne pas se contenter. Sur quelques poèmes ésotériques de Fernando Pessoa (Christian Bourgois). Vie de Rancé de Chateaubriand (Flammarion, coll. GF).
Vie de Rancé de Chateaubriand (Flammarion, coll. GF). Le signe secret entre Carl Schmitt et Jacob Taubes (Rivages Poche, coll. Petite Bibliothèque).
Le signe secret entre Carl Schmitt et Jacob Taubes (Rivages Poche, coll. Petite Bibliothèque). Ernst Bloch et Jacob Taubes (Les Prairies singulières et L’Éclat).
Ernst Bloch et Jacob Taubes (Les Prairies singulières et L’Éclat).
 Le Verbe nu. Méditation pour la fin des temps d'Armel Guerne (Seuil).
Le Verbe nu. Méditation pour la fin des temps d'Armel Guerne (Seuil). Le Langage de Fritz Mauthner (Bartillat).
Le Langage de Fritz Mauthner (Bartillat). La Persuasion et la Rhétorique de Carlo Michelstaedter (L’Éclat).
La Persuasion et la Rhétorique de Carlo Michelstaedter (L’Éclat).Nullités
 Apocalypses sans royaume de Jean-Paul Engélibert (Garnier).
Apocalypses sans royaume de Jean-Paul Engélibert (Garnier). La monnaie des défaites : Renaud Camus, Richard Millet, cœurs brûlants dans une fumée de mots.
La monnaie des défaites : Renaud Camus, Richard Millet, cœurs brûlants dans une fumée de mots. Lettre aux Norvégiens sur la littérature et les victimes de Richard Millet (Éditions Pierre-Guillaume de Roux).
Lettre aux Norvégiens sur la littérature et les victimes de Richard Millet (Éditions Pierre-Guillaume de Roux). Le Grand Remplacement suivi de Discours d'Orange de Renaud Camus (chez l'éditeur).
Le Grand Remplacement suivi de Discours d'Orange de Renaud Camus (chez l'éditeur). Méfiez-vous des enfants sages de Cécile Coulon (Viviane Hamy).
Méfiez-vous des enfants sages de Cécile Coulon (Viviane Hamy). Pas pleurer de Lydie Salvayre (Seuil).
Pas pleurer de Lydie Salvayre (Seuil). La Panique identitaire de Joseph Macé-Scaron (Grasset).
La Panique identitaire de Joseph Macé-Scaron (Grasset).
28/12/2014 | Lien permanent
Morteparole de Jean Védrines

 C’est dans la discrétion que Jean Védrines fait mûrir une œuvre romanesque subtile, elliptique, parfois fulgurante, dont le sujet unique est la lente destruction de la parole commise par les «milliers de fabriques à petits chefs illettrés» (p. 166), et l'exposition de l'attitude qu'il convient d'adopter pour lutter contre cet état de fait. L’écriture du sixième roman de l'auteur, qui suit La Belle étoile (paru en 2011), L'Italie la nuit (2008) et Stalag (2004) et que j'avais évoqué dans la Zone, est révoltée, belle, malgré quelques vilains tics qui finissent par devenir obsédants (comme celui de l’inversion : «Un arbre, pourtant, il avait vraiment vu en classe, ses ramures effleurant le plafond» (p. 45)), et en dévoile dès le titre le motif dans le tapis. D’un côté, un langage vivant, enfantin, qui conserve la fraîcheur de «la puissance des premières fois, la lumière violente» (p. 26), une parole vivifiante qui se tient aux côtés de l’élan révolutionnaire, l’accompagne, se rebelle et crie, tel un «très lointain souvenir du Christ rouge» «le pain, un toit, la dignité des pauvres» (p. 90).
C’est dans la discrétion que Jean Védrines fait mûrir une œuvre romanesque subtile, elliptique, parfois fulgurante, dont le sujet unique est la lente destruction de la parole commise par les «milliers de fabriques à petits chefs illettrés» (p. 166), et l'exposition de l'attitude qu'il convient d'adopter pour lutter contre cet état de fait. L’écriture du sixième roman de l'auteur, qui suit La Belle étoile (paru en 2011), L'Italie la nuit (2008) et Stalag (2004) et que j'avais évoqué dans la Zone, est révoltée, belle, malgré quelques vilains tics qui finissent par devenir obsédants (comme celui de l’inversion : «Un arbre, pourtant, il avait vraiment vu en classe, ses ramures effleurant le plafond» (p. 45)), et en dévoile dès le titre le motif dans le tapis. D’un côté, un langage vivant, enfantin, qui conserve la fraîcheur de «la puissance des premières fois, la lumière violente» (p. 26), une parole vivifiante qui se tient aux côtés de l’élan révolutionnaire, l’accompagne, se rebelle et crie, tel un «très lointain souvenir du Christ rouge» «le pain, un toit, la dignité des pauvres» (p. 90).Jean Védrines est du côté de Bernanos lorsqu'il écrit : «Même si je reste persuadé qu'une poignée d'entre nous, l'élite de chaque génération, réussit à sauver l'enfant qu'il fut, à le garder du monde, des autres, de la bêtise adulte, puissante et arrivée. Mais c'est secret, enfoui au tréfonds, on n'en perçoit pas de signe visible, rien sur le visage qui trahisse que le gamin, le huit, neuf ans, est dissimulé là-dedans, a pris le cœur, les sentiments, et le reste, âme, esprit, idée [...]. C'est la position sociale souvent qui va révéler cette folie, cet enfermement dans l'enfance : le renoncement au travail, le dénuement, la pauvreté qui mène à l'hôpital, sous les ponts. Ou à la vie violente, sacrifiée» (pp. 23-4).
De l’autre, un langage mourant, mort à vrai dire, celui des Maîtres, des vieillards, de ce pitoyable et si médiocre Bec-Amer, «rebut de mots techniques, pesants et grossiers» qui ne peut que détester la «parole brûlée» (p. 95) qui fut un temps celle de l’ami de Giovan, le héros de L’Italie la nuit, Paul, avant qu’il ne sombre dans la grisaille professorale et n’oublie «les histoires riches et girondes comme des filles, les corps à détours, replis et secrets. La littérature, en somme, les délices» (p. 100). Il s’agit ainsi de se convertir à la Parole, «à la beauté du Verbe, au seul deuxième monde auquel nous avons à coup sûr accès» (p. 102), et de fustiger la «prose rabougrie» (p. 104) empestant «la morgue, le formol» (p. 106) des contrôleurs et ergoteurs qui pullulent. Cette conversion est une conquête ou plutôt, une reconquête, afin de retrouver la «parole enfantine», «une emprise infinie sur la beauté du monde» (p. 134). Dans ce roman qui n’est qu’un long cri de colère et peut se lire comme la geste de tout homme aux prises avec l’injustice, Giovan est le nécessiteux, alors que tout est facile, donné à Paul, les bonnes notes puis les belles femmes. L’un doit lutter pour rester pur, reconquérir la langue sonnant pouilleuse de ses ancêtres, conquérir la française, et cela alors même, nous confie Jean Védrines, que nos forces s'épuisent et que la chute paraît s'accélérer (cf. p. 136), l’autre s'abaisse, délaisse les images «tracées comme à la cendre, à la suie, sur la pierre des falaises, des cavernes» (p. 136), et nous ne savons à vrai dire, des deux hommes, qui sauvera sa vie et son âme par une fidélité aimante à la parole vivante.
Une version plus courte de cette note de lecture a paru dans le numéro de la revue Études du mois de novembre, dont voici le sommaire.
31/10/2014 | Lien permanent
Excellences et nullités, une année de lectures : 2016

Rappel
 Excellences et nullités de l'année 2010.
Excellences et nullités de l'année 2010. Excellences et nullités de l'année 2011.
Excellences et nullités de l'année 2011. Excellences et nullités de l'année 2012.
Excellences et nullités de l'année 2012. Excellences et nullités de l'année 2013.
Excellences et nullités de l'année 2013. Excellences et nullités de l'année 2014.
Excellences et nullités de l'année 2014. Excellences et nullités de l'année 2015.
Excellences et nullités de l'année 2015.Exceptionnellement, l'une des nullités ne concerne pas, cette année, un ouvrage, mais une attitude, l'attitude de la fille d'un homme qui fut un grand éditeur, l'attitude abjecte, irresponsable et surtout profondément inculte de la nouvelle patronne de L'Âge d'Homme, une maison d'édition naguère courageuse et intelligente et aujourd'hui littéralement ridiculisée par la connerie rageuse, la rage imbécile (il n'y a pas d'autre mot) d'une femme qui dilapide un héritage remarquable, l'héritage des lecteurs que nous sommes.
Excellences
 Histoire d'un Allemand de Sebastian Haffner (Actes Sud/Babel).
Histoire d'un Allemand de Sebastian Haffner (Actes Sud/Babel). Les Réprouvés d'Ernst von Salomon (Bartillat).
Les Réprouvés d'Ernst von Salomon (Bartillat). La Religion perverse. Essai sur le charisme, de Jean-Luc Evard (Le Rocher).
La Religion perverse. Essai sur le charisme, de Jean-Luc Evard (Le Rocher). Moravagine de Blaise Cendrars (Grasset/Les Cahiers rouges).
Moravagine de Blaise Cendrars (Grasset/Les Cahiers rouges). Au nom du père de Christian Guillet (L'Âge d'Homme).
Au nom du père de Christian Guillet (L'Âge d'Homme). Les Manœuvres d'automne de Guy Dupré (Bartillat/Omnia).
Les Manœuvres d'automne de Guy Dupré (Bartillat/Omnia). Contre les Français de Manuel Arroyo-Stephens (Exils).
Contre les Français de Manuel Arroyo-Stephens (Exils). Orages d'acier d'Ernst Jünger (Le Livre de Poche).
Orages d'acier d'Ernst Jünger (Le Livre de Poche). Le grenier de Bolton Lovehart de Robert Penn Warren (Chambon/Le Rouergue).
Le grenier de Bolton Lovehart de Robert Penn Warren (Chambon/Le Rouergue). La Symphonie des spectres de John Gardner (Points/Signatures).
La Symphonie des spectres de John Gardner (Points/Signatures). De la désintégration des formes dans l'art moderne de Max Picard (E. Vitte/Parvis).
De la désintégration des formes dans l'art moderne de Max Picard (E. Vitte/Parvis). Jeanne d'Arc et l'Allemagne de Léon Bloy (Jérôme Millon/Atopia).
Jeanne d'Arc et l'Allemagne de Léon Bloy (Jérôme Millon/Atopia). Je ne pense plus voyager de François Sureau (Gallimard/NRF).
Je ne pense plus voyager de François Sureau (Gallimard/NRF). Le Cœur aventureux d'Ernst Jünger (Gallimard).
Le Cœur aventureux d'Ernst Jünger (Gallimard). Le secret de René Dorlinde de Pierre Boutang (La Différence).
Le secret de René Dorlinde de Pierre Boutang (La Différence). Parade sauvage de Jean-Jacques Salgon (Verdier).
Parade sauvage de Jean-Jacques Salgon (Verdier). Le Territoire de l'homme d'Elias Canetti (Le Livre de poche/Biblio).
Le Territoire de l'homme d'Elias Canetti (Le Livre de poche/Biblio). Le Grand d'Espagne de Roger Nimier (Gallimard/Folio).
Le Grand d'Espagne de Roger Nimier (Gallimard/Folio). Une génération perdue de Maurizio Serra (Seuil).
Une génération perdue de Maurizio Serra (Seuil). Quelques pistes bloyennes de recherche sur Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos (Gallimard/La Pléiade, édition de Béguin, Picon et Estève).
Quelques pistes bloyennes de recherche sur Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos (Gallimard/La Pléiade, édition de Béguin, Picon et Estève). Narthex de Marien Defalvard (Exils).
Narthex de Marien Defalvard (Exils). Lancelot de Walker Percy (J'ai Lu).
Lancelot de Walker Percy (J'ai Lu). La mort d'Artemio Cruz de Carlos Fuentes (Gallimard/Folio).
La mort d'Artemio Cruz de Carlos Fuentes (Gallimard/Folio). «De nouveau l’âme vacille». Sur Océan et Brésil d’Abel Bonnard (Flammarion).
«De nouveau l’âme vacille». Sur Océan et Brésil d’Abel Bonnard (Flammarion). Les Déracinés de Maurice Barrès (Bartillat/Omnia).
Les Déracinés de Maurice Barrès (Bartillat/Omnia).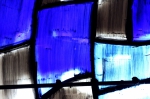 Le Siècle des Lumières d'Alejo Carpentier (Gallimard/Folio).
Le Siècle des Lumières d'Alejo Carpentier (Gallimard/Folio).Nullités
 Naufrage d'un prophète. Heidegger aujourd'hui de François Rastier (PUF).
Naufrage d'un prophète. Heidegger aujourd'hui de François Rastier (PUF). La (seule) librairie française des Éditions L'Âge d'Homme est-elle morte d'une indigestion de cuisine végane ? (L'Âge d'Homme, ou ce qu'il en reste).
La (seule) librairie française des Éditions L'Âge d'Homme est-elle morte d'une indigestion de cuisine végane ? (L'Âge d'Homme, ou ce qu'il en reste). Jacques Fesch. Mystique public n°1 de Mireille Cassin (Cerf).
Jacques Fesch. Mystique public n°1 de Mireille Cassin (Cerf). Les Événements de Jean Rolin (POL).
Les Événements de Jean Rolin (POL). Armel Guerne l'annonciateur de Charles Le Brun et Jean Moncelon (Pierre-Guillaume de Roux).
Armel Guerne l'annonciateur de Charles Le Brun et Jean Moncelon (Pierre-Guillaume de Roux). La littérature sans idéal de Philippe Vilain (Grasset).
La littérature sans idéal de Philippe Vilain (Grasset). Les Verticaux de Romaric Sangars (Léo Scheer).
Les Verticaux de Romaric Sangars (Léo Scheer). Guerilla de Laurent Obertone (Ring).
Guerilla de Laurent Obertone (Ring).
30/12/2016 | Lien permanent

























































